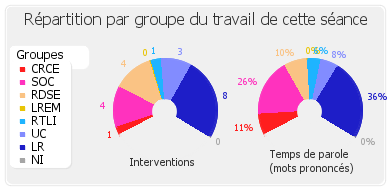Séance en hémicycle du 16 mai 2013 à 9h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France.
J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe UMP, de la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (proposition n° 546 rectifié bis [2011-2012], texte de la commission n° 520, rapport n° 519).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les marées noires ont été nombreuses, trop nombreuses, depuis la catastrophe du Torrey Canyon, en 1967. Elles se sont même enchaînées : l’Amoco Cadiz en 1978, le Gino en 1979, le Tanio en 1980, l’Exxon Valdez en 1989, l’Erika le 23 décembre 1999 et le Prestige en 2002.
À chaque fois, ces catastrophes donnent lieu à des drames. Le naufrage de l’Erika, ce sont 400 kilomètres de littoral et les sept dixièmes des côtes vendéennes souillés, des oiseaux mazoutés, des paysages marins défigurés, sans compter les dégâts économiques et la désespérance de ceux qui travaillent grâce à la mer.
À chaque fois, ce sont les mêmes souffrances, de longues procédures à l’issue incertaine, et aussi la même antienne : plus jamais ça !... jusqu’à la fois suivante, malheureusement.
S’agissant de l’affaire de l’Erika, j’ai suivi chaque étape de ce long parcours juridique – je dirai même de ce combat ! –, qui a duré treize années et s’est révélé, jusqu’à son terme, aléatoire. Je vous rappelle que les conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation ont failli ruiner les avancées obtenues au fond, les juges de première instance et d’appel ayant précédemment retenu l’existence d’un « préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands ».
C’est parce que j’ai vécu, avec d’autres, ces hésitations, et aussi parce que le temps paraît venu de consacrer dans le code civil la notion de préjudice écologique, que nous avons décidé de déposer cette proposition de loi.
Avant de présenter succinctement le texte, je voudrais adresser quelques remerciements : je remercie ainsi mes collègues du groupe de l’UMP, qui ont accepté d’inscrire l’examen de ce texte à l’ordre du jour, ainsi que les éminents juristes, qu’ils soient professeurs d’université ou conseillers d’État, qui m’ont aidé et soutenu dans cette démarche.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement le rapporteur, Alain Anziani, qui a réalisé, en collaboration avec le président et les membres de la commission des lois, un très beau travail. Nous avions déjà collaboré dans le cadre de la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia. Voilà quelques jours, préparant mon intervention, je me faisais la réflexion que c’étaient les catastrophes qui nous rapprochaient, monsieur le rapporteur, alors même que nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques.
Il est d’ailleurs heureux que, à l’occasion de l’examen d’un tel texte, nous puissions nous retrouver, au-delà des clivages partisans, pour travailler dans l’intérêt général, celui-là même qui nous commande, en l’occurrence, de faire avancer la cause du préjudice écologique et de la protection de l’environnement dans notre droit.
Le point de départ de cette démarche est l’affaire de l’Erika, qui a donné lieu, je le disais, à treize années d’un combat juridique auquel ont participé de nombreuses parties civiles, qu’il s’agisse de communes, de départements, de régions ou de nombreuses associations de protection de l’environnement.
Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un grand arrêt, sans doute historique, aux termes duquel elle a consacré l’existence d’un préjudice écologique consistant en « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement ».
Le préjudice écologique présente donc désormais un double caractère, à la fois objectif et collectif : ce préjudice est objectif en ce qu’il atteint un objet plutôt qu’un sujet, la nature n’étant pas un sujet de droit, et collectif en ce qu’il ne vise pas une personne.
En réalité, cet arrêt a suivi d’une année une décision importante d’une autre très haute juridiction, le Conseil constitutionnel, qui, le 8 avril 2011, avait ouvert la voie de deux façons : tout d’abord, en affirmant qu’un devoir de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement s’imposait à tous ; ensuite, en retenant la possibilité d’une action en responsabilité.
Mes chers collègues, la question qui se posait était la suivante : à partir du moment où deux de nos plus hautes juridictions, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, avaient reconnu l’existence de cette notion juridique de préjudice écologique – je parle bien là d’un préjudice écologique pur, autonome, distinct de ceux, traditionnels, que sont les préjudices matériel et moral –, fallait-il aller plus loin en ouvrant le code civil à celle-ci ? Et si oui, comment procéder ?
J’avais initialement proposé d’inscrire cette nouvelle disposition dans le fameux article 1382 qui, comme l’indique M. Anziani dans son rapport écrit, est un « monument du droit », une sorte de totem, puisqu’il s’agit du texte fondateur du régime de la responsabilité civile.
Pour ne choquer personne, et tout en poursuivant néanmoins le même objectif, nous avons déplacé l’inscription du préjudice écologique dans un titre IV ter, intitulé « De la responsabilité du fait des dommages à l’environnement », spécifiquement créé à cette fin, comme nous le verrons dans quelques instants.
Pourquoi fallait-il ouvrir le code civil au préjudice écologique ? Fondamentalement, pour trois raisons.
La première tient au fait que le code civil est en quelque sorte un chaînon manquant, la clef de voûte faisant encore défaut à l’édifice juridique qui s’est construit, notamment en France par la voie jurisprudentielle, et qui vise à protéger l’environnement en sanctionnant les atteintes qui y sont portées.
Cet édifice s’est construit en France, mais aussi au niveau international.
S’agissant du niveau international, je citerai les grands sommets internationaux consacrés à la protection de l’environnement, comme ceux de Stockholm, de Rio et de Johannesburg. Le principe 13 de la Déclaration de Rio demandait ainsi aux États d’« élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour des dommages à l’environnement ».
Au niveau européen, l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le TFUE, nous rappelle, en posant le principe pollueur-payeur, que l’environnement est un bien précieux.
En outre, la directive de 2004, que nous avons transposée dans la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, dite loi LRE, représentait une avancée, même si cette dernière, très insuffisante, s’est révélée depuis lors largement inopérante pour deux raisons : premièrement, son champ d’application extrêmement limité exclut nombre de faits générateurs et de cas de figure ; deuxièmement, ce texte institue un régime de police administrative centré sur le préfet, et non un régime de responsabilité.
Cet édifice s’est également construit au niveau national, avec la constitutionnalisation en 2007 de la Charte de l’environnement.
Nous ne devons donc pas nous étonner, mes chers collègues, que l’ensemble des réflexions et travaux menés sur le sujet, ainsi que les conclusions des groupes de travail et des divers rapports y afférents, convergent tous dans le même sens : la nécessité d’inscrire dans le code civil la notion de préjudice écologique. C’était ainsi le cas dans le rapport Catala en 2006, dans le rapport Lepage en 2008, dans le rapport Terré en 2011 et dans le rapport de la commission Environnement du Club des juristes en 2011, sur lequel mes travaux sont fondés.
Je sais aussi que vous avez institué au sein de votre ministère, madame le garde des sceaux, un groupe de travail ayant pour mission d’inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil.
Il y a donc bien là la force d’une logique, d’une cohérence.
La deuxième raison de la nécessité d’une ouverture du code civil au préjudice écologique tient aux difficultés spécifiques de la responsabilité civile à saisir et à appréhender la notion de préjudice écologique pur.
Je tiens d’ailleurs à faire observer que ce sont précisément ces difficultés qui peuvent expliquer les hésitations de la jurisprudence depuis une dizaine d’années, et parfois même ses contradictions.
Cela peut enfin expliquer qu’il s’en soit fallu de peu, dans l’affaire de l’Erika, pour que, comme le préconisait dans ses conclusions l’avocat général près la Cour de cassation, le préjudice écologique ne soit purement et simplement évincé au profit d’autres notions, sans doute plus traditionnelles et orthodoxes sur le plan du droit mais qui auraient été profondément injustes.
Quelles sont les difficultés de la responsabilité civile traditionnelle à saisir la notion de préjudice écologique ?
La première est importante. Les civilistes qui siègent dans cet hémicycle savent que, traditionnellement, un dommage est réparable dès lors qu’il concerne une personne.
Le dommage écologique est une atteinte à la nature. Or celle-ci n’est ni un bien personnel ni une personne, mais un bien commun, collectif. Là se pose la première difficulté, qui est importante.
La nature n’étant pas une personne, le dommage qui lui est causé n’atteint personne. Or si personne n’est victime, une responsabilité peut-elle être engagée ? C’est ce type d’enchaînement juridique qu’il s’agit de traiter et de dénouer !
Deuxième difficulté, les préjudices écologiques sont souvent des préjudices premiers, dans le sens où ils entraînent d’autres préjudices que la responsabilité civile connaît bien, car ils sont traditionnels.
Il peut ainsi s’agir d’un préjudice matériel : c’est le cas lorsqu’un port ou des espaces naturels, qui sont par exemple la propriété d’un département, sont pollués par une marée noire.
Il peut aussi s’agir d’un préjudice moral, notamment en cas d’atteinte à l’image d’une région entraînant des perturbations pour les professionnels du tourisme concernés.
La jurisprudence montre bien que les juges, ne trouvant pas dans le droit positif l'outil approprié, se sont saisis du préjudice écologique par une voie détournée, en essayant d'appréhender les deux autres préjudices que je viens de citer et que l’on peut qualifier de préjudices seconds ou dérivés. Cet enchevêtrement de préjudices pose deux problèmes : d'une part, il rend beaucoup plus complexe la reconnaissance de l'autonomie conceptuelle, voire notionnelle, du préjudice écologique ; d'autre part, il est la cause d'une autre confusion en matière de réparation.
La troisième difficulté tient à l’inadaptation des deux principes traditionnels dans ce cas, inadaptation qui justifie à elle seule une modification du code civil.
Il s’agit tout d’abord du principe de liberté du juge : celui-ci dispose en effet d'un véritable pouvoir d'appréciation pour décider si la réparation d'un dommage se fait en nature ou en argent.
Il s’agit ensuite du principe de non-affectation des indemnités, c'est-à-dire des dommages et intérêts, à un usage particulier.
L’application de ces deux principes au préjudice écologique comporte un double risque.
Il y a en premier lieu un risque de détournement de l’indemnité réparatrice, laquelle peut se voir affectée à une autre destination qu’à la réparation du dommage causé dans la mesure où le titulaire de l'action devant les tribunaux est un tiers et non la nature elle-même, cette dernière n'étant pas une personne.
Il faut envisager en second lieu le risque, plus traditionnel – on en trouve un certain nombre de cas dans la jurisprudence –, de la redondance de la réparation ou au contraire de son caractère partiel. Ainsi, il peut y avoir redondance, lorsque le juge indemnise plusieurs associations pour un même préjudice, comme, à l'inverse, caractère partiel, lorsque le juge se contente d'une indemnité unique pour réparer des préjudices qui sont multiples, c'est-à-dire à la fois d’ordre matériel, écologique ou moral.
C'est pour prévenir ces difficultés que le texte prévoit une réparation prioritairement en nature. Celle-ci est plus juste parce qu’elle permet une remise en l'état initial. Elle est également plus efficace, parce qu’elle supprime la cause d'autres préjudices, notamment de préjudices dérivés.
Je tiens à remercier une fois encore le rapporteur de son action. Les travaux de la commission des lois ont permis de compléter le dispositif, en prévoyant non seulement des mesures permettant de se substituer à l’indemnisation en nature lorsque celle-ci est impossible, mais également un dispositif de vigilance et de prévention, qui répond précisément à l'injonction du Conseil constitutionnel dans sa décision du mois d'avril 2011.
Ces ajouts me semblent extrêmement judicieux. Il est ainsi proposé d'adapter le régime de réparation et de s'écarter du droit commun de la réparation.
Il s’agit tout d’abord de remplacer le principe de liberté du juge par un principe de hiérarchie : la réparation se fait prioritairement en nature, sans exclure les indemnités ni les dommages et intérêts.
Il s’agit ensuite de substituer au principe de liberté d'usage des dommages et intérêts une possibilité d'affectation à la restauration de l'environnement.
Enfin, une troisième raison, de nature symbolique, justifie l’introduction du préjudice écologique dans le code civil. Comme vous le savez, madame le garde des sceaux, le symbole est important en politique : il est ce qui relie, ce qui donne du sens.
Mme le garde des sceaux acquiesce.

L'histoire de l'émergence du préjudice écologique est celle de la lente, parfois trop lente, prise en considération d'un bien collectif : la nature, entendue comme patrimoine naturel. Les éléments qui la composent relèvent de l'article 714 du code civil : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. » On ne saurait mieux dire ! Nous sommes véritablement là au cœur du sujet. Si, comme l'a si bien écrit le professeur de droit Yves Gaudemet, le code civil est la « constitution de la société civile française », mettre cette constitution civile en harmonie avec la constitution politique de notre pays aurait une portée éminemment symbolique.
Vous le voyez, mes chers collègues, la reconnaissance du préjudice écologique par la jurisprudence ne doit pas être une raison, voire une excuse, pour ne rien faire et ne pas légiférer. Selon la formule de Victor Hugo, il faut faire entrer le droit dans la loi, en l'occurrence légaliser la jurisprudence. Il appartient désormais au législateur que nous sommes de consolider ce qu'ont fait les juges. Nous devons nous y employer pour enrichir le code civil, qui ancre traditionnellement la protection de l'homme dans les seuls droits individuels, en y ajoutant une double dimension, collective et de long terme. Nous devons également nous y consacrer pour affirmer haut et fort qu'une écologie humaine est possible et qu'elle peut trouver sa traduction dans le droit.
Je terminerai en citant l'éminent professeur de droit, François Guy Trébulle. Agir ainsi serait également une manière de rappeler que, « face à l'individualisme triomphant de nos sociétés contemporaines, l'environnement est l'un des rares domaines dans lequel le bien commun, objectif et collectif, apparaît consensuel ». §

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, voilà maintenant treize ans, le navire Erika, pétrolier chargé de fioul lourd affrété par la société Total, faisait naufrage au large des côtes de la Bretagne, causant des dommages considérables : 400 kilomètres de littoral souillé, 150 000 oiseaux retrouvés morts, 18 tonnes de fioul et 8 tonnes de produits cancérigènes déversées dans la mer.
Il a fallu attendre treize ans – mais c'est le temps de la justice – pour que la Cour de cassation rende un arrêt très musclé sur le plan des sanctions. En effet, non seulement une amende maximale a été retenue – 375 000 euros –, mais la société Total a été condamnée à verser des dommages et intérêts importants – 200 millions d'euros – aux différentes parties civiles, l'État, les collectivités territoriales, les associations.
Cependant, une fois rendu, cet arrêt Erika, loin de clore le sujet, ouvre une discussion dont Bruno Retailleau a parfaitement résumé l’enjeu : à quel titre la Cour de cassation, juridiction la plus éminente, a-t-elle accordé cette indemnisation ? A-t-elle réparé un préjudice personnel ? On comprend que cela ne puisse pas être le cas, en tout cas pour une partie du préjudice. Il s'agit en effet non pas d'un préjudice matériel ou moral, mais bien plutôt d’un préjudice d'image pour les collectivités territoriales.
Par le truchement de cette affaire, la Cour de cassation pose implicitement – mais elle ne pouvait faire autrement – la question de l’existence d’un préjudice distinct des préjudices que nous connaissons aujourd'hui en matière de responsabilité. En d’autres termes, peut-on concevoir un préjudice écologique pur ? Certes, cette notion peut sembler un peu abstraite, mais elle concerne tout préjudice subi non par une personne physique ou morale, mais par la nature elle-même.
L’exemple de l’ourse Cannelle, unique spécimen d’une espèce protégée dans les Pyrénées, exemple que j’évoque souvent et qui peut faire sourire, est à mon sens la meilleure illustration qui soit. Lorsqu’un chasseur a abattu ce plantigrade, il a provoqué la disparition de l’espèce tout entière. Le préjudice n'est donc pas subi par les villageois, pas plus que par les associations de tourisme qui pouvaient se prévaloir de l'existence de cet animal dans leur patrimoine ; il est subi par l'environnement lui-même qui se voit retrancher une espèce de son catalogue naturel. Il s’agit bien là d’un préjudice écologique pur.
La proposition de loi présentée par Bruno Retailleau a le très grand mérite d'essayer de donner un fondement juridique au préjudice écologique.
Comme il l’a souligné, notre relation s'est effectivement nouée dans les catastrophes : hier Xynthia, aujourd'hui Erika. Pour autant, elle n'est pas catastrophique et nous essaierons de faire en sorte qu'elle ne le devienne pas !
Madame la ministre, à ce stade de mon propos, je souhaite vous associer à ce travail. Vous nous avez fait l'honneur de participer au colloque organisé par Bruno Retailleau et auquel j’avais moi-même pris part. Vous avez immédiatement saisi l’enjeu de la question de la responsabilité civile contemporaine et avez mis en place un groupe de travail afin d’apporter une réponse complète.

Cinq questions restent selon moi en chantier.
Premièrement, à la suite de Bruno Retailleau, je m’interroge : tout cela était-il nécessaire ? Pourquoi faut-il modifier le code civil ? Ne disposons-nous pas d'un arsenal juridique suffisant ?
Ainsi, depuis 2004, la Charte de l'environnement est intégrée dans le bloc de constitutionnalité et, depuis la révision constitutionnelle de 2005, l'article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux […] de la préservation de l'environnement ».
En outre, la directive européenne de 2004 sur la responsabilité environnementale a été transposée par la loi du 1er août 2008. Cependant, même si ce texte est excellent, à l'instar de tous ceux qui composent notre droit, il est inappliqué parce qu'inapplicable. En effet, il présente un défaut majeur, celui de dresser la liste des dommages, ce qui revient à exclure ceux qui ne sont pas énumérés. Par conséquent, les préfets, chargés de l'application de ce texte, ne l'ont pas mis en œuvre, faute d'avoir pu le faire.
On nous rétorquera que les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil suffisent et que nous n’avons besoin de rien d’autre. Il est vrai qu’ils offrent une réponse très classique.
Par ailleurs, l'arrêt Erika de 2012 indique que le droit actuel n'est pas suffisant. La Cour de cassation pointe la nécessité de consolider les décisions qu’il contient dans le code civil, ce que les spécialistes du droit confirment, même si nous savons qu’il s’agit d’une jurisprudence sur laquelle chacun doit s'aligner.
Il revient donc à la Chancellerie de participer à l’élaboration définitive de cette architecture.
Deuxièmement, où faut-il inscrire ces nouvelles dispositions ?
Une discussion a eu lieu. La proposition de loi s'est voulue révolutionnaire en adjoignant un article 1382-1 à l'article 1382. C'était faire preuve de rationalité que d’agir ainsi, en précisant que celui qui cause un dommage à la nature doit réparation, à l’instar de celui qui cause un dommage à autrui.
Disons-le franchement : cela a fait peur ! Nos éminents juristes ont considéré qu'il y avait là peut-être trop d'audace et qu'il ne fallait toucher à l’article 1382 que d'une main tremblante, pour reprendre une expression parfois critiquée. Peut-être la main avait-elle été ici un peu trop ferme...
Dans leur sagesse, les auteurs de la proposition de loi ont donc fait évoluer cette dernière et retenu l’idée d’adjoindre à la responsabilité délictuelle, à la responsabilité quasi-délictuelle et à la responsabilité du fait des produits défectueux un autre type de responsabilité, la responsabilité environnementale, consacrée à travers un titre spécifique du code civil, le titre IV ter, dans lequel serait notamment inséré un article 1386-19. Tel est aujourd’hui l’objet de notre discussion.
Troisièmement, faut-il restreindre cette responsabilité à la faute ? Cette question est extrêmement délicate, et je me plais à le souligner même si la commission a adopté sur mon initiative un amendement supprimant la référence à la faute, s’agissant de la responsabilité.
Nous savons aujourd’hui que l’activité humaine est par elle-même génératrice d’un certain nombre de dommages qui peuvent être importants. Dès lors, exclure cette activité du champ de la loi n’irait pas dans le sens de l’objectivation croissante du droit de la responsabilité, dont la mise en œuvre ne réclame plus nécessairement une faute, puisque l’on essaie plutôt de réparer le dommage à chaque fois qu’il se produit.
Je reconnais néanmoins que plusieurs questions restent pendantes, notamment celle, extrêmement délicate, de savoir si cette responsabilité peut faire l’objet d’une assurance. Il faudra sans doute s’interroger à l’avenir sur ce qui peut être pris en charge par les assurances, dans quelles conditions et à quel coût.
Si vous me le permettez, mes chers collègues, je dirai que nous devons nous aussi faire preuve, dans ce domaine, de beaucoup de responsabilité !
Pour illustrer cette tendance du droit de la responsabilité à évoluer vers la responsabilité sans faute, je prendrai l’exemple de l’article 4 de la Charte de l’environnement, qui dispose que « toute personne doit contribuer à la réparation du dommage qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ». Je pense que c’est dans cette direction que nous allons.
Nous devrons bien entendu nous adosser à la jurisprudence existante, en posant la condition du caractère réel et certain du dommage et en excluant les dommages mineurs. Il nous faudra aussi réaffirmer notre souci de ne pas empêcher tout développement économique et industriel, comme l’avait d’ailleurs fait avec beaucoup de force M. le président de la commission des lois à l’occasion de nos travaux.
Quatrièmement, quelle réparation faut-il privilégier ? C’est un vaste problème. Initialement, Bruno Retailleau avait envisagé une réparation exclusivement en nature, dont on comprend aisément le sens. Nous avons ajouté subsidiairement une compensation financière de l’État dans la mesure où, parfois, il ne s’agit pas simplement de dépolluer une plage. Si, par exemple, une espèce vient à disparaître, la réparation en nature semble impossible. Dans ce cas, il faut prévoir une compensation financière au moyen de dommages et intérêts dont le montant sera défini par les tribunaux et affecté à un fonds de l’État ou à un organisme désigné par lui.
Enfin, cinquièmement, se posent toutes les questions de procédure. Elles sont liées à mes développements précédents et ne relèvent en principe pas de la loi. Qui aura intérêt à agir ? Qui exercera l’action ? Ces questions sont extrêmement délicates, d’autant que nous savons qu’il y aura, dans nombre de cas, une pluralité d’actions, et que des actions groupées pourront aussi sans doute se manifester. En outre, quel sera le délai de la prescription ? À cet égard, j’avais proposé un amendement, avant de le retirer. Aujourd’hui, l’article L. 152-1 du code de l’environnement prévoit une prescription de trente ans à compter du fait générateur. Or de nombreux spécialistes nous ont alertés sur le fait que, en la matière, le dommage pouvait n’apparaître que des années plus tard. Ainsi, les conséquences de la pollution d’une source peuvent survenir plus de trente ans après la contamination, et la question se pose alors d’une prescription qui courrait seulement à compter de l’apparition du dommage et non pas du fait générateur.
Au-delà de ces interrogations, je voudrais encore une fois me féliciter de l’existence de cette proposition de loi.
Je voudrais dire aussi à Mme la garde des sceaux que le débat n’est pas terminé. J’ai noté la constitution d’un groupe de travail qui devrait rendre ses conclusions à l’automne. Il aura fort à faire car, au fond, le préjudice écologique ressemble à un gisement de droits qui devra être précisé, encadré, enrichi.
Il faudra sans doute, à un moment ou à un autre, débattre à nouveau de ces questions, mais l’impulsion a été donnée par cette proposition de loi, qui constitue assurément une initiative majeure.
Applaudissements.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, il est vrai que M. le rapporteur, M. Retailleau et moi-même nous rencontrons régulièrement depuis quelques mois pour débattre de ce sujet.
J’avais ainsi tenu à intervenir en conclusion du colloque que vous aviez organisé ici même au Sénat, Monsieur Retailleau, et auquel vous aviez vous aussi participé très activement, Monsieur Anziani. Je me souviens de la qualité de vos travaux et des interrogations qui se faisaient déjà jour à l’époque. À cette occasion, j’avais annoncé que j’avais commencé à faire travailler sur le sujet les services de la Chancellerie, lesquels avaient identifié un certain nombre de questions majeures auxquelles il nous faudrait répondre. J’avais également indiqué que, pour ma part, je ne savais pas encore s’il valait mieux prévoir un véhicule de procédure civile permettant de couvrir tous les préjudices, y compris les préjudices sériels – je travaillais encore à l’époque sur le projet de loi relatif à l’action de groupe – ou nous contraindre à travailler strictement sur le préjudice écologique.
Compte tenu de la segmentation et de la spécialisation de notre droit – celle-ci ne me paraît pas être, à terme, une condition d’efficacité –, j’avais alors très clairement exprimé ma préférence pour un véhicule de procédure civile qui permettrait d’englober l’ensemble des préjudices.
J’avais toutefois conscience des difficultés, qui étaient ressorties des consultations que j’avais commencé à mener, et qui tenaient notamment au caractère assez singulier du préjudice écologique.
Cette étape de la réflexion est aujourd’hui derrière nous, puisque le projet de loi relatif à l’action de groupe sera finalement limité au champ de la consommation. C’est sans doute une condition d’efficacité et de rapidité. À long terme, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure formule, mais le fait est qu’il en est ainsi, et que ce texte est le fruit d’un travail extrêmement sérieux mené par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, avec l’appui de la Chancellerie – c’est en effet la grandeur et la servitude du ministère de la justice que d’intervenir sur tous les textes de loi, y compris ceux qui sont portés par d’autres ministères !
À long terme, je le répète, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution pour notre droit, mais, comme le disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts… §Mieux vaut donc faire en sorte que nous ayons dès à présent des outils législatifs, juridiques et judiciaires nous permettant de répondre aux besoins de nos temps.
Vous avez parfaitement raison de considérer qu’il y a urgence à légiférer, messieurs. À l’occasion de ce colloque, je vous avais d’ailleurs promis de revenir vers vous avec un projet de loi. Disons que cette proposition de loi m’oblige à revenir devant vous un peu plus vite que prévu !
Mais c’est avec plaisir que je débats avec vous ce matin, d’autant que je suis convaincue, compte tenu de la qualité du travail fourni pour la rédaction de la proposition de loi et pour l’élaboration du rapport de la commission des lois, que nos échanges seront de très grande qualité.
Vous avez eu l’amabilité, messieurs Retailleau et Anziani, d’indiquer que j’ai installé un groupe de travail chargé de réfléchir à ces questions. Il mobilise trois ministères, dont le mien, bien entendu, et se réunit à la Chancellerie. Il est présidé par le professeur Yves Jégouzo, un publiciste reconnu qui ne restera assurément pas campé sur des positions fermées, mais sera capable d’écouter les différentes sensibilités en présence et les diverses appréciations portées sur le sujet.
Ce groupe de travail interministériel, auquel sont associés le ministère de l’écologie, conduit par Mme Batho, et celui de l’économie et des finances, conduit par M. Moscovici, est composé de personnalités diverses – magistrats, avocats, universitaires et praticiens du droit –, qui ont toutes réfléchi et produit des écrits sur ces questions, et qui ont été chargées de travailler sur des thématiques très précises.
Le groupe de travail fera son miel de vos travaux et du rapport de la commission. Il tirera incontestablement profit de ce débat et, en retour, il me paraît normal que vous puissiez intervenir dans les discussions comme bon vous semble. J’espère aussi que vous me ferez l’honneur d’être présents pour la remise du rapport, fixée au 15 septembre 2013.
Avant la fin de l’année, je reviendrai devant vous avec un projet de loi sur cette question. Nous verrons comment les choses évoluent à la suite du débat d’aujourd’hui.
Vous avez raison de considérer qu’il y a une réelle urgence à légiférer. Le sujet est en effet extrêmement important, mais il est aussi très complexe.
Vous avez eu l’audace, monsieur Retailleau, de nous soumettre une proposition de loi. Vous avez aussi indiqué dans votre intervention que vous n’ignoriez pas que certaines questions techniquement complexes restaient en suspens, et qu’il conviendrait de faire des choix. Il nous faudra avancer sur ces points d’ici à l’examen du projet de loi.
C’est toutefois un fait que, en l’état, notre droit de la responsabilité civile n’est pas approprié pour réparer un préjudice subi par une victime qui est non pas une personne, mais la nature.
Il est donc nécessaire de légiférer et d’introduire dans notre code civil cette notion de préjudice écologique. On dit, un peu trop vite parfois, que la nature a horreur du vide. Des réponses ont en effet d’ores et déjà été apportées. Vous avez rappelé, messieurs Retailleau et Anziani, les dispositions du code de l’environnement et la jurisprudence des deux hautes instances judiciaires que sont le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.
Nous ne sommes donc pas dépourvus de matière. Nous pouvons aussi nous appuyer sur la jurisprudence construite par les juridictions de première et de deuxième instance, qui ont prononcé des jugements et des arrêts, même si ces derniers sont fortement basés sur la notion de troubles anormaux du voisinage, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle n’est pas pleinement satisfaisante.
Le sujet est donc si prégnant que des réponses judiciaires ont déjà été avancées. Il nous faut aujourd’hui apporter une réponse juridique, mais je souhaiterais qu’elle passe plutôt par l’adoption du projet de loi que je vous présenterai, lequel se sera bien entendu enrichi de vos travaux et des conclusions du groupe de travail. Nous serons ainsi contraints de répondre à toutes les questions qui sont encore en suspens et par lesquelles M. le rapporteur a conclu son intervention.
Il reste une difficulté : la définition du préjudice écologique, constitué par l’atteinte aux actifs environnementaux non marchands. C’est une définition relativement générale qui se concilie assez difficilement avec le principe de responsabilité dans notre droit, lequel doit reposer sur un préjudice certain, direct et personnel.
Nous devons donc œuvrer pour concilier ce préjudice, qui est par nature général, avec le principe du préjudice direct, certain et personnel.
C’est ce que vous faites, monsieur Retailleau, au travers de ce texte, dont l’article 1er introduit, avec une grande audace, un titre nouveau dans le code civil.
Comme vous le rappeliez, ainsi que M. Anziani, tout le monde tremble à l’idée de toucher à l’article 1382 du code civil. Il faut dire qu’il est immuable depuis 1804 et que sa rédaction, d’une grande sobriété, est assez époustouflante : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est à la fois sobre et précis.
Cet article a survécu deux siècles, mais est à l’origine d’une abondante jurisprudence.
Le texte proposé par la commission pour l’article 1386-19 du code civil introduit un dommage autonome causé à l’environnement et un principe de responsabilité sans faute. C’est à mon avis l’essentiel. Il faut introduire ce dommage et cette responsabilité sans faute.
Toutefois, si notre droit civil permet depuis deux siècles de réparer les dommages causés à des personnes, trois faits générateurs de responsabilité sont distingués : le préjudice doit relever du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait des choses.
Le premier article de la proposition de loi a un caractère plus général et donc plus imprévisible pour les potentiels auteurs de préjudices. Or, conformément à l’un des principes de la Constitution, le droit doit être prévisible. Mais je ne reviendrai pas sur ce fameux principe, évoqué récemment, afin de ne pas réveiller certains souvenirs, lesquels ne sont d’ailleurs pas désagréables finalement ! §
Les principes de la Constitution, les principes à valeur constitutionnelle, les principes généraux du droit, ainsi que le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, nous obligent à disposer d’un droit prévisible et lisible. Il nous faut donc travailler sur ce point afin de nous assurer que notre droit est bien prévisible et lisible.
Il faut également retenir que, tel que le préjudice aux personnes est défini pour apprécier la responsabilité civile, la protection des personnes est encadrée. Donner une définition plus générale pour la nature aboutirait à faire bénéficier celle-ci d’une protection plus large, plus vaste, que les personnes. A priori, je ne suis pas persuadée qu’il faille le faire.
J’adore les arbres, les rivières et les paysages. Je sais que la nature est vivante, qu’elle nous est indispensable. Je sais que des espèces vivantes ont disparu lorsque la nature a été abîmée, qu’il existe un lien intrinsèque, indéfectible, entre toutes les espèces vivantes, y compris la nôtre, et la nature. J’avoue toutefois que j’éprouve tout de même un tremblement plus fort face aux êtres humains, que j’ai une tendresse plus grande encore, en tout cas plus continue, pour eux. §
Il faut en tout cas accepter que la discussion porte sur des niveaux différents de protection des personnes et, éventuellement, de protection de la nature. Toutefois, s’il n’est pas interdit d’élever le niveau de protection des personnes, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’écart qu’entraînerait l’adoption du texte proposé pour l’article 1386-19 tel qu’il est actuellement rédigé.
Le texte proposé pour l’article 1386-20 est ainsi rédigé : « La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. » L’idée est indiscutablement très belle. Nous en avions d’ailleurs débattu lors du colloque. Toutefois, tel qu’il est rédigé, cet article me paraît lui aussi un peu général : la réparation en nature se conçoit pour des préjudices collectifs causés à la nature ou à l’homme. Pour le reste, je ne sais pas si la réparation en nature est la bonne réponse.
La difficulté – il est dit « prioritairement » et non pas « exclusivement » dans l’article –, c’est que les conditions de cette réparation ne sont pas définies dans le texte, non plus que les modalités d’exécution et de suivi de cette réparation. Or, l’efficacité de notre droit, c’est aussi le respect de ce droit : lorsqu’une décision de justice est prononcée, il faut s’assurer qu’elle sera exécutée. Comment le sera-t-elle ? Le suivi sera-t-il judiciaire ou administratif ?
Nous avons des précédents. D’autres types de dommages sont évidemment causés aux êtres humains. Des fonds d’indemnisation ont été mis en place, des procédures que nous connaissons permettent d’assurer le suivi de la réparation, le respect de son volume et du calendrier. Or le texte que nous examinons aujourd'hui ne prévoit pas de tels mécanismes, et ceux qui existent ne sont pas suffisants, car ils ne peuvent pas être appliqués sans d’autres dispositions.
Il nous faut donc travailler sur un mécanisme général qui couvrirait toutes ces questions : les types de dommages, les conditions et les modalités d’exécution. Ce mécanisme pourrait éventuellement s’articuler avec le code des assurances, par exemple – dans certaines situations, il faudra mobiliser les assurances –, et avec le code de l’environnement.
Comme l’a rappelé M. le rapporteur tout à l’heure, la loi relative à la responsabilité environnementale, transposant la directive européenne de 2004, a permis de mettre en place, sous l’autorité du préfet, autorité strictement administrative, un mécanisme qui retient surtout les préjudices graves, soit un champ relativement restreint. Un ensemble de préjudices en sont donc exclus.
Il est vrai que, selon un principe général de notre droit, on ne traite pas de choses extrêmement mineures. Toutefois, il faut tout de même être en mesure d’estimer le caractère extrêmement mineur d’un préjudice. Je pense donc que nous devons approfondir ces questions pour disposer d’un instrument nous permettant d’y répondre.
Il faut donc travailler davantage sur la définition du dommage et de la réparation. Il faut également définir qui sont celles et ceux ayant vocation à agir : qui pourra estimer le préjudice collectif, le fameux préjudice « pur » ? Qui pourra agir ? Qui pourra prévoir les dommages ? Qui pourra procéder aux réparations, notamment aux réparations en nature ? Dans quelles conditions ? Avec quel encadrement ? Il faut traiter toutes ces questions.
Je le répète, il faut beaucoup d’audace, monsieur Retailleau, pour toucher au code civil, quel que soit le chapitre auquel on s’attaque, et ce compte tenu de la construction très cohérente et structurée de ce code.
De l’audace, vous en avez fait preuve en la circonstance ! Vous avez choisi de ne pas toucher à l’article 1382, que vous avez qualifié de « totem », qualification qui me paraît judicieuse – nombreux sont ceux qui vous auraient sévèrement critiqué si vous aviez touché à ce « monument du droit » –, préférant introduire un titre nouveau, le titre IV ter, composé de quatre articles, les articles 1386-19 et suivants.
Il reste que l’introduction d’un titre nouveau modifie l’équilibre général des titres. En outre, vous prévoyez un régime spécial.
Nous devons donc nous assurer que le nouveau régime spécial de responsabilité que vous souhaitez introduire dans le code civil est compatible avec les principes généraux. Certes, il existe déjà soixante-dix régimes spéciaux, dont certains sont d’ailleurs intégrés au code civil, même si la plupart résultent de lois extérieures.
Ces régimes spéciaux – et vous le savez mieux que quiconque, monsieur Anziani, vous qui avez rédigé avec M. Béteille, en 2009, un excellent rapport d’information relatif à la responsabilité civile – permettent de donner des réponses à des préjudices très particuliers. Toutefois, même si nul n’est censé ignorer la loi, les justiciables ne savent généralement pas forcément de quel régime spécial ils relèvent.
Il existe par exemple un régime spécial pour la responsabilité du fait des produits défectueux, un régime spécial pour la responsabilité des conducteurs de véhicule automobile. Il n’en existe pas en revanche pour les cyclistes, même si des dispositions concernent ces derniers : ainsi, un cycliste titulaire d’un permis de conduire grillant un feu rouge – pour ma part, j’ai un permis de conduire, mais je ne grille pas les feux ! §–, peut voir l’effet porter sur son permis de conduire. Nous ne sommes donc pas, s’agissant des cyclistes, dans une situation de non-droit.
Il existe également un régime spécial pour la responsabilité en matière d’économie numérique.
Si nous avons donc déjà plusieurs régimes spéciaux, nous devons nous interroger sur l’introduction d’un nouveau régime de ce type. L’avantage d’un projet de loi, c’est qu’il contraint à effectuer une étude d’impact. Une telle étude nous permettra d’évaluer tous les aspects de la question et de réfléchir à la nécessaire conciliation entre ce nouveau régime et les différents régimes existants.
Par ailleurs, il faut également réfléchir à la question de l’articulation de cette proposition de loi avec un certain nombre de textes internationaux : je pense par exemple à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conclue à Bruxelles en 1969, qui porte sur la responsabilité des propriétaires de navire transportant des hydrocarbures. Je me demande s’il ne faut pas travailler un peu plus sur cet aspect. Je pense également à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il y a là un potentiel de préjudices et d’impact élevé.
Je le répète, il nous faut à mon avis travailler un peu plus sur l’articulation entre ce texte et les textes internationaux, les directives européennes que nous avons transposées dans notre droit, nos textes nationaux, notamment la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, loi qui transposait une directive européenne de 2004, et le code civil actuel. Une cohérence est en effet nécessaire.
Vous avez indiscutablement effectué un travail de fond et de qualité, mesdames, messieurs les sénateurs. Je serai la dernière à le nier, car je sais toutes les questions que vous vous êtes posées avant, pendant et après le colloque, lesquelles ont permis d’aboutir à cette proposition de loi. Nous ne manquerons pas de faire bon usage de ces travaux.
Compte tenu de la méthode très originale du Sénat, méthode qui consiste, notamment sur les grands sujets d’intérêt général, à travailler sur des bases transpartisanes, les groupes qui se sont impliqués aussi fortement sur cette question vont vraisemblablement voter en faveur de ce texte, même si ce n’est bien sûr pas automatique. Il serait donc aventureux de ma part de vous inviter à rejeter cette proposition de loi… J’attendrai par conséquent le vote avec une grande sérénité.
Je vous confirme simplement que le groupe de travail constitué à ma demande est réellement au travail, que je lui ai demandé de réfléchir à des thématiques portant sur le champ des responsabilités, sur le principe de réparation, sur les modalités de réparation et de contrôle, sur les personnes ayant vocation à agir. En un mot, ce groupe de travail, à qui j’ai demandé des réponses juridiques et techniques précises, a vocation à couvrir la totalité des thématiques que vous avez abordées et que j’ai reprises pour certaines ici. Il remettra son rapport le 15 septembre prochain.
J’ajoute que la direction des affaires civiles et du sceau a déjà produit un travail extrêmement élaboré sur la responsabilité en général et sur notre droit contractuel, en particulier dans la perspective de l’introduction dans le code civil de la notion de préjudice écologique. Ce travail est d’ailleurs à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs. En outre, des séances de travail avec les responsables de cette direction sont possibles si vous le souhaitez : ces fonctionnaires seront en effet heureux de vous présenter le produit de leur travail et de discuter des éléments qu’il reste à élaborer. En votre qualité de parlementaires, vous serez les bienvenus.
Il sera bien entendu de ma responsabilité que soient respectés dans le projet de loi les principes de lisibilité, de prévisibilité et d’efficacité du droit : comme nous y appelle la jurisprudence, nous devrons parvenir à concilier le plus haut niveau de protection des personnes – il peut arriver qu’il y ait des victimes humaines – avec ces principes.
Dans le même temps, nous devrons mettre à la disposition tant des acteurs particulièrement mobilisés par la défense de l’environnement, à savoir les associations, que des entreprises, notamment des très petites, des petites et des moyennes entreprises, déjà fragilisées par un contexte économique difficile, les outils les plus précis pour qu’ils soient en mesure autant que possible d’anticiper l’engagement de leur responsabilité et d’éviter à répondre d’un préjudice écologique.
Pour autant, il nous faut veiller à ce que les grands pollueurs ne puissent contourner la loi. Nous devons faire preuve d’une grande vigilance dans l’écriture du texte afin d’éviter toute faille que des batteries de juristes pourraient utiliser pour éviter à ceux qui polluent avec cynisme ce bien commun qu’est la nature d’être condamnés.
C’est à toutes ces contraintes que nous allons nous plier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, une fois de plus, je vous remercie du travail accompli. Je compte sur vous pour contribuer à améliorer la rédaction du texte gouvernemental au cours des prochains mois et je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver d’ici à la fin de l’année pour débattre de ce nouveau projet de loi.
Applaudissements.

M. Joël Labbé . J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les propos de Mme le garde des sceaux, comme toujours intarissable !
Sourires.

Je voudrais simplement apporter une petite nuance au sujet de la balance entre l’homme et la nature. En réalité, le problème ne se pose pas en termes de choix – vous semblez d’ailleurs en être d’accord, madame la ministre –tant les interactions sont indissociables.
La biodiversité constitue le tissu vivant de la planète, avec deux dimensions inséparables : d’une part, la richesse des formes du vivant et, d’autre part, la complexité et l’organisation des interactions entre toutes les espèces ainsi qu’entre ces dernières et leurs milieux naturels.
La « perte de nature » et les dégâts causés aux écosystèmes risquent d’être irréversibles. Puisque tout doit être quantifié à l’heure actuelle, relevons que, aujourd’hui, la nature rend gratuitement un nombre considérable de services : pollinisation, épuration, paysages, protection contre de nombreux risques... À cet égard, 40 % de l’économie mondiale repose sur ces services, dont hélas ! 60 % sont en déclin.
Ce jour, nous avons enfin l’occasion de débattre, au sein de notre assemblée, de la valeur de la nature en tant que telle et des bénéfices qu’elle apporte, et de considérer la nature autrement que comme une somme d’espaces à maîtriser.
La question des dommages causés à l’environnement et de la réparation du préjudice qui en est la conséquence est donc fondamentale.
Les membres du groupe écologiste tiennent à saluer l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, dont la proposition de loi fait suite aux contentieux soulevés lors du procès de l’Erika.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a reconnu le dommage écologique et a créé la notion jurisprudentielle de « préjudice écologique », afin que ce dernier soit réparé au bénéfice de certaines parties civiles, et ce en parallèle de la reconnaissance classique des préjudices matériels et moraux.
La présente proposition de loi est fondée sur ce jugement. Ses auteurs proposent d’inscrire le préjudice écologique dans le code civil et de le définir comme un préjudice autonome qui implique une réparation.
À ce jour, le texte de référence est la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il est applicable à l’égard de tous les dommages écologiques survenus à partir du 1er mai 2007 ou dont les causes se poursuivent après cette date. Cette directive organise à la fois la prévention accrue et la réparation entière du dommage environnemental, mais ses domaines d’application sont très limités.
La proposition de loi que nous examinons est donc une initiative fort intéressante sur le fond, d’autant que la commission des lois l’a déjà améliorée. En effet, le principe d’une indemnisation d’un préjudice écologique prioritairement en nature, par la remise en l’état initial du milieu affecté, est posé. Pour nous écologistes, il est essentiel, la réparation pécuniaire ne devant intervenir que si la remise en l’état s’avère techniquement impossible.
Pour autant, ce texte n’est qu’un premier pas. De nombreuses questions demeurent en suspens. Comment évaluer le préjudice écologique ? Sur quels fondements juridiques ? Quels sont les titulaires de ce droit à réparation susceptibles de s’en prévaloir ? Comment organiser la réparation ?
Madame le garde des sceaux, vous avez évoqué le fameux groupe de travail interministériel portant sur ces enjeux. Sa tâche est particulièrement nécessaire. Bien sûr, nous le soutenons et nous attendons que tous les acteurs concernés puissent y prendre part. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas déposer d’amendements à cette étape de la discussion.
Le préjudice écologique doit bien s’entendre comme étant la perte ou la dégradation de la biodiversité, des fonctionnalités écologiques et des biens et services – ils sont nombreux – qu’en tire la société, de façon directe et indirecte.
Certes, il y a les pollutions accidentelles spectaculaires, en particulier du littoral, dont les conséquences sont visibles. Je citerai les naufrages de l’Amoco Cadiz, du Torrey Canyon, de l’Erika plus récemment, qui ont définitivement marqué nos littoraux et nos mémoires.

Il en est d’autres beaucoup plus insidieuses, parce que leur effet est différé.
Prenons l’exemple du chlordécone. Il est vrai que les dommages écologiques sont survenus avant le 1er mai 2007, mais la Guadeloupe va devoir supporter fort longtemps – plusieurs générations - les conséquences de l’utilisation de ce produit sur la nature, la biodiversité, la santé, l’économie, l’emploi.
De nombreux Antillais considèrent que cette question constitue un scandale d’État. En effet, si les États-Unis ont stoppé l’utilisation de ce produit dès 1976 et ainsi reconnu son danger, la France a continué à l’utiliser jusqu’en 1990 et les outre-mer ont « bénéficié », si je puis dire, de mesures dérogatoires pour poursuivre son utilisation jusqu’en 1993.
Par ailleurs, alors que l’Union européenne a interdit l’épandage aérien de pesticides par une directive de 2009, la Guadeloupe vient encore de « bénéficier » d’une dérogation d’un an à compter du 29 avril dernier par un arrêté préfectoral. Pourtant, le 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rendu un jugement annulant les dérogations des mois de juillet et d’octobre 2012, considérant que « le préfet de Guadeloupe a insuffisamment évalué la situation et méconnu l’étendue des pouvoirs que lui confère le code rural dans l’intérêt de la santé publique et de la protection de l’environnement ».
Derrière ces dommages causés à la nature, à l’homme, à la biodiversité, à l’emploi, à l’économie, c’est la responsabilité de l’État qui est bien sûr engagée.
La mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement menée l’année dernière par le Sénat, dont le rapporteur était notre collègue Nicole Bonnefoy, nous a suffisamment éclairés pour que nous dénoncions avec force de telles pratiques.
Madame le garde des sceaux, vous avez souligné tout à l’heure que le groupe de travail ferait son miel de nos contributions. Votre remarque me conduit tout naturellement à évoquer les abeilles : qui dédommagera des préjudices qui leur ont été causés par l’utilisation de pesticides ?
Par ailleurs, dans le domaine de la réhabilitation de la qualité de l’eau, qui doit payer le coût de dépollution à la suite du recours aux pesticides ?
Toutes ces observations témoignent de l’importance du travail que compte entreprendre le Gouvernement, mais de l’importance aussi de nos attentes, comme de celles de la société tout entière.
C’est pourquoi nous voterons en faveur de cette proposition de loi, qui constitue, selon nous, une première étape sur le bon chemin.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, on dit bien souvent que la nature a horreur du vide. C’est sans doute vrai, au moins pour ce qui concerne le vide juridique !
Alors que le code civil ne traite pas directement des atteintes qui peuvent être portées à cette même nature, depuis plusieurs années déjà, le juge a fait évoluer la jurisprudence et a permis d’apporter une réponse aux préjudices écologiques.
Or ces sujets ont vocation à prendre de l’ampleur, du fait de la multiplication des atteintes liées à la pression croissante des sociétés humaines sur leur environnement. Toutefois, la jurisprudence est fluctuante et l’absence d’un principe clair fait à ce jour cruellement défaut.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de permettre la réparation d’atteintes portées exclusivement à l’environnement. On parle d’ailleurs parfois de « préjudice écologique pur ». En fait, il convient de distinguer préjudice et dommage. Un dommage est une atteinte objective, tandis qu’un préjudice relève d’un sentiment subjectif, d’un « ressenti » de la victime.
Dans le cas de l’environnement, on s’aperçoit immédiatement qu’il existe une disjonction entre ce qui constituera bientôt un nouveau sujet de droit, l’environnement, et ce « ressenti » de la société et qu’il convient aussi d’appréhender l’intérêt à agir d’une manière différente. En la matière, celui-ci est collectif.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour être réparable, un dommage devait être direct, certain et personnel. Il s’agit donc là d’une petite révolution.
Certes, je le reconnais, les principes posés ici ne viennent pas de nulle part. Un chemin avait déjà été parcouru.
La loi Barnier de 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a permis aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour ce qui concerne les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction à la protection de la nature et de l’environnement.
Depuis 2008, grâce à l’adoption d’un amendement déposé par l’auteur de la présente proposition de loi, les collectivités peuvent exercer ces mêmes droits reconnus à la partie civile pour ce qui concerne les faits portant préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leur compétence. Autrement dit, le fait générateur peut avoir lieu sur un espace public ou privé de la collectivité.
L’inscription de la notion de « préjudice écologique » dans le code civil telle qu’elle nous est proposée aujourd’hui s’inscrit bien dans cette continuité.
En effet, il s’agit de protéger des biens communs, utiles à l’humanité, qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, c'est-à-dire non seulement de réparer des dégâts causés, mais aussi de prévenir la survenue de dommages, grâce à l’habile réécriture de la présente proposition de loi par le rapporteur. Ce texte est simple, court, intelligible ; il pose des principes clairs, qui ne souffrent pas d’exception. Son adoption permettra de clarifier les fondements sur lesquels les juges pourront construire leur raisonnement.
Bref, il est diamétralement opposé à la loi de 2008 relative à la responsabilité environnementale, texte touffu, technique, incompréhensible pour le commun des mortels, d’ailleurs inefficace et inappliqué, adopté dans de bien piètres conditions, au mépris du travail parlementaire, sous la pression du délai dépassé de transposition d’une directive européenne. Cette loi a créé une nouvelle police de l’environnement, sans même aborder l’articulation avec les autres polices, et a fait reposer tout le dispositif sur les seuls préfets, alors que l’on sait pertinemment qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires. Elle constituait déjà au moment de son adoption un signal fort du renoncement de la droite aux principes actés lors du Grenelle de l’environnement.
Mes chers collègues, vous me ferez probablement remarquer que la présente proposition de loi émane du groupe UMP, dont on pourrait donc estimer qu’il rectifie le tir malencontreux de 2008.
Néanmoins, soyons clairs : c’est bien la récriture de ce texte réalisée par le rapporteur qui nous permettra de le voter en l’état.
En effet, la version initiale ne nous aurait pas pleinement satisfaits.
Si nous allons bel et bien voter ce texte, c’est pour trois raisons principales.
Tout d'abord, le rapporteur et la commission ont eu l’intelligence de faire du régime de responsabilité civile créé par la proposition de loi un régime de responsabilité avec faute et sans faute, ce qui permet une mise en œuvre effective du principe de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement de 2004, à valeur constitutionnelle ; un simple régime de responsabilité avec faute n’aurait pas permis d’atteindre ce résultat.
Ensuite, la priorité a été donnée à la réparation en nature et non au paiement de dommages et intérêts, qui sont, on le sait bien, un moyen de s’acheter une bonne conscience, mais sans garantie d’effet sur l’environnement dégradé.
Enfin, un volet préventif a été ajouté ; cette disposition nous semble particulièrement bienvenue.
La réparation en nature des atteintes à l’environnement est une nécessité que nous aurions pu qualifier d’éthique il y a plusieurs décennies, mais que je qualifierais aujourd’hui de morale, car nous ne pouvons plus décemment y couper.
Cette réparation est une condition nécessaire si nous voulons laisser aux générations futures une terre habitable. L’homme existe parce que la nature existe, et la nature telle que nous la connaissons existe parce que l’homme existe ; l’homme et la nature doivent donc cohabiter, ce qui signifie que l’homme a d’énormes responsabilités envers la nature.
La réparation en nature est en quelque sorte le service minimum que nous devons à notre environnement pour le préserver.
Mais attention : la réparation n’est pas pour autant l’alpha et l’oméga de la protection de l’environnement.
Elle n’est en effet pas toujours possible. La dégradation ou la destruction d’écosystèmes endémiques, par exemple, ou encore la pollution de nappes d’eau fossiles peuvent parfaitement se révéler irréversibles ; je ne reviens pas sur le cas des abeilles. Une réparation compensatoire, qui se ferait ailleurs par des restaurations, des remises en état jugées équivalentes, ne permettra jamais vraiment de retrouver la valeur perdue.
Le groupe communiste l’a déjà affirmé dans cet hémicycle, la compensation écologique est une imposture intellectuelle ! Les biens communs qui constituent notre environnement ne sont pas des facteurs de production fongibles, comme le travail et le capital. Ils ont une identité propre et ne peuvent être substitués les uns aux autres comme s’ils étaient « hors sol ». Les interactions, synergies et autres dynamiques au sein de l’environnement, c’est-à-dire entre et au sein de la biosphère, de la lithosphère, de l’hydrosphère, de l’atmosphère et de la cryosphère, sont innombrables et continueront encore longtemps à dépasser les capacités d’ingénierie humaine.
C'est la raison pour laquelle le volet préventif est un élément incontournable du dispositif. Toutes les dégradations qui peuvent être évitées ou atténuées doivent l’être, et les moyens nécessaires pour y parvenir doivent être accordés aux personnes physiques et morales concernées.
Madame la garde des sceaux, je conclus en observant que vous avez mis en place il y a quelques jours un groupe de travail sur la question, afin de l’approfondir. Ce groupe de travail vous rendra ses conclusions vers la mi-septembre. Nous ne doutons pas que ces travaux permettent d’améliorer encore la qualité du présent texte, en particulier s'agissant de l’articulation avec les autres régimes de responsabilité existants.
En attendant, nous estimons que le signal est bon, que l’avancée juridique est indéniable et que l’équilibre de la présente proposition de loi est tout à fait satisfaisant. C’est pourquoi nous la voterons, et avec enthousiasme.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme l’a récemment souligné un avocat à la Cour sur son blog, « la réparation du préjudice écologique est sans doute l’une des grandes questions du droit civil en ce début du XXIe siècle ». Nous entamons donc une réflexion sur une grande question de droit civil. Je tiens à remercier tout particulièrement Bruno Retailleau d’avoir mené ce combat depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Pour un certain nombre d’entre nous, qui sommes parfois plus militants que juristes ou politiques, la nécessité d’inscrire le préjudice écologique dans le code civil est une évidence. Cependant, en 2007, il aurait été presque impossible de le faire, car les esprits n’étaient pas encore prêts. Aujourd'hui, ils le sont.
Plus qu’une loi, c’est un nouveau paradigme qui s’écrit. Lors du procès de l’Erika, en l’absence de texte absolument clair sur lequel fonder la notion de préjudice écologique, les juristes se sont régalés de raisonnements juridiques. La décision de la Cour de cassation nous oblige aujourd'hui à donner une base légale, solide, à cette notion.
En effet, il existe encore des incertitudes juridiques au sujet de la définition du préjudice écologique ; vous avez évoqué certaines d’entre elles, madame la garde des sceaux.
Dans son rapport, Alain Anziani insiste notamment sur la question de la prescription, au bout de cinq ou trente ans, avec un élément déclenchant plus ou moins solide, et donc plus ou moins facteur d’incertitude pour les entreprises et les autres acteurs concernés.
Il faudra également clarifier la question de la prévention. Cette question a été évoquée lors des auditions. Un article a été inséré dans la proposition de loi pour ouvrir la possibilité d’allouer des dommages et intérêts en compensation de dépenses de prévention. Je préférais la version initiale du texte, qui permettait au juge de prescrire des mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte illicite à l’environnement. Si on conserve l’idée de dommages et intérêts, il faudrait également prévoir le remboursement des dépenses de prévention, qui n’est pas systématique.
Le groupe de travail pourra apporter des réponses sur ces différents éléments. Il est logique que le texte, qui, je l’espère, sera voté ce matin, puisse être enrichi non seulement par la navette parlementaire mais aussi par les conclusions du groupe de travail.
Je le répète, l’intérêt de cette proposition de loi est qu’elle ouvre un nouveau paradigme. La reconnaissance, non d’un droit de la nature, mais d’une responsabilité de l’homme dans une approche écosystémique, dépasse presque la référence à Hans Jonas que vous avez incluse dans votre rapport, monsieur Anziani. En effet, avec la notion de « préjudice écologique », c’est non un préjudice indirect pour l’homme qui est consacré, mais bien la dépendance de l’homme à l’égard de son environnement, de son écosystème.
Madame la garde des sceaux, vous avez déclaré tout à l'heure que vous ressentiez un plus grand « tremblement » face aux personnes que face aux animaux. Cependant, si vous connaissiez la biodiversité de votre flore intestinale, si vous saviez qu’elle vous permet de survivre, vous ressentiriez davantage, j’en suis certaine, ce tremblement face à la nature.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Face à la flore amazonienne, oui, mais pas face à ma flore intestinale !
Rires.

Je vous l’accorde !
Après la reconnaissance du préjudice écologique, il faudra sans doute aborder l’autre question du droit de l’animal et de son statut dans le code civil. Peut-on encore se contenter de l’assimilation des animaux à des biens meubles ? C’est une question particulièrement sensible, comme l’ont montré les débats au Conseil économique, social et environnemental.
Une troisième question apparaît en filigrane dans la proposition de loi. Celle-ci traduit clairement une vision patrimoniale de notre environnement, ou du moins elle reconnaît l’existence d’un capital environnemental. On sort donc de la vision du XXe siècle, incarnée notamment par le concept de « produit intérieur brut », dans lequel tout n’est que flux et somme de valeurs ajoutées. Cette évolution s’inscrit dans la lignée des travaux de Joseph Stiglitz et Amartya Sen sur la nécessité de revoir, de corriger, de compléter le concept de PIB. J’admets que cette belle réflexion n’a pas sa place ici, mais elle me tient à cœur.
Ne nous voilons pas la face, l’application de cette proposition de loi soulève des difficultés, qui me semblent plus méthodologiques que juridiques. Ces difficultés concernent en particulier l’évaluation de la réparation et sa mise en œuvre. Nous connaissons la réparation en nature, mais elle n’est pas toujours possible. Il est donc logique de prévoir également une réparation pécuniaire.
Toutefois, ce type de réparation est très difficile à mettre en œuvre. Le professeur Chevassus-au-Louis a mené des travaux pour tenter d’estimer la valeur des différents écosystèmes. Il a donné une valeur aux prairies et aux forêts, mais il a surtout montré les obstacles. Par exemple, si on constate la disparition d’une espèce exceptionnelle, comment estimer sa valeur ? Sur un plan philosophique, peut-on accepter de « monétariser » une espèce ?
Plus généralement, quelle méthodologie devons-nous employer ? Faut-il se contenter d’évaluer les seuls services économiques de la biodiversité ordinaire ? Des estimations ont été réalisées : 153 milliards d'euros pour les pollinisateurs et 380 milliards de dollars pour les bousiers aux États-Unis. Il existe même une estimation de la valeur monétaire des sangsues, mais je pense que cela ne provoquera chez vous aucun tremblement, madame la garde des sceaux…
En effet, je tremble davantage pour les abeilles que pour les sangsues !

Vous le voyez, de nombreuses questions méthodologiques se posent. Il est urgent que les administrations et les experts en matière de biodiversité au sens large s’en saisissent, comme il est normal que la loi les incite à se mobiliser.
Le fait que des questions se posent encore ne constitue donc pas une raison pour repousser la reconnaissance de la notion de « préjudice écologique » ; je pense d'ailleurs que personne ne le comprendrait. Aussi notre groupe soutiendra-t-il, lui aussi avec enthousiasme, cette proposition de loi.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil répond à une double nécessité : apporter une base juridique claire aux tribunaux et reconnaître enfin la responsabilité des personnes ayant causé des dommages à l’environnement.
Cette double nécessité revêt pour moi une importance cruciale, car il s’agit de combler un vide juridique dont nous sommes aujourd’hui tous victimes. En effet, plus un jour ne passe sans qu’une nouvelle catastrophe ou un nouveau scandale environnemental éclate. Marée noire, fuite de produits chimiques, pollution massive des eaux et de l’air, scandales sanitaires liés à l’usage de produits dangereux : les exemples pourraient être multipliés à l’infini.
Or ces atteintes parfois graves à l’environnement n’entraînent que trop rarement des condamnations et des réparations. Il existe donc bien une certaine impunité pour ceux qui endommagent notre patrimoine commun le plus cher, notre environnement.
Cette situation n’a que trop duré. Il est temps de mettre les auteurs d’infractions, d’erreurs ou d’imprudences graves devant leurs responsabilités, et de les faire payer à hauteur des dommages qu’ils ont occasionnés. Nous devons intégrer dans la loi des mécanismes de prévention, de pénalisation et de réparation des préjudices environnementaux. C’est pourquoi je partage l’ambition de cette proposition de loi, qui vise à introduire la notion de « préjudice écologique » dans le code civil, afin de lui conférer un fondement juridique incontestable.
Au-delà de sa nécessité intrinsèque, cette ambition s’inscrit dans une logique. Les mentalités ont commencé à évoluer, et une prise de conscience de notre devoir d’agir dans ce domaine est apparue ces dernières années. La Charte de l’environnement de 2004, qui reconnaît des droits et des devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, a désormais valeur constitutionnelle. La loi du 1er août 2008 a transposé dans le droit français une directive européenne visant à donner un fondement juridique à l’obligation de réparation des dommages environnementaux. Parallèlement, la jurisprudence française a reconnu à plusieurs reprises la notion de « préjudice écologique ».
Si nous pouvons nous féliciter de ces avancées progressives, tant au niveau national qu’au niveau européen, nous pouvons néanmoins regretter qu’il ait fallu attendre une catastrophe – en l’espèce, le naufrage de l’Erika – et onze années de procès pour que les choses évoluent.
Il en va souvent ainsi, malheureusement, lorsqu’il est question d’atteinte à l’environnement et je tiens à m’en faire le témoin.
En octobre dernier, j’ai présenté un rapport d’information consacré à l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement. Après six mois de travaux, une centaine d’auditions et plusieurs déplacements en France, j’ai dressé un constat assez alarmant de la situation actuelle dans notre pays : les dangers liés à l’usage des pesticides sont clairement sous-évalués ; le suivi des produits mis sur le marché n’est qu’imparfaitement assuré ; l’effet des perturbateurs endocriniens est mal pris en compte ; les protections ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques ; surtout, les pratiques agricoles, industrielles et commerciales n’intègrent pas suffisamment la nécessité de passer à un autre système, beaucoup plus économe en intrants.
En somme, la dangerosité des produits phytosanitaires est loin d’être reconnue à sa juste mesure. Pire, les impacts majeurs de ces produits sur l’environnement commencent tout juste à être appréhendés et considérés.
La raison en est simple : dans ce domaine, les intérêts économiques en jeu sont colossaux et beaucoup préfèrent encore fermer les yeux.
Si, là encore, une prise de conscience tend à avoir lieu, dans la société civile comme dans le monde agricole, elle semble encore bien timorée. Une fois de plus, il semblerait que nous soyons contraints d’attendre un scandale environnemental ou des drames humains pour que les choses évoluent réellement. Malheureusement, c’est ce à quoi nous commençons à assister.
L’exemple le plus flagrant, déjà cité, est celui du scandale de la chlordécone aux Antilles – mon collègue Félix Desplan l’évoquera plus longuement dans quelques instants –, qui est l’illustration des dangers représentés par certains produits. Il faudra plusieurs centaines d’années – on parle de 700 ans ! – pour que cette substance nocive disparaisse des sols.
Je pense également aux incidences de ces produits sur la biodiversité, dont certains ont déjà parlé. Nous savons que de nombreuses espèces utiles à l’écosystème commencent à décliner, voire ont déjà disparu. Tel est le cas, par exemple, des populations d’abeilles dont l’évolution est inquiétante depuis plus d’une dizaine d’années. Nous venons ainsi d’apprendre, voilà quelques jours, qu’un tiers des colonies d’abeilles des États-Unis avaient péri durant l’hiver. Si l’origine de ce déclin est très certainement multifactoriel, il n’en reste pas moins que l’implication des pesticides dans ce phénomène est aujourd’hui largement démontrée.
C’est pourquoi je me félicite de l’engagement du Gouvernement, par la voix du ministre de l’agriculture, en faveur de la protection de cette espèce pollinisatrice, qui s’est manifesté par l’interdiction du Cruiser en juillet dernier et la présentation d’un plan pour l’apiculture. Au niveau européen, il faut également saluer la décision d’interdire trois nouveaux insecticides dont l’impact sur les abeilles a été démontré.
Nous devons, certes, nous réjouir de ces avancées, mais, une fois de plus, ces décisions interviennent en réaction et non pas en prévention.
À mon sens, c’est tout un système qui est à revoir. Il faut bien avoir à l’esprit que seule une infime partie des pesticides atteint sa cible. En effet, l’essentiel du produit est dispersé par le vent lors de sa pulvérisation, se retrouvant ainsi dans des zones censées être épargnées, avant de finir sa course dans des cours d’eau ou des nappes phréatiques.
Dans mon rapport d’information présenté en octobre dernier, j’ai rappelé que des études du ministère de l’écologie avaient détecté des pesticides dans 91 % des points de suivi de la qualité des cours d’eau français entre 2007 et 2009.
Ces mêmes enquêtes ont révélé que des produits interdits, comme l’atrazine, étaient encore très présents dans les sols, ce qui prouve que la dégradation peut s’avérer très lente ou que certains produits interdits sont encore utilisés.
Au-delà de leur impact environnemental évident, la présence de ces résidus chimiques dans les sols représente un coût pour la collectivité, engendré notamment par les traitements nécessaires en matière de qualité de l’eau. À ces pollutions diffuses et continues s’ajoutent des pollutions ponctuelles liées à des accidents, des erreurs ou des négligences.
En somme, et pour refermer ce chapitre sur les pesticides, de nombreuses responsabilités peuvent et doivent aujourd’hui être engagées. Nous avons donc besoin d’outils juridiques pour les prévenir et les sanctionner.
Pour toutes ces raisons, je tiens à féliciter notre collègue Bruno Retailleau de son initiative, ainsi que notre rapporteur Alain Anziani de son excellent travail, matérialisé dans les apports de la commission des lois.
Je sais que la volonté d’avancer sur ce sujet est partagée par beaucoup. Ainsi, vous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, le Gouvernement a annoncé qu’il œuvrait à actuellement sur cette évolution du code civil, notamment grâce à un groupe de travail.
Ce travail collectif viendra apporter une base juridique claire aux juridictions pour la condamnation des auteurs de dommages causés à l’environnement. Elle assurera une réparation du préjudice occasionné et aura, je l’espère, un pouvoir dissuasif sur les comportements à risque.
Néanmoins, je pense que l’accent doit avant tout être mis sur la prévention et l’information. Les impacts environnementaux de certaines catastrophes ne pourront pas être réparés avant plusieurs décennies, voire des siècles.
Les marées noires en sont une parfaite illustration : quand une catastrophe humaine détruit en une semaine ou un mois ce qu’un écosystème a mis parfois des milliers d’années à constituer, aucune réparation ne peut être à la hauteur du préjudice subi.
C’est pourquoi les principaux efforts doivent être consentis en matière de prévention, mais, les bonnes volontés ne suffisant malheureusement pas, nous sommes contraints aujourd’hui de mettre en place un système plus coercitif de sanction des préjudices écologiques. Il y va de l’intérêt général.
En conclusion, mes chers collègues, le groupe socialiste votera cette proposition de loi de bon sens, dont l’enjeu est crucial et la portée majeure. §

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, déposée par Bruno Retailleau, cette proposition de loi vise à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil
Président de la collectivité vendéenne, Bruno Retailleau connaît mieux que personne le préjudice causé par la catastrophe de l’Erika, qui ne fut qu’une étape dans une série noire allant de l’Amoco Cadiz au Prestige.
Certes, cette affaire emblématique de l’Erika a donné lieu à une jurisprudence innovante, la Cour de cassation consacrant la notion de préjudice écologique.
Le 25 septembre 2012, elle a jugé Total civilement responsable de la catastrophe, confirmant ainsi les indemnités déjà versées par le pétrolier, et le condamnant à « réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d’ores et déjà condamnés », sans oublier les dommages et intérêts.
Malgré cette avancée, la France est encore loin du compte.
D’abord, si l’on compare la condamnation pécuniaire de Total dans l’affaire de l’Erika à celle qui a été prononcée l’encontre d’Exxon Mobil dans une autre affaire célèbre aux États-Unis, on constate qu’une marée noire coûte infiniment plus cher à son responsable de l’autre côté de l’Atlantique.
En 1994, à l’issue d’un procès historique, un jury fédéral condamna Exxon Mobil. En plus des centaines de millions de dollars déjà déboursés pour nettoyer les sites et indemniser les professionnels de la mer, Exxon a dû verser plus de 5 milliards de dollars de dommages dits « punitifs », soit l’équivalent, à l’époque, d’une année de bénéfices du groupe pétrolier.
D’ailleurs, l’affaire de l’Exxon Valdez a marqué un coup d’arrêt net, même s’il faut « toucher du bois », aux catastrophes provoquées par les tankers transportant du fioul lourd.
En France, à la suite des plus importantes marées noires, jamais de telles indemnités n’ont été prononcées par des juridictions ni même réclamées. En effet, pour l’affaire de l’Erika, la somme demandée était de l’ordre de 1 milliard d’euros et Total a finalement été condamné à payer moins de 200 millions d’euros, amende et dommages et intérêts confondus, soit moins d’une semaine de bénéfices du groupe.
D’un côté, 5 milliards de dollars ; de l’autre, 200 millions d’euros !
Dans notre économie mixte française, le bénéfice est privatisé, mais le risque et la réparation du préjudice sont trop souvent socialisés, mutualisés, payés par le contribuable.

M. François Grosdidier. La liberté plus grande dont jouissent, outre-Atlantique, les agents économiques est peut-être critiquable et souvent critiquée, mais au moins, là-bas, la liberté a pour corollaire la responsabilité.
M. André Gattolin opine.
M. André Gattolin opine de nouveau.

La réparation est insuffisante, mais, la plupart du temps, elle est inexistante pour des préjudices certes moins spectaculaires que des marées noires, mais dont l’addition peut pourtant s’avérer bien plus dommageable à l’environnement et à la santé humaine. Certains collègues, qui ont notamment évoqué les pesticides perturbateurs endocriniens, ont cité quelques exemples.
Elle apparaît surtout insuffisante, car, n’étant pas inscrite dans la loi, elle n’est pas systématique.
Bien sûr, l’article 4 de la Charte de l’environnement pose, dans la Constitution, le principe pollueur-payeur, mais il renvoie à la loi les conditions de son application.
Le Grenelle de l’environnement, lancé par Nicolas Sarkozy, a lui aussi permis aux uns et aux autres d’évoluer sur la compréhension de ces catastrophes, la nécessité d’avoir une réponse juridique forte, une vision tournée vers l’avenir en sécurisant ce qui a été élaboré ces dernières années et en lui donnant de la matière.
Nous avons aussi adopté la loi du 1er août 2008, laquelle est, honnêtement, une transposition plutôt a minima d’une directive européenne, de façon limitative et non exhaustive.
Il y a surtout la jurisprudence, notamment cet arrêt Erika de la Cour de cassation, mais celle-ci demeure incohérente et aléatoire.
Ces éléments restent des outils dispersés qui conduisent les tribunaux à se fonder sur la responsabilité civile de droit commun, responsabilité bien éloignée du préjudice collectif causé à l’environnement, notre patrimoine commun, qui appartient à tout le monde et à personne, qui n’appartient donc notamment à aucune personne morale, pas même à l’État.
La sanction pénale punit une faute morale commise contre la société, mais pas le préjudice fait à la communauté des vivants et des êtres à venir. De surcroît, il ne s’agit pas nécessairement de punir s’il n’y avait pas intention de nuire, mais il s’agit, en tout état de cause, de réparer.
C’est l’apport de ce texte de Bruno Retailleau, enrichi par la commission des lois.
Je salue l’idée de notre collègue Retailleau d’exiger la réparation du préjudice causé à l’environnement au-delà des effets pécuniaires qu’ils peuvent entraîner notamment sur les agents économiques pouvant en souffrir, et de privilégier la réparation en nature, qui est le plus sûr moyen d’une réparation effective, même si elle n’est pas toujours possible.
Je salue aussi le travail de la commission des lois, et en particulier de son rapporteur, Alain Anziani, dont la contribution a permis d’améliorer ce texte. La commission a estimé que l’engagement de la responsabilité de l’auteur du dommage causé à l’environnement ne pouvait se limiter au seul cas où il a commis une faute, retenant un régime de responsabilité civile objective, susceptible d’être engagée même en l’absence de faute.
En conclusion, je tiens à dire qu’il serait curieux que les parlementaires décident de ne pas légiférer au motif qu’une réponse serait déjà apportée par la jurisprudence, d’autant que la Charte de l’environnement confère expressément cette responsabilité au Parlement. Ce serait une démission de notre part.
Il s’agit de notre responsabilité première que de légiférer en la matière, afin de poser dans la loi le régime de responsabilité d’un principe que nous avons inscrit, voilà près d’une décennie, dans notre Constitution.
Mes chers collègues de la majorité, vous qui discourez tant sur l’écologie, vous avez, en votant pour ce texte, l’occasion d’accorder vos actes à vos discours.
Quant au groupe UMP, qui revendique une éthique de la liberté et de la responsabilité en toute matière, il sera cohérent avec ses principes, y compris dans le domaine de l’environnement, en votant en faveur de ce texte. §

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mon cher collègue Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, si nous avons ici tous à l’esprit les conséquences du naufrage de l’Erika, qui a inspiré cette proposition de loi, les Guadeloupéens et les Martiniquais vivent au quotidien un désastre écologique majeur, puisqu’il atteint tout à la fois les sols, les eaux et les sédiments marins de leurs îles, et ce pour les cinq à six siècles à venir !
Il est la conséquence de l’utilisation abondante, pendant une vingtaine d’années, d’un pesticide, le chlordécone, pour lutter contre le charançon du bananier.
Dès 1976, les États-Unis avaient cessé de produire et d’utiliser cette molécule chimique très toxique et extrêmement rémanente. En France, dès 1977, plusieurs rapports avaient établi l’existence d’une pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les organochlorés.
Cependant, malgré un retrait d’homologation treize ans plus tard et l’existence de traitements alternatifs, les autorités françaises, par le biais de dérogations et sous la pression des planteurs de bananes, ont maintenu licite l’usage du chlordécone dans les Antilles jusqu’en septembre 1993.
Aujourd’hui, le constat est affligeant : « Guadeloupe : monstre chimique » titrait Le Monde, le 17 avril dernier.
Quelque 6 500 hectares de surface agricole utile sont contaminés dans ce département, essentiellement dans le sud de la Basse-Terre. En Martinique, la pollution est plus diffuse et concerne environ 14 500 hectares, les surfaces les plus atteintes se situant dans le nord-est de l’île.
La molécule est très stable à l’abri de la lumière. Aussi l’impact sur la production agricole et l’élevage est-il fort. Les légumes racines, mais aussi ceux qui poussent près du sol, tels que le giraumon, tous très consommés par les Antillais, sont atteints, tout comme les viandes bovines, les volailles, le lait et les œufs.
Cette pollution des sols a entraîné un transfert de contamination vers les eaux douces et littorales, atteignant, en conséquence, les poissons et les crustacés.
Le polluant a été répandu pour protéger certains intérêts économiques. La banane, au demeurant très subventionnée, est le principal produit d’exportation des Antilles, mais la dégradation écologique que son utilisation a engendrée a bel et bien des effets néfastes pour l’ensemble de l’économie de ces petits territoires à la biodiversité exceptionnelle.
La production agricole locale est atteinte. Les élevages aquacoles en eau douce ont dû être fermés, à Goyave notamment. La pollution des sédiments marins n’en finit pas de pénaliser les pêcheurs professionnels et de récentes analyses ont conduit les autorités à étendre les zones d’interdiction totale ou partielle de pêche et le nombre d’espèces interdites à la consommation. En Guadeloupe, ces zones d’interdiction représentent 161 kilomètres carrés, allant parfois au-delà du plateau continental, et 44 espèces sont concernées.
Ces décisions ont été prises pour prémunir la population. Le chlordécone serait la cause d’une augmentation des cancers de la prostate chez les travailleurs des bananeraies, d’une surincidence de myélomes multiples et d’un retard de développement psychomoteur chez certains nourrissons.
Quant aux conséquences à long terme pour l’évolution ou la survie de la faune et de la flore, il est difficile de les évaluer pleinement, faute d’études scientifiques, mais il est sûr que la terre et les eaux qui les font exister sont contaminées de façon importante, et pour très longtemps.
L’État a mis en place deux plans d’action, dont le second se termine cette année. Plus de 60 millions d’euros de crédits de l’État, des collectivités locales et de l’Union européenne ont été engagés par divers acteurs : cette somme est considérable.
Les planteurs de bananes, rappelons-le, agissaient en toute légalité. Les Antilles ont été empoisonnées par un produit autorisé, homologué. Les planteurs respectaient les règles : bien qu’à l’origine de la catastrophe, ils n’ont donc pas eu à en supporter les conséquences financières. Ils n’ont toutefois pas le monopole des atteintes à l’environnement outre-mer.
Ainsi, dans les années 1970, l’Office national des forêts, l’ONF, avait décidé de transformer une partie de la forêt primaire de Guadeloupe en plantations de mahoganys, une variété d’acajou exploitable pour son bois. Après un premier défrichement au sabre, et pour favoriser la croissance de ces mahoganys qui exigeaient beaucoup d’eau et d’espace, des agents de l’Office ont empoisonné les autres arbres, en injectant à leur racine un herbicide puissant, l’acide 2, 4, 5-trichlorophénoxyacétique, l’un des deux composants de l’« agent orange » utilisé lors de la guerre du Vietnam. Cette initiative a provoqué la disparition d’espèces rares. Là aussi, les études d’écotoxicité font défaut et il n’est pas possible d’estimer les effets à long terme de cette pollution sur l’ensemble de la faune et de la flore, mais il a été démontré que ce défoliant peut causer chez l’homme certains types de cancer ou le diabète. L’histoire est d’autant plus navrante que ces mahoganys n’ont pas été exploités, faute de main-d’œuvre et de demande !
La reconnaissance, dans le code civil, du dommage causé à l’environnement sans notion de faute, comme l’a votée notre commission des lois sur l’initiative de son rapporteur, est un signal fort. Une personne sera responsable car elle aura créé un risque dont elle tire profit. Le juge civil déterminera le caractère réel et certain du dommage, puis conciliera les différents intérêts en présence. Il ne s’agit pas de freiner tout développement économique, par essence porteur de risque pour l’environnement, mais d’assurer la réparation des atteintes à ce dernier.
Les pollueurs potentiels seront incités à la prudence. Cette précaution revêt une importance toute particulière pour nos territoires d’outre-mer, territoires fragiles qui connaissent une dégradation continue de leurs écosystèmes.
La commission des lois a également souhaité que les réparations puissent revêtir des formes très diverses, appropriées à chaque situation. Reste en suspens, toutefois, le problème du délai de prescription, qui n’est pas explicitement traité par ce texte.
Cette reconnaissance du préjudice écologique pourra conforter et encourager des initiatives prises par les acteurs économiques pour protéger l’environnement. Je citerai comme exemple l’accord de partenariat signé entre le ministère de l’agriculture, les collectivités locales et les acteurs de la filière qui garantit que l’exploitation de la banane de Guadeloupe et de Martinique – fruit qui, paradoxalement, n’a jamais été contaminé ! – aura à l’avenir une incidence minimale sur l’environnement – cette banane sera désormais « écologique » !
Cependant, la plus grande vigilance devra toujours être de mise, l’actuelle polémique autour des conséquences de l’épandage aérien sur les plantations bananières et les recours devant les tribunaux pour contester les dérogations accordées l’attestent.
Si cette proposition de loi demande à être complétée – mais Mme la ministre nous a rassurés sur ce point en évoquant les études qu’elle avait demandées –, nous l’avons vu, elle n’en constitue pas moins une avancée essentielle. Pour cette raison, comme tous mes collègues du groupe socialiste, je la voterai.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, de l’UDI-UC et de l’UMP . – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je fais actuellement procéder à des vérifications concernant la question posée par MM. Félix Desplan et Joël Labbé sur l’autorisation d’épandage aérien accordée en Guadeloupe. Certains éléments me sont parvenus, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre en toute certitude sur ce point. Dans la mesure où mes propos seront retranscrits au Journal officiel, vous comprendrez que je demeure prudente.
Quoi qu’il en soit, je comprends la protestation vigoureuse que vous avez élevée, messieurs les sénateurs. Lorsque je siégeais à l’Assemblée nationale, il m’est arrivé de participer à des réunions avec le professeur Belpomme qui avait posé la question des conséquences de l’emploi du chlordécone. Les événements ont pris ensuite une tournure déconcertante, puisque ce dernier est revenu sur certaines de ses affirmations, estimant que tous les éléments scientifiques nécessaires pour se prononcer n’étaient pas réunis : peu importe, nous n’allons pas discutailler sur l’ampleur des dommages, il s’agit bel et bien d’une catastrophe !
Les terrains plantés de bananiers, en Guadeloupe et à la Martinique, ne sont pas les seuls touchés, parce que la nature et l’homme sont intrinsèquement liés, comme je le disais tout à l’heure. La contamination du sol s’étend au sous-sol, aux cours d’eau et à la mer : personne ne peut dire que ces produits toxiques seront arrêtés par une quelconque frontière.
La dérogation à l’interdiction de ce produit, respectée dans l’Union européenne et en métropole, constitue en soi un scandale. N’oublions pas non plus que l’Union européenne avait elle-même tardé à agir, puisqu’elle n’a décidé cette interdiction que près de vingt ans après les États-Unis.
Soyons clairs, des intérêts antagonistes sont en jeu : la défense du bien commun, c’est-à-dire de la nature, les préoccupations de santé publique, d’une part, et les arguments relatifs aux superficies agricoles, aux emplois directs et indirects, d’autre part. L’État doit contribuer à résoudre cette difficulté.
Comme je représente aussi l’État, je ne me défausse pas, mais je ne suis pas en mesure de répondre très précisément à vos questions. J’essaie de savoir si cette autorisation d’épandage concerne aussi le chlordécone, car j’ai reçu deux réponses contradictoires…
M. Joël Labbé fait un signe de dénégation.
Je ne devrais pas m’avancer sur ce terrain, mais je vous répondrais malgré tout que, même face à des enjeux économiques importants, la protection de l’environnement et la santé publique doivent être privilégiées. Il ne s’agit pas, pour autant, de laisser sans réponse les questions économiques. Les économies de la Martinique et de la Guadeloupe reposent principalement sur la culture et l’exportation de la banane et il n’est pas possible de négliger totalement les emplois, directs et indirects, qui dépendent de ces activités. En revanche, on ne peut pas non plus vivre en différant constamment les réponses aux problèmes.
Si je considère que la priorité doit être donnée à la protection de l’environnement et à la santé publique, j’estime qu’il faut également s’interroger sur la possibilité de promouvoir un autre modèle économique de développement de ces territoires – cette question aurait dû être posée depuis longtemps, au moins depuis 1993, date de la première dérogation. En effet, ces îles recèlent des potentialités de développement considérables, en premier lieu grâce à l’importance de leur jeunesse : il convient donc de proposer des programmes de formation, avec des ouvertures sur des métiers nouveaux. Un autre de leurs atouts est la biodiversité, essentielle pour les développements futurs de la pharmacopée.
L’existence de ces filières économiques potentielles doit donc permettre la diversification de ces économies, afin que celles-ci ne reposent plus uniquement sur l’accompagnement de productions multiséculaires. Certes, la banane a été la première diversification introduite pour en finir avec la monoculture sucrière, mais il n’en reste pas moins que ces économies restent limitées à deux filières, ce qui ne permet pas le développement des territoires concernés. En m’exprimant ainsi, je suis consciente d’aller beaucoup plus loin que je ne devrais, mais j’en assumerai toutes les conséquences. §
J’en reviens donc au texte de la proposition de loi, même si le sujet que je viens d’évoquer y était entièrement lié, pour répondre très rapidement aux différents intervenants. En effet, en dehors de cette question très précise, toutes les interventions ont développé des arguments et des prises de position auxquels je m’associe totalement : la discussion générale a enrichi le débat et apporté de nouvelles précisions, mais les interrogations du Gouvernement sont identiques aux vôtres, mesdames, messieurs les sénateurs.
En ce qui concerne la réparation en nature des préjudices, il faudra définir le but : cette réparation est censée soit supprimer le dommage, soit le réduire, soit le compenser. Mes services vont donc y travailler.
J’ai bien compris que cette proposition de loi serait adoptée par votre assemblée. M. le président de la commission des lois m’a demandé quelle était la position du Gouvernement, mais je pensais avoir été claire : à partir du moment où un travail associant les parlementaires de tous les groupes politiques a été réalisé, je ne peux que m’en remettre à la sagesse de votre assemblée. Je l’ai d’ailleurs dit avant même d’entendre que tel groupe allait voter cette proposition de loi « avec force », tel autre « avec enthousiasme ». Mme Jouanno, pour le groupe de l’UDI-UC, nous a même dit qu’elle le voterait « avec force et enthousiasme »
Sourires.
Aussi, je m’en remets, en toute sérénité, à la sagesse de votre assemblée, mais j’ai compris la force de votre résolution. Je prends donc acte du fait que le vote qui va intervenir sera vraisemblablement positif et, probablement, unanime – excusez du peu, monsieur Retailleau, c’est un véritable exploit et vous auriez tort de bouder votre plaisir.
Se pose la question des critères précis concernant la réparation en nature. Se pose également la question, qui est essentielle et sur laquelle j’ai échangé avec le sénateur Anziani, des conséquences de l’autorisation administrative. En dehors des statuts plus lourds et contraignants, comme celui qui a trait aux installations classées, il existe deux régimes pour les installations industrielles, le régime de l’autorisation administrative et le régime déclaratif. Pour le premier, peut-être nous faudra-t-il travailler sur le contenu de l’autorisation et, pour le second, peut-être faudra-t-il s’intéresser aux critères requis. Il s’agit de se prémunir contre le risque de voir un pollueur se retourner contre la puissance publique en invoquant une autorisation délivrée sans garantie suffisante contre le risque de pollution.
Toute une série de questions restent donc en suspens. M. le sénateur Grosdidier s’est interrogé sur la réparation pécuniaire, qui est un vrai sujet. C’est pourquoi je disais que la réparation en nature est une priorité, sans être une exclusivité. En tout cas, dans l’esprit de la proposition de loi du sénateur Retailleau, il y a, en effet, la réparation pécuniaire.
Nous travaillons sur deux pistes qui ne sont pas encore dans notre droit. L’amende civile y est déjà, mais il faut voir comment nous allons améliorer les possibilités de réponse judiciaire sous cette forme. Et puis nous réfléchissons sur la manière d’approfondir un concept juridique et judiciaire qui existe dans d’autres droits, mais pas encore dans le nôtre, celui de la « faute lucrative ». Le principe, c’est qu’il ne faut pas que la sanction soit inférieure au bénéfice tiré par l’auteur des faits.
Je remercie Mme la sénatrice Jouanno des informations qu’elle m’apportera sur les sangsues. §J’avoue leur préférer les abeilles, parfois agressives, certes, mais seulement quand on les provoque ! Je crois savoir que les sangsues ont fait des miracles, au Moyen Âge, un peu plus tard, aussi.
Je suis très sensible, et depuis déjà très longtemps, aux questions de biodiversité. Certains se sont étonnés de m’entendre dire que j’ai plus de tendresse, voire plus de « tremblement », pour les personnes que pour la nature.
Eh bien, j’ai beaucoup de tendresse pour la nature, et, de plus, les choses sont liées ! La vie et la vitalité de l’espèce humaine dépendent de la vie et de la vitalité de la nature. L’homme est un gardien de la nature, un sculpteur de la nature, y compris dans ses activités économiques. La nature, nous la sculptons. La relation est donc vraiment intrinsèque et organique.
Je voulais ainsi juste illustrer le fait que la précision de l’écriture doit permettre d’éviter un écart trop important entre le niveau de protection des personnes et ce qu’on peut induire en niveau de protection de la nature.
D’ailleurs, peut-être nous faut-il travailler à élever le niveau de protection des personnes. Toutefois, il semble que la jurisprudence produite par ce fameux article 1382 du code civil a conduit à encadrer ce niveau de protection. Pour appliquer le droit, le magistrat a, en effet, besoin d’éléments. Il y a des faits générateurs, qui sont précis. La défense peut éventuellement les contester. Il faut donc une rédaction précise pour éviter à la fois des interprétations, qui peuvent être abusives, et des décisions qui cassent les jugements.
De plus, le seul fait de contempler la nature est un droit. Il y a des merveilles à voir et c’est tout de même un devoir de notre génération que de faire en sorte d’inclure la beauté des paysages dans ce que nous transmettons à la génération suivante.
À ce propos, je me souviens d’un film que tout le monde ici a probablement vu, qui s’appelle Soleil vert. Interprété par l’inimitable Charlton Heston, il a été réalisé par Richard Fleischer pendant les années soixante-dix, qui furent les années d’études des plus vieux d’entre nous. Vous vous souvenez de la récompense accordée à ceux qui acceptent de disparaître parce que la nature a été tellement abîmée qu’elle n’est plus en mesure de nourrir les êtres humains. C’était un film d’anticipation. Et il situait la date de la fin à 2022 ! Cela arrive vite, d’autant plus vite qu’on n’arrête pas certaines pratiques ! Donc, il y a nécessité urgente d’arrêter !
Dans le film, disais-je, la nature était tellement abîmée qu’elle ne pouvait plus nourrir tous les êtres humains. Ceux qui étaient considérés comme un poids, les personnes âgées, notamment, étaient invités à accepter de passer, de traverser. Elles se rendaient dans un centre où elles étaient installées, accompagnées en musique, une musique qu’on n’entendait plus guère, une musique très douce.
Absolument ! Merci, monsieur Retailleau ! Et vous vous souvenez de ces magnifiques images de paysages qui leur étaient diffusées. Leur cadeau, pour la traversée, c’était cette contemplation des paysages. C’est dire à quel point il s’agit d’un droit, d’une liberté et même d’une nécessité. Nous avons donc le devoir de préserver ces paysages.
J’ai évoqué cet exemple simplement pour sortir du pré-lyrisme de la flore intestinale et passer à un lyrisme plus floral. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de me réjouir à mon tour de l’excellent travail produit par M. Bruno Retailleau et par M. Alain Anziani. Je me félicite des convergences qui sont apparues dans toutes les belles interventions que nous avons pu entendre ce matin.
Et parmi les belles interventions, madame la ministre, je classerai naturellement la vôtre. Pour ceux, dont je suis, qui s’intéressent beaucoup à la langue et au discours, il y a chez vous, ce lyrisme qui, je le constate, s’appuie toujours sur des réalités sensibles, un lyrisme qui n’est pas éthéré, qui est lié au rutilement du monde, à la beauté des choses, …
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je la crains !
Nouveaux sourires.

Ne la craignez pas.
Je voulais souligner que ce texte sera sans doute adopté dans de très bonnes conditions par notre assemblée. Nous sommes très heureux que des textes soient adoptés dans de bonnes conditions et que le Gouvernement s’en remette à la sagesse du Sénat. Quelle belle parole, la sagesse !
Simplement, nous avons le souci que le travail du Sénat puisse porter ses fruits au-delà de notre seule assemblée et, donc, que les textes puissent être examinés aussi par l’Assemblée nationale.
Vous avez expliqué la démarche qui est la vôtre, vous avez parlé du texte en préparation. Je ne sais comment il va s’articuler avec le présent texte dans son cours parlementaire. Un auteur du XXe sièclea déclaré : « Tout ce qui monte, converge ». Donc, je pense que nous pourrons avoir des convergences utiles.
Je profite de cette occasion pour souligner que, contrairement à ce qu’on lit parfois, le Sénat adopte beaucoup de textes dans de bonnes conditions, et souvent, d’ailleurs, à l’unanimité. La presse met quelquefois en avant le caractère pluraliste de cette assemblée, qui, dans un certain nombre de circonstances, ne permet pas de réunir des majorités. C’est une réalité.
Je vais vous citer quatre textes, tous adoptés à l’unanimité par le Sénat, et dont aucun n’a donné lieu, à ce jour, au moindre débat à l’Assemblée nationale.
Premier exemple, nous avons adopté, madame la ministre, voilà au moins deux ans, une proposition de loi sur les sondages. Qui dira que la loi de 1977 sur les sondages est aujourd'hui pertinente ? Elle doit être revue. Or nous attendons que ce texte puisse être examiné à l’Assemblée nationale !
Deuxième exemple, à la suite des états généraux de la démocratie locale, nous avons adopté à l’unanimité une proposition de loi sur les conditions d’exercice des mandats locaux. Voilà un sujet qui, au-delà des divergences légitimes, intéresse tous les élus. Eh bien, nous attendons que ce texte, voté unanimement par le Sénat, soit examiné à l’Assemblée nationale !
Troisième exemple, nous avons adopté une proposition de loi qui crée une instance destinée à examiner en amont les textes législatifs ou réglementaires instaurant de nouvelles normes pour les collectivités locales. Il a recueilli un grand accord ici. En effet, tout le monde se plaint qu’il y a trop de normes, mais pour y mettre un terme, sans doute faut-il qu’en amont une instance statue, publie des avis, demande au Gouvernement ou au Parlement de revoir tel ou tel projet, de manière à maîtriser ce développement des normes. Eh bien, cette proposition de loi, nous attendons qu’elle soit examinée par l’Assemblée nationale !
Quatrième exemple, nous avons voté ici même un texte que j’avais eu l’honneur de déposer et pour lequel le rapporteur, Alain Anziani, alors aussi brillant qu’aujourd'hui, avait beaucoup œuvré. Vous le savez, madame la ministre, puisque vous étiez au banc du Gouvernement, cette proposition concerne les prérogatives du juge français par rapport aux infractions et aux crimes relevant de la Cour pénale internationale, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocide. Voté à l’unanimité, après un débat, sur le rôle du parquet en particulier, important, ce texte est très attendu et observé non seulement en France, mais au-delà de nos frontières, à l’étranger. Les avancées de la France sur un tel sujet ne seront pas anodines. Or ce texte, que vous avez bien voulu soutenir, madame la ministre, n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale !
Je reviens au sujet, dont je m’étais un peu écarté, pour vous saluer, monsieur Retailleau, et vous tous, mes chers collègues, qui êtes intervenus et qui avez travaillé, et pour souligner le grand intérêt de cette proposition de loi. Je voudrais aussi émettre un vœu, que le président Bel ne manquera pas, j’en suis persuadé, de transmettre au président de l’Assemblée nationale. Il s’agit de faire en sorte que le travail fait dans une assemblée arrive facilement, normalement dans l’autre chambre, de telle manière que le travail accompli produise ses fruits, ses fleurs, madame la ministre, tous ses effets.
Je me permets de le dire en vous remerciant, bien entendu, pour toute l’attention que vous avez portée à ce texte. Vous le savez bien, l’attention, elle est dans les paroles, surtout si elles sont lyriques, et surtout si le lyrisme s’incarne dans ce que disait Mallarmé : « Donner un sens plus pur aux mots de la tribu ». Mais c’est encore mieux si cela s’accompagne des actes qui feront que tous les textes dont je viens de parler, et celui-là, soient un jour votés par le Parlement ! §

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« Titre IV ter
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
« Art. 1386–19 . – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386–20 . – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.
« Art. 1386–21 . – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation, ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tenais à formaliser le soutien du groupe UDI-UC à l’excellente proposition de loi du sénateur Bruno Retailleau visant à inscrire dans le code civil la notion de préjudice écologique.
Insérer un titre IV ter, consacré spécifiquement à la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement donne désormais un fondement juridique incontestable à la notion de préjudice écologique et à son indemnisation.
Je me souviens de la première grande catastrophe écologique sur les côtes bretonnes : le naufrage de l’Amoco Cadiz en mars 1978.
Rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés lors de cette catastrophe écologique me paraît essentiel aujourd’hui. Déjà, en 1978, les dégâts causés sur l’écosystème ont été monstrueux et parfois irréparables : des milliers de cadavres d’oiseaux, la disparition d’espèces et le sacrifice de poissons et de crustacés. De nombreuses algues ont subi l’engluement ou l’intoxication au pétrole. Sans parler des 400 kilomètres de côtes bretonnes nappées de 234 000 tonnes de pétrole brut, auxquelles viendront s’ajouter 3 000 tonnes de fuel.
Dès le 16 mars 1978, le plan Polmar a pris en charge au jour le jour les réparations de cette catastrophe. La Marine nationale mettait à disposition 4 500 hommes et cinquante bateaux. Des sapeurs-pompiers et des unités volontaires de l’armée de terre viendront également en renfort. Sur cette période, en moyenne, 420 à 7 500 personnes par jour se sont relayées du 17 mars au 7 mai sur six à quatre-vingt-dix chantiers.
Les agriculteurs se sont également mobilisés en utilisant des tonnes de lisier.
Par la suite, l’ampleur des dégâts conduisit les autorités à faire appel à plus de 1 300 véhicules pour participer au nettoyage.
Les autorités disent avoir mis près de six mois pour faire pomper ou disperser le pétrole et nettoyer les côtes bretonnes. Mais, en réalité, les grands nettoyeurs ont été les vagues et les bactéries naturelles.
Dans l’urgence, les déchets pétrolifères ramassés ont été rassemblés, puis enfouis dans le sol sur une centaine de sites choisis, dans les Côtes-d’Armor et le Finistère. Ce sont des faits marquants dont nos territoires portent aujourd’hui encore les cicatrices. Les événements ont beau être loin, les risques sont encore établis.
Que sont devenus ces déchets oubliés ? Qui en a la responsabilité et qui gère la surveillance de leur stockage ? C’est une question que nous nous posons encore.
Après l’Amoco Cadiz, ce fut en 1999 la catastrophe de l’Erika, qui a souillé 400 kilomètres de côtes du Finistère jusqu’à la Charente-Maritime. N’oublions pas en 2011 le saccage des côtes par la pollution à Erdeven. Je pense également à bien d’autres catastrophes dans d’autres domaines : Bhopal en Inde en 1984, Tchernobyl en Ukraine en 1986, etc.
Ainsi, dans le monde, comme en France, depuis quarante ans, les catastrophes écologiques se succèdent, marquant durablement les esprits.
Avec la catastrophe en 1999 de l’Erika, c’est la notion jurisprudentielle de « préjudice écologique » qui a été consacrée. Il est temps de lui donner toute sa place dans le code civil, et c’est ce que nous propose Bruno Retailleau.
Il est indispensable de sécuriser ce qui a été progressivement construit par nos tribunaux et il devient incontournable de proposer une réponse juridique pour que toute personne qui cause par sa faute un dommage environnemental soit tenue de le réparer. C’est l’objet de l’article 1386–19 que l’on nous propose aujourd’hui d’insérer dans le code civil.
Il devient tout aussi indispensable que « la réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature ». C’est à mon sens l’évolution majeure de cette proposition de loi, car, il faut l’admettre, l’environnement est un patrimoine commun de la nation. Il faut donc s’assurer que les atteintes qu’il subit puissent être sanctionnées et, surtout, réparées.
Voilà en quelques mots les raisons de ce soutien à cette proposition de loi.
Qu’il me soit permis de conclure en émettant deux vœux : le premier a été rappelé par le président Sueur, je veux parler de la nécessité de poursuivre ce travail à l’Assemblée nationale afin que le texte trouve une répercussion pratique ; le second est que nos voisins européens et les instances européennes puissent s’inspirer de nos travaux. §

Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Puisque le vote sur l’article unique vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi, je souhaite intervenir non pour expliquer mon vote, dont vous vous doutez, mais pour remercier l’ensemble des groupes qui ont su dépasser les clivages traditionnels pour se rassembler autour du bien commun et de l’intérêt général.
À la suite des deux interventions intéressantes de Mme la ministre et du président de la commission des lois, M. Jean-Pierre Sueur, je dirai rapidement quelques mots.
Madame la ministre, vous m’avez tout à l’heure interrogé sur mon état d’esprit par rapport au groupe de travail. On ne doit avoir sur ces sujets aucune vanité ni aucune susceptibilité d’auteur, car on ne légifère pas pour soi, on légifère pour le bien commun. Je me suis moi-même appuyé sur des textes, des rapports, des conclusions de travaux. Il ne peut donc y avoir un auteur nominal. Un tel travail n’entre dans le patrimoine de personne.
Si, comme ce sera sans doute le cas, cette proposition de loi est adoptée aujourd’hui, il y aura deux voies. Jean-Pierre Sueur a évoqué la voie de la navette parlementaire : le texte devra être examiné par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, notre action doit servir dans le cadre des travaux que vous avez lancés avec le groupe de travail présidé par le professeur Jégouzo.
L’important est que nous aboutissions, que ce soit par une proposition de loi, qui a effectivement une valeur symbolique, ou par un projet de loi. Au XXIe siècle, il n’est pas possible de ne pas donner sur ces questions un fondement objectif au droit positif. Les juges ont fait leur travail et ont fait preuve d’énormément d’audace. Il appartient désormais au Gouvernement et au législateur, ensemble, de faire avancer les choses.
Pour ma part, je suis certain que le préjudice écologique sera saisi par le code civil. J’en suis sûr, d’abord, parce que la jurisprudence nous y pousse : on ne peut plus faire marche arrière. J’en suis sûr, ensuite, parce qu’il s’agit d’une question sociétale. De nombreux jeunes nous écoutent
L’orateur montre une des tribunes du public.

Cela a été souligné, la difficulté est que la nature est un bien commun, mais qu’elle n’est pas une personne. En conséquence, le code civil dans sa version traditionnelle a du mal à s’en saisir. Je suis certain d’une chose, c’est que les victimes des dommages causés aujourd’hui à la nature sont les futures générations.
On a parlé de l'article 1382 du code civil, article totémique, qui fait un peu figure de « vache sacrée ». Nous travaillons sous l’ombre de Portalis, qui disait que – cette phrase a, d’ailleurs, été plus ou moins reprise par un chanteur contemporain de variété française
Sourires.

Il convient donc d’adapter le code civil, qui a été écrit voilà 200 ans, à l'époque où l'homme devait soumettre la nature. Aujourd'hui, nous avons une autre relation avec la nature, qui est importante.
Il n'en reste pas moins que la proposition de loi n’épuise pas l’ensemble du sujet. Alain Anziani, que je salue une nouvelle fois, l’a parfaitement souligné.
Quatre points méritent sans doute d’être précisés, ce qui relève de la navette et du groupe de travail que vous avez constitué, madame la ministre.
Premièrement, j'avais, dans un premier temps, souhaité limiter la responsabilité à la faute. Dès lors que l'on ouvre le dispositif à la responsabilité sans faute, il faut prévoir ce qu'il advient des régimes d'autorisation ou de déclaration administratives, notamment quand un industriel à qui une telle autorisation a été accordée pollue. C’est un point qu'il faudra traiter.
Deuxièmement, qui a intérêt à agir ? La Cour de cassation l'a dit : la défense de l'intérêt légitime de l'environnement appartient concurremment à l'État, bien sûr, aux collectivités territoriales ou locales et aux associations auxquelles je rends hommage car elles aussi m’ont aidé dans mes travaux. L'intérêt à agir doit être partagé. Selon moi, ce point ne posera pas de problème.
Troisièmement, quid du régime de réparation ? Réparer prioritairement en nature, c'est mieux, plus juste et plus efficace, comme je l'ai expliqué dans la discussion générale.
Quatrièmement, se pose la question de la prescription, qui mérite une attention particulière.
En conclusion, je suis très heureux et je veux saluer l'ensemble de mes collègues pour leurs prises de parole dans ce débat qui a été d’un bon niveau. Je pense que, après le juge, le législateur saura prendre ses responsabilités ; le texte sera, je l’espère, adopté à l’unanimité. Personne ne comprendrait que l'on revienne en arrière sur des sujets aussi importants. On peut être favorable à la liberté, on peut porter une conception de la liberté, mais l'exercice quotidien de la liberté n'a d'autre nom que la responsabilité.

Mme la ministre et M. le président de la commission ont évoqué la sagesse de notre assemblée.
Hier soir, c'est également à l’unanimité que nous avons adopté une proposition de résolution européenne déposée par le groupe UDI-UC tendant à la création d’un droit européen pour le consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation. Cela a son importance et c'est avec satisfaction que nous voyons se dégager une unanimité sur certains sujets.
Hier, j'ai conclu mon propos en disant notre confiance dans le Gouvernement. En effet, cette année, nous examinerons une loi sur la consommation ainsi qu’une loi d'avenir agricole. Par ailleurs, le groupe de travail, madame la ministre, va enrichir nos débats d’aujourd’hui.
Selon nous, c’est une confiance et une sagesse qui sont déterminées et combatives. C'est donc avec force, enthousiasme et allégresse que nous voterons le présent texte.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi.
Je constate que ce texte a été adopté à une belle unanimité : ni voix contre ni abstention.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Yves Leconte, Mmes Catherine Tasca, Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, Christophe-André Frassa et Michel Mercier ;
Suppléants : MM. Pierre-Yves Collombat, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Jean-Pierre Michel, Alain Richard, Mme Catherine Troendle et M. François Zocchetto.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.