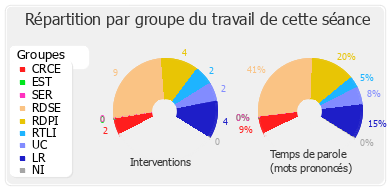Séance en hémicycle du 30 novembre 2010 à 10h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Sanctions disciplinaires voire pénales à l'encontre des fonctionnaires en application de l'article 40 du code de procédure pénale (voir le dossier)
- Meilleure adaptation des concours financiers de l'état aux collectivités de guyane (voir le dossier)
- Plan cancer ii et augmentation des moyens consacrés à la recherche scientifique relative aux causes environnementales du cancer (voir le dossier)
- Application aux élections sénatorales des dispositions relatives au financement des campagnes électorales (voir le dossier)
- Incertitudes persistantes concernant l'avenir du centre de vallon-pont-d'arc du creps paca (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, auteur de la question n° 1053, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la mise en œuvre du projet de ligne à grande vitesse Paris-Normandie dont le Président de la République a annoncé la réalisation lors de sa visite au Havre, le 16 juillet 2009.
Si l’objectif de cette ligne est de faire en sorte que Paris se dote, dans le cadre du Grand Paris, d’une porte maritime, je souhaiterais obtenir quelques assurances sur le fait que le projet concerne bien tout le territoire normand. La future LGV normande doit en effet être l’occasion d’engager une réflexion d’ensemble sur l’aménagement de ce territoire, et je rappelle que ce projet ne sera viable que s’il concerne un tracé desservant Paris-Rouen-Caen-Le Havre.
C’est, en effet, un projet transrégional que l’on doit avoir pour ambition d’élaborer, car il est d’une importance considérable pour l’avenir économique de l’Île-de-France, de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie.
À ce propos, je tiens à souligner l’action conjointe, au sein de l’association pour la promotion du TGV Paris-Normandie, des trois conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER, et de l’ensemble du monde consulaire de ces trois régions.
À cet égard, je tiens à relayer l’inquiétude exprimée par les présidents des trois CESER face à la difficile mise en œuvre de ce dossier depuis l’annonce du Président de la République. Même si l’on ne peut que se féliciter de l’inscription, au printemps dernier, de ce projet au schéma national des infrastructures de transport, la place qui lui a été accordée ne contribue pas à rassurer les acteurs régionaux.
Cette inquiétude n’a fait que croître en apprenant que le débat public ne devrait intervenir qu’à l’automne 2011 pour s’achever en février 2012 si, comme on peut le souhaiter, RFF a bien saisi la Commission nationale du débat public d’ici à la fin du mois de janvier 2011. Aussi vous demanderai-je, monsieur le secrétaire d'État, de veiller à ce qu’il en soit ainsi, voire, si possible, de faire en sorte que le débat public commence dès la mi-2011.
Enfin, j’aimerais obtenir des assurances quant au délai de mise en œuvre de ce projet, concernant notamment le calendrier de réalisation des travaux. Il faut dès maintenant envisager le projet de manière qu’il soit mené jusqu’à son terme et que la LGV relie in fine le portuaire à l’aéroportuaire, c'est-à-dire que la ligne aille du Havre à Roissy.
En effet, au vu de son coût, un tel chantier ne peut se réaliser que par phases. S’il paraît sans aucun doute réaliste que la première tranche s’arrête à La Défense, j’insiste sur le fait que l’on doit envisager de prolonger, à terme, le tracé de cette ligne jusqu’à Roissy, ce qui permettrait de connecter la Normandie au réseau TGV français et européen.
Madame la sénatrice, lors de son déplacement au Havre, le 6 juillet dernier, Jean-Louis Borloo a bien entendu la requête de l’ensemble des élus en faveur d’un calendrier resserré pour la ligne nouvelle. Aussi a-t-il demandé à Réseau ferré de France et à Jean-Pierre Duport, président du comité de pilotage, d’accélérer le plus possible la date de lancement du débat public, qui portera sur l’ensemble de l’ouvrage Paris-Normandie, dont la section Paris-Mantes constituerait une première tranche fonctionnelle. Il en résulte un calendrier resserré.
Pour que le débat public soit engagé à l’automne 2011, Réseau ferré de France doit saisir la Commission nationale du débat public, la CNDP, dès février 2011, sur la base d’un dossier simplifié.
Les études techniques, économiques et environnementales constituant le dossier de saisine de la CNDP et le dossier support du débat ont commencé dès septembre 2010 et se poursuivront pendant un an. Elles s’appuieront sur le dossier stratégique déjà présenté par RFF et sur toutes les contributions qui ont été apportées par les collectivités et organismes associés.
Le comité de pilotage ainsi que les comités territoriaux sont tenus régulièrement informés des résultats de ces études. C’est ainsi que les premiers scénarios ont pu être présentés au dernier comité territorial réuni le 14 octobre dernier à Rouen.
Le débat public sera l’occasion de présenter diverses options de passage et d’éclairer les décideurs sur les conditions de poursuite de cette opération, notamment pour ce qui concerne le ou les tracés à retenir pour les études opérationnelles qui suivront.
Madame la sénatrice, je sais l’importance que vous attachez à ce projet, et je partage votre idée selon laquelle il doit s’agir d’un grand projet d’aménagement pour la France, notamment pour les trois régions concernées, à savoir l’Île-de-France, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie.
Ce matin, après avoir répondu à deux questions orales sans débat, ici, au Sénat, je vais participer à l’inauguration d’un nouveau tronçon de ligne TGV en direction de la Suisse. Ne doutez pas que, au cours des trois heures que je passerai avec le responsable de RFF, je ne manquerai pas d’évoquer la ligne à grande vitesse en Normandie et demanderai le respect du calendrier afin que ce projet puisse voir le jour le plus tôt possible.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de votre réponse. Toutefois, une question demeure en suspens. J’aimerais avoir l’assurance qu’il est envisagé de prolonger, à terme, la ligne grande vitesse pour relier le portuaire à l’aéroportuaire, c'est-à-dire Le Havre via Rouen à Roissy.

La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la question n° 1051, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite appeler votre attention sur les ventes de listes d’appartements aux étudiants par certaines agences immobilières, communément appelées les « marchands de listes ».
Le principe est simple : une agence immobilière fournit au client une liste de logements à louer, moyennant le versement d’une somme d’argent. C’est ensuite au locataire potentiel de contacter directement les propriétaires.
Cependant, dans les faits, règne un véritable scandale dans la mesure où les marchands de listes n’assurent pas le service promis.
En effet, les annonces ne sont pas réactualisées, correspondent rarement à la demande formulée à l’origine par l’étudiant, ou les contacts ne sont pas joignables. Lorsque les clients mécontents exigent le remboursement de la somme versée au départ, les marchands de listes, la plupart du temps, refusent. Bref, il s’agit d’une pure escroquerie et d’une exploitation des jeunes étudiants, qui sont dans l’angoisse de trouver un logement.
Chaque année, cette arnaque continue à faire de nombreuses victimes : les étudiants, manquant de temps pour trouver un logement, sont attirés par le moindre coût de cette pratique, en comparaison avec les traditionnels frais d’agence.
Pourtant, une loi existe, mais le cadre réglementaire qu’elle fixe reste limité : elle oblige à établir une convention écrite avec « les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier » et précise que le paiement ne peut plus avoir lieu avant la transmission de la liste.
Actuellement, les contrats ne sont pas assez précis pour établir une réelle obligation de respecter le souhait du client. Les caractéristiques des logements recherchés se limitant à quelques critères, il est ensuite facile soit de proposer des appartements correspondant assez peu à la recherche initiale, soit de fournir une liste ne comportant qu’un ou deux appartements.
Il est donc nécessaire d’imposer des contrats plus détaillés, qui obligent les agences immobilières à remplir le service qu’elles promettent, à savoir mettre en relation propriétaires et locataires en accord sur une offre locative.
Par ailleurs, le paiement du service rendu devrait s’effectuer une fois le client satisfait, ce qui serait un gage de sérieux et dissuaderait les agences de fournir la même liste à des dizaines et des dizaines de clients.
J’ai noté que le Gouvernement a récemment demandé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, d’enquêter sur ce sujet afin de mieux contrôler les agences immobilières qui se livrent à de telles pratiques. Nous serons nombreux à examiner les conclusions de cette enquête et serons surtout attentifs à la suite que donnera le Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d'État, il est primordial de réformer le marché locatif, car les étudiants sont impuissants face à l’explosion des prix et de la demande. Vous le savez, il n’existe, en France, que 160 000 logements pour 1, 3 million d’étudiants. Il appartient donc à l’État de faire en sorte que ceux-ci puissent se loger rapidement, à des coûts raisonnables et dans le cadre de contrats sérieusement encadrés.
Pouvez-vous me dire où en est le Gouvernement sur ce sujet, qui, croyez-moi, préoccupe à chaque rentrée des milliers d’étudiants et de familles ?
Monsieur le sénateur, vous avez soulevé un vrai problème.
L’activité de marchand de listes est régie par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. Une carte portant la mention « marchand de listes » doit être sollicitée auprès de la préfecture compétente pour l’exercice de cette activité.
Afin de garantir que les offres figurant sur les listes correspondent à des biens effectivement mis sur le marché, cette réglementation prévoit l’obligation, pour le professionnel, de conclure une convention écrite avec le propriétaire du bien, ainsi qu’une convention avec l’acheteur de listes ou de fichiers, en vue de préciser notamment les caractéristiques du bien recherché et les moyens à mettre en œuvre pour que ne figurent sur la liste que des biens disponibles.
Par ailleurs, aucune somme d’argent ou rémunération n’est due au marchand de listes ou ne peut être exigée de lui préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers.
Malgré ce dispositif juridique contraignant, des pratiques consistant à proposer des listes non actualisées ou ne correspondant pas aux critères de choix ont été constatées – vous l’avez souligné, monsieur le sénateur –, constat que nous partageons, hélas !
Afin de mettre un terme à ces pratiques illicites, mon collègue Benoist Apparu a demandé au secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation de mobiliser la DGCRF pour étendre ses contrôles aux marchands de listes, lesquels ont débuté le 11 octobre dernier.
Plus généralement, M. le secrétaire d’État chargé du logement a demandé aux partenaires, notamment à l’UNPI, l’Union nationale de la propriété immobilière, à l’UNIS, l’Union des syndicats de l’immobilier, et à la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers, de lui faire des propositions pour moraliser la location des micro-surfaces.
Le Gouvernement attend bien évidemment rapidement de leur part des propositions sur la question des marchands de listes, en vue de faire évoluer ce dispositif. Comme vous connaissez bien cette question, monsieur le sénateur, vos suggestions, ou celles d’éminents collègues, seront les bienvenues.

Monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous remercier de votre réponse, car elle témoigne du fait que cette préoccupation est unanimement partagée.
Néanmoins, ce souci est récurrent : chaque année, lors de la rentrée universitaire notamment, les étudiants se plaignent d’avoir payé pour obtenir des listes qui ne correspondent pas à la demande qu’ils ont formulée ou nous signalent que le contact indiqué ne leur répond pas.
Certes, des contrôles ont été mis en place ; mais ceux-ci, on le sait, sont la plupart du temps ponctuels.
Par ailleurs, de quels moyens disposez-vous ? Quels résultats peut-on attendre ? Les cas d’espèce sont multiples dans la seule ville de Paris, et je ne pense pas que vous ayez les moyens de réaliser ces contrôles au-delà du périphérique, si je puis dire, voire ailleurs, alors que l’ensemble de notre pays est concerné.
Tôt ou tard – et le plus tôt sera le mieux ! –, une initiative législative devra s’imposer pour encadrer cette pratique.Certes, on peut faire confiance aux agences immobilières, qui font elles-mêmes confiance aux étudiants et les respectent. Mais lorsque les agissements s’apparentent quelque peu à de l’escroquerie, il faut envisager de réprimer.

La parole est à M. Robert Laufoaulu, auteur de la question n° 1031, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Ma question concerne le lycée agricole de Wallis, dossier que j’ai porté depuis ces dernières années avec le président de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et qui a reçu le soutien total des différentes autorités locales.
Ce lycée est un peu notre enfant, mais il doit le jour à l’écoute et à la réactivité de Bruno Le Maire et de Marie-Luce Penchard, que je remercie tous deux, ainsi qu’à l’aide de Luc Chatel dans la mesure où le ministère de l’éducation nationale prête ses locaux.
Actuellement, en effet, les enseignements agricoles ont démarré dans un collège de Wallis, et l’effectif dépasse soixante-dix élèves.
À la rentrée 2012, le lycée qui doit voir le jour devrait compter plus d’une centaine d’élèves. Sa création et son développement répondent à une orientation vitale pour un territoire aussi isolé que Wallis-et-Futuna.
Pour filer la métaphore, je dirai que ce lycée, pour grandir, pour prendre son essor et devenir adulte, a d’abord besoin d’un décret officialisant son existence. Je sais que ce décret est en cours de préparation et je souhaiterais savoir à quel moment sa parution est prévue.
Mais il faut aussi des moyens matériels, financiers et humains. Pourriez-vous m’apporter des précisions sur ce point, sachant que le ministère de l’outre-mer, en prévision de l’ouverture du lycée en janvier 2011, a accordé une délégation de crédits de 60 000 euros, sur les 110 000 euros nécessaires, pour l’amélioration des équipements ?
Nous comptons beaucoup sur l’aide du Gouvernement pour trouver dès que possible les 50 000 euros complémentaires, correspondant à l’achat d’un tracteur nécessaire à l’enseignement agricole qui sera délivré.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. Bruno Le Maire, lequel participe en ce moment au conseil des ministres.
Monsieur Laufoaulu, les préoccupations que vous exprimez sur l’avenir du lycée agricole de Wallis-et-Futuna témoignent de l’intérêt et de l’attention que vous manifestez à l’égard de l’enseignement agricole, reconnu comme une filière de réussite et d’insertion sociale et professionnelle dans les territoires, par la diversité de son offre de formation et l’originalité de son ancrage local.
Comme vous le savez, le projet de décret portant création de l’établissement public national d’enseignement et de formation agricoles, dénommé « lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna », est entré dans la phase finale de consultation auprès des ministres de l’éducation nationale, de l’outre-mer et du budget. Sa parution au Journal officiel est prévue en décembre 2010, pour une mise en application au 1er janvier 2011.
L’accompagnement de cette création, dont vous avez été l’un des initiateurs, a été prévu de la façon suivante.
Pour la prise en charge des coûts d’investissement, le ministère chargé de l’outre-mer s’est engagé sur le versement, dès la création du lycée professionnel agricole, d’un montant de 60 000 euros.
Au titre des coûts de fonctionnement, la subvention versée par le ministère de l’agriculture sur le programme 143 a, de son côté, progressé de 12 %. Cette augmentation correspond à une enveloppe supplémentaire de 8 000 euros, qui a été budgétée dès l’année 2010.
Toutes les possibilités de financement complémentaires au fonctionnement de cet établissement seront examinées avec beaucoup d’attention. Enfin, je souligne que sa dotation en emplois passe de 7, 5 équivalents temps plein travaillé pour l’année 2010 à 8 équivalents temps plein pour l’année 2011.

Je tiens à remercier Mme la secrétaire d’État pour cette réponse. J’attends bien sûr la visite de Mme Penchard et de M. Le Maire, qui viendront certainement voir ce lycée. Ils seront accueillis avec beaucoup d’attention et de reconnaissance.

La parole est à M. René Vestri, auteur de la question n° 1073, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Madame la secrétaire d’État, je veux attirer votre attention sur l’obligation de dénonciation faite aux fonctionnaires par l’article 40 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Cette obligation juridique s’impose non seulement aux fonctionnaires de police mais aussi à toutes les catégories de fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.
En effet, cet article 40 stipule que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Alors que les termes de ce texte paraissent clairs, force est de constater que les modalités d’application de cette disposition sont plus que variables et parfois même arbitraires.
J’en veux pour preuve un cas particulier survenu dans mon département des Alpes-Maritimes. Conformément aux dispositions générales de l’article 40, un élu a dénoncé aux plus hautes autorités de l’État les conditions d’attribution d’un marché public portant sur un montant de 150 millions d’euros.
Moi-même, interpellé par différentes associations, je suis intervenu auprès du préfet pour appuyer le dossier, mais aucune réaction des instances de l’État n’est venue étayer ma demande.
Je ne comprends pas cette attitude et je crains que cette situation ne fasse qu’accroître la défiance des citoyens envers l’État, les collectivités locales et la justice.
Aussi, madame la secrétaire d’État, pourriez-vous m’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’article 40 du code de procédure pénale et celles de l’article 434-1 du code pénal ?
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Michel Mercier, qui participe en ce moment au conseil des ministres.
Monsieur Vestri, comme vous l’avez rappelé, l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale couvre un domaine beaucoup plus large que d’autres obligations légales qui imposent un devoir de révélation à certaines autorités. Il n’opère pas de distinction entre les crimes et délits selon leur gravité.
Il concerne tous les crimes et délits dont aurait connaissance un fonctionnaire, un officier public ou toute autorité constituée.
Ces personnes sont soumises à des devoirs et à des obligations plus étendus que les citoyens ordinaires, puisque leurs fonctions imposent de servir l’intérêt général dont l’État est le garant.
Cette exigence a été rappelée depuis de nombreuses années par les gardes des sceaux successifs. En effet, l’absence de révélation par l’administration de faits portés à sa connaissance, à l’occasion de l’exercice de ses missions, conduit cette dernière à apprécier, au lieu et place du ministère public, l’opportunité des poursuites. Elle a donc une obligation de révélation.
À l’inverse, et pour les mêmes raisons, un signalement adressé au parquet au titre de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne lie pas le ministère public. Ce dernier conserve l’opportunité des poursuites, comme pour toutes les plaintes et dénonciations dont il est saisi. Le parquet apprécie en effet les suites qu’il convient de réserver au signalement, selon les distinctions précisées à l’article 40-1 du code de procédure pénale introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à savoir la mise en mouvement de l’action publique, l’engagement d’alternatives aux poursuites ou le classement sans suite.
La loi précitée a également institué, à l’article 40-2 du code de procédure pénale, le principe d’un avis du parquet aux plaignants, aux victimes et aux personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40 du même code, quand des poursuites ou des alternatives aux poursuites ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Cette information réciproque des autorités administratives et judiciaires sur les infractions dénoncées et les suites qui leur sont réservées à travers l’avis paraît de nature à faciliter, dans le respect des attributions de chacun, un fonctionnement transparent de la vie publique, conforme aux attentes légitimes de nos concitoyens.
Les prescriptions de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de rappeler les contraintes de l’article 40.
Dans le cas que je viens d’évoquer, il s’agit d’un marché public de 150 millions d’euros, au sujet duquel le doute était flagrant et la tentative de fraude certaine. Le maire ayant été avisé, il a immédiatement bloqué le marché. C’est donc la preuve qu’il s’est passé quelque chose.
Je pars d’un principe très simple : pour apprécier, il faut comparer. Or, j’ai pu constater que, dans une affaire portant sur 3 000 euros, des perquisitions avaient été immédiatement opérées, des mises en garde à vue avaient été effectuées, et l’ensemble d’un conseil municipal avait été appelé à témoigner. Il s’agissait, je le répète, de 3 000 euros. Or, dans le cas particulier que je viens d’évoquer, madame la secrétaire d’État, c’était un marché public de 150 millions d’euros ! Et rien, rien n’a été fait ! Voilà ! C’est tout !

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 1047, transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les zones de revitalisation rurale ont été mises en place avec pour objectif de soutenir des zones difficiles, des zones où la population s’en va, sans retour peut-on dire. Il s’agit de zones où la disponibilité de terrain à destination de construction individuelle, artisanale ou industrielle présente un prix compétitif ; mais, comme vous le savez, madame le secrétaire d’État, les hommes, dont les responsables d’entreprise, choisissent leur lieu de vie ou d’activité, et les élus sont souvent désarmés devant ces décisions.
Créées le 4 février 1995 par la loi sur les territoires ruraux, ces zones ont été améliorées en 2005, avec des dispositifs fiscaux appréciables, ainsi que par une incitation à enrichir l’intercommunalité.
Madame la secrétaire d’État, en France, le zonage est parlant. Par exemple, dans mon département, la Haute-Loire, 188 communes sur 260 sont en zones de revitalisation rurale. Ce n’est pas une exception, puisque trois départements français sont totalement en zones de revitalisation rurale. Ces zones couvrent environ un tiers du territoire national.
Reconnaissons que ces aides sont très appréciables et qu’elles sont non pas des privilèges mais des compensations souvent liées à la topographie, au climat et, bien sûr, à la démographie.
Inutile de vous dire que nous souhaitons très vivement le maintien de ce dispositif permettant d’accompagner les territoires ruraux les plus sensibles.
Madame la secrétaire d’État, bien que conscients des difficultés budgétaires nationales, nous souhaiterions très vivement le maintien, voire l’ouverture de ces aides à certaines initiatives, comme la création d’emploi par exemple.
Nous souhaiterions également, et cela en toute objectivité, que ces zones soient prioritaires dans le cadre des pôles d’excellence rurale, car il faut agir vite dans certains secteurs, avant qu’il ne soit trop tard.
Je vous remercie beaucoup de bien vouloir m’indiquer les perspectives envisagées dans ce domaine.
Monsieur Boyer, vous le savez, les zones de revitalisation rurale, créées par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, regroupent les territoires ruraux les plus fragiles, en déprise démographique ou ayant des handicaps structurels sur le plan socio-économique.
Le classement en zones de revitalisation rurale concerne environ un tiers des communes françaises, représentant 8 % de la population. Les entreprises installées dans ces zones bénéficient d’exonérations des cotisations sociales patronales et d’exonérations fiscales. Environ 500 millions d’euros sont octroyés chaque année au titre de ces exonérations.
Ce dispositif est essentiel pour l’attractivité et le développement économique des territoires ruraux les plus fragiles. C’est pourquoi, lors du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 11 mai dernier, le Premier ministre a décidé de renforcer le ciblage de ce dispositif, afin de le rendre encore plus efficace.
Ainsi, l’article 65 du projet de loi de finances prévoit une ouverture très importante du dispositif d’exonération en faveur des entreprises, puisqu’il l’étend à la reprise et à la transmission d’entreprises, contribuant ainsi à la pérennité du tissu d’entreprises artisanales en milieu rural, enjeu majeur pour ces territoires.
Cet élargissement s’accompagne d’un ciblage du dispositif sur les entreprises de moins de dix salariés pour une durée d’exonération fiscale de huit ans.
Enfin, le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire a chargé le ministre en charge de l’aménagement du territoire de proposer les évolutions nécessaires concernant les critères retenus pour la définition de zones de revitalisation rurale et permettant d’accompagner les territoires ruraux les plus sensibles.

Ma réponse sera courte et claire. Madame la secrétaire d'État, nous nous réjouissons que ces mesures d’accompagnement perdurent dans nos zones difficiles.

La parole est à M. Georges Patient, auteur de la question n° 1037, adressée à M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la secrétaire d'État, une fois de plus, j’attire l’attention du Gouvernement sur la situation critique des finances des collectivités locales de Guyane. La situation financière de ces dernières se démarque en effet de celle des autres départements d’outre-mer par des produits de fiscalité directe plus faibles, en raison des particularités du département : un produit intérieur brut qui est le plus bas des quatre départements d’outre-mer, un taux de croissance démographique de 3, 9 % qui est le plus dynamique des régions françaises, un seuil de pauvreté qui est le plus important de France, plus de 50 % des foyers fiscaux disposant d’un revenu inférieur à 9 400 euros, contre seulement 26 % en métropole.
Pour compenser la croissance inévitable des charges des collectivités locales de Guyane, croissance forcément supérieure à la progression de leurs recettes, la seule véritable solution demeure, pour l’heure, une meilleure adaptation des concours financiers de l’État aux réalités de la Guyane.
Pour ce faire, l’État doit adapter la dotation globale de fonctionnement, véritable outil de péréquation, en se fondant sur des critères plus opérants, tels que le revenu moyen par habitant, le nombre d’élèves scolarisés sur le territoire par rapport à la population totale et la situation sociodémographique avec sa pyramide des âges à base très élargie qui n’a rien à voir avec les standards nationaux.
En outre, l’État doit dans l’immédiat supprimer le plafonnement qui frappe la dotation superficiaire, institué pour les seules communes de Guyane et faisant perdre annuellement à celles-ci 16 millions d’euros, quitte à instaurer une péréquation de ce montant entre les seules communes de Guyane.
Enfin, l’État doit rétrocéder aux communes de Guyane les 27 millions d’euros qui leur font défaut au titre de l’octroi de mer. Il faut préciser que ce sont les seules communes d’outre-mer à subir un tel prélèvement.
Au total, au titre de ces deux recettes, ce sont 43 millions d’euros qui échappent chaque année aux communes de Guyane.
Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de me faire savoir ce que peuvent espérer les collectivités de Guyane sur tous ces points.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des finances des collectivités locales de Guyane.
Je vous prie tout d’abord d’excuser M. Brice Hortefeux, qui participe en ce moment au conseil des ministres.
Par principe, les dotations de l’État aux collectivités territoriales des départements et régions d’outre-mer sont, chaque fois que cela est possible, identiques au droit commun métropolitain, le principe constitutionnel d’unité s’appliquant.
Les communes d’outre-mer bénéficient ainsi, à l’instar des communes de métropole, d’une dotation globale de fonctionnement composée d’une part forfaitaire et d’une part de péréquation, celle-ci étant toutefois calculée dans des conditions favorables.
En effet, le mode de calcul de la dotation d’aménagement ultramarine traduit la solidarité nationale en faveur des communes d’outre-mer, puisque leur est affectée une quote-part prélevée sur la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale, ainsi que la dotation nationale de péréquation plus favorable que celle qui résulte de leur strict poids démographique au sein de la population nationale totale.
En outre, la réforme de la dotation globale de fonctionnement de 2005, en instituant une dotation forfaitaire indexée sur la population, a été largement favorable aux collectivités de Guyane, qui connaissent, comme vous l’avez rappelé, une croissance démographique élevée.
En instituant une part indexée sur la superficie, cette réforme a également été favorable à certaines communes très étendues des départements d’outre-mer, notamment en Guyane.
L’ensemble de ces dispositions est donc largement à l’avantage des collectivités de Guyane, qui bénéficient de montants de dotation globale de fonctionnement bien supérieurs aux moyennes nationales, attestant de la prise en compte des particularités du département.
Ainsi, en 2010, tandis que le montant moyen de dotation globale de fonctionnement par habitant des communes s’élevait à 240 euros à l’échelon national, le montant moyen en Guyane atteignait 280 euros, soit près de 17 % de plus.
Pour 2011, alors que l’enveloppe des concours financiers de l’État est gelée, et tandis qu’un certain nombre de collectivités verront leur dotation globale de fonctionnement diminuer, les communes guyanaises continueront de bénéficier du mécanisme leur garantissant annuellement une progression de leur dotation globale de fonctionnement totale.
S’agissant plus spécifiquement de l’octroi de mer, les 27 millions d’euros que vous évoquez n’échappent pas à la Guyane, puisqu’ils sont attribués au département, qui, depuis 1974, perçoit une part du produit de l’octroi de mer. Cette part dans les recettes des communes guyanaises demeure significative, puisqu’elle représente en moyenne 47 % des recettes fiscales totales.
Enfin, s’agissant des recettes fiscales, le constat d’une insuffisance d’identification des bases fiscales de contributions directes en Guyane est largement partagé. Un travail important d’identification de ces bases est en cours de réalisation dans le cadre de la démarche de restructuration financière des communes et devrait, à terme, permettre un surcroît de recettes fiscales.

Madame la secrétaire d'État, il faut comparer ce qui est comparable. La Guyane est un vaste département de quelque 90 000 kilomètres carrés, qui connaît une très forte croissante démographique, la plus importante de France et l’une des plus importantes du monde, et un produit intérieur brut par habitant qui ne représente pas la moitié du niveau français.
Il est donc tout à fait naturel qu’un effort soit consenti pour ce département en raison de sa démographie. Mais ce que nous réclamons, c’est une meilleure application du droit commun, et je m’arrêterai sur les deux recettes que vous avez citées : l’octroi de mer et la dotation superficiaire. Elles doivent être appliquées en Guyane, comme elles le sont en France métropolitaine et dans les autres départements d’outre-mer.
Alors que l’étendue des communes permettait pour une fois à la Guyane de bénéficier d’une dotation importante, le montant de la dotation superficiaire a été plafonné par rapport à celui de la dotation de base à 3 euros l’hectare, et cela uniquement pour ce département, puisque ce n’est pas le cas des autres départements d’outre-mer, ni de la France métropolitaine, où la dotation a même été augmentée pour les communes de montagne !
Il en va de même pour l’octroi de mer : alors qu’il est intégralement versé aux communes de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion, l’État, de façon unique et inique, prélève une part de 27 millions d'euros par an au profit du conseil général de Guyane, qui connaît des difficultés financières. On a presque une péréquation entre pauvres ! Nous réclamons donc à juste titre que ces sommes soient rétrocédées aux communes de Guyane.
Si l’on ajoute à ce prélèvement sur l’octroi de mer l’amputation de la dotation superficiaire, ce sont 43 millions d'euros que perdent les communes de Guyane. Certes, les sommes concernées, versées pour partie au conseil général et pour partie aux communes, profitent à la Guyane. Mais la plupart des communes sont en déficit et, tant qu’on ne leur restituera pas ces sommes, le marasme qu’elles connaissent actuellement perdurera !
Voilà pourquoi j’insiste à nouveau sur cette question, que je ne pose d’ailleurs pas pour la première fois.

La parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la question n° 1041, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

Madame la secrétaire d'État, voilà plus d’un an déjà, le Président de la République annonçait le lancement du Plan cancer 2009-2013, dit Plan cancer II, qui doit mobiliser un budget de 750 millions d’euros, afin de financer la lutte contre le cancer, première cause de mortalité par maladie en France.
Après avoir qualifié d’ « inacceptables » les inégalités tant sociales que géographiques des patients face à ce fléau, le Président de la République avait désigné la consommation de tabac et d’alcool comme étant la principale responsable de cette pandémie.
En conséquence, le Plan cancer II met en œuvre un volet Prévention principalement dédié à ces deux facteurs, ainsi qu’à la promotion d’une alimentation équilibrée ou encore d’exercices physiques quotidiens.
Le volet environnemental des causes de la maladie en est complètement absent. Pourtant, depuis la publication des conclusions concordantes de plusieurs études indépendantes au niveau international, de nombreux médecins spécialisés en oncologie s’accordent à reconnaître que 80 % des cancers ont une cause environnementale.
Cet oubli est donc dramatique, pour ne pas dire coupable. Compte tenu de l’avancée des connaissances scientifiques et médicales, le principe de précaution doit être appliqué pour la contamination de l’eau, de l’air, des sols et de la nourriture par des produits cancérigènes.
Je pense en particulier à l’usage de certains pesticides dans l’agriculture ou encore de plastiques, comme le bisphénol A, dans l’industrie agroalimentaire.
Seule une volonté politique forte peut orienter et mobiliser les moyens nécessaires à la recherche scientifique, en vue d’identifier le rôle exact des polluants dans l’apparition des cancers. La France doit s’atteler à cette tâche et intensifier son effort de recherche dans ce domaine. Pour atteindre cet objectif, elle doit notamment rassembler des disciplines scientifiques complémentaires telles que la carcinogenèse, la toxicologie in vivo, in vitro, in silico, la toxicologie génomique, l’épidémiologie descriptive et analytique, l’épidémiologie moléculaire, les biostatistiques ou la biosurveillance.
La mise en place de ces nouveaux outils est urgente. Elle traduirait non seulement une prise de conscience nouvelle, mais surtout une volonté d’agir. Les solutions sont nombreuses. Je pense notamment à la création d’une chaire « environnement et cancer » et d’un institut de recherche sur les causes du cancer adossé à l’un des cancéropôles, ainsi qu’à la promotion et au développement de la chimie verte et, plus largement, des technologies vertes.
C’est pourquoi je vous demande, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir préciser, d’une part, le montant qui sera consacré à la recherche des causes environnementales dans le cadre du Plan cancer II et, d’autre part, la date prévue pour la mise en place de passerelles clairement identifiées entre les différents cancéropôles français et le Pôle national applicatif en toxicologie et écotoxicologie, récemment créé. Enfin, il est essentiel que le Gouvernement puisse traduire en actes les résultats des recherches scientifiques, et ce de façon beaucoup plus réactive.
Pour illustrer mon propos, je rappelle que les particules fines diffusées dans l’atmosphère par les moteurs automobiles diesels sont reconnues comme hautement cancérigènes. Les mesures fiscales incitant à l’achat de véhicules automobiles diesels, mises en place par le précédent gouvernement, représentent donc un danger pour la santé publique. Que comptez-vous faire pour y remédier ?
Madame la sénatrice, vous m’interrogez, d’une part, sur les moyens consacrés à la recherche scientifique relative aux causes environnementales du cancer et, d’autre part, sur l’existence de passerelles entre les centres de recherche.
Tout d’abord, je tiens à souligner que l’une des mesures phare du Plan cancer 2009-2013 concerne l’identification des risques liés à l’environnement général et professionnel.
En effet, 2, 3 millions d’euros ont été directement consacrés en 2009 au financement de projets de recherche sur les risques environnementaux et comportementaux. D’ici à la fin du plan, 15 % de la recherche en cancérologie aura été consacrée à l’analyse des risques environnementaux et comportementaux.
Concernant l’existence de passerelles, je puis vous assurer, madame la sénatrice, que les différentes disciplines de recherche sont d’ores et déjà mobilisées, afin d’associer divers spécialistes sur certains types de cancer.
De même, la recherche compétitive en toxicologie, en génétique et épidémiologie moléculaire, ainsi qu’en recherche clinique interventionnelle, est réactivée via sept appels à projet de recherche portant sur les risques environnementaux et comportementaux et financés par l’Institut national du cancer, l’INCA, en 2009 et en 2010, à hauteur de 1, 5 million d’euros.
Un appel à projet en écotoxicologie lancé par l’Agence nationale de la recherche, l’ANR, sera également cofinancé par l’INCA à hauteur de 2 millions d’euros pour les projets en lien avec le cancer.
Concernant la coordination entre différents pôles de recherche relative aux causes environnementales, l’INCA et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, organiseront un colloque international sur les causes environnementales des cancers dans le courant de l’année 2011.
En 2010, les deux agences ont lancé un appel à projets conjoints, qui a permis la sélection de huit projets à hauteur de 1 million d’euros, en complément des cinq projets déjà soutenus par l’ANSES dans le cadre du Programme national de recherche en environnement-santé-travail.
Je tiens par ailleurs à rappeler que le Plan cancer s’articule avec le volet recherche du Plan national santé-environnement 2009-2013, qui vise notamment à renforcer la recherche sur les interactions entre la qualité des milieux environnementaux et la santé des populations, ainsi qu’à développer la recherche sur certaines pathologies en forte augmentation du fait de l’exposition des populations aux polluants environnementaux.
J’évoquerai enfin les instruments de recherche destinés à l’ensemble de la communauté scientifique travaillant sur ces sujets.
Trois cohortes, qui font partie des très grandes infrastructures de recherche, pilotées par l’Institut de recherche en santé publique, l’IRESP, et l’Institut thématique santé publique, sont soutenues financièrement par l’INCA et la Ligue nationale contre le cancer, pour un montant annuel de 3 millions d’euros.
En outre, l’INCA et les cancéropôles Nord-Ouest et Grand Sud-Ouest participent au financement de la cohorte AGRICAN. Celle-ci, composée de plus de 180 000 personnes, doit mettre en lumière les effets à long terme des pesticides.
Vous l’aurez compris, madame la sénatrice, la recherche sur les causes environnementales du cancer tient une place importante au sein de ce plan national, et les moyens qui lui sont alloués nous permettront de mieux connaître ce type de risque et d’adapter nos politiques de lutte en fonction des données de la recherche dans ce domaine.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, qui comporte de nombreux chiffres et renseignements, et que je relirai bien sûr avec attention.
J’insiste toutefois sur la difficulté à disposer, face au lobbying industriel, d’une expertise objective, ce qui me conduit à faire appel à votre vigilance. Au demeurant, sachez que je continuerai à suivre avec attention les évolutions du Plan cancer.

La parole est à M. Roger Madec, auteur de la question n° 1012, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le droit à la tranquillité et le droit à la sécurité sont reconnus par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; leur non-respect constitue une inégalité sociale supplémentaire.
Des élus parisiens, bien que démunis de pouvoirs de police, mobilisent des moyens sans précédent pour soutenir les clubs de prévention, les structures de prise en charge sanitaire de la toxicomanie ou des systèmes innovants tels que les équipes de correspondants de nuit, dans un contexte de désengagement du Gouvernement dans les domaines sociaux et éducatifs.
J’ajoute que les élus parisiens sont engagés dans une démarche partenariale et constructive de coproduction avec les services de la préfecture de police, dans le cadre de la signature des contrats de sécurité d’arrondissement.
En tant qu’élu local, je mesure quotidiennement non seulement le dévouement de nos policiers, mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent pour assurer pleinement leur mission. Je ne m’associe donc pas aux propos parfois irresponsables tenus à leur encontre. Je souhaite, en outre, rendre hommage au préfet de police Michel Gaudin, qui est un grand fonctionnaire.
Cependant, je ne peux m’empêcher de vous interpeller sur la politique de sécurité mise en place depuis huit ans.
L’abandon en 2002 de la police de proximité par le ministre de l’intérieur de l’époque – il occupe aujourd’hui les plus hautes fonctions de l’État –, confirmé par les gouvernements successifs depuis 2007, ainsi que la suppression programmée, mais discrète, de 5 000 postes de policiers d’ici à 2011 dans les arrondissements parisiens – il a été indiqué aux syndicats que les départs ne seront pas remplacés durant une année –, dans un contexte d’approfondissement de la crise économique et sociale du pays, se traduisent par une aggravation et une généralisation des atteintes à la tranquillité des habitants dans les espaces publics et privés, particulièrement dans les halls d’immeuble.
Ce phénomène est aussi aggravé par la multiplication du nombre de trafics de stupéfiants orchestrés, à la vue de tous, à l’intérieur des immeubles, qui accroît, auprès de nos concitoyens, un sentiment d’impunité.
Les commissariats locaux ont-ils réellement les moyens de combattre ce fléau, dès lors que les moyens importants se concentrent sur le démantèlement des gros trafics ?
Cette détérioration des effectifs est fortement ressentie sur le terrain, et les habitants considèrent à juste titre que la police n’est plus « à leurs côtés » et n’a pas les moyens nécessaires pour réagir au plus vite et se déplacer rapidement en cas d’infraction signalée.
Je me félicite de la progression du taux d’élucidation des crimes et délits par nos forces de police. Malheureusement, une telle réussite cache d’autres chiffres plus inquiétants.
Entre 2008 et 2009, les violences physiques crapuleuses ont augmenté de 17, 5 % et les violences physiques non crapuleuses, de plus de 21% entre 2001 et 2009.
Plus grave, les menaces de violence et de chantage, quant à elles, ont enregistré une hausse de 157, 08 % de 2001 à 2009.
Que dire de la délinquance de proximité, appellation moderne de l’ancienne « délinquance de voie publique », pour laquelle le Président de la République avait prédit, à la fin de l’année 2007, une baisse de 10 % ? Or, dans le 19e arrondissement de Paris, aucune baisse significative n’est intervenue. Au contraire, nous observons une recrudescence inquiétante – de près de 16 % entre 2008 et 2009 – des infractions relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité physique.
Ainsi le sentiment d’insécurité reste-t-il lourdement ancré dans le paysage social de l’Est parisien.
En conséquence, madame la secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir m’indiquer quels moyens supplémentaires visibles et concrets vous allez mettre en place afin que le droit à la sécurité et à la tranquillité publique soit assuré pour tous dans Paris.
Monsieur Madec, je vous prie de bien vouloir excuser M. Brice Hortefeux, qui se trouve en ce moment même au conseil des ministres et qui m’a demandé de vous répondre.
Il apparaît toutefois que votre question originelle portait davantage sur les violences qui se sont déroulées dans le 19e arrondissement de Paris au cours de la fête nationale.
Comme les années précédentes, la préfecture de police a mis en place un dispositif renforcé de sécurisation et de surveillance de la voie publique durant les deux jours traditionnellement sensibles des 13 et 14 juillet.
Dans le 19e arrondissement, comme dans les arrondissements voisins, la présence policière des effectifs locaux sur la voie publique a été renforcée par des unités départementales et des effectifs de forces mobiles, à hauteur d’une demi-compagnie de CRS. Leur déploiement a été optimisé afin d’assurer une forte visibilité des effectifs en tenue et de procéder à des arrestations en flagrant délit, par des policiers en civil. Douze équipages de la BAC, la brigade anti-criminalité, civile ont ainsi été engagés.
Des mesures spécifiques ont été prises pour lutter contre les phénomènes potentiels de violences urbaines, tels que des incendies de véhicules ou de containers ou des jets de projectiles.
Durant les deux nuits, les effectifs territoriaux ont été spécialement dédiés à des missions de sécurisation générale et de surveillance des festivités locales. La sécurisation des zones sensibles a été assurée par des effectifs en civil pour procéder au contrôle et à l’arrestation de tout individu au comportement suspect et susceptible de commettre une infraction.
Les compagnies de sécurisation et d’intervention de Paris, les CSI 75, les forces mobiles et les unités de la BAC 75 N ont été fortement mobilisées dans les quartiers sensibles du 19e arrondissement, notamment les quartiers Danube-Solidarité, Curial-Cambrai et Orgues de Flandre. Six sections de la CSI 75, soit 18 équipages, ont été mises à disposition, ainsi que quatre équipages motocyclistes. En outre, une demi-compagnie de CRS a été positionnée place du Général Cochet, en réserve d’intervention et sécurisation.
Ces moyens importants ont permis de faire cesser très rapidement les troubles qui ont pu être constatés au cours de ces festivités et d’interpeller leurs auteurs pour les mettre à la disposition de la justice.
Ainsi, dans la nuit du 13 juillet, les effectifs de la CSI 75 ont arrêté cinq individus qui avaient dressé des barricades dans la cité Curial-Cambrai et qui étaient en possession de bouteilles en verre, d’engins incendiaires et de pétards de forte puissance. Ils ont été immédiatement placés en garde à vue.
L’incident majeur a été l’incendie qui s’est déclaré à la fin du bal dans l’enceinte de la caserne des pompiers de la place de Bitche, à la suite de jets de pétards et de feux d’artifices.
Aucun autre incident grave n’a été porté à la connaissance des services.
Au total, une vingtaine d’interpellations ont été réalisées durant les deux nuits sur le 19e arrondissement, entraînant toutes des placements en garde à vue, notamment pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et jets de projectiles.

Avec tout le respect que je vous dois, madame la secrétaire d’État, vous n’avez pas compétence pour me répondre, même si tous les membres d’un gouvernement sont engagés par les décisions gouvernementales.
Par conséquent, je regrette que le ministre de l’intérieur ne soit pas là, d’autant que d’autres ministres seront présents tout à l’heure pour répondre aux questions de mes collègues. La situation – je suis désolé de le dire – est donc quelque peu inconvenante.
Madame la secrétaire d’État, ma question ne portait pas uniquement sur les incidents du 14 juillet, qui constituent un épiphénomène concentré sur deux jours. Sur le fond, je constate que vous ne m’avez apporté aucune réponse, ce qui me laisse sur ma faim.
Pour faire face à la suppression de postes, les forces de police, à Paris comme dans d’autres métropoles urbaines, gèrent la pénurie, en donnant le meilleur d’elles-mêmes.
Je le répète, il est fort dommage que la police de proximité mise en place par un ancien ministre de l’intérieur qui siège aujourd’hui dans notre assemblée ait été démantelée, sans qu’aucune solution concrète ait été apportée par la suite.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, auteur de la question n° 1052, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la présidente, madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, la révision de la législation sur le financement des campagnes électorales et son extension aux élections sénatoriales ont été évoquées à plusieurs reprises.
La question a en particulier été soulevée par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud et mis en place par le président de l’Assemblée nationale – l’Assemblée nationale adore s’occuper de nous ! – qui plaidait pour l’extension de la loi aux campagnes électorales sénatoriales, mais la modestie des dépenses engagées dans ce cadre ne rend pas particulièrement urgente une telle réforme. En outre, celle-ci impliquerait le remboursement des dépenses afférentes et aurait donc un coût.
Il faut néanmoins rappeler que les règles générales prévues par le code électoral en matière de dépenses électorales s’appliquent à l’élection sénatoriale.
À cet égard, subsiste une incertitude juridique quant à la portée dans le temps de la notion de « dépenses électorales ».
La législation prévoit en effet que constitue une dépense électorale une dépense engagée dans l’année précédant l’élection. Il s’agit là d’une norme générale, s’appliquant à toutes les élections. Or, en l’absence de textes interprétatifs de cette notion pour l’élection des sénateurs, il est arrivé, semble-t-il, que le ministère de l’intérieur retienne la période couvrant toutes les dépenses engagées pendant la durée du mandat.
Cette question n’est pas innocente, d’autant qu’elle pourrait se poser, de la même manière, pour les cantons de moins de 9 000 habitants – l’établissement de comptes de campagne n’est pas prévu dans ce cas – et pour toutes les communes qui ne sont pas concernées par le remboursement des frais de campagne. Cela va donc bien au-delà des élections sénatoriales.
Madame le secrétaire d’État, pourriez-vous donc m’apporter une réponse claire permettant de lever cette incertitude juridique ?
Monsieur le sénateur, je vais vous livrer la réponse de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur cette question relative à l’application aux élections sénatoriales des dispositions relatives au financement des campagnes électorales.
Il convient tout d’abord de rappeler que, aux termes de l’article L.308-1 du code électoral, les seules dispositions qui s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales sont celles des deuxième et cinquième alinéas de l’article L.52-8 du même code, prohibant le financement des campagnes par les personnes morales ou les États étrangers.
Je tiens toutefois à vous préciser que, lorsque l’article L.52-4 du code électoral s’applique – ce n’est actuellement pas le cas pour les élections sénatoriales –, la notion de « dépense électorale » s’apprécie bien pour la seule année précédant le mois de l’élection, et non pas pour l’ensemble de la durée du mandat.
Au-delà de ce point précis, l’extension de la loi relative au financement des campagnes électorales aux élections sénatoriales a effectivement été proposée par le groupe de travail présidé par Pierre Mazeaud dans son rapport rendu en 2009.
Je sais par ailleurs qu’un groupe de travail a été constitué, au sein de la commission des lois que vous présidez, afin de réfléchir aux différentes modifications qu’il conviendrait d’apporter à notre législation électorale.
Le Gouvernement est tout à fait ouvert à une réflexion sur ce sujet. En tout état de cause, il appartiendra au Sénat de se prononcer, le moment venu, sur ce sujet, qui touche aux modalités même d’élection de ses membres.

Je vous remercie de cette réponse, madame le secrétaire d’État, même si, bien entendu, ce n’est pas tout à fait celle que j’attendais. Vous nous dites en effet que nous ne sommes pas vraiment visés par ces dispositions, mais que, dans tous les cas, la période prise en compte est d’un an avant le mois de l’élection.
Il est vrai que nous travaillons actuellement, d’ailleurs en collaboration avec le ministère de l’intérieur, sur des évolutions possibles du dispositif. Mais je pense qu’il est important que nos collègues dont les sièges seront renouvelés en septembre prochain disposent d’une certaine sécurité juridique s’agissant des dépenses qu’ils pourraient engager à cet effet.
J’attire de nouveau votre attention, madame le secrétaire d’État, sur le fait que cette question ne se limite pas aux seules élections sénatoriales, mais peut aussi concerner les cantons de moins de 9 000 habitants et les communes qui ne sont pas soumises aux obligations existantes en matière de comptes de campagne.
Il faudrait donc, me semble-t-il, que la règle générale tendant à comptabiliser les dépenses électorales sur une période d’un an précédant les élections – et pas plus – soit bien précisée dans les textes de loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, auteur de la question n° 1055, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame le secrétaire d’État, je veux attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur une question difficile, mais importante : la pérennisation de la Fondation pour les œuvres de l’islam de France.
Ce projet a vu le jour dès 1999, dans le but de permettre à nos concitoyens de confession musulmane de pratiquer leur culte à l’égal des personnes qui se réclament de l’une des trois autres religions traditionnelles.
Alors ministre de l’intérieur, je citais volontiers l’historien Maurice Agulhon : s’il y a place pour trois, il doit y avoir place pour quatre à la table de la République. J’ai lancé à cette époque une consultation, une istichara, qui a abouti à la création du Conseil français du culte musulman – le CFCM – par M. Nicolas Sarkozy, mon successeur au ministère de l’intérieur.
Le projet de fondation dans le but d’améliorer les conditions d’exercice du culte des musulmans français a été « institutionnalisé » au travers de la création, le 31 mai 2005, de la Fondation pour les œuvres de l’islam de France.
Cette institution est chargée de trois missions, dont la principale est la construction et la gestion des lieux de culte, en accord avec les maires des communes concernées, qui, souvent, mettent à disposition des terrains sous le régime de baux emphytéotiques.
Forte de sa reconnaissance en Conseil d’État, de la caution de l’administration par sa présence au sein du conseil d’administration, de l’engagement de la Caisse des dépôts et consignations, du dépôt d’une somme non négligeable - un million d’euros allouée en vue de son financement par une entreprise française ; d’autres entreprises opérant à l’étranger, notamment dans des pays musulmans, étaient également conviées à contribuer à son action –, forte donc de tous ces avantages tout à fait spécifiques auxquels venait s’ajouter l’accord, dans un premier temps, de toutes les parties musulmanes, cette fondation disposait initialement d’atouts considérables.
Que s’est-il passé ?
Des difficultés ont surgi – je ne l’ignore pas – au sein de son conseil d’administration et la collecte de fonds supplémentaires, par rapport à la dotation originelle de un million d’euros, s’est trouvée interrompue.
Ces dysfonctionnements tiennent d’abord à la composition du conseil d’administration, liée aux équilibres difficiles à trouver, au sein du CFCM, entre les trois fédérations principales de l’islam de France : l’Union des organisations islamiques de France – l’UOIF –, la Fédération nationale des musulmans de France – la FNMF – et la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris – la FNGMP.
Chacune a effectivement son propre dispositif de financement et c’est là, madame le secrétaire d’État, la question qui se pose : va-t-on s’accommoder d’un système dans lequel chacun dispose de ses propres réseaux, de ses propres relais, de ses propres donateurs ?
Selon moi, il appartient à l’État républicain de faire en sorte que les financements que les uns et les autres peuvent obtenir, de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite, du Maroc, de tel ou tel autre pays du Golfe, puissent transiter par le canal de la Fondation pour les œuvres de l’islam de France, de façon que l’argent collecté soit mis en commun.
C’est un test, madame le secrétaire d’État, pour ce que l’on appelle l’islam de France, et non pas l’islam en France !
L’islam de France ne peut se résumer à la juxtaposition de réseaux plus ou moins financés par des pays étrangers. L’État a son mot à dire sur cette question. J’ajoute que l’objectif doit rester de mettre à contribution les entreprises françaises.
Une politique cohérente doit donc être élaborée, tenant compte des besoins des musulmans de France et faisant naturellement une juste place aux différentes sensibilités de l’islam. Ils peuvent s’entendre ! Ce sont des hommes et, en plus, comme je leur ai déjà dit, ce sont des musulmans.
C’est à l’État de faire en sorte que ces équilibres puissent être trouvés et, s’il saisit l’opinion, il aura l’appui de la majorité des musulmans.
Je souhaite donc que vous m’indiquiez, madame le secrétaire d’État, les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer la pérennité de la Fondation pour les œuvres de l’islam de France.
Je vous demande aussi de m’indiquer le montant des fonds dont elle dispose actuellement à la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, que vous avez interrogé sur la Fondation pour les œuvres de l’islam de France. Voici la réponse qu’il m’a demandé de vous faire.
Permettez-moi, tout d’abord, de souligner que le Conseil français du culte musulman est progressivement devenu l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour toutes les questions relatives à l’exercice du culte musulman sur le territoire français.
En tout juste sept ans d’existence, le CFCM et les vingt-cinq conseils régionaux du culte musulman sont devenus le visage et la voix des quelque cinq millions de personnes dans notre pays qui, dans leur unité comme dans leur diversité, se reconnaissent dans la religion musulmane ou s’en sentent proches.
La légitimité du CFCM s’est d’ailleurs renforcée à la faveur des scrutins de 2005 et 2008 et de l’action déterminée du recteur Dalil Boubakeur, qui a été le premier à présider aux destinées de cette institution, et de son successeur depuis juin 2008, le professeur Mohammed Moussaoui.
Fort de cette représentativité et de cette légitimité, aujourd’hui incontestables, le CFCM entretient désormais avec l’État, à l’instar des autres instances représentatives des cultes, un dialogue régulier sur des sujets aussi importants que la lutte contre les actes à caractère raciste, la police des funérailles et les carrés confessionnels, l’abattage rituel, le pèlerinage à La Mecque ou la formation des aumôniers et des cadres religieux musulmans.
Vous vous interrogez, par ailleurs, sur le rôle joué par la Fondation pour les œuvres de l’islam de France.
Créée par un décret en Conseil d’État du 31 mai 2005, elle a vocation, comme l’indiquent ses statuts, à faciliter la construction et la gestion des lieux de culte, en lien avec les maires et les communes concernés. Elle s’est dotée d’instances décisionnelles en octobre 2007, voilà donc trois ans.
Comme pour toutes les fondations reconnues d’utilité publique, l’État siège à son conseil d’administration. Son représentant ne dispose toutefois d’aucun droit de vote et émet simplement, en tant que commissaire du Gouvernement, des avis juridiques sur le fonctionnement général de la fondation et les projets qu’elle est amenée à soutenir.
Ainsi, il n’appartient pas aux pouvoirs publics de se substituer aux fédérations musulmanes composant le conseil d’administration de la Fondation pour les œuvres de l’islam de France, qu’il s’agisse, par exemple, de décider de la collecte des ressources de l’institution ou de déterminer des projets de construction de lieux de culte.
Force est de constater que, ces dernières années, les fédérations n’ont pas estimé que la Fondation devait être le vecteur privilégié de leur action. Nous en prenons acte : c’est aux musulmans de France eux-mêmes qu’il revient de choisir s’ils souhaitent, ou non, utiliser cet outil.
Les services de l’État n’en restent pas moins, naturellement, très attentifs et soucieux d’entretenir un dialogue régulier et approfondi avec les responsables des structures représentatives de l’islam de France. C’est dans le cadre de ce dialogue qu’ont vocation à être évoquées toutes les questions intéressant le culte musulman.

Madame le secrétaire d’État, la réponse de M. Brice Hortefeux ne me convient pas : elle marque que l’État renonce à faire en sorte que l’islam de France se constitue conformément aux principes qui ont été posés dès l’origine, par une déclaration signée de tous les représentants de toutes les sensibilités de cet islam de France.
Le but à atteindre est évidemment, non seulement de faciliter la construction de mosquées, mais aussi d’éviter l’intrusion de politiques étrangères qui peuvent chercher à influencer, par ce biais, telle ou telle fraction de la communauté des musulmans de France.
Il était tout de même possible, par un dialogue de conviction, de conduire les différentes sensibilités de l’islam de France à admettre le principe d’un transit commun des fonds qu’elles reçoivent, à charge pour elles, ensuite, de redistribuer ces fonds d’une manière équitable entre elles.
Si j’ai bien compris la réponse de M. Brice Hortefeux, celui-ci se contente de l’existence du CFCM et n’applique pas les règles de clarté qui auraient dû aller de pair avec la création de la Fondation.
Je le regrette, je le regrette pour la République, pour les musulmans de France et pour le concept même d’un islam de France !

La parole est à Mme Patricia Schillinger, auteur de la question n° 1034, adressée à M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur la situation des travailleurs frontaliers exerçant en Suisse, et plus particulièrement sur les différences de traitement pratiquées entre salariés de nationalité suisse et frontaliers.
Monsieur le ministre, de nombreux travailleurs alsaciens exerçant une activité salariée en Suisse ont pris l’habitude d’y être traités différemment des employés de nationalité suisse. Travailler en Suisse est avantageux en termes de rémunération, mais il n’en demeure pas moins fréquent de constater que, pour le même travail, les salariés alsaciens sont moins rémunérés que leurs collègues de nationalité suisse.
Si certaines différences de traitement sont dues à la non-reconnaissance de diplômes et de savoir-faire français, des entreprises suisses ont même franchi un cran supplémentaire dans la discrimination, en fondant celle-ci sur la santé du franc suisse par rapport à l’euro. C’est ainsi que, en septembre dernier, les salariés frontaliers de l’entreprise Stöcklin ont dû consentir à une diminution de 6 % de leur salaire. Sont concernés par cette baisse uniquement les 120 travailleurs frontaliers sur les 350 que compte l’entreprise.
Outre la chute d’activité liée à la crise, l’entreprise argue, pour justifier cette mesure et pour ne viser que les travailleurs frontaliers, de la santé du franc suisse par rapport à l’euro. Le cours de la monnaie helvétique compenserait alors la perte de salaire des travailleurs frontaliers par une hausse de leur pouvoir d’achat.
Parmi les frontaliers, 24 ont refusé cette mesure à cause de son caractère discriminatoire, et ont été licenciés.
Il est choquant et inadmissible qu’il soit demandé aux seuls travailleurs frontaliers de fournir des efforts et de consentir, sous la menace d’un licenciement, à des baisses de salaire.
Cela est tout à fait contraire aux accords de libre circulation conclus entre la Suisse et l’Union européenne, accords censés garantir aux ressortissants suisses et européens une égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et tous les autres avantages pouvant contribuer à faciliter l’intégration des travailleurs dans le pays d’accueil.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le Gouvernement compte rappeler à la Suisse ses obligations dans le cadre des accords bilatéraux passés avec l’Union, et obtenir ainsi des autorités suisses la condamnation de ce genre de politiques salariales ?
Plus précisément, dans le cadre de la collaboration franco-suisse, le Gouvernement envisage-t-il, pour déceler ces pratiques hautement discriminatoires et y mettre fin, de demander à la Confédération helvétique de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement à la libre circulation prévues en marge des accords bilatéraux ?
Madame le sénateur, je suis très heureux de vous répondre, puisque nous avons souvent travaillé ensemble sur différents sujets liés notamment aux affaires sociales et à l’emploi.
Vous m’interrogez aujourd’hui sur la coopération transfrontalière, qui est très importante pour la France. Chaque année en effet, ce sont près de 10 millions de travailleurs français qui sont concernés par ces problématiques transfrontalières, avec la Suisse, mais aussi, principalement, avec l’Allemagne, le Luxembourg ou la Belgique.
Vous le savez, le rapport remis en juin dernier par le député Étienne Blanc, la sénatrice Fabienne Keller et la députée européenne Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, dresse un constat édifiant sur l’importance du nombre des travailleurs transfrontaliers, mais aussi sur les difficultés auxquelles ils se heurtent.
Dans ce contexte, madame le sénateur, vous avez plus particulièrement appelé mon attention sur la situation en Suisse, notamment sur le cas très révélateur d’une entreprise suisse qui a décidé de son propre chef de faire varier les salaires des travailleurs frontaliers français, en considérant que l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse leur était devenue très favorable.
Le Gouvernement fait preuve de la plus grande vigilance sur ce sujet, afin de s’assurer que la Suisse remplit tout simplement, ni plus ni moins, les obligations qui sont les siennes, notamment celles qui résultent de l’accord conclu avec l’Union européenne sur la libre circulation des personnes.
D’après les informations que j’ai pu recueillir, il s’agirait d’un cas isolé, et le gouvernement suisse nous a réaffirmé sa détermination à veiller à ce qu’il ne se reproduise pas.
Dans l’immédiat, en ce qui concerne les salariés de cette entreprise, le mieux est de leur recommander de saisir rapidement les tribunaux compétents afin de contester les réductions salariales. Ils peuvent également engager une action judiciaire pour discrimination, sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes.
Par ailleurs, nous avons saisi la Commission tripartite cantonale de Bâle-Campagne, qui regroupe des représentants des salariés, des employeurs et des autorités cantonales, afin qu’elle procède à un examen de ce dossier.
Madame le sénateur, vous le voyez, le Gouvernement suit avec attention ce dossier, qui est certes isolé, mais qui témoigne de manière exemplaire des difficultés auxquelles nos travailleurs transfrontaliers peuvent se heurter.
Ce n’est notre conception ni de l’Europe ni des relations avec la Suisse !

Je remercie M. le ministre de sa réponse, et lui sais gré d’avoir déjà engagé des actions.
Je serai vigilante, car certains de ces travailleurs frontaliers ont tout de même subi une diminution de leur salaire de 6 %. En outre, ces salariés sont pénalisés par les horaires de travail – ce sont non pas les 35 heures, mais les 40 ou les 42 heures ! –, n’ont que quatre semaines de vacances par an, et un niveau de protection sociale différent.
Cela étant, nous sommes très heureux que ces Français puissent travailler en Suisse, puisque, vous le savez parfaitement, nous avons des zones sinistrées en Alsace. Il ne faudrait pas que les salariés soient doublement pénalisés.
Monsieur le ministre, je pense que nous nous reverrons ultérieurement pour faire le point sur cette question.

La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 1058, adressée à Mme la ministre des sports.

Madame la ministre, le cinquantième anniversaire du centre de Vallon-Pont-d’Arc du CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur a été célébré le 1er octobre 2010. À cette occasion, Mme Yade, alors secrétaire d’État chargée des sports, avait transmis à M. le préfet de l’Ardèche un message dans lequel elle soulignait le renforcement dans ses missions, comme dans ses moyens, de l’établissement ardéchois du ministère des sports, Pôle ressources national sports de nature.
Pour confirmer cette volonté de renforcement, elle mettait notamment en exergue « l’effort en moyens humains » réalisé par le ministère avec l’affectation à cet établissement d’un nouvel emploi de professeur depuis le 1er septembre. Or j’ai récemment été informé qu’un professeur doit partir à la retraite le mois prochain, et que, pour l’instant, il n’est pas remplacé. L’effort aura donc été bref...
Mme Yade évoquait aussi la réalisation d’investissements d’amélioration ou de mise en sécurité des installations, sans toutefois en préciser le contenu ni le calendrier.
Des incertitudes importantes demeurent donc quant à la réelle mise en œuvre des moyens tant humains que matériels qui sont indispensables au développement du centre de plein air de Vallon-Pont-d’Arc.
Par ailleurs, la « gouvernance » de l’établissement, à la suite de son rattachement à un CREPS situé hors de sa région administrative, reste problématique, alors qu’aucune garantie n’a été apportée, notamment quant à la possibilité de double gouvernance régionale du CREPS PACA ou encore à la mise en place de services à comptabilité distincte.
Lors de l’entretien qu’elle m’avait accordé le 8 avril dernier, Mme Yade m’avait fait part de ses intentions de réaliser un programme pluriannuel d’investissements liés aux missions confiées au centre de Vallon-Pont-d’Arc et de proposer une concertation réunissant les acteurs concernés et des élus du territoire.
Ces intentions, réaffirmées dans son message du 1er octobre, seraient susceptibles, si vous étiez en mesure de les confirmer et d’en préciser la matérialisation prochaine, madame la ministre, d’apaiser les inquiétudes persistantes des personnels comme des élus du territoire.
Je souhaite donc, madame la ministre, que vous m’indiquiez précisément quels sont les investissements immobiliers envisagés ainsi que le calendrier prévisionnel de leur réalisation.
Je vous demande aussi de m’assurer que la table ronde prévue au sujet, notamment, de la gouvernance de cet établissement pourra être organisée dans un délai raisonnable.
Monsieur le sénateur, vous l’avez rappelé, le centre de Vallon-Pont-d’Arc fait partie du patrimoine et de l’histoire du ministère des sports.
Si les sports de nature connaissent aujourd’hui un tel succès dans notre pays, c’est en partie parce que ce centre de Vallon-Pont-d’Arc et quelques autres institutions comme l’École nationale de ski et d’alpinisme, l’ENSA, l’École nationale de voile et des sports nautiques, l’ENV, et l’Union nationale des centres sportifs de plein air, l’UCPA, les ont légitimés et ont formé les éducateurs pour les enseigner et encadrer ceux qui les pratiquent.
Avec le Pôle ressources national sports de nature implanté sur son site, il fournit aux cadres des services territoriaux de l’État les savoirs et les méthodes qui leur permettent d’apporter un concours aux départements chargés de l’élaboration des plans départementaux des espaces.
Le réseau ainsi constitué des correspondants des sports de nature est l’une des explications du développement harmonieux de ces sports, respectueux de l’environnement et des autres usages. Les conflits rencontrés sont souvent réglés avec l’aide de fonctionnaires qui sont capables de porter un jugement équilibré sur les intérêts en présence.
C’est pourquoi, dans le contexte du rattachement du centre de Vallon-Pont-d’Arc au CREPS PACA le 1er septembre dernier, comme vous l’avez rappelé, le ministère des sports a tenu à renforcer ses moyens pour assurer la continuité de ses missions.
Ses moyens humains ont récemment été renforcés avec un poste supplémentaire de professeur de sport – le départ à la retraite sera bien remplacé – et la prise en charge sur le budget du ministère du financement d’un poste de chargé de mission au Pôle ressources national, qui était auparavant imputé sur le budget de l’établissement.
Des travaux d’amélioration et de sécurisation du parcours d’eaux vives, à hauteur de 130 000 euros, sont en cours, ainsi que des travaux de mise en sécurité des installations. Ils sont assurés par le budget de l’État sur l’exercice 2010.
Au-delà des chantiers en cours, une réflexion de fond doit être engagée sur l’ampleur et la nature de la rénovation des installations d’hébergement. Il faut en effet prendre en compte les besoins actuels de l’établissement, mais aussi les activités que ce site pourrait développer sur la proposition des différents partenaires du centre.
C’est pourquoi le préfet de l’Ardèche a reçu mission d’organiser une concertation sur ce sujet avec tous les acteurs concernés et les élus. La première réunion se tiendra le jeudi 16 décembre avec les collectivités locales, en présence des représentants des services régionaux et départementaux de l’État et de la direction du CREPS.
Cette concertation sera complétée par les conclusions de la mission d’analyse que le directeur du CREPS de PACA remettra à la fin de l’année. Elles pourront nourrir la réflexion des parlementaires qui sont attachés à développer les missions du centre de Vallon-Pont-d’Arc.
Le plan d’investissement, élaboré dans la concertation, pourra ainsi être présenté au début de l’année 2011.
Vallon-Pont-d’Arc, vous le rappeliez, monsieur le sénateur, a fêté le 1er octobre son cinquantième anniversaire. Pourtant, la mission dont il était investi dès l’origine, l’éducation et la sensibilisation à la découverte de la nature par l’activité physique, est d’actualité ; je dirai même qu’elle est une mission du futur.

Je prends acte des réponses apportées par Mme la ministre, notamment de celles qui ont trait à la tenue d’une table ronde, qui débutera le 16 décembre prochain avec les principaux acteurs concernés et les élus.
Cette table ronde me paraît nécessaire pour deux raisons.
La première, c’est qu’il est important de permettre à tous les acteurs concernés de pouvoir disposer du même niveau d’information au sujet des moyens humains, matériels et financiers que le ministère est disposé à engager sur ce centre.
La seconde raison, c’est qu’il me paraît nécessaire de pouvoir régler, ou du moins pointer un certain nombre de difficultés à la suite du rattachement du centre de Vallon-Pont-d’Arc à un CREPS qui est situé dans une région administrative différente.
À cet égard, pourquoi ne pas faire de Vallon-Pont-d’Arc un centre national des sports de nature ? Pourquoi ne pas lui donner la dénomination de « CREPS PACA Rhône-Alpes » ou de « CREPS Grand Sud-Est » ?
Bien sûr, au-delà des mots et des intentions affichées, ce qui importe, c’est que le ministère donne des garanties afin que ce centre puisse exercer pleinement ses missions, qui sont essentielles, vous l’avez rappelé, madame la ministre, et doivent, à notre sens, être maintenues, protégées et développées sur ce site.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 975 à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’un des objectifs affichés dans le cadre de la création du statut de l’auto-entrepreneur était la lutte contre le fléau du travail illégal.
Or les résultats sont contraires à ces annonces. Le régime des auto-entrepreneurs a cassé un système qui donnait satisfaction aux artisans comme aux clients. Ainsi, 80 000 artisans de ce pays, dont la seule ambition était de continuer à travailler dans leur secteur, avec la passion qu’on leur connaît, ont cessé leur activité.
Monsieur le ministre, vous dégradez les conditions d’exécution des chantiers en ne faisant pas respecter les mêmes règles selon que l’on est artisan ou auto-entrepreneur. Cette concurrence déloyale repose sur un régime fiscal et social préférentiel, une absence de contrôle des qualifications ainsi que des garanties réduites ou inexistantes pour les clients.
L’année dernière, en France, le nombre de procès-verbaux dressés pour travail illégal a bondi de 27 %. Une enquête menée par l’URSSAF de la Haute-Vienne chez les auto-entrepreneurs révèle que ce statut ne protège en rien contre de telles dérives. Près d’un dossier sur deux révèle des anomalies, dont plus de 12 % portent sur la dissimulation du chiffre d’affaires.
Le président de l’URSSAF de ce département va jusqu’à dire, dans un article paru en septembre dans la presse locale, que « ce nouveau statut ressemble fort à une légalisation du travail illégal et à la promotion de la concurrence déloyale ».
M. Novelli, alors secrétaire d’État, considérait qu’il avait dopé la création d’entreprises avec ce nouveau statut. Une telle affirmation ressemble fort à un mensonge par omission puisque, après sept années de hausse, l’INSEE nous a informés que le rythme des créations d’entreprises ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise a ralenti de 21, 5 % entre 2008 et 2009. En région Centre, les créations d’entreprises employant des salariés ont chuté de près de 30 % entre 2009 et 2008. On est bien obligé de s’interroger !
Monsieur le ministre, les artisans que j’ai rencontrés sont très en colère. Ils ne comprennent pas que vous fassiez le choix de la dérégulation, alors qu’ils sont attachés au travail bien fait et fondé sur des règles qui privilégient l’intérêt de leurs clients.
En outre, 51 % des auto-entrepreneurs n’ont aucune activité et 15 % ont déclaré moins de 1 000 euros par an. Sans chiffre d’affaires et donc sans cotisation, aucun droit à une pension vieillesse ne pourra être ouvert. C’est inacceptable !
L’auto-entrepreneuriat est souvent une forme de salariat déguisé, puisque des entreprises vont jusqu’à faire démissionner des salariés pour les « recycler » dans ce nouveau statut. C’est une nouvelle catégorie de travailleurs « auto-exploités », sans garanties, sans droits et sans protection, qui a ainsi été créée, et qui tire vers le bas l’ensemble du secteur de la petite entreprise.
Les artisans, activités de services ou commerçants souffrent de la création du statut d’auto-entrepreneur.
Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de mettre sur un pied d’égalité artisans et auto-entrepreneurs, dans l’intérêt de chacun d’entre eux, en respectant les règles et les valeurs qui président à l’artisanat.
Madame la sénatrice, je tiens à excuser Frédéric Lefebvre, empêché, qui m’a demandé de vous donner la réponse suivante.
Le régime de l’auto-entrepreneur a révélé le profond désir d’entreprendre des Français : on a dénombré 322 000 inscriptions en 2009 et près de 600 000 en 2010, à ce jour. Ce régime attire d’ailleurs les artisans, puisque, dans ce secteur, 60 % des créations d’entreprises sont faites sous le régime de l’auto-entrepreneur.
Ce dernier n’a pas vocation à remplacer les statuts classiques des entreprises, mais il vise à faciliter l’exercice d’activités générant un chiffre d’affaires limité. Lorsque l’activité produit un chiffre d’affaires supérieur aux seuils, les auto-entrepreneurs deviennent des entrepreneurs individuels soumis aux règles communes, ou bien ils créent leur société.
Le régime de l’auto-entrepreneur ne suscite aucune concurrence déloyale en termes d’exigence de qualification ou d’assurance obligatoire.
Les règles de qualification des auto-entrepreneurs sont, sans aucune dispense, identiques à celles des autres artisans. Il est exact que l’obligation de qualification n’était jusqu’à présent pas contrôlée lors de la création, mais ne faisait l’objet que de contrôles inopinés intervenant durant la vie de l’entreprise. Le Gouvernement a corrigé cette situation par un décret publié le 12 mars 2010, et applicable depuis le 1er avril. Désormais, tous les artisans et les auto-entrepreneurs souhaitant créer leur activité doivent, au préalable, attester leur qualification.
Depuis le 1er avril dernier, les auto-entrepreneurs exerçant à titre principal sont tenus de s’immatriculer au répertoire des métiers, auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat, comme les autres artisans. La dispense d’affiliation consulaire dont bénéficient les auto-entrepreneurs ne vaut qu’en cas d’activité exercée à titre complémentaire. Cette dispense d’affiliation ne les exonère pas de la déclaration au centre de formalités des entreprises.
L’auto-entrepreneur est une entreprise comme une autre et doit respecter les règles de l’exercice de son activité. Celle-ci est soumise à la réglementation applicable à tous les professionnels du secteur, en termes de formation et de qualification professionnelle préalable, d’application des normes techniques, d’hygiène et de sécurité, de déclaration et d’emploi des salariés, d’assurance et de responsabilité ou encore de facturation à la clientèle.
La limitation du chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs est une caractéristique intrinsèque du régime. Elle leur permet de disposer d’un environnement administratif particulièrement simplifié, notamment pour l’exercice d’activités complémentaires ou pour le démarrage d’une activité.
Les auto-entrepreneurs bénéficient d’une couverture sociale semblable à celle des autres entrepreneurs individuels, tout particulièrement en matière de maladie et de maternité. Au-delà d’un montant minimum – fixé à 200 fois le SMIC horaire – nécessaire pour éviter qu’une façade d’activité ne génère indûment des droits à la retraite, l’activité d’auto-entrepreneur permet de valider des droits à la retraite dans des conditions tout à fait équivalentes à celles de l’ensemble des travailleurs indépendants.
Le régime de l’auto-entrepreneur arrive désormais en phase de maturité. Mon collègue Frédéric Lefebvre devrait prochainement faire des propositions pour clarifier le fonctionnement du régime, en termes d’obligations déclaratives ou d’accès à la formation professionnelle.

Je souhaiterais pour ma part que, loin de se contenter de recenser le nombre d’inscrits entre 2009 et 2010, on puisse savoir précisément ce que sont devenus tous ces auto-entrepreneurs, ce qui nous permettrait d’avoir une analyse plus fine de la situation.
Les représentants des organisations professionnelles de mon département de l’artisanat que j’ai rencontrés sont unanimes à souligner le décalage qui existe entre le bilan présenté par le Gouvernement et la réalité. Je souhaiterais donc que le bilan soit plus partagé par les professionnels.
Vous avez précisé, monsieur le ministre, que les auto-entrepreneurs doivent désormais présenter un diplôme attestant leur qualification lors de la création de leur activité. Mais j’aimerais bien savoir en pratique comment cette exigence est vérifiée et quels sont les moyens à disposition pour ce faire.
Par ailleurs, les conditions d’exercice des artisans et des auto-entrepreneurs n’étant pas équivalentes, de quelles garanties, de quelle sécurité disposent les clients des auto-entrepreneurs ? Pourtant, comme je l’ai déjà souligné, ces derniers ont bien souvent besoin de la garantie décennale.
De surcroît, l’obligation de formation à la gestion n’est toujours pas mise en œuvre pour le moment.
Ce statut continue donc de susciter de nombreuses interrogations de notre part, d’autant qu’aucune amélioration de la situation de l’auto-entrepreneur ne semble se profiler à l’horizon.
Au final, l’auto-entrepreneur se trouve bien souvent dans la situation d’un ouvrier peu qualifié à qui l’on demande, aujourd’hui, de prendre des responsabilités, mais qui risque, demain, de payer lourdement le fait de ne pas avoir été déclaré dans les mêmes conditions qu’un salarié en activité dans son entreprise.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 979, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.

Monsieur le ministre, la séance des questions du mardi matin ayant été annulée à deux reprises, j’ai dû patienter plusieurs semaines avant de pouvoir poser cette question, qui intéresse tous les consommateurs. Je me réjouis donc de pouvoir vous la poser aujourd’hui et je vous remercie par avance de votre réponse.
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 15 avril 2010 un arrêt sur les frais d’expédition en cas de retour d’un objet commandé par correspondance.
Cet arrêt intéresse tous les consommateurs français qui, depuis la loi du 26 juillet 2005, disposent d’un délai de sept jours francs pour exercer leur droit de rétractation, sans avoir à justifier des motifs ou à payer des pénalités.
Or, en France, certaines entreprises prévoient dans leurs conditions générales de vente qu’en cas de rétractation les acheteurs seront remboursés du seul prix de l’objet, et non des frais d’expédition exposés.
Le juge européen considère dans son arrêt du 15 avril 2010 qu’une réglementation nationale qui permet au fournisseur d’imputer les frais d’expédition au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation est contraire au droit européen.
La Cour de justice estime en effet que « le fait d’imputer au consommateur, en plus des frais directs de renvoi des marchandises, les frais d’expédition est de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises ».
Certaines clauses existantes peuvent donc désormais être considérées comme abusives.
Je voudrais savoir si le Gouvernement prévoit de mettre ces conditions générales de vente en conformité par rapport à cette nouvelle décision européenne, et s’il entend modifier le code de la consommation, de quelle manière et dans quel délai.
Enfin, la décision de la Cour de justice ne me paraissant pas très claire sur les frais de réexpédition, j’aimerais obtenir des précisions sur le cas des frais liés au retour de l’objet par l’acheteur au vendeur dans le délai de sept jours. Ces frais sont-ils à la charge du vendeur ou du client ?
Vous l’aurez compris, madame la sénatrice, je vous réponds en lieu et place de mon collègue Frédéric Lefebvre, empêché, qui m’a demandé de vous transmettre ses excuses.
Vous souhaitez connaître les mesures qui seront prises en France pour rendre les contrats de vente conclus à distance conformes à la décision du 15 avril 2010 de la Cour de justice des Communautés européennes relative à l’imputation des frais d’expédition des marchandises lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat de vente conclu à distance.
La CJCE a en effet été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/7/CE relative aux contrats de vente à distance, question posés par une société de vente par correspondance allemande dans le cadre d’un litige qui l’opposait à une association de consommateurs.
La Cour a dit pour droit qu’une réglementation nationale qui permettrait au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur qui exerce son droit de rétractation serait contraire à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
Il convient de noter qu’en France aucune réglementation n’a jamais autorisé les vendeurs à distance à imputer les frais d’expédition des marchandises aux clients qui ont exercé leur droit de rétractation.
La directive 97/7/CE a été transposée par l’ordonnance du 23 août 2001. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la directive ont, par cette ordonnance, été repris aux articles L. 121-20 et L. 121-20-1 du code de la consommation.
Dans l’esprit du législateur français, il a toujours été parfaitement clair que la directive 97/7/CE ne permet pas aux professionnels de la vente à distance d’imputer au consommateur qui se rétracte les frais d’expédition de la marchandise. À cet égard, le considérant 14 de la directive indique que, pour que le droit de rétractation ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce ce droit doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises.
Cependant, dans la pratique, certains professionnels ont interprété l’obligation de remboursement qui leur était faite comme une obligation de remboursement du prix du produit hors frais d’expédition.
C’est pourquoi, à l’occasion de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service du consommateur, dite loi Chatel, l’article L. 121-20-1 a été modifié et précisé pour qu’il ne soit plus l’objet d’interprétations erronées.
Désormais, la première phrase de l’article L. 121-20-1 est ainsi rédigée : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, [...]. »
En conclusion, la décision de la Cour du 15 avril 2010, qui rappelle les principes de la directive 97/7/CE, ne nécessite pas d’adaptation de notre droit national, puisque, lors de la transposition en droit interne, en 2001, de cette directive, la France avait déjà intégré ce principe et l’a conforté à l’occasion du vote de la loi Chatel du 3 janvier 2008.

Votre réponse est très claire, monsieur le ministre, mais il est regrettable que les consommateurs doivent parfois se battre pour que les vendeurs à distance appliquent la législation en vigueur.
En ce qui concerne les frais de réexpédition, j’ai bien compris qu’ils ne pouvaient pas être remboursés. Quand il s’agit d’un petit objet, ce n’est pas grave. En revanche, si vous voulez réexpédier dans le délai de sept jours un lave-linge, un lave-vaisselle ou un réfrigérateur, les frais de réexpédition deviennent assez prohibitifs. Il faudrait donc progresser également dans ce domaine.

La parole est à M. Serge Larcher, auteur de la question n° 1075, transmise à M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans mon département comme dans l’ensemble des départements d’outre-mer, la construction des équipements et des réseaux d’électricité a été réalisée avec un très grand retard par rapport à l’Hexagone.
L’écart du niveau d’équipement s’est progressivement creusé et n’a jamais été comblé.
Ainsi, le réseau de transport d’électricité présente aujourd’hui de telles faiblesses en Martinique que la sécurité de l’alimentation électrique pour l’ensemble des usagers n’est pas assurée.
Les moyens de production sont incontestablement insuffisants et la puissance installée cumulée de l’île ne respecte plus les standards usuels en production insulaire similaire.
Face à cette situation, la politique d’investissement apparaît aujourd’hui largement insuffisante. Elle repose, par ailleurs, sur des prévisions de croissance de la demande d’électricité pour les vingt prochaines années qui demeurent notoirement en deçà des besoins réels.
De nombreux dysfonctionnements pénalisent, de ce fait, l’activité économique de la Martinique.
Nombre d’entreprises se sont donc équipées de groupes électrogènes autonomes.
Pourtant, la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité de février 2000 énonce les grands principes du service public de l’électricité et propose les moyens d’améliorer la sécurité des réseaux et la qualité de l’électricité. Elle aurait dû permettre une remise à niveau des équipements.
Cependant, l’arrêté pour l’application du décret relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques prévus par cette loi n’a été pris qu’en 2007, et il ne définit, pour les départements d’outre-mer, ni seuils ni critères d’évaluation des systèmes électriques.
Pour tous les départements d’outre-mer, en effet, la mention « réservée » figure dans les champs à renseigner par l’arrêté.
En l’état, les dispositions prévues par la loi de février 2000 n’y sont donc pas applicables, alors que le niveau de qualité et de sécurité de l’alimentation électrique constitue un enjeu majeur pour ces territoires en mal de développement.
Ceux-ci sont privés de tout objectif en matière de niveau de qualité exigible.
Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, connaître précisément les initiatives que le Gouvernement compte prendre afin de combler le vide actuel.
De plus, ne croyez-vous pas qu’il y a lieu de prévoir des moyens plus importants et mieux adaptés aux impératifs de développement économique de nos régions d’outre-mer ?
Monsieur le sénateur, les réseaux électriques dans les départements d’outre-mer, contrairement aux réseaux en métropole, ne sont pas interconnectés à un réseau continental et n’ont donc pas l’avantage dont disposent les grands systèmes interconnectés pour faire face à d’éventuels aléas. En outre, les DOM connaissent une croissance importante de leur demande en électricité, entre 2, 5 et 3 % par an en moyenne pour la Martinique.
Les contraintes qui pèsent sur les systèmes électriques dans les DOM sont fortement liées à ces deux spécificités.
L’augmentation croissante de la consommation est en effet à l’origine de fréquentes chutes de tension sur les réseaux, notamment pendant les heures de pointe. L’impact de ces chutes de tension sur la qualité de l’électricité est d’autant plus perceptible pour les usagers qu’il est accentué par le caractère isolé de ces réseaux insulaires.
La priorité pour la qualité de l’électricité dans les départements d’outre-mer réside donc dans un premier temps dans la réduction des chutes de tension. C’est pourquoi un arrêté spécifique a été pris le 24 décembre 2007 en application du décret de 2007 relatif aux niveaux de qualité, qui prévoit des dispositions à la fois pour les chutes de tension et les coupures d’alimentation sur les réseaux. Cet arrêté fixe des seuils précis concernant les niveaux de tension dans les DOM.
Dans un second temps, des seuils et des critères précis pour les coupures d’alimentation sur les réseaux devront également être arrêtés une fois la question des chutes de tension résolue.
La définition de ces critères nécessitera que des études soient menées afin de fixer des seuils techniquement réalistes.
Les prévisions de consommations pour les années à venir ne semblent pas sous-estimées par rapport aux besoins réels.
Ainsi, le bilan prévisionnel réalisé en 2007 pour la Martinique prévoyait une consommation de plus de 1700 gigawatts par heure en 2010, alors que la consommation effective cette même année devrait être de l’ordre de 1600 gigawatts par heure.
S’agissant de la politique d’équipement et de modernisation, il faut souligner que le niveau d’investissement par usager, pour les réseaux électriques en Martinique, est supérieur d’environ 50 % à celui qui est réalisé en métropole.
Le montant de ces investissements, pour la Martinique, atteindra 30 millions d’euros en 2012 et en 2013 – contre 25 millions d’euros actuellement –, afin notamment de renforcer l’alimentation de l’agglomération de Fort-de-France. Cet effort important est justifié par un programme de lutte contre l’aléa cyclonique mis en place en 2008, après le cyclone Dean, et par les prévisions de croissance de la consommation pour les années à venir.
J’ajoute que le Fonds d’amortissement des charges d’électrification constitue une aide supplémentaire à destination des autorités concédantes, à hauteur d’environ 17 millions d’euros par an pour l’outre-mer, dont plus de 2 millions d’euros par an pour la Martinique.

Je suis heureux que le Gouvernement ait pris des initiatives pour essayer de combler le vide dans lequel nous sommes depuis quelque temps. L’arrêté a été pris en 2007, mais, jusqu’à présent, il n’a eu aucun effet dans les départements d’outre-mer.
La fréquence des coupures de courant est inquiétante, monsieur le ministre, à tel point que, à l’heure actuelle, lorsque l’on regarde un film à la télévision, on n’est jamais sûr d’en voir la fin. Il s’agit d’un handicap très important pour un département à vocation touristique, quand les îles voisines, qui sont nos concurrentes, disposent d’un réseau électrique leur garantissant une qualité de fourniture nettement meilleure.
Par ailleurs, cette situation porte également préjudice aux ménages, car outre les chutes de tension et les coupures d’alimentation, on constate aussi des surtensions, qui provoquent des dégâts énormes en endommageant irrémédiablement des appareils électroménagers. Dans de tels cas, il est très difficile de faire admettre à EDF sa responsabilité.
Néanmoins, je ne désespère pas de l’amélioration de la qualité de la distribution du courant électrique à l’avenir. Il s’agit là d’une question essentielle, l’électricité étant un élément indispensable du développement, mais aussi du confort des ménages.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, auteur de la question n° 1068, adressée à M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

La direction d’Unilever France a annoncé son intention de fermer l’usine Fralib de Gémenos, dans le département des Bouches-du-Rhône, qui produit notamment du thé et des infusions sous la marque « Éléphant », implantée dans la région marseillaise depuis plus d’un siècle.
Que l’on me permette de rappeler certaines pratiques « industrielles » qui conduisent droit dans le mur le dialogue social et l’économie de notre pays.
En 1976, la multinationale Unilever achète Fralib à Pernod-Ricard.
En 1988, avec un bel opportunisme, Unilever délocalise son site de Marseille à Gémenos pour profiter des subventions européennes liées à la revitalisation d’un territoire sinistré à la suite de la disparition des chantiers navals de La Ciotat.
En 1998, Unilever ferme son site du Havre et transfère la production en Belgique. Moins d’un tiers des salariés sont reclassés à Gémenos.
En 2006, enfin, la multinationale crée en Suisse, donc hors de la zone euro, Unilever Supply Chain Company, USCC, entité dont la seule fonction est d’assécher les marges des sites de production.
Ce sont ainsi chaque année 200 millions d'euros qui manquent au produit intérieur brut de notre pays et 67 millions d'euros qui échappent aux services fiscaux français, tandis qu’Unilever a distribué quelque 750 millions d'euros à ses actionnaires au titre de l’année 2008.
En vingt ans, la productivité par salarié a progressé d’environ 50 %, avec un volume de production sensiblement égal entre 1989 et 2009, alors que les effectifs passaient de 286 à 185 salariés.
Monsieur le ministre, mon collègue député et ami Michel Vaxès vous a déjà interrogé sur ce sujet, le 23 novembre dernier. Ce jour-là, vous sembliez déjà vous préparer à une reconversion du site et de ses salariés.
Vous avez demandé au préfet d’organiser une table ronde, qui s’est tenue vendredi 26 novembre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les représentants d’Unilever n’ont convaincu personne, pas même le préfet, du caractère inéluctable de la fermeture de l’usine.
Je voudrais citer une phrase d’un courrier adressé par votre prédécesseur, M. Estrosi, aux parlementaires : « Mon intention, vous le savez, c’est de remettre le “fabriqué en France” au cœur de notre stratégie de développement industriel. »
Monsieur le ministre, je vous pose de nouveau la question, en espérant que votre réponse sera cohérente avec les propos tenus lors de la table ronde : jusqu’à quand le Gouvernement va-t-il s’accommoder de délocalisations d’entreprises motivées par des raisons purement financières ?
Madame la sénatrice, nous partageons une conviction : la France n’a pas d’avenir sans une industrie forte. Le maintien et le développement de notre industrie sont donc une priorité pour le Gouvernement, comme pour tous les groupes politiques du Sénat.
En ce qui concerne Fralib, le groupe Unilever a annoncé le 28 septembre dernier son intention de fermer le site de Gémenos au début de 2011. Cette entreprise a pour activité le mélange et le conditionnement de thés et d’infusions.
La direction d’Unilever justifie cette fermeture par des raisons liées à l’évolution du marché du thé, notamment la montée en puissance des gammes de distributeurs, et par les caractéristiques propres du site de Gémenos. Selon elle, ce site représenterait en effet 5 % de la production européenne de thés d’Unilever, mais 27 % des coûts.
Devant cette volonté d’Unilever de fermer le site de Gémenos, j’ai demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d’étudier attentivement ce dossier, afin notamment que, dans l’hypothèse d’une confirmation de la fermeture du site, aucun salarié ne soit laissé au bord du chemin.
Le préfet a ainsi organisé, vendredi 26 novembre dernier, une table ronde avec l’ensemble des acteurs concernés. À l’issue de cette réunion, il a proposé aux organisations syndicales et aux représentants de Fralib et d’Unilever de créer un groupe de travail, animé par le responsable de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Ce groupe de travail doit examiner de manière approfondie l’ensemble des scénarios pouvant déboucher sur une solution autre que la fermeture du site, notamment la réinstallation, par Unilever, d’une usine de conditionnement de thé, l’installation d’une autre activité du groupe Unilever, ou encore l’établissement d’une nouvelle entreprise, qui reprendrait les salariés. Les conclusions du groupe de travail doivent être rendues avant la prochaine réunion du comité d’entreprise, le 13 décembre.
Par ailleurs, j’ai demandé au préfet d’examiner les mesures d’accompagnement qui pourraient, le cas échéant, être prises et mises en œuvre afin qu’un avenir soit assuré à chacun des 182 salariés du site de Gémenos et que les engagements d’Unilever en matière de revitalisation du territoire soient à la hauteur de la réputation et des moyens financiers de cette grande entreprise.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, nous essayons de travailler sur toutes les hypothèses, y compris une reprise d’activité ou une poursuite de celle-ci sous d’autres formes.

Monsieur le ministre, vous reprenez quasiment mot pour mot le compte rendu des travaux de la table ronde que j’ai pu obtenir de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Je voudrais apporter une précision concernant les chiffres donnés par Unilever.
Effectivement, la production de Fralib ne représente que 5 % de la production de thés d’Unilever, mais ce groupe a fait le choix de faire fabriquer à Gémenos des sachets de 1, 6 gramme, et non de 2 grammes comme dans les autres usines. Cela explique le tonnage relativement faible produit sur ce site, avec des coûts forcément supérieurs.
Cela étant, lors de cette table ronde, à aucun moment Unilever n’a évoqué les profits réalisés grâce aux gains de productivité obtenus dans cette usine, ni le sous-investissement dont celle-ci a souffert : en quatre ans, Fralib n’a bénéficié que de 5 % des 85 millions d’euros investis dans les usines européennes du groupe.
Il faut mettre Unilever face à ses responsabilités, et j’espère que le Gouvernement jouera un rôle important dans le traitement de ce dossier.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 1066, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

L’avant-projet du schéma national des infrastructures de transports, publié le 12 juillet dernier, expose les priorités françaises en la matière pour les vingt ou trente années à venir.
À la lecture de ce document, en particulier des cartes qu’il contient, intitulées « Réponses aux enjeux d’équité territoriale et de désenclavement », je suis outré de constater que le Massif central et l’Auvergne sont purement et simplement oubliés. Rien n’est prévu, notamment, pour le désenclavement du Cantal, en particulier de l’arrondissement d’Aurillac.
Je n’entends pas lancer ici un combat contre cet avant-projet, dont je partage nombre d’objectifs, mais je demande que les territoires les plus enclavés ne soient pas laissés à l’écart du développement.
Améliorer l’accessibilité des territoires est en principe l’un des objectifs poursuivis au travers de cet avant-projet, dont je voudrais citer la page 15 : « Améliorer la performance du système de transport dans la desserte des territoires, c’est d’abord améliorer les capacités du système de transport à permettre aux populations et aux acteurs économiques l’accès aux territoires. […] Il renvoie en outre à une notion d’équité des territoires face aux besoins de mobilité des individus dans une perspective d’aménagement durable du territoire. »
Je souscris à cet objectif. Nous ne demandons qu’une chose : qu’il soit mis en œuvre ! Malheureusement, ce qui est proposé est en totale contradiction avec « l’équité territoriale » recherchée. Les grands axes de développement contournent le Massif central. En matière de fret ferroviaire, il y a un grand trou au centre de la France. Pour les transports collectifs, sur quarante opérations préconisées, aucune ne concerne le Massif central. Rien n’est prévu concernant la route nationale 122, qui finit en cul-de-sac à Figeac, alors que Castres, qui connaît la même problématique avec une RN 126 en impasse, se verra reliée à Toulouse, ce dont nous nous en réjouissons.
Il n’est pas acceptable que, en 2010, une préfecture soit encore délibérément privée de tout moyen efficace d’accès, la route nationale 122 étant difficilement praticable et comportant encore des passages où la vitesse est limitée à 30 kilomètres à l’heure, monsieur le ministre, tandis que son prolongement de Figeac à l’autoroute A 20 est injustement refusé à ce jour.
C’est le problème récurrent du désenclavement qui est au cœur du débat. Il n’est pas raisonnable de justifier le manque d’infrastructures par le manque de population. Monsieur le ministre, je vous demande de prendre en compte ces observations et d’inclure dans le projet définitif de schéma national les dispositions nécessaires pour permettre le désenclavement du Cantal et de sa préfecture, qui est devenu, malheureusement, le territoire le plus mal desservi de France.
Monsieur le sénateur, je vous prie d’abord de bien vouloir excuser M. Thierry Mariani, qui est en déplacement. Il m’a demandé de vous transmettre sa réponse, dont je vais maintenant vous donner lecture.
Vous souhaitez la prise en compte de la desserte d’Aurillac dans l’avant-projet de schéma national des infrastructures de transports, qui a été rendu public à la mi-juillet.
Je tiens à vous rassurer quant à l’importance qu’attache l’État au désenclavement du Cantal et à l’aménagement de la RN 122.
Les aménagements qui restent à réaliser sur la RN 122 pour que celle-ci puisse répondre dans de bonnes conditions aux besoins légitimes, en matière de mobilité, des territoires et des populations du Cantal, ne relèvent pas de la catégorie des projets ayant vocation à figurer explicitement dans le schéma national. En effet, seuls les projets de développement dont la réalisation introduit de nouvelles fonctionnalités et peut avoir une incidence sur l’expression de la mobilité à l’échelle du système de transport dans son ensemble ont vocation à y figurer. Une ligne ferroviaire à grande vitesse, une autoroute, un contournement de ville venant conforter une continuité autoroutière sont, typiquement, les projets concernés.
Les projets qui visent à une adaptation plus localisée des infrastructures existantes – c’est le cas des aménagements à réaliser sur la RN 122 – pour répondre à des problèmes locaux de desserte du territoire, de sécurité, de congestion, de nuisances ou encore d’intégration environnementale et qui ne viennent pas créer de nouvelles fonctionnalités et influencer à grande échelle les comportements avec induction de nouveaux trafics ou des reports modaux n’ont pas vocation à figurer dans le schéma.
Ces projets seront progressivement réalisés dans le cadre des programmes de développement et de modernisation des itinéraires routiers, les PDMI, en cohérence avec les orientations qui auront été retenues dans le schéma national des infrastructures de transports.
Ainsi, l’aménagement de la RN 122 se poursuit aujourd'hui dans le cadre de l’actuel PDMI de la région Auvergne. Celui-ci prévoit, par exemple, la réalisation de la déviation de Sansac-de-Marmiesse, pour un montant de 32, 2 millions d’euros, les acquisitions foncières liées à la déviation de Polminhac, pour un montant de 4 millions d’euros, ou encore la mise en place de créneaux de dépassement, pour un montant de 10 millions d’euros.

La réponse que vient de lire M. le ministre est terrible pour notre territoire ! Elle ne correspond pas aux cartes contenues dans l’avant-projet du schéma national des infrastructures de transports, intitulées « Réponses aux enjeux d’équité territoriale et de désenclavement ». Une telle réponse, qui s’apparente à un flot d’eau tiède, marque un mépris absolu pour notre territoire, dont la situation va être encore aggravée. Cela ne pose manifestement aucun problème au Gouvernement, qui choie à juste titre les îles ultramarines, mais désespère les habitants de l’île terrestre que constitue notre territoire.
Permettez-moi de vous donner un seul exemple, monsieur le ministre, pour étayer mon propos. Je suis venu du Cantal à Paris dimanche afin d’être présent en séance lundi matin. N’ayant pu prendre ni l’avion – il n’y a qu’une ligne, et il y avait malheureusement un peu de neige sur la piste –, ni le train – il était trop tard –, il m’a fallu faire neuf heures de route sous la neige pour rejoindre Paris. Il n’en était pas ainsi voilà vingt ou trente ans, car notre territoire était alors mieux desservi.
Certes, ce n’est sans doute pas très important à l’échelle du territoire national, mais il ne me semble pas de bonne politique de renvoyer aux calendes grecques, comme vous le faites, l’aménagement du territoire. La réponse dont vous venez de me donner lecture, monsieur le ministre, est difficilement acceptable !

La parole est à M. Michel Boutant, auteur de la question n° 1097, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le problème de la mise aux normes du tunnel de la Gâtine, sis sur le territoire de la commune d’Angoulême.
Les tunnels, on le sait, font l’objet d’une mise aux normes depuis le terrible accident qui s’est produit sous le tunnel du Mont-Blanc voilà une dizaine d’années.
Le tunnel de la Gâtine est d’une importance capitale pour la circulation dans et autour de la ville. Il est ainsi utilisé non seulement par une grande partie des Angoumoisins, mais également par les habitants des communes périphériques et, plus généralement, par toutes les personnes qui souhaitent traverser rapidement la cité charentaise du Nord au Sud afin de rejoindre les grands axes de circulation en direction de Libourne, de Périgueux, de Poitiers ou le pôle d’échange intermodal de la gare. Quotidiennement, ce sont plus de 17 000 véhicules qui empruntent cette voie.
Il ne s’agit donc pas d’un tunnel à usage exclusivement communal. Pourtant, on exige aujourd’hui de la ville d’Angoulême qu’elle finance seule sa mise aux normes. Les critères à respecter pour cette mise en conformité ont été définis dans les décrets n° 2000-63 du 25 août 2000 et n° 2006-20 du 29 mars 2006, ainsi que dans le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005, portant sur les obligations des collectivités.
Le tunnel, dans sa forme actuelle, est trop étroit pour accueillir deux sens de circulation et une galerie d’évacuation pour les usagers. Le gabarit, déjà limité à 3, 50 mètres par la ville en 2006, devrait être réduit à 2, 25 mètres.
Le montant des travaux s’élèverait à 14, 5 millions d’euros pour 300 mètres de tunnel, somme absolument considérable pour une municipalité de 42 000 habitants, surtout dans la situation de gel des dotations aux collectivités locales que nous connaissons. Ce montant correspond à l’équivalent de dix années de programmes d’entretien de la voirie communale ou à deux annuités de dépenses de travaux d’investissement. De plus, l’encours de la dette de la ville d’Angoulême reste, malgré les efforts considérables de la municipalité, deux fois supérieur à la moyenne nationale des villes de même strate.
Plusieurs autres solutions ont été envisagées par la ville, notamment le passage à un sens unique de circulation. Cette option n’a pour le moment pas été retenue, le coût des travaux nécessaires étant au final sensiblement le même que celui d’une remise aux normes. La question de l’opportunité de celle-ci pourrait aussi se poser, compte tenu de la longueur de ce tunnel, surtout à un moment où le Président de la République et le Premier ministre s’interrogent sur la sévérité des normes qui s’imposent à nos collectivités.
Il est en tout cas regrettable que l’État exige de la ville qu’elle finance seule ce projet, dans la mesure où l’État avait participé à la réalisation de l’ouvrage, voilà plus de trente ans, et où, contrairement à ceux des huit autres communes de France concernées par une telle remise aux normes, le tunnel de la ville d’Angoulême est justement le seul qui ne soit pas à usage uniquement communal. Si un bien public profite à tous, au-delà des habitants du secteur géographique où il se trouve, alors l’État devrait intervenir.
Monsieur le ministre, je me demande, à l’instar des élus de la ville d’Angoulême, si l’on n’exige pas trop d’une ville qui donne pourtant déjà beaucoup. L’État ne pourrait-il pas verser une aide exceptionnelle et participer ainsi au financement des travaux de mise aux normes du tunnel routier d’Angoulême ?
Monsieur le sénateur, Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne pouvant être présente ce matin, elle m’a prié de vous faire part de sa réponse.
Vous avez appelé son attention sur l’investissement lourd que représente l’opération de mise aux normes du tunnel routier de la Gâtine, situé à Angoulême, et sollicitez une participation financière de l’État à la mise en œuvre du projet de rénovation de cet ouvrage.
Mme Kosciusko-Morizet est convaincue de l’importance de ce tunnel, qui est un enjeu pour la ville d’Angoulême et son agglomération, compte tenu notamment du niveau de trafic.
Cependant, cet ouvrage appartenant à une collectivité territoriale et ne faisant pas partie du réseau routier national, le ministère ne peut malheureusement pas contribuer financièrement à ces travaux, en raison du partage des compétences en matière d’infrastructures routières. En effet, l’État a transféré aux collectivités territoriales une partie du réseau routier dont il avait auparavant la charge. À la suite de ce partage, notamment, tous les travaux d’infrastructures routières ont été sortis des contrats de projet, lorsqu’ils existent, l’État n’entretenant plus que les infrastructures relevant strictement de sa compétence.
Par ailleurs, votre département participe au financement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. À cet égard, depuis la réalisation de la ligne TGV Est européenne, qui relie Paris à Strasbourg et sera prolongée, à terme, au-delà du Rhin, les collectivités territoriales sont systématiquement associées au financement de ce type d’infrastructures. Ainsi, la contribution du département du Bas-Rhin au financement de la ligne TGV Est européenne s’était élevée à 75 millions d’euros.
Il est donc logique que votre département participe au financement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, monsieur le sénateur. Le Gouvernement souhaite que les travaux puissent débuter dans les meilleurs délais, afin que la mise en service ait lieu dès 2016.
Enfin, Mme Kosciusko-Morizet connaît votre projet de réalisation d’un bus à haut niveau de service de la communauté d’agglomération du grand Angoulême. Un dossier a été déposé dans le cadre du deuxième appel à projets en faveur des transports urbains lancé le 4 mai 2010. Cet appel est désormais clos. Il rencontre un réel succès : plus de quatre-vingts projets ont été déposés par cinquante-sept autorités organisatrices. Je tiens également à souligner que vingt projets sont portés par dix agglomérations participant à la démarche EcoCité.
Le projet d’Angoulême répond aux objectifs du Grenelle de l’environnement et aux enjeux d’une mobilité durable. Il sera d’ailleurs examiné par le comité technique qui se réunira les 1er et 2 décembre prochains. Les lauréats de l’appel à projets seront désignés dans les prochaines semaines. J’espère, monsieur le sénateur, que votre projet sera retenu.

Votre réponse est paradoxale, monsieur le ministre.
Pour justifier la non-intervention de l’État en faveur de la commune d’Angoulême, vous arguez que les compétences ont été partagées et que l’État ne s’occupe plus désormais que de la voirie relevant strictement de la sienne.
Or, en tant que président d’un conseil général, vous savez aussi bien que moi que les départements continuent malgré tout à participer au financement des programmes de développement et de modernisation des itinéraires routiers. Ainsi, dans le cadre du dernier contrat de plan État-région, le mien a contribué à hauteur de 67 millions d’euros aux travaux effectués sur la voirie nationale. Je ne peux donc accepter votre réponse, monsieur le ministre.
Par ailleurs, bien que la loi portant réforme des collectivités territoriales interdise un certain nombre de financements croisés, l’État est aujourd'hui le premier à exiger le recours à de tels financements, en particulier en matière de développement ferroviaire. À cet égard, vous avez évoqué la ligne à grande vitesse Est européenne : il en va de même pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, le département de la Charente étant appelé à apporter 30 millions d’euros, la communauté d’agglomération d’Angoulême 10 millions d’euros et la ville de Cognac, pourtant distante de quarante kilomètres, 4 millions d’euros.
Je ne peux donc souscrire à vos arguments, monsieur le ministre ; votre sourire témoigne d’ailleurs que vous-même n’y croyez pas !

La parole est à M. Jean Milhau, auteur de la question n° 1046, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

La prolifération du frelon asiatique est devenue un véritable fléau depuis l’apparition de cet insecte dans le sud-ouest de la France en 2004.
Cette espèce invasive se développe de manière exponentielle en raison de son cycle de reproduction très rapide. Cela entraîne la destruction des ruchers et a des conséquences sur la biodiversité. Mais nos populations se trouvent également affectées et ainsi mises en danger. Les services d’incendie et de secours n’intervenant plus qu’en cas de péril sur la voie publique, les particuliers doivent faire détruire à leurs frais les nids par des sociétés privées. Or ces nids sont souvent situés à la cime des arbres, ce qui nécessite l’utilisation d’une nacelle, d’où un coût difficilement supportable pour un ménage, pouvant varier entre 150 euros et 1 000 euros.
Au mois de janvier 2010, le Gouvernement avait indiqué qu’un projet d’arrêté visant à classer le frelon asiatique comme espèce invasive était en préparation et qu’une mission interministérielle était en cours, afin d’étudier des solutions techniques fiables permettant d’assurer le contrôle de l’espèce.
À ma connaissance, cette mission n’a toujours pas publié son rapport à ce jour, alors que c’est à l’automne que les nids deviennent visibles. Il y a urgence à les détruire, et tous les moyens doivent être mis en œuvre, qu’il s’agisse du piégeage des femelles fondatrices ou de l’attribution de crédits spécifiques à la recherche, afin de freiner cette prolifération, de préserver la qualité et la biodiversité de notre environnement et de défendre notre écosystème, qui est tributaire des pollinisateurs autochtones.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer à quelle date la mission interministérielle rendra son rapport et quelles mesures spécifiques seront retenues pour procéder le plus rapidement possible à la destruction des nids et lutter contre cette espèce invasive ?
Monsieur Milhau, la question que vous avez adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement intéresse non seulement les apiculteurs, évidemment concernés au premier chef, mais également une grande partie de la population, car le développement d’espèces invasives, dans le domaine animal comme dans le domaine végétal, peut affecter la biodiversité.
Le frelon à pattes jaunes, originaire d’Asie, est un prédateur de l’abeille domestique. Comme vous l’avez rappelé, son inscription sur l’une des nombreuses listes de nuisibles a, dans un premier temps, été envisagée, mais cet insecte n’est pas connu pour porter atteinte à la biodiversité. D’ailleurs, les interventions contre lui ne relèvent pas des dispositions prévues par le code de l’environnement pour la protection de la nature.
Le contrôle de l’expansion du frelon à pattes jaunes pose avant tout des problèmes d’ordre technique. Faute de pouvoir envisager l’éradication de cette espèce, deux voies complémentaires méritent d’être explorées : d’une part, les possibilités de protection ponctuelle des ruchers ; d’autre part, le contrôle de la dynamique des populations de cet insecte. Chacune de ces deux voies nécessite des solutions techniques fiables, qui font encore défaut. Par exemple, le piégeage des reines sortant d’hibernation a été conseillé par un institut technique, mais déconseillé par le Muséum national d’histoire naturelle. Les avis divergent également sur l’opportunité de détruire les nids.
La mission conjointe réunissant des inspecteurs généraux des ministères chargés de l’agriculture, de la santé et de l’environnement vient de s’achever, et son rapport orientera les choix juridiques et techniques à effectuer. D’ores et déjà, l’administration du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement apporte son soutien au Muséum national d’histoire naturelle, qui travaille à réunir et à valider les données naturalistes relatives à l’expansion de cette espèce en France et contribue à la recherche de solutions nouvelles, en coordination avec un laboratoire de l’Institut national de la recherche agronomique implanté à Bordeaux, auquel les services du ministère apportent également leur soutien financier.
Vous m’avez interrogé sur la date de publication du rapport et sur les suites qui y seront apportées. Je puis vous indiquer que les inspecteurs généraux missionnés ont remis leurs conclusions et que leurs propositions sont en cours d’analyse. Le rapport sera publié dans les tout prochains jours.

Je remercie M. le ministre de ces informations.
Je n’ignore pas que ce frelon participe à la biodiversité et qu’il n’est pas question de l’éradiquer. Toutefois, je pense qu’il convient de lutter contre sa prolifération.

Par conséquent, je souhaite que la mission en cours puisse nous apporter un éclairage et des pistes pour lutter contre un fléau qui touche en effet non seulement les apiculteurs, mais également l’ensemble du monde rural.

Monsieur le ministre, je vous prie de remercier en notre nom M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement, d’avoir permis la tenue dans de très bonnes conditions de cette séance tardive de questions orales, malgré la réunion du conseil des ministres.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.