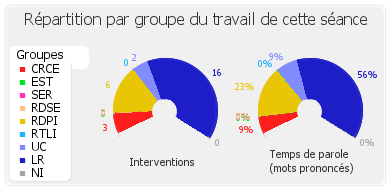Séance en hémicycle du 9 juillet 2013 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi et d'une proposition de loi
- Commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Organismes extraparlementaires (voir le dossier)
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Questions orales (voir le dossier)
- Rôle de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la prévention du risque inondation (voir le dossier)
- Retards de paiement du fonds d'intervention pour les services l'artisanat et le commerce dans le département de la haute-vienne (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :
– du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 juin 2013 ;
– de la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2013.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Par lettres en date du 3 juillet 2013, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de Jean-Louis Lorrain, au sein :
– du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en application des articles L. 1418-4 et R. 1418-19 du code de la santé publique ;
– de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, en application des articles L. 1114-1, R. 1114-5 et R. 1114-6 du code de la santé publique ;
– du Conseil supérieur du travail social, en application de l’article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2010.
Conformément à l’article 9 du règlement du Sénat, la commission des affaires sociales a été saisie de ces désignations.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.
Ce rapport a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des lois.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 5 juillet 2013 :
– une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L.231 du code électoral (n° 2013-326 QPC) ;
– une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (n° 2013-331 QPC).
Acte est donné de ces communications.

La parole est à M. Christian Namy, auteur de la question n° 472, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique.

Madame la ministre, le déploiement du très haut débit est un enjeu national. Le Président de la République, François Hollande, a fixé pour objectif la couverture intégrale de notre pays à l’horizon 2022.
Dans le département de la Meuse, le conseil général s’inscrit dans cette dynamique. Il a adopté en décembre dernier son schéma directeur territorial d’aménagement numérique, document stratégique qui planifie la montée en débit sur son territoire.
S’il est certain que le déploiement du très haut débit dans toute la France constitue un enjeu financier lourd – il est estimé a minima à 20 milliards d’euros –, c’est d’autant plus vrai pour les territoires ruraux qui sont confrontés à une faible densité de population et à un éparpillement de l’habitat.
Il est donc indispensable de tenir compte des spécificités de ces territoires dans les règles de subventionnement par l’État des investissements des collectivités locales par le biais du Fonds national pour la société numérique.
Or les règles qui viennent de nous être communiquées ne prennent à mon avis pas assez en compte les difficultés financières et la spécificité rurale non seulement de mon département, mais également, de manière générale, des départements ruraux.
Je souhaite par conséquent, en premier lieu, une augmentation du taux de subvention. En Meuse, le coût moyen de la prise s’élève à 2 600 euros dans les zones où le déploiement relève de l’initiative publique. Si le taux de subvention affiché est de 54, 5 %, il n’est en réalité que de 41 %, car les règles de calcul du Fonds national pour la société numérique imposent de déduire des prévisions de recettes d’exploitation et prévoient des plafonds.
Par ailleurs, j’invite à la non-extension des zones confiées aux opérateurs privés. Aujourd’hui, le déploiement du très haut débit est confié aux opérateurs privés dans les zones denses, dites zones AMII, et aux réseaux d’initiative publique dans les autres zones. Si l’on confiait de nouvelles zones au secteur privé, on risquerait de concentrer les investissements publics dans les zones les plus isolées. En conséquence, le prix moyen de la prise augmenterait encore, rendant le coût du déploiement plus lourd pour les collectivités locales.
Enfin, je suis favorable à l’éligibilité de la technologie FH-FTTH aux subventions accordées par le Fonds national pour la société numérique. Le conseil général de la Meuse a fait le choix de déployer la fibre optique en deux étapes. Si la partie « collecte » se fera exclusivement par la fibre optique, la partie « desserte » se fera en partie, dans un premier temps, par la technologie FH-FTTH.
Cette technique allie le faisceau hertzien, du point de mutualisation au répartiteur du village, et la fibre optique, du répartiteur au domicile de l’abonné. Elle est donc particulièrement adaptée aux territoires ruraux où des distances importantes, souvent de plusieurs kilomètres, séparent les points de mutualisation des villages raccordés.
Les solutions de mix technologique semblent désormais étudiées par l’État lorsqu’elles favorisent ses objectifs nationaux, si j’en crois les récentes déclarations d’Antoine Darodes, directeur de la mission «Très haut débit ».
Madame la ministre, j’ai bien conscience de la précision et de la technicité de mes questions, mais je crois relayer, au travers de l’exemple de mon département, les préoccupations d’un grand nombre de territoires ruraux qui se mobilisent pour éviter que le numérique ne soit le fondement d’une nouvelle fracture entre les territoires.
Monsieur le sénateur Christian Namy, le plan « France Très haut débit », ou FTHD, est l’un des chantiers d’infrastructures les plus ambitieux qu’ait connus la France au cours de ces dernières années.
Comme vous l’avez rappelé, le Gouvernement, fidèle à l’engagement pris par le Président de la République pendant la campagne électorale et à l’objectif affiché de permettre à tous les Français d’accéder au très haut débit d’ici à 10 ans, a conçu un plan de déploiement soucieux à la fois d’efficacité et de solidarité.
Plus de 120 millions d’euros ont déjà été engagés depuis la publication du nouveau cahier des charges à la toute fin du mois d’avril, et trente-sept collectivités ont déposé leur dossier technique auprès du Commissariat général à l’investissement.
D’emblée, monsieur le sénateur, je peux vous dire qu’aujourd’hui, concrètement, les dossiers des collectivités locales avancent ; mais je veux revenir sur les deux volets de votre question, pour vous répondre avec précision.
S’agissant du premier volet de votre question, je tiens à préciser que le plan « France Très haut débit » est un plan solidaire qui organise la péréquation territoriale en renforçant l’aide aux territoires les plus ruraux, comme le vôtre. Ce n’est pas seulement un discours, mais une réalité inscrite dans la manière même dont j’ai souhaité concevoir le plan.
Ainsi, pour votre département de la Meuse, le niveau de l’aide apportée par l’État connaît une augmentation significative de près d’un tiers dans le nouveau plan par rapport au précédent : le taux d’aide passe en effet de 42, 2 % à 54, 4 %.
J’ajoute que le plafond de subventionnement a été substantiellement relevé de 54 %, passant de 367 euros à 566 euros par prise.
Le Gouvernement a parfaitement conscience de l’effort financier très important que représente pour les collectivités, malgré l’augmentation de son soutien, ce défi crucial pour la vie économique, sociale et citoyenne des territoires. Une mobilisation générale de l’ensemble des collectivités territoriales est donc nécessaire pour engager des projets ambitieux. Ce défi appelle des choix exigeants de leur part, mais il est indispensable au maintien de la vitalité de zones rurales. Pour accompagner ces efforts, le plan FTHD met à leur disposition une enveloppe de prêts de plusieurs milliards d’euros à des taux extrêmement attractifs et sur des maturités longues – de vingt ans à quarante ans – qui permettent de lisser financièrement cet effort très important.
Enfin, le Gouvernement se bat en ce moment même auprès de la Commission européenne pour que les prochaines enveloppes des programmes opérationnels des fonds FEDER 2014-2020 puissent soutenir les projets de déploiement d’infrastructures numériques à très haut débit.
Monsieur le sénateur, le second volet de votre question concerne la solution FH-FTTH. Je vous confirme que celle-ci n’est pas, à ce jour, soutenue par le plan « France Très haut débit ». Je connais les contraintes très lourdes de la réalisation des réseaux de collecte en fibre optique dans les zones rurales, parfois isolées, et je comprends aisément qu’il puisse être très tentant de céder à des solutions alternatives moins onéreuses, parfois un peu à l’économie, et apparemment efficaces. Elles sont d’ailleurs habilement proposées par certains opérateurs, notamment en utilisant des technologies hertziennes.
Néanmoins, nous avons la profonde conviction qu’il faut dès aujourd’hui préparer l’avenir : il est nécessaire de déployer des réseaux de fibre optique dans les campagnes afin d’amener dans tous les villages la fibre optique, formidable arme contre l’isolement et la relégation économique. En effet, la fibre optique se joue des distances et laisse entrevoir des potentialités sans limites, ou presque, en matière d’usages. Elle seule offre une solution pérenne, évolutive et d’une grande fiabilité, de nature à développer de nouvelles applications, notamment pour l’éducation, la télémédecine ou les services publics.
De même qu’il était important, hier, de goudronner les routes nationales et départementales irriguant les villages de nos territoires pour rompre l’isolement physique, il est fondamental, aujourd’hui, de déployer des réseaux de collecte en fibre optique vers tous les villages pour neutraliser cet insupportable isolement numérique, aussi appelé « fracture numérique ».
Par ailleurs, je vous précise que la solution FH-FTTH repose sur un raccordement activé de la boucle locale FTTH qui pourrait soulever des interrogations au regard de la réglementation établie par le régulateur indépendant.
Monsieur le sénateur, je sais que les équipes du conseil général de la Meuse ont engagé des discussions avec la mission FTHD, dirigée par Antoine Darodes, qui m’est directement rattachée. Sachez que je veillerai à ce que celle-ci puisse poursuivre l’accompagnement de votre département dans le déploiement de la fibre.
J’ai intégré, depuis des mois maintenant, l’urgence de l’aménagement numérique des territoires. Le rythme d’instruction des dossiers par la mission « Très haut débit » me donne bon espoir de réduire enfin la fracture numérique dans notre pays.

Madame la ministre, je reconnais que le plan actuel est meilleur que le précédent. Je salue aussi votre engagement personnel sur ce dossier du tout-numérique, et vous en remercie.
En revanche, s’agissant du taux de subvention, je peux vous dire que les méthodes de calcul ne permettent pas d’atteindre le taux de 54 % dont vous avez fait état : nous sommes largement en dessous.
Ensuite, vous avez remis en cause la technologie FH-FTTH en disant qu’elle n’était pas forcément la meilleure formule aujourd’hui. Je pense au contraire qu’elle permet d’aborder le tout-fibre dans un deuxième temps, d’abord parce qu’elle amène la fibre optique dans tous les foyers de nos communes, ensuite parce qu’elle évite des remplacements à court terme des lignes de cuivre enfouies qui ne sont plus en état. Elle est donc susceptible de fournir à l’abonné le haut débit rapide à un coût raisonnable.
À mon sens, il s’agit donc actuellement de la meilleure solution en milieu rural, compte tenu des capacités financières de nos départements. Nous reverrons ce dossier avec votre collaborateur, mais permettez-moi de vous remercier de ce que vous faites.

La parole est à M. Philippe Dominati, auteur de la question n° 89, adressée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, au mois de février 2012, la CNIL a mis en lumière un fichage massif par Paris Habitat, l’office HLM de Paris, de 125 000 locataires, avec des annotations à caractère privé particulièrement graves : « alcoolique », « chômeur en fin de droits », « séropositif », « n’est pas de nationalité française », « sous chimiothérapie ». Ce fichier pour le moins curieux a été dénoncé par la CNIL.
Nous avons évoqué cette situation à plusieurs reprises, notamment à l’occasion d’une séance de questions d’actualité, voilà un an, pour savoir ce que le Gouvernement comptait faire. À chaque fois, il nous a été répondu que l’affaire suivait son cours.
Aujourd’hui, un an près, je souhaiterais savoir où l’on en est. Un audit devait être réalisé, et je sais qu’une remise en ordre technique a été opérée sur le logiciel. Pour autant, où sont les responsabilités ? Quelles suites le Gouvernement a-t-il donné à cette découverte d’un fichage massif des locataires parisiens, parmi les plus faibles de nos concitoyens, qui ont rarement la possibilité de se défendre ?
Je sais que vous allez m’apporter une réponse technique, mais, au-delà, je voudrais savoir quelle est réellement l’action du Gouvernement pour protéger les plus faibles, pour éviter que ce genre de dérive ne se reproduise et, surtout, pour définir les responsabilités. A-t-on mis la poussière sous le tapis ou a-t-on véritablement recherché les responsables de ce fichage massif ? Madame la ministre, tel est le sens de ma question.
Monsieur le sénateur, les manquements relevés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, en décembre 2011, lors de sa mission de contrôle du système informatique de Paris Habitat, n’avaient pas de caractère généralisé, puisqu’il s’agissait de cas très isolés d’enregistrements non pertinents, réalisés sans qu’aucune instruction ait été donnée.
En outre, Paris Habitat a engagé un travail de fond afin de répondre aux attentes de la CNIL. Ce travail a été présenté à cette dernière dans un mémoire en réponse, qui a d’ailleurs donné lieu à plusieurs réunions avec les services de la commission et a traduit en engagements concrets la mise en œuvre de cette démarche. Parmi ces engagements, figurait la nomination d’un correspondant informatique et libertés, devenue effective le 8 juillet 2012, en application des procédures définies par la CNIL. Le correspondant exerce sa fonction avec l’indépendance et l’autonomie d’action requises, en cohérence avec son statut.
La réalité de la mise en œuvre de ces engagements a pu être vérifiée lors de contrôles réalisés par les services de la CNIL. En effet, par courrier du 19 juillet 2012, la présidente de cette commission a décidé de procéder à la clôture de la mise en demeure de Paris Habitat. Dans ce courrier, elle a pris acte des mesures prises par Paris Habitat et noté que, dans certains domaines, les mesures prises « vont au-delà de ce qui était exigé dans la mise en demeure ».
En tout état de cause, le maire de Paris a écrit dès le 3 février 2012 aux présidents des trois autres organismes liés à la Ville de Paris, en leur demandant, d’une part, de vérifier sans délai la stricte conformité de leurs pratiques en matière d’enregistrement des données personnelles et, d’autre part, de présenter à leur prochain conseil d’administration les mesures mises en œuvre pour garantir le respect de la loi. La Régie immobilière de la ville de Paris, ou RIVP, la Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris, ou SIEMP, et la Société de gérance des immeubles municipaux, ou SGIM, devenue ELOGIE, les trois autres organismes concernés, ont réagi très rapidement et indiqué notamment que leurs gardiens n’avaient pas accès au système de gestion.
Des précisions ont été apportées, en particulier en termes de conservation des données et de vigilance rappelée aux équipes quant à l’utilisation, dans les applications de gestion, des éventuels champs libres réservés aux commentaires. Une présentation des mesures existantes a également eu lieu lors des conseils d’administration de ces trois organismes.
Enfin, à la suite du traitement de ce dossier, la CNIL a engagé une concertation nationale avec les acteurs du logement social. « Consciente des problèmes que peuvent rencontrer les bailleurs sociaux » – ce sont ses propres termes – dans l’application de la loi de 1978, la CNIL souhaite faire évoluer sa norme simplifiée et proposer un « pack de conformité », tenant compte des évolutions du métier de bailleur social requises par l’évolution des politiques publiques.

Madame la ministre, votre réponse portait sur les mesures prises dans le champ de compétence de la CNIL et la mise en conformité du logiciel de Paris Habitat. Finalement, si je comprends bien, personne n’est responsable ni coupable du fichage des locataires parisiens.
Sur le plan de la justice, le Gouvernement devrait savoir ce qui s’est passé. La direction de l’entreprise était-elle à l’origine des faits reprochés, ou s’agissait-il de phénomènes isolés résultant d’initiatives individuelles ? Un an après, nous n’en savons toujours rien !
Des instructions ont été données, on a prétendument réagi pour que de tels actes ne se reproduisent plus, mais aucune suite n’a été donnée à cette affaire. En réalité, on a voulu masquer cette action dérangeante. Un organisme public d’HLM gérant 120 000 locataires procède à un fichage individuel de ceux-ci, et il ne se passe rien ! Pour autant, vous prétendez tenir un discours d’exemplarité, en particulier aux jeunes, dans le domaine du numérique, des fichiers et du traitement des données.
Votre réponse est faible, madame la ministre – ce n’est d’ailleurs pas la vôtre, mais celle du Gouvernement. Normalement, le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur ont été informés, mais, en réalité, le problème est éludé et on fait en sorte que rien ne se passe !
Je ne peux donc pas me satisfaire de votre réponse.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, auteur de la question n° 453, adressée à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Nièvre dispose d’une ressource forestière abondante sur plus de 225 000 hectares. Le taux de boisement global du département est de 33 %. Les forêts nivernaises sont composées de 180 000 hectares de feuillus dont l’essence majoritaire est le chêne – plus de 66 % – et de 45 000 hectares de résineux, en majorité des douglas plantés dans la seconde moitié du XXe siècle.
Élue d’un département pour lequel la forêt est un bien précieux et la transformation du bois un axe majeur de développement économique, je souhaite aujourd’hui vous interpeller, madame la ministre, sur la nécessité de recréer les outils destinés à mettre en œuvre une politique forestière moderne et ambitieuse. Deux rapports viennent d’être présentés au Gouvernement ; ils sont destinés à alimenter la partie du futur projet de loi d’avenir sur l’agriculture consacrée à la forêt.
Je salue ici le travail de M. Jean-Yves Caullet, qui propose un certain nombre de pistes destinées à sortir la forêt française de l’« immobilisme » dans lequel elle stagnait ces dernières années, ainsi que le travail de la mission interministérielle menée par Christophe Attali, dont le rapport intitulé Vers une filière intégrée de la forêt et du bois prévoit l’élaboration d’un plan national de la forêt et du bois, qui serait la clef de voûte des instruments d’orientation et de conduite de la politique nationale forestière.
Madame la ministre, le Fonds forestier national, ou FFN, fonds d’État, a été supprimé par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001. Il était destiné à permettre une gestion plus dynamique des forêts françaises et à aider la filière bois à se développer en encourageant le reboisement et en désenclavant les forêts grâce à un meilleur accès des engins de débardage. Il était alimenté par une taxe fiscale et, en tant que compte spécial du trésor, il échappait à l’annualité budgétaire. Cette taxe était versée par les exploitants forestiers et le commerce de première transformation du bois.
Durant cinquante ans, ce fonds, outil essentiel d’une politique forestière nationale stratégique, a parfaitement répondu aux objectifs qui lui étaient assignés : extension forestière – plus de 2 millions d’hectares ont été plantés dont 1, 5 million appartient à des propriétaires privés –, développement de pépinières forestières, de routes, de pistes et de cloisonnements permettant une exploitation plus rapide et rentable des forêts, mise en place de système de défense contre les incendies, développement des métiers de la forêt.
Toutefois, des effets pervers se sont également fait sentir : la recherche d’une rentabilité maximale, couplée à un système d’aides spécifiques, a fortement privilégié résineux et peupliers dans beaucoup de régions françaises, créant un déséquilibre entre feuillus et résineux au détriment d’une biodiversité naturelle et indispensable. Le Morvan en est un exemple : il a connu un fort enrésinement dans la seconde moitié du XXe siècle ; sa ressource arrive à maturité et la disponibilité en résineux dans cette région reste supérieure à un volume de 1, 1 million de mètres cubes jusqu’en 2040.
L’exploitation actuelle de cette ressource ne s’effectue pas dans des conditions acceptables : les coupes rases, l’artificialisation des forêts et leur fragmentation écologique, aggravées par un exode rural non négligeable, sont à déplorer et menacent nos forêts actuelles. Aujourd’hui, alors que des plantations arrivent à maturité, ces « forêts de rendement » font l’objet d’une exploitation massive dans un contexte caractérisé par l’absence préjudiciable de moyens de contrôle et de réglementation. La question du repeuplement, du renouvellement de la ressource, des conditions de replantation et de l’équilibre des essences reste par ailleurs posée. Depuis 2001, aucune politique forestière n’a réellement été engagée, ni même pensée.
L’engagement de l’État en faveur de la forêt française est indispensable ; il ne s’était jamais démenti, s’appuyant, entre autres, sur des outils fiscaux et des subventions spécifiques. Ces outils, comme le FFN en son temps, constituaient des leviers efficaces permettant de développer une politique forestière durable.
Madame la ministre, est-il envisageable de travailler à la mise en place de nouveaux outils de gestion et de promotion de la filière bois et de la forêt française – comme le « fonds forestier stratégique carbone », proposé par les acteurs du secteur –, basés sur des financements alternatifs appuyés sur les nouveaux enjeux économiques et environnementaux liés à la forêt française ?
Je souhaiterais également savoir si de telles orientations seront inscrites dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, en préparation.
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Stéphane Le Foll, retenu ce matin au conseil d’administration de FranceAgriMer.
Le Fonds forestier national a été un formidable outil de rénovation de la forêt française entre 1946 et 2000, qui a permis le boisement de plus de deux millions d’hectares de terres abandonnées par l’agriculture et l’amélioration de la desserte. L’accent mis sur les résineux a certes modifié le paysage, mais la France reste un pays de feuillus avec 71 % de sa surface couverte par ces essences.
Les boisements réalisés grâce au FFN alimentent aujourd’hui une filière industrielle très dynamique, répondant à la demande de l’aval qui porte essentiellement sur des sciages résineux. Les actions d’animation territoriale – chartes forestières de territoire et plans de développement de massif – qui touchent un quart de la forêt privée portent sur le renouvellement de ces boisements qui arrivent à maturité et sont exploités, de façon à les remplacer par des peuplements mieux adaptés aux nouvelles conditions climatiques et plus riches du point de vue environnemental.
Les nombreux défis auxquels la forêt française doit faire face sont liés à des demandes économiques, écologiques et sociales de plus en plus appuyées, notamment du fait de la prise de conscience de la place de la forêt et du bois dans la lutte contre l’effet de serre : multifonctionnalité et gestion durable des forêts, intégration des forêts et du bois dans l’économie du carbone, préservation de la biodiversité, défense de l’emploi et aménagement du territoire sont autant de fonctions à développer.
Atteindre ces objectifs suppose, en premier lieu, d’assurer la pérennité de la forêt française par le renouvellement et l’amélioration des peuplements, en prenant en compte les conséquences du changement climatique. La constitution d’un outil financier capable de porter cette politique d’adaptation de la forêt française est donc un préalable.
Lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le Président de la République a annoncé, dans la feuille de route pour la transition écologique, le lancement immédiat d’une mission conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et du ministère du redressement productif, pour la création d’un fonds « bois-carbone » et d’un « comité national filière bois ». Il s’agissait notamment d’étudier la possibilité de mettre en place des financements alternatifs appuyés sur l’économie du carbone.
Le rapport de cette mission, remis récemment, se prononce pour la constitution d’un plan national de la forêt et du bois et la création d’un « fonds stratégique forêt-bois ». La mission confiée par le Premier ministre à M. Jean-Yves Caullet, député de l’Yonne, sur la forêt française et la filière bois conclut dans les mêmes termes.
Cet enjeu est donc bien identifié et fait l’objet de travaux pour sa mise en œuvre dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, actuellement en préparation. Parmi les six axes d’action du volet forestier de ce projet annoncés par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, lors du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois du 6 mai dernier, figure la mise en place d’un fonds stratégique forêt-bois et de son comité de gestion.
Les discussions en cours visent à mettre en place les conditions d’alimentation de ce fonds par diverses sources budgétaires, fiscales et de fonds de concours, de façon à redonner à la politique forestière des moyens en adéquation avec les défis qu’elle doit et souhaite relever.

Je tiens à remercier Mme le ministre de ces informations, espérant que nous obtiendrons satisfaction lors de la présentation de la loi d’orientation.

La parole est à Mme Catherine Deroche, auteur de la question n° 388, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie.

Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur les difficultés financières sérieuses que connaissent les gestionnaires des logements-foyers, tant dans la gestion de leur activité que dans la recherche d’aides à la réhabilitation des bâtiments.
Les logements-foyers ont été créés dans les années soixante-dix ; leur originalité réside dans leur mode d’accueil des personnes âgées dans des conditions proches de celles du domicile. Actuellement, ils représentent 2 330 structures en France et accueillent désormais près de 120 000 personnes.
Aujourd’hui, le parc des logements-foyers a vieilli et les besoins de rénovation du bâti et des équipements sont importants, tant pour la remise en état des bâtiments que pour leur adaptation au vieillissement des résidents, afin de prolonger le plus longtemps possible l’autonomie des personnes.
Ces logements-foyers ont été oubliés pendant de nombreuses années par les politiques nationales. Les financements se font rares ; or les investissements sont indispensables pour moderniser ces structures, face à des réglementations extrêmement rigides. Les travaux de réhabilitation ne peuvent être imputés à des résidents qui ne disposent, très souvent, que de faibles revenus, et les gestionnaires, tels les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, ne souhaitent pas répercuter sur ces résidents des charges trop importantes par le biais des redevances qui, de toute façon, sont encadrées financièrement ; ils hésitent aussi devant le coût des emprunts à contracter.
D’après les travaux de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, l’UNCASS, le coût de réhabilitation d’un logement-foyer est au minimum compris entre 23 000 euros et 26 000 euros par logement, soit 14 000 euros pour les travaux dans le logement et 9 000 euros pour les parties communes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, je vous remercie de m’indiquer de quelles aides financières des pouvoirs publics peuvent disposer les gestionnaires de logements-foyers qui sont dans l’attente de solutions pour la rénovation des établissements existants et la réalisation de nouveaux projets.
Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser Michèle Delaunay, ministre déléguée en charge des personnes âgées et de l’autonomie, qui préside actuellement « l’assemblée générale des âgés », au ministère.
Comme vous l’avez très justement souligné, il existe aujourd’hui en France 2 300 établissements et 116 000 logements pour des résidents dont la moyenne d’âge est de 82 ans. Les bailleurs sociaux possèdent 80 % de ces foyers-logements, dont 56 % ont été construits voilà plus de trente ans. Par ailleurs, 65 % des foyers-logements doivent aujourd’hui bénéficier d’une rénovation, et une étude récente de l’UNCASS met en évidence un besoin de financement de travaux de l’ordre de 360 000 euros en moyenne par établissement.
Plusieurs aides sont disponibles à cet effet avec, en premier lieu, celles qui sont déjà versées par les collectivités locales, conseils généraux et communes.
En second lieu, la Caisse nationale d’assurance vieillesse peut également être sollicitée : 78 millions d’euros en prêts sans intérêts qui représentent entre 15 % et 20 % des travaux ont ainsi été versés en 2012. Ces 78 millions d’euros ont d’ores et déjà permis de financer 133 projets.
Il existe aussi les aides de la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement pour le public, le parapublic et les structures privées non lucratives : ce sont les PHARE, ou Prêts habitat amélioration restructuration extension, et les Éco prêts.
Enfin, un nouveau prêt vient d’être ouvert, avec 20 milliards d’euros mis à disposition des collectivités locales. Ce prêt, accessible aux centres communaux d’action sociale, les CCAS, qui sont propriétaires d’environ 20 % des foyers-logements, est destiné à financer des travaux supérieurs à 200 euros le mètre carré, travaux qui devront répondre au moins à l’un des trois objectifs suivants : l’amélioration thermique, la sécurité et l’accessibilité.
Parallèlement, le Gouvernement a engagé des réflexions pour améliorer l’accès et le développement de ces aides.
La renégociation de la convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la Caisse nationale d’assurance vieillesse sera justement l’occasion pour le Gouvernement de s’interroger sur la nécessité de poser une priorité sur les foyers-logements.
Par ailleurs, subsistent des problématiques inhérentes aux conditions mêmes d’obtention de ces prêts de la Caisse des dépôts et consignations. Pour être éligible au PHARE, par exemple, il faut être habilité à l’aide sociale à hauteur de 100 %. Il faut aussi être titulaire de droits réels, ce qui signifie être propriétaire du mur, et avoir une stratégie de patrimoine, laquelle peut d’ailleurs différer des priorités du gestionnaire.
Pour l’Éco prêt, ce sont des conditions très fortes en termes d’économie d’énergie qui, bien souvent, alourdissent le coût final et font, au final, disparaître toute incitation. Sauf à faire porter le surcoût sur les résidents, ce que ni vous ni moi ne souhaitons, c’est donc vraiment sur l’ensemble de ces conditions qu’il faut désormais agir !
Mme Michèle Delaunay a lancé des groupes de travail pour revoir à la fois la réglementation et la législation en matière de foyers-logements, pour définir plus précisément leur modèle économique et la façon de mieux accueillir ces publics. Cela va venir en renfort des discussions qu’elle a d’ores et déjà entreprises dans ce sens avec la Caisse des dépôts et consignations.

Madame la ministre, je vous remercie de m’avoir apporté toutes ces précisions.
Même si le logement en foyer est pour certains un mode d’hébergement en diminution, il reste très prégnant. Il me paraît correspondre à une phase de la vie. Il paraît donc important que les collectivités territoriales disposent de ce type de logement sur leur territoire.
Les contraintes que vous avez évoquées sont souvent des freins. Tous les gestionnaires le disent, notamment dans mon département du Maine-et-Loire, la somme qui reste in fine à leur charge est trop importante. Sans répercussion sur les redevances, cela devient impossible pour eux ! Le travail qui doit être fait en termes d’assouplissement, tout en respectant les règles de sécurité et d’accessibilité, est un élément majeur à l’avenir. C’est vrai, d’ailleurs, pour d’autres équipements publics.

La parole est à M. Jean-Vincent Placé, auteur de la question n° 417, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France connaît un taux de fécondité relativement élevé comparé à ses voisins européens, ce dont on ne peut que se réjouir. Pourtant, sa structure démographique est sur le point de changer radicalement. En trente ans, les hommes ont gagné huit ans d’espérance de vie, et les femmes sept ans. La part des personnes âgées de 60 ans et plus est passée de 16 % de la population totale en 1950 à 24 % en 2012, et elle devrait atteindre 32 % en 2060. Les enjeux en matière de lutte contre la dépendance sont donc très importants et vont le devenir de plus en plus.
Or, la France reste en retard en termes d’adaptation des logements au vieillissement de leurs occupants. Selon l’Agence nationale de l’habitat, ce sont deux millions de logements qui nécessiteraient des travaux afin d’être adaptés à l’âge de leurs occupants. C’est également le constat tiré par le rapport de Luc Broussy – c’est un grand spécialiste des questions de la dépendance et de l’intergénérationnel – sur l’adaptation de la société française au vieillissement de la population : 6 % des logements français sont aménagés pour les plus de 65 ans, contre 16 % aux Pays-Bas. L’Espagne, l’Allemagne et le Danemark sont aussi largement mieux équipés que notre pays.
Dans mon département, l’Essonne, j’ai participé le 25 novembre 2011, à Morangis, à la pose de la première pierre du premier établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, en France. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une politique extrêmement volontariste souhaitée par le président du conseil général, mon ami Jérôme Guedj. Je sais, madame la ministre, que vous êtes venue dans l’Essonne pour visiter d’autres établissements. §Vous connaissez très bien le sujet, comme l’ensemble du secteur dont vous avez la charge.
Le nombre de places dans les établissements d’accueil spécialisés nécessite d’être adapté aux besoins. L’INSEE a recensé 531 927 lits dans les EHPAD en 2011. Or, on estime qu’en 2010 le nombre de personnes dépendantes s’élevait à 1, 1 million. Ce nombre pourrait s’élever à 2 millions en 2040.
La France, quels que soient les gouvernements en place depuis vingt ans – j’ai évoqué des chiffres et n’entend nullement engager une quelconque polémique politicienne –, ne paraît pas suffisamment préparée au vieillissement de sa population et à la sécurisation des seniors.
Madame la ministre, quelle est la stratégie du Gouvernement en matière d’hébergement des personnes âgées ? Je le sais, le temps imparti pour votre réponse ne vous permettra pas d’être exhaustive.
Monsieur le sénateur, permettez-moi de répondre à la place de Michèle Delaunay, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence.
Comme vous le savez, deux plans de développement arrivent à échéance : le plan Alzheimer et le plan Solidarité grand âge. Cependant, à l’heure actuelle, de nombreuses places qui relèvent de ces plans restent encore à installer sur la période 2014-2016. Il existe en effet, vous le savez, un délai entre le moment où le dossier est autorisé et l’ouverture réelle de la structure.
Afin de répondre immédiatement et dans l’urgence aux besoins non satisfaits, nous allons ouvrir 26 000 places d’EHPAD d’ici à la fin du quinquennat, avec une exigence de justice renforcée.
L’exigence de justice vise, d’abord, à réparer les inégalités entre les territoires aujourd’hui plus ou moins bien pourvus en établissements. Il y a, de ce point de vue, une énorme disparité que nous voulons rattraper.
L’exigence de justice vise aussi les personnes âgées et leur famille en offrant à tous une meilleure accessibilité, une transparence de l’information et un encadrement des tarifs. Il s’agit là d’une vraie rupture par rapport à l’action du gouvernement précédent, qui n’était pas à la hauteur des besoins actuels de notre pays.
L’analyse des schémas régionaux des agences régionales de santé, les ARS, comme les contacts avec le terrain et les représentants des établissements et financeurs mettent en exergue la nécessité de consolider l’existant plutôt que d’investir massivement en vue de la création de nouvelles places, même si cela paraît nécessaire.
Cette consolidation passe par une politique de médicalisation ambitieuse des structures – à cette fin, 155 millions d’euros seront attribués dès cette année –, par une meilleure inscription des EHPAD dans les filières de soins afin d’améliorer les parcours de santé des personnes âgées, et, enfin, par une plus grande accessibilité financière à cette offre : rien ne sert en effet d’augmenter et d’améliorer le parc si celui-ci reste inaccessible au plus grand nombre !
Ces analyses et ces contacts de terrain, monsieur le sénateur, soulignent aussi la nécessité d’agir, en utilisant trois leviers incontournables et prioritaires.
Il faut d’abord agir sur la prévention pour retarder la perte d’autonomie et mieux gérer les conséquences des maladies chroniques. Afin de préparer l’avenir face à la révolution de l’âge, le Gouvernement investit massivement dans une politique active de prévention de la perte d’autonomie. Nous engageons la transformation nécessaire du système de santé afin de garantir le droit au maintien au domicile grâce à une médecine de parcours qui sera mieux organisée et fondée sur des services médicosociaux renforcés.
Il faut ensuite agir sur le renforcement de l’offre. À cette fin et pour mieux accompagner les personnes âgées en établissement, il importe de renforcer la présence humaine. Nous allons donc recruter plusieurs milliers de postes destinés aux EHPAD déjà existants dans le cadre de la médicalisation des structures que je viens d’évoquer.
Il faut enfin agir sur l’attractivité du secteur de la gérontologie et de la gériatrie pour le doter de professionnels formés, compétents, engagés et en grand nombre. Sans une action forte pour rendre attractif ce secteur d’activité porteur, nous ne pourrons pas faire face et couvrir l’ensemble des besoins. Il y a là un potentiel d’emplois très important. Nous engageons donc un vaste plan « métiers » pour mieux recruter, former et soutenir les personnels qui sont quotidiennement auprès de ces personnes âgées.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement, qui sera prête pour la fin de l’année – vous le savez, ma collègue Michèle Delaunay y travaille – viendra renforcer l’ensemble des dispositifs évoqués. Elle s’inscrit dans le droit-fil des engagements pris par Mme la ministre et que le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse que vous m’avez transmise de la part de votre collègue Michèle Delaunay, dont je salue le travail très volontariste réalisé sur ce dossier. Je ne peux que me réjouir des propos très dynamiques, sérieux et extrêmement argumentés que vous avez tenus tant sur la prévention que sur les moyens et la formation.
J’ai écouté avec un intérêt particulier votre propos sur les inégalités entre les territoires. Je veux plaider à cet égard pour mon département situé en Île-de-France : cette région, que l’on croit toujours riche et puissante, est en réalité très contrastée.
La grande couronne, dont je suis l’élu, compte des territoires ruraux : parce qu’ils sont proches de l’Île-de-France et pas vraiment situés en province, on peut les croire richement dotés en services publics. Or tel n’est pas le cas. Les personnes âgées, les personnes en grande difficulté qui ont besoin de la puissance publique éprouvent, au-delà d’un sentiment d’isolement, la réalité de l’isolement.
Le conseil général, présidé par mon ami Jérôme Guedj, fait déjà beaucoup. Cependant, nous avons besoin de l’action puissante de l’État, d’une action de solidarité et de justice. Les propos que vous avez tenus à cet égard me rassurent fortement, madame la ministre.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 437, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur le manque de structures d’accueil des personnes handicapées vieillissantes.
Ainsi, à titre d’exemple, pour le département de la Drôme, alors que 1 300 personnes sont confrontées à cette difficulté, s’y ajouteront bientôt 141 nouvelles personnes handicapées âgées de 55 à 60 ans.
Face au placement en maison de retraite traditionnelle, qui ne peut être une solution satisfaisante à tous points de vue, il est mis en place de petites unités à l’intérieur de foyers d’hébergements existants. Cependant, ces initiatives limitées ne sauraient résoudre le problème posé, qui est global.
Aussi convient-il de trouver dès à présent des solutions permettant de tenir compte de tous les paramètres et de l’aspect humain de cette question.
Face à cette situation, à juste titre particulièrement mal vécue par les personnes handicapées et leur famille, je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer quelles mesures vous entendez prendre en urgence pour faire face à ce manque cruel de structures adaptées aux personnes handicapées vieillissantes.
Monsieur le sénateur, vous appelez mon attention sur le manque de structures d’accueil pour les personnes handicapées vieillissantes, et vous avez raison. Nous avons énormément de retard dans ce domaine.
Vous le savez, les personnes handicapées, comme l’ensemble de la population, connaissent un allongement de leur espérance de vie. Je m’en félicite et suppose que c’est encore mieux dans le département de la Drôme, où l’on vit très bien !
Cette réalité a cependant des conséquences spécifiques qu’il convient d’anticiper, pour les établissements d’accueil et les services d’accompagnement, mais aussi pour les familles, les aidants et les professionnels.
C’est la raison pour laquelle Mme la ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie et moi-même avons souhaité engager dès le mois de février dernier une réflexion destinée à évaluer le phénomène, que nous n’avions pas suffisamment pris en compte jusqu’à ce jour. Nous avons également voulu évaluer les difficultés que soulève cette évolution, qui constitue un atout, une chance, mais crée aussi des contraintes. Nous avons entrepris d’apprécier les besoins qu’elle génère et les moyens d’y apporter des réponses, notamment en termes d’accompagnement, que ce soit en établissement ou à domicile, la majorité des personnes souhaitant rester chez elles.
Cette mission a été confiée à un groupe de travail qui réunit l’ensemble des acteurs concernés par le sujet et dont l’animation est assurée par M. Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales.
Ce travail vise non à instituer une nouvelle catégorie administrative qui serait liée à l’âge, mais à répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées vieillissantes dans le cadre des politiques générales du handicap, d’une part, et de l’avancée en âge, d’autre part.
Il ne vise pas davantage à créer un type particulier et distinct de structures. L’objectif est d’adapter et de diversifier le dispositif existant. Il convient également, et nous allons le faire, de conforter le rôle des aidants, qu’ils soient familiaux ou professionnels. Nous avons d’ailleurs organisé une réunion sur ce sujet.
Les travaux du groupe sont d’ores et déjà assez avancés pour permettre la prochaine remise d’un rapport, qui sera présenté au Premier ministre. Nous pourrons alors envisager les suites à y apporter. Je ne manquerai pas d’en tenir la représentation nationale informée, particulièrement vous, monsieur le sénateur.
Cette question, comme de nombreuses autres lorsqu’il s’agit du handicap, fait l’objet d’un traitement interministériel.
Le Premier ministre convoquera très prochainement, avant la fin de l’été ou dès la rentrée, le comité interministériel du handicap, le CIH, qui se réunira pour la première fois depuis sa création par le précédent gouvernement, comme il le fera dorénavant chaque année.
L’un des éléments forts à l’ordre du jour de ce CIH sera justement la question de la prise en charge des personnes âgées handicapées, à laquelle Michèle Delaunay et moi-même avons à cœur d’apporter une réponse. J’informerai bien sûr de ces travaux la représentation nationale.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Je n’ai jamais douté de votre volonté de résoudre ce problème, et je souhaite que le calendrier que vous avez indiqué soit respecté.
Je note surtout que les mesures proposées s’intégreront dans le dispositif en vigueur.
J’espère, enfin, que l’on veillera à permettre aux personnes âgées de rester à domicile, car il s’agit selon moi de la meilleure solution.

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 462, à nouveau transmise à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a des chiffres qui s’imposent et que l’on ne peut oublier : dix personnes meurent chaque jour, en France, d’avoir respiré cette poussière blanche qu’est l’amiante. Ce fléau est responsable de 3 000 décès par an.
Depuis les années 2000, plus de 1 500 personnes sont décédées en Aquitaine des conséquences de l’amiante. Interdite depuis 1997, alors que l’effet cancérigène de la fibre était connu depuis les années trente, l’amiante, avec ses fibres mortelles, continue de représenter un danger pour tous ceux qui y sont exposés.
Les associations de défense des victimes de l’amiante, qui agissent pour stopper la progression de ce fléau, font état de plus de 200 000 tonnes d’amiante et de 24 millions de tonnes de fibrociment répartis sur notre territoire.
Vous le savez, madame la ministre, plus de 70 % des chantiers de désamiantage sont réalisés dans de très mauvaises conditions et deviennent de nouvelles sources de contamination. Le constat est alarmant : aucun risque d’exposition n’est maîtrisé !
Une étude de 2009 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, démontre que les fibres fines ont un effet cancérigène avéré, et que l’on ne peut pas écarter l’effet cancérigène des fibres courtes.
Cette étude préconise la prise en compte de cette nouvelle donne dans les directives préventives, et plus particulièrement l’abaissement par dix des valeurs limites d’empoussièrement en milieu professionnel. On peut regretter que cette décision ne devienne effective qu’à l’horizon 2015.
De plus, les équipements de protection individuelle qui sont actuellement utilisés ne sont pas adaptés aux dangers auxquels sont exposés les intervenants professionnels.
En outre, les inspecteurs du travail, en nombre insuffisant, ne peuvent contrôler l’application de la réglementation en vigueur, car ils sont trop rarement informés de l’ouverture des chantiers de désamiantage.
Bien qu’incomplète, la législation existe, mais elle n’est pas respectée par les entreprises agréées qualifiées pour le retrait et le confinement de l’amiante : ces entreprises enlèvent les marchés puis, par le jeu de la sous-traitance, transmettent ces chantiers à des entreprises qui, elles, ne sont généralement pas qualifiées et agissent au mépris tant de la santé de leurs employés que de la protection de l’environnement.
L’aspect professionnel des chantiers de désamiantage ne doit pas occulter le désamiantage effectué par des particuliers. Les décrets du 3 juin 2011 et l’arrêté du 21 décembre 2012 stipulent que les particuliers ont l’obligation de faire appel à des professionnels pour mener des opérations de désamiantage. Comme vous pouvez l’imaginer, cet appel se trouve limité en raison du coût prohibitif des interventions.
De nombreuses communes sont confrontées au grave problème de désamiantage des établissements scolaires. De tels chantiers réalisés dans de très mauvaises conditions génèrent des tonnes de déchets qu’il faut stocker, transporter et éliminer.
Madame la ministre, je suis certain que vous êtes consciente de la nécessité d’éviter les dépôts sauvages. L’absence ou la méconnaissance d’un réseau de déchetteries de proximité habilitées à recevoir les produits dangereux, mis à disposition avec des moyens adaptés, est un élément essentiel de cette problématique.
Même réalisé dans les conditions optimales, l’enfouissement ne peut représenter une solution durable pour l’environnement. D’après les associations, le seul moyen de neutralisation définitive sur notre territoire serait le procédé d’inertage au moyen de la torche à plasma, proposé par la société INERTAM de Morcenx, dans les Landes. En raison de ses coûts de revient, cette solution ne serait utilisée qu’à 12 % de sa capacité.
Il conviendrait d’encourager le développement en volume de l’utilisation de l’inertage, ainsi que la recherche d’autres procédés d’élimination définitive.
Nous vous faisons confiance, madame la ministre, pour que des directives soient enfin prises pour éviter la propagation de ce véritable fléau sanitaire. Seule une législation européenne claire et commune pourrait débarrasser l’Europe de ce poison.
N’oublions pas que l’on continue d’utiliser l’amiante dans de trop nombreux pays ! Seule une réglementation sévère, compréhensible permettra de la bannir et d’enrayer ce fléau.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur les conséquences dramatiques de l’utilisation de l’amiante et des nouvelles sources de contamination, notamment au cours des opérations de désamiantage. Vous avez évoqué avec une grande vérité l’ensemble des problèmes qui se posent et souhaitez, à juste titre, connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
En premier lieu, le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, entré en vigueur le 1er juillet 2012, constitue le fondement d’une réforme réglementaire d’ampleur, dans un souci de protection des travailleurs.
Les principales mesures proposées sont les suivantes : l’abaissement de la valeur limite d’exposition professionnelle, la VLEP, qui est actuellement de 100 fibres par litre, à 10 fibres par litre au 1er juillet 2015 ; la suppression dans le code du travail de la dualité entre les notions d’amiante friable et d’amiante non friable ; l’élévation des niveaux de prévention collective et individuelle à mettre en œuvre ; l’extension de la certification à l’ensemble des activités de retrait et d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante, en particulier aux activités de retrait de couverture et de bardage en amiante-ciment.
Le décret du 4 mai 2012 appelle quatre arrêtés d’application : l’arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, au contrôle de la VLEP aux fibres d’amiante et conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages ; l’arrêté du 14 décembre 2012 qui fixe les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ; l’arrêté du 7 mars 2013 relatif aux conditions d’entretien, d’utilisation et de vérification des équipements de protection individuelle ; enfin, l’arrêté du 8 avril 2013 qui fixe les conditions d’entretien, d’utilisation et de vérification des moyens de protection collective.
Par ailleurs, le dispositif de formation des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante a été renforcé par l’arrêté du 23 février 2012.
La démarche de certification des entreprises, notamment aux entreprises de couverture, permettra d’améliorer leur maîtrise technique sur le plan de la prévention des risques professionnels et d’éviter les pollutions et l’exposition du public. Elle permettra également de s’assurer de l’effectivité de la formation des travailleurs par un organisme de formation certifié et de vérifier l’existence d’une assurance professionnelle.
Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, de l’implication de l’ensemble des services de l’État concernés, au nombre desquels l’Inspection du travail, sur l’effectivité de cette réglementation, qui est la plus exigeante au sein de l’Union européenne. Il est vrai que nous devions également progresser au niveau de l’Europe.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
Sans douter de votre volonté de faire progresser la réflexion sur cette question, je me permets d’insister très fortement auprès du Gouvernement sur ce devoir d’information et de prévention du désamiantage, qui est un devoir de santé publique. Il faut en effet éviter que l’on ne fasse n’importe quoi dans ce domaine.

Mes chers collègues, avant d’aborder la question orale suivante, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à dix heures trente.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, auteur de la question n° 427, adressée à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à qui je souhaite la bienvenue dans cet hémicycle.

Monsieur le ministre, je suis très honoré de vous donner, avec d’autres collègues également auteurs de questions orales qui vous sont adressées, l’occasion de vous exprimer pour la première fois devant le Sénat.
Ladislas Poniatowski et moi-même avons rédigé un rapport, qui fut présenté au Gouvernement au mois de septembre 2011, concernant l’introduction dans notre système de distribution d’électricité d’un nouveau type de compteur qu'on a qualifié d’abord d’intelligent, puis de communicant et qui porte aujourd'hui la marque Linky.
Ce compteur présente un certain nombre de vertus. Il permet d'abord à l’usager de mieux suivre sa consommation, d'adapter son mode de consommation en fonction des tarifs qui sont proposés selon le moment de la journée ; à mon avis, d’autres modalités sont d’ailleurs envisageables.
Par ailleurs, sur le plan industriel, le développement de cet outil est susceptible d’avoir des effets extrêmement positifs : on parle de milliards d’euros et de quelque 10 000 emplois.
Pour l'instant, la décision de généraliser ces compteurs n'est pas prise. Un certain nombre d'expérimentations ont été menées. Beaucoup ont manifesté leur réticence, voire leur hostilité. Même s’il convient d’analyser attentivement leurs arguments, il faut aller de l'avant et introduire les compteurs Linky. Tout dépend du distributeur, ERDF, mais cette entreprise tiendra certainement compte du point de vue du Gouvernement et, notamment, je l’imagine, de votre avis, monsieur le ministre.
Pour ma part, je souhaite que des dispositions soient très rapidement prises pour généraliser ce compteur, qui a vocation à être largement exporté. Il faut en effet savoir que différents pays attendent que la France installe ce compteur pour décider de le faire eux-mêmes. L’Italie l'a déjà fait, mais avec un compteur un peu moins performant. Car, je le souligne, le compteur Linky est un excellent produit.
J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que la décision attendue pourrait être prise aujourd'hui même. Je ne vois là qu’une simple coïncidence : je ne peux croire que cela ait un lien avec le fait que ma question orale ait été inscrite à l'ordre du jour de ce matin ! §
Monsieur le ministre, j’espère que vous allez nous annoncer de bonnes nouvelles !
Monsieur le président, je tiens à souligner que c'est pour moi un grand honneur de m'exprimer devant la Haute Assemblée. Ayant été pendant des années le collaborateur le plus proche de Michel Charasse, je sais la qualité du travail qui y est accompli. Croyez bien que je m’attacherai, dans les responsabilités qui sont désormais les miennes, à répondre aux sollicitations des sénateurs.
Monsieur Lenoir, j'ai grand plaisir à vous retrouver ici après avoir siégé en même temps que vous à l’Assemblée nationale.
Votre question me donne l’occasion de préciser l’état d’avancement du projet de déploiement des compteurs intelligents Linky.
Dans le débat national sur la transition énergétique, il est clair que la sobriété et l’efficacité énergétiques constituent un enjeu majeur ; c’est d’ailleurs celui qui fait le plus consensus. Au titre de l’efficacité énergétique passive, la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier, donnera lieu à un programme ambitieux, mené par Mme Duflot. Le compteur intelligent se situe du côté de l’efficacité énergétique active en ce qu’il permet à l’utilisateur de piloter sa consommation de manière optimale.
Par ailleurs, les objectifs de développement des énergies renouvelables, très souvent intermittentes, nécessiteront un système électrique beaucoup plus réactif, à même de mieux les intégrer au réseau existant.
Un nouveau rapport entre l’offre, notamment les énergies renouvelables, et la demande doit donc émerger. À cet égard, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, le compteur Linky est appelé à jouer un rôle déterminant. C’est ce compteur intelligent qui rendra possible le déploiement des smart grids, c’est-à-dire des réseaux intelligents pour le système électrique. En période d’augmentation des coûts, c'est important.
Le projet Linky est ainsi un vrai projet d’intérêt général. Il profitera à l’ensemble du système de production et de distribution d’électricité comme à chaque foyer français.
La concertation engagée par le Gouvernement sur ce projet a permis des avancées significatives. Elle a abouti à une compréhension partagée de certains enjeux. Elle a clarifié les concepts et le vocabulaire. Cette concertation a également mis en exergue les forts enjeux industriels français attachés à ce projet et ses conséquences bénéfiques sur l’emploi dans la filière électrique, ainsi que, vous l’avez dit, sur nos exportations.
Le déploiement des compteurs devrait débuter d’ici à la fin de l’année 2014.
Toutefois, au-delà des décisions du Conseil d’État qui ont validé le dispositif réglementaire, il reste des étapes à franchir pour assurer une maîtrise optimale de la mise en œuvre du projet.
Le Gouvernement y sera attentif et je vous confirme que, cet après-midi, probablement, dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, le Premier ministre évoquera ce dossier, qui, conformément à ce que vous souhaitez, fait partie intégrante des investissements à réaliser.
Enfin, je tiens à dire que la même démarche est entreprise pour le gaz, avec le projet Gazpar, qui aura les mêmes effets bénéfiques pour les consommateurs.
Monsieur le sénateur, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de souligner la grande importance que le Gouvernement attache au développement du compteur Linky.

Monsieur le ministre, je vous remercie des informations que vous nous avez communiquées et je note avec plaisir l'intérêt manifeste que vous portez à cette question.
Vous l'avez souligné, le compteur Linky est appelé à connaître un grand succès industriel. Il faut maintenant passer aux actes.
Vous avez évoqué à juste titre les réseaux intelligents. En effet, il ne suffit pas que la terminaison, c'est-à-dire les compteurs, soit intelligente : il faut aussi que l'ensemble du réseau puisse, notamment dans la période de transition énergétique, bien répondre au développement des énergies renouvelables.
Les conditions sont donc réunies. Si l'élan est donné grâce à la décision qui pourrait être prise cet après-midi, je serai le premier à m'en réjouir.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, auteur de la question n° 441, adressée à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le ministre, je me permets tout d’abord de saluer à mon tour votre présence pour la première fois dans cet hémicycle.
La progression du chômage illustre la situation économique de notre pays. Les politiques gouvernementales n’ont pas, à ce jour, enrayé les effets d’une conjoncture qui a certes une dimension internationale, mais à laquelle viennent malheureusement s’ajouter des rigidités et complexités administratives dont le rapport qui vient d’être remis au Gouvernement au sujet des normes évalue l’impact à 2, 8 milliards d’euros par an, soit 3, 7 % du PIB national.
De cette rigidité, doublée d’une inadaptation des politiques menées, l’exemple de la filière solaire est l’illustration, cette filière ayant déjà été sérieusement ébranlée par le moratoire de 2010.
À l’occasion de la conférence environnementale, le Gouvernement s’était engagé à sauver cette filière en grand danger. Le 26 mars dernier, il a annoncé le lancement d’un nouveau cycle d’appel d’offres simplifié, ce qui s’est accompagné de la suppression des deux dernières périodes trimestrielles, provoquant un « trou d’air » de plusieurs mois.
Les mesures annoncées au mois de janvier dernier concernant le tarif d’achat et l’appel d’offres complet ne sont pas de nature à rassurer les professionnels, dont les propositions n’ont pas été entendues.
L’ensemble de ces décisions aura sans aucun doute de graves conséquences sur les emplois et ne permettra pas la mise en œuvre des investissements industriels attendus.
La chute du nombre des installations raccordées au réseau au dernier trimestre de 2012 est significative de l’état d’extrême fragilité de la filière photovoltaïque.
Or l’appel d’offres CRE 2 de septembre et l’appel d’offres simplifié d’octobre n’ont retenu aucune des observations et préconisations de la profession, ce qui ne laisse rien augurer de bon quant à son résultat et à ses effets sur l’économie de la filière.
Il serait intéressant de savoir comment le Gouvernement entend poursuivre le débat sur la transition énergétique, prendre en compte les conclusions du débat organisé le 17 mai à Lyon et associer davantage la filière à son devenir en ouvrant de nouveaux sujets comme l’autoconsommation.
Monsieur le sénateur, je le confirme, la transition énergétique est une priorité absolue du Gouvernement pour 2013. Dans ce cadre, la relance de la filière solaire a été actée lors de la conférence environnementale du mois de septembre dernier.
Je ne voudrais pas être désagréable, mais je rappelle qu’au cours des deux dernières années du précédent quinquennat ce sont pratiquement 10 000 emplois qui ont été détruits dans la filière.
Dans l’attente des conclusions du débat national sur la transition énergétique – le dossier final me sera transmis le 18 juillet prochain –, le Gouvernement a pris plusieurs mesures d’urgence.
D’abord, est prévue la régularisation de la situation de 80 000 producteurs photovoltaïques pour lesquels la décision du Conseil d’État du 12 avril 2012 a entraîné la suspension des contrats d’achat.
Ensuite, le 7 janvier 2013, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures d’urgence, entrées en vigueur au 1er février. Ces mesures concernent toutes les installations et visent à atteindre le développement annuel d’au moins 1 000 mégawatts par an de projets solaires en France en 2013, soit le double des objectifs annuels précédemment fixés.
Le but est la relance de la filière en réorientant la politique de soutien vers la mise en place d’une filière industrielle durable, créatrice de valeur ajoutée sur le territoire national et permettant ainsi de réduire le déficit commercial du secteur solaire.
Un système d’appel d’offres simplifié avait en effet été mis en place par le précédent gouvernement pour les installations de taille intermédiaire sur toiture, c’est-à-dire pour une puissance installée comprise entre 100 kilowatts et 250 kilowatts. Les premiers résultats de cet appel d’offres ont été peu satisfaisants en termes de coûts et de retombées industrielles.
Le Gouvernement a donc décidé de modifier le cahier des charges, notamment pour ajouter un critère d’évaluation carbone qui permettra de prendre en compte la contribution des projets à la protection du climat. En effet, un panneau solaire fabriqué en Europe, c’est jusqu’à cinq fois moins d’émissions de CO2 qu’un panneau importé d’Asie !
Cet appel d’offres prévoit un volume global de 120 mégawatts, réparti en trois périodes de candidature entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014.
Monsieur le sénateur, il n’y a donc aucun « trou d’air » dans cet appel d’offres, qui suscitera des investissements cumulés de l’ordre de 250 millions d’euros.
La date limite de remise des offres a été fixée au 31 octobre 2013. La désignation des lauréats pourrait ensuite avoir lieu en 2014, pour une mise en service des projets lauréats en 2015.
Au-delà des mesures d’urgence, le débat national sur la transition énergétique, dont les recommandations me seront remises le 18 juillet prochain, débouchera sur un projet de loi de programmation qui sera déposé au Parlement et examiné dès le début de 2014. Ce texte comportera des mesures pérennes pour soutenir efficacement la montée en puissance des énergies renouvelables, en vue d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République à l’horizon 2025.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions et de vos engagements. Je n'ai d’ailleurs pas manqué de lire avec la plus grande attention vos déclarations d'hier évoquant l'importance de la transition énergétique et l'enjeu structurant qu’elle représente en matière de développement économique, d'emploi et de solidarité.
Vous me donnerez acte que j'ai moi-même évoqué les vicissitudes que nous avons connues dans le passé, notamment le moratoire de 2010 et ses effets. J'insiste néanmoins sur le fait que, à l'époque, cela concernait le marché des particuliers. Alors que tout le monde considérait qu'il ne devait pas être affecté, car c'est lui qui est le plus créateur d'emplois, c’est celui qui a été le plus sinistré.
Aujourd'hui, je crains que les mesures avancées par les professionnels ne soient pas suffisamment prises en compte par CRE 2 et l'appel d'offres simplifié du mois d'octobre dernier. Monsieur le ministre, je vous remercie d’être particulièrement attentif à ce qui va se passer. Il ne faudrait pas que se reproduise ce que nous avons connu récemment parce que nous n'avions pas tenu compte des préconisations des professionnels.

La parole est à M. Richard Yung, en remplacement de M. Jean-Étienne Antoinette, auteur de la question n° 443, adressée à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le ministre, je vous assure, au nom de mon collègue Jean-Étienne Antoinette, retenu dans son département ultra-marin, comme en mon nom propre, de notre soutien dans l’exercice de cette responsabilité délicate qui vous a été confiée au sein du Gouvernement.
Le développement durable est au cœur de l’avenir de la Guyane et les projets qui occupent votre ministère rendent compte de l’importance de ce territoire, en particulier la protection de la biodiversité de la forêt amazonienne et la refonte du code minier, ces deux questions étant liées.
La forêt guyanaise recèle une biodiversité d’une richesse impressionnante : 98 % de la faune française et 96 % des espèces de plantes sont en Guyane. Outre le réchauffement climatique, qui touche l’ensemble de la planète, les activités humaines menées sur place – développement des infrastructures routières, exploitation de la forêt et de la ressource aurifère, notamment – mettent en danger cet écosystème.
Monsieur le ministre, vous avez identifié une première orientation pour protéger ce patrimoine naturel exceptionnel : la valorisation des richesses génétiques de la biodiversité du territoire.
Voilà quelques semaines, votre ministère lançait une concertation autour d’un projet de loi cadre intégrant cette question. Conformément au protocole de Nagoya, ce texte prévoit l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, notamment par leur accès satisfaisant et un transfert approprié des technologies pertinentes ; il contribue ainsi à la conservation de la diversité biologique.
Vous ne pouvez être trop timoré dans cette entreprise. La valorisation commence avec la recherche, pas seulement avec l’utilisation commerciale des ressources. Ensuite, les espèces naturelles comme les espèces domestiques doivent faire l’objet de mesures de protection et de valorisation. Enfin, la répartition des richesses doit concerner chacun des ayants droit, c’est-à-dire également les populations autochtones de la forêt guyanaise.
Les Amérindiens et les Bushinengués composent les peuples qui, traditionnellement, habitent la forêt et en vivent. Le partage des avantages tirés de ces richesses doit mettre en valeur leur savoir-faire et leur relation à la terre et permettre, finalement, la reconnaissance de leur existence autonome, que personne ne méconnaît en Guyane.
La seconde orientation est la valorisation du gigantesque puits de carbone que constitue la forêt tropicale humide de Guyane. S’il faut mener une étude définitive pour en mesurer le potentiel, il est extrêmement important de développer une gestion durable de la forêt. La récente loi transposant la directive sur le marché du carbone a révélé l’indifférence de l’Union européenne vis-à-vis de sa forêt humide en région ultrapériphérique, le choix ayant été fait d’ignorer tout mécanisme spécifique pour lutter contre le grave déboisement de la forêt guyanaise.
Intégrer ou adapter pour la Guyane les mécanismes de mise en œuvre conjointe, développer les marchés volontaires de crédits carbone ou la certification des projets de réduction d’émissions sont autant de pistes à étudier pour une valorisation durable de la forêt guyanaise.
Une politique publique respectueuse de l’environnement, soucieuse de développer la richesse endogène de la Guyane, emprunte ces voies. Quand et comment, monsieur le ministre, pensez-vous pouvoir la mettre en œuvre ?
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Yung, la Guyane est, comme vous l’avez rappelé au nom de votre collègue, un territoire d’une richesse exceptionnelle en termes de biodiversité, et je connais l’attachement de M. Antoinette à défendre ce patrimoine.
L’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation, afin de valoriser les ressources biologiques que recèle ce territoire, constituent l’un des piliers de la convention de Rio sur la diversité biologique. C’est un moyen de lutter contre la biopiraterie, mais aussi d’organiser et de structurer des actions de valorisation de la biodiversité.
La Guyane est déjà engagée dans cette voie avec les dispositions actuellement prévues pour le parc amazonien de Guyane. Mais il faut aller plus loin.
Il nous faut étendre ce sujet à l’ensemble de la Guyane et à tous ceux qui utilisent les ressources génétiques à des fins de recherche et de développement.
Il nous faut également actionner tous les leviers qu’offre le protocole de Nagoya. Je pense notamment à la coopération entre les États ayant signé ce protocole.
Lors de la conférence environnementale de septembre dernier, le Gouvernement a décidé que la loi-cadre pour la biodiversité prévoirait un régime d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages.
Ce projet, monsieur le sénateur, est en cours d’élaboration, en concertation avec tous les acteurs concernés. Je le présenterai devant le Parlement à l’automne.
Parallèlement, l’Union européenne travaille à un règlement qui complétera le dispositif français, en particulier sur le régime de conformité.
L’ensemble de ces travaux permettra la mise en œuvre concrète du protocole de Nagoya en France.
Nous ratifierons, avec les autres États membres et l’Union européenne, le protocole. Cela permettra sa ratification à l’automne 2014.
S’agissant de l’opportunité de valoriser la forêt de Guyane au titre du puits de carbone qu’elle représente, la gestion durable de la forêt guyanaise constitue, en effet, une nécessité et une véritable source de richesse pour la région. Elle représente un véritable stock de carbone, l’équivalent d’environ quinze ans d’émission du territoire national et, vous l’avez souligné, il existe à l’heure actuelle, compte tenu de la déforestation en cours, un enjeu de préservation de ce trésor national.
Une étude va prochainement être lancée par l’Institut géographique national et l’Office national des forêts afin d’évaluer l’évolution de ce stock.
Cette phase est primordiale pour démontrer le respect de nos engagements au titre de la deuxième période du protocole de Kyoto et elle nous permettra d’agir en toute responsabilité.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je la transmettrai à mon collègue Jean-Étienne Antoinette et je lui suggérerai de prendre contact avec vous et votre cabinet.

Dans l’attente des orateurs suivants, la séance est suspendue pour quelques instants.
La séance, suspendue à dix heures cinquante, est reprise à dix heures cinquante-cinq.

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 461, transmise à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention, ainsi que celle de l’ensemble du Gouvernement, sur les conséquences dommageables qu’auront pour le monde de l’élevage, en termes de charges supplémentaires, la mise en place de la taxe carbone – elle renchérira le coût de l’approvisionnement des exploitations en aliments pour le bétail, mais aussi celui du transport de tous les produits qu’elles commercialisent – et la mention des équivalents carbone des produits et de leurs emballages, à quoi vont s’ajouter les augmentations significatives du prix de l’électricité – une énergie ô combien importante pour les exploitations d’élevage ! – qui viennent d’être annoncées.
Lors du dernier salon de l’agriculture, le ministre de l’agriculture et d’autres membres du Gouvernement se sont exprimés, de même que les responsables agricoles des différentes filières, ovine, bovine, porcine et avicole, sur les grandes difficultés que traversent actuellement les éleveurs.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque l’on constate la diminution significative de ces productions – la chute est même catastrophique pour ce qui concerne la production ovine. Chaque jour, la France doit recourir à davantage d’importations de viande ou de volaille, provenant souvent de pays qui n’ont pas les mêmes garanties sanitaires, alors que nous avons d’immenses espaces dédiés à l’élevage, vouées ainsi à devenir autant de friches, principalement en montagne, avec en outre les conséquences que l’on sait : avalanches et incendies, plus particulièrement dans le sud.
Cette distorsion croissante de concurrence m’inquiète ; elle ne peut que pénaliser gravement les éleveurs français sur le marché mondial. Elle accroît le manque de rentabilité des exploitations d’élevage, alors que les contraintes sociales des éleveurs, qui doivent de surcroît assurer une présence quasi permanente auprès de leurs bêtes, sont déjà bien réelles.
L’augmentation importante du prix des matières premières que sont les céréales aggrave encore la situation. Devant ce constat, nombre d’éleveurs cessent leur production ou, quand ils le peuvent, retournent leurs prairies pour produire des céréales.
C’est pourquoi il ne m’apparaît pas réaliste de vouloir ajouter des charges nouvelles pour une filière déjà en grande difficulté.
Ces évolutions sont graves et, si rien n’est fait, pourraient bien conduire, à terme, à la disparition progressive de l’élevage dans notre pays. Mardi dernier, lors du débat sur la réforme de la PAC au Sénat, tous les intervenants, de quelque groupe qu’ils soient issus, ont souligné la situation dramatique et le désespoir des éleveurs.
Le Gouvernement envisage-t-il réellement de mettre en œuvre ces deux dispositions, qui ne pourront que contribuer à alourdir encore les charges qui pèsent sur les éleveurs et à menacer davantage leur existence ? Ne vaudrait-il pas mieux mettre en place d’urgence une politique de relance pour cette filière en fort déclin ?
Monsieur le sénateur, venant moi-même d’un département, le Gers, où l’élevage a quelque importance, je connais bien la situation dramatique des éleveurs. Je l’ai vue se dégrader durant les dix dernières années, au cours desquelles les éleveurs laitiers ont quasiment disparu de mon département.
Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Frédéric Cuvillier, qui m’a demandé de bien vouloir vous répondre en son nom.
Le dispositif d’affichage environnemental des produits et des emballages, en cours d’élaboration, est une application des articles 54 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et 228 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Ainsi, une expérimentation nationale a été menée entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2012. Le bilan de l’expérimentation, qui devra être transmis prochainement par le Gouvernement au Parlement, sera accompagné de rapports sur les retours d’expérience des acteurs.
Un premier retour d’expérience a été fait à l’occasion du « forum entreprises », le 18 février 2013. Plusieurs obstacles techniques ont été soulevés, concernant notamment la de standardisation de l’affichage et des référentiels. Il convient de définir des modalités adaptées pour chaque secteur, en veillant à respecter l’objectif d’une information claire et lisible du consommateur.
S’agissant de l’écotaxe poids lourds, qui s’applique à tous les véhicules de transports de marchandises de 3, 5 tonnes, y compris aux transporteurs étrangers, elle entrera en vigueur dès le 1er octobre prochain.
Proportionnelle aux kilomètres parcourus sur le réseau soumis à l’écotaxe, cette première fiscalité écologique sera directement liée à l’intensité des parcours sur le réseau taxable.
Les échanges de proximité sont donc favorisés, ce qui ne peut manquer de renforcer l’attractivité des produits locaux et va dans le sens de l’aide aux filières agroalimentaires françaises. Ainsi, les flux d’importations sont proportionnellement plus concernés par la tarification routière, péages autoroutiers et écotaxe confondus.
Par ailleurs, le choix du réseau taxable a été fait dans un souci de concentrer la tarification sur les axes principaux, et non sur le tissu local, irrigué par les voies secondaires.
Les 15 000 kilomètres de réseau soumis à l’écotaxe représentent moins de 1 % du réseau routier français total. Le réseau local concerné, lui-même limité à 5 000 kilomètres, ne représente que 1, 3 % des 372 000 kilomètres du réseau départemental. Il est prévu qu’un rapport évaluant l’impact de l’écotaxe sur les différentes filières soit transmis au Parlement d’ici au 31 décembre 2014.
Puisque vous évoquez également les augmentations des tarifs de l’électricité que j’ai moi-même annoncées hier soir, monsieur Bailly, je dois dire que, si le précédent Gouvernement n’avait pas privilégié une politique de fuite en avant, refusant d’évaluer correctement les coûts de l’électricité dans notre pays, nous ne serions pas obligés de procéder à cette augmentation. Celle-ci reste toutefois limitée, car nous sommes soucieux de préserver le pouvoir d’achat des ménages, notamment des plus fragiles d’entre eux, qui pourront avoir accès aux tarifs sociaux de l’électricité.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.

Monsieur le ministre, venant d’un département où l’élevage occupe une place importance, vous constatez vous-même, vous l’avez dit, la diminution du nombre des éleveurs. Vous comprendrez donc que le président du groupe d’études de l’élevage s’inquiète de voir baisser significativement – de près de 50 % en vingt ans – les cheptels bovin et ovin français, ce qui nous contraint à importer.
Vous le savez, les agriculteurs ont toujours eu, face à la grande distribution, beaucoup de mal à répercuter dans leurs prix de vente l’augmentation de leurs charges.
Vous me dites que le poids de l’écotaxe poids lourds s’appliquera à des grands itinéraires, que les dessertes locales seront épargnées, que les importations seront pénalisées et que nos éleveurs, finalement, en tireront bénéfice. Je crois qu’il faudra suivre cela de près. En tout cas, le Gouvernement doit vraiment faire en sorte que les charges supplémentaires qui résulteront pour les éleveurs de l’augmentation du prix de l’énergie et des trois dispositifs que j’ai évoqués soient maîtrisées.
Je rappelle que, dans nos fermes d’élevage, plus particulièrement en montagne, sur des secteurs d’AOC, le séchage en grange nécessite beaucoup d’énergie électrique. Mon souci est donc de savoir, monsieur le ministre, dans quelle mesure ces charges pourront être répercutées sur les prix de vente ?

Cette après-midi, la commission des affaires économiques reçoit M. Benoît Hamon, ministre en charge de la consommation : ce sera, pour nous, l’occasion d’évoquer cette question. Compte tenu des difficultés auxquelles les éleveurs sont aujourd'hui confrontés, il n’est pas imaginable qu’on laisse s’accroître les charges qui pèsent sur eux.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 469, adressée à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le ministre, je souhaite vous entretenir de la principale conclusion du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011. Ne voyez là aucune vanité d’auteur : c’est seulement la manifestation d’une préoccupation réelle.
Ce rapport, qui a été débattu en séance le 12 novembre 2012, en présence de Mme Delphine Batho, concluait à l’inexistence d’une politique de prévention de l’inondation en France, si l’on entend par « politique » une action cohérente et continue.
Parmi les causes multiples de cet état de fait, nous pouvons souligner l’existence d’objectifs théoriquement complémentaires mais qui, en réalité, se contrarient : je vise en l’occurrence la protection des populations contre l’inondation et la protection des milieux aquatiques.
Ainsi la mission a-t-elle fait, en matière d’entretien des cours d’eau, le constat suivant, que je me permets de vous rapporter : « Les rares personnes privées assurant leurs obligations et les collectivités locales voient leurs actions d’entretien des cours d’eau compliquées par les services chargés de la police de l’eau… Pas un élu rencontré par la mission qui n’ait fait état d’un conflit, se terminant parfois devant le tribunal correctionnel, avec la police de l’eau, agents de l’ONEMA compris. S’il est un constat unanime, c’est bien que le principal obstacle à l’entretien des cours d’eau réside dans le zèle de la police de l’eau, zèle qui la conduit à intervenir même là où il n’y a pas de cours d’eau, au sens de la jurisprudence, donc pas de réglementation protectrice du milieu aquatique à faire respecter. Effet plus pervers encore : le zèle de la police de l’eau est une bonne façon de ne rien faire pour ceux qui ont légalement à charge l’entretien des cours d’eau. »
Les agents de l’ONEMA – Office national de l’eau et des milieux aquatiques – assument environ un tiers de la mission de la police de l’eau, en principe sous la responsabilité du préfet. La direction de cet organisme n’ayant pas jugé bon de répondre aux interrogations que je lui avais soumises par lettre au sujet, notamment, des orientations de sa politique pour éviter que la protection des milieux aquatiques ne vienne contrarier la prévention efficace du risque d’inondation, je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître votre point de vue sur cette importante question.
Au passage, dans la mesure où les inondations ont aussi touché le département du Gers, je veux souligner la réactivité des services de l’État au cours de cette période. Que ce soit dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, les élus n’ont eu qu’à se louer de la présence massive de l’État : présence du Président de la République, des ministres concernés et de tous les services de l’État.
Permettez-moi aussi, au moment où je prends la tête de cette administration, d’affirmer mon soutien aux agents en charge de la police de l’eau et des milieux aquatiques. Il s’agit d’une mission à la fois essentielle et complexe, que ces agents accomplissent d’une manière qui mérite d’abord notre respect.
Vous avez raison, monsieur Collombat, de souligner que le double objectif de préservation des milieux aquatiques et de protection des populations contre les inondations est une priorité absolue. Les événements du printemps dernier ont, une nouvelle fois, montré l’importance de cette question.
Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique, lancé par le Premier ministre, deux évaluations sont actuellement en cours : l’une concerne la police de l’environnement, notamment la police de l’eau ; l’autre concerne la politique de l’eau dans son ensemble.
Le rapport d’évaluation de la politique de l’eau, remis récemment au Premier ministre par le député Michel Lesage – ainsi qu’un autre rapport, commis à l’époque par un député nommé… Philippe Martin –, évoque justement le sujet. Il propose des pistes pour améliorer l’efficacité de la police de l’eau, assurée par les services de l’État et par l’ONEMA. Ses préconisations seront étudiées et discutées lors de la prochaine conférence environnementale, en septembre 2013, au cours de la table ronde sur l’eau, l’eau constituant l’une des thématiques retenues pour ladite conférence.
Quoi qu'il en soit, je souhaite dès à présent réaffirmer clairement que l’objectif recherché est bien la conciliation des impératifs de protection des milieux aquatiques, de préservation de l’environnement et de prévention des risques liés aux inondations.
Vous l’avez relevé dans votre rapport, cela nécessite des compétences adaptées. C’est bien en ce sens que vous avez déposé un amendement au projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, soutenu par le Gouvernement et adopté ici le 5 juin dernier. Il attribue aux collectivités locales et à leurs groupements une compétence « milieux aquatiques » intégrant la réalisation de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, la prévention des risques liés aux inondations et submersions, l’aménagement des bassins hydrographiques.
Au-delà, je le sais, l’application du droit de l’environnement et notamment de la police de l’eau peut être complexe. La volonté du Gouvernement est de la rendre plus simple, plus efficace et plus lisible, dans le cadre des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement.
C’est en concertation avec l’ensemble des parties prenantes – en particulier les élus, dont vous signaliez l’absence dans les dialogues qui ont pu avoir lieu – que nous pourrons trouver les solutions les plus appropriées sans renoncer à nos objectifs de préservation de l’environnement. (

Monsieur le ministre, je laisse de côté, en la circonstance, tout ce qui a trait à la gestion des crises ainsi que ce qui concerne les réparations : il s’agit ici d’évoquer simplement la prévention des inondations. À cet égard, il convient de mener une politique continue, financée à hauteur des besoins et non contradictoire.
Je conviens qu’il faut concilier les exigences de protection de l’environnement et les exigences de protection des populations. Toutefois, ce que je constate, c’est que, sauf sur le papier, ces objectifs ne se concilient pas ! Et ce n’est pas parce qu’on répétera à longueur de journée la nécessité de les concilier qu’ils seront effectivement conciliés !
Nous l’avons constaté, partout monte une immense plainte : « Chaque fois que l’on veut faire quelque chose, on a toujours la police de l’eau sur le dos ! »

Tout le monde le dit ! Alors, on peut continuer à dire qu’il faut concilier les objectifs, mais il vaudrait mieux trouver des solutions.
Il n’est pas question de brader les objectifs de protection de l’environnement. Du reste, celle-ci peut aussi être une façon de régler le problème des inondations. Mais encore faut-il sortir de ce système « autobloquant » : à chaque dispositif correspond un autre qui le contrarie !
C’est l’objet des propositions que j’ai faites, et je remercie le Gouvernement d’avoir soutenu une première proposition. J’aurai une autre proposition à vous soumettre, monsieur le ministre, et j’espère que vous la soutiendrez aussi, notamment dans son aspect financier, car l’attribution de moyens est la condition de la réussite du dispositif.
Année après année, des événements viennent nous apporter la preuve que se pose un véritable problème. Il y a quand même 40 % des communes françaises qui ont un territoire inondable !
Mon seul but est de trouver un moyen de concilier concrètement, et pas uniquement sur le papier, les objectifs sur lesquels nous sommes d’accord. Si l’ONEMA m’avait répondu, je n’aurais probablement pas été amené à vous solliciter, monsieur le ministre.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, auteur de la question n° 446, adressée à Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.

Madame la ministre, vous le savez, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, autrement dit le FISAC, relève d’un dispositif initialement fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution. Il était, jusqu’en 2002, alimenté par un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, acquittée par la grande distribution.
La loi de finances pour 2003 a affecté le produit de la TACA au budget général de l’État. Depuis cette date, le montant des dotations ouvertes au titre du FISAC est fixé, chaque année, par la loi de finances, indépendamment du produit attendu de la TACA, devenue en 2008 la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM.
Depuis 2008, la dotation du FISAC a surtout été fortement réduite, passant de 60 millions d’euros en 2008 à 42 millions d’euros en 2012, alors même que le nombre de dossiers instruits est passé de 783 en 2008 à 1570 en 2011, soit plus du double, ce qui témoigne du succès de ce dispositif, et donc de son intérêt.
Cette situation a provoqué de nombreux dysfonctionnements, notamment des retards de paiement pour les bénéficiaires et collectivités territoriales accompagnatrices de projets.
Concrètement, à titre d’exemple, dans le département de la Haute-Vienne, le préfet estime à 1, 7 million d’euros le montant des paiements en retard pour l’ensemble du département.
Plus précisément encore, le Pays d’Ouest Limousin, qui a reçu délégation et assure à ce titre l’instruction, l’animation et le paiement des dossiers déposés, se plaint de n’avoir reçu aucun versement depuis deux ans. Il a mis en place, pour accompagner les projets d’entreprises artisanales, commerciales et de services, à partir de 2006, une démarche collective territorialisée, ou DCT, renouvelée en 2011 avec l’accord de l’État. Or, depuis 2011, il ne peut que donner un avis sur les dossiers sans garantie de bonne fin.
À aucun moment, les services de l’État ne donnent la moindre assurance, sans pour autant décourager les postulants. Au contraire, par lettre du 23 décembre 2011, le secrétaire général de la préfecture affirmait que la « décision ministérielle d’approbation devrait être signée et notifiée d’ici à la fin de l’année » !
Vous conviendrez, madame la ministre, qu’il est tout à fait inopportun de réduire la dotation du FISAC dans cette période difficile. Le FISAC œuvre en faveur de l’économie de proximité, il permet aux zones rurales et urbaines fragilisées de soutenir le commerce et l’artisanat local.
Il a un effet non négligeable sur l’économie locale et la qualité de vie des habitants parce qu’il a pour objet la redynamisation et de pérennisation des commerces, des services et de l’artisanat, qui ont une fonction économique à part entière et jouent un rôle important en matière d’aménagement du territoire.
Madame le ministre, il avait été question d’une remise à plat complète du dispositif afin de lui donner une nouvelle impulsion, ce qui, d’ailleurs, n’apparaît pas vraiment indispensable eu égard au grand nombre de dossiers déposés...
Envisagez-vous un financement spécifique du FISAC, qui prendrait le relais de l’ex-TACA ? Qu’en est-il du remboursement annoncé depuis près de deux ans ?
Vous venez de le souligner à très juste titre, monsieur le sénateur, le FISAC est d’une importance capitale pour nos territoires et pour l’économie de proximité ; c’est un véritable levier de croissance pour les commerçants, les artisans et les services.
Je l’ai, pour ma part, rappelé à de nombreuses reprises : ce fonds se trouve aujourd’hui dans une situation très préoccupante.
Ainsi que vous l’avez fort bien expliqué, le précédent gouvernement a élargi les critères d’éligibilité au FISAC et, dans le même temps, diminué drastiquement les crédits alloués à ce fonds. Faire augmenter les besoins de financement, puis supprimer les crédits, voilà une étrange logique, vous en conviendrez !
Cette attitude a conduit à une forte augmentation du stock de dossiers et, faute de crédits suffisants, à un retard considérable dans leur traitement. Lors de mon arrivée à Bercy, j’ai trouvé environ 1 800 dossiers non financés, représentant plus de 120 millions d’euros. Les quatre prochains exercices budgétaires ne suffiraient même pas à régulariser la situation !
Pour ce qui concerne le département de la Haute-Vienne, j’ai récemment attribué une subvention de 150 000 euros à la communauté d’agglomération de Limoges. Je le sais, de nombreux autres dossiers sont en attente de financement ; ceux qui sont instruits à ce jour nécessitent des crédits à hauteur de 1 million d’euros. Des besoins se font encore jour : la récente demande de subvention formulée par la communauté de communes des Monts de Châlus pour la création d’une boucherie-charcuterie en est la preuve.
L’opération collective de modernisation du Pays d’Ouest Limousin, que vous venez de me signaler, monsieur le sénateur, appartient à ce stock non financé à ce jour, compte tenu du nombre de dossiers accumulés ces dernières années sans financement correspondant. La demande de subvention relative aux deux premières tranches de cette opération qui a été adressée à mes services est néanmoins instruite sur le plan technique.
Cependant, la situation budgétaire dont j’ai hérité ne permet pas d’honorer toutes les demandes à la hauteur et dans les délais attendus, ce qui conduit bien souvent les collectivités à engager des crédits avant de se voir notifier leur subvention.
Vous l’avez rappelé, j’ai commandé une évaluation complète du FISAC, afin de sécuriser et d’assurer la stabilité juridique de ce dispositif. Des travaux complémentaires ont été nécessaires, tant ce fonds a été mal structuré et mal utilisé. En collaboration avec mon collègue ministre du budget et l’ensemble des membres du Gouvernement, j’essaie d’apporter des réponses aux nombreux courriers que je reçois et aux interpellations formulées par tous les élus, notamment par ceux de la Haute Assemblée.
Je souhaite ouvrir, une fois la clarté faite à l’issue de l’évaluation, une négociation sur le financement du fonds. Parallèlement, dans le cadre d’un projet de loi que je vous présenterai ultérieurement, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite également modifier les critères d’attribution du FISAC, afin, non pas de redynamiser ce dernier, puisque les demandes existent bel et bien, mais de répondre aux attentes et aux besoins des commerçants, des artisans et de respecter enfin l’enveloppe budgétaire allouée. À cet effet, il convient d’instaurer des critères allant dans le sens des priorités fixées tant par le Gouvernement dans le pacte pour l’artisanat que par moi-même dans le plan d’action pour le commerce et les commerçants que j’ai présenté voilà quelques semaines, afin de mener une action efficace et pertinente sur l’ensemble des territoires.

Cela dit, la situation est extrêmement difficile. En effet, les communes et groupements, qui n’ont reçu aucune consigne contraire, instruisent les dossiers qu’ils reçoivent et donnent un avis, sans savoir toutefois s’il leur sera donné suite. Et l’État déconcentré ne leur dit pas qu’il n’y aura pas de crédits. Les artisans, commerçants, prestataires de sociétés de services attendent donc avec espoir.
Comme moi, vous avez souligné que le dispositif pouvait être amélioré. Localement, il a un certain poids et assure une réelle dynamisation du commerce, notamment en milieu rural.
Je ne suis pas du tout opposé au subventionnement de l’agglomération de Limoges, mais elle ne constitue pas la partie du département de la Haute-Vienne qui connaît les difficultés économiques les plus importantes. En réalité, il conviendrait que vous portiez une attention particulière aux zones rurales. Actuellement, des postulants à des aides, qu’il s’agisse de sociétés, d’artisans, de commerçants, sont en train de revoir un certain nombre d’investissements à la baisse. Je rappelle que le FISAC représente le tiers des aides qui peuvent leur être apportées, ce qui n’est pas mineur.
En conclusion, madame le ministre, tout en vous remerciant de votre réponse, je vous dis mon espoir de voir la situation s’améliorer. Le dispositif est attractif, répond à des demandes, à des besoins. Or, malgré tous les biais recherchés pour essayer de mieux faire fonctionner la machine, je crains que les difficultés ne perdurent s’il n’y a pas une augmentation significative du volume des aides.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 502, adressée à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Madame le ministre, dans le prolongement de mes préoccupations liées à la vie associative et au sport, je souhaite modestement attirer votre attention sur la situation du bénévolat dans notre pays, en particulier dans le monde rural.
Nous ne saurions trop rappeler l’importance de la vie associative et de l’engagement bénévole qui en découle. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui consacrent du temps, de l’énergie et même de l’argent pour donner au mot « bénévolat » tout son sens. Nous le savons tous très bien, ce travail de terrain formidable, permanent et toujours inachevé est aussi un atout pour l’État et les collectivités locales, qui peuvent s’appuyer sur un réseau social, sportif et associatif de premier plan.
Le jugement très favorable qui est porté sur votre action, madame le ministre, démontre d’ailleurs que vous partagez ce point de vue.
En effet, sans ces femmes et ces hommes de bonne volonté, il serait nécessaire de multiplier fortement les crédits consacrés à l’ensemble des missions concernées. Des avancées ont été enregistrées, des dispositions encadrent et accompagnent le monde associatif, qui dispose ainsi d’outils performants. Mais ne faut-il pas aller plus loin dans une société qui devient de plus en plus égoïste ?
On peut en outre constater avec quelque regret que la situation du bénévole a évolué quant à ce que l’on exige de lui, voire quant aux risques qu’il peut encourir.
Dans ce que l’on appelle la « France profonde », les responsables qui souhaitent constituer une équipe de football, par exemple, doivent aller en voiture chercher les adolescents dont les familles se trouvent en difficulté, faute de quoi l’effectif requis ne sera pas atteint.
Madame le ministre, le temps n’est-il pas venu de poursuivre cette réflexion en organisant un vrai débat au sein des instances parlementaires ? C’est la raison pour laquelle je vous demande ce matin, devant la Haute Assemblée, de faire en sorte que puisse être discutée la proposition de loi portant sur l’engagement et la reconnaissance du bénévolat associatif à laquelle j’ai réfléchi, avec mes collègues de la commission de la culture, et qui, pour autant, ne dénaturerait pas le bénévolat. Un engagement quant à une inscription à l’ordre du jour de ce texte dès l’automne serait bienvenu.
Monsieur le sénateur, je vous remercie d’avoir posé cette question, qui permet de mettre en lumière l’action de ces seize millions de personnes qui, dans notre pays, s’engagent gratuitement au service des autres.
Voilà un mois, l’association France bénévolat, en association avec l’IFOP, a publié une étude sur les bénévoles dans notre pays. Entre 2010 et 2013, le nombre de ces derniers a augmenté de 14 % ; sur la tranche d’âge des 15-35 ans, cette hausse a même atteint 32 % ! Il s’agit là d’un élément extrêmement positif, qui contredit quelque peu certains discours décrivant une jeunesse se repliant sur elle-même. En fait, notre jeunesse est extrêmement généreuse : elle sait donner de son temps au service de l’intérêt général.
Comme vous l’avez vous-même noté, il est essentiel que nous veillions à accompagner et soutenir le bénévolat. À cet égard, plusieurs dispositifs existent déjà. Je veux les rappeler ici : la clarification du cadre juridique dans lequel les bénévoles interviennent ; le remboursement des dépenses engagées dans le cadre des activités associatives sur la base réelle des montants justifiés, tels les frais de déplacements supportés particulièrement par un certain nombre de dirigeants sportifs, que vous avez vous-même évoqués ; la possibilité, pour les bénévoles, de bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons en cas de renonciation au remboursement de frais.
Par ailleurs, pour encourager le bénévolat, l’un des axes privilégiés de la politique du Gouvernement est le soutien à la formation et à l’accompagnement des bénévoles. En 2013, l’État a consacré près de 11 millions d’euros au Fonds pour le développement de la vie associative, ou FDVA, qui finance les formations de bénévoles dans tous les secteurs, hormis celles qui concernent les membres d’associations sportives, qui bénéficient de l’aide du Centre national pour le développement du sport, le CNDS.
J’ai souhaité que les crédits du FDVA soient stabilisés, ce qui lui a permis de financer, cette année, 6 500 projets de formation au bénéfice de 170 000 bénévoles.
Pour ce qui concerne le sport, 15 millions d’euros de moyens ont été consacrés à la formation des dirigeants, des personnels encadrants, des arbitres qui, majoritairement, sont des bénévoles.
Monsieur le sénateur, je partage votre point de vue : il faut aller plus loin. Au demeurant, c’est ce que j’ai essayé de faire depuis ma prise de fonctions.
J’ai d’abord souhaité instituer un congé d’engagement bénévole, qui permettrait d’accroître pour les responsables associatifs qui exercent une activité salariée le temps disponible. Au mois de juillet dernier, j’ai sollicité le Haut Conseil à la vie associative, le HCVA. Dans son avis rendu au mois de novembre, celui-ci a préconisé l’octroi d’un crédit de temps annuel pour l’exercice d’une responsabilité associative. En liaison avec le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, mon ministère étudie actuellement les possibilités d’élargir le champ d’application du congé de représentation pour ces responsables associatifs salariés.
Par ailleurs, toujours en liaison avec le HCVA, le Gouvernement souhaite développer des outils pour permettre aux bénévoles d’attester de leur expérience associative dans leur parcours scolaire, universitaire, professionnel. J’évoquais tout à l’heure le nombre des bénévoles âgés de moins de 35 ans : ces derniers doivent pouvoir valoriser cette expérience.
Enfin, pour permettre une meilleure reconnaissance de l’engagement bénévole, nous travaillons avec la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur pour étendre le périmètre de la médaille de la jeunesse et des sports à l’engagement associatif, ce qui devrait être fait l’année prochaine.
Quant à la question du statut des bénévoles, elle a été longuement explorée lors de la conférence de la vie associative en 2006. Le débat se poursuit, mais la grande diversité des formes que revêt le bénévolat rend difficile la définition d’un tel statut et s’oppose à toute forme de rétribution puisque le bénévolat est, par définition, un don de temps librement consenti et gratuit.
Création d’un congé d’engagement bénévole pour les actifs, développement de la valorisation des acquis de l’expérience associative, extension à la vie associative de la médaille de la jeunesse et des sports : vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement est déterminé à soutenir et conforter l’action des seize millions de bénévoles, ces « fantassins de la République » engagés au service de l’intérêt général.

Madame le ministre, j’apprécie énormément votre réponse parce que, et ce n’est pas pour me surprendre, vous avez tenu à me répondre complètement, en entrant dans le détail de toutes les possibilités qui s’offrent dans notre pays au milieu associatif. Cependant, je me demande si celui-ci les connaît bien, ces possibilités.
La proposition de loi portant sur l’engagement et la reconnaissance du bénévolat associatif, dont, si j’ai bien compris, l’examen est repoussé à plus tard, vise à apporter un encouragement, mais sans recourir à des incitations sous forme d’avantages financiers.
Un grand Français a dit qu’on ne pouvait être à la fois responsable et désespéré. Votre réponse m’a fait comprendre, je vous le dis très sincèrement, que c’est bien ainsi que vous concevez votre rôle de ministre. Même dans les périodes difficiles comme celle que nous traversons, vous ne m’entendrez jamais critiquer ; je ne le fais pas plus aujourd'hui que je ne l’ai fait hier. Je sais en effet que, dans la vie, il y a le vouloir et le pouvoir.
Ma question ne visait donc nullement à vous adresser une critique ; d’ailleurs, vous ne l’avez d'ailleurs pas prise ainsi. Elle était avant tout destinée à vous faire part d’une prévision. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai que gouverner, c’est prévoir, et que prévoir, c’est regarder un peu l’existant.
Moi qui suis un ancien responsable sportif, je n’ai pas choisi un homme politique pour me remettre la Légion d’honneur, mais un très grand sportif français. C’est très significatif de mon engagement en faveur du sport et de la vie associative.
Madame le ministre, je vous remercie de votre réponse.

La parole est à M. Dominique Bailly, auteur de la question n° 429, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

J’ai souhaité interroger ce matin M. le ministre de l’économie et des finances sur la redistribution du produit de la taxe à 75 % sur les salaires de plus d’un million d’euros versés par les clubs sportifs professionnels. M. le Premier ministre a en effet confirmé, dans un communiqué officiel en date du 2 avril 2013, que cette taxe concernerait toutes les entreprises qui versent de tels salaires. Elle touchera donc les sociétés à objet sportif, et, au premier chef, les clubs de football de Ligue 1.
La réalité économique de nombreux clubs professionnels, toutes disciplines confondues, est bien éloignée de celle que vivent les clubs qui seront touchés par la taxe. Les salaires y sont bien moins élevés, et nombre d’exemples soulignent la fragilité financière de structures, même professionnelles, qui ont subi une descente sportive ou une faillite. La réalité vécue par le monde sportif amateur est tout aussi difficile.
La solidarité entre les clubs les mieux dotés et le reste du monde sportif, professionnel et amateur, doit donc être renforcée pour garantir la pérennité de l’ensemble. Selon la Cour des comptes, « les flux financiers nets entre les fédérations » – le monde amateur – « et leurs ligues » – le monde professionnel –, « traduisant l’application concrète de la solidarité entre le sport professionnel et amateur, se révèlent modérément favorables à la fédération dans le cas du football, et même favorables à la ligue dans le cas du rugby ».
C'est pourquoi, sans rien retirer à l’universalité de cette taxe dite exceptionnelle, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de reverser, sous certaines conditions, une partie de son produit au mouvement sportif, et notamment au mouvement sportif amateur.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d’excuser l’absence de Pierre Moscovici, qui est retenu à Bruxelles par un conseil Écofin.
Vous souhaitez savoir si le Gouvernement envisage de reverser au mouvement sportif tout ou partie du produit de la taxe exceptionnelle à 75 % sur les salaires de plus d’un million d’euros versés par les clubs sportifs professionnels, et en premier lieu par les clubs de football.
Comme vous le soulignez très justement, la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur doit être renforcée ; c’est d’ailleurs l’un des axes majeurs de la politique menée par ma collègue Valérie Fourneyron. Toutefois, le Gouvernement n’estime pas que le renforcement de cette solidarité doive passer par le reversement direct au mouvement sportif du produit de la taxe exceptionnelle sur les salaires de plus d’un million d’euros.
Cette taxe exceptionnelle vise à contribuer à l’effort de redressement de nos comptes publics, mais elle procède aussi et surtout d’un souci de justice sociale et de renforcement de la solidarité nationale. Le versement de son produit au budget général témoigne de sa vocation universelle : il ne s’agit pas de renforcer la solidarité entre les acteurs d’un secteur économique particulier, tel que le sport, mais de renforcer la solidarité au sein de la Nation tout entière.
Par ailleurs, ainsi vous l’avez vous-même rappelé, le principe d’universalité budgétaire fait obstacle à l’utilisation d’une recette déterminée pour le financement d’une dépense déterminée. Il existe, certes, des possibilités de déroger à cette règle dans des cas très particuliers, mais, en l’occurrence, cela ne me semble pas opportun. Une telle dérogation serait même contraire à l’esprit de la circulaire du Premier ministre en date du 14 janvier 2013 relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques. Le Gouvernement a d'ailleurs demandé au Conseil des prélèvements obligatoires d’examiner systématiquement les taxes affectées existantes, dans le but de remettre en cause certaines de ces affectations.
Pour autant, le renforcement de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur constitue l’un des axes majeurs de la politique nationale des sports menée par le Gouvernement. Beaucoup a déjà été fait en la matière. Beaucoup reste également à faire, mais ce renforcement passe par d’autres moyens que celui que vous proposez.
Nous avons stabilisé les ressources du Centre national pour le développement du sport, le CNDS. Celui-ci est, comme vous le savez, notre principal outil de développement du sport pour tous et notre principal instrument de redistribution entre le sport professionnel et le sport amateur, puisque ses recettes sont notamment constituées par la taxe dite « Buffet », qui est une contribution sur les droits de diffusion audiovisuelle des compétitions sportives, que perçoivent au premier chef les clubs professionnels.
Nous avons constaté, au début de cette législature, que le CNDS se trouvait dans une situation financière profondément dégradée. Nous avons donc mis en place un plan de redressement financier de l’établissement, qui garantit à ce dernier la stabilité de ses ressources, alors que, au même moment, il était demandé d’importants efforts à tous les opérateurs de l’État bénéficiant de ressources fiscales affectées : les plafonds des taxes qui leur sont attribuées ont diminué de 10 %.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, votre souci d’une plus grande solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur est entièrement partagé par le Gouvernement. Cependant, cette solidarité doit passer par d’autres voies que l’affectation au mouvement sportif d’une recette fiscale dont l’essence même est de participer au financement de la solidarité nationale.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. J’ai moi-même évoqué l’universalité de la taxe à 75 % : je comprends donc votre raisonnement.
Je souhaitais attirer l’attention du Gouvernement sur la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Vous l’avez d'ailleurs évoquée.
Le groupe de travail sur l’éthique du sport, que j’anime, a rendu ses conclusions. L’une des priorités est que la relation entre le monde professionnel et le monde amateur soit amplifiée et dynamisée. Je sais que Mme la ministre des sports, que je salue, y est sensible – je la remercie d’ailleurs d’être restée dans l’hémicycle pour entendre ma question.
S'agissant de la taxe exceptionnelle de 75 %, on aurait pu, par dérogation – vous avez souligné que d’autres dérogations existaient déjà –, reverser une partie de son produit au monde amateur. En politique, il y a aussi des symboles, et cela en aurait constitué un puissant.
J’ai entendu votre réponse. Avec Mme la ministre des sports, nous attendrons le futur projet de loi de programmation, qui sera vraisemblablement présenté à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Je suis convaincu que la solidarité ente le monde professionnel et le monde amateur sera un maillon fort du nouveau dispositif législatif.

La parole est à M. Ronan Kerdraon, auteur de la question n° 451, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Ma question porte sur la présence douanière en Côtes-d’Armor.
Depuis près d’une vingtaine d’années, l’administration des douanes subit de multiples réformes. Du fait des baisses constantes d’effectifs et des coupes budgétaires, les douaniers ne sont plus en mesure d’exercer correctement les missions qui leur sont confiées.
Je veux rappeler que les douaniers s’acquittent du contrôle physique des marchandises, de la recherche de contrefaçons – de médicaments, de jouets, avec des implications en matière de sécurité, de produits de marque, etc. –, de la protection des enfants ou encore du contrôle de la fiscalité. Cette administration comptait 19 500 agents en 2005 ; il n’en reste plus aujourd’hui que 17 500. Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, l’administration douanière va être confrontée à un taux de 2, 5 % de suppressions d’effectifs – un taux jamais égalé à ce jour –, ce qui représente plus de 400 suppressions d’emplois par an.
Une telle politique de diminution des moyens humains est préjudiciable au budget même de la Nation, à celui des collectivités territoriales et à celui des organismes de sécurité sociale. Par exemple, dans mon département des Côtes-d’Armor, on comptait il y a encore quelques années 72 agents des douanes. Actuellement, nous disposons de 14 agents de bureau et de 19 agents de brigade ; nous avons donc perdu 39 postes. Or la suppression de 8 postes supplémentaires est prévue dans le cadre du « Plan stratégique douane 2014-2018 ».
Toutes ces réductions d’emplois ont des effets négatifs sur les agents et leurs familles, pénalisent fortement l’action même du service public et pèsent sur l’emploi local par le biais des emplois induits. Pourtant, la présence douanière est essentielle, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la contrefaçon. Le service des douanes assure de nombreuses missions au service des particuliers comme auprès des entreprises locales.
À l’heure où se précisent plusieurs projets d’envergure, comme l’installation d’un parc éolien en baie de Saint-Brieuc ou le développement du port du Légué, nous pouvons légitimement craindre que la disparition d’un service de douane local soit également de nature à porter préjudice à l’attractivité économique de notre département. La réduction des effectifs associée à la centralisation des services douaniers des Côtes-d’Armor affecte également les missions de sécurité et d’intervention sur l’ensemble du département.
À ce jour, le dialogue social entre les organisations syndicales et la Direction générale des douanes et droits indirects, la DGDDI, est chaotique. Il me paraît donc nécessaire de renouer le dialogue afin d’instaurer un débat serein sur l’avenir de cette administration.
Les douaniers costarmoricains se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser les intentions du Gouvernement pour que soit gérée avec sérénité la réorganisation nécessaire du service des douanes et confortée sa place dans la société actuelle ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d’excuser l’absence de Pierre Moscovici, retenu à Bruxelles.
Comme vous, le Gouvernement mesure et déplore les conséquences de la manière dont a été conduite la révision générale des politiques publiques sur la capacité de nombreuses administrations à assurer leurs missions et sur les conditions de travail des agents publics. Cette approche brutale, non concertée et reposant sur des critères arbitraires, est désormais abandonnée. La modernisation de l’action publique engagée depuis 2012 par le Gouvernement repose en effet sur une méthode renouvelée. De manière cohérente, les arbitrages budgétaires sont différenciés en fonction des priorités, de la réalité des missions et des gains de productivité possibles, avec pour préoccupation permanente le redressement budgétaire de la France.
Comme l’ensemble des directions du ministère de l’économie et des finances, la DGDDI continuera donc à participer à l’effort de réduction des déficits publics tout en poursuivant l’adaptation de ses méthodes de travail afin que les missions qui lui sont confiées soient menées à bien dans un souci constant d’efficacité, et en portant une attention particulière à ses agents. Parallèlement, la DGDDI bénéficie d’une dotation complémentaire de 350 emplois en 2013 et 2014 au titre de la taxe poids lourds, qui constitue une mission nouvelle pour elle. En 2013, la baisse nette des effectifs est ainsi limitée à 60 agents sur un total de 17 000, ce qui représente une diminution de 0, 4 %.
Par ailleurs, dès la fin de l’année 2012, Pierre Moscovici, Nicole Bricq et Bernard Cazeneuve ont demandé à l’administration des douanes d’élaborer un projet stratégique afin de tracer une trajectoire d’évolution de ses missions et de son organisation à l’horizon 2018.
Menée sur la base d’une très large concertation, cette réflexion associe, sans exclusive, toutes les parties concernées, à l’échelon national comme au niveau local. Les agents de terrain ont ainsi été consultés afin, notamment, d’optimiser les pratiques professionnelles, de réfléchir aux évolutions des différents métiers et de recueillir les propositions sur les besoins qui en découleront.
Enfin, dans un souci constant de ce dialogue avec les partenaires sociaux que vous appelez de vos vœux, les organisations syndicales ont naturellement été invitées à participer à cette réflexion ; toutefois, au cours de ces derniers mois, elles n’ont pas souhaité répondre à cette invitation.
Le Gouvernement, monsieur le sénateur, mesure les inquiétudes qui s’expriment parmi les douaniers, et nous souhaitons y répondre, dans la clarté et en toute franchise.
Pour le département des Côtes-d’Armor qui compte, à Saint-Brieuc, un bureau fiscal et une brigade de surveillance, le directeur interrégional de Nantes réfléchit à la répartition de ses moyens pour 2014 et les années suivantes. Ce travail prospectif n’est pas achevé, une première restitution étant attendue à l’automne prochain. Aucune proposition d’évolution ou, a fortiori, de restructuration n’a pour l’instant été soumise au ministre de l’économie et des finances. En toute hypothèse, une concertation locale approfondie devra être conduite avant toute décision.
Pour conclure, monsieur le sénateur, je vous remercie d’avoir posé cette question, qui nous donne l’occasion d’affirmer la nécessité de ne pas affaiblir les missions douanières de lutte contre la fraude, de protection des citoyens et d’accompagnement des entreprises à l’international, qui sont au cœur des préoccupations du Gouvernement, comme vous l’avez souligné dans votre intervention.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui s’inscrit dans le cadre de la philosophie du Gouvernement. Bien entendu, du côté gauche de l’hémicycle, nous avons la même ambition de faire en sorte que les douanes s’adaptent à l’environnement dans lequel elles évoluent. Nous partageons également le constat que vous avez dressé tout à l’heure sur les réformes antérieures, car, aujourd’hui, on est « à l’os » !
Par ailleurs, je me réjouis de votre volonté de réfléchir aux évolutions possibles dans le dialogue et la concertation. Cette ambition est certes nationale, mais, je vous l’assure, il faut aussi l’envisager sur le plan local, ainsi que vous l’avez souligné.
Pour conclure, madame la ministre, je voudrais procéder à une petite rectification concernant une information que vous avez donnée sur les douanes en Côtes-d’Armor et leur présence à Saint-Brieuc. Elles se trouvent en réalité sur la commune de Plérin, dont je suis maire. §

Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme la ministre chargée des Français de l’étranger, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 438, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger.

Madame la ministre, ma question porte sur un sujet que vous connaissez bien : la fermeture des classes de la seconde à la terminale du lycée Sadi Carnot de Diego-Suarez.
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, s’est engagée depuis deux ans dans un projet de restructuration du réseau de ses établissements dans la grande île. Ce réseau se caractérisait par un ensemble de petits, moyens et gros établissements maillant efficacement le territoire malgache et répondant à la relative dispersion de la population française. Je le sais pour avoir été moi-même un élève de ce système d’enseignement pendant de nombreuses années.
La grave crise économique et politique touchant Madagascar depuis plusieurs années – et la situation ne semble pas s’améliorer ! – a progressivement amoindri les moyens de nombreuses familles malgaches et franco-malgaches dont les enfants fréquentaient ces établissements. Cela a conduit à la diminution progressive des effectifs de la plupart des établissements, sauf à Tananarive.
Parallèlement, l’AEFE met en place depuis quelques années une politique de reconcentration des moyens et de rationalisation des coûts, l’incitant à ne plus accompagner les petits et moyens établissements.
Ainsi, deux sections de lycée auront été fermées en trois ans, l’une à Fianarantsoa, l’autre à Diego-Suarez. Parallèlement, le lycée de Tananarive bénéficie d’investissements importants avec la construction de nouveaux bâtiments, pour l’internat aussi bien que pour l’enseignement, dont les coûts sont jugés importants.
Ces choix ne font évidemment pas l’unanimité parmi la communauté éducative et les parents d’élèves, en particulier ceux qui résident à Diego-Suarez, car ils s’inquiètent de devoir envoyer leurs enfants adolescents au lycée de Tananarive, à 1 200 kilomètres.
Madame la ministre, quelles mesures sont proposées aux familles pour accompagner ces élèves lors de la prochaine année scolaire ? Quels sont les projets pour les futures évolutions du réseau des établissements de l’AEFE à Madagascar ? En outre, comment les élus, les parents et les enseignants peuvent-ils être mieux associés aux décisions qui touchent à l’avenir de leurs enfants ?
Monsieur le sénateur, votre attachement pour Madagascar n’a d’égal que le mien pour notre réseau d’enseignement français à l’étranger.
Nous avons effectivement décidé de réorganiser notre offre pédagogique sur l’île et, face à la diminution des effectifs, de concentrer nos moyens et renforcer les capacités d’accueil des lycées de Tananarive et de Tamatave par le développement d’espaces pédagogiques et l’ouverture d’internats de grande qualité.
Les fermetures auxquelles vous avez fait référence ne se sont pas faites sans une information préalable et très large. Ainsi, de multiples rencontres avec les associations de parents d’élèves, les organisations syndicales et les conseillers élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ont été organisées depuis 2007.
S’agissant de l’établissement d’Antsiranana, la fermeture du cycle lycée pour la rentrée 2013 a été annoncée en conseil d’établissement en mai 2011 et confirmée à la rentrée 2012.
Parmi les lycéens concernés par cette fermeture, 38 souhaitent poursuivre leur scolarité en France mais la majorité – 60 élèves – souhaite aller au lycée de Tananarive et 11 au lycée de Tamatave.
Bien évidemment, des mesures d’accompagnement ont été décidées : les élèves français pourront bénéficier des bourses sur critères sociaux, les élèves malgaches seront exonérés des droits de première inscription. L’État prendra à sa charge la différence du coût de la scolarité entre Tananarive et Diego-Suarez, ainsi que les frais d’internat, à hauteur de 50 % au maximum et sur critères sociaux. Nous avons également mis en place un forfait annuel de transport de 500 euros qui permettra de financer deux allers-retours Diego-Suarez-Tananarive en avion.
Pour les élèves malgaches ne pouvant se rendre à Tananarive, l’AEFE a obtenu l’autorisation de mettre en place un enseignement par le Centre national d’enseignement à distance, au tarif réglementé.
Aucune autre modification du réseau malgache n’est envisagée, monsieur le sénateur. Notre seule préoccupation est d’assurer pour l’avenir, et pour longtemps, un enseignement de qualité sur l’île.

Madame la ministre, je tiens à vous remercier de ces éclaircissements sur le dispositif mis en place autour de la ville de Diego-Suarez, appelée aussi Antsiranana. Il devrait rassurer une bonne partie des parents d’élèves.
Je note par ailleurs avec plaisir qu’aucune autre modification significative du réseau à Madagascar n’est envisagée pour les prochaines années.
À mon sens, le développement des internats est tout à fait positif. Celui de Tananarive a été très sensiblement étendu et amélioré, avec la construction d’un nouveau bâtiment. Au cours des prochains mois, nous aurons à nous pencher sur la situation de l’internat de Tamatave, qui mérite encore d’être confortée, ainsi que sur le projet d’internat du lycée de Majunga. Nous devons encourager cette politique, qui permet de répondre aux besoins des différentes régions.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 464, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la ministre, selon le ministère de l’intérieur, l’usurpation des plaques d’immatriculation de véhicules est en augmentation : près de 17 500 délits de cette nature auraient été recensés en 2012, soit une hausse assez affolante, de l’ordre de 73 % en un an.
Quels que soient les motifs de ces actes – échapper aux contrôles automatiques des radars, aux péages, aux stationnements payants ou, plus grave encore, à l’obligation d’assurance –, certains individus décident de se faire graver des plaques au numéro d’un autre automobiliste. C’est alors celui-ci qui reçoit les amendes, se voit retirer des points sur son permis et, éventuellement, subit les saisies.
Et en cas de « doublette parfaite » – c'est-à-dire si le numéro minéralogique de l’automobiliste concerné a été apposé sur une voiture de même modèle que la sienne –, les conséquences financières et administratives sont particulièrement lourdes : non seulement la victime de l’usurpation devra prouver sa bonne foi par des témoignages et des attestations de présence, mais elle devra attendre que justice lui soit rendue.
Ainsi, un automobiliste de mon département, le Val-de-Marne, a dû subir deux ans de procédures pour faire classer sans suite quarante-neuf procès-verbaux, éviter 2 000 euros d’amende et empêcher le trésor public de saisir ses comptes, alors que l’individu qui avait usurpé sa plaque d’immatriculation avait été interpellé. Ce cas, loin d’être isolé, illustre le vide juridique qui entoure les usurpations d’identité.
Alors que l’article R. 317-8 du code de la route indique que tous les véhicules à moteur doivent être équipés de plaques et que l’arrêté du 9 février 2009 précise les caractéristiques et les modalités de pose de ces plaques, je ne comprends pas pourquoi aucun texte n’encadre leur fabrication. Non seulement l’acheteur n’est obligé de fournir ni certificat d’immatriculation ni titre d’identité, mais le distributeur n’est soumis à aucun contrôle. Ainsi, de nombreux sites internet et même quelques professionnels ayant pignon sur rue n’exigent pas le moindre justificatif.
Comment expliquer l’absence d’encadrement et de contrôle de cette source de délinquance routière, parfois même revendiquée comme telle sur des forums internet ? Le Gouvernement envisage-t-il de faire évoluer la législation ou d’instaurer un agrément pour les distributeurs, qui seraient dès lors tenus de contrôler l’existence d’un certificat d’immatriculation et de tenir un registre des gravures ?
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Manuel Valls, qui m’a chargé de vous transmettre sa réponse concernant le phénomène d’usurpation des plaques d’immatriculation.
D’emblée, je précise que le cas bien particulier de l’usurpation du numéro d’immatriculation, pour lequel une procédure spécifique existe, a parfois été confondu avec le problème, aujourd’hui résolu, des verbalisations indues après la vente d’un véhicule.
Ensuite, je rappelle que le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule, qui constitue une usurpation, est un délit sévèrement sanctionné. Conformément à l’article L. 317-4-1 du code de la route, ce délit est passible de sept ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Indépendamment des poursuites pénales lancées à l’encontre des contrevenants, une procédure de changement d’immatriculation existe afin de répondre à ce type de difficultés.
Les victimes peuvent ainsi se rendre en préfecture pour demander à bénéficier d’un nouveau numéro d’immatriculation, sur présentation du dépôt de plainte effectué auprès des forces de l’ordre. Un nouveau numéro est alors attribué, sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l’ancien numéro ne sont plus reprochées aux personnes dont l’immatriculation a été usurpée. Cette procédure protège les victimes d’usurpation de leur numéro d’immatriculation de toute verbalisation indue. Elle est du reste bien utilisée par nos concitoyens, comme en témoignent les 11 060 opérations de réimmatriculation faisant suite à usurpation enregistrées en 2012 dans le système d’immatriculation des véhicules.
En outre, pour contester les amendes déjà reçues, la victime d’usurpation peut déposer une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quarante-cinq jours et en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l’amende et aucune consignation ne sont nécessaires dans ce cas.
Une autre mesure protectrice a été mise en œuvre avec la saisie du champ « marque du véhicule », désormais effectuée lors de la constatation des infractions de stationnement relevées par procès-verbal électronique. Cette mesure permet de détecter une incohérence avec le champ « marque » retourné par le système d’immatriculation des véhicules et ainsi d’éviter l’envoi d’un avis de contravention au titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule d’une autre marque dont le numéro d’immatriculation aurait été usurpé.
Pour ce qui concerne les problèmes de verbalisation indue faisant suite à la vente d’un véhicule, une difficulté s’est fait jour en 2011 : notre droit considérait que le titulaire du certificat d’immatriculation était le responsable du véhicule. De ce fait, lorsqu’une infraction était commise par un nouvel acquéreur avant qu’il n’ait procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom, l’ancien propriétaire pouvait être injustement sanctionné.
La loi n° 2011-1562 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, publiée le 14 décembre 2011, a remédié à ce problème en modifiant les articles L.121-2 et L. 121-3 du code de la route. Le vendeur du véhicule n’est plus destinataire des contraventions dressées postérieurement à la cession du véhicule, quand bien même le nouvel acquéreur n’aurait pas encore procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom.
Les mesures ainsi prises doivent permettre de répondre aux difficultés causées aux automobilistes. Si ce sujet continue à faire l’objet d’un suivi vigilant, il ne paraît pas nécessaire à ce jour d’introduire une réglementation nouvelle concernant l’activité économique de vendeur de plaques d’immatriculation, ce qui aurait notamment pour effet d’alourdir la charge de travail des préfectures.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse très complète, qui sera utile aux victimes. En effet, la possibilité d’obtenir une réimmatriculation doit être mieux connue.
Cela étant, s’il est bon de s’attacher à résoudre les problèmes des victimes, je note que le Gouvernement ne s’attaque nullement à la fraude. Or, en l’espèce, n’importe qui peut se procurer une plaque d’immatriculation sans conditions particulières. Moi-même, il y a quelques années, j’ai fait fabriquer une plaque d’immatriculation portant la date de naissance d’un ami en guise de cadeau d’anniversaire : on ne m’a pas demandé le moindre justificatif ! C’est cette situation qui pose problème.
Aujourd’hui, selon vous, les victimes seraient protégées. Je doute cependant que le trésor public renonce si facilement à envoyer des rappels tant que la procédure est en cours : j’ai cité le cas de personnes qui ont subi de graves désagréments. Si le dispositif que vous avez mentionné et qui, du reste, ne date que de 2011, offre un peu plus d’efficacité, aucune réglementation n’encadre la délivrance des plaques, et je persiste à ne pas comprendre pourquoi. Vous dites que cela constituerait une charge de travail supplémentaire pour les préfectures. Or, avec le nouveau système d’immatriculation, où le numéro du département ne figure plus qu’à titre indicatif, je ne vois pas en quoi les préfectures seraient concernées.
Je le répète, les mesures que vous avez citées sont très positives, et il faudra développer l’information en la matière. Toutefois, je regrette que les revendeurs de plaques d’immatriculation – pour qui, au demeurant, cette vente ne représente qu’une part marginale de leur chiffre d’affaires – ne fassent pas l’objet du moindre contrôle, notamment lorsque la vente se fait sur internet.

La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 467, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir pris la peine de venir au Sénat remplacer M. le ministre de l’intérieur, dont je regrette qu’il ne puisse être présent pour répondre personnellement à ma question, car celle-ci fait suite à une conversation que nous avions eue précédemment. Je comprends cependant qu’il soit occupé.
Madame la ministre, les faits sont aujourd’hui un peu anciens, mais le principe qui semble les sous-tendre est toujours d’actualité, et c’est ce qui m’a conduit à interroger M. Valls sur ce que j’appelle le « deux poids, deux mesures » en matière de sécurité. Ce phénomène commence à créer un réel malaise dans notre pays !
Rappelons quelques faits. En décembre 2012, les pickpockets étant toujours plus nombreux – une armée ! – et toujours plus agressifs au Louvre, la direction du musée avait déposé plainte auprès du parquet de Paris. Elle avait également demandé des renforts policiers.
Au 10 avril 2013, aucune mesure sérieuse n’ayant été mise en place pour remédier à ces agissements qui portent préjudice aux visiteurs – des étrangers pour la plupart, ce qui donne à penser que les actes en question ternissent en outre gravement la réputation de notre pays –, deux cents agents du musée ont fini par exercer leur droit de retrait ; en d’autres termes, ils se sont mis en grève.
Quelques semaines plutôt, le 20 mars 2013, l’agression d’un groupe de touristes chinois rançonnés devant un restaurant au Bourget avait fait réagir Pékin : cela confirme le caractère grave de ces agissements et l’image déplorable qu’ils donnent de notre pays.
Cette grève des agents du Louvre a eu lieu après la « manif pour tous » du 24 mars 2013, au cours de laquelle des jets de gaz lacrymogène furent dirigés contre des familles défilant pacifiquement. J’y étais, cela s’est passé derrière moi !
Donc, quand le ministre de l’intérieur en a eu besoin, il a su trouver des forces de l’ordre pour faire taire les opposants au mariage pour tous, alors même que ce n’était pas leur rôle : c’est au maintien de l’ordre républicain, et non de l’ordre socialiste, qu’elles doivent être employées.
En évoquant ce dévoiement préoccupant, qui inquiète les Français, je ne peux m’empêcher de penser à ce jeune opposant au mariage pour tous qui a été interpellé et incarcéré à Fleury-Mérogis. Son cas étant examiné aujourd’hui par la cour d’appel de Paris, je n’en dirai pas plus.
Le 13 mai, au Trocadéro, la police, insuffisante en nombre, n’a pu empêcher qu’éclatent de violents affrontements entre supporteurs de clubs de football et que le quartier soit mis à sac. Depuis, elle a remonté les pistes de jeunes casseurs connus de ses services et procédé à des arrestations. Trop tard ! Les violences avaient eu lieu, provoquant des dégâts estimés à un million d’euros.
Ma question est double. Comment les forces de police sont-elles utilisées ? Quelles mesures le ministre entend-il prendre pour que les situations, en matière de sécurité, soient mieux appréhendées, c’est-à-dire avec bon sens et sans esprit partisan ?
Monsieur le sénateur, ma réponse ne sera pas partisane : ce sera simplement celle du ministre de l’intérieur, qui vous prie d’excuser son absence ce matin.
La lutte contre la délinquance, en particulier contre les pickpockets aux abords du Louvre, constitue l’une des priorités des effectifs de la préfecture de police.
Autour du secteur touristique Louvre–Palais-Royal, plus de 10 000 personnes ont fait l’objet d’un contrôle depuis juin 2012 et plus de 2 000 individus ont été interpellés pour vol simple, vol à l’étalage, vente à la sauvette ou escroquerie à la suite des 140 opérations réalisées. Depuis le début de l’année 2013, ces contrôles, réalisés sur la base de réquisitions du procureur de la République, ont été maintenus et récemment renforcés dans le cadre du plan mis en place depuis le 7 juin pour accroître la sécurité des zones touristiques.
La présence policière aux abords des principaux sites parisiens a fait l’objet d’un renforcement depuis le mois d’avril dernier. Ainsi, chaque jour, plus de deux cents policiers sont mobilisés dans toute la capitale et dans les réseaux de transport pour lutter notamment contre les faits de délinquance commis à l’encontre des touristes.
Au-delà du renforcement de la présence policière, une série de mesures de nature à renforcer la sécurité des touristes fréquentant la capitale a été présentée par le préfet de police. Ce plan, fondé sur vingt-six mesures, a été défini en partenariat avec la Ville de Paris, les professionnels du tourisme, dont l’office du tourisme et des congrès de Paris et les responsables des sites touristiques, les hôteliers, les transporteurs ainsi que différents ministères. Il s’articule autour de quatre axes.
Premièrement, il vise au renforcement de la présence policière sur les sites touristiques les plus visités et les hôtels qui accueillent des touristes étrangers.
Deuxièmement, il prévoit la mise en place d’un partenariat actif avec les ambassades, les gestionnaires des activités liées au tourisme, les hôteliers de Paris et de la périphérie, ainsi que la RATP et la SNCF, pour identifier ensemble les secteurs d’action prioritaires, organiser les dispositifs de sécurité appropriés, veiller à une meilleure information et à une sensibilisation plus grande des étrangers concernant les bonnes pratiques en matière de sécurité.
Troisièmement, ce plan comprend l’amélioration de l’accueil des victimes étrangères, en facilitant le dépôt de plainte dans sa langue d’origine, l’accès aux services de police à proximité des sites touristiques et la prise de contact avec des interprètes.
Quatrièmement, enfin, il tend à une meilleure diffusion de l’information sur la sécurité à travers une nouvelle édition d’un guide pratique, Paris en toute sécurité, qui sera traduit en six langues.
Ces actions ont d’ores et déjà permis d’enregistrer des résultats significatifs. Le nombre de violences volontaires dans les secteurs touristiques a diminué de 12 % par rapport au mois d’avril 2012 et le nombre de plaintes pour vol dans l’enceinte du musée du Louvre est passé de cent vingt, en moyenne, par mois à une trentaine en mai, soit une baisse de 75 %. La direction de l’établissement a d’ailleurs exprimé publiquement sa satisfaction et salué le travail accompli par les services de police à l’occasion d’une visite sur site du préfet de police, le 6 juin dernier.
Les résultats obtenus démontrent, pour répondre directement à votre question, que les forces de police sont déployées comme il le faut, là où il le faut, dans le souci constant d’assurer à nos concitoyens comme à tous ceux qui visitent la capitale un cadre de vie sûr et respectueux des droits de chacun.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse, mais je tiens à vous raconter une anecdote : sortant un jour de l’Assemblée nationale, je me suis rendu à la Madeleine à pied, en traversant donc la place de la Concorde. Sur tout le trajet, je n’ai pas vu un seul policier et le touriste originaire d’Extrême-Orient qui marchait devant moi aurait très bien pu se faire dévaliser sans que son voleur soit autrement inquiété ! Vous me parlez de deux cents policiers, mais je ne les ai pas vus ! De toute façon, ce nombre est insuffisant !
Comment voulez-vous qu’aujourd’hui, avec deux cents policiers, on protège tous ceux qui visitent la capitale, les étrangers et les provinciaux, qui sont aussi des cibles, car les uns et les autres ne sont pas toujours vigilants, laissant leur portefeuille dans la poche arrière de leur pantalon ou leur sac ouvert ?
Dans votre réponse, j’ai été intéressé par l’idée de protéger certaines sorties d’hôtel. Car ces délinquants commencent à s’attaquer aux touristes devant leur hôtel, pendant qu’ils attendent leur autocar ou un taxi !
Je voudrais également saluer la sortie du guide pratique à destination des visiteurs. C’est une très bonne chose : on peut le distribuer aux touristes dès leur arrivée, en prenant garde toutefois à ne pas leur faire peur !
Madame la ministre, vous affirmez que la police est bien utilisée. Mais voici un article d’un journal du soir dans lequel un syndicat de CRS dit tout le contraire ! §Dans cet article, plutôt bien fait, les CRS avouent avoir honte de la manière dont ils sont employés.
Je vais même parler pour les gendarmes, qui n’ont pas de syndicats et qui n’ont pas le droit de s’exprimer. Je suis officier de gendarmerie : je connais donc un peu ces questions. J’étais à une manifestation durant laquelle les gendarmes qui étaient devant moi m’ont confié leur honte quant à l’utilisation que l’on fait d’eux dans les manifestations contre le mariage pour tous.
Moi, j’étais derrière la banderole des élus. C’était d’un calme absolu, il y avait des femmes et des enfants, beaucoup de petits enfants – je n’aurais d’ailleurs pas emmené manifester de si jeunes enfants ! –, mais le déploiement de police était absolument incroyable, madame la ministre, je vous l’assure. J’ai rarement vu cela pour une manifestation !

Je sais bien, madame la ministre, que ce n’est pas facile pour vous, mais quand on voit, juste après, les évènements du Trocadéro… Moi, qui ne suis rien, qui ne dispose pas d’un service de renseignement, mais je savais qu’il allait y avoir des incidents ! Il suffit d’écouter et de regarder autour de soi : les voyous échangent des messages sur Twitter. Ils avaient effectivement prévu de tout casser ! J’ai même vu des policiers s’écarter pour laisser passer des voyous qui s’en prenaient aux vitres d’un café !
Alors, madame la ministre, je vous demande de transmettre à M. Valls qu’il lui faut bien mesurer l’utilisation des forces de police afin de ne pas prêter le flanc à de telles critiques dans la presse. Je ne suis pas intéressé par les polémiques, je suis fier de mon pays et je voudrais que les touristes y soient bien accueillis !

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente.