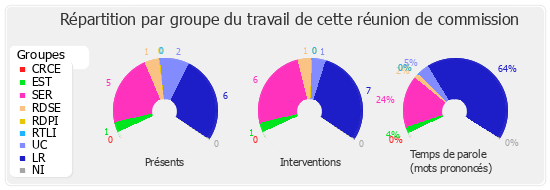Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 15 février 2023 à 10h00
Sommaire
- Défis posés par la raréfaction de la ressource en eau
- Audition de mm. frédéric veau préfet délégué interministériel en charge du suivi du varenne agricole de l'eau » et de l'adaptation au changement climatique ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire maximilien pellegrini président de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau fp2e vazken andréassian directeur de l'unité hydrosystèmes continentaux anthropisés inrae et bruno de chergé directeur relations institutionnelles régulations et coordination de l'eau edf hydro (voir le dossier)
- Bilan de la 15e conférence des nations unies sur la biodiversité cop15 et accord de kunming-montréal
- Proposition de nomination de m. marc papinutti candidat proposé par le président de la république aux fonctions de président de l'autorité de régulation des transports
La réunion
Défis posés par la raréfaction de la ressource en eau
Audition de Mm. Frédéric Veau préfet délégué interministériel en charge du suivi du varenne agricole de l'eau » et de l'adaptation au changement climatique ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire maximilien pellegrini président de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau fp2e vazken andréassian directeur de l'unité hydrosystèmes continentaux anthropisés inrae et bruno de chergé directeur relations institutionnelles régulations et coordination de l'eau edf hydro

Mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour clore notre cycle d'auditions sur la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, après plusieurs tables rondes consacrées aux multiples défis et enjeux qui pèsent sur la gestion durable et équitable d'une ressource dont nous savons désormais qu'elle se raréfiera inexorablement dans les années et les décennies à venir.
Au terme des quatre auditions plénières consacrées à la ressource en eau, je formule le voeu que les échanges aient permis à chacun d'entre vous d'être « comme un poisson dans l'eau » quand il s'agit d'envisager les enjeux hydriques. Notre cycle au long cours engagé toutes ces semaines a démontré qu'il n'était pas exagéré de considérer l'eau, dans tous ses aspects, comme l'un des défis du XXIe siècle.
La sécheresse inédite de l'été dernier a mis en évidence les fragilités hydriques des territoires et le manque de robustesse de certains réseaux de distribution d'eau. Cette crise a heureusement pu être surmontée grâce à l'implication des acteurs de l'eau, de l'État et des élus locaux, mais nous devons y voir un indicateur de la fin de l'abondance aquatique dans notre pays. La raréfaction de la ressource en eau ouvre une nouvelle ère qui nous impose de changer de paradigme pour la gestion de l'eau.
Nous devons, sans plus attendre, préparer le futur hydrique de la France à l'aide de nouveaux instruments, réglementaires, administratifs et surtout financiers, et en simplifiant ce qui est inutilement complexe.
Les conflits d'usages ne sont plus l'apanage des pays aux climats désertiques ou semi-arides. Les sécheresses estivales récurrentes sont la preuve que l'eau peut devenir source de conflits, à travers les tensions hydriques entre différents usages aussi vitaux les uns que les autres : la souveraineté alimentaire, la résilience et l'autonomie de notre mix énergétique à travers la production d'hydroélectricité et le refroidissement des centrales nucléaires, le développement du fret fluvial, que la commission appelle de ses voeux pour favoriser le report vers des modes de transport moins intenses en carbone, ou le nécessaire maintien de la biodiversité aquatique et des trames bleues, pour ne citer que les usages les plus intuitifs de l'eau.
Face à cette crise révélatrice des fragilités hydriques de nos territoires, une prise de conscience commence à s'opérer. Les acteurs de l'eau, publics et privés, y ont vu une mise en garde, douloureuse mais salutaire, dans la mesure où elle contribue à faire figurer à l'agenda politique les enjeux de résilience hydrique au niveau national, mais également à l'échelle locale.
Après les assises de l'eau, le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique et la séquence de planification écologique consacrée à l'eau, les constats sont clairs : il n'est plus envisageable de continuer comme avant. La sobriété devient indispensable, la réutilisation des eaux usées traitées doit être encouragée et il faut organiser le partage de l'eau de façon claire et lisible. En somme, la politique de gestion de l'eau doit gagner en agilité et en adaptabilité.
Mais prise de conscience ne signifie pas connaissance : si nous entrevoyons les enjeux de la raréfaction de la ressource en eau, ils ne nous apparaissent pas encore « clairs comme de l'eau de roche ». La question mérite en effet d'être explorée sous l'angle des défis concrets et des incidences sur les pratiques et les usages.
D'ailleurs, la commission avait envisagé de lancer une mission d'information au « format flash » consacrée au petit cycle de l'eau, avec pour points d'attention l'état et la performance des réseaux ainsi que la qualité de traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel.
Entre-temps, le groupe socialiste, écologiste et républicain a souhaité exercer son droit de tirage sur ce thème central et demandé la création d'une mission d'information consacrée à la « gestion durable de l'eau : l'urgence d'agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement », qui sera présidée, ce dont je me félicite puisqu'il s'agit de membres de la commission, par notre collègue Rémy Pointereau et dont le rapporteur est Hervé Gillé, que je salue.
Il m'a donc paru opportun de laisser cette mission mener à bien ses travaux et d'attendre les conclusions et les recommandations qu'elle versera au débat public, afin de ne pas multiplier les instances travaillant sur des sujets similaires, conformément aux recommandations du groupe de travail sur la modernisation de nos méthodes de travail, présidé par notre collègue Pascale Gruny. À l'issue des travaux qui vont s'engager, il nous sera loisible, au besoin, d'approfondir le sujet si la mission commune d'information fait le choix de ne pas l'aborder.
Mais revenons à l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui. Pour aborder ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir :
- Frédéric Veau, délégué interministériel chargé du suivi des conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique ;
- Maximilien Pellegrini, président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) ;
- Vazken Andréassian, directeur de l'unité hydrosystèmes continentaux anthropisés (INRAE) ;
- et Bruno Chergé, directeur relations institutionnelles, régulations et coordination de l'eau (EDF Hydro).
J'invite chaque intervenant, au cours de son bref propos liminaire afin de laisser du temps aux échanges, à présenter les défis concrets que pose la raréfaction de la ressource hydrique au regard de sa position institutionnelle ou scientifique. Grâce à la diversité des intervenants, les angles d'approche concernent aussi bien les enjeux agricoles et de souveraineté alimentaire, que les questions que devront résoudre les gestionnaires du petit cycle de l'eau, les implications concrètes de la raréfaction et de la saisonnalité plus marquée de la ressource pour la production électrique, et enfin les défis tels qu'entrevus par un scientifique spécialiste de la modélisation mathématique du comportement des bassins versants, grâce à laquelle peuvent être produites des connaissances en matière de prévision des crues, d'étiages, d'évaluation des impacts du changement d'occupation des sols et du climat. C'est dire la richesse des points de vue.
Monsieur le président, je voudrais en préambule vous informer que je ne suis ni un spécialiste scientifique ni un technicien de l'eau. J'en suis tout au plus un praticien, puisque j'ai eu à gérer des épisodes de sécheresse aux conséquences très différentes, à Mayotte puis comme préfet de la Corrèze. Ma mission consiste en la mise en oeuvre du Varenne, qui est centré sur les enjeux de l'eau dans l'agriculture.
L'agriculture représente 9 % des 32 milliards de m3 de prélèvement, mais 45 % des m3 de consommation de l'eau, avant le secteur énergétique ou l'eau potable.
Je souhaiterais ici me référer à la synthèse réalisée par la délégation à la prospective du Sénat fin novembre, qui indique que la France hexagonale se trouve en bordure de zone d'aridification. La pluviométrie sera plus marquée par la saisonnalité. La moitié sud de la France connaîtra un climat plus sec et nous subirons une baisse sévère des débits et des étiages des cours d'eau, selon les études du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et l'étude Explore 2070, conduite il y a une dizaine d'années. Elle est en cours d'actualisation dans le cadre du Varenne sous le nom d'Explore2.
Pour l'agriculture, cela signifie concrètement qu'une moindre quantité d'eau est désormais disponible au moment où les cultures en ont le plus besoin, c'est-à-dire à la fin du printemps et au début de l'été. Il convient donc de faire évoluer notre gestion de l'eau.
Le Varenne se décline sous la forme de trois axes stratégiques et 24 mesures.
Le premier de ces trois axes concerne la protection de l'agriculture avec l'assurance récolte qui a été adoptée et qui est en cours de déploiement. Elle ne figure pas dans le périmètre de compétence de ma délégation.
Le deuxième volet du Varenne concerne l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Que faisons-nous à ce titre ? Toute une série de plans d'adaptation sontt conduits par les différentes filières agricoles, avec l'appui de FranceAgriMer pour déterminer la meilleure façon d'évoluer et de s'adapter au changement climatique.
Nous prolongeons ces travaux par une mission du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), qui portera sur les moyens de renforcer la résilience des productions agricoles.
Des expériences sont menées çà et là pour développer le miscanthus, le lin ou le chanvre. L'objectif de la mission est d'avoir une vision consolidée au plan national, à la fois agronomique et économique, sur les opportunités végétales les mieux adaptées au changement climatique.
Tout un travail est mené par les instituts techniques des filières, fédérées par l'Association de coordination technique agricole (ACTA) sur les leviers d'adaptation des exploitations.
Enfin, les chambres d'agriculture, fédérées par Chambres d'agriculture France, sont en train d'achever la mise au point d'un plan d'accompagnement des exploitations face au changement climatique. L'objectif est de décliner les mesures au niveau de l'exploitation elle-même, afin de l'accompagner dans les changements à opérer. Une présérie de 1 500 exploitations devrait être concernée, l'objectif étant d'atteindre un régime de croisière de 10 000 exploitations par an.
Le troisième axe du Varenne concerne l'accès raisonné à la ressource en eau. À la fin du mois de juillet, un décret a été pris pour déterminer la méthode concernant les volumes prélevables hors période de basses eaux. Comme vous le savez, les prélèvements en période d'étiage étaient réglementés. L'objectif est de l'appliquer aux périodes où l'on bénéficie de davantage d'eau, partant de l'idée que, si l'on connaît une période sèche bien plus marquée, il existe aussi des périodes où l'eau est bien plus abondante. C'est évidemment le moment le plus opportun pour constituer des stocks. Ce décret doit être accompagné par une étude pilotée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et l'Office français de la biodiversité (OFB) sur la méthodologie de détermination des volumes prélevables.
Fin janvier, une instruction complémentaire a été prise sur les plans territoriaux de gestion des eaux. Pour résumer, cette instruction donne la possibilité au préfet coordonnateur, pour chaque projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), au bout d'un certain délai de débats et d'échanges, d'arbitrer et de prendre de grandes orientations pour faire aboutir ces démarches.
Nous travaillons également sur la réutilisation des eaux usées traitées industrielles. Il existe un projet de décret et un projet d'arrêté qui ne sont pas encore stabilisés, l'idée étant que le décret fixe un cadre d'ensemble et que l'arrêté puisse, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), définir des couples entre l'usage et les précautions à prendre dans la réutilisation des eaux usées traitées. Plus on s'approche de la production alimentaire, plus il faut augmenter le niveau de précaution et d'exigence.
Le Varenne a aussi permis un soutien aux ouvrages hydrauliques agricoles. Les 45 millions d'euros du plan de relance de l'an passé ont été complétés par 20 millions d'euros cette année. Il existe également toute une série d'appels à projets et à manifestations d'intérêts au titre de France 2030.
Dans l'appel à manifestations d'intérêts « Démonstrateurs territoriaux », deux lauréats correspondent au Varenne : un projet d'irrigation dans le sud de l'Hérault et du Gard à partir d'eaux usées traitées, et un autre projet plus axé sur les nouvelles technologies de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire.
Enfin, un chantier reste à développer, c'est celui de l'optimisation des ouvrages hydrauliques existants. Un inventaire dressé par photos satellites a été réalisé. Nous disposons sur le territoire national d'environ 350 000 réserves de plus de 0,1 hectare de superficie. C'est un patrimoine colossal.
L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) est en train de travailler sur une méthodologie pour pouvoir mobiliser au mieux ces masses d'eau.
Une fois la photographie connue, il faut en effet savoir qui est propriétaire de l'ouvrage, dans quel état il se trouve, s'il existe à proximité des exploitations qui peuvent être intéressées par l'irrigation, comment gérer la relation entre le propriétaire de l'ouvrage et les exploitations, sans parler des conséquences environnementales.
Je voudrais conclure en insistant sur un point particulièrement important : le Varenne consiste en un équilibre d'ensemble entre les démarches d'adaptation de l'agriculture au changement et d'accès raisonné à la ressource. Le Varenne porte sur l'une et l'autre de ces grandes orientations. On ne joue pas l'une contre l'autre ni l'une sans l'autre.
Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les enjeux de l'eau et du changement climatique lors du rapport produit par la délégation sénatoriale à la prospective. Des sénateurs membres de cette délégation ont visité un aménagement hydroélectrique, ce qui permet de comprendre ce qui se passe sur nos territoires.
EDF Hydro est l'entité qui gère les aménagements hydroélectriques en France métropolitaine. L'hydroélectricité, on l'oublie trop souvent, est la première des énergies renouvelables (EnR). C'est une énergie souveraine, flexible, stockable : elle coche donc beaucoup de cases. Il s'agit sans conteste d'une énergie fort ancienne, mais elle a encore de très beaux atouts dans le cadre de la transition énergétique que la France est en train de mener.
Par ailleurs, elle s'inscrit dans le temps long de la vie des territoires et contribue à leur dynamisme, avec l'emploi, la fiscalité, le multi-usage de l'eau.
Fort heureusement, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, vous avez contribué à l'y introduire. Soyez-en remerciés. Nous comptons sur vous, durant cette année 2023, pour promouvoir son déploiement dans les différents véhicules législatifs que vous aurez à examiner.
L'autre spécificité de la production hydroélectrique est qu'elle touche à l'eau, qui constitue aussi un bien commun essentiel. Nous sommes, en tant qu'hydroélectriciens, à la croisée de ces deux biens communs que sont l'énergie et l'eau.
EDF Hydro gère ainsi, pour le compte de la collectivité, quelques milliards de m3 d'eau de surface stockée dans les barrages et les retenues en France métropolitaine. Cette eau sert principalement à la production hydroélectrique, notamment pour adapter le système électrique aux variations de consommation journalières, mais aussi aux pointes en hiver.
Cette eau sert également à d'autres usages comme l'irrigation, l'eau potable, le tourisme, la navigation ou la préservation de la biodiversité ; nous sommes donc à la croisée d'un certain nombre de chemins. Elle contribue enfin au refroidissement des centrales, comme cela a été indiqué.
Deux tiers de nos concessions hydroélectriques permettent déjà d'autres usages que la production d'hydroélectricité. EDF veille en permanence à assurer la gestion des aménagements hydroélectriques en concertation avec les accords locaux de l'eau. Elle participe aux instances de gouvernance et de gestion nationale et locale de l'eau. Elle a su montrer cet été son sens du service public et de l'intérêt général puisque, sur la Durance, nous avons arrêté de produire de l'électricité dès la fin du mois de février pour accélérer le remplissage du lac de Serre-Ponçon et permettre les usages vitaux pour l'été, comme l'agriculture.
L'hydroélectricité ne consomme pas d'eau, il est important de le garder en tête. On la retient quand elle est abondante et on la relâche en cas de besoin. Elle participe donc à l'atténuation des effets du changement climatique.
Durant l'été, qui a été difficile, le rôle d'EDF a été salué dans l'accompagnement de l'État et des collectivités locales. C'est sans doute une chance pour la France de bénéficier d'un acteur hydroélectrique au service de la gestion de l'eau sur les territoires de montagne.
EDF a accumulé une expérience de gestion de l'eau qui peut servir dans les temps compliqués vers lesquels nous nous dirigeons collectivement. Il faut néanmoins intégrer les différentes temporalités de la gestion de l'eau et les différents niveaux de décision et d'enjeux.
Du point de vue énergétique, le stockage derrière le mur des barrages vise à conserver l'eau pour produire de l'électricité principalement l'hiver. Du point de vue des autres usages, cette eau doit être relâchée pour le multi-usage plutôt l'été, même s'il ne faut pas négliger les équilibres entre l'offre et la demande qui peuvent survenir l'été. Durant cet été 2022, il a fallu faire face plusieurs fois à la nécessité de produire de l'hydroélectricité pour apporter de la puissance au système, notamment début juillet.
Nous devons aussi répondre à des enjeux de sécurité du système électrique à la maille nationale, voire régionale et, en même temps, répondre à des enjeux de multi-usage de l'eau au niveau local.
Concilier ces deux dimensions dans des contextes temporels et spatiaux aussi différents n'est pas chose aisée. Nous avons, depuis des années, adapté notre gestion pour y faire face. Nous relâchons des centaines de millions de m3 chaque année pour d'autres usages, tout en assurant les besoins de flexibilité du système électrique. La mobilisation des réservoirs hydrauliques est déjà largement activée. Deux tiers des concessions ont déjà d'autres usages de l'eau que la production d'énergie.
Dans beaucoup d'endroits, le fait que les barrages servent à d'autres usages a ainsi masqué le besoin d'adaptation au changement climatique des bénéficiaires. Nous avons connu, durant l'été 2022, une sécheresse exceptionnelle qui nous a conduits à déstocker plus que la normale - 800 millions de m3, soit 60 % de plus que la moyenne 2015-2021, plusieurs retenues ayant été totalement vidées, à la limite de la vidange - et, en même temps, à gérer un risque pour l'hiver qui risquait d'être très tendu, ce qui sera de nouveau le cas en 2023. Ceci nous a amenés à constituer des réserves d'eau suffisantes pour anticiper l'hiver et les pointes de consommation.
Dernièrement, les limites physiques de ce genre d'exercice sont apparues. Les éventuelles mobilisations supplémentaires des retenues hydroélectriques ne sont pas une solution miracle, d'une part parce que les installations ne sont pas toujours géographiquement localisées où se trouvent les besoins en eau, d'autre part parce que les volumes seraient insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins, accrus sous l'effet du changement climatique.
Il ne saurait être question de sacrifier l'une des dimensions eau ou énergie de l'eau au bénéfice de l'autre. Notre défi collectif est de mener à bien, de front, la transition énergétique et la gestion durable de la ressource en eau.
Au-delà de la contribution des réservoirs en régime normal et des nouvelles solutions face aux besoins en eau, qu'elles soient fondées sur la sobriété des usages ou reposent sur la constitution de nouvelles capacités de stockage, il est nécessaire de continuer à développer l'hydroélectricité, notamment parce que le besoin de flexibilité du système électrique s'accroîtra.
Nous considérons qu'il existe encore en France et dans les outre-mer un gisement de développement potentiel pour l'hydroélectricité, que ce soit dans un cadre énergétique ou multi-usage équilibré, comme nos prédécesseurs ont su le faire sur la Durance où, au titre du multi-usage de l'eau, un bel ensemble a pu voir le jour.
Merci pour cette invitation autour d'un sujet qui anime certains de nos adhérents depuis 150 ans.
Tout d'abord, nous ne devons pas nous tromper : l'été 2022 n'a pas été exceptionnellement chaud. Nous faisons face à des périodes sèches de plus en plus fréquentes, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'été 2023, compte tenu du niveau des nappes phréatiques, sera tout aussi compliqué.
Durant l'été 2022, en France, plus de 500 communes ont été privées d'eau potable : nous devons collectivement anticiper ces sujets. Il suffit d'observer les projections de Météo-France sur certaines parties du territoire, de mesurer l'étiage des fleuves et de noter la concentration de pollution du fait de la baisse du niveau des nappes pour comprendre que l'état de la ressource en France est en danger. Peu de gens peuvent dire le contraire.
S'ajoute à cela un retard structurel d'investissement des services d'eau et d'assainissement. Ce constat a été dressé avant l'été 2022. Nous investissons, en France, un peu plus de 6 milliards d'euros dans ces domaines. En 2020 ou 2021, la filière a mis en lumière un retard d'investissement d'une quinzaine de milliards d'euros sur les cinq ans à venir pour anticiper les effets du changement climatique.
La ressource se raréfie, ce qui complique énormément les traitements en qualité, et les concentrations de pollution s'intensifient alors que, dans le même temps, le patrimoine des services d'eau et d'assainissement s'érode.
Les solutions existent et elles sont nombreuses. Tout d'abord, nous devons être extrêmement prudents avec les notions de qualité et d'efficacité des services d'eau en France. On parle beaucoup du fameux rendement de réseau, ces quantités d'eau que nous perdons dans les réseaux et qui n'arrivent pas au robinet de l'usager.
En France, le rendement est de 80 %. On perd un litre d'eau sur cinq dans les réseaux, ce qui est plutôt dans les moyennes hautes de l'Europe. Néanmoins, cette situation cache une disparité et une hétérogénéité importante dans les territoires. Certains territoires ruraux ou semi-ruraux ont des rendements de réseau de l'ordre de 60 à 70 % parce que la population n'est pas la même et que l'effort d'investissement doit être encore plus important.
Les solutions existent. Aujourd'hui, un réseau de distribution d'eau, en France, a une moyenne de vie de 150 ans, le taux de renouvellement étant globalement de 0,7 %. Or il faudrait passer à 1,5 %, car on sait que la vie utile d'un réseau est en France comprise entre 70 et 80 ans. Il faudrait donc, sur ce sujet spécifique, investir un milliard de plus par an.
Les solutions de digitalisation existent. Ce qui est important, c'est la connaissance du patrimoine, de manière à savoir où investir, quand et comment, pour maximiser l'efficacité des investissements.
Les Français veulent participer à la lutte contre le changement climatique. Là aussi, des solutions existent, comme les compteurs d'eau intelligents qui permettent de retracer la consommation quotidienne, mais surtout de se positionner face aux profils-types de consommation des usagers et face au changement climatique.
Aujourd'hui, le sujet de l'eau est national. Je suis toujours surpris de constater que nos concitoyens ne connaissent pas parfaitement le fonctionnement du cycle de l'eau. Le fait de les intégrer dans ce dispositif pour qu'ils puissent comprendre les bénéfices de la sobriété permettra aussi de les éduquer aux politiques publiques qui les concernent.
La deuxième catégorie de solutions que nous essayons de promouvoir - et il semble que nous ayons été écoutés - concerne la réutilisation des eaux usées traitées. La France est un mauvais élève en Europe, puisque nous n'en réutilisons qu'un peu moins de 1 %, contre 14 % en Espagne ou 8 % en Italie. L'agriculture espagnole utilise très largement cette eau pour son agriculture dont les produits sont consommés en France.
Les technologies existent. Elles sont d'ores et déjà maîtrisées et nous pouvons les déployer. La fédération professionnelle des entreprises de l'eau a proposé l'objectif de 10 %, ce qui permettrait d'apporter 500 millions de m3 à l'irrigation, soit 15 % des besoins agricoles, de façon à soulager la ressource.
On parle beaucoup de réutilisation des eaux, mais la réalimentation des nappes est un dispositif extrêmement intéressant qui consiste à les réalimenter l'hiver pour faire face aux pics l'été.
Il ne faut pas oublier des sujets comme la sécurisation de l'alimentation. Le Gouvernement a débloqué 100 millions d'euros en début d'été pour s'assurer de son bon fonctionnement. Couplé à la désimperméabilisation des sols, le remplissage des nappes peut contribuer à mieux mobiliser la ressource.
Deux réflexions pour conclure.
Aujourd'hui, la France a mis en place un système extrêmement performant qui a fait école et qui a rayonné dans le monde entier. Nous devons non seulement le défendre, mais aussi le promouvoir de façon à ce qu'il reste la référence mondiale.
Le système de compétences est décentralisé au niveau des collectivités territoriales, l'État légifère et les agences de l'eau font, de notre point de vue, un travail remarquable de péréquation et de répartition des investissements.
Néanmoins, ce système ne permet pas d'élaborer aujourd'hui une vision programmatique au niveau national, de manière à combler les retards et les lacunes et à anticiper les effets du changement climatique.
Les constats sont clairs : le Varenne agricole de l'eau a fait un travail remarquable, de même que les Assises de l'eau avant lui. L'idée qui doit être la nôtre aujourd'hui est de passer de ces constats à l'action, une action coordonnée, synchronisée et qui permette d'anticiper les effets du changement climatique.
Je suis hydrologue et toujours un peu gêné par le terme de « ressource en eau » : malgré son apparente simplicité, la question est assez complexe et parfois mal posée.
Vous avez évoqué deux chiffres, l'agriculture représentant 9 % des prélèvements et 45 % de la consommation. En fait, il ne s'agit pas de pourcentages calculés sur une ressource mal définie, mais sur la totalité des écoulements de la France, qui ne peut constituer une « ressource » au sens anthropique. La ressource, c'est ce que nous, les hommes, pouvons utiliser. Le fait de qualifier la ressource de naturelle ne change rien à la situation.
La question se complexifie en parlant de ressources souterraines et de ressources de surface. Les ressources souterraines constituent à la fois un stock et un flux, les ressources de surface essentiellement un flux. Les ressources souterraines et les ressources de surface ne sont pas indépendantes. Si l'on excepte les ressources souterraines qui alimentent directement les océans, que je pense négligeables, les ressources souterraines sont également en été des ressources de surface. Il n'a pas plu en juillet et pourtant, dans beaucoup de rivières, il y avait de l'eau, même s'il y en avait peu. L'eau souterraine réapparaissait, drainée par les rivières.
Qualifier l'ensemble des écoulements de ressource entraîne une surestimation de la ressource mobilisable. Lors d'une crue cévenole très intense, une quantité faramineuse d'eau passe dans les ruisseaux et les rivières sans pouvoir être stockée. Nous ne disposons pas des moyens pour cela et ne sommes pas en mesure d'utiliser de telles quantités.
Enfin, le terme de ressource renvoie à la notion d'utilisation. L'eau est utilisable de nombreuses façons quand on la prélève, mais aussi quand on la laisse là où elle est ; c'est le cas par exemple de la navigation.
En tant qu'êtres humains, nous avons la possibilité de mobiliser une plus grande part de l'écoulement naturel en développant des stockages. On le fait depuis toujours, comme dans le bassin de la Seine, qui constitue une bonne illustration des stockages réalisés.
Les grands lacs de Seine permettent de réalimenter la Seine tout l'été. Nous n'avons pas eu de problème de production d'eau ni de navigation sur la Seine parce que près de 60 % de l'écoulement provient en réalité d'un écoulement qui avait été stocké pendant l'hiver et qui était livré à la rivière.
Certains noteront que je n'ai pas parlé d'écologie. C'est parce que je suis gêné par le terme de « ressource », qui me semble peu adapté, mais il va de soi que, lorsqu'on mobilise les écoulements naturels, il est essentiel d'en laisser une part non négligeable aux écosystèmes aquatiques, qui constituent une source très importante de biodiversité à laquelle les Français sont, je pense, très attachés.

Je voudrais revenir sur la nécessaire sobriété en eau et la modération de sa consommation à l'échelle nationale, sur le modèle des économies en matière d'énergie.
J'ai deux questions à poser aux intervenants, et plus particulièrement à M. Pellegrini.
Ma question porte sur les gâchis domestiques et structurels. On le sait, une simple chasse d'eau défectueuse peut consommer jusqu'à 25 litres d'eau par heure. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 68 millions à les faire, comme le dit la publicité.
Un amendement que j'avais défendu a été adopté à l'Assemblée nationale, lors du « Grenelle de l'environnement », pour la récupération des eaux de pluie utilisables dans les bâtiments publics pour alimenter les chasses d'eau. Ce principe est-il développé ?
Plus largement, qu'en est-il de la réutilisation des eaux usées traitées en France, qui représente une des solutions d'avenir à la raréfaction de l'eau ? Nos voisins espagnols et italiens sont en avance sur le sujet concernant cette pratique en sortie de station d'épuration des eaux usées. Quels sont les freins et les leviers pour démocratiser cette procédure en France ?
Par ailleurs, je lisais ce week-end dans le Journal du dimanche un article de Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, qui expliquait que les sécheresses successives ne font qu'accélérer la détérioration des réseaux. Un milliard de m3 d'eau se perd chaque année, et nos réseaux souffrent d'un sous-investissement chronique. Au rythme actuel, dit-il, il faudrait 150 ans pour les renouveler en intégralité. Selon les observateurs, le besoin d'investissement est de 4 milliards d'euros par an à l'échelle nationale. Votre fédération intervient-elle sur le sujet pour sensibiliser les élus et les pouvoirs publics à la nécessaire accélération de ces investissements ?

Dans un contexte de dérèglement climatique, la gestion de l'eau doit être une priorité, non seulement pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour la souveraineté alimentaire. On dresse beaucoup de constats, mais on ne transforme guère le verbe en action.
La ressource en eau est en danger, et il faut savoir que nous n'avons plus de politique de gestion de la ressource depuis plus de 30 ans, que ce soit sur le plan quantitatif ou sur le plan qualitatif.
En janvier dernier, lors d'un débat en séance publique au Sénat, un certain nombre d'entre nous a proposé des solutions. Peut-être viennent-elles tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire : politique de nouveaux barrages pour soutenir l'étiage de nos rivières, relance de l'hydroélectricité, développement des énergies renouvelables qui ne consomment pas d'eau, rechargement des nappes par injection, dont on parle très peu et qui peut constituer une solution, réutilisation des eaux usées traitées, qui pose problème car, sur le plan financier, les grandes agglomérations disposent d'un volume suffisant pour irriguer des cultures à proximité, mais le monde rural, qui compte peu d'habitants, va devoir réaliser des kilomètres de canalisations pour amener l'eau sur les cultures, ce qui génère des coûts énormes.
On peut évoquer la désalinisation et la simplification de la mise en place des réserves de substitution. On a vu ce que cela pouvait donner dans les Deux-Sèvres il y a quelque temps.
Il faut agir et pour cela des moyens financiers importants sont nécessaires. On voit que les agences de l'eau sont aujourd'hui limitées en termes d'investissement : elles ne sont plus en mesure d'apporter un certain nombre de financements. Avec le plafond mordant, les agences n'ont plus la capacité d'investir suffisamment alors que, dans le même temps, de nouvelles priorités émergent. Mon collègue évoquait le milliard de m3 d'eau traitée perdu dans les canalisations.
Il faut donc instaurer des priorités pour financer la réhabilitation progressive de ces canalisations. Cela nous permettrait de récupérer de l'eau potable, ce qui coûterait moins cher au contribuable, ainsi que de l'eau pour l'irrigation.
Il existe des solutions, avec des priorités et des exemples à suivre. Israël est dans ce domaine assez exceptionnel car, malgré la rareté de l'eau, ils font beaucoup de choses. On pourrait s'en inspirer. L'Espagne aussi - mais elle se heurte à présent à d'autres problèmes pour réaliser ses réserves.
Enfin, devons-nous légiférer à nouveau sur l'eau ? La dernière loi date de 2006. Ne faut-il pas revoir le cadre normatif dans ce domaine ? Je répète qu'en tout état de cause, l'investissement demeure prioritaire.

Les intervenants ont tracé un certain nombre de pistes et de perspectives qu'il nous faudra sans doute creuser encore pour déterminer de quelle manière nous pouvons aboutir sur un certain nombre de sujets.
Je voudrais revenir sur la gestion et la politique de l'eau dans les politiques d'urbanisme. Il semblerait que ce soit aujourd'hui un axe important sur lequel il faudrait peut-être avancer de manière plus forte.
La gestion de l'eau en termes de ressource pourrait s'intégrer aux schémas de cohérence territoriale (SCoT) et nous permettre également, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et des plans locaux d'urbanisme (PLU), de développer un certain nombre de stratégies, notamment en matière de gestion du fil de l'eau ou des eaux pluviales. Il s'agit de considérer la ressource en eau comme une stratégie territoriale par rapport à l'accueil des nouveaux habitants et de l'intégrer dans les politiques d'urbanisme. Ce n'est pas réellement le cas aujourd'hui. Quel est votre avis sur le sujet ?
Concernant les concessions hydroélectriques, un sujet se pose avec la mise en demeure de l'Europe concernant l'évolution de nos concessions et leur mise en concurrence. Je voudrais également connaître votre avis sur cette problématique car c'est un sujet majeur.
Un autre sujet concerne le développement des solidarités interbassins : ce qu'on ne turbine pas d'un côté peut permettre de créer des lâchures supplémentaires utiles en termes de soutien d'étiage.
Vous avez par ailleurs abordé le sujet de la sobriété des usages, qui pose la question de la recherche appliquée aux techniques agricoles, sur lesquelles on manque de visibilité.
Quelles sont les stratégies nationales ? Comment sont-elles déclinées en termes de subsidiarité ? Ceci pourrait nous permettre d'avancer sur un certain nombre de technologies et de pratiques. Or cette question souffre d'un manque d'éclairage.
D'autre part, la tarification différenciée pourrait accompagner les évolutions vers plus de sobriété. Ce sujet a-t-il été travaillé à différents niveaux ?
Enfin, en termes de gouvernance, faut-il clarifier les compétences entre les collectivités territoriales - régions, départements -, celles-ci étant membres des syndicats et des comités de bassin ? Existe-t-il une évolution en la matière qui permette d'obtenir une meilleure efficacité ?

Vaste sujet que celui de la clarification des compétences ! Cela va devenir urgent.

On assiste depuis plusieurs années à des sécheresses successives, avec des débits très réduits dans de nombreuses rivières. À certaines époques de l'année, les débits sont principalement assurés par les rejets des stations d'épuration, ce qui a pour conséquence de concentrer les polluants. Or les pompages dans les nappes alluviales alimentent une grande partie de nos concitoyens.
On a beaucoup parlé de quantités. Pouvez-vous nous apporter quelques ébauches de solutions au sujet de la qualité et des conséquences de ces concentrations de polluants ? Quels sont les traitements nouveaux à mettre en place ? Quelles sont les obligations d'analyse à mettre en oeuvre ? Quelles sont les conséquences en matière de biodiversité dans les rivières, notamment sur la faune piscicole ?

Malgré des précipitations importantes en janvier, l'Observatoire régional de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine constate que seules 14 % des nappes phréatiques ont retrouvé des niveaux satisfaisants. Mon département, la Charente, est particulièrement touché par le phénomène de sécheresse et de raréfaction de la ressource en eau.
Concernés au premier chef, les agriculteurs, même s'ils disposent de réserves en eau, redoutent la raréfaction de la ressource et les menaces qui pèsent sur leur activité. Certains ont pris les devants en diminuant leur production de maïs, très gourmande en eau, ou en cultivant davantage de blé, de soja ou de chanvre. Il y a un vrai travail à faire pour aider les agriculteurs à connaître les sols et l'état de la ressource afin de déterminer les conversions et les transitions agricoles à réaliser.
Ne pourrait-on envisager un grand plan d'accompagnement des agriculteurs pour adapter leurs cultures en vue de préserver la ressource en eau ? Des labels pourraient être créés en lien avec les collectivités qui généralisent des plans alimentaires territoriaux ambitieux, comme dans mon département. Quelles sont vos pistes pour développer et soutenir les filières à faible impact sur la ressource en eau ?
Par ailleurs, les paiements pour services environnementaux (PSE) représentent un levier d'accompagnement inédit pour les collectivités et les agences afin d'anticiper les évolutions climatiques et réaliser la transition agroécologique. Avez-vous étudié les premiers retours des appels à projets concernant ces PSE ?

Le département dont je suis sénateur, les Deux-Sèvres, connaît une particularité géologique. Le nord du département est sur le massif hercynien, le sud est en zone quartzique, à savoir des sols à dominante calcaire.
En pratique, les agriculteurs du sud, sur les zones de grandes cultures, réalisent des forages pour aller chercher l'eau dans les nappes profondes. Ceci a été critiqué à juste titre, car les nappes profondes prennent du temps à se renouveler. C'est dans ce contexte que le système des fameuses bassines a été imaginé : des retenues artificielles que l'on recharge avec des prélèvements d'eau au moment des périodes de pluie d'hiver et de printemps dans les nappes de surface afin d'irriguer les grandes cultures au moment de la croissance des plantes. Ce sujet présente un fort potentiel polémique. Je pense pour ma part que l'agriculture a besoin d'eau : on peut difficilement empêcher les agriculteurs d'utiliser de l'eau.
La constitution de ces retenues d'eau et l'irrigation des grandes cultures me paraissent normales. Existe-t-il pour nos intervenants une solution alternative, plus opportune pour les cultures ? Les arrosages avec les canons à eau utilisent beaucoup d'eau et ne constituent sans doute pas la meilleure méthode.
Comment accompagner les usagers dans leur consommation d'eau et faire en sorte que les réseaux de distribution soient plus efficaces ?
Les Français sont aujourd'hui équipés à 40 % de compteurs d'eau intelligents. Les autres reçoivent une facture d'eau basée sur un relevé annuel ou effectué deux fois par an. Autant dire que pour 60 % des Français, le profil de consommation et la capacité à l'infléchir sont complètement déconnectés du système de facturation.
C'est pourquoi les compteurs intelligents et les applications qui ont été développées permettent de synchroniser l'usage et la conscientisation. Aujourd'hui, il est possible, grâce à nos applications, de détecter des pommes de douche déficientes afin d'en conseiller le remplacement. Nos entreprises sont également extrêmement investies dans la distribution de produits hydro-économes, qu'adorent les jeunes générations. Il s'agit de pommeaux qui changent de couleur lorsque la douche dure trop longtemps.
Encore une fois, tout cela ne fonctionne que si les citoyens et l'usager constatent l'effet de leurs efforts sur leur facturation d'eau.
La recherche des fuites se développe également dans les résidences secondaires, les bâtiments administratifs où on enregistre très peu de mouvement le week-end ou à certaines périodes de l'année, comme les établissements scolaires.
Le système de facturation des services d'eau en France repose sur un modèle volumétrique. Plus on consomme d'eau, plus le prix au m3 est bas. Face à la conscientisation des usages, ne faut-il pas développer des modèles où les entreprises sont rémunérées pour leur économie d'eau en matière de distribution auprès des usagers ? Cela me paraît une piste intéressante.
Quant à la réutilisation, il s'agit d'un sujet majeur qui peut se concevoir à l'échelle du bâtiment pour peu qu'on l'anticipe dans l'aménagement immobilier, comme la récupération d'eau de pluie. C'est plus compliqué pour un bâtiment existant.
Il est aujourd'hui essentiel de prendre en compte les services dans leur globalité en matière d'aménagement du territoire. Lorsque nous tentons de mailler les différents réseaux, nous voyons bien qu'il n'existe pas de convergence. Je suis donc favorable, tout comme la fédération que je préside, à faire en sorte que l'aménagement du territoire prenne en compte les services essentiels.
S'agissant du rendement des réseaux, nous estimons qu'il faut prioritairement augmenter le taux de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable. Un milliard de plus par an nous paraît suffisant pour combler, en cinq à six ans, le retard que nous avons, et passer à un taux de 1,5 % qui correspond à un âge moyen de 75 ans.
La problématique repose sur la fracture territoriale par rapport au rendement du réseau. L'effort d'investissement va peser davantage dans les territoires où les densités sont très faibles. Un risque de découplage territorial existe avec, d'un côté, des métropoles où les taux de rendement de réseaux sont extrêmement bons et les prix de l'eau compétitifs et, de l'autre, des territoires ruraux et subruraux où le prix de l'eau sera plus cher et les rendements de réseau extrêmement bas.
Il s'agit d'une question de péréquation nationale qui ne peut être traitée à l'échelle de la collectivité territoriale. Lorsque les réseaux sont invisibles et enterrés, ils sont plus difficiles à cartographier. Il nous paraît essentiel de connaître ce patrimoine afin que les efforts soient réalisés de manière plus efficiente, en investissant le bon euro, au bon endroit et au bon moment.
L'innovation technique nous permet, en fonction des mouvements de sol et de certaines caractéristiques géotechniques, de savoir où rénover en priorité, les interventions se faisant toutefois souvent lors des aménagements de mobilité. Lorsqu'une nouvelle ligne de tram est construite, on en profite par exemple pour renouveler le réseau d'eau. Ces questions sont donc intimement liées.
Faut-il une nouvelle loi sur l'eau ? C'est à vous, en faisant preuve de sagacité, d'y réfléchir. Nous constatons que les collectivités territoriales font face à des défis considérables. La compétence en eau et assainissement fait sens car la ressource est toujours locale, mais cela complexifie la conduite de politiques efficaces, les problématiques, les sociologies et l'état du patrimoine relevant du domaine local. Néanmoins, ce système a accumulé trop de retard compte tenu de l'accélération du changement climatique. Un coup de pouce pour accélérer le niveau d'investissement et passer à une action véritable serait le bienvenu.
Les questions de qualité d'eau et de traitement sont considérables. Nous devons aborder les sujets en conservant la vision d'ensemble du cycle de l'eau. Un projet de directive européenne portant sur l'assainissement est actuellement en cours de discussion entre les États membres. Il est proposé de traiter les résidus médicamenteux dans l'assainissement. Ceux-ci constituent 90 % des micropollutions. Les traiter à travers l'assainissement protège la capacité et la ressource en eau.
Il faut donc une vision d'ensemble. Nous devons également être extrêmement méfiants vis-à-vis des polémiques portant sur la qualité de l'eau, qui visent à opposer traitement et prévention. Il faut évidemment réaliser les deux.
Les nappes de l'ouest de la France connaissent de fortes concentrations de pesticides. La prévention n'y fera rien. Il va falloir développer des capacités de traitement, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas protéger la ressource en amont. Il faut exercer notre discernement territoire par territoire pour protéger la qualité de l'eau.
En tout état de cause, il est certain que l'effet du changement climatique et la raréfaction de la ressource entraînent des sujets préoccupants en termes de qualité, auxquels nous devons répondre.
Je voudrais revenir sur l'accompagnement des agricultures et la performance de l'irrigation.
Une charte d'engagement entre l'État, les chambres d'agriculture et les différentes filières agricoles a été signée au moment des conclusions du Varenne. C'est ainsi qu'ont été engagés les plans d'adaptation des filières et les plans territoriaux au niveau régional. Ceci nous donne le cadre.
Le Varenne étant une démarche évolutive, nous allons avoir besoin de capitaliser tous les éléments d'évolution recensés par ces différents travaux, qui expriment tous un besoin important de recherche appliquée. C'est aussi ce qu'a montré le CGAAER sur les productions résilientes. C'est ce que vont mettre en oeuvre les leviers d'adaptation qui feront l'objet de travaux de l'INRAE et de Chambres d'agriculture France, au travers d'un regroupement spécifique.
Nous allons donc avoir besoin de consolider cette vision pour aller au-delà de l'initiative de Chambres d'agriculture France en matière d'accompagnement des exploitations.
La performance de l'irrigation est un sujet à l'évidence lié à la question de la sobriété. Le dernier recensement agricole montre que la surface agricole utile irriguée s'est accrue entre les recensements de 2010 et de 2020 en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans les Hauts-de-France. Ceci n'est toutefois pas homogène, mais l'utilisation d'eau agricole a progressé moins vite que la superficie irriguée. Cela signifie que la performance de l'irrigation a été prise en compte par les agriculteurs.
On progresse en passant d'une irrigation gravitaire, où on laisse couler l'eau, à une irrigation sous pression, mais le coût de l'énergie constitue un élément nouveau depuis quelques mois. Un professionnel me disait il y a peu qu'avant de déclencher sa pompe, il y réfléchissait à présent à deux fois. Ceci est évidemment lié aux facturations électriques.
On progresse aussi en passant de l'aspersion au goutte-à-goutte, en irriguant tout aussi bien avec moins d'eau. Lauréate de France 2030, la Chambre régionale des Pays de la Loire est en train de développer un programme d'irrigation dite « intelligente ». Cela consiste à placer dans les champs des capteurs qui analysent le niveau de confort de la plante. Cela indique à l'agriculteur à quel moment déclencher l'irrigation grâce à des applications sur mobile.
Il faut continuer à explorer ces solutions techniques. Cela fait partie du programme France 2030, mais aussi d'une initiative qu'on appelle la troisième révolution agricole, afin d'aller toujours plus loin dans cette performance - et on voit bien qu'il existe des marges de manoeuvre.

Par ailleurs, Rémy Pointereau a posé une question sur le financement des agences de l'eau et le plafond mordant.
Enfin, faut-il une nouvelle loi sur l'eau et un chef de file ? Quelles collectivités pourraient s'en charger ?
Tout d'abord, je n'ai pas d'élément concernant les PSE, mais je sais qu'il s'agit d'un outil que certaines collectivités souhaitent mettre en oeuvre. J'ai un exemple en tête où des zones d'extension des crues permettent l'infiltration, tout en ayant un système de PSE pour les agriculteurs concernés.
Faut-il une nouvelle loi sur l'eau ? Il ne m'appartient pas d'y répondre, mais je me suis référé au rapport de la délégation à la prospective. Ceci n'est pas encore tranché.
Quant à la question des compétences, elle sous-tend la notion de chef de filât des collectivités. En zone rurale, on retrouve dans le domaine de l'adduction d'eau potable le sujet des capacités financières, des capacités techniques et de l'ingénierie. On a peut-être intérêt à disposer de structures plus importantes pour pouvoir conduire des projets d'interconnexion.
Lors des sécheresses de 2018-2019, de petites structures qui n'étaient pas interconnectées ont dû recourir à l'approvisionnement par camion.
Je ne peux trancher au niveau institutionnel.

Avez-vous des éléments concernant la question de Mme Bonnefoy au sujet des retenues ?
Ma réponse sur les retenues provoque généralement beaucoup de critiques de la part de mes collègues écologues et hydrologues, qui ne s'entendent pas sur l'opportunité des retenues.
Une bassine est un objet mal identifié. J'ai tendance à considérer qu'une bassine est une retenue qui comporte plus d'une digue, par contraste à un barrage sur une rivière. Les « giga-bassines » par excellence sont constituées par les retenues des grands lacs de Seine, qui comptent quatre retenues, une sur l'Yonne et trois en dérivation sur l'Aube, la Marne et la Seine. Ces bassines, en dérivation par rapport aux cours d'eau principaux, sont alimentées par un canal de prélèvement et restituent l'eau au cours d'eau par un autre canal. Il est frappant de constater que ces giga-bassines sont parfaitement acceptées et sont même devenues des sites importants pour les écologues et les protecteurs des oiseaux. Je pense donc qu'une retenue n'est pas condamnée, dès sa conception, à être quelque chose de démoniaque.
Les bassines des Deux-Sèvres et les quelque 11 000 plans d'eau, dans le bassin versant de la Sèvre nantaise, sont alimentés par les ruissellements. Certains de ces plans d'eau sont très anciens et ne posent pas de problèmes a priori. Ils appartiennent au paysage. Ce qui soulève des difficultés, c'est un type de bassine bien définie, alimentée par pompage.
La première question que posent ceux qui s'y opposent est de savoir pourquoi prélever l'eau de la nappe superficielle. Le fait d'alimenter ces bassines par pompage est perçu par certains défenseurs de l'environnement comme une intention de contourner les restrictions, alors qu'on pourrait défendre le contraire. Je ne défendrai rien quant à moi, mes recherches ne m'ont pas permis de trancher cette question.
Une réserve de substitution alimentée par des écoulements de surface me semble plus acceptable. Son impact au moment du remplissage est plus fort, mais elle ne présente pas d'incidence différée, l'eau souterraine étant destinée à s'écouler et à rejoindre, pour la quasi-totalité des eaux souterraines françaises, un cours d'eau avant de se jeter dans la mer.
Je pense qu'un gros travail de communication reste à faire. Les grands lacs de Seine font d'ailleurs un énorme effort de communication sur leurs avantages et sur les populations d'oiseaux qu'ils abritent. Ils sont très bien acceptés. Il n'y a donc pas de raison que d'autres ouvrages ne puissent pas être acceptés de la même façon.
J'ajoute, s'agissant du recyclage des eaux usées traitées, que celui-ci se fait depuis très longtemps, mais on le faisait sans le dire puisque, dès lors qu'une station d'épuration rejette de l'eau dans un cours d'eau, celle-ci repart dans le cycle naturel, la seule exception étant les communes littorales, qui rejettent les eaux traitées directement en mer.
Le bassin de la Sèvre nantaise compte ainsi plus de rejets de stations d'épuration que de prélèvements agricoles.
Comme cela a été dit, cela peut poser des problèmes de chimie des eaux et générer des effets sur l'environnement. Nous savons tous que les stations d'épuration n'ont pas la capacité d'épurer les eaux en totalité. Se pose donc la question des perturbateurs endocriniens, ces résidus médicamenteux se retrouvant dans les cours d'eau, où ils perturbent la faune aquatique - phénomènes de changement de sexe chez certaines espèces de poissons, etc. - mais aussi sur l'ensemble de l'écosystème. On a effectivement du mal à en évaluer les effets.
Il n'empêche que les stations d'épuration ne peuvent stocker l'eau, et il serait illusoire de prétendre qu'une station d'épuration pourrait avoir un rendement de 100 % et produire une eau distillée.
Il y aura donc toujours un flux de pollution, et il faudra toujours des flux d'eau non polluée pour diluer une partie de celui-ci. Je ne dis pas que c'est bien ou mal : pratiquement, c'est ce que l'on observe.
Il est vrai que la France fait face à deux mises en demeure de la Commission au sujet des concessions hydroélectriques, l'une en 2015, l'autre en 2019.
Collectivement, le Gouvernement et le Parlement se sont emparés de ce sujet depuis quelque temps. Il faut sortir du statu quo qui existe sur ce sujet depuis trop longtemps, trouver une solution juridique permettant de consolider ces concessions, et faire en sorte de préserver ce qui relève de la souveraineté de l'eau et de la souveraineté de l'énergie. Il faut arriver à en sortir.
Si l'on veut poursuivre notre développement hydroélectrique, nous sommes obligés de résoudre cette problématique avec la Commission européenne. Nous avons sur la Truyère un projet de développement de surpuissance et de station de transfert d'énergie par pompage. La commission considère quant à elle que le projet ne peut être réalisé du fait de cette mise en demeure qui pèse sur la France et qui n'est pour le moment pas résolue. Nous avons donc collectivement intérêt à trouver une solution juridique qui protège les intérêts français.
Pour ce qui est du soutien d'étiage et des cahiers des charges, le sujet est plus complexe. Cela fait appel à l'intelligence collective et à une certaine souplesse. Les choses se sont mises en place à travers des conventions.
Sur le bassin Adour-Garonne, EDF a passé convention avec l'ensemble des acteurs depuis 1993, en lien avec l'État, afin d'optimiser les choses entre énergie et multi-usages de l'eau.
En 2022, nous avons collectivement réussi à faire face aux problématiques pour anticiper ces lâchers d'eau du fait d'un besoin plus précoce dans la saison, en faisant attention, l'été, aux retenues qui présentaient le coefficient énergétique le plus important sur ce bassin pour pouvoir reconstituer les stocks et passer l'hiver sans trop de dommages pour l'équilibre entre offre et demande énergétique.
Nous sommes donc capables, collectivement, au-delà des cahiers des charges, de trouver des équilibres. Cela ne se fait évidemment pas concession par concession, mais sur des ensembles, comme vous le savez. C'est ce qui est problématique dans la mise en concurrence, avec le risque de perdre cette optimisation globale par bassin, par grande vallée hydrographique, en mobilisant de façon différentielle les différentes retenues pour préserver celles ayant un meilleur coefficient énergétique et sont utiles en période de pointe.
Enfin, concernant l'opportunité d'une loi sur l'eau, il ne m'appartient pas de me positionner sur ce sujet. Avec M. Pellegrini, nous participons au Cercle français de l'eau, présidé par Thierry Burlot. Nous avons organisé trois colloques l'année dernière traitant de ce sujet. Je vous renvoie à ces travaux, qui ont été très enrichissants. Une des conclusions a été de dire que la politique de l'eau ne doit pas être considérée d'un point de vue individuel.
Il nous faut donc parvenir à ne pas isoler la politique de l'eau, car elle est à la confluence de l'ensemble des enjeux environnementaux, énergétiques, urbanistiques et économiques.

Ma question concerne la qualité de l'eau et reprend en partie ce que disaient M. Gold et Mme Bonnefoy.
Nous avons été interpellés par les déclarations de l'ANSES, qui lance la procédure de retrait du marché du métolachlore, un des pesticides les plus utilisés en France, non seulement parce que nous avons atteint le taux limité fixé par la Commission européenne, mais surtout parce que des mesures intermédiaires ont déjà été mises en place et que les résultats des études ne sont pas satisfaisants, les eaux souterraines étant contaminées par ce pesticide.
Les conclusions du Varenne agricole de l'eau sont-elles à la hauteur de ces dégâts causés sur l'environnement ? Vous évoquez des chartes, des plans d'accompagnement. Ils sont certes importants et montrent des progrès considérables, mais comment aller au-delà pour être à la hauteur de la prise de conscience que l'agriculture contribue largement aux dégâts en matière de qualité et de quantité de l'eau ?

On sait financer l'eau dès lors qu'elle constitue une menace - je pense aux Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et à la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), pour laquelle on a d'ailleurs créé une taxe. Cela devient de plus en plus complexe dès lors que l'eau est un bien de consommation. On le voit très bien dans les budgets annexes, où l'eau doit financer l'eau.
Comment faire face à ce mur d'investissement, notamment pour la performance des réseaux et la réduction des fuites ? Ne pourrait-on imaginer un système identique à celui qui prévaut dans le domaine de l'énergie, à travers des contrats de performance énergétique ? Un tel contrat permettait à un investisseur tiers de se rémunérer sur une part de l'économie réalisée. Ce système vous paraît-il transposable à l'eau ? Quelles autres pistes pourrait-on envisager ?

Je souhaiterais revenir sur la création de stations de transfert d'eau par pompage qui permettent de pallier notre manque d'électricité. Il s'agit, lorsqu'on bénéficie d'un surplus d'électricité, de pomper l'eau pour l'amener en altitude, avant de la laisser redescendre par gravité afin de faire fonctionner les alternateurs qui produisent l'électricité.
D'autres projets de ce type pourraient-ils être mis en oeuvre ? Ces stations correspondent-elles à nos besoins, étant donné qu'on les a assez peu mobilisées jusqu'à présent ? Je dépose régulièrement, lors des projets de loi de finances, des propositions destinées à obtenir différentes subventions - en pure perte pour l'instant. Par ailleurs, j'ai été effarée d'apprendre, lors d'un colloque du comité de bassin Adour-Garonne sur la qualité de l'eau, que de nouvelles entités chimiques sont régulièrement introduites et que nous avons dépassé la sixième limite planétaire en la matière.
Les analyses de qualité recherchent actuellement un certain nombre de molécules, mais bien d'autres existent et on ne peut trouver ce qu'on ne cherche pas. Les problèmes que l'on va devoir gérer sont colossaux. On est dans une sorte de fuite en avant sur cette question. Comment faire ?
Enfin, comme la plupart de mes collègues, je siège au conseil municipal de ma commune, qui comporte une régie municipale. Je voudrais insister sur le fait qu'il faut faire confiance à nos élus, notamment aux communes en régie dont les adjoints connaissent les réseaux. Or, malheureusement, ces dernières années, les subventions pour refaire les réseaux ont diminué.
Beaucoup de petites communes sont à la peine parce qu'elles ne bénéficient pas de subventions, alors qu'elles savent ce qu'elles devraient et pourraient faire.

Les normes que nous mettons en place au niveau national en matière d'assainissement des eaux usées ne sont-elles pas prohibitives par rapport aux autres pays, puisque vous affirmez que nous sommes particulièrement en retard par rapport à l'Espagne et au Portugal ?
A-t-on besoin de la même qualité d'eau pour un arrosage par aspersion ou de façon gravitaire, quand on arrose des cultures maraîchères ou des pieds de vigne au goutte-à-goutte ?
Par ailleurs, pourquoi n'arrive-t-on pas à lier entre elles les productions d'énergies renouvelables ? L'électricité produite par un parc photovoltaïque au moment où on n'en a pas nécessairement besoin pourrait être renvoyée vers les barrages afin de remonter de l'eau et servir à produire de l'électricité au moment nécessaire. Dans le Verdon, ce serait particulièrement efficace.

Je souhaitais revenir sur l'intervention de M. Pellegrini. Vous avez évoqué le besoin d'abonder le budget de l'État dans le domaine de l'eau. Pouvez-vous nous rappeler les chiffres ?
Par ailleurs, tenez-vous compte du patrimoine enterré dans ces montants ? Cela suppose-t-il une prise en charge par l'État d'un volet très prégnant pour nos collectivités ?
Enfin, pouvez-vous nous rappeler les montants consacrés à la prévention et nous indiquer ce qu'ils comprennent ?

Je remercie M. de Chergé d'avoir cité la vallée de la Truyère et je souhaiterais rappeler le travail que nous avons réalisé depuis douze ans : construire des barrages ne constitue pas forcément un gros mot.
Territorialement, cela peut être une occasion de développement économique, mais aussi touristique. Le travail qui a été fait au travers de la route de l'énergie, avec une mise en résonance des barrages du Massif central et des Pyrénées, a permis à la métropole et aux petits toulousains de découvrir l'intérêt de l'énergie hydroélectrique.
Ma question porte sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. Les magistrats de la Cour des comptes viennent d'envoyer un rapport à Mme la Première ministre à ce sujet. Ils ont estimé que la France conduisait depuis 30 ans cette question « de façon chaotique » et que le calendrier des échéances est crucial.
Le rapport rappelle que 340 installations vont être renouvelées d'ici 2080. Trente-huit concessions sont échues à ce jour et non renouvelées, et poursuivent leur exploitation sous le régime dérogatoire des délais glissants.
Que pensez-vous du référé de la Cour des comptes du 6 février 2023, qui alerte le Gouvernement sur les conséquences de sa gestion chaotique de l'ensemble du parc hydroélectrique, qui se dégrade et ne peut jouer pleinement son rôle dans la tradition énergétique ?
Partagez-vous l'avis de la Cour des comptes qui, dans ce même référé, indique qu'il est préférable d'opter pour le statut de la quasi-régie pour la gestion des concessions hydroélectriques plutôt que pour la mise en concurrence voulue par Bruxelles ?

Je voudrais revenir sur la raréfaction de la ressource en eau et la qualité de l'eau du robinet. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Par ailleurs, qu'en est-il du prix de l'eau dans un contexte de raréfaction de la ressource ? Pouvez-vous nous dire ce qui pourrait être proposé ? Cela peut aussi dépendre du prix.
Quelle est votre réaction face à la proposition de la création d'une agence nationale de l'eau, qui aurait pour mission d'opérer une péréquation sur le prix de l'eau afin d'éviter que l'eau soit peu chère en ville et chère à la campagne ?
Le représentant d'EDF a enfin évoqué des études sur de nouvelles installations. Pourrait-on connaître le nombre de projets prêts pour la phase de débat public ?
S'agissant des STEP, nos stations sont très sollicitées.
Le besoin de flexibilité est avéré, puisque l'usure des turbines des stations de transfert d'énergie par pompage est très importante.
Nous pensons que ce besoin de flexibilité et de stockage va aller grandissant. Beaucoup d'études existent en interne, et nous sommes en train de mener un projet de couplage entre les énergies renouvelables variables et l'hydroélectricité, notamment sur la Durance. Un certain nombre d'études existent sur ce volet. Ce sont des sujets sur lesquels on innove énormément pour faire en sorte que l'hydroélectricité, qui est une vieille dame, puisse continuer à prospérer et à apporter tout ce qu'elle peut apporter au titre de la transition énergétique.
Nous avons de nombreux projets, mais tout ceci est lié à la mise en demeure de la France sur le sujet. Il faut qu'on arrive collectivement à en sortir.
Nous avons de nombreux projets. Réseau de transport d'électricité (RTE), dans son rapport de l'année dernière sur le futur énergétique, a indiqué qu'il y aurait un grand besoin de flexibilité et l'a d'ores et déjà chiffré à 3 gigawatts.
Il serait en effet dommage de passer à côté de ces batteries liquides énormes que possède la France. On n'a besoin d'aucun autre matériau, et la chaîne industrielle est essentiellement française et européenne. On a sous la main une ressource sur laquelle on peut se reposer. Nous poussons, avec les autres hydroélectriciens, le chiffre de 1,5 gigawatt de STEP à l'horizon 2033. Nous disposons de projets dont les études préalables ont été menées et qui ne demandent qu'à être réalisés rapidement, si tant est que ce soit possible.
S'agissant de la Cour des comptes, je ne me prononcerai pas. La Cour a fait un référé auprès de la Première ministre. C'est au Gouvernement de s'exprimer sur ce sujet.
Je répondrai en biaisant et en disant que toute solution, sauf la mise en concurrence, est forcément une bonne solution pour EDF. Il existe plusieurs possibilités. Au Gouvernement, en lien avec les parlementaires, de trouver la meilleure solution.
S'agissant de la gestion quantitative et qualitative de l'eau, la délégation interministérielle est une petite structure de quatre personnes. Notre feuille de route, fixée par décret, correspond à la mise en oeuvre des conclusions du Varenne.
Ces conclusions sont essentiellement orientées vers la question quantitative. Cela ne veut pas dire que le qualitatif est absent de nos préoccupations, mais il est suivi par d'autres structures administratives que la délégation, comme la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) ou à la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB).
Ma mission a été fixée pour trois ans et s'achève en 2025. Je dois rendre un rapport au ministre de la transition écologique et au ministre de l'agriculture. Ce sont les autorités gouvernementales qui décideront, le moment venu, s'il y a lieu de poursuivre cette mission et de l'étendre à d'autres sujets.
En matière de qualité des eaux de réutilisation, il importe, pour la France comme pour tous les pays qui utilisent cette technique, de prévenir le passage de résidus qui se trouvaient dans l'eau vers la production alimentaire. C'est une situation au cas par cas. Ce qui sort d'une station d'épuration à un endroit ne ressort pas forcément à un autre endroit, mais on doit rester dans une logique de prévention.
Il faut également tenir compte des situations où les stations d'épuration contribuent largement au débit d'étiage de certains cours d'eau. C'est un équilibre à trouver. Il faut prendre en compte le coût de production du m3 d'eau réutilisée. Plus on augmente les exigences, plus le coût est élevé. Dans l'industrie alimentaire, le traitement se fait souvent par la technique dite d'osmose inverse, qu'on utilise entre autres pour le dessalement de l'eau de mer, très coûteux en énergie.
Le sujet de la réutilisation est clairement identifié. Nous sommes en train d'y travailler, l'objectif étant bien entendu d'accroître la part de cette ressource complémentaire.
La question du financement du retard d'investissement ou d'investissements supplémentaires est évidemment centrale. Plusieurs réponses peuvent être apportées.
Nos entreprises sont prêtes à adopter des modèles de contractualisation avec les collectivités territoriales qui nous récompensent au rendement et au résultat. Dans nombre de contrats, les investissements sont à notre charge et à nos risques et périls, et nous nous engageons sur une amélioration de rendement de réseau. Les investissements sont donc choisis, étudiés et analysés, et les entreprises peuvent s'engager largement sur une amélioration significative du rendement de réseau.
D'autres types d'indicateurs opérationnels peuvent nous permettre d'améliorer significativement la qualité du service et d'être rémunérés. Tout cela est très ouvert. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. La palette de modèles de contractualisation nous permet de nous exprimer. Il faut simplement répondre à la volonté de nos clients.
Dans un contexte où l'on accumule des retards d'investissement, le plafond mordant est difficile à comprendre. Je ne peux en dire plus.
S'agissant du tarif, la tarification progressive n'est pas toujours de mise. La tarification progressive consiste à ce que les gros consommateurs payent davantage. Lorsque vous remplissez une piscine d'eau l'été, il peut paraître raisonnable de la payer un peu plus cher que les 30 premiers m3 qui servent aux besoins essentiels.
La tarification est une compétence des collectivités territoriales. Elles la définissent en fonction de leur volonté politique et de leur sociologie. L'ingénierie tarifaire est quelque chose que nos entreprises savent faire et qui est à leur portée.
Le mètre cube d'eau, en France, coûte 4 euros en moyenne, ce qui représente 0,8 % du budget des ménages. Il est de 5,50 euros en Allemagne, un pays similaire au nôtre en ce que l'eau y paye également l'eau. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux foyers qui ne sont pas capables de faire face à ce besoin essentiel. Il faut les accompagner. Nos entreprises ont proposé de généraliser le chèque « eau ». Il existe d'autres dispositifs sociaux. Ce prix nous semble raisonné et raisonnable.
Enfin, il existe d'autres modèles de financement. Le projet européen sur l'assainissement propose d'intégrer le principe pollueur-payeur, très largement utilisé dans le recyclage des déchets, qui pourrait consister à capter des sources de financement additionnel pour investir et protéger la ressource en eau. C'est une question que pose l'Europe et qui nous paraît extrêmement intéressante.
S'agissant de la réutilisation des eaux usées, nous proposons de systématiser l'analyse de tous les projets dans les plans territoriaux de gestion de l'eau. Il n'y a, selon nous, pas de sujet sur le littoral. Les rejets des stations d'épuration participent à l'étiage des fleuves, mais il s'agit de n'en réutiliser qu'une partie pour les services industriels des usines d'assainissement et les besoins des collectivités territoriales.
Selon la législation de mars 2002, nous devons adapter la qualité de l'eau aux usages. L'eau d'irrigation doit être potable ou s'en approcher. En revanche, pour la voirie, les espaces verts ou les usages industriels, on peut très bien ne pas viser la même qualité de l'eau. On pense à des modèles économiques plus compétitifs. Tout cela doit être débattu au niveau territorial, de manière à trouver les bons équilibres.
Aujourd'hui, il faut dix ans pour mener à bien un projet de réutilisation des eaux usées. Nous avons fait un certain nombre de propositions, comme le guichet départemental unique pour faciliter les démarches administratives, avec des périodes d'expérimentation plus longues. Je pense que, sur le plan administratif, les choses pourraient être plus souples, plus rapides et plus flexibles.
C'est ce que nous proposons avec un observatoire national qui pourrait expertiser la qualité des eaux réutilisées, de manière à afficher une transparence complète vis-à-vis de tous les usages.
Quant aux retards d'investissement, les 15 à 17 milliards d'euros portent les cinq prochaines d'années, avec deux gros volets : tout d'abord, la sécurisation intègre le renouvellement des canalisations de distribution d'eau, la mise en conformité de nos usines qui ne le sont pas, et l'interconnexion des systèmes. Par ailleurs, la qualité santé-environnement porte sur l'amélioration de la qualité des eaux rejetées et du traitement des usines de production d'eau potable et d'eau pluviale rejetée, une directive nous imposant de ne les rejeter qu'après traitement à hauteur de 5 % - 55 % des collectivités étant non conformes.
Enfin, la qualité de l'eau du robinet constitue une compétence qui ne nous appartient pas. Elle relève des services de santé de l'État. En France, l'eau est conforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la réglementation et s'inscrit parmi les meilleurs standards mondiaux.

Un immense chantier s'ouvre devant nous. Il faut réussir à trouver des solutions pour que l'eau, qui est un produit rare, ne devienne pas un produit hors de portée.
Nous devons également viser une eau de qualité, pour laquelle les coûts de traitement sont très importants. On n'a pas obligatoirement besoin d'une eau de qualité pour nettoyer ou arroser, mais on ne doit pas rejeter dans les sous-sols quartziques des eaux qui finissent par polluer nos rivières.
C'est un beau chantier. Nous essaierons d'évaluer l'opportunité d'une nouvelle loi sur l'eau et d'un changement dans la répartition des compétences. Ce sont des sujets fondamentaux, qui vont être difficiles à résoudre, mais qui ne doivent pas être tabous.
Merci de votre participation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous en venons désormais au second point de notre ordre du jour, avec l'examen du rapport d'information de notre collègue Guillaume Chevrollier consacré au bilan de la COP15 biodiversité et à l'accord de Kunming à Montréal. Ce rapport fait suite au déplacement d'une délégation de la commission au Canada du 11 au 14 décembre dernier, composée du rapporteur, de Denise Saint-Pé et de Jean-Michel Houllegatte. Je signale que Ronan Dantec a également participé aux travaux de la COP15.
Avant de céder la parole au rapporteur, je souhaite dire combien je suis attaché à la participation de notre commission aux COP climat et biodiversité. Cela permet aux commissaires d'appréhender les dynamiques mondiales qui inspirent les diplomaties climatique et environnementale et d'apprécier, au sein même des enceintes où s'élaborent les grandes orientations mondiales, les mécaniques des accords, les intérêts divergents et les clivages parfois puissants qui peuvent exister entre pays, bien mieux que ne le permet un suivi médiatique de ces questions. La présence d'une délégation sénatoriale est un signal fort de l'intérêt de notre commission pour la protection de la biodiversité et le moyen pour les commissaires d'avoir accès à une information de première main.
Les rencontres sur place avec des parlementaires canadiens, des ONG françaises et internationales, des acteurs africains de la biodiversité au quotidien, mais aussi les négociateurs de l'équipe qui accompagnait le ministre sont autant de moyens d'enrichir les points de vue et l'expertise de notre commission en matière de coopération environnementale.
Le 1er février dernier, nous avons déjà eu l'occasion de tirer un premier bilan de la COP15 avec la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard. Il revient désormais à Guillaume Chevrollier de nous présenter son analyse de l'accord de Kunming à Montréal, les dynamiques en faveur de la biodiversité, les enjeux de la déclinaison du cadre mondial à travers la stratégie nationale biodiversité 2030 ainsi que les points de vigilance pour ne pas reproduire l'échec des objectifs d'Aichi.

La commission s'intéresse pour la troisième fois à la 15e Conférence des Nations unies sur la biodiversité, que certains médias ont présentée comme « la COP de la décennie » ou « de la dernière chance ». L'intérêt que porte notre commission à cet évènement est parfaitement légitime, car l'enjeu est de taille : il ne s'agit de rien de moins que de la définition du nouveau cadre international pour la biodiversité à l'horizon de 2030 pour les 195 États parties à la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire la nouvelle feuille de route mondiale pour enrayer le déclin de la biodiversité.
Nous avons entendu en novembre dernier Sylvie Lemmet, ambassadrice déléguée chargée de l'environnement, qui nous a dressé un panorama complet des enjeux et des difficultés géopolitiques et sanitaires préalables à la COP15, en mettant l'accent sur la diversité des attentes et des ambitions des pays membres de la Convention sur la diversité biologique, au nombre de 195, auxquels s'ajoute l'Union européenne, le grand absent étant les États-Unis. Au cours de son audition organisée il y a deux semaines, Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, a présenté le bilan de la COP15 du point de vue du Gouvernement, au regard des ambitions défendues par la France et des stratégies de diplomatie environnementale de notre pays. La conclusion d'un accord ambitieux n'était pas écrite d'avance, mais le rôle moteur de la présidence chinoise, les efforts conjoints du Canada, pays organisateur, et de quelques autres États, dont la France, ont permis l'adoption d'un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité. Le crédit de notre pays dans les enceintes multilatérales me paraît renforcé à l'issue de cette séquence ; la France a joué un rôle moteur et fédérateur, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Nous avons constaté une forte mobilisation gouvernementale et parlementaire de notre pays, puisqu'il y avait de nombreux ministres et une délégation de chaque chambre. Reste maintenant à renforcer notre crédibilité, en déclinant de manière exemplaire le cadre mondial et les 23 cibles adoptées à Montréal au sein de ses politiques environnementales.
Je vais désormais vous présenter mon analyse de l'accord, des dynamiques catalysées dans l'accord de Kunming à Montréal et des points de vigilance pour que ce cadre ne soit pas un accord de papier et que cet accord fasse l'objet d'une véritable déclinaison au travers des plans et des stratégies nationales en faveur de la biodiversité. Je mettrai l'accent particulièrement sur les enjeux pour la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, en cours d'élaboration par le Gouvernement, qui devrait être présentée en mars prochain.
Une délégation de la commission, composée de Denise Saint-Pé, de Jean-Michel Houllegatte et de moi-même, s'est rendue pendant trois jours, du 11 au 14 décembre, au Palais des congrès de Montréal, où avaient lieu les négociations et les évènements annexes. Nous y avons retrouvé notre collègue Ronan Dantec, présent avec son organisation.
Diverses rencontres nous ont permis de mieux comprendre les dynamiques et les forces en présence : nos échanges avec une sénatrice canadienne, une représentante allemande du Bundesamt für Natur - équivalent de l'Office français de la biodiversité -, des organisations non gouvernementales (ONG) canadiennes, l'équipe de négociateurs des ministres Béchu et Couillard, le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et le directeur général de l'OFB ont été riches et fructueux. Le temps de notre séjour canadien, nous avons vécu à l'heure de la COP biodiversité, en suivant au jour le jour l'avancée des négociations, les points bloquants, les retournements de situation. Je salue à ce propos l'opiniâtreté des négociateurs et leur volonté d'aboutir.
Le premier constat qui s'impose aux participants à la COP15, c'est l'effervescence des échanges, même si elle est moindre qu'aux COP climat. Le Palais des congrès bruissait de rencontres et d'évènements, la dynamique en faveur de la biodiversité était perceptible, avec une société civile présente et des ONG mobilisées.
La dynamique en faveur de la biodiversité ne va pas de soi, elle est le fruit d'un patient travail de diplomatie environnementale. Depuis la prise de conscience fondatrice du sommet de la Terre à Rio, en 1992 et l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, l'ambition multilatérale en faveur de la biodiversité n'est pas parvenue à enrayer le déclin préoccupant du vivant.
J'y vois trois raisons principales.
D'abord, la biodiversité a longtemps été éclipsée par le climat : l'urgence à agir dans ce domaine, pourtant à l'origine de toute forme de vie, n'a jusqu'à récemment pas été ressentie avec la même acuité. La prise de conscience de la nécessaire convergence de l'action en faveur du climat et de la biodiversité est récente. Chaque fois que l'on recrée de la biodiversité, on apporte une solution au changement climatique, car des boucles de rétroaction existent entre le changement climatique et l'extinction de la biodiversité : la hausse des températures a globalement un effet négatif sur la biodiversité et les écosystèmes et le mauvais état des écosystèmes terrestres, forestiers et océaniques réduit leur capacité à freiner les effets du changement climatique.
Ensuite, la communauté scientifique n'a pas été en mesure d'élaborer un indicateur pour favoriser la prise de conscience des menaces pesant sur la biodiversité : du point de vue de l'expérience humaine, le déclin de la biodiversité est invisible et silencieux, il ne peut s'appréhender que de manière médiate, à travers des indicateurs. Contrairement au réchauffement du climat, dont la prise de conscience est facilitée par la hausse des températures, désormais perceptible par tous, et par l'indicateur « tonne équivalent carbone », l'érosion de la biodiversité, plus difficile à appréhender, est systématiquement sous-estimée, alors qu'elle est essentielle pour le bien-être de l'homme, la santé de la planète et la prospérité économique. Les États ont en outre été impuissants à valoriser les externalités naturelles positives.
Enfin, la biodiversité a longtemps constitué le parent pauvre des politiques publiques : si la prise de conscience législative des enjeux de la protection de la nature et de la biodiversité date d'il y a presque cinquante ans, l'action publique et les résultats obtenus restent largement perfectibles. Les effets des politiques environnementales sont parfois amoindris par les arbitrages et les conciliations qui sont au fondement même des politiques publiques. La poursuite simultanée des objectifs économiques, sociaux et environnementaux n'est pas chose aisée.
Avant le cadre élaboré à Montréal, la COP10, qui s'est tenue à Nagoya au Japon en 2010, avait déjà construit un cadre mondial ambitieux, articulé autour des 20 objectifs d'Aichi, afin de guider les efforts internationaux et nationaux de lutte contre la perte de biodiversité. Mais aucun de ces objectifs n'a été atteint. Cet échec était prévisible : la feuille de route était irréaliste, les indicateurs extrêmement ambitieux et non chiffrés, aucun mécanisme de suivi n'avait été prévu et le cadre était difficilement transposable par les États. La dynamique en faveur de la biodiversité s'est corrodée, les moyens financiers ont été insuffisants et l'action des États n'a pas été suffisamment volontariste. Les négociateurs avaient oublié que les engagements de ce type ne sont que des promesses qui doivent être régulièrement rappelées aux États qui les font...
Toutefois, même si l'on peut parler de « décennie perdue », cet échec n'aura pas été vain, car il a permis d'initier une démarche d'évaluation, afin de dégager des axes d'amélioration, les erreurs à ne pas commettre et les lacunes du cadre mondial antérieur. La COP15 bénéficiait ainsi d'un retour d'expérience, faisant office de guide méthodologique.
La COP15 s'est inscrite dans cette volonté d'amélioration. Le contexte sanitaire en a compliqué l'organisation, qui a pris deux années de retard : le cadre décennal doit être mis en oeuvre en huit ans, ce qui renforce le défi qui se présente aux États et aux acteurs de la protection de la biodiversité.
L'accord de Kunming à Montréal s'appuie sur une indéniable ambition, en visant un élan transformateur en faveur de la biodiversité. Son adoption a été largement saluée, les 23 cibles s'articulent autour des principaux facteurs d'érosion de la biodiversité et un cadre de suivi a été élaboré pour un pilotage plus fin des trajectoires. Le cadre s'appuie sur une vision pour 2050, pour parvenir à un monde de vie en harmonie avec la nature avec quatre grands objectifs : l'augmentation surfacique des écosystèmes naturels, la gestion et l'utilisation durables de la biodiversité avec la restauration des écosystèmes, le partage des avantages découlant des ressources génétiques et la mobilisation de moyens financiers et humains de mise en oeuvre adéquats.
Le cadre pour 2030 ambitionne quant à lui de mettre fin à la perte de biodiversité au travers de 23 cibles mondiales, dont les plus emblématiques consistent en la protection de 30 % des terres et des mers et la protection des écosystèmes - cibles 2 et 3 -, la diminution du taux et du risque d'extinction des espèces - cible 4 -, la réduction de moitié du risque global lié aux pesticides et la réduction de la pollution plastique - cible 7 -, l'augmentation des pratiques agroécologiques - cible 10 -, l'augmentation des flux financiers en faveur de la biodiversité avec au moins 20 milliards de dollars par an de financement Nord-Sud d'ici à 2025 et au moins 30 milliards d'ici à 2030, tout en réformant les subventions néfastes à la biodiversité ainsi qu'une incitation pour les entreprises de faire connaître leurs impacts et leurs dépendances en matière de biodiversité - cibles 18 et 19.
Au regard des ambitions défendues par la France, l'accord de Kunming à Montréal constitue un indéniable succès. Les regrets sont relativement limités du côté de la secrétaire d'État : l'absence de cibles chiffrées d'ici à 2050, les insuffisances du cadre pour protéger les espèces menacées, le versement des financements internationaux pour la biodiversité via le fonds pour l'environnement mondial et non un fonds spécifique. Mais ce ne sont que des motifs mineurs, le cadre offrant une armature robuste pour l'action internationale en faveur de la biodiversité.
Ce cadre appelle néanmoins de ma part trois points de vigilance principaux.
En premier lieu, son succès dépendra du bon vouloir des États : la logique de mise en oeuvre du cadre repose sur la subsidiarité, décentralisée au niveau national, ce qui donne aux États le choix des instruments et des moyens d'action, mais complexifie les mécanismes d'évaluation et de mise en oeuvre du cadre. L'accord est en effet non contraignant ; il suppose par conséquent des mécanismes de responsabilité et de transparence. Car si l'action des États ne s'approche pas suffisamment des cibles, le cadre ne prévoit pas de mécanisme spécifique pour rectifier les trajectoires et rehausser les ambitions. Le mécanisme de suivi prévu, fondé sur des indicateurs, permet d'évaluer les progrès et les correctifs à apporter, mais avec des délais incompressibles de déclinaison nationale.
En second lieu, le succès de l'accord dépend aussi des moyens financiers et humains consacrés à la biodiversité : cette problématique a constitué un axe fort des négociations, tant l'enjeu est majeur. D'importants moyens financiers sont en effet essentiels pour la bonne gestion des aires protégées, la restauration de la nature et le bon fonctionnement des écosystèmes, les plans d'actions pour protéger les espèces menacées, le renforcement de la protection judiciaire de l'environnement et des moyens de contrôle des atteintes à la biodiversité, le soutien aux transformations agricoles, la mise en oeuvre de nouvelles normes comptables, les plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la solidarité internationale en faveur des pays en développement, etc. ; l'inventaire pourrait être encore plus long... À cela s'ajoute la nécessité de mieux orienter les dépenses publiques en faveur de la biodiversité. Selon l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), à l'échelle mondiale, les pouvoirs publics consacrent environ 500 milliards de dollars par an à des actions de soutien susceptibles de nuire à la biodiversité, soit cinq à six fois plus que la totalité des dépenses en sa faveur. L'enjeu est de taille...
En troisième lieu, le succès du cadre dépendra enfin de la cohérence des politiques publiques : il me paraît nécessaire de veiller à ce que les effets des politiques environnementales ne soient pas neutralisés par des politiques agricoles, industrielles ou économiques qui nuisent à la biodiversité. « La biodiversité dans toutes les politiques » ne doit pas être une formule creuse mais un principe d'action publique, dès la conception des politiques publiques. Si le cadre d'action des États n'est pas cohérent, complémentaire et coopératif, l'accord de Montréal connaîtra le même sort que les objectifs d'Aichi.
En définitive, l'accord de Kunming à Montréal me paraît constituer un ensemble de possibles, un cap et une boussole dont les États doivent s'emparer, dans le cadre d'une mise en oeuvre qui tient compte des enjeux institutionnels, économiques et sociaux propres à chaque État. Le succès dépendra également de l'accompagnement scientifique et de l'évaluation des mesures en faveur de la biodiversité, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien ; le défi de la transmission de la connaissance est donc un enjeu important. Ce nouveau cadre mondial fournit l'ensemble des outils, des approches et des indicateurs pour inverser les courbes en matière de biodiversité, mais il ne sera véritablement transformateur que si les États le font vivre, à travers leurs politiques publiques, leurs financements et en veillant aux incidences environnementales de chaque décision. Il faudra une mobilisation de l'État et des collectivités territoriales, car la biodiversité est un pari mutuel que nous devons collectivement gagner, parlementaires, élus locaux et ensemble des citoyens.

Ce déplacement nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des « boîtes noires » que sont les COP et les liens qu'entretiennent les acteurs institutionnels avec les ONG. Le fonds vert comporte des mesures d'accompagnement de la stratégie nationale de la biodiversité, avec la protection des espèces, la conservation et la restauration des espèces menacées, la lutte contre les espèces exotiques et la pollution plastique ou encore les restaurations écologiques. Ce fonds comporte un volet important d'accompagnement de la biodiversité. Les collectivités doivent donc s'en saisir, dans la dynamique de la COP15, car les actions locales seront déterminantes.

J'étais présent pour mon ONG Climate Chance, qui présentait une initiative mondiale.
Cette COP a intégré plus clairement la question de l'effondrement de la biodiversité au sein de l'« agenda » international comme une vraie priorité. C'est un peu le pendant du sommet de Copenhague pour la biodiversité, mais avec un résultat plus positif, car la biodiversité restera « en haut de l'agenda ». On n'a tenu aucun des objectifs d'Aichi, donc rien ne dit que l'on tiendra ces objectifs, qui sont ambitieux. C'est une petite COP par rapport aux COP climat, c'est un petit monde, dans lequel les ONG de protection de l'environnement occupent une place importante. La France est un État moteur : elle a envoyé quatre ministres ! Cela crée une dynamique.
Sur les financements entre Nord et Sud, attendons de voir. Il faudra vérifier qui paie, comme l'a dit Bérangère Couillard...
Je souhaite enfin partager mon sentiment à la suite d'un échange extrêmement intéressant avec les ONG environnementales québécoises. Les choses fonctionnent différemment au Québec. Ici, nous sommes dans l'affrontement ; là-bas, la priorité est à la recherche permanente du compromis. Les ONG ne sont pas moins ambitieuses ni moins actives que les nôtres, mais le Gouvernement fédéral paie des ONG pour trouver des médiateurs et des compromis. C'est comme si Laurent Wauquiez, par exemple, payait Greenpeace pour trouver des compromis. Et ils trouvent de vrais compromis ! Cela m'a beaucoup plu.

La culture du compromis et du consensus en France pourrait faire l'objet de longs développements philosophiques...
La commission adopte à l'unanimité le rapport d'information ainsi que ses recommandations et en autorise la publication.

Le Président de la République propose M. Marc Papinutti, actuel directeur de cabinet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pour occuper le poste de président de l'Autorité de régulation des transports (ART). Nous attendions cette désignation depuis l'arrivée à expiration du mandat de Bernard Roman, le 1er août dernier. Je tiens à cet égard à saluer la qualité de nos échanges avec ce dernier, qui s'est attaché à défendre le rôle du régulateur au long de son mandat ; il a été pour nous interlocuteur de grande qualité. Actuellement, notre ancien collègue Philippe Richert exerce ces fonctions par intérim.
L'audition de M. Papinutti pourrait être envisagée le 1er mars prochain, ce qui nécessite de désigner le rapporteur chargé de conduire cette audition.
J'ai reçu pour cela la candidature de M. Philippe Tabarot.
La commission désigne M. Philippe Tabarot rapporteur sur la proposition de nomination, par le Président de la République, de M. Marc Papinutti aux fonctions de président de l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article 13 de la Constitution.
La réunion est close à 12 h 30.