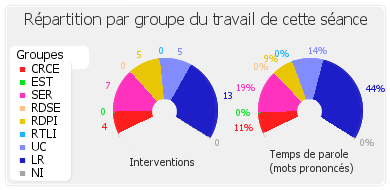Séance en hémicycle du 8 juillet 2014 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Défense de la langue française et conditions d'un développement harmonieux de la diversité linguistique (voir le dossier)
- Élus locaux et périmètres des espaces territoriaux de solidarité et de réciprocité (voir le dossier)
- Commission mixte paritaire (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Jean-Paul Fournier, auteur de la question n° 817, adressée à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Madame la ministre, ma question concerne les conséquences immédiates de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, dont l’application s’est imposée aux communes dès le jour de sa promulgation, entre les deux tours des élections municipales.
Je parle de « conséquences », mais il serait plus précis de parler de « préjudices », tant l’incidence de certaines des dispositions de ce texte est potentiellement dévastatrice en matière à la fois d’harmonie urbaine et d’environnement.
L’entrée en vigueur sans délai de cette loi n’a pas laissé le temps aux communes de procéder aux aménagements de la réglementation locale propres à amortir les effets de la suppression du COS, le coefficient d’occupation des sols, et des surfaces minimales pour la constructibilité.
De nombreuses communes, notamment de l’arc méditerranéen, situées entre plaine littorale inondable et reliefs, souvent adossées à des massifs de garrigues ou de forêts méditerranéennes, qui représentent les seules parties de leur territoire non submersibles, parvenaient à gérer leurs sols par un fin équilibre entre urbanisation et respect des identités paysagères locales. Les règles locales d’urbanisme posant des surfaces minimales importantes pour la constructibilité permettaient cet équilibre.
La suppression brutale de ces surfaces minimales, combinée à la suppression tout aussi soudaine du COS, a eu pour effet immédiat une accumulation de demandes d’autorisations de construire assorties de divisions parcellaires qui sont venues encombrer nos services d’urbanisme.
S’il ne peut être rejeté ou suspendu à l’issue de l’instruction, à défaut de bases juridiques, cet afflux de demandes ouvre des perspectives immédiates de défiguration totale des identités paysagères et urbanistiques de nos communes.
La typicité de l’urbanisme méditerranéen, qui est aussi une richesse nationale en termes d’économie touristique, se trouve donc mise à mal. Et je n’évoque pas ici les conséquences en termes de dessertes et de réseaux pour satisfaire aux besoins engendrés par cette densification imposée.
Il est regrettable que l’environnement, le logement et l’urbanisme ne soient pensés que selon les problématiques franciliennes, qui sont à mille lieues de nos contraintes…
En conséquence, madame la ministre, je vous demande de m’indiquer de quels moyens disposent les autorités communales pour remédier sans délai à cette situation catastrophique, sans aller jusqu’au gel global et définitif de la constructibilité dans ces seules parties du territoire qui la permettent.
Monsieur le sénateur, vous avez évoqué la question de la limitation de l’étalement urbain. Vous le savez bien, la doctrine de l’État en la matière est constante depuis quatorze ans.
Tout d’abord, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a supprimé les anciennes zones NB présentes dans les POS, les plans d’occupation des sols, au motif que ces zones permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels.
Cet ancien zonage, notamment utilisé dans les POS du sud-est de la France, a pu contribuer à banaliser les paysages naturels, d’une grande beauté, pour laisser s’y construire des maisons individuelles sur de grandes parcelles, contribuant ainsi à l’étalement urbain, à la dévitalisation des centres-bourgs et à la fragilisation des équilibres environnementaux de ces espaces.
Malgré la loi SRU, certaines communes ont choisi de laisser perdurer ce type de zones en les classant en zone U lors de la transformation du POS en plan local d’urbanisme, ou PLU, mais les caractéristiques sont restées les mêmes : celles de zones peu équipées, sans composition d’ensemble et avec comme éléments essentiels de régulation de l’occupation du sol une taille minimale de parcelle élevée et un coefficient d’occupation des sols très faible.
La loi ALUR, en supprimant le COS et la taille minimale des terrains, s’inscrit dans la continuité de la loi SRU, en tirant les conséquences de la mauvaise interprétation, sur certaines parties du territoire national, des principes posés par la loi.
Les élus concernés par cette situation doivent donc en premier lieu s’attacher au plus vite à régler au fond la question de ces ex-zones NB et à se doter d’un PLU répondant aux exigences de la loi et aux impératifs d’une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l’environnement et des paysages.
Toutefois, le temps que les procédures arrivent à terme, et lorsque les projets sont vraiment contraires aux grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l’étalement urbain, les collectivités territoriales ont la possibilité de les refuser en se fondant sur les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme pour des motifs, entre autres, d’atteinte à l’intérêt des sites et paysages, de sécurité publique – notamment au regard du risque d’incendie – ou de sous-équipement de la zone.

J’entends bien votre réponse, madame la ministre, mais je vous invite à lire, ou à relire, l’étude que John B. Calhoun a publié en 1962 à la suite d’une expérience qu’il avait réalisée sur les conditions de surpeuplement, étude dont l’influence a été telle qu’elle est devenue la pierre angulaire de la sociologie urbaine. Vous vous rendrez alors compte que la loi ALUR est loin de constituer une avancée…

La parole est à M. Yannick Botrel, auteur de la question n° 810, adressée à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Madame la ministre, je veux avant toute chose vous dire l’incompréhension des élus des communes rurales face aux nouvelles dispositions en matière d’urbanisme concernant les hameaux et l’habitat dispersé. Je vous rappelle la situation créée par l’annulation du PLU de Châteauneuf-du-Rhône, qui a eu pour effet de rendre attaquables les plans locaux d’urbanisme au prétexte que les micro-zones ou pastillages des PLU n’avaient pas de fondement réglementaire, bien qu’ils aient été institués jusqu’à cette époque sur la recommandation des services de l’État.
Afin de répondre à l’insécurité juridique dans laquelle se sont alors trouvé plongées un certain nombre de communes, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite loi ENE, en matière de droit du sol, a ouvert la possibilité de créer en 2010 ces micro-zones sous la dénomination de « secteurs de taille et de capacité d’accueil limité », ou STECAL.
Le problème paraissait réglé à la satisfaction générale, jusqu’à l’adoption récente de la loi ALUR, qui a remis en cause ce qui avait été décidé seulement quatre ans plus tôt. Désormais, dans les zones naturelles ou agricoles, ce n’est qu’à titre exceptionnel – et j’insiste sur ce dernier terme – que le règlement du PLU peut délimiter des STECAL. Dans le contexte spécifique de la Bretagne, qui se caractérise par une dispersion de l’habitat, cette nouvelle législation soulève la question du devenir de la plupart des hameaux et des constructions isolées.
Or, cette dispersion de l’habitat est un fait ancien. Ainsi, dans les Côtes-d’Armor, une commune de 7 000 hectares compte 150 écarts – au sens que l’INSEE donne à ce terme – qui, sans aucune exception, figuraient tous sur le cadastre napoléonien de 1840. La situation actuelle est donc issue d’une organisation historique de l’espace, avec des constructions dispersées qui furent à l’origine des fermes, et qui ne le sont plus.
Désormais, en zones agricole ou naturelle, la loi prévoit donc seulement la possibilité d’effectuer un changement de destination ou une extension limitée à des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial qui devront être désignés dans le règlement du PLU. Le dispositif ne peut être utilisé que de manière exceptionnelle et, par conséquent, se pose la question du devenir des autres constructions que celles qui viennent d’être décrites, et qui sont d’ailleurs les plus nombreuses. Ces dernières ne pourront plus faire l’objet que d’adaptations mineures, sans extension possible, même limitée.
Dans ces conditions, l’application de la loi ALUR peut conduire à s’interroger sur le devenir de l’habitat des communes concernées, telles que celles que l’on rencontre en centre Bretagne, dont le maintien de la population passe justement par la valorisation de tout cet habitat.
Enfin, des communes aujourd’hui très avancées dans l’élaboration de leurs futurs documents d’urbanisme – le PLU – voient remis en question le travail, parfois entamé depuis plusieurs années, qu’elles ont effectué à ce sujet.
Cette réflexion a occasionné des dépenses d’argent public et tout autant d’investissement des élus locaux, auxquels on vient aujourd’hui expliquer que le travail qu’ils ont fourni n’a servi à rien et qu’il est à refaire…
Je souhaite donc connaître votre analyse de cette question, madame la ministre, et savoir si vous envisagez des mesures afin de revenir aux dispositions précédemment introduites par la loi ENE.
Monsieur le sénateur Yannick Botrel, vous avez appelé mon attention sur les récents changements concernant les possibilités offertes pour la construction en zone naturelle et agricole, notamment en ce qui concerne la nouvelle écriture de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Comme vous le savez, le code de l’urbanisme porte depuis toujours des objectifs de densification, de lutte contre l’étalement urbain et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les zones naturelles et agricoles sont en principe inconstructibles, ce qui est cohérent avec les ambitions portées par ce code.
Il existe cependant des mécanismes d’exception qui permettent la construction dans ces zones de façon encadrée. Ainsi, la création de secteurs constructibles en zone agricole, naturelle ou forestière est possible, mais elle doit être envisagée de manière exceptionnelle afin d’éviter le mitage des espaces que l’on cherche à protéger de l’urbanisation.
Par ailleurs, l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, ou CDCEA, doit à présent être sollicité quant à la création de tels secteurs lors de l’élaboration des PLU.
Néanmoins, le bâti remarquable – du fait de son architecture ou du patrimoine culturel qu’il représente – peut faire l’objet de changement de destination et même d’extension lorsqu’on se trouve en zone A. Quant au reste des bâtiments à usage d’habitation déjà implantés dans les zones naturelles et agricoles, ils peuvent faire l’objet de réfections et d’adaptations. Mais l’extension et le changement de destination ne sont pas possibles pour ces bâtiments.
Je suis toutefois sensible à vos préoccupations, monsieur le sénateur, et je note les difficultés potentielles que cette impossibilité soulève, difficultés que vous avez largement évoquées dans votre question.
Une réflexion est actuellement menée, conjointement avec le ministère de l’agriculture, dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, afin d’étendre les possibilités offertes aux bâtiments remarquables à l’ensemble des bâtiments existants en zone agricole et naturelle. Ces réflexions permettront d’améliorer la situation que vous avez évoquée dans votre question.

M. Yannick Botrel. Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse ; elle avait plutôt mal commencé, de mon point de vue, mais elle se conclut de façon plus favorable…
Sourires.

En effet, la question n’est pas de consommer des terres agricoles pour le plaisir – d'ailleurs, tout le monde s’accorde pour dire qu’il ne faut pas s'orienter dans cette direction.
Mais, dès lors que, dans un village, des habitations existent et que l’on parle d’extension limitée, de quarante mètres carrés – surface que les PLU prévoyaient généralement–, on ne peut véritablement parler de consommation de terres agricoles.
Quant au mitage, je l’ai expliqué, c'est un fait que je n’accepte pas pour la Bretagne ; nous sommes parvenus à un degré de dispersion de l’habitat historique, et il ne faudrait pas l’accroître.
Mais j’en reviens à votre conclusion, dont je pense qu’elle ouvre des possibilités si, du moins, elle est suivie d’effets.

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 815, adressée à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Madame la ministre, chers collègues de la Bretagne, je vais vous ramener en région parisienne, en évoquant une opération d’urbanisme tout à fait impressionnante qui se déroule actuellement dans la ville d’Ivry. En effet, le tiers de la commune – près de 145 hectares – est concernée par cette affaire et de très nombreuses personnes, dont je me fais ici l’interprète, souhaitent vous faire part de leur inquiétude et de leur désarroi.
Il s'agit d’une zone d’aménagement concerté, ou ZAC, lancée par la ville d’Ivry ; elle a démarré en 2011 avec les procédures habituelles. Dans un premier temps, avant de construire plus de 6 000 logements, cette ZAC visait à faire disparaitre par voie d’expropriation un nombre tout à fait considérable de logements qui sont actuellement occupés.
Ce projet, appelé « Ivry Confluences », représente, je l’ai dit, un tiers de la ville et concerne d'ores et déjà plus de 400 familles – c'est-à-dire 1 500 personnes au total –, des entreprises et des commerces de proximité.
Au cours de la procédure, le commissaire enquêteur, lorsqu’il s'est penché sur ce dossier, a notamment insisté sur la nécessité d’envisager le relogement et l’indemnisation équitable des habitants concernés, ce qui est somme toute assez logique.
Or, à ce jour, malgré un semblant de concertation, la population concernée par cette opération est laissée dans l’incertitude. Elle n’a reçu aucun élément précis sur ce projet, ce qui entraîne, vous le comprendrez, beaucoup d’inquiétude et de désarroi au moment même où la procédure va bientôt conduire à la signature des arrêtés de cessibilité au bénéfice de la SADEV 94, organisme aménageur choisi par la ville.
L’objet de ma question, madame la ministre, n’est bien évidemment pas de remettre en cause l’opportunité de cette opération d’urbanisme, car cette responsabilité relève des élus municipaux et des organismes aménageurs associés. Toutefois, on peut s’interroger sur le gigantisme d’une telle opération, laquelle va entraîner la disparition de nombreuses habitations à un moment où la crise du logement pose de véritables problèmes.
En revanche, je souhaite évoquer l’information des personnes intéressées et les conditions d’indemnisation des propriétaires de pavillons, d’appartements, de commerces et d’entreprises concernés.
Les informations que j’ai recueillies montrent que la mairie et, surtout, l’organisme aménageur ne font manifestement pas les efforts nécessaires pour informer la population de manière précise sur leurs intentions, sur le calendrier et sur les conditions d’indemnisation des expulsions : les futurs expropriés ne sont pas tous prévenus en même temps, le tracé précis de la zone concernée est constamment modifié…
La conséquence, c’est que les intéressés ne savent pas tous ce qui va leur arriver. Quant aux quelques personnes qui ont reçu des propositions, elles contestent bien évidemment le montant des indemnités d’expropriation.
Les habitants d’Ivry se sont rassemblés en collectif contre ce programme de rénovation urbaine. Certains d’entre eux sont présents dans les tribunes ce matin : ils ont tenu à venir vous entendre, madame la ministre, pour vous montrer leur désarroi.
Le collectif « Ivry sans toi(t) » nous signalait encore récemment que des propriétaires modestes – j’insiste sur ce point – ont dû céder leur appartement sur la base de 2 000 euros le mètre carré, alors que le prix moyen dans cette commune, comme dans les communes limitrophes, oscille entre 4 000 et 5 000 euros le mètre carré !
Madame la ministre, peut-on, en 2014, conduire des opérations selon cette méthode ? Nous sommes ici un certain nombre d’élus, de maires qui ont bien l’habitude de ce genre de choses. S’il est tout à fait possible, et même souhaitable, de conduire des opérations d’urbanisme, il faut le faire dans le respect des habitants. En l’espèce, les règles en matière tant d’information que d’indemnisation ne sont manifestement pas appliquées.
Quelles mesures le Gouvernement peut-il prendre pour que les autorités départementales de l’État veillent au respect de la procédure afin que ces femmes et ces hommes, qui expriment depuis longtemps leurs difficultés et leur désarroi, puissent à la fois connaître le véritable but – les limites – de cette opération et se voir appliquer les meilleures conditions d’indemnisation auxquelles ils ont naturellement droit ?
Monsieur le sénateur Christian Cambon, la zone d’aménagement concerté d’Ivry Confluences dont vous parlez, située au sein du périmètre de l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont, revêt un enjeu très fort de développement dans le Val-de-Marne, à travers la restructuration d’un quartier de 145 hectares, essentiellement composé de friches industrielles figées depuis des décennies, pour répondre à un très important besoin en logements dans le secteur.
L’enjeu est de développer dans ce quartier géographiquement contraint, entre fleuve et voies ferrées, un projet mixte et équilibré.
Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur, sur l’opportunité d’une telle opération. La construction de plus de 5 000 logements dans cette ZAC répond à un besoin fortement exprimé par le Gouvernement dans une ville qui jouxte Paris et dont les atouts de desserte sont réels.
Une attention particulière est portée au programme résidentiel, qui prévoit une part substantielle de logements sociaux, ainsi qu’au phasage de sa réalisation, afin de ne pas compromettre les objectifs de mixité sociale définis dans le programme local de l’habitat, ou PLH.
Monsieur le sénateur, pour répondre aux craintes que vous exprimez quant à l’information et au relogement des populations qui habitaient ce secteur, je tiens à vous préciser que l’ensemble des aspects programmation et relogement ont fait l’objet d’efforts particuliers de concertation et de communication de la part tant de la ville que de l’aménageur.
En outre, concernant le relogement ou la relocalisation des populations existantes, la ville d’Ivry-sur-Seine et l’aménageur ont mis en place une maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale pour le relogement des propriétaires occupants et des locataires.
Plus précisément, cette action s’est traduite par le réinvestissement de quatorze propriétaires-occupants dans des opérations neuves construites sur la ZAC ; huit dossiers sont en cours d’instruction. De plus, le relogement de vingt-deux locataires chez les bailleurs sociaux présents sur ce territoire a déjà été assuré.
Il convient aussi de noter que les expropriations dans la ZAC sont phasées afin de permettre aux personnes faisant l’objet d’un relogement de bénéficier en partie des programmes en cours de construction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, je confirme que l’intérêt des populations et des entreprises locales est bien pris en compte et que le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des habitants et aux préoccupations légitimes de ces derniers. Nous continuerons à suivre particulièrement ce dossier.

Madame la ministre, je note un point positif dans votre réponse, puisque vous réaffirmez l’intérêt du Gouvernement et soulignez l’attention qu’il va porter au déroulement de cette opération.
Néanmoins, je ne peux que rappeler à nouveau la réalité vécue sur le terrain : les gens ne disposent pas du niveau d’information que vos services vous ont rapporté.
Ce que je souhaite, c’est que l’État, par l’intermédiaire du préfet, rappelle à l’organisme aménageur les règles très précises en matière d’information.
Par ailleurs, vous n’avez pas abordé le problème de l’indemnisation en matière immobilière. Il est absolument impossible, pour ne pas dire scandaleux, que l’on propose une indemnisation de 2 000 euros le mètre carré quand les prix sont parfois de deux à trois fois supérieurs. Là aussi, le Gouvernement, qui met en avant des préoccupations sociales tout à fait légitimes, doit faire en sorte que ces mêmes préoccupations prennent corps sur le terrain. Les personnes concernées sont non pas des opposants, contrairement à ce que certains prétendent, mais simplement des gens modestes, qui veulent faire valoir leur intérêt et protéger le patrimoine que constituent ces petites propriétés
Je compte donc sur vous, madame la ministre. Croyez-moi, nous serons très vigilants. Nous continuerons à observer cette opération avec attention et à être aux côtés des populations, qui ne se sentent pas toujours comprises.

La parole est à M. André Gattolin, auteur de la question n° 806, adressée à M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Ma question porte sur la situation de l’activité postale dans le département des Hauts-de-Seine.
Depuis le 29 janvier dernier, soit depuis près de six mois, des postiers du département des Hauts-de-Seine sont en grève. À l’origine, ce mouvement était axé sur le non-renouvellement du contrat d’insertion d’une factrice. Depuis, son objet est devenu plus global : il porte désormais sur la précarisation des facteurs.
Les revendications actuelles des grévistes sont les suivantes : versement d’une prime de vie chère, fin des emplois précaires et des tâches supplémentaires et arrêt des réorganisations aboutissant à la suppression d’emplois.
Le nombre de facteurs en grève est estimé à une centaine. Même si la direction de La Poste estime que ce mouvement est « ultraminoritaire », cette grève a néanmoins des conséquences importantes tant sur la vie personnelle des personnels en grève que sur la distribution du courrier – et donc sur la vie des citoyens et des entreprises – puisque, selon les grévistes, il y aurait des milliers de plis en attente d’être distribués.
Le contrat d’entreprise 2013-2017, signé le 1er juillet 2013 entre l’État et La Poste, précise les engagements en matière de responsabilité sociale de l’entreprise. Y sont mentionnées les attentes des salariés de La Poste à l’égard de leur entreprise. Ces derniers ont exprimé « une demande de sens et de dialogue sur l’évolution de leur entreprise et de leur travail » ; ils sont également « en attente d’un management de proximité attentif ».
De même, La Poste a signé un accord-cadre avec quatre organisations syndicales couvrant l’ensemble du champ de la relation sociale.
Aussi, au regard de l’importance de ces documents et du rôle d’actionnaire de l’État au sein du groupe La Poste, je vous demande, madame la secrétaire d’État, de m’indiquer quelles mesures vous comptez prendre pour qu’une sortie de conflit acceptable pour tous puisse être obtenue au plus vite.
Monsieur le sénateur André Gattolin, les volumes du courrier ont baissé de 22 % entre 2008 et 2013.
Le contrat d’entreprise 2013-2017 a permis de confirmer l’attachement de l’État et de l’entreprise à ces missions et à la qualité de la mise en œuvre du service universel postal.
Le Gouvernement est bien sûr attentif à la préservation de la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise. Ainsi, à la demande d’Arnaud Montebourg, ministre chargé des postes, le contrat d’entreprise 2013-2017 comprend un volet portant sur les engagements citoyens de La Poste, tout particulièrement dans le domaine de la responsabilité sociale.
Lors de l’adoption, en janvier dernier, du plan stratégique 2014-2020, le président-directeur général a annoncé la mise en négociation d’un « pacte social », appelé à prendre le relais de l’accord-cadre de janvier 2013 sur la qualité de vie au travail, sur la mise en œuvre des mesures d’effet immédiat, telles que l’embauche de 15 000 personnes en CDI – pour lutter contre la précarité – et sur l’amélioration de la concertation sociale avant les réorganisations.
L’État veillera bien entendu à ce que les conclusions du pacte social soient adaptées aux besoins des activités de l’entreprise et à ses missions de service public.
S’agissant plus particulièrement de la situation de l’activité postale et sociale dans les Hauts-de-Seine, le mouvement social, qui a débuté le 29 janvier dernier, a mobilisé environ 70 grévistes par jour sur un total de de 7 000 postiers travaillant dans les Hauts-de-Seine.
Depuis le début du conflit, le dialogue social est continu et les représentants SUD Poste 92, qui ont été les seuls à appeler à la grève, ont été reçus en audience par la direction du courrier des Hauts-de-Seine.
Après de nombreuses audiences, près de douze propositions de protocole de sortie de conflit ont été formulées par La Poste. Malheureusement, aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une signature de la part des représentants de SUD Poste 92. De ce fait, les mesures proposées ne peuvent être engagées.
Enfin, certaines demandes du syndicat SUD Poste 92, telles que la mise en œuvre différée de la réorganisation de l’établissement de Rueil, non réorganisé depuis quinze ans, sont susceptibles d’avoir des conséquences très délicates en termes de créations futures d’emplois. Elles vont en effet à l’encontre des orientations stratégiques de La Poste, dans un contexte de mutation.
Dans ces conditions, les projets d’adaptation sont absolument nécessaires afin d’offrir un avenir durable à tous les postiers.
C’est la raison pour laquelle l’État engage La Poste à poursuivre le dialogue avec l’ensemble des organisations syndicales, afin non seulement de trouver une issue au conflit dans l’intérêt commun des clients et des postiers, mais aussi de réaliser la nécessaire adaptation de ses missions.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État.
« Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ». C’est là un principe de bon sens. Certes, d’aucuns trouveront peut-être bizarre qu’un écologiste cite Maurice Thorez…
Sourires.

Je suis d’accord avec vous, certaines demandes des grévistes peuvent paraître extrêmes par rapport à la nécessaire réorganisation de la distribution du courrier, due à l’érosion du volume traité par La Poste.
Cependant, il nous faut trouver un moyen de sortir d’un conflit qui dure depuis plus de 160 jours et qui a cristallisé bien des peurs, en faisant en sorte que personne ne perde totalement la face.
Le changement se gère par le dialogue et non par la prise de sanctions disciplinaires.
La réflexion menée dans d’autres départements autour du concept de « facteur de demain », devant faire preuve de polyvalence, peut constituer une piste. Après avoir été testée en Seine-et-Marne, cette expérimentation ne pourrait-elle pas se développer dans les Hauts-de-Seine ?
Vous avez raison, le point de cristallisation majeur est la disparition ou la suppression d’emplois. Visiblement, les syndicats, même le plus impliqué dans cette affaire, préfèrent une polyvalence des tâches à des suppressions de poste.
Peut-être s’agit-il d’une piste à suivre afin de sortir de ce conflit ? Les habitants de Rueil-Malmaison, ville que vous avez citée, mais aussi ceux de Courbevoie ou de la Garenne-Colombe ont le droit de recevoir leur courrier tous les jours et non deux fois par semaine, comme c’est le cas actuellement.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, auteur de la question n° 818, adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Ma question porte sur un sujet assez technique et je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de vous faire le porte-parole des services de Bercy pour y répondre.
Le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, a été mis en place dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Certaines communes y cotisent, d’autres reçoivent ses versements.
Un problème très précis se pose pour les communes qui, depuis la réforme de 2010, ont intégré une intercommunalité. La cotisation au FNGIR étant figée au niveau établi pour l’année 2010, ces communes se voient privées d’une partie de leurs ressources, ce qui les place dans une grande difficulté. J’en ai même recensé certaines, au-delà de mon seul département, qui sont placées sous surveillance par la chambre régionale des comptes dont elles dépendent.
Un second problème avait été relevé par Roland Ries l’année dernière. Lors d’une séance de questions orales au Gouvernement, il avait posé à ce propos une excellente question, que je me permets de citer. Notre collègue affirmait alors : « La part départementale de la taxe d’habitation […] a été transférée du département au bloc communal. […] En revanche, les communes isolées ne faisant pas encore partie d’un EPCI à cette date percevaient alors l’intégralité du taux départemental de la taxe d’habitation et subissaient, parallèlement, un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR. Par la suite, l’adhésion de ces communes isolées à un EPCI […] n’a pas été accompagnée d’une révision du mécanisme de compensation de la réforme des finances locales […]. Dès lors, les habitants […] sont contraints de supporter deux fois la part départementale de la taxe d’habitation. En effet, le taux de la taxe d’habitation appliqué à ces contribuables se décompose en un taux communal, qui inclut la totalité du taux départemental, et un taux intercommunal, qui inclut une fraction du taux départemental. »
Roland Ries avait reçu une réponse extrêmement aimable de la part de la secrétaire d’État chargée de la décentralisation, qui représentait le ministre en charge de ces questions ; mais le problème n’est cependant toujours pas réglé. Or voilà plusieurs années que ce mécanisme a été mis en place, et les difficultés qu’il pose place ces communes – souvent de petite taille, parfois de taille moyenne – dans une situation impossible à gérer.
J’attends donc avec beaucoup d’intérêt votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu appeler l’attention du ministre des finances et des comptes publics sur la situation des communes qui, comme la loi le leur permet, ont choisi de réduire leur taux de la taxe d’habitation sans diminuer dans la même proportion leur taux de cotisation foncière des entreprises, lors de leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité additionnelle.
Vous regrettez que ces communes continuent, le cas échéant, de supporter un prélèvement identique au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.
Les garanties de ressources mises en place dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, consécutive à la suppression de la taxe professionnelle, ont eu pour objet d’assurer aux collectivités territoriales un niveau de ressources après réforme assez proche de celui qui la précédait.
S’agissant plus particulièrement du FNGIR, les prélèvements et les reversements s’établissent de façon que, au sein d’une même catégorie de collectivités, la somme des reversements soit égale à la somme des prélèvements. Il ne serait donc pas justifié que la politique de taux des communes qui choisissent de les diminuer influe sur les ressources des communes bénéficiaires de ce Fonds. Plus généralement, l’ajustement permanent des garanties de ressources serait source d’instabilité pour les collectivités.
Par ailleurs, l’adhésion d’une commune à un EPCI entraîne un transfert de compétences. En conséquence, le besoin de financement de la commune diminue normalement de manière corrélative. L’incidence de cette opération sur les finances communales doit donc être relativisé. Ayant moins de charges à honorer, la fiscalité de ces communes peut être moins élevée, ce qui peut expliquer la baisse du taux de la taxe d’habitation.
Par ailleurs, les communes, à l’occasion de leur rattachement à un EPCI à fiscalité additionnelle, peuvent, conformément à l’article 37 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, mettre le prélèvement au titre du FNGIR à la charge de l’EPCI, avec l’accord de ce dernier, notamment si elles diminuent leur taux de taxe d’habitation.

Je vous remercie pour ces précisions, madame la secrétaire d’État.
Je me permets de compléter la question que je vous ai posée voilà un instant. Les communes ayant adhéré à une intercommunalité à compter de 2010 ne sont pas les seules concernées par ce problème ; les communes ayant fait le choix de diminuer leur taux, parfois membres d’une communauté de communes, le sont aussi.
Cela étant, les deux problèmes évoqués se posent toujours.
Le premier a trait à la double imposition – une « double peine », pour ainsi dire – que cette situation crée, la part départementale étant payée deux fois par les contribuables de ces communes. Je souhaiterais que les services de Bercy s’intéressent avec beaucoup d’attention à ce problème, particulièrement pénalisant pour les contribuables de ces communes.
Le second problème a trait au gel du prélèvement pour le FNGIR. Pour les communes ayant adhéré à une communauté de communes, vous affirmez, madame la secrétaire d’État, qu’il appartiendrait à l’EPCI à fiscalité additionnelle de répartir les sommes concernées.
Le problème, c’est que les fonctionnaires chargés de la gestion de ces dossiers – les représentants de la Direction générale des finances publiques dans nos départements – prétendent que cela n’est pas possible, sauf pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique, ou TPU.
Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.

Je n’ai pas besoin de vous dire, madame la secrétaire d’État, que, entre le point de vue exprimé par un membre du Gouvernement et celui d’un fonctionnaire, j’attache beaucoup plus d’importance au premier ! Vous affirmez – et vos propos figureront au Journal officiel – que c’est possible ; c’est donc une avancée qui justifiait, madame la secrétaire d’État, que nous nous retrouvions au Sénat, après nous être connus à l’Assemblée nationale.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 784, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Avant toute chose, je tiens, madame la garde des sceaux, à vous exprimer mon soutien le plus vif face aux accusations proférées à votre encontre par l’ancien Président de la République, aujourd’hui mis en examen. Je suis convaincu que les propos tenus par l’ancien chef de l’État, remettant en cause, d’une certaine manière, l’indépendance de la justice, sont condamnés, toutes tendances politiques confondues, par la majorité des membres de la Haute Assemblée.

Je souhaite vous interroger sur le financement des associations d’aide aux victimes.
Je tiens à revenir, d’abord, sur l’historique de cette question. En juillet 2012, je vous avais écrit, madame la garde des sceaux, afin de vous interroger sur la situation financière de ces associations et sur les aides consenties par le ministère de la justice. Au mois d’août de la même année, vous m’indiquiez avoir demandé à vos services de procéder à l’examen de ce dossier dans les meilleurs délais. N’ayant reçu aucune réponse depuis lors, je m’adresse directement à vous aujourd’hui.
Les associations d’aide aux victimes sont présentes sur tout le territoire et sont fédérées par l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, l’INAVEM. Vous le savez, leurs actions sont fondamentales pour les victimes ; ces associations assurent une mission tout à fait complémentaire des missions de la police et de la justice. La plupart d’entre elles ont d’ailleurs une permanence dans les commissariats, afin d’apporter une aide psychologique aux victimes d’infractions.
Aujourd’hui, les baisses successives des subventions accordées mettent en péril leur avenir. C’est le cas, en particulier, pour l’association Prévenir et Réparer, compétente dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Mais le problème, vous l’aurez compris, est global. Les missions d’aide, de médiation et d’administration de ces associations sont menacées par le manque de moyens.
Je sais que le Gouvernement a placé la justice au cœur de ses priorités, et je m’en félicite. Le financement des associations d’aide aux victimes en constitue, d’une certaine manière, le bras armé. C’est pourquoi je souhaite savoir, madame la garde des sceaux, quelles mesures vous envisagez de prendre pour leur permettre de continuer à exercer leurs missions d’intérêt général dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, je souhaiterais connaître votre position sur la proposition, pour moi tout à fait pertinente, de l’INAVEM, relative à l’instauration d’une amende pénale infligée aux auteurs d’infractions, dont le produit serait affecté aux associations dont nous parlons. Cette disposition est actuellement en vigueur au Québec et semble y donner satisfaction, notamment parce qu’elle n’affecte pas le budget de l’État.
Si les amendes pénales étaient augmentées de 1, 5 %, les auteurs d’infractions participeraient au financement des services d’information juridique et de soutien psycho-social, qui sont offerts gratuitement aux victimes. Je souhaiterais donc avoir votre point de vue sur cette proposition, madame la garde des sceaux, et vous remercie de l’attention que vous voudrez bien lui apporter.
Monsieur le sénateur, je vous remercie pour vos mots de soutien extrêmement justes, auxquels, au-delà des rangs de la majorité, doivent normalement s’associer tous ceux qui sont soucieux du bon fonctionnement de l’institution judiciaire.
Vous m’interrogez sur la politique du Gouvernement en matière d’aide aux victimes, entre autres actions précises. Tout d’abord, alors que, sous le précédent quinquennat, on a sans arrêt entendu parler des victimes, le budget consacré à ces dernières a baissé pendant quatre années consécutives.
J’ai donc pris la décision, dès notre première année de responsabilité budgétaire, c’est-à-dire pour 2013, d’augmenter de 25, 8 % le budget de l’aide aux victimes. Cette année encore, en 2014, il a connu une hausse de 7 %. Ce budget est donc passé de 10 millions d’euros à notre arrivée au Gouvernement à 13, 8 millions d’euros aujourd’hui.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, j’ai eu le souci d’ouvrir des bureaux d’aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Pour la seule année 2013, cent ont été ouverts ou consolidés, alors qu’il n’en existait que cinquante auparavant. À la fin du premier semestre 2014, notre objectif d’un bureau d’aide aux victimes dans chacun des tribunaux de grande instance sera atteint.
En outre, le Gouvernement s’est engagé sur le quatrième plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans ce cadre, nous avons dédié une enveloppe supplémentaire de 1, 4 million d’euros au soutien aux associations locales intervenant dans l’aide aux victimes. Cette enveloppe a été transmise aux cours d’appel, les chefs de juridiction devant décider de l’attribution de cette dotation aux associations locales, pour subventionner leurs projets.
Ces interventions ne sont pas exclusives d’autres financements ou d’autres instruments de l’État. J’appelle ainsi votre attention sur le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, dont 75 % du budget était consacré à la vidéosurveillance lors de notre arrivée aux responsabilités. Nous avons inversé le ratio, pour favoriser la présence et l’intervention humaines. En 2014, dans le cadre des trois programmes d’actions de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, le FIPD contribuera donc essentiellement au financement des interventions humaines, dont pourront profiter les associations locales.
J’en viens aux charges qui résultent des missions judiciaires confiées à ces associations, comme l’aide aux victimes, la médiation pénale ou l’administration ad hoc. Ces charges relèvent de l’enveloppe dédiée aux frais de justice, dont les tarifs sont déterminés par le code de procédure pénale.
Néanmoins, portant une attention particulière aux victimes, j’ai demandé à l’administration d’être vigilante sur le règlement de ces frais par les régies de juridiction ou par les services administratifs régionaux des cours d’appel.
Par ailleurs, j’ai demandé à l’administration de mettre en œuvre un plan d’actions – il est en place depuis plus d’un an désormais –, afin de faciliter le règlement des frais par le regroupement des missions, la simplification du circuit de dépense et le raccourcissement des délais.
Pour répondre à votre dernière question, j’indique que le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines a institué une majoration de l’amende prononcée par des juridictions répressives.
Enfin, vous indiquez m’avoir écrit, monsieur le sénateur. Si les associations de votre département connaissent des problèmes particuliers, n’hésitez pas à alerter directement l’administration, qui assure une vigilance continue sur ces sujets. Vous pouvez, pour ce faire, passer par l’intermédiaire de mes deux conseillers parlementaires.

Madame la garde des sceaux, je vous remercie de cette réponse très complète.
Vous l’avez souligné, le budget de l’aide aux victimes a augmenté de 25 % alors qu’il avait diminué au cours des années précédentes. Il était, me semble-t-il, utile de le rappeler.
Je salue également la hausse des dotations en faveur des bureaux d’aide aux victimes et la revalorisation, à hauteur de 1, 4 million d’euros, des crédits aux associations.
J’avais eu connaissance d’un amendement déposé quant à un dispositif inspiré de la pratique en vigueur au Québec, qui a fait ses preuves.
Vous nous avez annoncé trois bonnes nouvelles. La première concerne les associations, qui effectuent un travail considérable et jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement de notre justice et, plus généralement, de notre démocratie. La deuxième se rapporte à l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, qui regroupe l’ensemble de ces associations ; c’est un encouragement à leur égard dont je vous remercie, d’autant qu’elles travaillent dans des conditions parfois difficiles. Et la troisième s’adresse directement aux victimes.
Je me permets en conséquence de vous adresser trois remerciements.
Mme la garde des sceaux sourit.

La parole est à M. Éric Bocquet, auteur de la question n° 824, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Madame la ministre, dans quelques semaines, ce sera le vingtième anniversaire de l’adoption de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Chacun s’en souvient, ce texte s’appuyait sur une disposition introduite en 1992 dans la Constitution, à l’article 2 : « La langue de la République est le français. »
Le décret d’application du 3 juillet 1996 a mis en place un dispositif d’enrichissement de la langue française. Ses articles 11 et 12 imposent l’usage des termes en français dans les services et établissements publics de l’État.
Ce vingtième anniversaire peut être l’occasion d’un point d’étape sur la loi de 1994, dont Jacques Toubon, l’un de vos prédécesseurs, avait été à l’origine.
Depuis plusieurs années, chacun peut faire le constat d’une accélération de l’évolution dans l’emploi d’un vocabulaire nouveau, essentiellement d’origine anglo-saxonne. La mondialisation économique et l’essor des nouvelles technologies y ont également grandement contribué.
Le débat n’a donc rien de superficiel ou d’anecdotique. L’évolution de notre langue est aussi le marqueur d’une évolution d’un certain mode de pensée, ce que d’aucuns appellent parfois la « pensée unique », elle-même révélatrice d’un système économique que certains souhaiteraient également unique. Les mots sont bien les outils et les véhicules de l’expression d’une pensée.
L’enjeu n’est donc pas seulement linguistique ou défensif ; il est aussi fondamentalement politique, au sens le plus noble du terme. Il s’agit non pas d’engager une guerre linguistique, mais bien de créer les conditions d’un développement harmonieux et mutuellement enrichissant de la diversité linguistique dans nos sociétés.
Je souhaite connaître vos réflexions sur ce sujet, madame la ministre. Pourriez-vous également nous présenter les éventuelles initiatives en cours ou à venir pour répondre au défi de la défense et de la promotion de la langue française ?
Monsieur le sénateur, vous appelez mon attention sur le sens et l’ambition de la politique, certes interministérielle mais d’abord pilotée par le ministère de la culture, en faveur de la langue française et de la diversité linguistique.
Comme vous le rappelez à juste titre, la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est une grande loi. D’ailleurs, la date symbolique du 4 août n’a pas été choisie au hasard : la maîtrise de la langue, c’est véritablement l’abolition des privilèges ! Donner à tous nos concitoyens les outils de maîtrise de la langue française, c’est leur permettre d’accéder à l’égalité.
La défense et la promotion de la langue française s’inscrivent dans une perspective de valorisation de la diversité culturelle et linguistique dont notre pays est porteur. On a longtemps considéré que le français s’opposait aux langues régionales, aux langues de France. Aujourd'hui, par la politique culturelle que je mène, j’entends bien montrer que valorisation de la diversité linguistique et défense et promotion de la langue française sont parfaitement conciliables.
J’espère pouvoir répondre à vos interrogations sur les orientations et actions.
La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est un élément essentiel de notre pacte républicain. C'est la raison pour laquelle j’ai souhaité, avec Catherine Tasca, mettre à profit le vingtième anniversaire de son adoption pour organiser le 13 octobre prochain au Sénat une réflexion sur la portée réelle de ce texte, sur son rôle au regard de nos solidarités francophones et sur sa pertinence dans un contexte d’internationalisation des échanges et de bouleversement dans les conditions de transmission des savoirs.
Vous le savez, il y a eu un débat sur l’enseignement en langue anglaise dans certaines de nos universités et grandes écoles pour des élèves étrangers issus de pays non francophones. À mon sens, compte tenu des garanties qui ont été apportées, notamment sur le fait qu’une telle démarche s’inscrivait dans un processus d’apprentissage du français, la possibilité d’offrir à ces étudiants des cours en anglais à leur arrivée en France, en tout cas au début, doit être assurée. Cela fait partie, vous l’avez souligné, d’une politique ouverte et dynamique pour promouvoir l’enseignement de la langue française et sa diffusion partout dans le monde.
Par ailleurs, il existe un comité de terminologie, dans lequel l’Académie française et nos partenaires francophones jouent un rôle très actif. Ce dispositif interministériel nous permet d’enrichir la langue en permanence.
Il est indispensable de pouvoir décrire toutes les réalités techniques ou sociologiques du monde contemporain, ainsi que les évolutions sociétales. La stratégie d’influence de la France repose aussi sur sa capacité à représenter le monde contemporain et donc à en nommer les réalités. Ainsi, dans nombre de domaines scientifiques et techniques, nous avons des termes français précis et correctement définis qui permettent de maintenir notre langue en état d’exercice et d’en faire le vecteur privilégié de la transmission et du partage des savoirs.
La pluralité linguistique est constitutive de notre pays ; vous y êtes attaché.
J’ai souhaité conduire une réflexion pour définir une politique publique en faveur des langues régionales. Plusieurs des conclusions formulées l’année dernière par le comité consultatif que j’avais mis en place ont d’ores et déjà été mises en œuvre.
J’ai ainsi publié un code des langues de France qui permet de regrouper et d’organiser, un peu sur le modèle des codes Dalloz, l’ensemble des textes législatifs et réglementaires assurant la présence de ces langues dans la société, que ce soit dans l’enseignement, dans les médias ou dans la justice. Il s’agit là d’une avancée notable dans la reconnaissance des langues qui font la France.
Le 31 mars dernier, j’ai signé et adressé à l’ensemble des directeurs de mon ministère et aux principaux responsables d’institutions culturelles une circulaire relative à la valorisation des langues de France. Un principe de non-discrimination y est posé de manière très nette : il faut appliquer aux projets en langues régionales les dispositifs de droit commun, notamment s’agissant du soutien financier – soutien financier à la création, par exemple –, en vigueur pour les projets en langue française. Cela répond à une exigence d’égalité et de démocratie culturelle.
À travers ces différentes mesures – et je n’en citerai pas d’autres pour ne pas allonger mon propos –, il s’agit pour le Gouvernement tout entier de créer les conditions d’un développement harmonieux de la diversité linguistique dans notre pays.
Une vigilance constante est nécessaire pour veiller à l’application du principe constitutionnel qui fait du français la langue de la République, mais nous devons également donner à cette dernière les moyens d’accueillir et de valoriser son patrimoine linguistique riche et vivant.
Comme je l’avais indiqué devant l’Assemble nationale au mois de janvier dernier, il faut concilier la langue de la République et la République des langues.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Je souhaitais vivement connaître votre appréciation sur le sujet. Les éléments d’information que vous apportez sont tout à fait satisfaisants.
Vous l’avez bien compris, il ne s’agit nullement d’une démarche défensive ; l’enjeu n’est pas d’ériger une ligne Maginot face à l’intrusion des langues étrangères. D’ailleurs, l’apprentissage d’autres langues permet de mieux comprendre la sienne, et les langues s’enrichissent mutuellement.
Le processus est donc permanent. Il s’agit non pas d’arrêter l’histoire de l’évolution, mais d’avoir tout de même en tête des préoccupations que nous sommes très nombreux à partager. Après tout, la Joconde aurait-elle connu le même succès si toutes les couleurs avaient été mélangées pour aboutir à une teinte tout à fait indéfinissable ?
Mme la ministre sourit.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 748, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Je remercie Mme la ministre de la culture et de la communication de me répondre à la place de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Bocquet vient de souligner qu’il ne fallait pas « arrêter l’histoire de l’évolution ». Je partage ce souci. C’est le sens de ma question, qui concerne l’apprentissage de l’informatique et de son langage dans l’enseignement non seulement secondaire, mais également primaire.
Depuis 2012, les élèves des terminales scientifiques peuvent choisir une option « Informatique et sciences du numérique », possibilité qui sera étendue à l’ensemble des classes de terminale à la prochaine rentrée.
L’enseignement de l’informatique a été introduit dans un certain nombre de pays, comme le Royaume-Uni, la Suisse, l’Estonie, la Finlande, Singapour, Israël, d’ailleurs avec beaucoup de succès, ou dans le secondaire aux États-Unis.
L’initiation à la programmation dès le plus jeune âge est préconisée par de nombreux experts. Une approche ludique permet un accès au socle de la logique informatique et de la programmation, stimulant, d’après les spécialistes, une culture transverse et logique.
L’Académie des sciences a très récemment rappelé dans un rapport l’importance d’une formation aux codes et aux langages. Reconnaissons que notre pays est longtemps resté hermétique en la matière ; le déficit d’éducation à l’informatique est réel.
Récemment encore, dans son discours aux États-Unis, lors de l’US French Tech Hub, le Président de la République, François Hollande, a lui-même exprimé sa volonté de donner une impulsion à l’enseignement de la programmation informatique dans nos collèges.
Madame la ministre, pourriez-vous me préciser le calendrier prévu pour la mise en place de telles expérimentations et les critères de choix des établissements ? Le dispositif sera-t-il fondé sur le volontariat, en fonction des académies ?
Au-delà du simple développement de l’usage du numérique dans le milieu scolaire, il est essentiel de favoriser le développement et la compréhension de la science informatique.
Vous-même, M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et Mme la secrétaire d'État chargée du numérique partagez-vous le jugement des spécialistes quant à « l’urgence de ne pas attendre » ?
Madame la sénatrice, M. Benoît Hamon, qui participe à la grande conférence sociale, vous prie de bien vouloir excuser son absence.
Le déploiement du numérique et l’apprentissage de l’informatique à l’école représentent un véritable enjeu pour la réussite des élèves et la lutte contre les discriminations entre les territoires.
L’école doit être actrice de telles évolutions pour accompagner tous les élèves dans leurs apprentissages avec le numérique, par le numérique et au numérique. Il s’agit donc de se saisir du numérique pour refonder l’école.
Actuellement, tous les programmes de l’école et du collège intègrent une composante relative à l’informatique, que ce soit dans les usages ou dans les activités de modélisation.
Dans toutes les séries technologiques au lycée, les élèves sont conduits à une utilisation plus experte des technologies de l’information et de la communication.
Dans la voie professionnelle, l’usage du numérique est pleinement intégré dans l’apprentissage du métier. C’est même une condition nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles indispensables à l’insertion.
Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, et dans le cadre de la réforme du lycée, l’informatique fait l’objet d’un enseignement à part entière en classe de terminale de la série scientifique, avec l’option « Informatique et sciences du numérique », ou ISN, qui propose aux élèves une introduction à la science informatique : information numérique, algorithmes, langages, architectures. C’est aussi un enseignement d’ouverture et de découverte qui valorise la créativité, prépare les élèves au monde de demain et permet à ces derniers de mieux s’orienter. Cela s’inscrit dans la lignée de la découverte de l’algorithmique, présente dans les programmes de mathématiques des classes de seconde et de première scientifique.
Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, l’académie de Montpellier expérimente l’extension de cette option ISN aux séries économique et sociale, ou ES, et littéraire, ou L, sur la base d’un enseignement adapté aux objectifs de formation de chacune. M. le ministre de l’éducation nationale a demandé une évaluation de l’expérimentation avant d’envisager son éventuelle généralisation.
Au-delà de l’enseignement de l’ISN, le Conseil supérieur des programmes s’est saisi du sujet au moment de l’élaboration du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Ce socle, vous le savez, offre un cadre renouvelé pour penser la place de l’informatique au sein de la scolarité obligatoire des élèves. Le numérique, l’informatique et leurs usages occupent une bonne place, puisqu’il est précisé que, en fin de cursus scolaire obligatoire, « l’élève sait que les équipements informatiques utilisent une information codée et il est initié au fonctionnement, au processus et aux règles des langages informatiques ; il est capable de réaliser de petites applications utilisant des algorithmes simples ». Il nous appartient aujourd’hui, par la refonte des programmes à venir, de répondre à cette exigence. Nous examinons les modalités de cette réponse.
Le Gouvernement salue la chance que nous avons de disposer de personnels tout à fait motivés et formés au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE, pour accompagner la montée en puissance du numérique à l’école. Le ministre de l’éducation nationale veut également mentionner le rôle essentiel de l’École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ESENESR, qui a fait le choix d’investir l’ensemble des outils institutionnels de formation à distance pour les enseignants, afin de permettre aux cadres administratifs d’appréhender les dispositifs à destination des personnels.
L’école doit non seulement former les élèves à maîtriser les outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs études et leur vie quotidienne, mais aussi, et surtout, préparer les futurs citoyens à vivre et à travailler dans une société dont l’environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement.

Je vous remercie, madame la ministre, de m’avoir lu les éléments d’information qui vous ont été transmis par le ministère de l’éducation nationale. Cependant, cette réponse ne me satisfait pas pleinement. En effet, elle se borne à évoquer de nouveau les quelques expériences existantes et une refondation des programmes qui, en réalité, a lieu tous les ans.
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur le développement de l’économie numérique française, récemment remis par Mmes Erhel et de La Raudière, préconise un éveil à l’informatique dès l’école primaire. Or, dans la réponse que vous venez de me transmettre, madame la ministre, il est simplement question des classes de terminale scientifique et d’une expérimentation de l’extension de l’option ISN aux classes de terminale des séries ES et L.
La question qui se pose est la suivante : la programmation informatique doit-elle être enseignée uniquement en terminale ? Les enfants ont accès très tôt au numérique. La programmation informatique et l’algorithmique pourraient être abordées par le biais du jeu, et ce dès le plus jeune âge. Avec l’approche retenue par le ministère, je crains que nous ne finissions par prendre autant de retard dans l’apprentissage des bases de l’informatique que dans celui des langues, alors que la maîtrise du langage informatique sera un facteur essentiel de l’employabilité à l’avenir. Au XXIe siècle, l’informatique n’est plus une nouvelle technologie, contrairement à ce que semble penser le ministère de l’éducation nationale. Il importe d’y former nos enfants dès le plus jeune âge. J’espère que les divers rapports et conseils permettront d’inciter le ministère à faire preuve d’un plus grand dynamisme dans ce domaine.

La parole est à M. Éric Bocquet, en remplacement de Mme Éliane Assassi, auteur de la question n° 811, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Assassi, retenue, m’a demandé de la suppléer et vous prie de l’excuser, madame la ministre.
Consulté dans le cadre de l’élaboration de la carte scolaire pour 2014, M. le maire de Cahors, dans le Lot, a proposé, sans concertation avec les parents, la suppression d’un poste d’enseignant à l’école maternelle Henri-Thamier, dans le quartier populaire de Sainte-Valérie, conduisant à la fermeture de cette école. Les parents d’élèves, mobilisés, n’ont eu de cesse de s’élever contre cette décision.
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, que le groupe CRC a votée, comporte de nombreuses dispositions qui plaident en faveur du maintien de cette école maternelle située dans un quartier défavorisé.
Le rapport de l’Assemblée nationale publié le 28 février 2013 à l’occasion de l’examen de ce texte indique que la scolarisation précoce contribue fortement à l’amélioration des trajectoires des élèves issus des milieux défavorisés et préconise de la développer en priorité dans les écoles dont l’environnement social est difficile. Ce rapport a conduit à la modification de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui précise désormais que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile. […] L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. »
Le quartier où est implantée l’école maternelle Henri-Thamier se trouve précisément dans cette situation. Cela justifie que celle-ci relève d’un contrat urbain de cohésion sociale articulé selon trois objectifs, dont la réussite scolaire.
En supprimant un service public, on met aussi en cause la mixité sociale et culturelle existante – 75 % des familles occupent un logement locatif HLM et 25 % vivent dans des zones pavillonnaires –, au risque de faire de Sainte-Valérie un quartier de relégation.
Rappelons que plus de 50 % des habitants du quartier n’ont pas de moyen de locomotion et qu’il leur sera difficile de rejoindre une école située à plus d’un kilomètre. Cet obstacle constitue un premier pas vers une forme de fracture sociale et, dans certains cas, la déscolarisation.
Quelles actions le Gouvernement compte-t-il engager afin que la loi du 8 juillet 2013 soit appliquée en portant une attention particulière à la scolarisation précoce des enfants dans le quartier de Sainte-Valérie à Cahors ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser M. le ministre de l’éducation nationale, retenu par la grande conférence sociale.
Je vous remercie de souligner les efforts déployés par le Gouvernement pour rétablir l’égalité des chances à l’école et lutter contre l’échec scolaire.
À cet égard, la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République accorde la priorité au premier degré, car la réussite des élèves passe par la maîtrise des premiers apprentissages, notamment celui de la langue.
C’est pourquoi, comme vous le soulignez très justement, il est aujourd’hui primordial de revaloriser le rôle de l’école maternelle et de favoriser la réussite des plus jeunes, notamment dans les secteurs les plus fragiles socialement et économiquement.
C’est tout le sens de la réforme de l’éducation prioritaire que mène Benoît Hamon, avec Najat Vallaud-Belkacem, dans le cadre de la réforme de la politique de la ville. L’objectif est de concentrer les moyens sur les quartiers prioritaires et d’optimiser l’emploi des outils de l’action publique pour restaurer l’égalité républicaine entre les territoires.
Dans ce cadre, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans est une priorité que nous nous sommes fixée. Il s’agit de lutter contre les discriminations sociales, culturelles et linguistiques, en faisant de l’école un lieu d’accompagnement de tous les élèves, et d’abord de ceux qui sont le plus en difficulté, vers la réussite.
Cet effort est déjà bien engagé dans le département du Lot, où le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est nettement supérieur à la moyenne nationale.
En ce qui concerne le cas précis de la fermeture de l’école maternelle Henri-Thamier, qui fait l’objet de votre question, M. le ministre de l’éducation nationale peut vous apporter les précisions suivantes.
Pour l’année scolaire 2014-2015, la baisse des effectifs prévue dans le département du Lot a conduit à la suppression de quatre postes, dont un dans la ville de Cahors. Dans le souci d’optimiser le redéploiement du réseau scolaire, l’équipe municipale a décidé de procéder à la fermeture de l’école maternelle à classe unique Henri-Thamier.
Cette décision a été le fruit d’une longue concertation, à laquelle la communauté éducative et les parents d’élèves ont été pleinement associés. Les services académiques ont pris les mesures nécessaires pour garantir la continuité des apprentissages. En effet, les vingt-six élèves concernés par cette fermeture de classe seront accueillis au sein de l’école maternelle Jean-Calvet ou de l’école Bellevue, établissements qui se situent tous deux à moins de 750 mètres de l’école Henri-Thamier. Un service de transport scolaire par navettes municipales sera mis en place à la rentrée 2014 pour faciliter les déplacements des plus petits.
Cette décision présente l’avantage d’assurer l’accueil des élèves de moins de 3 ans dans une structure de plus grande importance, où ils seront en contact avec d’autres enfants, tout en prenant en compte la spécificité de leurs besoins, conformément aux recommandations de la circulaire du 18 décembre 2012.
Ainsi, les conditions d’apprentissage des élèves de l’école Henri-Thamier sont préservées, ainsi que l’accueil des enfants de moins de 3 ans. Les enfants du quartier Sainte-Valérie pourront bénéficier de meilleures chances de réussite.
L’objectif qui anime l’action du ministre de l’éducation nationale est de guider l’ensemble de la communauté éducative pour combattre dès le plus jeune âge les inégalités sociales et territoriales, afin de favoriser la réussite de chaque jeune. Ensemble, nous devons faire évoluer l’école vers la réussite de tous. Vous pouvez compter sur le Gouvernement pour défendre cette priorité essentielle de la République.

Je vous remercie, madame la ministre, de m’avoir apporté ces éléments de réponse.
Cette question offre l’occasion de remettre au cœur de notre réflexion l’importance particulière de l’école maternelle. L’acquisition de la maîtrise du langage est une condition déterminante de la réussite future de l’enfant. En effet, selon que le bagage de celui-ci est de 500 mots ou de 2 000 mots à son arrivée à l’école, ses chances en matière d’apprentissage de la lecture et de l’écriture ne sont pas les mêmes ! Il est donc essentiel de maintenir la priorité accordée à la scolarisation précoce.
Notre école maternelle est reconnue en Europe pour son efficacité en matière non seulement de socialisation et de préscolarisation, mais aussi d’acquisition langagière. Pour l’heure, l’école n’est toujours pas parvenue à résorber l’ensemble des inégalités, qui ont même tendance à s’aggraver dans la période difficile que nous traversons. La priorité absolue doit être donnée à l’école maternelle dans la durée.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, auteur de la question n° 816, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Le 25 mai 2014, 442 conseillers consulaires et près d’une centaine de délégués consulaires ont été élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. Ces élus de proximité feront vivre la démocratie participative sur les cinq continents au sein de la communauté française qu’ils représentent.
Les électeurs avaient la possibilité de voter dans les consulats, qui s’étaient transformés pour l’occasion en bureaux de vote, par procuration ou par voie électronique. En 2012, ils avaient très largement choisi, pour les élections législatives, la voie électronique, beaucoup d’entre eux vivant à plusieurs milliers de kilomètres d’un consulat. Toutefois, ils avaient été déroutés par certains dysfonctionnements du logiciel de vote Java, dont il fallait installer une version obsolète pour qu’il fonctionne !
À la suite des incidents survenus, le ministère des affaires étrangères, qui a la charge de l’organisation de ces élections, avait fait le bilan des difficultés rencontrées. Il a cependant été décidé de conserver le même système pour les élections des conseillers consulaires. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’utilisation de ce logiciel a malheureusement privé quelques milliers d’électeurs de la possibilité d’exercer leur droit de vote.
Vendredi dernier, le directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire a réuni les parlementaires et ses services pour faire le bilan de ces élections consulaires. Un grand nombre de problèmes ont été identifiés.
Madame la secrétaire d’État, le ministère des affaires étrangères – je tiens à saluer l’engagement de son administration, à la fois dans les postes et à Paris, pour l’organisation de ce scrutin – envisage-t-il, pour les prochains scrutins, de s’inspirer des leçons tirées des problèmes rencontrés par les électeurs afin de simplifier le processus et de permettre ainsi à tous ceux qui souhaitent voter par voie électronique de pouvoir le faire ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui me permet de saluer la réforme de la représentation politique des Français de l’étranger que vous avez menée.
Cette réforme s’est traduite notamment par la mise en place de conseils consulaires, permettant d’installer la démocratie de proximité pour nos concitoyens établis à l’étranger.
Ce scrutin était inédit pour le ministère des affaires étrangères et du développement international, qui organisait pour la première fois une élection dans 129 circonscriptions électorales. Près de 3 000 Françaises et Français se sont présentés, ce qui témoigne de la vitalité démocratique de notre communauté expatriée.
Ce scrutin est original, puisque nos compatriotes ont eu la possibilité de voter par internet. Instaurer cette possibilité était, nous le savons, une nécessité : si nous avons ouvert 482 bureaux de vote dans le monde, nombre de nos compatriotes résident encore loin des urnes.
Ainsi, 80 000 de nos concitoyens ont voté par internet pour ces élections consulaires, ce qui représente 43 % des votants et 7 % des inscrits sur les listes électorales.
Quelques milliers d’électeurs n’auraient pu cependant finaliser leur opération de vote électronique, malgré l’assistance téléphonique mise en place. Ils conservaient néanmoins la possibilité de voter à l’urne.
Le directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire a réuni voilà quelques jours l’ensemble des parlementaires représentant les Français de l’étranger pour tirer le bilan de ces élections.
Les difficultés liées à la mise à jour du logiciel Java sur l’ordinateur de l’électeur ont été évoquées. Ce logiciel est un prérequis de sécurité du système de vote actuel. Je peux vous annoncer qu’une nouvelle solution de vote électronique sera développée, qui permettra de se passer du logiciel en question.
Les Français de l’étranger sont pionniers en ce domaine. Notre objectif est de simplifier le vote par internet afin de favoriser leur expression démocratique, tout en garantissant la sincérité et le secret de cette modalité de vote.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse.
Dans la perspective des scrutins à venir, notamment ceux de 2017 pour l’élection des députés des Français de l’étranger et de 2020 pour le renouvellement des conseils consulaires, on peut imaginer qu’un plus grand nombre de familles seront équipées d’ordinateurs et que le vote électronique ne peut que se développer. On a constaté une baisse de la participation en raison des problèmes techniques rencontrés lors des élections consulaires. Je me félicite que vous ayez pu me donner l’assurance que ces problèmes seront pris en compte, que des solutions seront mises en place et que les scrutins à venir se dérouleront convenablement.

La parole est à M. Henri Tandonnet, auteur de la question n° 805, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les dispositions relatives au temps partiel prévues à l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, s’agissant plus particulièrement des entreprises de moins de dix salariés de la branche du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et crémerie.
Ces entreprises, notamment les vendeurs de primeurs exerçant principalement sur les marchés et ayant un statut non sédentaire, n’ont pas les ressources matérielles et humaines suffisantes pour faire bénéficier leurs salariés à temps partiel d’une durée de travail de vingt-quatre heures au minimum par semaine.
Les cas de dérogation prévus par la loi ne suffisent pas. Les formalités liées à la dérogation sur demande du salarié ou au refus de l’employeur d’augmenter la durée du travail pour les contrats déjà en cours au 1er janvier 2014 ajoutent encore aux lourdeurs administratives qui entravent le fonctionnement de ces entreprises. Ces dernières n’ont, en majorité, que leur comptable pour faire office de service des ressources humaines, et ces dispositions engendrent une insécurité juridique.
Les commerçants se trouvent donc contraints de ne pas embaucher, de supprimer des emplois ou d’augmenter la charge de travail de leurs salariés ou même la leur, déjà très importante. Ils subissent, en parallèle, la concurrence toujours plus forte des supermarchés. Ils demandent notamment un cadre législatif et réglementaire adapté à leurs spécificités de commerçants, y compris non sédentaires.
Je souhaiterais donc savoir, madame la secrétaire d’État, si le Gouvernement compte revenir sur la durée minimale obligatoire de vingt-quatre heures de travail par semaine et adapter la législation relative au temps partiel au cas spécifique des commerçants de la branche, notamment des vendeurs de primeurs sur les marchés, lesquels ne peuvent pas, du fait du nombre et des horaires des marchés, offrir un emploi pour vingt-quatre heures par semaine.
Monsieur Tandonnet, François Rebsamen vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il est, comme vous le savez, retenu ce jour par la grande conférence sociale pour l’emploi.
Vous attirez l’attention du Gouvernement sur les difficultés d’application, dans la branche du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et crèmerie, de la règle des vingt-quatre heures de travail hebdomadaires instituée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette règle, vous le savez, a été instaurée par la volonté des partenaires sociaux qui ont signé l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Il s’agit là d’un progrès social important, en particulier pour les femmes, qui subissent plus que toute autre catégorie de salariés le temps partiel. Celui-ci ne doit plus être une variable d’ajustement.
La loi a prévu, pour prendre en compte certaines situations spécifiques, deux voies de dérogation possibles, assorties à chaque fois de contreparties : une dérogation individuelle, à la demande du salarié qui souhaite travailler moins de vingt-quatre heures par semaine ; des dérogations collectives si un accord de branche prévoit d’abaisser le seuil minimal.
Plusieurs branches ont réussi à négocier et sont parvenues à un accord : ainsi, au 1er juillet 2014, vingt-deux accords ont été signés, certains dans des branches d’une importance significative ; je pense, par exemple, à la restauration rapide. Près d’un tiers de l’ensemble des salariés à temps partiel – hors particuliers employeurs, qui ne sont pas soumis à la règle des vingt-quatre heures –, soit près d’un million de personnes, sont ainsi couverts par un accord de branche, le taux atteignant 63 % pour les salariés des branches les plus concernées, qui étaient tenues d’ouvrir des négociations.
Les négociations se poursuivent dans un très grand nombre de branches, et j’ai bon espoir qu’elles aboutissent. L’équilibre visé au travers de la loi relative à la sécurisation de l’emploi sera ainsi atteint.
Vous faites état, pour une branche spécifique, de difficultés particulières. Le Gouvernement ne s’engagera pas dans la voie de dérogations sectorielles, car cela serait contraire à l’objectif de créer une règle générale de vingt-quatre heures applicable dans tous les secteurs, à l’accord national interprofessionnel, à la position du Gouvernement, qui a écarté tous les amendements allant en ce sens pendant les débats parlementaires sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi, et ce serait ouvrir une boîte de Pandore.
Pour autant, les solutions existent pour prendre en compte les spécificités de telle ou telle branche : la dérogation individuelle, bien sûr, ou des idées constructives qui ont été trouvées dans certaines branches pour parvenir à un accord collectif. Bon nombre de branches sont parvenues à un accord alors même que de fortes spécificités les empêchent d’appliquer la règle des vingt-quatre heures.
En revanche, il est vrai que le cas des salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 pour moins de vingt-quatre heures de travail hebdomadaires et qui souhaiteraient passer à vingt-quatre heures pose une difficulté. Le Gouvernement, qui en est conscient, fera très prochainement une proposition pour sécuriser cette situation particulière. Il faut en effet, pour ces salariés, prévoir une priorité d’accès à un emploi de vingt-quatre heures hebdomadaires, mais sans automaticité, et simplifier la procédure, pour l’heure trop lourde, comme vous le soulignez à juste titre.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse.
Sur 4 millions de travailleurs à temps partiel, 2 millions travaillent moins de vingt-quatre heures par semaine.
La règle des vingt-quatre heures est tout de même très contraignante. Si sa mise en œuvre peut se concevoir au sein des grandes entreprises, elle crée des difficultés pour de nombreuses petites entreprises de secteurs très variés, par exemple pour les vendeurs de primeurs sur les marchés.
J’ai récemment été interpellé, sur le terrain, par une association de services aux personnes qui ne peut embaucher un travailleur à temps partiel, faute de pouvoir, à l’heure actuelle, lui assurer cette durée minimale de vingt-quatre heures de travail hebdomadaires. Or le travail à temps partiel permet souvent une première embauche.
Je pense donc qu’il faudrait apporter des aménagements à cette règle, qui est trop contraignante et ne correspond pas à la réalité du monde du travail. Sa portée est trop générale, à l’heure où le chômage s’aggrave.

La parole est à M. Charles Revet, auteur de la question n° 795, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Madame la secrétaire d’État, ma question a trait à la place de l’aquaculture sur le littoral et, plus largement, sur le territoire national.
L’aquaculture française stagne depuis 1995. La France a été en pointe dans les années soixante-dix, mais ses productions n’évoluent pas ; pis, elles régressent. La conchyliculture produit 163 000 tonnes de coquillages, la pisciculture seulement 6 000 tonnes de poisson, mais 200 millions d’œufs embryonnaires ou de larves, dont 66 % sont exportés, ce qui est positif pour notre commerce extérieur, dont vous avez la charge. Au total, 3 000 entreprises emploient 18 000 salariés, pour un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros.
La France, qui possède la deuxième plus grande zone économique maritime au monde, juste derrière les États-Unis d’Amérique, ne couvre, selon les statistiques, ses besoins en poissons et crustacés qu’à hauteur de 15 %. Cette situation est inacceptable, mais, a contrario, pourrait offrir des possibilités de développement pour peu que des contraintes souvent spécifiques à la France n’aboutissent pas à bloquer les projets et à dissuader les pêcheurs et aquaculteurs de s’engager.
Une disposition de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a visé à l’établissement de schémas tout au long du littoral français, faisant ressortir les espaces à protéger, les espaces où pourraient s’établir des productions aquacoles ou autres activités économiques et, éventuellement, des espaces à classement ultérieur, afin de ne pas hypothéquer l’avenir des terrains concernés. Cela s’est traduit par une modification du code de l’environnement ; je souhaiterais que vous me précisiez quelle application a été faite des dispositifs des articles L. 219-6-1 et L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’algoculture, dont les débouchés, tels les cosmétiques ou la biomasse, sont nombreux, est un gisement à développer.
L’aquaculture contribue fortement à la sécurité alimentaire. En 2030, selon un rapport de la Banque mondiale, plus de 60 % du poisson consommé proviendra de l’aquaculture. La Chine en produira 38 % et en consommera 37 %.
Il importe, pour éviter les concentrations au Vietnam, en Chine et au Chili, dommageables pour l’environnement, de diversifier les lieux de production, mais également d’augmenter la sécurité alimentaire en termes de production de qualité et de couverture des besoins.
La France assure 10 % des captures de poissons. Elle dispose du second domaine maritime au monde en termes de zone économique. La pêche française représente 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 93 000 emplois. La richesse halieutique s’épuisant, il est nécessaire de stimuler une économie de substitution.
Je souhaiterais donc connaître les actions conduites en faveur d’un développement significatif de l’aquaculture, afin de faire de notre façade maritime un vivier halieutique de substitution, générateur d’activité économique et contribuant à l’équilibre alimentaire des populations.
La consultation citoyenne relative au « mieux consommer » vient de s’achever. Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous m’indiquer quels en sont les enseignements et quelles sont les perspectives pour l’aquaculture, l’algoculture, la conchyliculture, la pisciculture ?
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de Frédéric Cuvillier, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, sur la place de l’aquaculture sur le littoral français.
En matière de production conchylicole, la France se classe au deuxième rang des pays de l’Union européenne, avec 160 000 tonnes en 2012, et au premier pour la production ostréicole, avec 80 000 tonnes la même année. En revanche, notre production piscicole marine est très en retrait par rapport à celle d’autres pays, comme l’Espagne ou la Grèce.
La France partage la volonté de soutenir fortement le développement de l’aquaculture affichée par la Commission européenne, qui vise un doublement de la production d’ici à 2020, afin de réduire la pression sur la ressource halieutique et les importations en provenance de pays tiers.
L’augmentation de la production aquacole, en particulier de la production piscicole marine, sera donc l’un des objectifs majeurs du plan national stratégique de développement de l’aquaculture en cours d’élaboration.
Ce plan prévoit des actions de soutien articulées selon quatre axes.
Premièrement, il s’agit d’améliorer l’efficacité de l’action administrative, de la simplifier de manière notamment à réduire les délais d’instruction des autorisations d’installation.
Deuxièmement, il est prévu de planifier l’utilisation des espaces marins, en particulier en prenant appui sur les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, initiative qui mérite d’être menée à son terme sur l’ensemble des façades – cinq sont finalisés, deux autres sont en phase de finalisation – avant de pouvoir être approfondie.
Troisièmement, il importe d’assurer le soutien à la compétitivité des entreprises, notamment en orientant les aides du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, sur la période 2014-2020.
Enfin, il faut exploiter les avantages de l’aquaculture française, en ce qu’elle apporte des garanties sur la qualité et sur la protection de l’environnement : garanties sur l’origine, sur la connaissance de l’impact réel sur l’environnement, etc.
L’algoculture est actuellement peu développée, mais elle présente, vous l’avez rappelé, un fort potentiel et fait donc partie intégrante de la stratégie française pour le développement des aquacultures.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, de l’entière mobilisation de Frédéric Cuvillier en faveur du développement de cette filière économique.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des réponses que vous m’apportez au nom de M. Cuvillier, que j’avais d’ailleurs déjà interpellé sur ce sujet.
Ce dossier vous concerne directement dans la mesure où la France importe 85 % des poissons et crustacés qu’elle consomme, ce qui induit un déficit pour notre balance commerciale, entre autres conséquences.
J’avais suggéré, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, que soient établis des schémas territoriaux pour déterminer les endroits où il serait possible d’implanter des fermes aquacoles. Au lieu de cela, on continue de classer tous les terrains. On me dit que le fait qu’un terrain soit classé n’empêche pas la création d’une activité aquacole, mais, vous le savez, cela prend alors beaucoup plus de temps, ce qui décourage les entrepreneurs.
Les schémas départementaux prévus en 2009 devaient avoir été établis un an après ; nous les attendons toujours. Il conviendrait que vous nous aidiez à faire respecter les décisions du Parlement : le rôle de l’administration est aussi de les appliquer. J’y reviendrai si nécessaire, mais je tenais à attirer votre attention sur cet aspect des choses.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, auteur de la question n° 799, transmise à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

J’attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique sur le CPIER, le contrat de plan interrégional État-régions pour la vallée de la Seine.
Le 22 novembre 2012, le ministre des transports annonçait la volonté de l’État de revoir la gouvernance de l’axe Seine, ainsi que celle de conclure des contrats avec les territoires concernés, afin de définir les priorités et les moyens financiers qui pourraient être accordés à un projet d’aménagement du territoire à grande échelle autour de l’axe Seine. Cette annonce s’inscrivait donc dans la perspective de la poursuite de la politique que le gouvernement de François Fillon avait amorcée.
Cependant, il aura ensuite fallu attendre six mois avant que ne soit nommé un délégué interministériel, par décret du 24 avril 2013. C’était là faire table rase de tout le travail réalisé, notamment du rapport qui avait été rédigé par le commissaire au développement de l’axe Seine en février 2012.
L’État a refusé de manière inexplicable, par la suite, la création d’un pôle métropolitain de l’Estuaire qui aurait été un atout et une force motrice pour le développement de l’axe Seine, au mépris du travail réalisé et du consensus qui s’était dégagé parmi les élus locaux participants.
Je rappelle que les conseils économiques, sociaux et environnementaux, les CESER, des trois régions d’Île-de-France, de Basse-Normandie et de Haute-Normandie et les chambres de commerce et d’industrie attendent des signes forts quant à la ligne nouvelle Paris-Normandie et, plus globalement, à la vallée de la Seine. Ils ont expressément demandé des « moyens exceptionnels et proportionnés à l’ampleur de l’ambition ».
Par ailleurs, les chambres de commerce et d’industrie des trois régions se sont mises en ordre de marche au sein de Paris-Seine-Normandie. Pour la CCI du Havre, ce sont pas moins de 700 millions d’euros qui vont être investis sur la base de la charte « Compétences totalement Estuaire », afin d’attirer les entreprises. Ainsi, les acteurs dits de la société civile ont commencé à avancer ensemble.
C’est pourquoi, malgré le dynamisme et la motivation des acteurs consulaires, malgré l’impulsion donnée, depuis 2009, au développement de l’axe Seine, je tiens à vous faire part de ma grande inquiétude de ne toujours rien voir venir. Tous les acteurs s’interrogent. Les assemblées régionales, pourtant concernées au premier chef, n’ont reçu aucune information sur la négociation du futur contrat et du schéma stratégique pour l’aménagement et le développement de la vallée de la Seine.
Aussi, je demande à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires de bien vouloir m’éclairer sur l’avancée des négociations relatives au CPIER et les engagements financiers de l’État dans ce dossier, afin que tous les acteurs locaux continuent à se mobiliser autour de cette indispensable ambition qu’est la vallée de la Seine.
Dans cette période troublée, à la suite des annonces successives, quelquefois contradictoires, du Gouvernement relatives à la décentralisation, il est réellement nécessaire de donner enfin des gages et des éléments précis à tous ceux qui agissent sur le terrain pour donner vie à l’axe Seine.
Madame la sénatrice, la nomination, le 24 avril 2013, d’un délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, le préfet François Philizot, assisté, sur le plan local, par un préfet coordonnateur, qui est celui de la région Haute-Normandie, illustre la reconnaissance par le Gouvernement de la spécificité de cet espace.
Placé auprès du Premier ministre, le délégué interministériel développe une méthodologie participative afin d’élaborer de façon collégiale entre l’État et les trois régions – Haute-Normandie, Basse-Normandie et Île-de-France – un schéma stratégique d’aménagement et de développement de la vallée de la Seine à l’horizon 2030. Ce schéma a vocation à être décliné dès son approbation en un contrat de plan interrégional État-régions pour la période 2015-2020.
Le premier comité directeur réunissant l’État et les régions, installé le 3 juillet 2013, a permis d’arrêter le cadre général d’élaboration du schéma stratégique, ainsi que ses orientations principales.
L’ensemble des éléments issus du précédent commissariat à la vallée de la Seine ont été utilisés dans le travail de préparation du schéma stratégique. Ce dernier a fait l’objet de nombreuses réunions selon trois thématiques qui ont constitué la matière d’autant de groupes de travail : déplacements, réseaux et flux ; filières et développement économique ; gestion de l’espace et excellence environnementale.
Ces groupes de travail ont associé les partenaires indispensables : départements et principales agglomérations, milieux socioéconomiques, établissements publics de l’État, CESER, Paris-Seine-Normandie.
Ces travaux ont permis aux services de l’État et des régions d’avancer rapidement. La validation finale du schéma stratégique est prévue en septembre 2014 et donnera lieu à la réunion de l’ensemble des partenaires associés à la démarche.
Parallèlement, le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine et l’ensemble des partenaires locaux travaillent de concert à la traduction opérationnelle de ce schéma dans le CPIER pour la vallée de la Seine.
Des réunions, tant avec les services de l’État en région qu’avec les ministères concernés, ont d’ores et déjà permis d’avancer dans l’identification des actions prioritaires. Quant aux engagements financiers de l’État, ils sont soumis au même calendrier que l’ensemble de la procédure contractuelle, dans le cadre annoncé par le Premier ministre en juin dernier.
La ligne nouvelle Paris-Normandie est, dans cette perspective, l’une des infrastructures prévues. Le comité de pilotage, présidé par le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, a approuvé, le 29 janvier dernier, le calendrier de travail permettant de déboucher sur la déclaration d’utilité publique à la fin de la décennie. Lors de sa deuxième réunion, le 2 juillet 2014, il a précisé certaines options importantes.
La méthodologie participative adoptée et l’étroite coopération entre l’État et les régions sont autant d’éléments déterminants du succès de cette démarche.

Madame la secrétaire d’État, j’ai pris bonne note des différents éléments que vous avez portés à ma connaissance quant au calendrier des diverses réunions et à la réaffirmation de l’ambition pour l’axe Seine à la suite de la nomination du préfet Philizot.
Vous avez évoqué une démarche participative. Permettez-moi de vous dire qu’il est fort regrettable que, contrairement à ce qui s’était passé précédemment, les parlementaires, notamment de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, qui se mobilisent sur ces dossiers – je parle sous le contrôle de mon collègue Charles Revet, qui intervient régulièrement sur les questions portuaires et ferroviaires – n’y aient pas été associés localement, …

… d’autant qu’ils sont souvent aussi des élus locaux. Pour ma part, j’étais encore très récemment conseillère régionale. Visiblement, la communication n’est pas complètement au rendez-vous !
En tout cas, les acteurs pensent que le processus manque de dynamisme et de réactivité ; les questions que j’ai évoquées demeurent.
Concernant le pôle métropolitain de l’Estuaire, je ne comprends pas pourquoi l’État a mis un veto à ce qui n’était, pour l’ouest du département, que le projet miroir du pôle métropolitain CREA de l’agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe.
M. Fabius, qui fut longtemps le président de l’agglomération rouennaise, a été le moteur de la création de ce pôle métropolitain de l’Estuaire, rendue possible par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Pourquoi ses amis politiques se sont-ils opposés à la création d’un pôle métropolitain à l’ouest du département, projet totalement pertinent qui avait fait l’objet d’un travail immense de tous les élus locaux, de tous bords politiques, depuis des années ? Je tenais à souligner cette incohérence.

La parole est à M. Charles Revet, en remplacement de M. Jean-François Humbert, auteur de la question n° 821, adressée à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

C’est avec plaisir que je supplée mon collègue Jean-François Humbert, qui n’a pu être présent ce matin.
Avant de relayer son propos, j’indique que je partage entièrement les préoccupations exprimées à l’instant par Mme Morin-Desailly, puisque ma collectivité devait faire partie de ce pôle métropolitain. Nous n’avons pas compris pour quelles raisons ce projet n’a pu aboutir. La question de ma collègue était donc tout à fait judicieuse et d’actualité.
M. Humbert souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la réforme des collectivités territoriales.
Si une clarification des compétences, avec une rationalisation de notre « millefeuille territorial », est attendue par bon nombre de nos élus et de nos concitoyens, il convient néanmoins de s’interroger sur la méthode employée par le Gouvernement.
En effet, les objectifs de cette réforme doivent être de gagner en lisibilité et en efficacité, au travers d’une clarification des compétences des différents échelons territoriaux, et de permettre, dans un contexte de crise, de mieux gérer les dépenses publiques en réalisant des économies.
Depuis plusieurs années maintenant, l’impérieuse nécessité de réformer est acceptée par tous, mais la question est de savoir dans quelles conditions le faire.
En 2009 et en 2012, M. Humbert a souhaité consulter l’ensemble des 594 maires du département du Doubs pour connaître leur position sur la réforme des collectivités territoriales et leurs attentes, enquête dont les résultats ont été adressés au ministère en temps voulu.
Majoritairement, les élus ont exprimé le souhait d’une clarification des compétences, mais demeurent attachés au maintien du conseil général pour assurer la compétence en matière sociale et au maintien de la région pour exercer sa compétence exclusive en matière économique. Concernant l’intercommunalité, ils ne souhaitent pas le transfert de davantage de compétences aux groupements intercommunaux existants.
Si les objectifs de cette réforme sont essentiels, il importe d’écouter les élus, de ne pas négliger la méthode, de ne pas se précipiter et de ne pas mettre une telle démarche au service de fins électorales. Cette réforme structurelle doit être travaillée dans la concertation, en tenant compte des réalités et de la diversité de chaque territoire.
M. Humbert demande au Gouvernement s’il est prêt à s’engager dans cette voie.
Monsieur le sénateur, consulter les élus, mais aussi les agents du service public, les acteurs de la société civile, les citoyens, prendre en compte la diversité des territoires, c’est une véritable méthode depuis le début du quinquennat. Souvenons-nous en particulier des états généraux de la démocratie territoriale, organisés sur l’initiative du Sénat.
La consultation est donc notre méthode. Une fois cette consultation close, les parlementaires consultent à leur tour. C’est la raison pour laquelle, tout au long de son examen, le texte du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a évolué. C’est la concertation qui a fait naître, au Sénat précisément, les pôles ruraux d’équilibre. C’est aussi la concertation qui a conduit à la dépénalisation du stationnement payant, que la commission du développement durable du Sénat a soutenue tout au long du débat. C’est enfin la concertation qui a permis d’affiner le dispositif des conférences territoriales de l’action publique.
Pour l’élaboration du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, nous n’avons pas procédé autrement. Nous avons ainsi consulté l’Association des régions de France et toutes les associations d’élus. Nous avons aussi entamé un tour de France des régions, et la Franche-Comté, que M. Humbert a présidée, a fait l’objet d’un des tout premiers déplacements.
Néanmoins, l’intérêt général ne saurait se définir comme l’addition des intérêts particuliers : nous avons le devoir de proposer une vision. Cette vision rejoint celle de M. Humbert sur l’attribution de la compétence économique à la région, ainsi que sur la nécessité d’assurer le meilleur exercice possible de la compétence sociale.
S’agissant précisément des départements, si l’on peut comprendre l’attachement de beaucoup à une institution qui n’a pas démérité, cela ne signifie pas pour autant que les structures doivent être immuables. Dans les métropoles, par exemple, les synergies entre l’exercice de la compétence sociale et celui des compétences en matière de logement sont évidentes.
Enfin, il est bon de consulter les maires, car ils sont les interlocuteurs privilégiés de tous nos concitoyens. Eux-mêmes savent que la survie de la commune, à court et moyen terme, passe par une intégration renforcée dans l’intercommunalité.
En réalité, cette réforme, loin de n’être qu’une réforme électorale ou institutionnelle, est bien une réforme d’ampleur, une réforme profondément progressiste, une réforme attendue par les Français, qui la comprennent bien comme un atout majeur pour le développement de notre pays. Elle est la réponse directe à l’une de leurs préoccupations essentielles, eux qui doutent aujourd’hui de la capacité de la puissance publique à assurer le redressement de notre pays, mais réclament, en même temps, des services publics plus accessibles et plus efficaces.
En fait, la conférence territoriale de l’action publique, créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de janvier dernier, permettra justement d’adapter l’exercice concret des compétences aux réalités de chaque région. Ce sont les élus qui feront la décentralisation de demain et qui mettront en œuvre concrètement les changements institutionnels, ainsi que la répartition des compétences sur le terrain.
L’alternative est simple : soit nous allons vite, soit nous laissons les conservatismes reprendre le dessus. Le Gouvernement, Manuel Valls et Marylise Lebranchu ont fait le choix d’aller vite, pour ne pas laisser s’enliser le débat. Bernard Cazeneuve est venu ici, dès la semaine dernière, discuter le premier volet de la réforme, et, à l’automne, nous débattrons du second.
Le Premier ministre le rappelait la semaine dernière, il a invité le Sénat à faire preuve d’imagination, notamment pour inventer la solution la plus juste et la plus efficace pour l’avenir des territoires ruraux comme pour celui des conseils généraux.

Madame la secrétaire d’État, il y a quelques jours seulement, le Sénat a rejeté le texte présenté par le Gouvernement. Vous avez parlé de concertation, mais de nombreuses interrogations demeurent, et le projet du Gouvernement ne correspondait manifestement pas aux attentes de la majorité des sénateurs.
Il faut aller plus loin. Je voudrais attirer votre attention et celle de notre ancien collègue André Vallini, ici présent, sur le besoin de proximité.
Pour en avoir rencontré beaucoup sur le terrain, je peux vous dire que les maires sont inquiets. Le devenir des petites communes, notamment au regard des répartitions de recettes, les préoccupe tout particulièrement, ainsi que la suppression des départements. En effet, le département est le bon échelon pour répondre aux besoins dans un certain nombre de domaines. Si nous souscrivons au principe de la création de grandes régions – mieux dessinées toutefois que dans le projet actuel –, nous estimons qu’il est nécessaire de conserver une dimension de proximité. Avec la disparition des départements, un écart se creusera entre la commune et la région. Cette situation suscite l’inquiétude de beaucoup d’élus, au Sénat comme ailleurs.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, auteur de la question n° 825, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale.

Monsieur le secrétaire d'État, les élus locaux font actuellement l’objet d’injonctions multiples, les invitant à revoir les périmètres des espaces territoriaux de solidarité et de réciprocité.
En premier lieu, les préfets, en application de l’article 79 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ont engagé la consultation avec les syndicats mixtes constitués exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant été reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, afin de les transformer rapidement en pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, ou PETR. Ces EPCI disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification, par le représentant de l’État dans le département, du projet de transformation pour s’opposer éventuellement à celle-ci.
En second lieu, le projet de réforme territoriale invite dès à présent les élus municipaux et intercommunaux à travailler à des regroupements permettant de dessiner, d’ici au 1er janvier 2017, une carte de l’intercommunalité autour d’espaces comptant au moins 20 000 habitants.
Or, le périmètre des PETR comprenant des EPCI, il apparaît impossible ou, du moins, très difficile de délimiter les premiers sans avoir finalisé le travail sur le périmètre des futurs EPCI.
Devant cette complexité, de nombreux élus communaux et intercommunaux, en particulier ceux qui n’ont accédé à leurs fonctions qu’à l’issue du scrutin municipal de mars 2014, demandent à disposer d’un peu de temps pour travailler en profondeur sur ces questions, et s’approprier les problématiques de solidarité à travers les projets de développement, d’aménagement du territoire et de fiscalité locale. Dès lors, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous envisager de surseoir aux contraintes de délai imposées par l’article 79 de la loi du 27 janvier 2014 ?
Madame la sénatrice, vous souhaitez connaître les intentions du Gouvernement s’agissant de la mise en place des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux créés par la loi du 27 janvier 2014.
Le PETR, qui constitue une nouvelle catégorie d’établissement public, a été créé afin de doter les territoires ruraux, périurbains et les petites agglomérations d’un outil d’organisation et de développement leur permettant de mutualiser leurs moyens pour mener en commun des projets structurants. Cette nouvelle structure intercommunale est caractérisée par une organisation et un fonctionnement souples, permettant à ses membres d’organiser les modalités de leur coopération de manière concertée et solidaire.
Vous me faites part de la crainte que vous inspire le délai fixé par le législateur pour la transformation en PETR, par le représentant de l’État, de tous les syndicats mixtes composés exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
En effet, le II de l’article 79 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », prévoit que, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, le préfet informe les organes délibérants des syndicats concernés et leurs membres du projet de transformation. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois mois pour s’opposer à la transformation. À défaut d’opposition dans ce délai, la transformation du syndicat mixte de pays en PETR est décidée par arrêté du préfet du département où est situé le siège du syndicat.
Vous évoquez la difficile articulation entre, d’une part, la mise en place des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux issus de la transformation des syndicats mixtes de pays avant la fin de l’année 2014, et, d’autre part, la volonté de constituer, à l’horizon 2017, des EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants, comme prévu dans le projet de loi qu’examinera le Parlement à l’automne.
Vous demandez, en conséquence, le report du délai fixé par la loi du 27 janvier 2014. Je tiens à vous préciser que le périmètre des PETR issus de la transformation de syndicats mixtes de pays n’est pas figé dans le temps : aucune disposition de la loi ne fait obstacle à des modifications de périmètre au cours de la vie de la structure, afin de prendre en compte, au sein du pôle, les évolutions de périmètres d’EPCI à fiscalité propre pouvant notamment intervenir à la suite de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale. En fait, la création des PETR s’inscrit dans une vaste réorganisation du territoire, qui doit rester souple et ne constituer en rien une contrainte pour les collectivités composant cette structure.
Ainsi, si certains projets de transformation de syndicats mixtes de pays en PETR n’aboutissent pas à l’issue de la procédure engagée par le préfet dans les conditions prévues par la loi MAPTAM, celle-ci prévoit que d’autres modes de constitution de PETR puissent intervenir ultérieurement : la transformation sur l’initiative des syndicats répondant aux critères fixés par la loi, telle que prévue à l’article L. 5741-4 du code général des collectivités territoriales, mais également la création ex nihilo de PETR sur l’initiative d’EPCI à fiscalité propre souhaitant se regrouper au sein d’un périmètre pertinent et cohérent, résultant d’une concertation menée entre eux.
En conclusion, je résumerai ma réponse de la manière suivante.
Premièrement, la transformation d’un syndicat mixte de pays en PETR d’ici à la fin de l’année 2014 n’est pas automatique : elle peut donner lieu à une opposition du syndicat et, en tout cas, à un dialogue local avec le préfet.
Deuxièmement, si le PETR est créé, son périmètre devra évoluer avec la nouvelle carte des EPCI à fiscalité propre telle qu’envisagée dans le projet de loi que nous examinerons ensemble à l’automne.
Troisièmement, il apparaît possible – voire préférable dans certains cas à déterminer localement – d’attendre la nouvelle carte intercommunale avant de créer un PETR.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. Je pense que les élus locaux de la Nièvre suivront vos conseils pour la détermination de leur PETR !

La parole est à M. Didier Marie, auteur de la question n° 813, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les associations d’aide à domicile.
L'État a confié aux départements la charge de financer les prestations sociales correspondant aux risques de dépendance, à savoir, en 2002, l'allocation personnalisée d'autonomie, ou APA, puis, en 2006, la prestation de compensation du handicap.
Le département de la Seine-Maritime voit, depuis plusieurs années, le nombre de personnes concernées par ces prestations croître très régulièrement. Aujourd'hui, le taux de bénéficiaires d’une allocation personnalisée d’autonomie y est bien supérieur à la moyenne nationale, avec 251, 4 bénéficiaires pour 1 000 habitants de plus de 75 ans, contre 208, 1 au niveau national. Le conseil général accompagne ainsi 28 000 personnes, pour un budget supérieur à 120 millions d’euros. Parmi les quatre-vingt-dix services d’aide à domicile, les associations assurent les trois quarts des interventions au titre de l’APA et sont, de ce fait, les principaux employeurs des 13 000 salariés du secteur.
Comme dans de nombreux départements, plusieurs de ces associations sont en très grande difficulté. Ainsi, l’une d’elles vient d’être placée en liquidation judiciaire, 450 emplois étant menacés. D’autres associations mettent en œuvre des plans de sauvegarde de l’emploi. Parmi celles-ci, l’aide familiale populaire et l’aide à domicile en milieu rural effectuent, chaque année, 1 320 000 heures d’intervention, pour près de 6 580 bénéficiaires, et comptent 2 710 salariés. Ces associations viennent de lancer un SOS au conseil général, qui leur a répondu en adoptant une revalorisation du taux de prise en charge de 38 centimes par heure d’intervention dans le cadre du budget de 2014, ce qui représente une dépense supplémentaire de 2 millions d’euros par an.
La mobilisation du conseil général auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a abouti au versement d’une aide exceptionnelle de 1, 3 million d’euros, et une nouvelle aide de 810 000 euros est attendue par la région. Par ailleurs, le département a approuvé, il y a quelques mois, son schéma départemental d’autonomie, qui vise notamment à contribuer à la structuration, à la modernisation et à la professionnalisation du secteur.
Cependant, le département ne peut régler seul tous les problèmes, et les raisons des difficultés des associations demeurent. On peut citer la saturation du dispositif de l’APA, un grand nombre de bénéficiaires de cette allocation atteignant le plafond fixé dans les plans d’aide, aujourd'hui insuffisamment revalorisés. On peut également citer le développement, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2005, de l’offre de services du secteur commercial, qui a projeté les associations dans un univers concurrentiel. Enfin, si elle constitue une véritable avancée pour les salariés, la convention collective de la branche, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ne s’applique qu’aux seules associations, créant ainsi une distorsion de concurrence importante et inacceptable au bénéfice du secteur commercial.
Ces deux dernières causes ont entraîné, en Seine-Maritime, un transfert d’activité représentant près de 1 million d’euros de recettes depuis le secteur associatif non lucratif vers le secteur commercial.
Le Gouvernement a annoncé que le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement serait soumis prochainement au Parlement. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous me préciser le calendrier de cet examen ? En outre, le Gouvernement envisage-t-il d’étendre au secteur marchand toutes les dispositions qui s’imposent désormais aux associations d’aide à domicile ? Enfin, pouvez-vous me confirmer qu’une enveloppe supplémentaire de 810 000 euros sera attribuée à la région et m’indiquer si elle sera prioritairement fléchée vers les associations les plus en difficulté, que j’ai précédemment citées ?
Monsieur le sénateur, je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, retenue par d’autres obligations.
La situation des services d’aide à domicile intervenant auprès des publics fragiles est un dossier prioritaire pour le Gouvernement, qui a d’ores et déjà mobilisé 130 millions d’euros, de 2012 à 2014, pour soutenir ce secteur dans le cadre du Fonds de restructuration des services d’aide à domicile, dont 1, 2 million d’euros pour le département de la Seine-Maritime, sans compter les 810 000 euros de l’enveloppe complémentaire prévue en 2014 pour la région Haute-Normandie. L’attribution départementale par le biais des agences régionales de santé est en cours.
Il convient désormais de construire des réponses pérennes, notamment au travers du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Ce texte d’orientation et de programmation, qui a fait l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs, vise à mobiliser la société autour des enjeux du vieillissement, de la prévention et de la prise en charge de la perte d’autonomie, en s’attachant à répondre à l’attente de nos concitoyens, à savoir, pour résumer, vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions à domicile.
Le projet de loi repose sur trois piliers : anticiper le vieillissement, adapter la société et accompagner la perte d’autonomie.
En ce qui concerne le financement, dans le contexte budgétaire difficile que connaît notre pays, la mise en œuvre de cette loi va mobiliser 645 millions d’euros, au travers de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA.
Le volet « anticipation et prévention » sera doté d’une enveloppe de 185 millions d’euros. Le volet « accompagnement » est, quant à lui, doté de 460 millions d’euros, dont 375 millions d’euros pour la revalorisation de l’APA à domicile, qui est une mesure phare, sans oublier les 78 millions d’euros consacrés au droit au répit pour les aidants. Pendant la phase de montée en charge, 84 millions d’euros seront dégagés pour financer le volet « adaptation » de la loi, notamment pour l’aménagement des logements. Ainsi, la CASA sera bien affectée à 100 % à la mise en application de cette loi, dès son entrée en vigueur.
Le Gouvernement est en effet déterminé à aller vite : le texte a été adopté en conseil des ministres le 3 juin 2014 ; les travaux de la commission des affaires sociales ont débuté dans la foulée et une première lecture à l’Assemblée nationale pourrait avoir lieu à la rentrée.
Ce projet de loi apporte des réponses concrètes aux gestionnaires de services à domicile.
Au travers notamment de la réforme importante de l’APA à domicile, l’accessibilité financière des prestations sera largement améliorée : plus d’heures seront assurées, avec des plans d’aides diversifiés et une participation financière des usagers réduite. L’ensemble des bénéficiaires en profitera, l’effort étant accentué pour les personnes en perte d’autonomie importante et les foyers aux revenus modestes. En résumé, ce texte apportera une meilleure réponse aux attentes et aux besoins des personnes et plus de justice sociale.
Toutefois, si une meilleure solvabilisation des personnes aidées permettra de développer l’activité, elle ne résoudra pas toutes les difficultés des services d’aide à domicile que vous avez évoquées, monsieur le sénateur. Il sera nécessaire d’aller plus loin pour restructurer, moderniser et professionnaliser ces services, qui sont des maillons essentiels du dispositif de maintien à domicile.
Concernant l’harmonisation des conventions collectives du secteur, un grand pas a été franchi avec la signature, le 21 mai 2010, de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, cela après dix ans de négociations. Cette convention, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, remplace quatre textes : la convention collective nationale de l’UNADMR, l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural, la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile, la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales et les accords collectifs UNACCSS –Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé. Cette convention collective, majoritaire dans le secteur privé non lucratif, regroupe 220 000 salariés.
Le secteur privé lucratif a également avancé, avec la signature, le 3 avril 2014, d’un arrêté portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, qui a été publié le 30 avril 2014. Les entreprises ont jusqu’au 1er novembre 2014 pour se mettre en conformité avec ce texte.
Le mouvement d’harmonisation des cadres d’emploi du secteur du domicile est, vous le voyez, notable. La nécessaire poursuite de cette tendance dépend des négociations entre les partenaires sociaux, dont le Gouvernement ne doute pas qu’elle sera fructueuse.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de votre réponse et de l’intérêt que le Gouvernement porte aux associations d’aide à domicile, ainsi qu’aux personnes âgées et handicapées qui bénéficient de leurs prestations.
Mme la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, Laurence Rossignol, qui a annoncé un plan d’action pour le secteur de l’aide à domicile en septembre prochain, a promis « des avancées structurelles, des simplifications, une meilleure régulation de l’offre et une intégration des services à domicile, afin de mieux évaluer le juste coût des prestations nécessitant un plus juste financement ». Nous serons bien évidemment très attentifs à cette refondation.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.