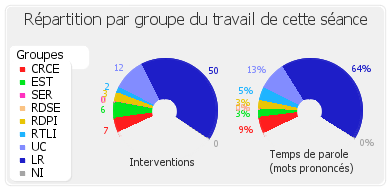Séance en hémicycle du 19 janvier 2015 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, pour finir, comme prévu, la discussion des articles du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République cette semaine, il paraît préférable, en accord avec la commission des lois et le Gouvernement, d’ouvrir, éventuellement, la nuit du vendredi 23 janvier et de siéger, éventuellement, le samedi 24 janvier, le matin et l’après-midi.
En conséquence, l’ordre du jour des séances du vendredi 23 et, éventuellement, du samedi 24 janvier s’établirait comme suit :
vendredi 23 janvier 2015
À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
- Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Éventuellement, samedi 24 janvier 2015
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Il n’y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.

Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Nous poursuivons la discussion des articles.

Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements déposés à l’article 14.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 556 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 691 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 871 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 556 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 691.

d’un amendement de suppression de l’article, car nous sommes opposés au fait que de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale soient arrêtés avant le 31 décembre 2016.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 871.

Personne ne sera étonné que nous demandions également, au travers de notre amendement, la suppression de l’article 14.
D’une part, dès la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, nous avons condamné l’autoritarisme de cette procédure qui contraignait les communes à se regrouper au sein d’intercommunalités ne correspondant pas, le plus souvent, au développement de projets communs et ne s’appuyant sur aucune volonté d’action commune.
Cette disposition est, en fait, un outil d’intégration communale et non la mise en œuvre d’un outil de coopération entre les communes, auquel nous restons attachés. Cela pose une nouvelle fois la question de l’avenir de nos communes… ou de leur évaporation !
D’autre part, nous contestons la volonté exprimée par ce texte de développer de nouvelles intercommunalités, regroupant un plus grand nombre de communes et renforçant encore leurs compétences. Si, en 2010, nous étions opposés au seuil minimum de 5 000 habitants, nous ne pouvons, comme la commission des lois, qu’être en désaccord avec son relèvement à 20 000 habitants.
Autre argument qui milite à ce jour en faveur de la suppression de cet article tel qu’il résulte de la rédaction de la commission : les intercommunalités en place aujourd’hui viennent seulement d’être installées. Elles disposent de compétences nouvelles qu’elles n’ont pas encore eu le temps de mettre en œuvre, dans la mesure où les élus sont en train d’apprendre à travailler ensemble et vont, dans les jours qui viennent, adopter leur premier budget.
En ouvrant dans les prochains mois une nouvelle procédure de concentration, nous allons bloquer leur activité et aucun projet ne pourra être envisagé. Nous craignons d’organiser l’attentisme, la gestion des affaires courantes, alors que la situation économique et sociale de notre pays appelle au contraire une mobilisation publique renforcée.
Enfin, les conditions de modification de la carte intercommunale sont déjà codifiées dans notre législation, il n’est nul besoin d’y revenir. Notre loi est suffisante, puisque, si des intercommunalités souhaitent se regrouper sur la base de projets partagés, elles peuvent d’ores et déjà le faire.

J’incite tous nos collègues à suivre Jacqueline Gourault dans la brièveté de ses interventions. Sa concision n’a pas empêché la clarté de son propos.
Il ne faudrait pas non plus multiplier les interventions, car toutes ces déclarations, certes intéressantes, finiront par nous obliger à modifier profondément nos méthodes de travail : le Sénat débat, contrairement à l’Assemblée nationale ; le temps programmé n’est pas, à mon avis, une bonne chose pour le débat parlementaire, encore faut-il que chacun fasse preuve d’un peu de discipline. Or, monsieur le président, depuis votre déclaration concernant la modification de notre ordre de jour, il est prévu que nous siégions vendredi dans la nuit et éventuellement samedi prochain ; et si cela ne suffisait pas, le lundi pourrait encore s’ajouter !
J’en reviens à l’article 14. Je rappelle que le projet du Gouvernement consistait à refondre complètement la carte territoriale pour tenir compte du nouveau seuil. Je rappelle également que la loi de 2010 prévoyait une clause dite de « revoyure », même si je n’apprécie guère ce terme. Considérant que l’effort n’a pas été consenti partout, cet article vise aussi à regrouper les syndicats faisant double emploi, car il y a encore beaucoup à faire en la matière.
La commission des lois qui, vous le savez, a estimé que le seuil de 20 000 habitants n’était pas pertinent, souhaite que l’on examine ce point, car presque toutes les communes de France font aujourd’hui partie d’intercommunalités. Nous aurons l’occasion de développer ce point lorsque nous examinerons l’amendement du Gouvernement. L’intercommunalité, je le souligne, n’est pas la « supracommunalité » Je vous renvoie au rapport de nos excellents collègues Jean-Pierre Raffarin et Yves Krattinger sur le sujet.
Nous sommes d’accord pour examiner la situation : certaines intercommunalités sont jeunes, d’autres plus anciennes, et des regroupements restent sans doute à faire dans des départements. Nous souhaitons donc conserver cette possibilité, sans pour autant nous livrer à un véritable remue-ménage et tout remettre en cause si rapidement.
La carte de l’intercommunalité étant récente et n’ayant pas été facile à établir dans certains départements, il convient d’y apporter des améliorations. C’est pourquoi nous sommes hostiles à la suppression de l’article ; mais, de grâce, comparez l’article voté par la commission des lois et le projet de Gouvernement !
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Nous maintenons cet amendement et tenons ensuite à rappeler à notre excellent rapporteur que la menace de séances qui se poursuivraient jusqu’à samedi ne suffirait pas à remettre en cause l’expression des groupes. Je ne pense pas que nous en abusions, …

… d’autant que, sur certains articles importants, il est nécessaire de se positionner – d’où ces amendements de suppression.
Je le dis à l’ensemble de cette assemblée : nos débats ne doivent nullement être calqués sur ceux de l’Assemblée nationale, sauf à ce que notre pays perde en démocratie.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent au moins 20 000 habitants.
« Il est toutefois possible d’adapter ce seuil de population, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne du département où se trouve le siège ou dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Il est également possible d’adapter ce seuil de population, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre a évolué entre le 1er janvier 2012 et la date de la publication de la loi n° … du …. portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Il est également possible d’adapter ce seuil pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant toutes les communes d’un territoire insulaire. » ;
1° bis Au début du premier alinéa du II, les mots : « Ce schéma » sont remplacés par les mots : « Le schéma départemental de coopération intercommunale » ;
1° ter Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
La parole est à Mme la ministre.
Dans le texte initial refondu par la commission des lois, nous avions envisagé, en utilisant la clause de revoyure de la dernière loi sur laquelle nous nous sommes alignés concernant les dates, de réintroduire un seuil de 20 000 habitants pour nos intercommunalités, estimant que, pour sauver les communes, rien ne vaut bien souvent l’intercommunalité ; encore faut-il que des bases fiscales importantes lui permettent d’agir.
Nous avons attentivement relu l’excellent travail réalisé, département par département, par le Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, qui a bien montré que ce seuil était un objectif largement atteignable ; nous avons entendu les uns et les autres, en considérant les remarques des élus au cours de nos nombreux déplacements, notamment à Caen, monsieur le président de la commission des lois, mais aussi les observations des associations départementales des maires de France ou des préfets : nous en avons retenu qu’il fallait envisager, non pas des dérogations, car ce mot choque les élus de montagne, mais des adaptations.
Le Premier ministre s’est engagé en ce sens lorsque la densité démographique et/ou la géographie ne permettent pas de constituer des intercommunalités de 20 000 habitants qui fonctionnent dans de bonnes conditions pour les élus, et donc pour les populations.
Face à cette évidence, nous avons envisagé une première adaptation pour les intercommunalités dont la densité démographique est inférieure de moitié à la densité moyenne du département.
D’autres critères, dont nous nous étions ouverts auprès de M. Larcher, ont été testés, comme celui de la distance entre le siège de l’intercommunalité et la commune la plus éloignée de ce dernier. Nous nous sommes toutefois aperçus que le critère de la densité démographique recouvrait tous les autres. Les résultats des simulations sont en effet les mêmes, que l’on retienne la densité démographique, la distance ou le nombre de communes.
Le critère de la densité permet donc de régler nombre de cas, en zones de montagne ou ailleurs. Cette première adaptation tient compte à la fois des observations des élus de montagne sur la nécessité de retenir un seuil différent et des remarques formulées par beaucoup de maires, de présidents de conseils généraux et de parlementaires qui connaissent dans leurs départements des zones de faible densité démographique.
Nous proposons une autre adaptation qui, pour sa part, devient dérogation, car elle n’est pas de la même nature.
En effet, si certaines intercommunalités qui viennent de se constituer depuis le 1er janvier 2012 ne comptent que 17 000 habitants, nous n’allons pas leur demander de tout recommencer.
Le cas est le même lorsque, dans une zone donnée, on peut constituer deux ou trois intercommunalités de 20 000 habitants, puis qu’il reste 17 000 habitants à regrouper.
Si le critère de la densité démographique permet de régler la très grande majorité des problèmes, nous devons aussi prendre en compte le cas des intercommunalités récemment créées – on ne peut pas leur demander de revoir leur copie pour trouver 3 000 ou 4 000 habitants supplémentaires –, et celui des zones frontalières ou littorales qui ne comptent pas suffisamment d’habitants pour atteindre le seuil de 20 000 habitants.
J’en viens aux territoires insulaires. Très peu sont concernés, mais une demande est intervenue de Belle-Île-en-Mer, qui compte plusieurs communes et peut donc constituer une intercommunalité. À l’inverse, d’autres îles appartiennent depuis longtemps à des communautés de communes qui, bien qu’elles soient rurales et dirigées par une majorité de même sensibilité politique que la majorité actuelle du Sénat, estiment que le seuil de 20 000 habitants constitue, pour un territoire rural, le minimum requis pour pouvoir se développer. Ainsi, l’île de Batz, que le président Larcher connaît bien pour avoir eu l’honneur de la visiter, a rejoint la communauté de communes du Pays Léonard.
Il convient de prendre en compte les questions posées, essentiellement, par Belle-Île-en-Mer et l’île de Ré, dont les communes abritent suffisamment d’habitants pour qu’elles puissent travailler ensemble et progresser en s’appuyant sur des outils de développement non négligeables comme le tourisme et l’agriculture.
Des adaptations d’une part, des dérogations d’autre part et, je l’espère, une façon d’avancer qui se traduira par une instruction aux préfets pour leur demander de prendre en compte ces différents critères, en premier lieu celui d’une densité démographique inférieure de moitié à la densité moyenne du département : telle est, monsieur le rapporteur, exposée aussi sommairement que possible, la nouvelle proposition du Gouvernement, issue des multiples discussions que nous avons eues avec les acteurs concernés.
Il faut avoir un horizon, mais aussi faire preuve de bon sens et développer une capacité d’adaptation ou de dérogation pour pouvoir prendre en compte toutes les situations.
Pour conclure, on voit bien que ce sujet suscite des doutes sur la façon de travailler en intercommunalités.
Nous avons discuté tout à l’heure du risque de perte d’identité, mais celui-ci peut être écarté, me semble-il, tant que la commune subsiste. En revanche, que confie-t-on à l’intercommunalité, que peut-on faire ensemble pour lutter contre les violentes inégalités entre les territoires ?
Il me semble qu’une petite intercommunalité perdue au milieu d’une zone de densité démographique moyenne à l’échelle de la France n’a pas beaucoup de chance de résister à une nouvelle concurrence entre les territoires. Aujourd’hui, l’association des maires ruraux s’inquiète notamment du fait que les intercommunalités rurales affichent souvent un faible taux d’emprunt et une pression fiscale très basse, car la base fiscale est tout simplement insuffisante pour mobiliser une population sur des projets structurants.
Au nom de l’intérêt général que nous devons défendre – c’est la mission d’un exécutif –, nous devons être lucides sur les difficultés de ces intercommunalités, dont certaines ne sont même plus en mesure de faire face aux dépenses liées à leur école primaire.
Je ne sais pas si l’on rendrait service à ces intercommunalités en les empêchant de disposer de moyens supplémentaires. En effet, le monde est difficile, et ceux de nos concitoyens qui partent vivre en milieu rural, s’ils acceptent d’avoir peu de services au début, ne l’acceptent souvent pas longtemps, quitte à devenir parfois un peu « difficiles », selon les termes des ruraux.
De la même façon, nous devons gagner dans nos territoires ruraux la bataille du maintien de la terre agricole et du développement de l’agroalimentaire, qui est en danger aujourd’hui, et qui le sera demain si l’on n’y prend garde. J’ai souvent insisté sur ce point, non pas pour défendre absolument nos territoires ruraux, mais pour les porter, car ils nous sont vraiment indispensables.
Quand on parle de densification, de prise en compte de tous ces mètres carrés précieux qui sont ceux de l’agriculture ou des espaces naturels qui nous protègent, il faut que l’intercommunalité en charge de ces terres dispose de quelques moyens. Or ceux-ci sont très limités quand on regroupe trop peu d’habitants.
C’est pourquoi le Gouvernement a ouvert le débat avec cet amendement, qui prévoit ces adaptations et ces dérogations.
C’est au contraire relativement simple, me semble-t-il :…
… un horizon ; une adaptation pour les zones de montagne et, plus généralement, pour les zones où la densité de population est faible ; enfin, une dérogation pour les intercommunalités de 16 000 ou 17 000 habitants qui viennent de se constituer, et une autre pour les îles.

Le sous-amendement n° 1180, présenté par M. F. Marc, est ainsi libellé :
Amendement n° 1105, alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d'une presqu'île
La parole est à M. François Marc.

J’ai entendu avec intérêt les arguments développés à l’instant par Mme la ministre sur la nécessité de proposer des adaptations.
Je partage l’idée selon laquelle il convient aujourd’hui de développer une logique globale de l’intercommunalité dans le cadre de cette législation nouvelle.
J’approuve aussi ce qu’elle a dit sur la nécessité d’avoir une ambition. Si l’on veut une intercommunalité qui réussit, qui apporte des services à nos concitoyens, qui sert l’intérêt général, il faut qu’elle dispose de ressources, et donc de bases fiscales suffisamment larges et significatives.
Dès lors, il me semble légitime de viser une taille minimum pour disposer de cette capacité d’agir et pour apporter ainsi du sens aux prestations assurées pour satisfaire l’intérêt général.
Des adaptations s’avèrent toutefois nécessaires.
Je souscris parfaitement aux évolutions suggérées s’agissant de la densité de population dans les territoires ruraux et de montagne. Il s’agit, me semble-t-il, d’une adaptation significative par rapport à la taille d’intercommunalité recherchée, qui permettra aussi, comme l’a souligné Mme la ministre, de répondre aux préoccupations de nombre d’élus de ces secteurs.
Je propose simplement que, parmi ces adaptations qui portent, pour l’une d’entre elles, sur les territoires insulaires, l’on tienne également compte des presqu’îles.
Lorsque vous êtes sur une île, que vous regardiez au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest, vous voyez…. de l’eau ! §En revanche, sur une presqu’île, vous voyez de l’eau devant vous, à gauche, à droite, et un peu de territoire derrière vous. Pourtant, il est parfois difficile de créer des liens avec ce territoire qui peut être relativement éloigné géographiquement, et cette particularité peut être à l’origine de difficultés importantes en matière d’organisation territoriale pour faciliter l’accès des services aux habitants.
Je propose donc, à travers ce sous-amendement, que la dérogation prévue pour les îles soit étendue aux presqu’îles.

L'amendement n° 600, présenté par M. A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 1°, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de coopération intercommunale » ;
La parole est à M. Alain Marc.

Mon amendement, qui vient en complément du vôtre, vise à faire en sorte que les préfets ne soient pas tout-puissants. J’ai bien entendu que vous alliez leur envoyer une circulaire. Toutefois, aujourd’hui, leur comportement est très éloigné de vos propositions. En effet, alors que nous sommes en train de discuter de ce projet de loi, les préfets, notamment celui de l’Aveyron, accompagnés des sous-préfets, sont en train de réunir les présidents d’intercommunalités, dont je fais partie, pour envisager les adaptations et les évolutions possibles de ces dernières.
Madame la ministre, si vous pouviez faire cesser ce hiatus administratif, lequel va à l’encontre de votre volonté d’adaptation qui me semble très positive, je retirerais mon amendement.

L'amendement n° 76, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé soit par le représentant de l'État dans le département soit à la demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des membres présents pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, des bassins de vie, des schémas de cohérence territoriale et du territoire vécu au regard des compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale du département.
« Afin de préserver des espaces de cohérence, de proximité, d’accessibilité aux services, les établissements publics de coopération intercommunale doivent comporter au maximum cinquante communes. Le représentant de l'État dans le département peut déroger à cette règle notamment pour les périmètres issus de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Roland Courteau.

Par cet amendement, nous vous proposons que le seuil fixé dans le projet de loi initial puisse être abaissé soit par le représentant de l’État dans le département, soit à la demande de la commission départementale de coopération intercommunale, à la majorité des deux tiers des membres présents.
Il s’agit de tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, des bassins de vie, des schémas de cohérence territoriale et du territoire vécu au regard des compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale du département.
Par ailleurs, cet amendement tend à permettre au représentant de l’État de limiter le nombre maximum de communes d’un EPCI afin de préserver la proximité, les espaces de cohérence et d’accessibilité aux services.

L'amendement n° 410, présenté par M. Montaugé et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « au moins 5 000 » sont remplacés par les mots : « un multiple de 5 000 habitants, en fonction de la densité d’habitat du territoire concerné, les seuils sont définis par décret » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. Bertrand et Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 937, présenté par M. Delebarre, Mmes Bonnefoy, Herviaux, Guillemot et S. Robert, MM. Germain, Haut, Botrel, Courteau et Montaugé, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;
… ) au 1°, après le mot : « département », sont insérés les mots : « sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres, »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Cet amendement a été déposé par l’ensemble du groupe socialiste.
Alors que le Gouvernement est entré dans le débat avec la volonté de fixer un seuil à 20 000 habitants, la commission des lois a supprimé ce seuil, pour en revenir à celui qui est actuellement en vigueur de 5 000 habitants.
Les membres du groupe socialiste estiment quant à eux qu’il serait utile de fixer un objectif de façon à inciter les intercommunalités à se regrouper, tout en jugeant le seuil de 20 000 habitants trop élevé. Nous proposons donc de le fixer à 15 000 habitants, ce qui apporterait plus de souplesse à ce dispositif.
Pourquoi regrouper les EPCI ? Cela ne répond pas à une simple volonté de disposer d’établissements toujours plus gros. Toutefois, nous le savons, il existe encore sur nos territoires trop de petits EPCI qui n’auront pas les capacités de faire face aux dépenses ni de rendre les services attendus par la population.
Nous prévoyons en outre des adaptations pour les territoires insulaires et les zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Nous avons par ailleurs souhaité donner aux commissions départementales de coopération intercommunale, à une majorité qualifiée, la possibilité de saisir le préfet pour obtenir une dérogation à ce seuil.
La solution de facilité serait de ne toucher à rien, de laisser les choses en l’état. Nous estimons au contraire qu’il convient de permettre aux EPCI de se regrouper et d’atteindre une taille et une force suffisantes. Cet enjeu est important.
Il en est de même de ce projet de loi, qui est essentiel pour nos collectivités, nous ne cessons de le répéter depuis le début de cette discussion. Nous allons non seulement renforcer la compétence des régions en matière économique et conforter les départements, mais encore construire des intercommunalités d’une taille suffisante
Ce n’est pas une question de taille ! sur les travées de l’UMP.

C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste, au lieu de rester dans le statu quo, fait un pas en proposant d’abaisser le seuil de 20 000 à 15 000 habitants.

Nous proposons de tenir compte des adaptations et aménagements présentés par la ministre, parmi lesquels la densité est une bonne idée en ce qu’elle permet non seulement de bien cibler les dérogations, mais aussi de donner la possibilité à la commission départementale de coopération intercommunale – c’est-à-dire aux élus locaux – de formuler une proposition au préfet si elle estime que, dans un coin du département et en dépit de ces adaptations, ce seuil de 15 000 habitants n’est pas adapté.
Cette solution équilibrée pourrait peut-être satisfaire tout le monde. Beaucoup ont déclaré au cours des débats qu’il fallait, pour arriver à un consensus, trouver un point d’équilibre. Le statu quo n’en est pas un et ferait courir au Sénat le risque d’être prochainement désavoué par l’Assemblée nationale et de voir le seuil remonter à 20 000 habitants. Le dispositif proposé, qui est raisonnable et peut faire l’objet de dérogations, va au contraire dans le sens de l’intérêt général. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a déposé cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je me permets de rappeler que l’Association des maires de France, dont le congrès s’est tenu il n’y a pas si longtemps, dans sa très grande majorité, s’est opposée à ce seuil. Elle n’en veut pas ! Certes, rien ne nous oblige à tenir compte de cet avis…
Marques d’approbation sur les travées de l’UDI-UC.

Quelles que soient les études retenues, madame la ministre, je reconnais l’effort de compréhension du Gouvernement sur les problèmes que rencontrent les collectivités en matière d’intercommunalité.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela dit, vous nous promettez monts et merveilles en la matière, mais hormis la création d’une mission obligatoire pour les offices de tourisme ou la prise en charge des gens du voyage, permettez-moi de douter des nouvelles compétences des intercommunalités !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Le Gouvernement propose de maintenir le seuil de 20 000 habitants tout en suggérant des adaptations. Je tiens tout d’abord à vous rappeler, s’agissant des communes de montagne, que la loi de 2010 n’avait prévu aucun seuil pour ces dernières. Telle est la loi actuellement en vigueur.

En effet, les conditions géographiques sont telles que même un seuil de 5 000 habitants ne pouvait pas coller !

Toujours est-il que revenir au seuil de 20 000 habitants serait une régression pour les communes de montagne.
Les possibilités d’adaptation seront de la responsabilité du préfet, dont j’ai toujours reconnu la force de proposition, sans préjudice des pouvoirs de la CDCI. D’ailleurs, en 2010 déjà, je défendais déjà les représentants de l’État, et ceux qui leur étaient opposés sont ceux-là mêmes qui les défendent aujourd’hui ! J’espère que, de l’autre côté de l’hémicycle, on ne va pas se mettre à les attaquer ! §
J’ai beau avoir bien lu l’étude d’impact, madame la ministre, je ne sais toujours pas à quoi correspond ce seuil de 20 000 habitants. On aurait tout aussi bien pu inscrire 25 000 que 15 000…
Selon moi, tout dépend des territoires. Le critère de densité moyenne auquel vous faites référence ne fonctionne pas pour un département très rural, où les dérogations et adaptations ne seront de toute façon pas possibles.
Oui ! sur les travées de l’UMP.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne sais pas quel technocrate a encore inventé cela, mais c’est bête conne chou ; ou alors je n’y comprends plus rien !
Rires sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur Alain Marc, si c’est bien à la CDCI de délibérer, je crois que, dans notre beau pays, c’est le représentant de l’État qui propose.
Monsieur Courteau, vous êtes également favorable au seuil de 20 000 habitants, …

… ce qui est contraire à la position de la commission.
Les dérogations que vous proposez ne sont pas suffisantes. Je pense notamment à la limitation du nombre de communes membres d’un EPCI à cinquante et à la possibilité de dérogation pour tenir compte des périmètres issus de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales.
Monsieur Kaltenbach, vous avez défendu l’amendement du groupe socialiste visant à abaisser ce seuil à 15 000 habitants. Nous pouvons jouer aux enchères descendantes, si vous le souhaitez.
Rires sur les travées de l'UMP.

J’ai moi-même fait une enchère descendante, puisque la commission souhaite en rester au seuil de 5 000 habitants, monsieur Kaltenbach.
Certains semblent ne pas comprendre que la mise en œuvre de la loi de 2010 a été difficile. Il a fallu convaincre toutes les collectivités…

Par ailleurs, certaines intercommunalités viennent tout juste de voir le jour. Plutôt que de leur proposer des adaptations, il faudrait les dispenser de seuil. Comment comptez-vous distinguer celles qui pourront y déroger des autres ?

Pour toutes ces raisons, la commission, qui reste soucieuse de la recherche d’un consensus…

… et qui a conservé le principe d’une révision de la carte et de la mise en place d’un nouveau schéma, …
La proposition de François Marc pour les presqu’îles s’inscrit dans le cadre du projet de circulaire adressé aux préfets concernant les zones frontalières, la mer ou la montagne. Là aussi, nous sommes face à une impossibilité physique.
Le Gouvernement est également défavorable aux autres amendements que le sien. Je voudrais toutefois apporter quelques précisions.
On a beaucoup parlé des départements de Savoie et de Haute-Savoie, par exemple, qui présenteraient des difficultés. Or le texte ne conduirait aujourd’hui aucune des intercommunalités de ces deux départements à bouger. Aucune !
En Lozère, qui compte 24 intercommunalités…
… en dessous du seuil fixé, compte tenu de l’ensemble des adaptations, nous accepterions aussi qu’elles ne bougent point. Vous voyez là un exemple typique d’adaptation.
Vous dites que le dispositif est compliqué, mais la France est compliquée ! §
Je continue mon énumération.
Prenez le territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, le Var, le Tarn, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Haute-Savoie, la Savoie, le Rhône, les Pyrénées orientales, le Nord, la Moselle, et la Lozère : dans ces départements, une seule intercommunalité, dans le pire des cas, serait susceptible de bouger ! En réalité, peu de départements sont concernés, puisque 29 % des EPCI s’interrogent.
Je tiens à souligner par là que les adaptations, et non pas les dérogations qui ont été demandées, sont nombreuses. Elles sont codifiées, seront inscrites de façon explicite dans la circulaire envoyée aux préfets, et la commission départementale de la coopération intercommunale aura naturellement pour mission de contrôler les projets.
On l’observe depuis quelque temps dans de nombreuses zones que l’on connaît bien, ceux d’entre vous, comme François Marc, qui ont assisté à des anniversaires d’intercommunalités rurales, ont rapporté que le président, contre toute attente, acceptait et encourageait les avancées, au risque de ne bénéficier d’aucun seuil critique d’action.
C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ces amendements et que je continue à défendre le nôtre. Toutefois, le Gouvernement n’est pas plus républicain que la République, et si notre proposition n’était pas acceptée, nous pourrions nous orienter vers une position de repli.
Nous sommes face à un vrai problème d’intérêt général, …
Mme Marylise Lebranchu, ministre. … puisque nous sommes le seul pays d’Europe à compter 36 000 communes et à avoir pris la décision de garder nos communes.
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Seulement, nous constatons tous ensemble que le sentiment d’abandon monte dans ces territoires ruraux, alors que nous avons des communes, des intercommunalités à taille modulable, des départements, et des régions.
L’intérêt général conduit l’exécutif à s’interroger sur le fait que, dans des zones très urbaines, l’hyper-richesse côtoie l’hyper-pauvreté, ce qui provoque parfois l’indignation chez les habitants et conduit à des événements dramatiques tels ceux que l’on a connus en Bretagne et qui pourraient se reproduire.
Ensemble, sans ironie et sans querelle, on peut se demander pourquoi, dans certaines communautés rurales, les habitants sont à ce point dépourvus de ressources. Face à ces très grandes difficultés, nous devons nous poser cette question fondamentale et tout faire pour y apporter des solutions !
En France, il existe une profonde inégalité entre les territoires, et voilà sans doute vingt ans que ces inégalités augmentent progressivement ! Pouvons-nous nous contenter d’être spectateurs ou devons-nous essayer d’agir ? C’est le fond de la question.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. S’agissant de l’étude d’impact, Mme la ministre a brandi un tableau. Or la commission n’a jamais reçu ces informations !
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Comment voulez-vous que l’on discute sérieusement si nous n’avons pas tous les éléments ? Dans la mesure où l’étude d’impact initiale était complètement nulle, même si le Conseil constitutionnel a jugé que cela répondait aux critères…

Je vous signale que l’étude d’impact portait non sur ce texte, mais sur le précédent.
Comment voulez-vous que l’on soit en mesure d’apprécier la situation sans avoir tous les éléments ? Ce n’est pas du tout convenable ! De même, lorsque des amendements sont déposés au dernier moment sans que nous puissions les discuter, nous ne pouvons pas travailler correctement. Je vous le dis, ce n’est pas ce soir, en séance, que nous trouverons un compromis, même si, personnellement, je le regrette.
Le sous-amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote sur l'amendement n° 1105.

Je partage entièrement les arguments de M. le rapporteur à propos du seuil de 20 000 habitants. Pourquoi pas 15 000, 25 000 ou 30 000 ? Pourquoi introduire une nouvelle norme à gérer, alors que nous tentons justement de les diminuer.
La commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire avait été saisie pour avis sur l’article 14, et nous avions déposé un amendement de suppression de ce seuil de 20 000 habitants.
Nous avions alors proposé, comme M. Marc, que ce soit la commission départementale de la coopération intercommunale qui décide du seuil requis selon les départements. Cependant, dans la mesure où la commission des lois a abaissé le seuil à 5 000 habitants, notre amendement n’avait plus d’objet, ce qui n’empêche pas qu’il ait été voté en commission à la quasi-unanimité.
Le fait de vouloir imposer ce seuil de 20 000 habitants est une absurdité qui soulève une profonde inquiétude chez les élus ruraux, puisque dans certains territoires il faudrait entre 80 et 100 communes pour atteindre ce seuil. À cela s’ajoute un problème de distance avec le siège de l’intercommunalité qui engagera évidemment des frais supplémentaires.
L’Association des maires de France, qui représente principalement les intérêts des maires ruraux, est opposée, me semble-t-il, au seuil des 20 000 habitants. L’intercommunalité doit être au service des communes, et non l’inverse.
L’intercommunalité doit pouvoir gérer dans un territoire ce que la commune ne peut assumer. Elle ne pourra néanmoins pas tout régler. En associant vingt, trente ou quarante communes pauvres, on ne créera jamais une intercommunalité riche, et même en multipliant le nombre d’habitants.
Dans les communautés de communes rurales où les décisions ne sont pas prises librement, les choses ne peuvent pas fonctionner. Même si l’intercommunalité dispose des moyens nécessaires, il faut aussi un projet commun, fédérateur.
On parle de 20 000 habitants en milieu rural, mais en milieu urbain, c’est peu. Il serait peut-être préférable d’augmenter ce seuil à 50 000 habitants en ville. On voit bien qu’il est difficile d’imposer un seuil global.
Notre territoire, comme le disait Mme la ministre, est divers et varié : nous avons des montagnes, des zones de plaine peu peuplées. Nous devons sortir d’une logique purement quantitative pour privilégier une logique qualitative qui serait plus adaptée aux réalités territoriales.
Nous devons faire confiance aux élus locaux et les laisser gérer leurs territoires ; ils sont suffisamment expérimentés pour savoir qu’un territoire de 8 500 habitants fonctionne correctement en intercommunalité. Laissons-les en paix !
Il faut aussi veiller à maintenir de la stabilité dans nos périmètres de communautés de communes. Certaines d’entre elles ont changé de périmètre trois fois : comment peuvent-elles mener à bien des projets et favoriser la croissance ? C’est impossible !
Pour toutes ces raisons, je suis tout à fait opposé à l’amendement du Gouvernement.

J’ai le sentiment, chers collègues, que l’on oppose l’ambition à la raison.
L’ambition du Gouvernement est de fixer le seuil à 20 000 habitants, seulement il s’agit là simplement d’un chiffre, d’une limite. C’est envisageable en milieu urbain, mais c’est autre chose du point de vue de la raison. Nous avons parlé des presqu’îles et des îles : une île, pour moi, est un endroit difficile d’accès, et les territoires ruraux sont parfois assimilables à des îles ou à des presqu’îles, en raison de leur éloignement.
Je viens du département de la Côte-d’Or, où il a fallu, pour créer une intercommunalité avec 20 000 habitants, réunir six cantons, tous pauvres. Seulement, on ne marie pas la misère à la misère !
Lors de l’examen de la dernière loi où cette fameuse limite à 5 000 habitants a été retenue, nous nous étions battus tous ensemble, et nous avions réussi à en créer deux dans le département de la Côte-d’Or. Toutefois, comme nous avions marié une intercommunalité riche avec une intercommunalité pauvre, le résultat est que, depuis deux ans, elles se battent pour des bases fiscales.
La conclusion de tout cela est que maintenant les ruraux disent que l’intercommunalité coûte trop cher !

Je crois qu’il faut les laisser faire.
La ruralité, c’est une chance pour la France. La France est une mosaïque de 36 000 communes, dont 80 % ont moins de 500 habitants.
Comme l’a dit M. Marc, il faut avancer ; cependant, cela nécessite un rééquilibrage, qui peut parfois prendre du temps, et il faut donner du temps au temps. Un Président de la République a dit, mais il l’a emprunté à un saint bourguignon qui s’appelait Saint Bernard : « Aimer, c’est donner ». Alors donnons !

Je voudrais commencer par saluer la sagesse de la commission des lois, de son président, et naturellement de son rapporteur.
Pour appuyer mon propos, je prendrai pour exemple le département dont je suis l’élu, le Bas-Rhin. Celui-ci compte trente-quatre intercommunalités, qui couvrent l’ensemble de son territoire. Quelques-unes d’entre elles comptent de 10 000 à 18 000 habitants. Leur fonctionnement est salué par tous, surtout par la population, qui commence enfin à identifier ses EPCI, voir à s’y identifier.
Dès lors, pourquoi casser ce qui fonctionne ? Nous le savons tous très bien, un mariage forcé ne marchera jamais. Pardonnez-moi, mais je trouve franchement stupide de remettre tout cela en cause ! Tout le travail mené par les commissions départementales de la coopération intercommunale, les CDCI, en totale concertation avec les collectivités concernées, et avec leur accord, aurait été fait pour rien ?
Laissons faire les élus ; ce sont des gens responsables, qui savent ce qu’ils font et ce qu’il faut à leur collectivité. En tant que président d’une association départementale des maires en contact régulier avec les EPCI et l’ensemble des élus, je puis vous assurer, mes chers collègues, que les élus concernés par des EPCI fragiles sont également conscients de leurs difficultés. Ils sont déjà en train de travailler pour fusionner, sans qu’on les y oblige.
Ce n’est pas le nombre d’habitants qui fera qu’une intercommunalité sera forte ou non ; prenez plutôt en compte les bassins de vie, ainsi que le dynamisme et les projets des territoires !

Je prendrai l’exemple de la communauté de communes dont j’étais président avant d’être élu sénateur. Composée de sept communes, elle comprend 17 000 habitants. Elle est aujourd’hui considérée comme une communauté de communes forte du département du Bas-Rhin.
Une autre communauté de communes regroupe 15 000 habitants répartis sur dix communes, dont le bourg-centre, qui compte plus de 10 000 habitants. Fusionnez ces deux communautés et, vous verrez, cela ne marchera plus : leurs projets, leurs compétences, leurs orientations ne sont pas les mêmes !
Enfin, une troisième communauté de communes, qui compte 33 000 habitants, ne fonctionne pas bien. Pourquoi, dès lors, casser la communauté de communes de 17 000 habitants qui, aujourd'hui, marche ?
Il n’est nul besoin de légiférer sur ce sujet, madame la ministre. Ayez un peu de bon sens, faites confiance, pour une fois, aux élus locaux, et retirez votre amendement.
Mme Sophie Joissains applaudit.

Les dispositions de l’amendement déposé par le Gouvernement constituent, à mes yeux, une belle avancée : il s’agit manifestement d’introduire de la souplesse pour la fixation du seuil à 20 000 habitants. Ce faisant, on reconnaît en réalité que ce seuil ne peut pas tenir, car aucun critère objectif ne permet de le défendre.
Notons d’ailleurs, cela a été souligné par Claude Kern, que certaines intercommunalités de moins de 20 000 habitants fonctionnent parfaitement bien. Elles ne se plaignent pas de leur sort et n’ont pas nécessairement envie d’évoluer, parce que la loi les y obligerait.
Le dispositif de cet amendement prévoit des outils devant permettre d’adapter le seuil pour les territoires insulaires ou les zones montagneuses. Mais la liste est-elle vraiment complète ? N’y a-t-il pas d’autres situations, non prévues par le présent amendement ? Et que faire, dans ce cas ?
En outre, la rédaction de l’amendement ne précise pas qui réalisera les adaptations de seuil. Il s’agira probablement de la CDCI, où siègent les élus eux-mêmes. Dès lors, s’ils ont l’intention d’adapter le seuil, ils n’ont pas besoin, pour ce faire, d’une règle supplémentaire, fixée par la loi. Cela se fera naturellement.
Il se peut aussi que le préfet soit chargé de ces adaptations. Si c’est le cas, cela irait à l’encontre même des intérêts des maires. J’ai sous les yeux un compte rendu faisant état des réactions de maires siégeant à la CDCI. Ils expriment très largement des réserves quant à la modification des périmètres de leurs communautés et craignent de voir leurs intercommunalités intégrées dans une fusion contre leur gré.
Toute décision en ce sens émanant de la préfecture s’opposerait à l’avis d’élus communautaires qui sont issus du suffrage universel et qui, rappelons-le, ont été fléchés lors du dernier scrutin municipal. À ce titre, ils revendiquent s’être engagés sur un programme communautaire et entendent le mettre en œuvre. Il serait donc incohérent de revenir sur une situation qui est le fruit d’une élection tenue il y a encore peu de temps !
À l’appui de votre amendement, madame la ministre, vous faites valoir que les intercommunalités éprouvent des difficultés. Les élus sont conscients de la raréfaction des deniers publics – ils ont parfaitement reçu le message de la diminution de 11 milliards d’euros des dotations aux collectivités territoriales – ; ils sont également conscients que leurs actions publiques doivent être plus efficaces.
Je crois qu’on peut leur faire confiance, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, les débats sur ce sujet au sein des CDCI sont largement engagés. Je ne crois pas que les élus fassent preuve de mauvaise volonté en la matière. Passer par la loi, ce serait donc leur donner le sentiment qu’on les oblige à évoluer. Ils sont plus proches des réalités du terrain : s’il y a souffrance, ils sauront réagir et prendre les décisions qui conviennent.
Ensuite, depuis le 1er janvier 2015, ont été créés, je le rappelle, des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. Donnons-leur la possibilité d’échanger sur les questions intercommunales et de prendre leur destin en main ; ils en sont tout à fait capables. En tout cas, cela ne se fera pas par des mesures jacobines, sans véritable logique, qui tomberaient d’en haut.
Pour terminer, nous venons de décider que de nouveaux schémas départementaux devront être adoptés pour le 1er janvier prochain. Les discussions sont bien engagées, car, pour respecter l’échéance, tout devra être bouclé pour le mois de juin prochain. Dès lors, laissons-les se concerter !

Je voudrais à mon tour louer la sagesse des propositions de la commission des lois. Je ne comprends pas l’entêtement du Gouvernement à vouloir maintenir un seuil.
Nous n’avons déjà pas retiré beaucoup de satisfaction de l’examen du projet de loi sur le redécoupage des régions, où l’on a imposé un nouveau schéma à l’ensemble des élus, lesquels, pour la plupart, y étaient opposés... Avec le présent texte, on veut procéder de la même façon, à un moment où, pourtant, on parle beaucoup de liberté.
J’ai interrogé les maires du département que je représente. Je n’en ai guère trouvé qui soutient l’idée d’instituer un seuil pour l’intercommunalité.
Pourquoi vouloir casser ce qui marche ? Dans le département que je représente et que vous connaissez parfaitement, madame la ministre, l’intercommunalité s’est organisée et fonctionne plutôt bien. La communauté de communes que je préside doit être la plus intégrée du département ; pourtant, elle ne compte pas 20 000 habitants. Cela ne veut pas dire qu’elle ne marche pas bien : au contraire, elle a des leçons à donner à beaucoup d’intercommunalités plus peuplées. C’est dire que ce seuil n’a pas de légitimité pour ce qui concerne l’opportunité de l’exercice des responsabilités.
Je ne comprends pas ce que veut le Gouvernement, et en tout cas je le regrette. Il vaudrait mieux instituer des notions plus réalistes, comme celle du bassin de vie, par exemple, qui semble beaucoup plus logique.

Pour les départements comme le mien, dont le territoire, restreint, est bordé par la mer d’un côté et par les grosses intercommunalités de l’autre, il n’est pas aisé de créer des intercommunalités comptant plus de 20 000 habitants.
J’espère que la raison prévaudra et que l’on s’en remettra à la grande sagesse des élus locaux, qui ont su montrer leur capacité à s’organiser. Ce n’est pas en mettant en cause les 36 000 communes de France que l’on apportera une réponse adaptée à la situation.

Comme beaucoup ici, j’assiste depuis quelques jours à des cérémonies de vœux. Or le sujet qui anime notre débat est régulièrement évoqué par les élus que l’on rencontre en ces circonstances et il revient dans toutes les prises de parole des présidents.
Comme M. Canevet, je suis d’une région où l’intercommunalité est désormais chose ancienne. Elle a émergé dès le début des années 1990 ; dès que la loi, en somme, s’est appliquée. C’est une région, en effet, où l’intercommunalité se pratique avec conviction.
Le premier argument mis en avant par les élus pour s’opposer à la mesure dont nous discutons tient à la remise en cause du travail conduit il y a seulement deux ans. C’est une réaction que l’on pouvait attendre et que l’on peut entendre.
Toutefois, j’entends aussi d’autres arguments, mes chers collègues, exprimés de façon dépassionnée, car nous avons une certaine expérience de ces questions. Une idée ressort principalement : nous avons besoin d’intercommunalités ayant une masse critique suffisante, pour des raisons que j’ai notées et que je partage évidemment.
Nous en avons besoin, par exemple, pour pratiquer les solidarités territoriales. J’étais hier sur le territoire de Lannion-Trégor, une grosse communauté, si l’on peut dire, qui compte 80 000 habitants, répartis sur un territoire dont une zone est très rurale et l’autre est spécialisée dans l’industrie de pointe. Dans cette intercommunalité, la richesse est partagée : 700 000 euros sont répartis entre les communes, dont beaucoup sont petites.
Un autre élément revient souvent dans la bouche des élus : certaines communes doivent trouver les moyens en ingénierie pour venir en appui des conseils municipaux et des maires. Or cela ne pourra se faire que dans des intercommunalités de dimension suffisante.
M. Canevet a indiqué que les 36 000 communes pourraient être remises en cause. Au contraire, mes chers collègues, dans des intercommunalités de dimension suffisante, les communes, pour des raisons de subsidiarité, ont encore plus de raisons d’exister. Elles en ont d’autant plus que les transferts de certaines de leurs compétences aux intercommunalités ont été opérés il y a quelques années, sans que leurs ressources aient vraiment baissé, ce qui leur a permis de continuer à vivre dans des conditions tout à fait acceptables, me semble-t-il.
On peut toujours débattre du seuil d’habitants. J’ai entendu les arguments exposés par Mme la ministre ; je considère qu’il y a là, manifestement, une avancée. Elle aurait d’ailleurs été encore plus grande si le sous-amendement de M. François Marc, qui visait à prendre en compte les presqu’îles, avait été adopté !
L’amendement n° 937, qui a été défendu à l’instant par Philippe Kaltenbach, tend à fixer le seuil à 15 000 habitants, ce qui représente, à mon sens, une masse critique significative. On peut bien sûr trouver des accommodements en fonction des situations locales, qui sont nombreuses. Elles sont tellement nombreuses, d’ailleurs, que l’on pourrait aisément retomber aujourd’hui dans le débat qui nous a animés lors de l’examen du texte relatif à la délimitation des régions et qui a vu la présentation d’un projet différent par orateur, ou presque !
Porter le seuil à 15 000 habitants, en donnant une large marge d’appréciation et de manœuvre aux CDCI, me semble tout le contraire de l’approche jacobine dénoncée tout à l’heure ; il s’agit bien plutôt d’une approche girondine, qui prend en compte les particularités des territoires.

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le texte de cet amendement. J’ai même, sur sa base, réalisé une simulation pour le département de la Marne, qui compte 566 000 habitants, soit une densité moyenne de 74 habitants au kilomètre carré. Si l’on retire Reims, ses 217 000 habitants et sa densité de 1 250 habitants au kilomètre carré, le calcul est bien entendu différent ! Or quinze intercommunalités, sur les trente que compte le département, connaissent une densité de population inférieure à moitié de la densité moyenne du département.
Sur cette base, j’ai également élaboré un « pré-schéma », pour voir ce que cela donnerait. Je peux vous le dire, madame la ministre, la mesure que vous défendez conduit à un résultat inverse de ce que vous recherchez. En effet, les intercommunalités dont la densité est supérieure à la moitié de la densité moyenne du département, contraintes de s’unir, se situent dans le territoire périurbain. Elles vont donc faire front pour empêcher les agglomérations de grossir, …

… une évolution déjà difficile dans le milieu rural, qui n’y est pas naturellement enclin.
Avec les seuils et les regroupements obligatoires, des zones entières bloqueront le développement des agglomérations pendant des années ! De même, forcer au regroupement d’intercommunalités d’une densité deux fois moindre que la moyenne, notamment autour de bourgs-centres éloignés des agglomérations, créera des « poches », qui entraveront aussi le développement de ces dernières. Le système est totalement contreproductif ; je tenais à le souligner.
Nous venons de vivre le regroupement des communes au 1er janvier dernier, avec les contraintes fiscales. Une commune de mon département rend de l’argent aux contribuables compte tenu de son adhésion par obligation à l’intercommunalité ! En effet, l’harmonie fiscale a été impossible à trouver avec les directions des impôts : la seule solution, c’est de rendre de l’argent. C’est tout de même extraordinaire ! Nous avons là un cas d’espèce illustrant la complexité du dispositif.
En ces temps de vœux, les élus que nous rencontrons nous font part de leurs craintes sur la proximité, sur les disparités des compétences – telle communauté n’a pas la compétence scolaire, par exemple – et sur les différences de fiscalité, comme sur la taxe des ordures ménagères.
Ma communauté de communes de 10 000 habitants n’a pas de siège ; c’est la mairie de la commune-centre qui en tient lieu. Les services sont mutualisés. Elle n’a pas non plus de fonctionnaires ; ce sont ceux de la commune qui sont mis à sa disposition. Le seuil des 20 000 habitants nous obligera à avoir un siège. Surtout, avec plus de cent communes, il n’y aura plus ni proximité ni représentation. La meilleure manière d’abandonner les habitants du monde rural – un phénomène contre lequel vous prétendez lutter –, c’est d’éloigner encore les centres de décisions ! J’insiste sur la gravité de la situation.
À chaque équipement correspond une taille critique de population. Un seul d’environ 5 000 habitants correspond à une structuration des communautés de communes autour des collèges. Si l’on veut une structuration autour des lycées, il faut 40 000 habitants ou 50 000 habitants. Là, on obtient la taille critique pour rationaliser les services et faire des économies. Ces dernières, on peut aussi en réaliser dans les petites intercommunalités, de 5 000 habitants ou 10 000 habitants, qui sont à taille humaine. Mais le seuil intermédiaire que vous proposez ne fera que complexifier la situation !
Le plus sage serait de faire confiance aux commissions départementales de coopération intercommunale et de favoriser par des dotations les intercommunalités qui mutualisent leurs moyens pour des équipements ou de services précis. Là, il y aurait une vraie politique incitative, en fonction des contraintes propres des territoires !
MM. Alain Houpert et Jean-Claude Lenoir applaudissent.

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour explication de vote.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Madame la ministre, même si cela ne saute peut-être pas aux yeux, nous avançons.
Marques d’ironie sur diverses travées.

En effet, l’amendement du Gouvernement ne nous satisfait pas entièrement, mais il a au moins le mérite de faire bouger les lignes.
M. le rapporteur a indiqué que la commission souhaitait un compromis. Cela suppose que chacun fasse un bout de chemin. D’ailleurs, en France, nous n’avons peut-être pas suffisamment la culture du compromis, ce qui pose un certain nombre de problèmes.
Le Gouvernement a proposé des avancées extrêmement importantes sur les possibilités d’adaptation ou de dérogation, ainsi que sur les pouvoirs des commissions départementales de coopération intercommunale, sous l’autorité des préfets. Tout cela va dans le bon sens, mais ce n’est sans doute pas suffisant.
Nous le savons, les seuils posent toujours problème. Celui qui se fait verbaliser à 93 ou 94 kilomètres-heure sur une route départementale où la vitesse est limitée à 90 kilomètres-heure se dit que le seuil devrait être à 95 kilomètres-heure !
Le seuil des 20 000 habitants pose peut-être en plus un problème psychologique. À mon avis, l’amendement du groupe socialiste tend à permettre de garder une taille critique pour les intercommunalités. En effet, le Gouvernement a raison de vouloir une taille critique : il faut que des dynamiques puissent se créer.
En ce début d’année, je forme le vœu que nous cessions d’opposer le rural et l’urbain. Il n’y a pas, d’un côté, les élus ruraux, dont je fais partie, qui auraient du bon sens et détiendraient la vérité révélée, et, de l’autre, les élus urbains, qui auraient nécessairement toujours tort !
Pour un élu départemental et, plus encore, pour le président d’un exécutif départemental, c’est la quadrature du cercle au quotidien. Il faut faire cohabiter des élus de territoires extrêmement ruraux et des élus de territoires extrêmement urbains, qui ont tous une légitimité et qui doivent tous être animés par le souci de l’intérêt général départemental. Avançons donc aujourd'hui et cessons de les opposer !
Madame la ministre, votre proposition de seuil peut-elle évoluer encore un peu ? Essayons d’arriver à une taille convenable tout en tenant compte des spécificités locales ; ce sera d’ailleurs le rôle de la commission départementale de coopération intercommunale. Nous le savons, il existe certaines absurdités. Il est parfois impossible de faire travailler ensemble deux communes, d’ailleurs moins pour des raisons politiques, les deux maires pouvant être de la même sensibilité, qu’en raison de rivalités de clocher remontant à des temps immémoriaux.
À mon avis, les commissions départementales de coopération intercommunale permettront de prendre en compte de telles réalités. Cela devrait nous permettre de retenir votre idée d’un seuil sans pour autant violer les consciences !
Exclamations.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Je profite du débat sur le seuil des 20 000 habitants pour interroger Mme la ministre sur les instructions qui ont été données aux préfectures au cours des derniers mois.

Au lendemain des élections municipales, lors d’une réunion organisée à la préfecture de Haute-Normandie, en présence des 245 maires nouvellement élus, venus s’informer du fonctionnement de services auxquels ils pourraient avoir recours, j’ai eu la surprise d’entendre le secrétaire général considérer le seuil des 20 000 habitants comme acquis et inciter les édiles à s’organiser en ce sens.
J’ai dû intervenir pour lui signaler que le Parlement n’avait encore rien voté de tel, et il m’a répondu qu’il suffisait de lire la presse pour savoir que ce seuil serait retenu !
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Voilà qui explique pourquoi les élus se sentent sous pression et manifestent à juste titre leur étonnement, voire leur désaccord, en s’interrogeant sur l’opportunité d’élargir les intercommunalités avant même d’en avoir parlé ! Ils se sont rebellés contre les seuils, car ils veulent être acteurs de la stratégie de développement de leur territoire. Pour eux, un territoire, c’est aussi un bassin de vie, de projet et de développement ; ils en ont la responsabilité.
J’attire donc l’attention du Gouvernement sur les pressions exercées sur les élus avant même que les dispositions ne soient votées démocratiquement au Parlement. §
M. Bruno Sido s’exclame.

Je partage totalement l’analyse de notre collègue René-Paul Savary, pour qui le seuil des 40 000 habitants, c'est-à-dire celui d’une structuration autour des lycées, correspond à l’échelle de rationalisation de l’action publique. Je pense qu’il faut entendre ses propos, qui sont importants.

En même temps, je rejoins notre collègue Michel Canevet sur la pertinence du raisonnement en termes de bassins de vie. Il faut que les citoyens s’identifient à un véritable territoire. Certes, il y a sans doute un travail de définition à mener. Faut-il reprendre celle de l’Institut national de la statistique et des études économiques ? Une définition culturelle est-elle préférable ? S’agit-il des pays ? Nous ne trancherons sans doute pas ce soir, mais je pense que, de toute manière, il faut creuser l’idée des bassins de vie.
Nombre de nos collègues, cela m’a particulièrement frappé, ont souligné que beaucoup d’intercommunalités fonctionnaient mal. Mme Catherine Morin-Desailly nous a apporté un début d’explication : il arrive que les habitants, voire les maires de deux communes ne s’entendent pas ! Certes, il existe également des intercommunalités où une belle dynamique se crée, par exemple autour d’un président consensuel. Néanmoins, ce n’est pas le cas partout, beaucoup d’intervenants ont insisté sur ce point.
Madame la ministre, les débats de ce soir nous offrent une solution : il faut des intercommunalités avec un seuil de 40 000 habitants, conçues autour des bassins de vie et des pays !
Exclamations amusées.

Surtout, pour résoudre le problème des maires qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, élisons les présidents des intercommunalités au suffrage universel direct !
Protestations sur les travées de l'UMP.

Je vois que vous comprenez bien le raisonnement, mon cher collègue ! Et nous pourrions même élire demain les conseillers départementaux à la proportionnelle dans ces grands territoires.
Je pense donc avoir trouvé la solution qui permet d’avancer. Bien entendu, des esprits doivent encore mûrir sur certaines travées, mais vous ne me remercierez jamais assez d’avoir opéré la synthèse entre vous !
Sourires sur les travées du groupe écologiste.

Cela dit, ceux qui veulent ne toucher à rien, ou seulement à la marge, délivrent une nouvelle fois un message extrêmement problématique. Comme l’a souligné Mme la ministre, et nous en faisons tous le constat, les fractures s’aggravent. Certains territoires n’ont rien, tandis que d’autres bénéficient d’une manne, liée par exemple à une centrale thermique ou, dans certains cas, à une centrale nucléaire.
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.

La synthèse que je viens d’esquisser ne sera peut-être pas retenue dès ce soir. Mais elle correspond à ce que ce sera un jour la réalité de notre pays, dans un avenir pas si lointain.

Dans un article, un ancien directeur général des collectivités locales, dont je ne me puis me rappeler le nom, a redessiné notre pays autour de douze à treize régions, de métropoles et de 4 500 intercommunalités, ce qui correspond d’ailleurs, si l’on fait le calcul, au fameux seuil des 20 000 habitants.
La suite de son propos était beaucoup plus grave ; j’espère que Mme la ministre nous rassurera à cet égard. Pour lui, les établissements publics de coopération intercommunale devaient, à terme, être dotés de compétences obligatoires. Or nous défendons tous le principe de la coopérative.

En tout cas, cher collègue, nous sommes une majorité à défendre le principe selon lequel les transferts de compétences des communes vers les intercommunalités doivent s’effectuer sur la base du volontariat. Les compétences obligatoires signifient donc, à terme, la disparition de nos communes. J’aimerais que Mme la ministre nous rassure et nous convainque que nous ne sommes pas sur cette pente glissante.
Madame la ministre, vous avez évoqué avec maints arguments les nombreux petits EPCI, ruraux, qui n’ont pas les moyens, dont la population est mécontente, etc. Je conclurai simplement sur quelques maîtres mots : il faut avoir confiance dans les élus locaux ; ce sont des gens responsables, des gens de bon sens.
Mme la ministre acquiesce.

On affirme que certains EPCI n’ont plus les moyens de fonctionner, mais il faut se demander pourquoi ! La baisse des dotations y contribue tout de même.

Lorsque des EPCI n’ont plus les moyens de fonctionner, par conséquent, il faut faire confiance aux élus pour nouer des rapprochements volontaires. On a parlé de « mariages forcés », qui ne fonctionnent pas. Cela s’est justement produit avec les EPCI qui ont été mis en place récemment. Certains ont été créés dans la douleur. Aujourd'hui, les élus ont besoin de s’apprivoiser, de prendre le temps de souffler un peu.
Madame la ministre, vous aviez annoncé un seuil de 20 000 habitants. Vous proposez aujourd'hui des assouplissements, des dérogations, ce qui prouve bien que, là encore, nous ne pouvons pas avancer à marche forcée.
Par conséquent, moi non plus, je ne pourrai voter votre amendement.

J’ai une certaine expérience personnelle – une vingtaine d’années ! – en matière d’intercommunalité, comme un bon nombre d’entre nous, mes chers collègues. J’ai beaucoup poussé, dans mon département, au regroupement intercommunal, et il n’est pas trop mal réussi. Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui avec de très grandes communautés, en nombre de communes : il faut parfois quatre-vingts communes pour rassembler 40 000 habitants.
Les conseils communautaires comptent plus de cent membres !

S’il y a un leader fort sur ce territoire, la communauté fonctionne. Si tel n’est pas le cas, elle devient difficilement gérable ; c’est l’administration qui prend le pas sur les élus et le conseil communautaire devient une chambre d’enregistrement.
J’en viens aux seuils : 20 000 habitants, 15 000 habitants… La France est diverse et les situations sont très différentes. Le seuil de 20 000 habitants ne pose pas trop de difficulté à notre collègue Savary, puisque sa circonscription comprend une grande ville et des zones rurales. Dans certains départements, une densité de population de la moitié de la moyenne nous amènera à créer des communautés relativement grandes et l’on ne pourra pas aller au-dessous de 20 000 habitants. Toutefois, 20 000 habitants, dans mon département, c’est beaucoup. Dans d’autres départements, c’est peu !
Comment trouver une adaptation ? Il me semble que l’on devrait tenir compte de la densité de population d’un territoire départemental. Cependant, la notion de la moitié de la moyenne peut poser des problèmes. Je pense donc que ramener le seuil à 15 000 habitants serait sage.

Certains départements rencontreront des difficultés. Je le dis d’autant plus facilement que, dans celui dont je suis l’élu, nous avons réalisé de grandes communautés ; ce n’est pas sans poser quelques problèmes, mais je crois que nous arriverons à les surmonter.
La situation est d’autant plus difficile que nous avons de très petites communes. Sur ce point, une réflexion doit être conduite. Je sais que, sur toutes les travées, on évoque la commune nouvelle, avec le regroupement de deux ou trois petites communes pour mutualiser un certain nombre de moyens. En effet, comment voulez-vous avoir les compétences pour faire fonctionner un secrétariat de mairie dans une commune de cinquante, voire de quatre-vingts habitants ? Cette situation suscite des dépenses qui devraient être mutualisées à une autre échelle.
Pour en revenir au seuil, j’aimerais que l’on trouve une solution médiane qui nous permette de maintenir quelques communautés en territoire rural à un niveau de population qui convienne à l’échelle d’un territoire, en s’adossant tout de même à une commune un peu importante. En effet, si quatre-vingts petites communes se rassemblent sans moyens, …

M. Alain Joyandet. Lorsque la réforme nous a été présentée, j’avais cru comprendre que le seuil de 20 000 habitants avait été défini en corrélation avec le projet de suppression des départements.
Mme la ministre le conteste.

Puisque la suppression des départements ne semble plus de mise, il n’y a pas de raison de maintenir un tel seuil.

Par ailleurs, madame la ministre, sans reprendre tout ce qui a été dit, nous peinons encore à digérer la fusion des communautés. Dans un certain nombre de territoires se posent des problèmes majeurs ; certaines communautés veulent même « défusionner ». Dans mon département, la Haute-Saône, trois communautés de communes se sont regroupées, rassemblant des personnes qui ne vivent pas du tout ensemble et qui ne partagent pas les mêmes projets. Nous nous retrouvons dans des situations financières très complexes. Nous ne nous en sortons pas !
Je salue néanmoins le fait que vous recherchiez une solution, madame la ministre. Vous avez donc constaté que cela ne fonctionnait pas. Hélas, je crois que la solution que vous nous proposez ne marchera pas non plus !
Vous avez cité des chiffres pour démontrer que ce seuil était pertinent. Dans mon département, sur vingt intercommunalités, seules trois regroupent plus de 20 000 habitants sans difficulté et fonctionnent relativement bien ; cinq pourront bénéficier de la mesure que vous proposez et douze en seront exclues. La raison est très simple : dans un département qui ne compte pas d’importante communauté urbaine, il n’existe quasiment pas d’écart de densité de population. Or il est difficile d’adapter le seuil pour les EPCI dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne en l’absence d’écart…
Cela signifie que votre « pas en avant », madame la ministre, ne s’appliquera quasiment pas dans mon département, sauf qu’il créera encore plus de confusion au sein des intercommunalités qui s’interrogent et ne vont pas bien, puisque cinq pourront adapter ce seuil et douze n’en auront pas le droit.
Vous ne pouvez pas dire que votre système fonctionne, madame la ministre, alors que tel ne sera pas le cas ! Si vous voulez vraiment instaurer des seuils en corrélation avec la densité de population, il faudrait partir d’une densité de population nationale et prévoir une flexibilité par rapport à la règle générale sur l’ensemble des départements qui se situent en dessous d’un certain seuil de densité.
La sagesse, à partir du moment où les départements sont maintenus, où rien ne vous oblige à créer des intercommunalités de 20 000 habitants et où nous peinons déjà à absorber les dernières fusions serait de laisser les élus locaux un peu tranquilles. Il n’y a aucune urgence à légiférer sur ce seuil !
Il faudrait d'ailleurs nous donner des arguments convaincants sur ce seuil de population, ou sur un autre. Je ne suis nullement convaincu du bien-fondé des 20 000 habitants. Je connais des intercommunalités de 8 000 habitants qui fonctionnent très bien, où la fiscalité n’est pas trop élevée et le nombre d’emplois publics mesuré ; laissons-les tranquilles !
Je suis effaré de constater que certaines intercommunalités de 15 000, 16 000 ou 17 000 habitants qui ont fusionné à partir de petites unités éditent cent cinquante bulletins de salaire par mois !
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Je vous remercie d’avoir engagé la réflexion avec nous. De ce point de vue, les dispositions de votre amendement constituent un pas en avant. Cependant, la solution que vous nous proposez n’étant, à mon avis, guère applicable, il est urgent d’attendre et, surtout, de faire confiance aux élus locaux.
Sourires.

Ce qu’il oublie et que notre collègue Joyandet rappelle indirectement, c’est que dans les petites collectivités se manifestent un volontariat et une mobilisation citoyenne – les écologistes les adorent par ailleurs –, qui ne se retrouvent pas dans les grandes communes, encore moins dans les intercommunalités, où ce sont des fonctionnaires qui accomplissent le travail. Il suffit de regarder les dépenses de fonctionnement des communes en fonction de leur taille : vous saurez tout de suite où l’on peut faire des économies.
Madame la ministre, vous posez une bonne question. Vous vous demandez pourquoi certains territoires ont l’impression d’être abandonnés. La réponse est simple : c’est parce qu’ils sont effectivement abandonnés ! Ils sont abandonnés par le service public. Je pourrais vous parler de La Poste, du personnel des sous-préfectures, de bien des choses… Ils doivent payer pour recevoir la télévision numérique terrestre quand ils ont fini de payer l’installation des relais de la télévision analogique. Il a fallu qu’ils payent les relais pour le téléphone, et je ne vous parle pas du haut débit ! Oui, ils sont abandonnés !
Vous vous préoccupez de la montée des inégalités. Certes, mais l’inégalité est organisée structurellement pour les petites collectivités. Comment se fait-il que, dans la dotation globale de fonctionnement, un habitant d’une commune de moins de 500 habitants rapporte deux fois moins qu’un habitant d’une commune de 200 000 habitants ?

Nous, nous avons des charges de ruralité !
Comment se fait-il que, pour la répartition du fonds de péréquation intercommunale, on ait inventé de magnifiques coefficients logarithmiques, parfaitement inégalitaires pour les petites collectivités ? C’est par une mobilisation de l’État que l’on pourra répondre à cette déshérence progressive de nos intercommunalités.
Vous avez une méthode qui ne coûte pas cher, madame la ministre, c’est de les regrouper, parce que le problème de fond, c’est qu’il faut donner l’impression de faire des réformes, mais sans que cela coûte quoi que ce soit… Est-ce que 20 000 habitants répartis sur 400 kilomètres carrés géreront mieux, seront plus riches, plus efficaces, mieux organisés que 5 000 habitants sur 100 kilomètres carrés ? Permettez-moi d’en douter !
Vous nous avez expliqué qu’il existait une taille critique pour les régions, et vous nous dites qu’il en va de même pour qu’une intercommunalité puisse vivre.
Mme la ministre proteste.

Des seuils de 20 000 habitants, de 15 000 habitants ou de 5 000 habitants, ce sont bien des tailles critiques ; ce sont des tailles à partir desquelles il devient intéressant de fonctionner. Donc, le pari, c’est que plus c’est gros, plus c’est efficace. Eh bien, c’est absolument faux.
Quant à miser sur l’intuition préfectorale, qui saura juger, dans chaque cas, s’il y a bien une péninsule ou une altitude moyenne qui correspond à ce que dit le texte… Vous me permettrez de penser, pour avoir vécu l’épisode précédent, que ce n’est pas ainsi que cela se passe !
Un certain nombre de préfets – pas tous ! – veulent créer des intercommunalités les plus larges possible, car ils pensent qu’ainsi ils récolteront des bons points… Plus ces intercommunalités seront larges, moins elles seront nombreuses, et plus ils seront bien vus.

Peut-être, madame la ministre, mais c'est comme cela que c’est ressenti ! De grâce, laissez les communes agir en fonction des besoins, et certaines intercommunalités deviendront forcément plus importantes. On le voit bien, le mouvement, lancé dans les années 2000, s’accélère. Ce n’est pas avec les mesures que vous proposez que l’on ira plus vite ; il faut laisser le mouvement se déployer.
Les communes existent depuis 1789 ; donnez-leur le temps de se moderniser pour s’adapter complètement à notre époque.

Je soutiens sans réserve la position de la commission des lois, qui a supprimé tout seuil. Je me permets d'ailleurs de rappeler que la seule fois où la référence à un seuil est apparue, c'est dans la loi de 2010, avec une limite de 5 000 habitants. Même la loi Chevènement, contrairement à tout ce qui a pu être dit, ne fixait pas de seuil à 3 500 habitants. Aujourd'hui, il faut absolument renoncer à toute idée de seuil, contrairement à ce que prévoit le projet de loi du Gouvernement.
Au préalable, je tiens à dire combien je suis consterné de lire sur certains visages un sentiment de commisération quand on parle d’intercommunalités dans le monde rural.
Historiquement, après le vote de la loi de 1992, c’est dans le monde rural que la coopération s’est développée sous toutes ses formes, notamment dans le domaine économique et, partant, agricole.
Mme Catherine Troendlé approuve.

Ensuite, je ne voudrais pas être désagréable, madame la ministre, mais le tableau imprimé sur une feuille recto verso en partie manuscrite qui circule depuis tout à l'heure et que l’on pourrait appeler « étude d’impact » me laisse quelque peu songeur. Sur ce sujet essentiel, dont nous débattons depuis des mois, il eût été convenable de fournir à la représentation nationale un document étayé, qui aurait exposé les attendus de votre projet.
Pour l’Orne, un département que je connais bien puisque je le représente depuis longtemps, hier à l'Assemblée nationale, aujourd’hui au Sénat, je conteste vos chiffres. Actuellement, nous avons 29 intercommunalités. Les trois principales représentent pratiquement la moitié de la population du département, qui compte un peu moins de 300 000 habitants. En appliquant le seuil de 20 000 habitants, il y aurait sept intercommunalités supplémentaires, ce qui porterait leur nombre total à 10, au lieu de 29.
J’aimerais vous rappeler, mes chers collègues, un souvenir récent. Il y a trois ans – j’étais alors jeune, ou plutôt nouveau, sénateur
Sourires.

En effet, le bon sens commande de ne pas fixer de seuil. Il faut faire confiance à l’intelligence des territoires. Nous, les élus, connaissons la taille de nos bassins de vie ; nous savons sur quels territoires nous pouvons travailler de façon efficace. Nous n’avons pas besoin de loi qui nous dicte notre façon de nous organiser.
Il y aura des différences, parce que la France est diverse. Respectons cette diversité ! Va-t-on aujourd'hui définir le périmètre des zones qui auront le droit de produire des fromages, pour faire référence à un illustre propos du général de Gaulle sur la spécificité française ? Non ! Faites confiance aux territoires et changez le regard que vous portez sur eux.
Je conclurai avec Honoré de Balzac, à qui j’ai fait référence au début de mon propos : « Un sentiment de commisération se peignit sur sa figure, et il jeta un regard de bienveillance sur les deux filles ».

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, il serait bon que cette disposition d’esprit inspire votre action, pour le bonheur de nos territoires !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

La question des intercommunalités soulève beaucoup de passions, probablement à juste titre.
Madame la ministre, les alinéas 2, 3 et 4 du I de votre amendement me conviennent parfaitement, puisqu’ils reprennent exactement la loi de 2010 ; seul le premier alinéa pose problème. C’est en effet cette loi qui a, pour la première fois, introduit un seuil de 5 000 habitants. Avant, il n’y en avait aucun. Un premier pas a été fait. Faut-il maintenant passer de 5 000 à 20 000 habitants ? La marche est haute !
Dans le département qui m’a élu, j’ai participé à de nombreuses réformes, qui m’ont fait perdre – c'est tout à fait normal ! – beaucoup de voix.

J’ai bien vu que mes concurrents voulaient eux aussi traiter de ces sujets. J’ai pensé qu’il valait mieux que je m’en occupe moi-même, pour obtenir de meilleurs résultats !
J’ai appliqué la loi de 2010 à peu près partout dans le Rhône. Sur le territoire où j’habite, nous avons fait une communauté de commune de 53 000 habitants, en milieu rural, qui couvre 579 kilomètres carrés, soit une superficie plus vaste que la métropole de Lyon !
Nous ne savions pas si cela allait marcher. Puisqu’il n’y avait pas de seuil, rien ne nous obligeait de faire une communauté de communes aussi large. Il importe peu de fixer un seuil, qu’il soit de 5 000, de 10 000 ou de 12 000 habitants. Ce qui compte, c'est que nous avons nous-mêmes pris la décision.
Madame la ministre, votre amendement est sensationnel : il ne s’appliquerait à aucun EPCI du département du Rhône, puisqu’ils sont tous situés en zone de montagne. Je pourrais donc le voter sans problème, puisqu’il serait sans conséquence pour mon département.
Néanmoins, permettez-moi de vous dire que le seuil de 20 000 habitants est devenu un chiffon rouge. Il faut trouver d’autres critères que la simple fixation d’un nombre d’habitants. Notre assemblée n’acceptera pas de relever le seuil de 5 000 à 20 000 habitants. C'est certain, une loi sera votée, peut-être pas ici, mais à l'Assemblée nationale. Toutefois, il faut aussi que les choses se passent bien sur le terrain. On ne peut pas en permanence changer les règles, mettre à feu et à sang les élus locaux, qui ne voudront jamais appliquer ce seuil de 20 000 habitants – certains voudront faire plus, d’autres moins.
Madame la ministre, vous avez commencé à faire de sages propositions. On ne trouvera probablement pas de solution ce soir, mais il faut continuer à travailler à cette question. Je le redis, le seuil de 20 000 habitants est devenu le symbole d’une gestion technocratique.

Certes, puisque ma communauté de communes compte 53 000 habitants. Laissez donc les collectivités s’organiser, et vous verrez qu’elles feront plus.

Toutefois, ne les obligez pas à appliquer un seuil.
Dans mon département, nous avons fait notre communauté de communes parce que nous l’avons voulu, et c’est la seule qui fonctionne. Nous ne sommes ni en avance ni en retard, nous nous sommes simplement mis d’accord.
Je pense très honnêtement qu’il n’est pas possible de faire des réformes territoriales en fixant des seuils. Si les intercommunalités récupéraient une nouvelle délégation de compétence, même de moindre importance, on pourrait peut-être dire qu’il est nécessaire d’atteindre le seuil de 20 000 habitants pour l’exercer. Néanmoins, nous n’avons rien de plus, à part les aires d’accueil des gens du voyage, qui ne suffisent pas à justifier un nouveau seuil. À un moment donné, quand on a écouté tout le monde et que l’on voit que le seuil de 20 000 habitants ne passe pas, il faut chercher une autre solution !

On ne fait pas de la coopération intercommunale pour le plaisir ! Les élus locaux font des intercommunalités, car ils se rendent compte qu’ils doivent se regrouper pour faire ce qu’ils ne peuvent réaliser seuls. C’est aussi simple que cela. Dans un premier temps, on se regroupe à trois ou quatre communes. Dans mon territoire, nous avions besoin d’une crèche, ce que ne pouvait faire une commune de 1 500 ou 2 000 habitants à elle seule. Nous avons donc créé une intercommunalité de 7 000 habitants pour pouvoir la construire.
Pour que nos communes se développent, elles doivent répondre aux besoins de nos concitoyens, qui ont des attentes. Qu’avons-nous à leur offrir quand ils viennent s’installer dans nos communes ? Nous avions une école, un collège à proximité, une crèche. Ils voulaient une piscine, ce qui n’est pas rien. Pour la créer, nous avons dû fusionner trois communautés de communes, ce qui n’est pas allé sans poser certaines difficultés, car elles n’avaient pas toutes les mêmes compétences. Cette nouvelle communauté représente un bassin de vie.
Madame la ministre, l’amendement défendu par notre collègue Kaltenbach ne vise pas à remettre en cause fondamentalement la notion de taille critique, indispensable pour mener à bien un certain nombre de réalisations. Cet amendement, dont les dispositions reposent sur une base de 15 000 habitants, est de bon sens.

Nous avons également proposé, ce qui devrait satisfaire nos collègues qui ne veulent aucun seuil, que ce nombre puisse être abaissé par le préfet, sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale, c’est-à-dire sur proposition des élus. On redonnerait ainsi de la force de proposition aux élus, ce qui renforcerait la démocratie.
L’amendement a également pour objet de prévoir que les conditions climatiques et géographiques et la dispersion de l’habitat soient prises en compte. Nous pourrions, me semble-t-il, trouver un consensus sur les propositions qui figurent dans cet amendement.
Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de faire un geste, d’écouter ce que les uns et les autres ont dit tout au long de ce débat, avec des nuances : réalisons ensemble, dans l’intérêt de nos populations, ce que nous ne pouvons pas faire seuls.
Nous nous rendons bien compte qu’il faut une taille critique. Toutefois, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, puisque le seuil de 20 000 habitants semble cristalliser les oppositions, pour des raisons diverses et variées – pas toujours pour des motifs de fond, du reste –, faites un geste ! Soutenez l’amendement présenté par M. Kaltenbach, qui vise à accorder un rôle important à la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI, et à prendre en compte les réalités du terrain, notamment les conditions climatiques et géographiques.
Je suis sûr que vous permettriez ainsi à cet amendement, qui va dans l’intérêt des communes, d’être adopté.
M. le secrétaire d'État manifeste son scepticisme.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

M. Alain Néri. Monsieur le secrétaire d'État, essayons avant de nous avouer vaincus ! Dès lors, je vous demande, ce soir, de faire ce geste en direction de la représentation nationale et d’écouter la voix du Sénat, qui est celle des communes de France.
Bravo ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.

J’interviens à un moment où tout ou presque a déjà été dit. De l’exposé de Mme la ministre, il ressort beaucoup d’habileté et, d'ailleurs, beaucoup de conviction.

M. Bruno Sido. Cependant, je voudrais lui adresser quelques remarques que personne ne lui a encore faites. Ce sera ma valeur ajoutée…
Sourires.

Je me méfie des dérogations et des adaptations. J’en veux pour preuve celles qui étaient prévues pour la création des nouveaux cantons : vous vous souvenez des zones de montagne, des zones peu denses, des obstacles géographiques, du « plus ou moins 20 % »… Finalement, il se trouve que, dans mon département, et il n’est pas le seul à être dans ce cas, le plus petit canton est urbain et le plus grand rural.

J’ai déposé un recours devant le Conseil d'État, qui m’a donné tort. Depuis lors, je me méfie beaucoup de la parole ministérielle prononcée dans l’hémicycle, ce qui est grave.
En effet, il nous avait été dit, assuré, répété que la population pouvait être inférieure de 20 % à la moyenne nationale dans les cantons ruraux, et supérieure de 20 % à cette moyenne dans les cantons urbains.
Philippe Kaltenbach s’exclame.

On nous cite les zones de montagne, mais celles-ci sont définies par la loi et ne posent donc pas de problème ! En revanche, les zones intermédiaires ne sont pas définies par la loi, et les zones hyper-rurales ne le sont pas davantage.
Comme M. Joyandet, j’ai examiné le tableau de Mme la ministre, qui est très intéressant et très instructif.
Dans les départements hyper-ruraux, la densité de population inférieure à la moitié de la densité moyenne du département ne constitue pas un critère pertinent. En Haute-Marne, une seule communauté de communes remplirait ce critère ! Et, sur nos seize communautés de communes, qui regroupent toutes plus de 5 000 habitants, puisqu’elles ne sont ni en zone de montagne, ni en zone intermédiaire, ni en zone hyper-rurale, celles-ci n’étant pas définies, dix devront fusionner pour atteindre le seuil de 20 000 habitants et neuf, soit une de moins, pour arriver à 15 000 habitants ! Autant dire que l’adoption de l’amendement présenté par M. Kaltenbach ne changerait rien.
L’amendement du Gouvernement tendrait à répondre à un certain nombre de problèmes si son dispositif était appliqué avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de flexibilité et sur la base d’instructions aux préfets adéquates. Je ne doute pas que cela sera le cas, mais nous savons désormais que le Conseil d'État est extrêmement rigoureux en la matière – je le dis sans porter de jugement de valeur.
Madame la ministre, la conclusion de votre propos était, de mon point de vue, très pertinente : il existe des zones riches, qui connaissent une dynamique, et des zones pauvres, qui sont en déshérence et qui n’arrivent pas à se ressaisir. Au fond, vous le savez bien, la dynamisation des zones pauvres est une question de moyens. Allons les chercher là où ils sont, quitte à les prendre à assiette constante, là où il y a une vraie dynamique, là où ils sont trop importants.
Madame la ministre, je partage votre point de vue. Si vous promettez une incitation financière aux intercommunalités situées dans des zones en déshérence, croyez bien qu’elles se regrouperont !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.
M. François Marc s’exclame.

Les dispositions de cet amendement nous permettent au moins de nous expliquer longuement. On le constate, sujet après sujet, ce projet de loi pose plus de problèmes qu’il n’en résout.
Madame la ministre, je veux vous communiquer une information qui date de ce matin. J’ai participé à une réunion des maires de la métropole de Montpellier, consacrée à l’élaboration de notre budget pour 2015. Il est apparu qu’une petite commune comme la mienne, qui compte 18 000 habitants, ne pourra plus investir que 900 000 euros dans la voirie, contre 2, 7 millions d’euros par an jusqu’à présent – et uniquement dans le traitement de surface. Naturellement, cela aura des conséquences dramatiques sur l’emploi et les entreprises !
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.

Vous le savez, j’ai été favorable à la transformation de Montpellier en métropole. J’ai été un ardent défenseur de la belle connexion entre les futures grandes régions et la métropole, notamment sur le plan économique ; M. le président de la commission s’en souvient.
Toutefois, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité de textes flous, peu connus des élus et peut-être même du Gouvernement, mais parfaitement maîtrisés par l’administration centrale, qui en est, en fait, l’auteur. Je l’ai très clairement dit au président de la métropole de Montpellier, qui est mon ami et que je soutiens : nous allons porter un fardeau qui n’est pas le nôtre.
J’en reviens à l’amendement du Gouvernement, qui vise à fixer un seuil minimal de 20 000 habitants pour la création des EPCI. Il se trouve que ma commune – toujours elle ! – fait partie d’une intercommunalité depuis cinquante ans. Un demi-siècle, ce n’est pas rien ! Nous avons donc de l’expérience. Pour présider cet EPCI depuis trente-deux ans, je sais ce qu’est l’intercommunalité.
Comme vous le savez, j’ai été élu sénateur en septembre dernier. Lors de ma campagne, quelque chose m’a interpellé : les maires ruraux, avec qui je n’avais jamais abordé le fond du sujet, ne cessaient de me parler de ce seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités, ce qui m’a rendu curieux.
Mon département de l’Hérault compte vingt-deux intercommunalités, dont dix regroupent moins de 20 000 habitants. J’ai compris, en étudiant le territoire, en parcourant ses différentes parties, ses vallons et ses monts, que l’addition nécessaire pour parvenir à 20 000 habitants impliquerait des choix d’une incohérence absolue.
Il est bien beau, lorsque l’on passe à la télévision, de présenter les élus municipaux comme des personnes formidables, avec des trémolos dans la voix ! Ce qu’il faut, c’est véritablement respecter les élus municipaux et traduire cette considération dans les textes. Pour ma part, je garde à l’esprit le discours qu’a prononcé le Président de la République, l’an dernier, devant les maires de France. Sauf que ses propos n’ont pas été suivis d’effet… Madame la ministre, comme d’aucuns l’ont dit avant moi, vous devez aujourd'hui faire confiance aux maires de France.
Certains problèmes nous viennent à l’esprit. Notre collègue de la Marne a ainsi expliqué que l’intégration, dans une agglomération ou une métropole, d’une commune située à la limite de celle-ci, parce que le préfet l’appelle de ses vœux, pourrait faire s’effondrer le château de cartes. J’ai eu l’occasion d’observer cette même difficulté dans mon propre département.
Très franchement, madame la ministre, ne consacrons pas ce seuil de 20 000 habitants ! Cela ne bouleversera ni votre politique ni la France – ce seuil pourrait faire plaisir à la Cour des comptes, mais ce n’est pas le sujet qui nous préoccupe en priorité…
M. François Marc s’exclame.

Laissons aux communes la liberté de s’organiser, conformément à la loi municipale de 1884, que nous pouvons, ce soir, faire respecter ! §

Je veux tout d'abord saluer la volonté de Mme la ministre de résoudre en quelque sorte la quadrature du cercle. En réalité, nous le voyons bien, nous hésitons entre ne pas forcer les élus à aller au-delà du raisonnable et ne pas bloquer l’évolution de l’intercommunalité. En fait, entre ces deux options, il faudrait que nous trouvions une solution médiane.
Madame la ministre, j’ai examiné avec attention votre proposition, qui dénote votre souci de vous rapprocher de nous. Malheureusement, je n’arrive pas à y trouver ce que j’y cherche.
Je pense, tout d'abord, à l’adaptation du critère de densité. Comme Bruno Sido vient de vous le dire, dans notre département de la Haute-Marne, ce critère ne fonctionne pas. Dans mon secteur, la densité est de quinze ou vingt habitants au kilomètre carré.
Mon intercommunalité regroupe d'ores et déjà cinquante-quatre communes. Comme l’évoquait notre collègue Gérard Miquel, le président d’un tel EPCI doit avoir un minimum de charisme ! Or, avec la loi sur le non-cumul, les parlementaires ne pourront plus occuper cette fonction. Qu’en sera-t-il quand, pour réunir 20 000 habitants, notre intercommunalité comptera quelque 110 communes ?

Pis, j’avais anticipé bien en amont l’application du seuil de 5 000 habitants, en réunissant trois intercommunalités dès 2011. Nous avions alors pu choisir nos partenaires, et nous avions abouti à un coefficient d’intégration fiscale de 0, 8, ce qui est considérable. Or ce coefficient n’est que de 0, 2 dans la commune voisine, avec laquelle mon intercommunalité pourrait avoir à se marier.

On va donc casser vingt ans d’efforts et de rationalisation, sur lesquels on ne devrait pas revenir !
J’en viens maintenant à la possibilité d’adaptation du seuil que comporte le dispositif de votre amendement, madame la ministre. Comme notre rapporteur général, je ne comprends pas très bien sur quoi porte cette possibilité : s’agit-il d’adapter le chiffre ou d’adapter dans le temps ? En tout état de cause, au regard de l’article 60 de la loi de réforme des collectivités territoriales, il paraît difficile de prévoir une adaptation temporaire. Au bout d’un moment, le préfet nous dira que la fête est finie et qu’il faut nous lancer ! On voit bien qu’il y a là un problème.
Comme je vous l’ai dit, je pensais passer par la petite porte, mais, précisément parce que j’ai fait preuve d’anticipation, je me retrouve coincé, sans porte de sortie.
On pourrait trouver d’autres solutions, comme celle de nos amis socialistes. Pourtant, honnêtement, un seuil à 15 000 habitants n’est pas meilleur ! Si j’étais méchant, je dirais même qu’il témoigne d’une certaine méconnaissance du sujet… En effet, à certains endroits, 20 000 habitants, ce n’est pas assez et, à d’autres, 15 000 habitants, c’est encore trop ! Qu’on se le dise.
En réalité, c’est de temps que nous avons besoin. En effet, comme l’a déclaré notre collègue Alain Houpert, nous avions déjà réalisé une révolution, il faut tout de même le dire, avec la fixation d’un seuil à 5 000 habitants. Madame la ministre, je pense que votre intention est bonne, mais que, à vouloir aller trop vite, on risque de courir à l’échec.
En outre, je veux vous rappeler le sort des municipalités cantonales, créées par la Constitution de l’an III : les difficultés à se déplacer ayant entraîné leur échec, elles ont dû être supprimées en l’an VIII. Mais comme, à l’époque, il n’y avait pas de fiscalité, ce recul n’était pas très grave. Il n’en irait pas de même aujourd'hui.
Pour conclure, la seule façon, me semble-t-il, de régler le problème, qui ne se pose, en réalité, que dans les zones rurales et hyper-rurales, c’est la commune nouvelle
M. le rapporteur et M. Bruno Sido approuvent.

Entre-temps, on peut même se servir des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les PETR et, progressivement, territorialiser la fiscalité – M. Savary en a parlé – et les financements. Au demeurant, je suis sûr que M. Morvan ne manque pas d’idées sur ces questions…
Sourires.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, et tant que vous n’aurez pas trouvé la martingale – je reconnais qu’elle est difficile à imaginer –, je suivrai la voie de la commission des lois, c'est-à-dire celle de la confiance dans les élus. §

En un peu plus de deux ans, nous sommes allés de renoncements en reniements ! Nous l’avons déjà souligné dans le cadre de la discussion générale, mais nous le voyons encore aujourd'hui : nous sommes en plein dans ce bouleversement permanent, d’où nul cap, nulle vision n’émergent. Ainsi, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, vous nous proposez ce soir des orientations différentes de celles que vous portiez vous-mêmes voilà quelques mois.
Néanmoins, je vais profiter de ces quelques instants pour vous proposer de prendre connaissance d’une démarche et peut-être, demain, de la soutenir.
Il s’agit d’une démarche inédite, qui est menée de manière exemplaire, dans la collégialité, au sein d’un département français ayant choisi, au début des années deux mille, de se doter de deux schémas de cohérence territoriale, ou SCOT. L’un d’entre eux regroupait 30 intercommunalités et 462 communes ; il compte aujourd'hui 476 communes au travers de 20 intercommunalités et a été adopté à l’unanimité des territoires.
Je serais tenté de vous proposer de vous inspirer de cette démarche émanant des territoires, de la France d’en bas ! Elle vous est apportée, non pas comme une dot, mais comme un objet méritant, selon moi, intérêt et considération, mais aussi, peut-être, soutien de votre part.
Pourquoi tenir de tels propos ? Comme bon nombre de mes collègues, je ne partage pas l’idée de fixer un seuil. En revanche, je suis convaincu que nous avons l’obligation de permettre aux territoires qui souhaitent s’engager dans cette voie, et cela indépendamment de leur taille ou de leur organisation, de coopérer dans un certain nombre de domaines, en refondant les dispositifs de dotation, de soutien, d’incitation et d’intéressement.
J’irai encore un peu plus loin. Toujours dans notre département, qui regroupe près de 600 000 habitants, nous travaillons actuellement, à raison d’un euro par habitant, réparti de manière équitable sur le territoire – hyper-ruralité, ruralité, secteurs péri-urbains ou cœurs d’agglomération –, sur le développement économique ou la question des mobilités et des déplacements, que ce soit au travers d’études ou de stratégies foncières. Nous allons notamment engager des travaux sur les ressources et la fiscalité, ou encore sur un schéma d’organisation des services publics et marchands.
Nous entendons livrer ce travail à la commission départementale de coopération intercommunale, car l’organisation des territoires en intercommunalités ou en bassins de vie nous apparaît comme un moyen – peut-être pas le seul, certes – de travailler en articulation avec ces territoires, notamment en mettant à disposition des moyens humains et financiers. Ainsi, nous demeurons dans des échelles pertinentes pour mener à bien un travail de coopération et de proximité !
En définitive, vous l’avez compris, j’en appelle au bon sens et à la reconnaissance des actions menées par les élus sur le territoire.
Selon un adage, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux ! Étant Nancéen et Lorrain, j’y ajouterai cette devise du roi Stanislas : « Le vrai bonheur consiste à faire des heureux ». C’est pourquoi, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, je vous invite à écouter le peuple et les élus, à prendre en compte leurs demandes et avis. Dès lors, peut-être nous aiderez-vous à construire un bonheur territorial !

Beaucoup a déjà été dit. Toutefois, je voulais attirer votre attention sur un point, madame la ministre, vous qui connaissez bien les départements, en particulier les ruraux, ainsi, me semble-t-il, que l’histoire écrite par chaque territoire, chacun à sa façon, dans le cadre des premières lois sur l’intercommunalité.
Il ne faut pas l’oublier, seulement deux ans se sont écoulés, pendant lesquels un travail important a été effectué et de nombreuses réunions se sont tenues. Les élus gardent en mémoire l’investissement qui a été le leur à cette occasion et, à titre personnel, je ne parviens pas à comprendre pourquoi vous voulez, par la loi, mettre tous les territoires sur un pied d’égalité en imposant ce seuil de 20 000 habitants.
Pour tenter de vous convaincre, je mettrai en avant l’exemple de mon département, celui des Deux-Sèvres, qui compte 400 000 habitants. Le nombre des intercommunalités y est passé de 26 à 13, et, pour cela, les élus n’ont pris en compte aucun seuil. En effet, s’ils s’étaient tenus au seuil de 5 000 habitants, ils auraient tout aussi bien pu conserver les 26 intercommunalités ! Il faut donc déjà se rappeler combien ils sont nombreux à s’être investis.
Sur les treize intercommunalités restantes, cinq sont des groupements de taille importante, correspondant à des agglomérations autour des grandes villes, et huit sont, au contraire, situées en territoire rural, sur des distances atteignant parfois 110 kilomètres et avec un nombre de communes significatif, compris entre quarante et cinquante.
On ne peut pas ignorer qu’une intercommunalité a vocation à répondre à des besoins de proximité, à permettre une écoute de la population, à mettre à sa disposition un certain nombre de services. Si nous devions retenir ce seuil de 20 000 habitants, les huit intercommunalités précédemment citées seraient tenues de rejoindre des communautés d’agglomération importantes.
Madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez montré une étude d’impact. Je crois qu’il en faudrait une par département ! Cela vous permettrait de faire un certain nombre de découvertes. Vous constateriez par exemple, dans le cas du département des Deux-Sèvres, que l’application du seuil contraindrait des intercommunalités de 16 000 habitants à rejoindre de grandes intercommunalités de 110 000 habitants. Vraiment, nous faisons fausse route en maintenant ce seuil !
Nous vivons l’intercommunalité chacun à notre façon. Les élus se sont beaucoup investis. Il me semble donc que vous devez les écouter, et cela, quelle que soit leur couleur politique. Des élections auront lieu dans deux mois et, dans de nombreux territoires, on se plaint déjà de ne pas comprendre grand-chose aux nouveaux cantons, dont le découpage ne respecte souvent pas les intercommunalités. Les maires ont besoin d’être rassurés. Il ne faut donc pas trop les traumatiser en les obligeant à organiser de nouvelles réunions.
Enfin, face au message permanent selon lequel il faut être dans de grandes structures pour réaliser de grands projets, je prendrai de nouveau l’exemple du département des Deux-Sèvres. Quelles communautés de communes y ont le plus fort coefficient d’intégration fiscal ? Ce sont souvent, non pas les intercommunalités importantes, mais les intercommunalités des zones rurales ! En effet, elles mettent de plus en plus de moyens en commun et, surtout, elles instaurent des offres de services correspondant aux souhaits des habitants. Leur regroupement dans de grandes structures entraînerait donc une forte déperdition d’énergie.
Par conséquent, madame la ministre, écoutez les élus, notamment ceux des zones rurales. Écoutez toutes les structures qui vous ont lancé ce message. Quant à moi, je partage le point de vue de la commission, consistant à ne pas maintenir de seuil dans le présent projet de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Compte tenu des explications fournies par les uns et les autres, nous pourrions peut-être passer au vote !
Sourires.
M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Mme la ministre a exprimé l’avis du Gouvernement de manière très claire et convaincante, en tout cas à mes yeux.
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.
Nous sommes un peu plus nombreux que cela en France, monsieur le sénateur !
Marylise Lebranchu et moi-même rencontrons aussi de nombreux élus. D’ailleurs, comme vous, nous assistons en ce moment à des cérémonies de vœux dans nos départements. Je puis vous assurer que, dans le mien en Isère, de nombreux élus jugent nécessaire d’aller au-delà du seuil actuel de 5 000 habitants.
En réaction aux différents propos tenus, je tiens simplement à lire quelques extraits d’un document dont je ne suis pas l’auteur : « La faible densité de population dans l’hyper-ruralité impose des efforts plus conséquents qu’ailleurs pour constituer des intercommunalités disposant d’une masse critique suffisante, tant en matière d’ingénierie que de capacités d’action, de représentation de l’hyper-ruralité et d’arbitrage. […] Sauf exception, les EPCI de l’hyper-ruralité ne disposent pas aujourd’hui de la taille critique nécessaire, et il revient à l’État […] de mettre ses interlocuteurs en capacité. »
Ce constat est celui d’Alain Bertrand
Exclamations.
… qui, dans ce même document, propose de fixer par la loi, au moins pour les territoires hyper-ruraux, un seuil minimal de 20 000 habitants.
Par ailleurs, j’ai beaucoup apprécié les propos du sénateur Yannick Botrel et je me contenterai donc de les reprendre. Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, vous qui êtes si attachés à l’existence des communes nées de la Révolution française – mais nous sommes toutes et tous, ici, très attachés aux communes, qui font partie de l’ADN de la République –, …
… sachez que la meilleure façon de les sauvegarder, de justifier leur existence dans les années et les décennies à venir, c’est, comme l’a indiqué Yannick Botrel, de disposer d’intercommunalités assez puissantes.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Plus les intercommunalités seront fortes et grandes, plus les communes, notamment les plus petites, auront leur raison d’être !
Marques de scepticisme sur les travées de l’UMP et du groupe CRC.

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’au vote sur l’amendement n° 1105, puis de lever la séance.
Il n’y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. le président de la commission.

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, le Sénat ne s’engagera pas avec vous dans une sorte de discussion de marchands de tapis. Vous avez bien compris que, pour nous, le problème réside, non pas dans la quotité du seuil, mais dans le principe même consistant à jouer sur ce dernier pour enclencher un nouveau processus de regroupement des intercommunalités existantes. Notre débat est politique ; il n’est pas arithmétique !
Nous comprenons tous vos objectifs. Vous les avez rappelés en citant le rapport de notre collègue Alain Bertrand. Il est vrai que, dans l’absolu, il faut atteindre une certaine dimension pour disposer d’une masse fiscale suffisante, permettant de mettre en œuvre des services à la population, ainsi que d’une administration suffisamment étoffée, avec, à sa tête, une direction faisant le poids. Nous le comprenons bien. Dans nos départements, nous avons nous-mêmes animé le processus de regroupement des intercommunalités ou nous y avons participé.
Néanmoins, à côté de cet objectif, tout à fait estimable, que vous cherchez à atteindre, d’autres éléments sont dignes d’être pris en compte. D’ailleurs, je le constate, vous-mêmes avez compris, depuis l’adoption de ce projet de loi par le conseil des ministres le 18 juin dernier, que le caractère contraignant du dispositif que vous aviez envisagé était excessif, puisque vous nous proposez aujourd'hui des correctifs.
Je salue cet effort que vous faites dans notre direction, mais vous restez en quelque sorte prisonnier de votre raisonnement initial, selon lequel il faudrait relancer le processus de regroupement des intercommunalités à partir d’un seuil de population plus élevé. C’est cela que nous contestons, sur de nombreuses travées.
L’effort que vous réalisez vise à ne pas déstabiliser les groupements de communes récemment constitués ; la plupart d’entre eux se sont constitués cette année, en réaction à la nouvelle direction prise après les élections municipales d’avril dernier. Donner dès 2015 un coup de boutoir latéral à ces groupements de communes en adoptant une nouvelle carte départementale de l’intercommunalité serait de nature à perturber profondément leur fonctionnement et à leur faire renoncer aux projets qu’ils pourraient être en train de concevoir sur la lancée de leur constitution. Vous avez raison de vouloir éviter cet impact négatif.
Par ailleurs, dans le monde rural, il faut être très attentif à ne pas forcer la constitution d’intercommunalités réunissant des territoires si vastes que le sentiment d’appartenance à une communauté ne pourrait pas s’y développer, ou en tout cas pas avant longtemps, faute d’homogénéité et de cohésion. Bien sûr, dans l’absolu, il est bon que les intercommunalités soient suffisamment peuplées, mais, si le résultat est la constitution de groupements sans cohérence ni cohésion, le bénéfice est plus que compensé par les inconvénients.
Je voudrais aussi vous signaler que, dans nos départements – plusieurs de nos collègues l’ont souligné –, nous avons tout de même réussi à constituer des intercommunalités rurales de 35 000, 45 000 ou 55 000 habitants. Bien souvent, nous les avons constituées à partir d’intercommunalités anciennes qui dépassaient le seuil de 5 000 habitants et n’étaient donc nullement tenues de se regrouper dans de plus grandes intercommunalités. Elles l’ont fait parce qu’elles ont estimé que c’était possible sur leur territoire. Elles n’ont pas eu besoin d’être forcées. Elles ne se sont pas regroupées à reculons.
Si, à côté de ces regroupements d’intercommunalités constitués sur une base très volontaire par les élus, d’autres intercommunalités ont préféré en rester à 5 000, 6 000 ou 8 000 habitants, elles l’ont fait elles aussi pour des raisons qu’elles estimaient valables. Pourquoi voudriez-vous que des raisons qui leur paraissaient fondées il y a de cela deux ans aient disparu comme par enchantement aujourd'hui ? Vouloir forcer le passage, c’est avoir l’assurance de créer des difficultés plutôt que d’atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés.
Or l’impact de votre critère de densité, qui m’a séduit au premier abord, est en réalité – vous avez eu la loyauté de nous faire connaître votre tableau – très faible ; cela aussi a été souligné par plusieurs de nos collègues.
Puisque la France compte cent départements, prenons par exemple, et au hasard, le cinquantième ; il s’agit de la Manche.
Sourires.

Il existe vingt-sept établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, dans ce département. Parmi eux, vingt ont moins de 20 000 habitants. Avec votre critère de densité, dix-sept seraient obligés de se regrouper ; ils ne seraient donc que trois à être exonérés de cette obligation. Tel qu’il a été conçu, votre critère de densité ne fonctionne pas.
Je voudrais enfin vous dire que nous observons, dans nos territoires, un phénomène nouveau, qui se propage rapidement : nous constatons un réel engouement pour la commune nouvelle, alors même que la proposition de loi relative à l’amélioration de son régime n’a pas encore été définitivement adoptée. Ce mouvement signifie que nos communes rurales souhaitent conserver des services de proximité.
Quand les communautés de communes étaient des communautés de proximité, puisqu’elles étaient petites, les communes n’éprouvaient pas le besoin de se regrouper, parce qu’elles arrivaient à s’entendre dans un cadre qui leur était familier pour assurer des services en commun. Maintenant qu’il y a de plus en plus de grandes intercommunalités, nos petites communes, qui ont envie de vivre, considèrent que, pour pouvoir continuer à vivre, il est préférable de se regrouper à plusieurs dans un cadre territorial limité. C’est donc la crainte des grandes intercommunalités qui pousse à la constitution de communes nouvelles, afin de gérer dans une bonne entente des services communs, tels que l’école ou la voirie.
Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, il faut absolument – je vous demande par avance de me pardonner cette cuistrerie – changer de paradigme.
Sourires et exclamations.

La loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale prévoit déjà une clause de rendez-vous en 2015. Et de toute façon, un processus doit avoir lieu, avec ou sans loi nouvelle. §

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1105.
L'amendement n'est pas adopté.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Mes chers collègues, nous avons examiné 37 amendements au cours de cette séance ; il en reste 594 à examiner.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, à dix heures trente, à quinze heures et le soir :
- À dix heures trente :
1. Dix-neuf questions orales.
- À quinze heures et le soir :
2. Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée, n° 636, 2013–2014) ;
Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 174, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 175, 2014-2015) ;
Avis de M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission du développement durable (n° 140, 2014-2015) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 150, 2014-2015) ;
Avis de M. René-Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 154, 2014-2015) ;
Avis de Mme Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 157, 2014-2015) ;
Avis de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 184, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 20 janvier 2015, à zéro heure dix.