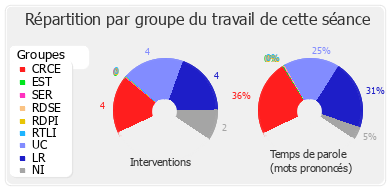Séance en hémicycle du 18 janvier 2005 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'anciens sénateurs
- Décisions du conseil constitutionnel (voir le dossier)
- Saisine du conseil constitutionnel
- Déchéance d'un sénateur
- Remplacement d'un sénateur déchu
- Communication du conseil constitutionnel
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
- Candidature à un organisme extraparlementaire
- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Difficultés des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif (voir le dossier)
- Difficultés des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux à but non lucratif (voir le dossier)
- Inquiétudes sur l'avenir de la couverture médicale en milieu rural en particulier en auvergne (voir le dossier)
- Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le procès-verbal de la séance du mercredi 22 décembre 2004 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

J'ai le regret de vous rappeler le décès de nos anciens collègues Pierre Ceccaldi-Pavard, qui fut sénateur de l'Essonne de 1977 à 1986, et Charles-Edmond Lenglet, qui fut sénateur de la Somme de 1977 à 1995.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, le texte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2004 sur la loi de finances pour 2005 et le 13 janvier 2005 sur la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Acte est donné de ces communications.
Ces décisions du Conseil constitutionnel ont été publiées au Journal officiel, édition des lois et décrets.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil Constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 2004, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, de demandes d'examen de la conformité à la Constitution, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

M. le président du Sénat a reçu du Conseil constitutionnel une décision en date du 23 décembre 2004, constatant la déchéance de plein droit de M. Henri d'Attilio de sa qualité de membre du Sénat.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision sera publiée en annexe au compte rendu intégral de la présente séance.

J'informe le Sénat que M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Jacques Siffre est appelé à remplacer, à compter du 24 décembre 2004, en qualité de sénateur des Bouches-du-Rhône, M. Henri d'Attilio, déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat.

M. le président du Sénat a reçu du Conseil constitutionnel une décision en date du 23 décembre 2004, sur la situation de M. Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision sera publiée en annexe au compte rendu intégral de la présente séance.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif aux perspectives d'activité et aux fonds propres de la société DCN, établi en application de l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de l'Observatoire des territoires.
La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean Pépin pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques et la commission des affaires sociales à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
J'informe le Sénat que les questions orales n° 603 de M. Alain Fouché et n° 604 de M. Daniel Goulet sont retirées à la demande de leur auteur de l'ordre du jour de la séance de ce jour.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 567, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et concerne les conséquences des mesures prévues par le plan de redressement de la branche fret de la SNCF.
La réorganisation des flux et des points de chargement suscite l'inquiétude chez les professionnels de la filière bois, en particulier dans le Morvan. La gare de Château-Chinon, dans sa fonction de « gare-bois », risque d'être délaissée du fait d'une très forte augmentation des tarifs d'embarquement, devenus prohibitifs au motif que la rampe d'accès, située en zone de demi-montagne, réduit le nombre de wagons utilisés.
Cette gare possède pourtant de réels atouts de par sa position géographique au coeur du massif forestier et nous savons que le fait d'éloigner le lieu d'embarquement du lieu de production a pour conséquence inéluctable la réduction de cette dernière. Or la fermeture de cette gare entraînerait l'accroissement du trafic routier, donc la dégradation des routes et les risques d'accidents, et dilapiderait les 4 millions de francs investis avec l'accord de la SNCF avant qu'elle ne modifie sa politique du fret.
Aussi, pour que l'investissement n'ait pas été vain et l'argent public gaspillé, nous demandons avec insistance que les coûts d'embarquement dans les gares du Morvan et de sa périphérie bénéficient d'un tarif unique grâce à une péréquation. Ainsi, seraient préservés les intérêts de la SNCF et ceux de l'entreprise CFTA, chemins de fer et transport automobile, qui gère ce réseau.
En conséquence, nous souhaiterions savoir si la SNCF entend assurer la pérennité du fret ferroviaire, en particulier à Château-Chinon, et envisage d'engager une négociation avec la collectivité de Château-Chinon, le conseil général et la préfecture de la Nièvre.
Monsieur le sénateur, permettez-moi, tout d'abord, d'excuser l'absence de mon collègue Gilles de Robien, qui est à Toulouse pour l'inauguration de l'Airbus A380.
Vous m'interrogez sur les conséquences des mesures du plan fret de la SNCF, notamment pour ce qui concerne la « gare-bois » » de la commune de Château-Chinon.
Je tiens ici à vous faire part de quelques éléments qui me paraissent essentiels pour replacer dans son contexte le plan de redressement que mène aujourd'hui la SNCF.
En quelques mots, le résultat net de l'activité fret de la SNCF en 2003 représente une perte de 450 millions d'euros. De nombreux trafics sont aujourd'hui réalisés à perte pour la SNCF ; le parc de matériel roulant est ancien et la qualité des prestations ne répond pas aux attentes des clients.
Cette situation, en l'absence de réaction de la part de l'entreprise, pouvait conduire à une marginalisation définitive de l'activité fret SNCF. C'est donc dans ce contexte que la SNCF a mis en place un plan de restructuration du fret, visant à restaurer l'équilibre économique de l'activité dès 2006, préalable, à mes yeux, indispensable au développement de cette activité.
Pour ce qui concerne la filière bois, il est également nécessaire de rappeler certains points. Le transport de bois représente 1, 7 % du chiffre d'affaires de fret SNCF, mais constitue 5 % de ses pertes. Le mode ferroviaire est minoritaire dans ce secteur, puisqu'il ne détient qu'un peu plus de 5 % des parts du marché.
C'est ainsi que la SNCF réfléchit actuellement au site de Château-Chinon et met au point un bilan logistique approfondi intégrant les réductions possibles de coûts de production et les hausses tarifaires supportables par ses clients. Mais Château-Chinon accueille surtout des trafics de courte distance et de faible volume, ce qui a correspondu, en 2003, à 3 200 tonnes de trafic, soit 70 wagons expédiés.
Comme elle l'a fait à de nombreuses reprises au plan national avec les représentants professionnels de la filière « bois-papier », la SNCF procède à des réunions régionales afin de définir au mieux la structure du réseau bois à l'horizon 2006.
Par ailleurs, M. Gilles de Robien a demandé à la SNCF que la directrice de la région Bourgogne rencontre les élus locaux pour évoquer l'avenir de la « gare-bois » de Château-Chinon.
II a notamment été demandé à la SNCF d'étudier rapidement la possible reprise d'exploitation de certaines dessertes par des sous-traitants, qui seraient mieux à même de répondre à une demande de transport plus dispersée. Le Morvan est l'une des zones qui a été identifiée dans ce but, puisque l'entreprise CFTA y assure déjà certains trafics.
Nous avons bon espoir, monsieur le sénateur, que cette démarche permette de dessiner des alternatives qui garantiraient ainsi la pérennité du fret ferroviaire dans votre région.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.
Toutefois, je tiens à rappeler que l'activité de la gare de Château-Chinon, qui a porté sur 3 200 tonnes de bois l'an passé, est freinée par le coût de l'embarquement, ce qui réduit considérablement son trafic. En effet, Château-Chinon avait embarqué auparavant jusqu'à 40 000 tonnes de bois.
Pour ce qui est des pertes de la SNCF concernant le fret, je ne saurais, bien entendu, le nier. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est d'avoir laissé faire des travaux pour découvrir un handicap qui existait avant.
Le problème de la rampe d'accès était connu et, pour avoir participé à des réunions sous l'autorité du sous-préfet de Château-Chinon, qui est un représentant de l'Etat, je puis vous dire que la SNCF nous avait elle-même encouragés à entreprendre ces travaux. C'est ainsi que les 4 millions de francs qui avaient été engagés à l'époque sont maintenant perdus, puisque cette activité est réduite à zéro.
Or, il serait pour le moins fâcheux que Château-Chinon considère la réfection de sa gare comme autant d'argent gaspillé. C'est pourquoi je souhaite que la réunion à laquelle s'est engagé le ministère pour la région Bourgogne, et qu'attendent avec impatience le préfet de la Nièvre ainsi que les élus, puisse déboucher sur une reprise d'activité de la gare.
Pour notre part, nous souhaitons que soit mise en place une sorte de péréquation concernant le coût d'embarquement de toutes les gares du Morvan, afin que la gare de Château-Chinon ne soit pas pénalisée par sa rampe très modeste, permettant aux trains de ne comporter que douze ou treize wagons au lieu d'une vingtaine.

La parole est à M. Michel Doublet, auteur de la question n° 580, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la loi n°2204-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a prévu le transfert aux départements des routes nationales d'intérêt local. Ainsi, les parcs de l'équipement devraient voir leur part d'activité pour les conseils généraux s'accroître.
Les ouvriers des parcs et ateliers sont des ouvriers d'Etat, leurs missions sont multiples et répondent aux besoins des collectivités et de l'Etat dans des domaines variés : services routiers, maritimes, voies navigables, bases aériennes. Ils ne sont pas concernés par le transfert des personnels aux collectivités territoriales. Ces personnels d'Etat, dont les activités font annuellement l'objet d'une convention avec les collectivités ou l'Etat, sont donc aujourd'hui dans l'incertitude quant à l'avenir de leurs services.
Une enquête, effectuée par l'Assemblée des départements de France, reflète la disparité des départements : seuls 50% de ces derniers souhaiteraient travailler avec le parc de l'équipement. Aussi, apparaît-il nécessaire de conforter les missions et les statuts des ouvriers des parcs et ateliers et de promouvoir un service de proximité auprès des collectivités dans les domaines de la protection civile, de la viabilité hivernale, de l'entretien routier, de la maintenance de la flotte des véhicules, etc. Le statut de ces personnels offre un panel très étendu des métiers et donne la possibilité de recrutements décentralisés. La disponibilité des OPA, leurs qualifications, la souplesse de leur intervention mettent en exergue toutes les potentialités offertes aux collectivités. L'intérêt économique d'une mise en commun des moyens mérite une attention particulière. Aujourd'hui, le régulateur de prix qu'est le parc de l'équipement dans les missions qui sont effectuées est une référence.
Les personnels demandent leur maintien dans un service d'Etat avec le statut d'ouvrier d'Etat au service des collectivités. Soucieux de leurs missions de service public auprès des collectivités locales, ils souhaitent avoir des assurances sur leur devenir.
En conséquence, monsieur le secrétaire d'Etat, quelles réponses pouvez-vous apporter à ce jour pour rassurer ces personnels quant à l'avenir de leur statut.
Monsieur le sénateur, les parcs de l'équipement sont des parties intégrantes des directions départementales de l'équipement. Ils assurent des missions de service public essentielles, telles que le déneigement des routes, la réalisation de travaux de réfection des chaussées ou bien encore la maintenance des dispositifs de signalisation et d'exploitation routière.
En leur sein, les ouvriers des parcs et ateliers exercent des métiers à forte qualification, fondés sur des capacités professionnelles reconnues. Leur statut d'ouvrier d'Etat permet, pour le service public, le recrutement de compétences spécifiques et nécessaires.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fixe une nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, en particulier dans le domaine routier. Cette nouvelle décentralisation devrait conduire à un transfert aux départements d'environ 20 000 kilomètres de routes nationales d'intérêt local, accompagnés d'une part des services correspondants des directions départementales de l'équipement.
Aussi, l'organisation future des services déconcentrés du ministère en matière d'entretien et d'exploitation du réseau routier national après transfert doit être revue. Cela fait actuellement l'objet de réflexions, l'objectif étant d'offrir aux usagers un niveau de service amélioré et de mettre en place une logique de gestion par grands itinéraires dépassant le cadre départemental.
L'activité des parcs, déjà majoritairement dédiée aux départements, va donc se trouver modifiée d'autant. Le cadre conventionnel, défini par la loi du 2 décembre 1992, qui constitue une garantie d'activités pour les parcs, s'applique. Il importe toutefois, avant la mise en oeuvre des futurs transferts, de définir le nouveau positionnement de ces structures, ainsi que les métiers de leurs personnels.
C'est pour cette raison que la loi du 13 août dernier, que j'ai évoquée tout à l'heure, prévoit, dans les trois ans à venir, la présentation devant le Parlement d'un rapport spécifique.
M. Gilles de Robien a souhaité que cette démarche puisse être menée de la façon la plus transparente et la plus concertée possible. Aussi, il a confié à une haute personnalité extérieure au ministère, M. Jean Courtial, maître des requêtes au Conseil d'Etat, une mission de réflexion sur les parcs de l'équipement, qui associe l'ensemble des partenaires concernés, les représentants des personnels et des collectivités territoriales, principalement des conseils généraux.
Cette mission doit permettre de formuler des propositions adaptées à l'exécution du service public routier, demain, par l'Etat et les départements sur leurs réseaux respectifs. Elle est également articulée avec une approche prévisionnelle et prospective sur les compétences, l'emploi et les métiers des ouvriers des parcs et ateliers qui préserve leurs droits et l'attrait de leur statut.
M. Gilles de Robien a demandé que les principales orientations soient déterminées pour le milieu de l'année 2005, afin de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires, conjointement à la mise en oeuvre de cette nouvelle étape de décentralisation.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre réponse. Nous allons donc attendre la fin de cette mission et le rapport qui va suivre. Nous serons très vigilants sur les conclusions même si, apparemment, il existe une volonté du Gouvernement, à qui nous faisons confiance, de trouver des solutions satisfaisantes pour les uns et pour les autres.

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 609, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux attirer votre attention sur les interrogations, voire les inquiétudes des départements relatives à la mise en oeuvre du transfert des routes nationales, au titre de l'investissement.
On ne peut que constater les différences très importantes des coûts de la voirie entre les départements, ceux qui ont peu de population sur des grands espaces étant très pénalisés. Le coût du kilomètre de voirie départementale par habitant varie beaucoup. A titre d'exemple, chaque habitant a 1, 20 mètre de route « en charge » dans les Yvelines, contre 13 mètres par habitant - dix fois plus ! - dans mon département du Jura, qui n'est pas le plus mal loti.
Le transfert de routes nationales ne doit pas augmenter les charges pour ces départements de superficie très étendue, mais qui sont aussi souvent les plus pauvres et situés en zone de montagne. D'ailleurs, vous connaissez les coûts supplémentaires importants qu'engendrent les investissements nécessaires pour les routes de montagne.
La loi n°2204-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales confie désormais aux départements l'exploitation du réseau routier de proximité. C'est un transfert important. Car, comme vous venez de le dire, monsieur le secrétaire d'Etat, environ 20 000 kilomètres de routes nationales seront transférés aux conseils généraux à partir de 2005. Ce transfert se fait, comme vous le savez, dans un contexte de décentralisation très délicat à gérer en termes financiers et budgétaires.
Les présidents de conseils généraux interrogés par les préfets sur les itinéraires transférés doivent donner leur réponse avant le 31 mars 2005. Comment le faire sans connaître les conditions exactes des transferts financiers sur ces crédits d'investissement ?
Le Jura compte déjà 3 300 kilomètres de routes départementales. Il nous est proposé de reprendre 295 kilomètres sur les 320 kilomètres de routes nationales qui seraient transférés, avec, entre autres, la RN 5 qui relie Paris à Genève et dont le tronçon Poligny-La Cure représente un axe important pour l'économie, le tourisme et le désenclavement du Haut-Jura.
Je souhaite donc, comme de nombreux présidents de conseils généraux, connaître précisément les critères, pour chaque département, qui seront retenus par le Gouvernement pour définir les montants des crédits d'investissements concernant les routes nationales transférées avant de pouvoir répondre au représentant de l'Etat.
Monsieur le sénateur, vous évoquez les inquiétudes des exécutifs départementaux sur les moyens financiers qui accompagneront le transfert des routes nationales, notamment dans les départements où la longueur du réseau transféré est importante, comme c'est le cas dans le Jura.
Je souhaite dissiper vos inquiétudes.
Les départements bénéficieront du transfert de la totalité des moyens matériels, humains et financiers aujourd'hui affectés à l'entretien et à la gestion des routes qui leur seront transférées, y compris le gros entretien, les réparations, etc.
Pour les moyens financiers, nous tiendrons compte, département par département, de la nature de chaque route transférée et, naturellement, de sa longueur, afin d'attribuer au département une compensation équivalente au montant des dépenses précédemment effectuées par l'Etat sur ladite route.
Pour chaque type de voie, le calcul sera effectué en utilisant les mêmes ratios que ceux que l'Etat utilise pour définir les dotations qu'il délègue aux directions départementales de l'équipement.
Concernant les investissements consacrés au développement du réseau, il faut, certes, permettre aux départements d'assumer leurs responsabilités, mais le raisonnement et la méthode doivent être différents.
Le transfert de crédits sur la base d'une moyenne calculée sur les dernières années conduirait en effet à donner plus d'argent à des départements qui en ont moins besoin et, à l'inverse, à donner moins aux départements dans lesquels nous n'avons pas beaucoup investi et où il reste, en conséquence, plus de besoins à satisfaire.
Nous avons donc choisi, dans ce domaine, la méthode du décroisement des financements, dont le principe est simple : les départements ne financent plus les routes nationales et l'Etat ne finance plus les routes nationales transférées. Les régions, quant à elles, seront appelées à participer, au côté des départements, aux investissements pour le réseau national transféré, car ce dernier, comme le futur réseau national constitueront l'armature structurante à l'échelle d'une région.
Les simulations effectuées par la Direction des routes montrent que la situation des départements serait alors équilibrée à l'échelle nationale. En outre, à l'échelle régionale, région et départements confondus disposeraient au total de crédits supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour moderniser le réseau transféré.
Ce résultat serait rendu possible grâce à l'importante innovation introduite par l'Etat dans la loi du 13 août 2004, que vous citiez, à savoir l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA des fonds de concours dont les régions vont notamment bénéficier au titre de leur participation aux investissements sur le réseau national futur.
Si l'on cherche à aller plus loin dans l'analyse en se plaçant à l'échelle départementale, cette situation se vérifie également pour la plupart des départements. Cependant, pour une bonne dizaine de départements, la situation est plus contrastée. Ils vont en effet devoir faire face à de nouveaux financements, sans disposer nécessairement à leur niveau des ressources suffisantes : comment, dès lors, résoudre cette difficulté ?
Une solution consiste, par un raisonnement à l'échelle régionale, à ce que la contractualisation qui interviendra entre la région et les départements permette de neutraliser ces déséquilibres.
Cette solution n'étant pas universelle, d'autres solutions peuvent être imaginées, faisant appel soit, très exceptionnellement, au périmètre du réseau transféré, soit à la mise au point, avec le soutien de l'Etat, de programmes localisés de travaux.
L'évaluation de ces différentes solutions destinées à résoudre les distorsions qui subsisteraient est en cours.
Vous le constatez, le Gouvernement est soucieux des moyens financiers dont disposeront les départements pour assumer l'extension de leurs responsabilités dans le domaine routier et il s'attache à régler l'ensemble des cas, même les cas les plus particuliers.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. Quoi qu'il en soit, nous examinerons, département par département, quelles seront effectivement les sommes transférées. En effet, nous avons aujourd'hui de très grandes disparités entre les départements.
Par exemple, dans le département du Jura, le taux d'exécution du plan est de 18 %, contre 66 % dans certains départements voisins qui disposaient déjà de crédits destinés aux routes nationales beaucoup plus importants.
Par conséquent, reconduire les montants prévus conduirait à des inégalités très grandes.
C'est pourquoi je souhaite que les difficultés rencontrées dans les zones de montagne ainsi que le niveau de richesse des départements soient pris en compte dans le calcul de la dotation des départements. En effet, ces derniers doivent pouvoir faire face à tout ce qui reste à faire et qui n'a pas été fait ces dernières années, au cours desquelles peu d'argent a été dépensé dans le cadre des contrats de plan sur les routes nationales.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a encore beaucoup de discussions à venir sur ce sujet et j'ose espérer que le Jura fera partie des départements à qui sera reconnue une certaine particularité.

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 612, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question concerne les dysfonctionnements constatés dans l'élaboration du plan de gêne sonore, PGS, autour de l'aéroport d'Orly.
Instaurés par la loi par la loi du 31 juillet 1992, les plans de gêne sonore liés aux aéroports définissent, à partir du trafic actuel, des zones à l'intérieur desquelles les riverains peuvent prétendre à une aide financière pour l'insonorisation de leur logement.
Le 25 juillet 2002, le Gouvernement a présenté un rapport intitulé « Pour un développement durable des aéroports parisiens », qui prévoyait la révision, sous un an, du plan de gêne sonore de l'aéroport d'Orly, établi en 1994 et devenu obsolète. La procédure de révision vient de se terminer. Malheureusement, force est de constater que le résultat n'est pas pleinement satisfaisant.
Les trente-cinq communes qui ont été appelées à se prononcer sur le projet de tracé du nouveau plan de gêne sonore ont émis des réserves très importantes. Dans le département du Val-de-Marne, sur les douze communes concernées, dix ont formulé des observations en demandant notamment le respect des engagements formels du Gouvernement.
Première mauvaise surprise : les élus ont constaté que le tracé proposé reposait sur une estimation du trafic à 250 000 mouvements annuels, alors que la limite réglementaire, qui figure dans l'arrêté du 6 octobre 1994, est fixée à 250 000 créneaux horaires pour environ 200 000 mouvements, ce qui est loin d'être la même chose !
De plus, alors que le Gouvernement s'était engagé à un élargissement « très significatif » de la zone d'aide, les frontières du plan de gêne sonore, manifestement déterminées par un modèle informatique, sont une nouvelle fois artificielles et engendrent de très graves incohérences. Ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat, conviendrait-il d'éviter que le tracé ne scinde en deux un même quartier et que les habitants d'une même rue, parfois d'un même pavillon, bien que soumis aux mêmes nuisances, ne soient traités différemment.
A titre d'exemple, la commune de Sucy-en-Brie entre pour la première fois dans le PGS, ce qui est une bonne chose, mais le champ géographique de cette inclusion est malheureusement trop limité, comme le souligne le rapport d'étude réalisé par l'Observatoire départemental de l'environnement sonore, l'ODES.
En effet, pour tenir compte des nuisances sonores réellement supportées par les habitants de la ville de Sucy-en-Brie - mais c'est le cas d'autres communes -, l'étude recommande un élargissement au nord du tracé proposé pour inclure l'ensemble du quartier des Bruyères.
Le même élargissement du tracé du PGS est demandé par le maire de Villeneuve-le-Roi. On sait que cette ville située dans le direct alignement des pistes d'Orly est martyrisée par le bruit et les nuisances environnementales.
Par ailleurs, aucun élément dans le rapport de présentation du plan de gêne sonore ne mentionne la prise en charge éventuelle des travaux de climatisation, alors que le rapport du ministère de juillet 2002 prévoyait pourtant la nécessité d'intégrer les éléments de confort climatique afin d'améliorer le système d'aide. Faudra-t-il donc choisir entre porter des boules Quies ou mourir de chaud ?
Enfin, le plan de gêne sonore et le plan d'exposition au bruit, le PEB, ne couvrent pas les mêmes zones.
Ainsi, lorsqu'un bien immobilier est inclus dans un plan d'exposition au bruit, mais situé à l'extérieur du plan de gêne sonore, il est soumis à des contraintes d'urbanisme sans que le propriétaire puisse pour autant prétendre à une aide pour réaliser des travaux d'insonorisation. Les municipalités, unanimes, demandent donc un alignement des périmètres des deux dispositifs. Au moment où le Gouvernement s'attache à la simplification administrative - nous en avons longuement débattu dans cette assemblée -, je pense que cette revendication pourrait donner lieu à une modification des dispositions actuellement proposées.
Malheureusement, en l'état actuel, ces observations sont restées lettre morte. Le tracé soumis pour avis à la commission consultative d'aide aux riverains n'a pas subi la moindre modification, alors qu'il pouvait être éventuellement revu pour tenir compte des critiques formulées. Bien plus, la date du tracé sur les plans n'a même pas été modifiée.
Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque le bruit est devenu l'un des premiers fléaux dont souffrent les banlieusards qui habitent à proximité des aéroports, notamment du fait des nuisances aériennes qui se multiplient, quelles mesures comptez-vous prendre pour que, d'une part, la révision du plan de gêne sonore respecte les engagements volontaristes du Gouvernement et que, d'autre part, les observations des communes, à défaut d'être entérinées, soient entendues ?
Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser MM. Gilles de Robien et François Goulard, qui sont ce matin à Toulouse pour l'inauguration de l'A 380.
Monsieur le sénateur, la révision des plans de gêne sonore, dont celui de l'aéroport de Paris - Orly, s'inscrit dans une importante réforme du dispositif d'aide à l'insonorisation des logements des riverains des principaux aéroports français conduite depuis juillet 2002.
Par décret du 26 avril 2002, les conditions d'élaboration de ces plans ont été modifiées afin d'élargir les zones qu'ils couvrent et d'augmenter le nombre d'ayants droit aux aides à l'insonorisation. L'indice choisi pour mesurer la gêne est celui qui a été recommandé par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l'ACNUSA, et qui a été retenu par l'Union européenne dans sa réglementation environnementale. La procédure de révision du plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris - Orly a été engagée sur ces nouvelles bases.
Je suis très conscient des inquiétudes légitimes des populations riveraines de l'aéroport de Paris - Orly pour le présent et pour l'avenir. C'est pourquoi Gilles de Robien et François Goulard ont réaffirmé à plusieurs reprises que les conditions d'exploitation de cette plate-forme ne sont pas remises en cause. Ainsi, le couvre-feu est maintenu et le nombre de créneaux horaires attribuables demeure strictement limité à 250 000 par an, conformément aux termes de l'arrêté du 6 octobre 1994.
Les créneaux horaires qui sont attribués ne sont pas forcément tous utilisés. C'est ainsi qu'au cours des dernières années l'aéroport de Paris - Orly a accueilli 219 000 mouvements en 2001, 211 000 en 2002 et un peu moins de 207 000 en 2003.
Pour l'élaboration du PGS, qui, je le rappelle, délimite les zones où les logements des riverains sont éligibles à une aide financière pour des travaux d'insonorisation, il a semblé légitime de prendre en compte l'hypothèse de trafic permettant à un maximum de personnes de bénéficier de cette aide. C'est ce qui a conduit à élaborer le projet de PGS sur la base de 250 000 mouvements par an. Le PGS ainsi révisé compterait environ 43 600 logements éligibles, soit une augmentation de 25 % par rapport au plan actuellement en vigueur.
Après une phase informelle de concertation conduite par les préfets concernés, le projet a été soumis à la consultation officielle des collectivités locales. La CCAR et l'ACNUSA ont par ailleurs rendu un avis favorable à ce projet, respectivement les 14 octobre et 16 novembre derniers. Le plan considéré est en cours d'approbation par les préfets des départements concernés.
Enfin, après l'élargissement des territoires couverts par les plans de gêne sonore, et la revalorisation des ressources financières affectées aux aides, la troisième phase de la réforme vise maintenant à améliorer le fonctionnement opérationnel du dispositif. Le groupe de travail mis en place à cet effet est chargé, entre autres, d'étudier la possibilité d'intégrer des éléments de confort climatique dans les dépenses éligibles. II rendra ses conclusions très prochainement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais tout d'abord vous remercier des précisions que vous avez apportées, notamment dans la prise en compte des nuisances climatiques, car les problèmes se posent de manière particulièrement sensible dans ce domaine.
Par ailleurs, je voudrais, une nouvelle fois, attirer votre attention sur le respect de la distinction entre les créneaux et les mouvements, car ce sont deux concepts qui ne peuvent pas être assimilés l'un à l'autre. Dans les chiffres que vous avez donnés, vous avez bien montré qu'il y a eu des dépassements en termes de mouvements à l'intérieur des créneaux, ce qui a un impact sur l'environnement.
Par ailleurs, je réitère mon souhait - qui est celui des municipalités concernées -, qu'il soit mis fin à l'inadéquation du modèle informatique proposé, qui aboutit parfois à diviser, au sein d'un même pavillon, la salle à manger et la chambre à coucher. C'est absolument incroyable en termes d'indemnisation ! Il faut que ces distorsions puissent être corrigées. Il s'agit là de mettre en valeur l'action du Gouvernement que, bien évidemment, nous soutenons.
Je suis persuadé que ces demandes aboutiront et que ce réel progrès par rapport à ce qui existait précédemment pourra ainsi être mieux compris par les municipalités et par les populations concernées, afin de les protéger contre ce bruit, action qui reste pour nous tous une priorité essentielle.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 614, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la secrétaire d'Etat, voilà maintenant deux ans que les centres éducatifs fermés ont été institués par la loi d'orientation et de programmation pour la justice de septembre 2002.
Ces centres éducatifs fermés sont censés accueillir des mineurs multirécidivistes, placés par le juge « en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ». En cas de fugue ou de manquement grave au règlement, le mineur peut être incarcéré.
Evidemment, le discours officiel martèle que les centres éducatifs fermés sont la dernière chance avant la prison. Mais, loin de diminuer durablement l'incarcération des mineurs, ces centres risquent de l'augmenter, puisqu'ils fonctionnent avec la menace de l'incarcération.
D'ailleurs, nombre de centres ont vu leur périmètre totalement clôturé par des grillages rehaussés d'au moins deux mètres, les entrées contrôlées par un système de barrière infrarouge, le tout est surveillé par des alarmes. Les balcons et les terrasses sont proscrits dans les chambres. Le caractère répressif l'emporte définitivement ! Quelle différence avec les prisons ?
Les éducateurs sont très réticents à concevoir leur mission dans ces centres fermés. La sanction, y compris la privation de liberté, n'est pas éducative en elle-même ; elle ne peut, à la rigueur, le devenir que si elle s'appuie sur la proposition positive de la récompense et de la réussite.
La synthèse du rapport d'étape du 28 avril 2004 sur les centres éducatifs fermés confirme d'ailleurs les craintes que beaucoup avaient les concernant. Elle fait déjà apparaître les confusions et les impasses inhérentes à ces structures.
Par conséquent, que comptez-vous faire pour rendre publique, au plus vite, l'intégralité du rapport d'étape ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier aux problèmes relevés dans le rapport, en particulier en ce qui concerne les droits et libertés des mineurs ?
Plus globalement - j'ai déjà eu l'occasion de faire cette proposition, mais je la renouvelle -, ne serait-il pas opportun d'envisager de mettre à plat les différents dispositifs existants, prisons, centres éducatifs fermés, centres éducatifs renforcés, et de réfléchir plus avant à une politique de prévention et de prise en charge globale en conformité avec l'esprit de l'ordonnance de 1945, laquelle n'est pas du tout désuète en matière de conception des rapports entre les mineurs et la sanction ? C'est ce que préconisait la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs.
Madame la sénatrice, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser M. le garde des sceaux, qui est retenu par une obligation et qui m'a chargée de vous livrer sa réponse.
Après les centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés, créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, sont un outil supplémentaire d'accueil et de prise en charge des mineurs délinquants. Les jeunes placés dans ces établissements, âgés de treize à dix-huit ans, sont en échec total ; ils sont tous multirécidivistes ou multiréitérants. Pour ces jeunes « incasables », les dispositifs existants n'ont pas apporté de réponse adéquate, qu'elle soit judiciaire et sociale.
En effet, au moment de leur accueil, 30 % ont déjà été incarcérés, ce chiffre atteignant 45 % pour les mineurs âgés de 16 à 18ans ; 90 % ont déjà été condamnés ou poursuivis ; 70 % ont déjà fait l'objet d'une mesure de protection administrative ; 76 % ont déjà fait l'objet d'un placement judiciaire et 33 % ont déjà été placés plus de trois fois.
C'est ce qui ressort de l'évaluation à laquelle le garde des sceaux a fait procéder, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Le document que vous évoquez, madame la sénatrice, a constitué un rapport d'étape dans l'évaluation du dispositif. En effet, il a couvert la période d'avril à octobre 2003 et n'a concerné que les quatre premiers centres éducatifs fermés, dits « expérimentaux ». Ce bilan a été complété depuis et porte sur dix-huit mois de fonctionnement. Le ministre de la justice en rendra le contenu public très prochainement.
D'ores et déjà, je peux vous indiquer que les premiers enseignements dégagés à mi-parcours sont confirmés. Les résultats sont encourageants et vont dans le sens d'une amélioration de la situation des jeunes.
Ce bilan prouve qu'un encadrement strict des mineurs, un programme d'activités intensif et un fort engagement des équipes éducatives constituent autant de facteurs de succès dans la prise en charge de ces jeunes multirécidivistes.
Les quarante magistrats de la jeunesse qui se sont exprimés dans le cadre de l'évaluation confirment que le placement en centres éducatifs fermés constitue une réelle alternative à l'incarcération.
De mars 2003 à décembre 2004, 213 jeunes ont été accueillis dans les centres éducatifs fermés. Par ailleurs, entre mai 2002 à janvier 2005, le nombre de mineurs incarcérés a sensiblement baissé, passant de 936 à 623. Il n'est donc pas exact de soutenir que les CEF augmentent l'incarcération des mineurs.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie des éléments de réponse que vous avez bien voulu m'apporter, mais qui n'ajoutent rien à la réponse que M. le garde des sceaux m'avait faite lors de la discussion budgétaire.
Nous attendons la publication du rapport d'étape.
Je ferai remarquer que les centres éducatifs fermés absorbent des crédits très importants et que le renforcement sécuritaire de ces centres est le signe de l'échec d'une approche éducative dans un cadre fermé.
Il s'agit d'un problème de conception. Vous dites que ces mineurs sont « incasables ». Le terme est significatif.
Je réitère donc ma demande, que je formulerai à nouveau devant M. le garde des sceaux lors d'un prochain débat sur la justice, de mettre à plat les différents dispositifs d'accueil des mineurs et faire des comparaisons statistiques entre les jeunes placés dans des centres éducatifs fermés et ceux qui sont en prison, entre ceux qui sont en centres éducatifs fermés et ceux qui sont en centres éducatifs ouverts. Il faut aussi étudier la dimension éducative dans l'emprisonnement.
Je considère que les centres éducatifs fermés nous ramènent, hélas ! aux conceptions dépassées qui prévalaient au temps des maisons de correction.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 611, adressée à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.

Madame la secrétaire d'Etat, à la suite des inondations meurtrières de novembre 1999 dans le département de l'Aude, et de celles, nombreuses, qui les ont précédées, je souhaite attirer votre attention sur deux dossiers précis.
Le premier concerne les financements des dispositifs de prévention des inondations sur l'ensemble du département. Le second se rapporte au projet de protection contre les inondations dans les basses plaines de l'Aude.
Les dernières crues ont provoqué la mort de 25 personnes et entraîné des dégâts d'un montant de près de 400 millions d'euros.
Nul ne sera donc étonné que, sur l'initiative du conseil général, et en collaboration avec les services de la préfecture, le département de l'Aude ait pris une certaine avance dans le domaine de la prévention en mettant en place, bien antérieurement au plan Bachelot, un dispositif de prévention des inondations regroupant 95 % des communes.
C'est là que se situe ma première inquiétude. Selon certaines informations, il semble que les crédits du contrat de plan soient réservés aux actions qui seront conduites dans le cadre du plan Bachelot.
Le président du conseil général de l'Aude m'indiquait au début du mois de décembre que, si cette information devait être confirmée, les dossiers présentés par ce département seraient alors doublement pénalisés. En effet, déjà inéligibles au plan Bachelot, ils seraient de surcroît exclus des autres sources de financement.
Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite donc que vous me donniez des assurances pour l'année 2004, mais aussi pour les années 2005 et 2006.
Quant aux basses plaines de l'Aude, après tant de crues, tant de catastrophes, et celle de 1999 fut particulièrement meurtrière, les populations de cette zone, de Sallèles-d'Aude aux Cabanes de Fleury, et de Cuxac-d'Aude à Coursan, vivent dans l'angoisse permanente qu'un jour prochain - peut-être demain ! - les mêmes causes provoquent les mêmes effets.
Comme je j'ai déjà dit et répété au moins à six reprises dans cet hémicycle, en 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 et 2003, il s'agit d'une situation à hauts risques, d'autant que, depuis le drame de 1999, rien n'a été entrepris sur le terrain.
Pis encore, certains remblais et digues, relevant des Voies navigables de France ou de la SNCF, dont la rupture fut à l'origine de l'effet de vague meurtrier, ont été reconstruits à l'identique.
Ainsi, si rien n'est fait dans de brefs délais, inéluctablement, demain, comme ce fut le cas à maintes reprises par le passé, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets.
Or, voilà dix-huit mois, l'Etat a considéré que les aménagements qu'il avait lui-même définis antérieurement, dans le cadre d'un programme d'ensemble concernant les basses plaines, devaient faire l'objet de modifications.
C'est la raison pour laquelle, en octobre 2003, j'ai interrogé Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie et du développement durable. A l'issue de très longues explications, elle m'a dit être consciente de la nécessité d'aller vite et elle s'est même engagée à réviser les clefs de financements des subventions d'Etat pour les aligner sur des clefs qu'elle qualifiait de plus avantageuses.
Aujourd'hui, c'est-à-dire quinze mois plus tard, j'ai donc tout naturellement souhaité demander à l'actuel ministre de l'écologie et du développement durable si le programme d'ensemble contre les inondations est d'ores et déjà arrêté et si, comme cela a été promis, les financements sont toujours disponibles, s'ils sont plus avantageux et sous quel délai on peut espérer le démarrage des travaux.
Je souhaite que le Gouvernement prenne conscience que chaque jour qui passe nous rapproche peut-être d'une nouvelle catastrophe.
Monsieur le sénateur, vous avez attiré l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les financements attendus de l'Etat dans le cadre du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région Languedoc-Roussillon pour les années 2000 à 2006, et plus particulièrement sur ceux qui sont relatifs à la mise en oeuvre d'actions de prévention des inondations dans le département de l'Aude.
Je vous prie de bien vouloir excuser M. Lepeltier, qui n'a pu se rendre disponible, mais qui m'a chargée de vous communiquer sa réponse.
Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région Languedoc-Roussillon pour les années 2000 à 2006 prévoit en effet que l'Etat apportera durant cette période, conjointement avec la région, des contributions financières pour aider les maîtres d'ouvrage locaux à entreprendre des actions de prévention des inondations.
Les risques liés aux inondations sont en effet particulièrement importants dans votre région, qui fut sinistrée à de nombreuses reprises par des inondations meurtrières. Le volume de ces aides a fait l'objet d'une augmentation dans le cadre d'un avenant conclu après la signature du contrat initial, pour tenir compte de l'importance des actions de prévention dans votre département, dont la nécessité avait été mise en évidence lors des crues catastrophiques qui ont frappé l'Aude et les départements voisins en novembre 1999.
Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause les engagements pris dans le cadre du contrat de plan. Toutefois, la mise en place de ces crédits ne peut se faire qu'au fur et à mesure de la mise au point des projets pouvant être subventionnés au titre du contrat de plan.
Les projets prévus dans le département de l'Aude ont donné lieu à une expertise technique qui a conduit à en revoir la conception. Cette révision n'est pas encore achevée. Mme Bachelot avait fait savoir au préfet de l'Aude que les actions de prévention des inondations à prévoir sur le bassin de l'Aude pourraient faire l'objet, dès l'achèvement d'un programme d'action répondant au cahier des charges de l'appel à projet qu'elle avait lancé le 1er octobre 2002, d'une aide exceptionnelle de l'Etat dans les mêmes conditions que pour les autres programmes d'action déjà retenus à ce jour pour plusieurs bassins fluviaux dans la région Languedoc-Roussillon.
Cette proposition reste toujours valable. Le programme d'action que vous présenterez sera financé même s'il s'inscrit en dehors du calendrier de l'appel à projet lancé par Mme Bachelot. Il permettra de mobiliser les crédits inscrits au contrat de plan.
Sans attendre cette mise au point, l'Etat et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ont déjà mobilisé des crédits importants qui ont permis d'améliorer la prévision des inondations, tant par le financement des travaux de remise en état des rivières et ouvrages hydrauliques endommagés en 1999 que par l'amélioration des dispositifs de prévision des inondations de l'Aude et de ses affluents.
Sur ce dernier point, il faut souligner la mise en service du radar hydrométéorologique d'Opoul, pour 2 millions d'euros, et la transformation du service d'annonce des crues de l'Aude, à Carcassonne, en service de prévision des crues pour les trois départements des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Hérault.
Enfin, des plans de prévention des risques d'inondation et les mesures de réduction de la vulnérabilité les accompagnant ont été mis au point.
Le département de l'Aude est à cet égard un département qui a été privilégié depuis la catastrophe de 1999 dans l'affectation des financements de l'Etat dédiés à la prévention des inondations.
Le Gouvernement entend poursuivre cet effort à l'avenir compte tenu de la gravité des risques auxquels reste exposé le département.

Je remercie Mme la secrétaire d'Etat des réponses qu'elle a apportées à mes interrogations sur le financement des dispositifs de prévention.
En revanche, elle n'a pas évoqué le second volet de ma question, relatif aux travaux de protection sur les basses plaines de l'Aude.
Je rappelle une nouvelle fois combien l'urgence est grande. Je ne le répéterai jamais assez : nous ne sommes pas à l'abri de revivre, dans les basses plaines de l'Aude, les mêmes drames qu'en novembre 1999. Je ne saurais trop insisté sur la nécessité d'aller vite, et même très vite, dans la réalisation des travaux de protection contre les inondations.
Madame la secrétaire d'Etat, je vous serais reconnaissant de transmettre ces inquiétudes au Gouvernement.

La parole est à M. Gérard Roujas, auteur de la question n° 599, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Madame la secrétaire d'Etat, vous n'ignorez pas la sensibilité particulière que revêt le projet de création d'une plateforme aéroportuaire en région toulousaine.
Je ne reviendrai pas sur la première étude liée directement à ce projet et définissant huit sites. Situés tous dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Toulouse, ils sont susceptibles, selon l'étude, d'accueillir une telle plate-forme.
La contre-étude réalisée à la demande des conseils généraux concernés a démontré le peu de sérieux de cette étude et a largement remis en cause les critères choisis pour calculer l'évolution du trafic aérien.
Le conseil régional de la région Midi-Pyrénées a, pour sa part, demandé la réalisation d'une étude sur les complémentarités possibles entre l'aéroport de Blagnac et les autres aéroports régionaux et sur l'impact du TGV en site propre reliant Toulouse à la capitale.
Les conclusions de cette nouvelle étude, dont la qualité et l'objectivité ne sauraient être contestées, sont claires.
S'agissant de la complémentarité entre aéroports, celui de Tarbes pourrait parfaitement s'inscrire dans cette démarche.
Par ailleurs, il semble tout aussi clair que la mise en service d'un TGV en site propre aurait un impact incontestable sur le trafic aérien, et ce pour peu que l'Etat s'engage d'une manière plus ferme et plus précise sur la réalisation de ce projet, et surtout sur la date qui reste encore très hasardeuse. Nous attendons tous, de la part du Gouvernement, une réponse sans ambiguïté.
Enfin, l'une des conclusions de cette étude, fondée sur l'évolution démographique de l'aire métropolitaine Toulousaine, exclut catégoriquement la création d'une plateforme aéroportuaire à moins de soixante-dix kilomètres de Toulouse.
Que la création d'une nouvelle plateforme aéroportuaire se justifie ou non - la démonstration n'est pas encore faite - il est d'ores et déjà possible de trancher certaines questions. Le Gouvernement doit le faire en tenant compte des données nouvelles de cette dernière étude.
Madame la secrétaire d'Etat, ma question est simple : M. le ministre entend-il, compte tenu de ce qui précède, annoncer rapidement l'abandon des huit sites actuellement proposés, tous ces sites étant situés à moins de soixante-dix kilomètres de Toulouse ?

Mon cher collègue, M. de Saint-Sernin avait prévu de vous répondre tout à l'heure. Il n'a pu le faire puisque vous êtes arrivé avec quelque retard. Il a donc prié Mme Guedj d'intervenir à sa place.
Vous avez la parole, madame la secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, voici la réponse que mon collègue Frédéric de Saint-Sernin a préparée à votre intention.
L'aéroport de Toulouse-Blagnac situé à proximité de zones fortement urbanisées a un potentiel de développement limité. Il génère des nuisances sonores vivement ressenties par les populations riveraines. C'est pourquoi, dans un souci de préservation de l'avenir, l'Etat et les principales collectivités territoriales se sont engagés, dès 1998, dans une réflexion approfondie sur le devenir de la desserte aéroportuaire de la région toulousaine et sur l'opportunité d'aménager une éventuelle nouvelle plateforme.
Les résultats des études préliminaires conduites à cette occasion ont été rendus publics en janvier 2003. Après avoir recueilli les observations critiques et les propositions de tous les acteurs concernés relatives aux perspectives dégagées par ces études, le préfet a synthétisé les éléments d'appréciation formulés dans un rapport qu'il a mis à la disposition du public en décembre 2003.
Depuis, d'autres études ont été réalisées, sont en cours ou seront lancées à l'initiative des collectivités ou de l'Etat. Aucune de celles qui sont déjà achevées ne remet en cause les contraintes environnementales et la saturation à terme de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
En tout état de cause, nous tenons à rappeler que l'Etat ne fera aucun choix et ne prendra aucune décision sur l'aménagement d'une nouvelle plateforme pour desservir la région toulousaine sans qu'un consensus intervienne avec les collectivités territoriales concernées.
Par ailleurs, conformément à ce qu'avait annoncé le préfet dans son rapport de décembre 2003, l'Etat a récemment engagé une nouvelle étude qui permettra d'actualiser les prévisions de trafic aérien à long terme. Cette étude prendra bien évidemment en compte les effets, sur ce trafic, du projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.
Ainsi est-il aujourd'hui tout à fait prématuré de définir une limite à l'intérieur ou au-delà de laquelle le site devrait être recherché alors même que le débat sur l'opportunité d'aménager un nouvel aéroport dans la région toulousaine reste ouvert.
Conformément aux décisions du Gouvernement prises lors du CIADT, le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, du 18 décembre 2003, le projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse fera l'objet d'un débat public, et ce dès la fin du premier semestre de 2005. Gilles de Robien a en effet veillé à ce que les études soient menées à un rythme soutenu.
Aujourd'hui, les services de l'Etat et Réseau ferré de France ont achevé toutes les études nécessaires à l'organisation du débat. La commission nationale du débat public fixera avant la fin du premier trimestre 2005 les modalités du débat public, tandis que les dossiers qui seront mis à disposition du public sont en cours d'élaboration.

Je souhaite simplement présenter des excuses pour mon retard et remercier madame la secrétaire d'Etat d'avoir répondu à la place de M. de Saint-Sernin.

En accord avec le Gouvernement et l'auteur de la question, j'appelle la question n° 623.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Roland Muzeau, auteur de la question n° 623, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Cet été, alors que le Parlement examinait la réforme de l'assurance maladie, qui encourage fortement - pour ne pas dire contraint - les patients à s'inscrire dans un parcours de soins articulé autour du médecin traitant, la question de l'accès direct à certaines spécialistes, en l'occurrence aux gynécologues, s'est posée.
M. Philippe Douste-Blazy a émis un avis défavorable sur les dérogations législatives que nous proposions devant permettre aux patientes de continuer à consulter le gynécologue de leur choix dans les conditions actuelles, c'est-à-dire non seulement sans prescription préalable de leur médecin traitant, mais également sans pénalisation financière. En revanche, devant la représentation nationale ainsi que devant le comité de défense de la gynécologie médicale qu'il a reçu, M. le ministre a pris un engagement important.
Je reprends la formulation retenue dans le communiqué de presse du 19 juin 2004, validé par vos services : « L'accès direct de toutes les femmes à leur gynécologue dans les conditions actuelles de remboursement resterait garanti, indépendamment du recours au médecin traitant. »
Rien ne devait changer pour les femmes et pourtant, aujourd'hui, de nouvelles barrières financières sont dressées, de lourdes menaces pèsent sur la liberté et l'égalité d'accès des femmes à une médecine de qualité spécialisée qui leur soit entièrement consacrée.
Bien sûr, est en cause la convention médicale récemment signée par trois syndicats médicaux et l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont l'élaboration s'est faite sous étroite surveillance du Gouvernement.
Vous ne parvenez pas à cacher que cet accord est très controversé. Il est notamment critiqué au fond par MG France, le syndicat des médecins généralistes, et l'ISNAR-IMG, et ce pour plusieurs raisons : sa philosophie étrangère aux enjeux de santé publique et de qualité des soins ; les risques d'institutionnalisation d'une médecine à deux vitesses ; les économies supportées, pour les trois quarts, par les patients en contrepartie de la hausse des revenus des seuls spécialistes ; enfin sa redoutable complexité.
Bien que vous utilisiez à l'extrême l'art de la communication, surfant à l'envi sur l'ambiguïté des mots, nous mesurons le caractère inacceptable des dispositions dudit accord relatives aux gynécologues.
Nous partageons aussi les inquiétudes du SYNGOF, le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, qui considère que « les gynécologues médicaux sont certainement les grands perdants de cet accord et par contrecoup les femmes, puisque le dispositif voté signe à terme la fin de l'égalité d'accès des femmes au gynécologue. »
Mauvaise lecture ou procès d'intention ? Vous aurez compris qu'il faut clarifier la situation ! Examinons donc cet accord en nous attachant précisément aux termes employés.
Tout d'abord, la notion « d'accès direct » n'y figure pas. Seul « l'accès spécifique » est envisagé.
Ensuite, le champ de cet accès spécifique est défini restrictivement. Il est limité à quatre types d'actes pour lesquels les femmes seraient exonérées du passage préalable par le médecin traitant : les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute autorité, la prescription et le suivi d'une contraception, là encore selon des référentiels à établir, le suivi des grossesses, l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
De surcroît, la convention renvoie à la Haute autorité le soin de définir les règles du jeu et d'encadrer encore ces actes via leur fréquence.
Le fait que cette autorité soit un organe scientifique ne suffit pas à me rassurer quant à son degré d'indépendance, dans la mesure où il lui revient, tout de même, de dessiner le panier de soins remboursables et de veiller à la maîtrise des dépenses de santé.
Demain, les huit sages, confondant campagnes de dépistage organisées et suivis individuels des patientes, peuvent tout naturellement décider d'un rythme de suivi adapté aux campagnes mais non aux suivis. Pourtant, c'est ce suivi individuel que les femmes pouvaient attendre jusqu'alors du médecin spécialiste choisi qui leur prescrivait une mammographie tous les deux ans ou un frottis tous les ans.
En dehors de ces normes, l'accès au gynécologue restera certes possible ; mais à condition que la patiente puisse financièrement l'assumer. En effet, elle sera moins bien remboursée par l'assurance maladie, voire plus du tout, et elle se verra appliquer des dépassements d'honoraires par son spécialiste.
Comment, dans ces conditions, soutenir que l'égal accès au gynécologue reste garanti ?
Madame la secrétaire d'Etat, allez-vous prendre des mesures afin de garantir effectivement le libre et égal accès de toutes les femmes au gynécologue de leur choix, sans distinction quant à l'objet d'une telle visite et sans discrimination en termes de remboursement ? Si oui, lesquelles ?
En outre, chimère pour les femmes, l'accès spécifique se révèle être aussi un formidable piège pour les professionnels de santé concernés.
Pour le SYNGOF, les dispositions spécifiques décidées pour la gynécologie médicale de secteur 1 dans l'accord - absence de revalorisation des actes, interdiction de pratiquer des dépassements d'honoraires pour 80 % des consultations - conduiront à paupériser une profession déjà sinistrée. Elles ne permettront plus « de maintenir des conditions d'exercice de qualité pour des consultations majoritairement longues, ni de continuer le rapport privilégié avec les femmes... ».
Ajoutons à cela la réponse que M. le ministre a apporté, le 9 décembre 2004, à la question de mon ami Guy Fischer relative à la formation en gynécologie médicale, dans laquelle il faisait état du travail en cours concernant la redéfinition du domaine de compétence de ces futurs spécialistes.
Autrement dit, vos décisions tendent, à terme, à ne pas pérenniser la gynécologie médicale, à laisser cette spécialité se vider de sa substance au mépris des exigences de santé publique et des besoins des femmes.
Il vous appartient, madame la secrétaire d'Etat, avec M. le ministre, de clarifier les contradictions existant entre les promesses et la réalité des faits. La situation peut encore changer !
En effet, il vous revient de valider la convention médicale ou d'agir pour que les gynécologues médicaux soient représentés au sein du Conseil national des universités et soient donc partie prenante à la réflexion en cours.
Allez-vous, madame la secrétaire d'Etat, agir pour préserver l'accès direct des femmes à une vraie spécialité de gynécologie médicale ?
Monsieur Muzeau, la réponse que je vais vous faire sera brève alors que votre question était longue ! En fait, elle sera brève, car elle est claire, comme vous allez pouvoir en juger !
Tout d'abord, le médecin traitant est au coeur de la réforme de l'assurance maladie votée cet été. Cette réforme se met en place : la convention entre l'UNCAM et les syndicats majoritaires de médecins généralistes et spécialistes vient d'être signée, le 12 janvier, ce dont, bien entendu, le Gouvernement se réjouit.
La notion de médecin traitant, comme vous le savez, monsieur le sénateur, est fondée sur la conviction qu'un accès organisé au système de santé est un gage de qualité des soins. C'est le médecin traitant qui aura la mission d'orienter son patient, quand cela est justifié, vers un médecin spécialiste.
Toutefois, il existe, c'est vrai, des spécialités pour lesquelles un accès direct se justifie pleinement, pour toute ou partie de l'activité. C'est le cas de la pédiatrie, de l'ophtalmologie et de la gynécologie.
S'agissant de la gynécologie, la convention prévoit de saisir la Haute autorité de santé pour définir, sur des bases médicales, dans quels cas un accès direct se justifie et dans quels cas il ne se justifie pas.
Monsieur le sénateur, dans l'attente des conclusions de la Haute autorité, le ministre de la santé souhaite être clair : l'ensemble de l'activité de gynécologie reste en accès direct, dans les mêmes conditions de remboursement qu'aujourd'hui.

Madame la secrétaire d'Etat, pour ma part, je regrette que la réponse que vous m'avez faite ait été aussi brève, d'autant plus que vous avez indiqué que, « dans l'attente », rien ne changeait.
Madame la secrétaire d'Etat, je n'ai pas parlé du moment présent ! Souvenez-vous de mes propos : j'ai parlé de l'avenir, de ce qui résultera des travaux de la commission réunissant les huit sages de la Haute autorité et de la convention ratifiée par trois syndicats et non par toutes les organisations syndicales.
La question reste entière. J'espère que le libre accès au gynécologue qui existe actuellement perdurera et je souhaite que les professionnels de santé, les gynécologues, leurs syndicats et la coordination qui les représente soient à nouveau rassurés sur ce point. Il conviendrait d'ailleurs qu'ils soient consultés sur les dispositions à prendre en vue de pérenniser ce libre accès des femmes ; pour ma part, j'éprouve quelques craintes à ce sujet. Je vous demande donc, madame la secrétaire d'Etat, de transmettre à M. le ministre ces préoccupations.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 608, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Madame la secrétaire d'Etat, nous avons été nombreux à être interpellés sur les difficultés que rencontrent déjà et que rencontreront demain encore les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
Pour ces établissements, le passage aux 35 heures, que certains ont promis et que d'autres sont obligés de financer, s'est effectué de façon obligatoire, suivant des modalités fixées par des accords agréés par le ministère en 2000, entraînant la suppression de plus de 10 % des heures travaillées.
Les établissements adhérents de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, la FEHAP, ont donc été dans l'obligation d'embaucher, pour la France entière, 9 000 salariés, dont la rémunération a été assurée pour moitié par les allégements de charges de droit commun, correspondant à 2, 5 % de la masse salariale, et pour moitié par un blocage des salaires des personnels, qui ont connu une minoration d'environ 2, 5 % par rapport à ceux de la fonction publique hospitalière.
Or, en 2005, la suppression des allégements de charges et le souhait, bien compréhensible, que les salaires soient remis à niveau semblent ne pas devoir permettre le maintien des 9 000 postes créés en raison du passage aux 35 heures. La qualité des soins et des services au sein du secteur hospitalier privé à but non lucratif va s'en trouver gravement dépréciée.
Comme vous le savez, madame la secrétaire d'Etat, la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2004 relatif à la sécurité sociale, avait elle aussi examiné l'assiette des cotisations maladie et famille dues par l'Etat pour les agents des trois fonctions publiques ; il apparaissait que les employeurs publics ne cotisaient pas à parité avec les employeurs privés. Or de nouvelles réformes vont être mises en place, notamment la tarification à l'activité - nous la souhaitons vivement -, qui aura bien évidemment pour conséquence l'instauration d'un tarif unique par pathologie, quel que soit le statut des établissements. Une distorsion de concurrence supplémentaire risque donc d'apparaître entre les deux types d'établissements.
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions savoir, madame la secrétaire d'Etat, quelles initiatives, quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour assurer au mieux la survie des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dont nous connaissons tous l'importance pour la vie de nos communes.
Madame le sénateur, vous appelez l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés particulières que rencontrent les établissements privés à but non lucratif du fait de la fin de la compensation des aides incitatives relatives à la réduction du temps de travail.
Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif ont bénéficié durant cinq années du dispositif d'aides incitatives qui avait été prévu dans la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail comme contrepartie au financement de la création des emplois découlant de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Il n'est pas envisagé, madame le sénateur, de pérenniser ce dispositif, qui, en raison de la charge considérable que représentait le coût de la réduction du temps de travail et de ses conséquences en matière d'embauche, a été conçu, vous le savez, pour être transitoire.
Il s'agit maintenant de décider de l'accompagnement de ces établissements à la sortie des dispositifs spécifiques. Une étude a donc été menée par les services du ministère de la santé, en liaison avec les fédérations représentatives des établissements, afin de dresser un bilan de la situation et d'évaluer de manière extrêmement rigoureuse les besoins.
En ce qui concerne le secteur sanitaire, compte tenu à la fois du rôle joué par les établissements de santé privés à but non lucratif dans l'offre de soins et des difficultés budgétaires qu'ils rencontrent, notamment dans les activités de court séjour, il a été décidé de mettre en place un dispositif de soutien pour l'année 2005. Ce dispositif s'inscrira dans le passage progressif à la tarification à l'activité - vous l'avez évoquée, madame -, qui exigera de la part de certains établissements, qu'ils soient publics ou privés, d'importants efforts d'adaptation, d'importants efforts de productivité. Lors de l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 et de l'évaluation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, des crédits reconductibles ont été réservés à ce titre sur la marge dégagée par le taux de progression de l'ondam.
Des mesures de financement spécifiques contribueront, le cas échéant, au redressement de la situation budgétaire des établissements qui se heurtent aux plus grandes difficultés, avec l'aide des agences régionales de l'hospitalisation. Un recensement précis des difficultés rencontrées par les établissements de santé privés à but non lucratif a donc été réalisé : il a déjà donné lieu en 2004 à des délégations de crédits exceptionnels, au cas par cas, dans le cadre de contrats de retour à l'équilibre.
Enfin, un dossier préparé par les services du ministère de la santé doit être très prochainement remis au Conseil de l'hospitalisation, qui formulera, dans le courant du mois de janvier, des recommandations sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et sur les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. Il serait cependant souhaitable que l'étude en cours de réalisation trouve très rapidement sa conclusion et que les soutiens financiers que vous avez annoncés soient pérennisés pour un certain nombre d'années : sans cela, c'est l'ensemble des établissements du territoire qui connaîtra les difficultés actuelles.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, auteur de la question n° 590, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

De 1956 à 1976, l'entreprise Alsthom Stein Sie, basée à Lys-Lez-Lannoy, près de Roubaix, a produit chaque année plus de 1 000 chaudières de type Dravo. Ces appareils à usage de chauffage collectif ont été largement disséminés sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les lieux collectifs - salles de sports, salles de spectacles, églises - et sont toujours en usage.
Les fiches techniques de fabrication de ces chaudières révèlent la présence de plaques, de fibres et de cordons en amiante. Leur fonctionnement diffuse en moyenne trois à quatre fibres d'amiante par heure, alors que la norme en cours est fixée à une fibre par vingt-quatre heures.
Ces informations, qui constituent une alerte, relèvent de votre compétence en matière de santé publique, madame la secrétaire d'Etat. Il me serait donc agréable que vous puissiez nous informer des conditions dans lesquelles vos services pourraient procéder en urgence au recensement des chaudières Dravo encore en fonctionnement, les localiser précisément et prévoir leur mise hors d'usage.
Madame le sénateur, les équipements, notamment les équipements de chauffage, contenant de l'amiante sont très nombreux, de même que les matériaux utilisés jusqu'à une époque récente dans l'aménagement des locaux.
L'approche que vous préconisez, madame le sénateur, est celle que pensaient adopter les services du ministère de la santé lorsque le Conseil supérieur d'hygiène publique de France avait attiré leur attention sur la nécessité de se préoccuper de l'état de conservation et du devenir de l'amiante présent dans les bâtiments.
Une étude portant sur les matériaux avait alors été entreprise pour étudier la faisabilité et la rentabilité d'une telle démarche. Elle avait démontré qu'il était illusoire de vouloir identifier un nombre significatif de locaux concernés à partir des données fournies par les constructeurs ou par les entreprises. C'est la raison pour laquelle la réglementation adoptée pour protéger le public d'une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - je me réfère au décret n° 96-97 modifié - a prévu que les propriétaires fassent un inventaire des matériaux et des équipements concernés et, en présence de matériaux friables dégradés, procèdent à des travaux ainsi qu'à la surveillance des matériaux restant en place.
Cette réglementation a procédé par étapes, s'attachant d'abord aux matériaux présentant les plus grands risques d'émission de fibres d'amiante dans l'air intérieur des locaux. Dans la mesure où il a été insisté sur les matériaux de calorifugeage, il est clair que les installations de chauffage ont fait l'objet d'une attention particulière. Les services du ministère de la santé ont confié au Centre scientifique et technique du bâtiment l'évaluation de la réglementation qui permettra d'analyser ce point.
En outre, les ministères concernés mettront l'accent sur l'information du public, en particulier sur celle des bricoleurs, ainsi que sur la compétence des diagnostiqueurs, notamment en matière de conseil des propriétaires.
Dans cette attente, le ministre de la santé n'est pas favorable à ce que l'on attire l'attention sur un équipement particulier, en l'occurrence sur les chaudières de type Dravo que vous venez d'évoquer, madame le sénateur, dans la mesure où, d'une part, nous ne disposons pas d'argument qui permette de considérer qu'ils présentent une dangerosité particulière et où, d'autre part, une telle démarche pourrait conduire à détourner d'autres équipements qui seraient tout aussi dangereux, voire davantage, l'attention des techniciens habilités à ce genre de recherche.

Les arguments à invoquer sont simples : des ouvriers sont déjà décédés ; les autres viennent d'être admis, par M. Larcher, à figurer dans le protocole des personnes exposées à l'amiante.
Je précise qu'il n'est pas question ici de matériaux inertes ou en train de se dégrader : il s'agit de véritables souffleries, très puissantes, de fibres d'amiante. Les lieux concernés sont des locaux immenses ; je pense aux locaux que vous avez tous fréquentés à l'occasion de foires-expositions ou aux églises qui ne sont chauffées que quelques heures par semaine ou quelques jours dans l'année.
Je le répète, ce sont de véritables souffleries à amiante. Ne pas vouloir s'en préoccuper me semble quelque peu étrange.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 598, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ma question concerne les graves difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les spécialistes du secteur privé de la Réunion.
Les professionnels médicaux libéraux, en particulier les chirurgiens et les anesthésistes-réanimateurs, y connaissent en effet un surhandicap par rapport à leurs collègues métropolitains, car, outre-mer, ils sont confrontés à des difficultés professionnelles plus importantes : rareté et coût de la main-d'oeuvre, notamment spécialisée ; limitation géographique et démographique du volume d'activité ; coût de l'immobilier professionnel ; coût des fournitures et consommables ; difficulté d'accès à la formation post-universitaire.
Par ailleurs, à la Réunion, les actes C, CS et B font conventionnellement l'objet d'une surrémunération, alors que les actes techniques, affectés des lettres K, KC, Z, sont cotés à la même valeur qu'en métropole, ce qui se révèle totalement inadapté et injuste compte tenu des surcoûts de main-d'oeuvre spécialisée déjà évoqués. Il en résulte une forte érosion des revenus bruts des chirurgiens et un certain déséquilibre, car la fonction publique hospitalière, elle, bénéficie d'un indice de majoration de salaire.
Cette situation est encore aggravée par la difficulté qu'éprouvent les praticiens réunionnais à contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle.
Cet état de fait contribue lourdement à la désaffection à l'égard de l'exercice libéral dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, l'exercice libéral de la chirurgie, notamment de la chirurgie générale, ne recrute plus, et nombreux sont les praticiens qui démissionnent pour travailler dans le secteur public, plus attractif. Les anesthésistes, qui se trouvent dans la même situation et sont en proie aux mêmes difficultés depuis longtemps, font de même.
Aussi les établissements privés de soin sont-ils menacés de désertification médicale. Cette tendance, qui est perceptible à l'échelon national, présente une acuité toute particulière à la Réunion.
Dans ce contexte difficile, le nouveau système de rémunération des actes médicaux intégré au plan Hôpital 2007 devrait, grâce à la mise en place de la classification commune des actes médiaux et à la tarification à l'activité, permettre de pallier partiellement l'absence de revalorisation, ces quinze dernières années, des actes techniques et chirurgicaux des spécialistes ainsi que l'inégalité de ressources entre les spécialités.
Toutefois, madame la secrétaire d'Etat, ce nouveau dispositif présente l'inconvénient majeur de ne prévoir aucune indexation des tarifs pour les DOM. Il n'est pas juste que les cabinets de spécialités, véritables micro-entreprises de santé, ne bénéficient pas de l'indexation de 30 % dont jouissent les établissements publics de soins. En effet, l'essentiel du fondement structurel des surcoûts dans les DOM - achats et charges de personnel - est identique pour l'ensemble des chirurgiens, qu'ils exercent à titre libéral ou dans un établissement public de santé. Une telle inégalité de traitement est donc totalement injustifiée.
C'est pourquoi, aujourd'hui, l'ensemble des spécialistes du secteur privé de la Réunion souhaitent que les actes de chirurgie nouvellement codifiés dans la CCAM, la classification commune des actes médicaux, soient indexés du même coefficient multiplicateur de 1, 30, que les actes techniques cotés K soient indexés d'un coefficient multiplicateur de 1, 20 à l'égal des actes cotés C et CS, que le MPC annexé au CS soit également indexé de 20 %, les médecins généralistes ayant bénéficié de cette mesure lors de la dernière revalorisation tarifaire des actes C.
Aussi, je vous demande, madame la secrétaire d'Etat, quelles mesures vous envisagez de mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation.
Madame le sénateur, vous soulevez la question de l'absence dans la CCAM de tout dispositif de majoration des tarifs qui seront mentionnés dans cette classification pour les médecins spécialistes libéraux exerçant dans les départements d'outre-mer.
Dans la situation actuelle, comme vous l'indiquez, les actes de consultation et de visite sont majorés dans les territoires d'outre-mer. En revanche, les actes techniques inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels ne font pas l'objet de majoration.
La convention qui vient d'être signée prévoit la mise en oeuvre prochaine de la CCAM. Comme vous le savez, la loi relative à l'assurance maladie confie désormais à l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le soin d'établir la CCAM, après avis notamment de la Haute autorité de santé.
Il revient également à l'UNCAM de négocier avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux les tarifs applicables à ces actes.
La négociation conventionnelle sur ce sujet va s'ouvrir. Les syndicats de médecins souhaitent qu'elle se traduise par une revalorisation globale de la rémunération des actes techniques.
Il appartient donc à l'UNCAM et aux syndicats médicaux de trouver par la négociation ce que doit être une juste rémunération de ces actes.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse, que je transmettrai aux intéressés.
Il est vraiment nécessaire de supprimer cette inégalité de traitement dans les départements d'outre-mer, d'autant qu'à la Réunion nous ne comptons que cinquante-cinq médecins spécialistes pour 100 000 habitants, ce qui est loin de la moyenne métropolitaine, qui est de quatre-vingt-huit. La différence est grande.

La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 566, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, alors que de très nombreux accidents peuvent être imputés en France à la prise de médicaments psychotropes, tranquillisants ou antidépresseurs, il est particulièrement étonnant qu'aujourd'hui encore il n'y ait pas de dépistage systématique des médicaments à risque lors de la survenance d'un accident, ce qui fait que nous ne disposons pas, pour l'heure, de statistiques fiables sur le nombre de Français victimes d'accidents de la route sous l'influence de tels médicaments.
En Belgique, pays proche de ma région, l'Institut pour la sécurité routière a récemment dévoilé que 15, 6 % des victimes d'accidents de la route étaient sous l'influence de tranquillisants, d'antidépresseurs ou de somnifères. Aux Etats-Unis, une étude rapporte le chiffre de 20 %.
En Ecosse, une autre étude a conclu que les conducteurs sous médicaments de la classe des benzodiazépines ont davantage d'accidents, jusqu'à quatre fois plus que les autres ; les tranquillisants sont plus concernés que les somnifères et constituent un important facteur d'accidents de la route.
Aux Pays-Bas, une étude a démontré que les consommateurs de certains tranquillisants présentaient pendant les deux premières semaines de traitement un risque d'accident cinq à six fois supérieur à la normale ; il est comparable à celui d'un taux d'alcoolémie de 1 gramme par litre.
Or chacun sait bien que notre pays - il a souvent été dénoncé à ce titre - est le champion du monde en matière de consommation de médicaments psychotropes ; malgré cela aucune statistique scientifique du phénomène n'est réalisée.
De la même manière, la loi du 18 juin 1999 qui réprime la conduite sous l'influence de stupéfiants a écarté l'imputation de prise de médicaments de nature à altérer gravement le comportement du conducteur. Seul un petit pictogramme parfaitement illisible figure sur les boîtes des médicaments concernés.
Au moment où nous assistons à une traque permanente de l'automobiliste sous toutes ses formes, n'y aurait-il pas lieu de l'avertir préventivement des risques qu'il encourt et qu'il fait encourir à d'autres par l'absorption de tels médicaments ?
Dans cette affaire, on a le sentiment que, depuis bien longtemps et pour des raisons obscures, aucune véritable volonté politique ne s'est manifestée pour alerter les Français sur la très grave dangerosité de ces médicaments. Rappelons que le dictionnaire Vidal déconseille la conduite automobile pour cent trente spécialités pharmaceutiques et, parmi celles-ci, figurent douze médicaments de la classe des benzodiazépines qui présentent un risque encore plus élevé au volant. Notre ancienne collègue Marie-Claude Beaudeau, dans une intervention remarquée dans cet hémicycle, affirmait que ces derniers peuvent être à la source de drames familiaux, mais aussi à celle d'une multitude d'accidents de la circulation.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui autorise la commercialisation des médicaments, devrait engager une grande campagne d'information à destination des praticiens et des Français en attirant leur attention sur la dangerosité au volant des médicaments psychotropes.
Je compte par ailleurs sur M. le ministre de la santé afin que le Parlement puisse très rapidement disposer de statistiques fiables sur le rôle joué par les médicaments psychotropes dans la survenance des accidents de la circulation.
Je l'invite également à user de sa très grande autorité morale afin de mettre solennellement en garde nos compatriotes sur les risques de conduite après la prise de médicaments psychotropes en favorisant, notamment, l'apposition de messages d'alerte plus explicites sur les emballages des médicaments concernés.
Monsieur le sénateur, de nombreux médicaments, dont les psychotropes, sont susceptibles de donner lieu à des effets comme la somnolence, la perte de connaissance, les vertiges, les étourdissements, les troubles visuels, les hallucinations, les troubles auditifs, la sensation d'ébriété, avec des modifications du comportement, parfois des idées suicidaires, qui peuvent entraîner des accidents.
S'agissant en particulier des benzodiazépines, la sédation, les troubles amnésiques, la diminution de la concentration et les altérations de la fonction musculaire sont en effet autant de symptômes qui peuvent exercer une influence défavorable sur l'aptitude à conduire des véhicules. Ces effets sont d'autant plus marqués que la dose est importante, qu'il est fait usage simultanément d'alcool ou d'autres produits agissant sur le système nerveux central.
Par ailleurs, les principales maladies neurologiques et psychiatriques s'accompagnent toutes de modifications plus ou moins importantes de la cognition, de la vigilance ou de l'attention.
Depuis la directive européenne du 26 octobre 1983, les effets des médicaments sur la capacité de conduite et l'utilisation de machines sont identifiés dans une rubrique spécifique du résumé des caractéristiques du produit de l'autorisation de mise sur le marché.
La France a été l'un des premiers pays européens à compléter ces mentions par l'application du pictogramme que vous avez évoqué sur les conditionnements, mesure qui a ensuite été reprise par la directive européenne du 6 novembre 2001.
En février 2003, sur proposition du comité interministériel de la sécurité routière, la direction générale de la santé a demandé à l'AFSSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'évaluer la pertinence d'une gradation de ce pictogramme en fonction de la dangerosité des médicaments. Un groupe d'experts constitué par l'AFSSAPS a classé, à partir du profil pharmacodynamique des 5000 spécialités comportant actuellement un pictogramme, les effets potentiels des médicaments sur la conduite selon quatre critères : effets sur la vigilance, sur la vision, sur le comportement, sur l'équilibre et le système cardiovasculaire, etc.
Un sous-groupe d'experts chargé de l'évaluation épidémiologique du risque a étudié les données de pharmacovigilance, les données expérimentales et d'accidentologie publiées à ce jour.
S'agissant de la proportion d'accidents mortels de la circulation liés aux psychotropes, on ne dispose que de données non validées par les experts compte tenu de la difficulté à attribuer la responsabilité de l'événement au médicament ou à quantifier la part prise par le médicament dans la survenance de l'accident.
Une revue de la littérature internationale portant sur les cinq dernières années montre que l'exposition à un médicament potentiellement responsable est retrouvée chez 1 % à 10 % des accidentés de la route. Les benzodiazépines sont les substances les plus fréquemment en cause, mais peu d'autres classes ont été étudiées.
Ce sous-groupe travaille actuellement sur la faisabilité d'études permettant d'évaluer l'exposition aux médicaments des sujets responsables d'accidents et de cerner les familles thérapeutiques les plus fréquemment mises en cause.
Le groupe d'experts a proposé une méthode de gradation du pictogramme allant du niveau 0 - médicaments ne présentant aucun effet identifié - au niveau 3 - danger majeur pour la conduite automobile. Cette gradation se traduira par l'apposition sur le conditionnement d'un pictogramme décliné en trois niveaux de risque, 1 à 3, accompagné de deux phrases courtes précisant le risque encouru et la conduite pratique à tenir.
Le classement dans chacun des grades nécessite l'analyse, pour chaque médicament, du profil pharmacodynamique, de l'évaluation épidémiologique et de données complémentaires telles que le dosage, la voie d'administration, les conditions d'utilisation et de délivrance, les interactions, la pharmacocinétique, les indications.
L'examen des classes représentant a priori le risque potentiel le plus élevé, notamment celle des médicaments du système nerveux central, est en cours et devrait permettre l'apposition du nouveau pictogramme et des messages d'accompagnement sur les conditionnements de ces produits dans le milieu de l'année 2005.
Monsieur le sénateur, la France sera alors le premier pays européen à mettre en place un tel système de gradation du risque.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces précisions. Je constate que vous avez pris conscience des difficultés que j'ai évoquées et j'espère que la situation va s'améliorer. Cela allait presque sans dire, mais il valait mieux que nous le redisions ensemble.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, auteur de la question n° 600, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ma question rejoint celle de Mme Hermange : nous avons en effet été nombreux à être saisis des difficultés financières rencontrées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif ; il est vrai que 9 000 emplois sont en suspens.
Il est facile de dire que ces postes n'avaient pas été financés par le gouvernement précédent. En réalité, ces 9 000 emplois étaient nécessaires et les établissements insistent sur le fait qu'ils souhaitent les garder.
Il y a donc une double difficulté : d'une part, un risque social, la disparition éventuelle de ces 9 000 emplois, d'autre part, un risque sanitaire, parce que ces 9 000 emplois sont absolument indispensables.
Madame la secrétaire d'Etat, le financement de ces postes a été aidé pendant cinq années par des allègements de charges. Par ailleurs, il est tout à fait légitime d'aligner le régime de ces salariés sur celui du secteur public.
Les inquiétudes que j'éprouve touchent à la pérennisation des mesures.
Vous nous dites qu'en 2004 des crédits exceptionnels ont été débloqués et que pour 2005 un soutien a été assuré. Mais qu'adviendra-t-il de tout cela dans l'avenir ?
Je crois, pour ma part, légitime d'aider de façon pérenne ces établissements qui travaillent pour l'intérêt général.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le sénateur, je ne vais pas reprendre les arguments que j'ai exposés tout à l'heure. Quant à la responsabilité du gouvernement précédent, je préfère que ce soit vous qui l'évoquiez plutôt que moi.
Sourires
Vous savez comme moi que la loi du 13 juin 1998 comportait un dispositif qui avait un caractère transitoire, ce caractère transitoire découlant du poids financier que représentaient ces mesures.
Par conséquent, aujourd'hui, la question est de savoir comment faire face à ce dispositif et comment en sortir.
J'ai évoqué tout à l'heure, en répondant à Mme Hermange, l'étude qui a été menée par les services du ministère de la santé, en liaison avec les fédérations représentatives des établissements. Il est en effet fondamental de dresser une évaluation de la situation à la fois précise et argumentée, car plusieurs phénomènes peuvent effectivement se cumuler pour aboutir aux difficultés rencontrées.
Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur sanitaire, compte tenu du rôle fondamental joué par les établissements de santé privés à but non lucratif et des difficultés budgétaires que ceux-ci rencontrent, en particulier dans les activités de court séjour qui sont lourdement pénalisées, il a été décidé, je le répète, de mettre en place un dispositif de soutien pour l'année 2005.
Ce dispositif de soutien a été défini lors de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment lors de l'évaluation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il importe de bien redire ici qu'il s'agit de crédits reconductibles, lesquels ont été réservés à ce titre sur la marge dégagée par le taux de progression de cet objectif.
Par ailleurs, des mesures de financement spécifiques ont dû être trouvées, car les problèmes se sont posés, dès 2004, pour un certain nombre d'établissements. Effectivement, des délégations de crédits exceptionnels ont déjà eu lieu en 2004, au cas par cas, dans le cadre d'un contrat de retour à l'équilibre.
En outre, un dossier préparé par les services du ministère de la santé sera prochainement soumis au Conseil de l'hospitalisation, qui nous transmettra, dès la fin du mois de janvier, ses recommandations sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun à toutes les activités que j'ai évoquées tout à l'heure et sur les montants régionaux des dotations annuelles.
Comme vous pouvez donc le constater, monsieur le sénateur, nous avons su, dès 2004, remédier par ce moyen à l'urgence de la situation et envisager, par le système des crédits reconductibles, la sortie de ces dispositifs prévus par la loi de 1998.

Madame la secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu vos propos et j'en accepte l'augure. Je souhaite toutefois que les conclusions de l'étude demandée soient connues dès la fin du mois de janvier, afin que soient mises en oeuvre très rapidement les mesures proposées.
En effet, c'est un véritable cri d'alarme que lancent les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, ce qui prouve l'urgente nécessité de prendre des mesures dans ce domaine.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 607, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre assemblée reprend ses travaux aujourd'hui avec, cet après-midi, l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Ma question se rattache à cet examen puisqu'elle coïncide parfaitement avec l'inquiétude qui prévaut actuellement sur les perspectives liées à la couverture médicale de certains territoires ruraux.
En effet, la situation des professionnels de santé, en particulier celle des médecins, des infirmières et des infirmiers libéraux, doit être prise très au sérieux, notamment dans les secteurs ruraux de montagne.
Si l'on n'y prête pas garde, des pans entiers de nos territoires risquent, dans un avenir relativement proche, de devenir des espaces sans couverture médicale, où l'absence de soins ne permettra plus le maintien à domicile, notamment de nos aînés.
Chacun peut en déduire que cette situation entraînera inévitablement une augmentation des placements en établissement, avec le coût important qui s'y rattache.
La désertification continuera ainsi à faire son oeuvre et à rendre ces territoires de moins en moins attractifs et de plus en plus inhospitaliers. En effet, la faiblesse des rémunérations, liée à l'importance du nombre d'heures à effectuer, qui doit intégrer inévitablement des déplacements nombreux, coûteux et insuffisamment pris en compte, aboutit à ce que très peu de jeunes décident de s'installer pour exercer une profession médicale, a fortiori en milieu rural.
Dans plusieurs zones du territoire, notamment dans mon département de la Haute-Loire, et plus généralement en Auvergne, le service à la population ne pourra plus être assuré au fur et à mesure du départ à la retraite des professionnels de santé.
Si je vous dis tout cela avec beaucoup de modération - je sais, en effet, que la situation n'est pas facile -, je vous le dis également avec solennité. Aujourd'hui, alors qu'il y a en moyenne un médecin pour 360 habitants sur le territoire français, il n'y a qu'un médecin pour 540 habitants en Auvergne, et la situation est bien pire dans les zones les plus reculées de cette région.
De graves disparités sont en train de se faire jour entre les zones les plus urbanisées et les parties les plus enclavées de notre territoire, ce qui crée véritablement des inégalités de traitement sur un même territoire identifié.
Madame la secrétaire d'Etat, comment le Gouvernement envisage-t-il de répondre à cette pénurie ? Quelles sont les mesures que le ministère entend adopter pour assurer le maintien et la pérennité du service médical en milieu rural, afin de répondre aux attentes non seulement des professionnels, mais aussi des patients ?
Une aide à l'installation, mais aussi à la compensation des handicaps pour ceux qui sont en place, ne pourrait-elle pas être envisagée, afin d'inciter les acteurs de notre système de santé à choisir de s'installer ou à rester plus facilement dans nos territoires ruraux, assurant de ce fait une meilleure répartition des soins au coeur de nos territoires ?
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est particulièrement soucieux d'assurer le maintien et la pérennité du service médical, notamment en milieu rural.
Pour répondre à cette exigence, le Gouvernement privilégie un ensemble de mesures qui portent tant sur les moyens financiers que sur la démographie médicale et sur les conditions mêmes de l'exercice de la pratique médicale.
Les médecins généralistes s'installant, exerçant ou se regroupant dans les zones déficitaires en offre de soins pourront bénéficier bientôt de trois types d'aides complémentaires.
Il s'agit, d'abord, de l'aide conventionnelle de l'assurance maladie, prévue à l'article 49 de la loi relative à l'assurance maladie. Vous le savez, une convention avec les médecins vient d'être signée le 12 janvier, et c'est dans ce cadre que sera définie l'aide à l'installation des médecins.
Il s'agit, ensuite, de l'aide de l'Etat, créée par la loi de finances rectificative pour 2003.
Il s'agit, enfin, de l'aide des collectivités locales, prévue par l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux et dont votre assemblée entamera l'examen en deuxième lecture cet après-midi. Ce texte vise notamment à donner un cadre juridique aux collectivités locales qui souhaiteront s'associer aux dispositifs d'aides de l'assurance maladie et de l'Etat.
Vous savez également que le numerus clausus a été fortement augmenté depuis 2002 puisqu'il a atteint 5 600 postes en 2004.
Cette augmentation permettra de retrouver un niveau global de densité qui corrigera les disparités constatées entre les régions et à l'intérieur même des régions.
Enfin, l'amélioration de la répartition des médecins sur le territoire se traduit également par un assouplissement des conditions d'exercice. Le Conseil national de l'ordre des médecins vient ainsi de réécrire l'article 85 de son code de déontologie pour favoriser la création de cabinets multisites afin d'améliorer ou de maintenir l'accès aux soins.
Cet ensemble de mesures forme, monsieur le sénateur, une réponse cohérente pour assurer l'égalité d'accès aux professionnels de santé sur notre territoire.
A cet égard, je vous redis l'attachement de Philippe Douste-Blazy et du Gouvernement tout entier sur cette question tout à fait primordiale pour nos concitoyens.

Madame la secrétaire d'Etat, si je m'attendais quelque peu à votre réponse, j'apprécie néanmoins que vous nous confirmiez la prise en compte de la situation des territoires ruraux.
Je suis très heureux que le message soit passé et que les zones de France qui connaissent des situations difficiles ne soient pas oubliées.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 613, adressée à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention sur les conditions de délivrance du macaron « Grand invalide civil », dit macaron GIC.
Ce macaron permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, sur la voie publique et dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées exclusivement aux véhicules des personnes handicapées.
Peuvent y prétendre les personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité et dont le handicap physique, sensoriel ou mental réduit de façon importante l'autonomie de déplacement ou impose l'accompagnement par une tierce personne lors des déplacements.
La délivrance d'une carte d'invalidité nécessite la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Or de nombreuses personnes handicapées qui ne se sont pas vu attribuer la carte d'invalidité rencontrent des difficultés importantes de mobilité, lesquelles justifieraient le bénéfice d'un accès aux places réservées aux titulaires du macaron GIC.
Ainsi, la rigidité de cette réglementation exclut de nombreuses personnes d'un dispositif prévu en leur faveur.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d'Etat, de m'indiquer si vous n'entendez pas dissocier la délivrance de ce macaron de l'obtention de la carte d'invalidité, mesure qui est réclamée par de nombreuses associations.
Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les conditions de délivrance du macaron « Grand invalide civil » ou macaron GIC.
En l'état actuel de la réglementation, la carte européenne de stationnement, qui a remplacé le macaron GIC depuis le 1er janvier 2000, peut être attribuée par le préfet, sur leur demande, aux personnes titulaires de la carte d'invalidité, dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 %, après examen de leur situation.
Les personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » ne peuvent donc y prétendre, et c'est bien tout le problème.
Toutefois, aux termes de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les maires ont la possibilité d'accorder aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » une autorisation de stationner, dans leur commune, sur les emplacements réservés aux personnes handicapées.
Ce nouveau dispositif, issu de l'article 86 de la loi précitée, requiert, pour être appliqué, la publication d'un décret en Conseil d'Etat.
Cependant, il est apparu, dans le cadre de la réflexion conduite sur la simplification des démarches administratives, que l'application de ces nouvelles dispositions pouvait se révéler complexe pour les maires, pour les services chargés de les mettre en oeuvre et pour les usagers, dans la mesure où l'autorisation de stationnement n'était valable que pour une seule commune. Or les personnes concernées souhaitent bien sûr pouvoir stationner ailleurs que dans leur commune de résidence.
C'est pourquoi le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui sera adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale cet après-midi lors d'un vote solennel, prévoit que toute personne atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou lui imposant un accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personne handicapée. Cette carte sera délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
Pour ma part, je trouve cette formule préférable à la première qui, en raison de son application territoriale réduite, n'apportait pas pleinement satisfaction aux personnes concernées.
Par ailleurs, il est également prévu que les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées puissent recevoir une telle carte.
Les conditions d'application de ces dispositions seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, afin que la mesure prévue par le texte que je viens de citer puisse devenir opérationnelle.
Ainsi pourront être satisfaites, me semble-t-il, l'ensemble des demandes qui vous sont directement adressées, monsieur le sénateur, comme celles qui sont adressées au secrétariat d'Etat.

M. Bernard Piras. Une fois n'est pas coutume, madame la secrétaire d'Etat, je suis ravi de votre réponse !
Sourires

Je ferai une simple observation : je souhaite que le décret d'application soit pris sans tarder, afin que je ne sois pas obligé de vous interpeller une nouvelle fois.
Mme la secrétaire d'Etat fait un signe d'acquiescement.

La parole est à M. Hubert Haenel, auteur de la question n° 584, adressée à M. le ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commune de Volgelsheim, dans le Haut-Rhin, est confrontée aux innombrables problèmes qu'engendre un quartier difficile.
Cette commune supporte des nuisances proportionnellement supérieures à celles des grandes agglomérations. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de constater cet état de fait. Le maire, crédule, s'est tourné vers l'Etat, imaginant pouvoir bénéficier, pour sa collectivité, du dispositif prévu par la loi « Borloo ».
A sa grande surprise, il lui a été simplement répondu que la situation du quartier en question ne répondait pas aux critères définis par cette loi. A aucun niveau, l'Etat n'a proposé aux élus concernés de se pencher sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il y a là de quoi être à la fois ulcéré et découragé !
Par ailleurs, le maire de Volgelsheim se heurte également à la toute-puissance de la SONACOTRA, la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs.
Monsieur le ministre, je souhaite donc que vous m'indiquiez les raisons pour lesquelles le dispositif prévu dans la loi « Borloo » ne peut s'appliquer dans ce quartier et, surtout, les mesures que compte prendre l'Etat pour remédier à cette situation.
Monsieur le sénateur, je me suis rendu récemment dans votre département, où j'ai eu l'occasion d'expliquer les positions du ministère du logement sur la loi « Borloo ».
La rédaction de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 est claire : elle définit les conditions de mise en oeuvre d'un programme national de rénovation urbaine, grâce à la mobilisation de fonds mutualisés très importants, pour une série de quartiers en grande difficulté. Or, pour créer un effet de levier, pour que ce dispositif soit une sorte de « plan Marshall » des banlieues, il faut bien effectuer une sélection de ces quartiers.
Selon la loi, ce programme concerne les quartiers classés en zone urbaine sensible. Or la commune que vous avez évoquée ne bénéficie pas de ce classement.
L'article 6 de la loi prévoit aussi la possibilité d'intervenir, après avis conforme du maire de la commune et accord du ministre délégué au logement et à la ville, dans des quartiers présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues à celles des zones urbaines sensibles.
Cette faculté n'est cependant prévue qu'à titre exceptionnel puisque, conformément à ce que je viens de vous dire, nous voulons concentrer les moyens, de manière à obtenir un effet de levier maximal.
Pour accorder de façon objective les exceptions prévues par la loi, j'ai prévu de prendre en compte, quartier par quartier, certains critères, qui sont ceux des zones urbaines sensibles, notamment le nombre de personnes bénéficiaires du RMI, le nombre de personnes au chômage ou le nombre de jeunes sans qualification. Par ailleurs, pour pouvoir intervenir, il faut que le quartier possède une taille suffisante.
Pour cette raison, je ne peux donc pas répondre positivement à la demande d'exception de la commune de Volgelsheim.
Pour autant, monsieur le sénateur, vous soulevez un vrai problème auquel j'ai également été confronté dans mon département du Nord, qui possède des caractéristiques analogues à celles du Haut-Rhin et qui, comme lui, est en outre un département frontalier.
Il est donc nécessaire de mobiliser des crédits pour la construction, la démolition et la réhabilitation d'un certain nombre de logements situés dans des quartiers qui, bien que non classés en zone urbaine sensible, connaissent des difficultés.
Evidemment, je donnerai aux préfets des instructions pour prendre en compte spécifiquement ces quartiers, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, laquelle permettra, vous le savez, de doubler le nombre de logements locatifs sociaux sur l'ensemble du territoire. Le quartier des logements sociaux du Bourg Vauban à Volgelsheim sera ainsi pris en compte dans ce cadre, dès que les différents partenaires auront défini un projet partagé.
S'agissant de la SONACOTRA, nous sommes en train de mettre au point, avec Jean-Louis Borloo, une convention d'objectifs, pour mieux cadrer les missions de cet organisme.
En ce qui concerne la commune de Volgelsheim, nous avons demandé à la SONACOTRA de faire évoluer sa position, afin qu'elle accepte le principe, sous l'impulsion des services de l'Etat, de restructurer le foyer de 100 chambres actuellement présent dans le quartier et qui pose de gros problèmes, ce dont je me suis rendu compte lors de la visite qu'y a faite l'ensemble des ministres du pôle de cohésion social.
Vous le savez, monsieur le sénateur, il est envisagé de créer deux structures distinctes : un centre d'accueil des demandeurs d'asile de 50 places et une maison relais de 20 places.
A ce propos, je rappelle que cet organisme s'est engagé, dans le cadre du contrat d'objectifs 2005-2010 présenté à son conseil d'administration le 13 décembre dernier, à adapter ses capacités territoriales à l'évolution des publics accueillis et à réhabiliter les foyers existants. Cet engagement ne doit pas seulement représenter une ligne d'écriture dans une convention d'objectifs. Il doit se traduire sur le terrain ; nous y veillerons, monsieur le sénateur.

Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous venez d'apporter, s'agissant non seulement des critères de la loi « Borloo », mais aussi et surtout des consignes qui vont être données au préfet du Haut-Rhin pour qu'il apporte tout le soutien nécessaire au maire de Volgelsheim. Ce dernier a bien besoin, en l'occurrence, que l'Etat se penche sur le sort du quartier Bourg Vauban, qui ne compte, ne l'oublions pas, que 2 000 habitants.
En effet, quand on se rend dans ce quartier, on constate que, même s'il ne s'agit pas d'une zone sensible entrant dans le champ d'application du dispositif prévu par la loi « Borloo », il connaît de graves difficultés.

Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean Pépin membre de l'Observatoire des territoires.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.