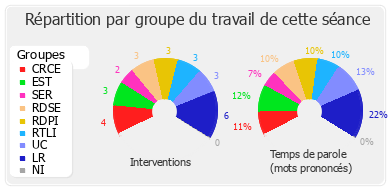Séance en hémicycle du 20 mai 2021 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à améliorer la trésorerie des associations (proposition n° 160 [2019-2020], texte de la commission n° 580, rapport n° 579).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
(Conforme)
Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l ’ article 10 de la loi n° 2000 -321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d ’ utilisation et les modalités de contrôle et d ’ évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l ’ organisme, s ’ il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d ’ une subvention n ’ ayant pas été intégralement consommée. »
(Conforme)
Le quatrième alinéa de l ’ article 10 de la loi n° 2000 -321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l ’ autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n ’ ait arrêté d ’ autres dates de versement ou n ’ ait subordonné le versement à la survenance d ’ un évènement déterminé. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s ’ applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s ’ appliquent ».
(Suppressions conformes)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
[Pour coordination]
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le 5 du I de l ’ article 150 -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « cinquième alinéa du I de l ’ article L. 312 -20 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même sixième alinéa ».
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du VI de l ’ article L. 312 -20, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° À la vingt et unième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743 -2, L. 753 -2 et L. 763 -2, les mots : « loi n° 2015 -990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1 er janvier 2020 » sont remplacés par la référence : « loi n° … du … visant à améliorer la trésorerie des associations ».
L ’ avant -dernier alinéa de l ’ article L. 52 -5 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « soit », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l ’ ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l ’ article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas -Rhin, du Haut -Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. » ;
2° Après le mot : « prévus », la fin de l ’ avant -dernière phrase est ainsi rédigée : « au présent alinéa, l ’ actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. »
Le dernier alinéa de l ’ article L. 52 -6 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « soit », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l ’ ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l ’ article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas -Rhin, du Haut -Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. » ;
2° Après le mot : « prévus », la fin de l ’ avant -dernière phrase est ainsi rédigée : « au présent article, l ’ actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. »
(Conforme)
I. – Le I de l ’ article 27 de la loi n° 2018 -699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l ’ ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.
« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu ’ un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d ’ eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.
« Le représentant de l ’ État dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l ’ ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
II. – (Non modifié)
[Pour coordination]
(Supprimé)
(Suppression conforme)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d ’ une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d ’ autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.
(Conforme)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4° de l ’ article L. 123 -16 -2, la première occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;
2° À la première phrase du I de l ’ article L. 822 -14, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;
3° L ’ article L. 950 -1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du 1° du I, la référence : « n° 2017 -86 du 27 janvier 2017 relative à l ’ égalité et à la citoyenneté » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à améliorer la trésorerie des associations » ;
b) La vingt -quatrième ligne du tableau du second alinéa du 2° du II est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 822-11-2 à L. 822-13
L ’ ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-14
La loi n° … du … visant à améliorer la trésorerie des associations
»
II à IV. – (Non modifiés)
V. – La loi n° 91 -772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :
1° Les deux premiers alinéas de l ’ article 3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l ’ environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d ’ en faire la déclaration auprès du représentant de l ’ État dans le département :
« 1° Préalablement à l ’ appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l ’ un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
« 2° À défaut, pendant l ’ exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l ’ appel à la générosité du public. » ;
2° Au premier alinéa de l ’ article 3 bis, le mot : « préalable » est supprimé ;
3° L ’ article 4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » et, au premier alinéa, le mot : « dons » est remplacé, deux fois, par les mots : « ressources collectées » ;
b) Après le mot : « organismes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l ’ annexe… (le reste sans changement). »
VI et VII. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
(Conforme)
L ’ article 4 de la loi n° 91 -772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d ’ un commissaire aux comptes, celui -ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques. »
(Suppression conforme)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
(Conforme)
À l ’ article L. 213 -7 du code de la route, après les mots : « d ’ association », sont insérés les mots : « ou les fondations au sens de l ’ article 18 de la loi n° 87 -571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pendant sept minutes, et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec une certaine émotion, je dois vous l’avouer, que je me trouve aujourd’hui face à vous, pour prendre la parole sur un texte important – cette proposition de loi en faveur du monde associatif –, une certaine émotion, disais-je, parce qu’il s’agit d’une proposition de loi que j’ai eu l’honneur de déposer à l’Assemblée nationale et que je défends aujourd’hui, au Sénat, en dernière lecture, je l’espère.
J’ai toujours été un défenseur du monde associatif, parce que je crois fondamentalement qu’il permet à chacun de s’émanciper. Le Sénat accompagne – il l’a toujours fait – le développement de nos associations dans nos territoires. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez nos associations ; elles créent du lien dans nos villes et nos bourgs, dont elles sont le visage.
Dans cette période de crise, le monde associatif a permis de garder quelque chose de précieux et dont nous avons été privés : le lien social. Fil rouge de mes actions et de mes prises de parole, l’engagement est pour moi plus qu’un moteur : c’est une philosophie. Je pense à cette phrase qui a conduit mon engagement, depuis plusieurs années maintenant, dans mon territoire, en tant qu’élue, d’abord, puis comme membre du Gouvernement : le citoyen n’est pas un consommateur ; au contraire, c’est un producteur d’idées, de convictions, d’engagement et de solidarité.
Nous voyons l’illustration parfaite de cette continuité dans les actions du Sénat et de l’Assemblée nationale, mais aussi, plus largement, dans celles des élus.
Le Sénat porte une attention plus particulière aux associations, qu’il accompagne. Je tiens particulièrement à remercier, de façon chaleureuse, Mme la rapporteure, Mme Eustache-Brinio. Madame la rapporteure, nous avons beaucoup travaillé, échangé, sur ce texte, dont nous avons trouvé le point d’équilibre, de consensus, en prenant en considération tant les difficultés que cela pouvait engendrer pour les collectivités que les réponses dont les associations avaient besoin. Ce travail intense a permis d’atteindre cet équilibre : ainsi l’ensemble des travées se retrouve-t-il autour d’un consensus permettant d’accompagner le monde associatif.
Je remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cet équilibre et qui ont permis que ce texte ne suscite pas d’amendement en séance.
Le monde associatif est présent partout, dans l’ensemble de nos territoires. Ainsi, il n’y a pas un besoin social ou environnemental qui ne soit couvert, au moins partiellement, par un engagement associatif. Il est le poumon et même le cœur battant de nos territoires.
Vous l’aurez compris, ce texte est utile, important et urgent, dans la période que nous traversons.
Les associations sont, par essence et par construction même, démocratiques et assurément républicaines. Ne l’oublions pas, le but même d’une association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, pour reprendre les mots de 1789. En miroir, le but de toute association est de faire vivre le lien et la passion de ceux qui ont décidé de se retrouver pour avancer ensemble. Là où la solidarité peut parfois s’effacer, l’association prend la place ; là où la force publique faillit, l’association prend le relais. À ceux qui, à deux, ont décidé de faire trois, nous devons permettre de choisir cette voie et nous devons les y accompagner.
Avec ce texte, nous permettrons au monde associatif de disposer de moyens supplémentaires, pour se développer ; quels que soient notre appartenance politique et notre parcours, nous partageons cette ambition. Notre pays, la France, dispose d’un réseau associatif riche et dense, dont il est l’héritier et que nous avons le devoir d’accompagner et de protéger. Nous parlons de plus de 1, 5 million d’associations, de plus de 70 000 créations par an, de 14 millions de bénévoles et de plus de 2 millions d’emplois. Voilà une partie du visage de notre Nation.
Ces associations et leurs adhérents font vivre nos territoires et rythment notre vie quotidienne ; c’est pour cela qu’ils nous ont manqué en cette période de crise. Ce sont nos clubs sportifs, les comités des fêtes, les associations culturelles et les organisations caritatives qui sont le ciment de notre société ; chaque fois qu’on les nomme, on voit le visage de ces hommes et de ces femmes, des bénévoles de ces associations, qui donnent de leur temps et qui accompagnent nos engagements, dans nos territoires respectifs.
Nous devons accompagner cet engagement de développement permanent.
Cette crise sanitaire a bousculé l’organisation de notre pays, mais elle a également révélé la grande solidarité des Français. Malgré elle, le monde associatif s’est adapté, organisé. Une partie de ce secteur a été plus que sollicité pour apporter des repas pour les personnes âgées ou pour accompagner les plus précaires.
Malheureusement, à ce jour, le nombre de créations d’association est en chute libre – il baisse de 40 % cette année – et les adhésions aux associations culturelles et sportives ont diminué de 25 % à 50 % ; en outre, 66 % des associations ont dû suspendre leurs activités.
Le monde associatif est – cette conviction est partagée sur l’ensemble des travées – un véritable trésor pour notre bien commun. Le texte que vous allez, je l’espère, adopter permettra de le redynamiser et de lui donner des moyens.
Évidemment, il hybride les ressources des associations, mais il permet de bénéficier de nouvelles ressources. C’est en ce sens qu’il y a non pas substitution mais apport supplémentaire, dans ce texte.
En cette matinée consacrée à deux beaux textes, lesquels soutiennent l’organisation et le financement du monde associatif et accompagnent les hommes et les femmes qui le font vivre – je pense aux responsables associatifs –, nous pouvons ressentir combien le bien commun, ce qui nous permet de faire société, nous fait frissonner.
Quelle est la genèse de ce texte ?
Proposition de loi élaborée en coconstruction, il est important de le rappeler, elle est le fruit des travaux du Mouvement associatif, qui avait remis un rapport au Premier ministre en 2017. Ce rapport contenait 59 propositions, dont 4 se retrouvent dans le texte. Celui-ci s’appuie également sur le rapport du Haut Conseil à la vie associative et sur des dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui avaient malheureusement été censurées par le Conseil constitutionnel, en tant que cavaliers législatifs.
Ce texte est donc bien issu des propositions remontées des territoires et des associations ; c’est pour cela qu’il est très attendu.
Vous l’aurez compris, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte permettra d’améliorer la trésorerie des associations, essentielle en ce moment. Encore une fois, je me réjouis d’être parmi vous ce matin pour examiner ces deux textes faisant vivre le monde associatif et les bénévoles qui donnent vie et un visage à celui-ci.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le 12 mai dernier, la commission des lois a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Cet examen a été conduit selon la procédure de législation en commission, prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du règlement du Sénat.
Vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, ce texte a une histoire assez longue puisqu’il a été déposé par vous-même et certains de vos collègues députés sur le bureau de l’Assemblée nationale, en octobre 2018 ; le Sénat l’a adopté en première lecture en juillet 2019. C’est un long parcours, mais il ne faut jamais baisser les bras ; la preuve : nous sommes là aujourd’hui.
Ainsi que je l’ai indiqué en commission, le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture répond au souhait que le Sénat avait exprimé de préserver l’équilibre entre collectivités territoriales et associations. Vous m’avez remerciée, madame la secrétaire d’État, et je souhaite vous remercier également, parce que nous avions échangé à ce sujet et que vous avez entendu nos inquiétudes à l’égard des collectivités territoriales. J’aimerais que tous les textes puissent être élaborés dans le même état d’esprit ; cela montre que, quand on s’écoute, quand on partage et quand on a un objectif commun, on peut y arriver. Je vous remercie donc, à titre personnel, de ce travail que nous avons mené en commun.
Si nous avons dû proposer des modifications, le 12 mai dernier, c’est pour des raisons de pure cohérence législative et, je pense pouvoir le dire, ce texte fait aujourd’hui l’objet d’un consensus.
Je souhaite rappeler quelle était la position du Sénat en première lecture. Nous partagions évidemment la volonté d’accompagner les associations, dont les financements ont tendanciellement baissé depuis quinze ans et qui agissent au quotidien dans les communes.
Nous avions donc adopté « conformes » quatre articles du texte et avions adopté les autres avec des modifications essentiellement techniques.
Toutefois, sur proposition de la commission, le Sénat avait refusé d’inscrire dans la loi la possibilité, pour les associations, de conserver un « excédent raisonnable » correspondant à tout ou partie d’une subvention non utilisée. C’est là-dessus que nous avons travaillé et que nous avons trouvé un point d’équilibre.
Dans la même logique, le Sénat avait supprimé l’article 1er bis, qui prévoyait une obligation de versement des subventions accordées en soixante jours, à partir de la notification de l’accord.
Enfin, le Sénat avait refusé d’exclure du droit de préemption les aliénations à titre gratuit au profit des organisations non lucratives et avait, en conséquence, supprimé l’article 4 bis.
Par ailleurs, nous avions enrichi le texte proposé de plusieurs articles additionnels, qui ont été conservés.
L’Assemblée nationale a maintenu la plupart des apports du Sénat et a pris en compte nos réserves sur plusieurs articles ; tel a été l’objet, je le répète, de nos discussions, qui ont pu aboutir à un accord.
L’Assemblée nationale a ainsi maintenu la suppression de l’article 4 bis empêchant les communes de faire usage du droit de préemption sur les biens cédés à titre gratuit aux associations ayant la capacité de recevoir des libéralités.
Elle a adopté une nouvelle rédaction de l’article 1er, afin de prévoir la possibilité, pour les associations, non plus de conserver un « excédent raisonnable » d’une subvention, mais de définir, dans le cadre d’une convention avec les collectivités, les conditions dans lesquelles elles peuvent conserver « tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ». Cette rédaction, issue d’une coconstruction, donnera, je pense, satisfaction à tout le monde.
L’article 1er bis a également fait l’objet d’une nouvelle rédaction, afin de prévoir que le délai de versement d’une subvention à une association est fixé à un certain nombre de jours, par convention, en fonction du lien individuel et indépendant qu’entretient la collectivité avec l’association. Chacun tiendra compte de l’autre, par convention, et tout cela devrait fonctionner.
Tout en maintenant le souhait de permettre aux associations de bénéficier de facilités de trésorerie et d’une plus grande prévisibilité sur le versement des subventions qui leur ont été allouées, ces nouvelles rédactions préservent les compétences des collectivités. Elles reposent sur la compréhension des difficultés que peuvent avoir les associations. Nous avons trouvé le bon équilibre.
Plus directement incompatible avec le texte soumis à l’examen du Sénat, le contenu de l’article 4, relatif à la mise à disposition, auprès d’associations, de fondations ou d’organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement, de biens immobiliers saisis lors de procédures pénales, figure désormais à l’article 4 de la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Il y a été introduit par le Sénat, sur proposition de notre collègue Alain Richard, qui ignorait quel serait le calendrier du texte dont nous discutons aujourd’hui. Cette disposition a donc « changé de texte » ; c’est aussi efficace et tout le monde s’y retrouve.
Aussi, bien que l’article 4 de la présente proposition de loi ait été adopté dans un texte conforme par les deux chambres et ne soit donc plus en navette, il a été nécessaire de le rappeler, conformément aux dispositions de l’article 44 bis du règlement du Sénat, afin d’assurer la coordination avec le texte de la loi du 8 avril dernier.
Enfin, la commission des lois a également adopté, le 12 mai dernier, deux amendements de coordination, ainsi qu’un amendement de notre collègue Cécile Cukierman, qui tendait à ajuster la période sur laquelle doit porter le rapport demandé à l’article 5, pour tenir compte du temps passé depuis la première lecture. On s’est adapté au temps que nous avons toutes les deux perdu, madame la secrétaire d’État…
Ne reste donc ouvert qu’un nombre très faible d’articles ; la fin de la navette en sera, je l’espère, facilitée d’autant.
Je conclus en soulignant que le contexte de 2021 n’est plus celui de 2019 et que le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme aura un impact important sur les associations. Outre le fait que ce projet de loi donne satisfaction à un amendement adopté par le Sénat en première lecture sur l’alignement des obligations de transparence financières pour toutes les associations qui gèrent une activité cultuelle, il impose le contrat d’engagement républicain – un objectif que nous partagions – aux associations sollicitant des subventions publiques.
C’est une réforme que nous avons approuvée et qui permettra de lutter contre certaines dérives que l’on a pu constater dans une partie toute petite mais malheureusement très active du monde associatif.
Le Sénat se réjouit aujourd’hui d’avoir fait ce chemin avec vous, madame la secrétaire d’État.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cela a été rappelé, c’est au terme d’une procédure législative particulièrement longue que nous allons enfin pouvoir apporter une réponse aux plus de 1, 3 million d’associations que compte notre pays ; ces structures attendent d’être soutenus, après la crise sanitaire qui a mis en berne la vie associative dans notre pays.
C’est tout l’intérêt de cette proposition de loi, enrichie tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, qui doit faciliter le fonctionnement et le développement des associations d’un point de vue financier. Cette nécessité se fait de plus en plus pressante à l’heure de la sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire et alors que les associations font face, depuis plus de quinze ans, à une baisse tendancielle des financements publics.
Le groupe Union Centriste estime, au moment où nous venons de voter le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, que les associations doivent être soutenues. Ces dernières sont des actrices essentielles de la vie des Français et leurs efforts ne doivent pas avoir été faits en vain.
À cet égard, je tiens à saluer Mme la rapporteure pour la qualité de son travail depuis le début du parcours de cette proposition de loi. En outre, la qualité de la relation entre notre rapporteure et son homologue de l’Assemblée nationale a permis de protéger les intérêts que nous défendons au Sénat, démontrant la volonté de nos deux chambres d’aboutir à un texte ambitieux, au service des associations mais également des collectivités.
À ce titre, le groupe Union Centriste se réjouit que la plupart des dispositions introduites par la Haute Assemblée en première lecture aient pu être maintenues à l’issue de la deuxième lecture, à l’Assemblée nationale. Je pense tout particulièrement aux dispositions visant à préserver l’équilibre, que nous estimons nécessaire, entre collectivités territoriales et associations. En tant que partenaires privilégiées de la vie sociale, les communes ne doivent pas se voir imposer des contraintes disproportionnées, voire contreproductives, ayant pour conséquence d’alourdir inutilement leur travail de coopération avec les associations.
Bien que les subventions publiques soient en baisse depuis plusieurs années, 49 % des ressources des associations continuent de provenir de financements publics, ce qui constitue un coût non négligeable, pesant sur les collectivités locales.
Le groupe Union Centriste partage les dispositions introduites au cours de la navette et considère que cette proposition de loi va dans le bon sens, pour plusieurs raisons.
Premièrement, ce texte multiplie les sources de financement des associations, en autorisant les prêts entre associations d’un même réseau.
Deuxièmement, il simplifie les relations entre les autorités administratives et les associations ; nous savons à quel point les démarches administratives sont un frein à l’efficacité et à la rapidité des mesures. D’une part, une autorisation sera accordée aux associations de conserver une partie d’une subvention non dépensée ; d’autre part, le texte ouvrira aux fondations la possibilité d’être agréées pour enseigner la conduite.
Troisièmement, ce texte accompagne la montée en charge du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), en intégrant les parlementaires à sa gouvernance et en reversant à ce fonds le solde des comptes inactifs d’association ou le solde des comptes de campagne n’ayant pas été attribués dans le délai prévu.
Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte.
M. Pierre-Antoine Levi applaudit.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en commission, le groupe SER s’est félicité, par la voix de son président Patrick Kanner, qui avait suivi ce texte et que je supplée aujourd’hui, de la poursuite de l’examen de ce texte, après une lecture au Sénat et deux lectures à l’Assemblée nationale. L’esprit de consensus, que vous venez d’illustrer, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, aura finalement animé les débats.
Plusieurs dispositions ont déjà fait l’objet d’une adoption conforme – les prêts entre associations, l’identification des comptes inactifs –, donc il est temps de conclure. C’est le souhait partagé par l’ensemble du Mouvement associatif et c’est la raison pour laquelle notre groupe n’a pas déposé d’amendements sur ce texte.
La crise sanitaire place les associations dans de grandes difficultés financières. Ces organismes connaissent une baisse sans précédent du nombre de leurs salariés et de leurs bénévoles. Notre volonté d’amplifier l’engagement, dans notre pays, de simplifier la vie des bénévoles et de faciliter l’accès aux financements n’est qu’un élément de réponse, qui ne suffira évidemment pas.
En 2020, selon le Mouvement associatif, 30 000 associations sont menacées de disparition, 55 000 ont déclaré ne pas pouvoir maintenir les salaires et l’on décompte 60 000 emplois en moins. Les déclarations d’embauche ont chuté de 45 % et les créations d’association de 40 %. Enfin, les adhésions ont décru de 25 % à 50 % dans les associations sportives, culturelles et de loisirs. C’est l’hécatombe, douloureux reflet des difficultés qui sont devant nous.
Les 16 millions de bénévoles et de salariés que comptent nos associations sont – vous l’avez vous-même rappelé, madame la secrétaire d’État – une richesse exceptionnelle pour notre démocratie. Cette proposition de loi qui vise à faciliter le fonctionnement et le développement de ces associations sur le plan financier doit désormais être adoptée.
Toutefois, l’esprit de consensus que j’évoquais ne constitue pas un blanc-seing donné au Gouvernement ; cette proposition de loi doit être vue pour ce qu’elle est : un petit pas visant à prendre en compte les attentes d’un secteur associatif en difficulté.
En reprenant des demandes du secteur ainsi que des mesures adoptées sous le précédent quinquennat, notamment dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté, chère au cœur de Patrick Kanner, mais censurées par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi va dans le bon sens.
L’examen de ce texte intervient dans un contexte de crise, je ne l’oublie pas, mais également de désengagement complet de l’État par rapport au milieu associatif. La suppression de plus de 250 000 contrats aidés en deux ans, la réduction de la dotation globale de fonctionnement et, plus largement, la baisse générale de la collecte grand public ont entamé le processus de délitement du secteur associatif, privant les associations de leur capacité d’embauche et certaines personnes d’une réinsertion sociale par le biais de l’emploi.
Le secteur associatif, les réseaux de l’éducation populaire et les clubs sportifs, renforts du service public, notamment de l’école, doivent – mais je vous en vois déjà persuadée, madame la secrétaire d’État – être soutenus pour irriguer l’ensemble des territoires – nous en sommes évidemment, au Sénat, les premiers convaincus – et apporter, par leur présence, un cadre et des repères aux jeunes, notamment aux enfants et aux adolescents.
Nous espérions une grande loi pour le secteur associatif, mais nous n’oublions pas que celui-ci a grandement besoin de ces premières mesures, qui sont urgentes. Donc, ne ralentissons pas leur adoption.
Nous ne pouvions pas adopter sans modification le texte présenté au Sénat en deuxième lecture, mais les modifications proposées ont été réduites, pour que restent en navette le moins d’articles possible. Il appartient désormais au Gouvernement d’inscrire rapidement ce texte, que nous approuvons, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, pour son adoption définitive.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes tous attachés au monde associatif : les associations jouent un rôle essentiel et irremplaçable. Dans nos villes, nos quartiers et nos villages, au plus près des habitants de toutes les générations, elles sont utiles au quotidien.
C’est encore plus vrai aujourd’hui, dans la période difficile que nous traversons ; je pense, bien sûr, aux associations du secteur sanitaire et social, mais également à celles qui facilitent la continuité pédagogique ou qui aident à lutter contre le décrochage scolaire. Dans cette situation inédite, les associations ont prouvé leur pertinence. Nous pouvons donc être fiers du dynamisme de notre secteur associatif.
On estime à 1, 5 million le nombre d’associations en France. Dans le département dont je suis élu, le Nord, où l’on en compte près de 48 000, l’engagement citoyen est très actif. Le monde associatif, c’est aussi plus de 70 000 créations par an, 16 millions de bénévoles et 1, 8 million d’emplois, à temps plein ou partiel. C’est enfin un budget total de 113 milliards d’euros, soit l’équivalent de 3 % du produit intérieur brut (PIB).
Ces derniers chiffres sont éloquents pour exprimer la place que les associations occupent dans la vie économique de notre pays. Néanmoins, leur rôle essentiel ne se résume pas à cet aspect, il va bien au-delà. Je veux parler ici des valeurs qu’elles portent : celles de l’engagement, des solidarités, de la philanthropie et de la générosité.
Aussi, soutenir les associations paraît indispensable, car elles sont au cœur de la cohésion sociale. La proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, soumise à notre vote aujourd’hui, est en navette depuis plus de deux ans. Elle est issue d’une proposition de loi que vous aviez déposée en octobre 2018, madame la secrétaire d’État, lorsque vous étiez députée. Ce texte, composé initialement de six articles, a été réécrit et étoffé par nos deux chambres.
Je me félicite que le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ait tenu compte des enrichissements apportés par le Sénat afin de préserver l’équilibre entre associations et collectivités territoriales.
Ainsi, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 1er définissant désormais les conditions dans lesquelles une association peut conserver « tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée », dans le cadre d’une convention signée entre une collectivité et une association. Je me réjouis qu’elle ait abandonné la notion trop imprécise d’« excédent raisonnable ».
La rédaction de l’article 1er bis a également été modifiée afin que le délai de versement d’une subvention à une association soit « fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé ».
Enfin, je suis satisfait du maintien de la suppression de l’article 4 bis privant les communes d’utiliser le droit de préemption urbain sur les biens immobiliers cédés à titre gratuit aux associations et fondations. En effet, ce droit, très encadré, est nécessaire à la cohérence des projets d’urbanisme des collectivités.
Avant de conclure, je tiens à rendre hommage, à cette tribune, aux millions de femmes et d’hommes, bénévoles associatifs, qui agissent avec l’élan du cœur et ne comptent pas leur temps.
Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, les associations font vivre le tissu économique local et dynamisent la vie de nos communes rurales et de nos quartiers urbains. Simplifier leur gestion et alléger la tâche de ceux qui s’y consacrent est un objectif que le groupe Les Indépendants partage pleinement. Il votera donc bien évidemment en faveur de cette proposition de loi.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le sort et la place du monde associatif ainsi que l’importance de la loi de 1901, récemment mises à mal lors de l’examen du projet de loi dit « Respect des principes de la République », figurent de nouveau à notre ordre du jour.
Cette proposition de loi que nous venons d’étudier en commission est la traduction législative du rapport Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d ’ une société de l ’ engagement, publié en mai 2018. En navette depuis deux ans, cette proposition de loi a eu le rare honneur de ne pas subir une procédure accélérée et de croiser d’autres textes structurants, comme la loi de finances pour 2020 créant un Fonds pour le développement de la vie associative, le fameux FDVA.
Ce rapport, issu d’une large concertation entre les secteurs divers du monde associatif, tels que le sport, l’environnement, le social, la culture, et les acteurs institutionnels impliqués, a abouti à 59 propositions concrètes.
La France compte environ 1, 3 million d’associations au sein desquelles sont engagés 16 millions de bénévoles et 1, 8 million de salariés.
Un point auquel je suis tout particulièrement attaché, ainsi que mon groupe, est la place primordiale des associations dans le monde de l’économie sociale et solidaire (ESS). Oui, la forme associative est celle qui est le plus souvent choisie – près de 90 %, d’après l’Atlas ESS de 2015 – pour encadrer l’exercice d’une activité qui s’inscrit dans le cadre ambitieux des solidarités.
Je ne rappellerai pas combien les écologistes encouragent et soutiennent un engagement citoyen fort, sur l’ensemble des territoires et dans l’ensemble des domaines. Nul besoin, non plus, de rappeler qu’avec la crise du covid-19 les associations ont encore plus montré qu’elles étaient précieuses pour les plus précaires, les plus isolés, les plus démunis et les plus abandonnés.
La sécurisation du financement des associations, en particulier dans leurs relations avec les collectivités territoriales, constitue le cadre le plus structurant pour assurer la pérennité de ces acteurs du quotidien.
Pourtant, ce gouvernement n’aura pas épargné les associations par sa politique fondée sur la théorie des premiers de cordée, dite aussi du ruissellement, par la baisse des subventions publiques, la fin des contrats aidés, sans oublier le tout récent contrat d’engagement républicain. Comment, alors, s’étonner des baisses de création et d’adhésion aux associations ?
Pour en revenir à l’étude des articles qui restaient en discussion après ce long processus législatif, nous avons pu nous pencher sur l’équilibre nécessaire entre, d’une part, les contraintes financières qui s’imposent aux associations, et, d’autre part, leurs contraintes administratives, tout particulièrement dans leurs relations avec les collectivités territoriales.
L’article 1er, qui reprenait la proposition 50 du rapport de 2018, a abandonné la notion « d’excédent raisonnable », pour définir les fonds issus de subventions publiques qu’une association pourra conserver d’une année sur l’autre.
Si j’entends que cette notion est trop vague, le fait d’indiquer qu’une association pourra conserver « tout ou partie » de ces fonds dans le cadre de conventions signées avec une collectivité s’éloigne des recommandations initiales du rapport. Ainsi, dans le cadre de ces conventions, cela laisse la place au dialogue pour définir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver « tout ou partie » de ces montants. Il convient tout de même de poser la question des différences territorialisées de ces conditions de trésorerie, voire des différences qui pourraient être faites d’une association à l’autre.
À ce titre, j’ai déjà alerté cette assemblée de l’importance de permettre aux petites structures associatives de l’ESS, dont l’activité dépend parfois d’une tarification publique ou de subventions pour des délégations d’action, de mettre en réserve une partie de leur résultat d’exploitation. La souplesse et la visibilité de leur gestion sont au cœur de la pérennité de ces structures. Cette mesure serait tout à fait bienvenue pour les petites associations issues de l’ESS.
Nous saluons l’adoption d’un délai légal de versement des subventions de soixante jours, qui permet aussi une plus grande visibilité à la vie associative.
Les modifications apportées par les articles 3 bis A et 3 bis B sur la dévolution des excédents des comptes de campagne électorale se révèlent un signal fort : sans action du mandataire ou de l’association de financement électoral sur le devenir de l’excédent, ce dernier reviendra au FDVA. C’est la reconnaissance du rôle essentiel des associations dans la vie locale. L’article 3 bis intègre d’ailleurs les parlementaires dans le collège consultatif du FDVA.
Je salue la position de notre commission sur l’article 5, qui a adopté la modification portée par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ayant souhaité inscrire le rapport prévu dans cet article dans une temporalité plus longue. Cela permettra vraisemblablement d’avoir une réelle analyse de l’impact de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur les dons.
Dans l’ensemble, ce texte, comme celui étudié en parallèle par la commission de la culture, va dans le bon sens, celui d’une reconnaissance des associations, de leur travail et d’une simplification de leur fonctionnement, y compris au niveau de leur trésorerie.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, conscient de l’importance de la place des associations dans notre société dans tous les domaines de la vie quotidienne, et malgré quelques réserves, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette deuxième lecture au Sénat marque l’aboutissement d’une navette de trois années, qui a permis, par des travaux constructifs, d’aboutir à un accord sur le fond.
Ce texte que vous portiez, madame la secrétaire d’État, comme auteure puis rapporteure lorsque vous siégiez à l’Assemblée nationale, est le fruit d’un long travail de concertation mené en lien avec le Mouvement associatif.
Il reprend notamment plusieurs dispositions qui n’avaient pas pu être intégrées, en 2017, dans le périmètre de la loi Égalité et citoyenneté. L’entrée en vigueur de ce texte, qui répond à la nécessité de permettre aux associations d’affermir leur stabilité par le recours à de nouvelles ressources, est donc très attendue par le monde associatif.
C’est justement pour répondre à cette impatience et parce que nous savions que certaines de ses dispositions étaient très attendues que, avec le groupe RDPI et sur l’initiative d’Alain Richard, nous avons fait le choix de reprendre, au sein de la loi améliorant la justice de proximité et de la réponse pénale, la possibilité pour l’État de mettre à disposition des associations, fondations ou organismes d’aide au logement des biens immobiliers saisis lors de procédures pénales. Grâce à cette initiative, ce dispositif est effectif depuis le mois dernier.
La deuxième lecture n’a donné lieu en commission des lois qu’à de simples ajustements de portée rédactionnelle ou de coordination, et n’a pas altéré sur le fond le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Et pour cause, l’Assemblée nationale s’est elle-même montrée bienveillante envers les réserves que le Sénat avait pu exprimer en première lecture et les a intégrées dans son travail. Elle a ainsi répondu à la nécessité de préciser la définition de l’« excédent raisonnable » de la subvention non utilisée pouvant être conservée et a clarifié la mise en œuvre du délai de versement des subventions.
Par ailleurs, les principaux apports du Sénat ont été conservés, tels que l’élargissement de la liste des associations pouvant bénéficier de l’excédent du compte de campagne ou le maintien de la possibilité, pour les communes, de faire usage du droit de préemption sur des biens cédés à titre gratuit aux associations. Ainsi, le texte que nous nous apprêtons à voter préserve utilement l’équilibre des liens établis entre collectivités territoriales et associations.
Comme les collectivités, les associations ont œuvré au soutien des populations les plus fragiles durant la crise sanitaire. Si le secteur associatif a été au cœur de la crise sanitaire, il a lui-même été gravement éprouvé par son contexte. Les chiffres sont saisissants : –40 % de création d’association et –25 % d’adhésions dans les associations culturelles et sportives.
Aussi, ce texte initialement conçu pour soutenir un secteur en pleine mutation est aujourd’hui rendu nécessaire pour soutenir son redémarrage et promouvoir le retour vers l’engagement.
Concrètement, la proposition de loi permettra aux associations de bénéficier de facilités de trésorerie et d’une plus grande prévisibilité sur le versement des subventions, grâce à la possibilité pour l’association de conserver tout ou partie de la subvention qui n’aurait pas été intégralement dépensée. Elle permettra également aux associations de s’accorder mutuellement des prêts de trésorerie, sans intérêt, pour une durée inférieure à deux ans.
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre d’une politique à plusieurs niveaux. Je pense ainsi aux moyens engagés pour soutenir le secteur dans le cadre du plan France Relance et, notamment, au plan exceptionnel de soutien de 100 millions d’euros pour les associations de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Complétant utilement ces dispositifs, le présent texte a fait l’objet d’un large consensus sur nos travées, à l’issue d’un travail constructif dont nous espérons qu’il aboutira prochainement.
Dans cette perspective, le groupe RDPI votera la proposition de loi.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, qu’elles soient sportives, culturelles ou caritatives, les associations sont le cœur battant de notre pays. Elles sont des lieux de mobilisation, de partage et d’éveil, qui permettent un brassage et des mélanges là où l’État, parfois, ne le fait plus.
Nous devons d’autant plus nous pencher sur leur sort que nombre d’entre elles n’ont pas été épargnées par la crise et ont vu leur activité ralentir ou s’interrompre complètement depuis maintenant un an. Précisons tout de même que certaines collectivités, malgré l’explosion des charges sociales, ont souhaité maintenir les niveaux d’aide et de subvention – c’est le cas du département des Hautes-Pyrénées.
Je pense également aux clubs de sport, très vite soumis à la suspension de nombreuses compétitions, et aux conséquences que ces décisions occasionnent. Il s’agit, tout d’abord, des conséquences morales pour de nombreux licenciés et bénévoles, lesquels se voient privés de leur activité hebdomadaire, de leur moment de détente et de convivialité qui caractérisent tant nos clubs. Il s’agit, ensuite, des conséquences financières sans commune mesure.
Aussi, comme je l’avais dit lors de la première lecture, nous ne pouvons que partager l’esprit et les objectifs de ce texte dans la simplification des relations entre les associations et les collectivités et l’amélioration de leur trésorerie.
Toutefois, nous ne pouvons occulter un problème de fond : le recul croissant du financement public des associations. Nous le savons tous sur ces travées, la baisse des ressources des collectivités a entraîné une baisse des financements pour les associations. On le doit d’abord à une baisse significative de la dotation globale de fonctionnement (DGF), mais aussi à une réforme fiscale venue limiter les marges de manœuvre de celles-ci.
Je ne reviendrai pas sur la réserve parlementaire qu’on a préféré supprimer plutôt que de venir limiter l’usage abusif qui pouvait en être fait par une minorité. Par conséquent, de plus en plus d’associations se tournent vers le privé. Si nos marges de manœuvre sur les financements de l’État sont faibles, nous devons accompagner et encadrer ce financement par les acteurs privés.
Pour en venir au texte, je rejoins l’avis de la commission : nous devons conserver l’équilibre entre les finances des associations et celles des collectivités.
À l’article 1er, la suppression de la notion d’excédent raisonnable est une bonne avancée. Son maintien aurait posé quelques difficultés, tout d’abord dans la définition de ce qu’est un excédent raisonnable, car cela aurait entraîné, en conséquence, une modification des pratiques des collectivités, qui auraient dû faire face à la difficulté de définir avec chacune des associations la hauteur de cet excédent raisonnable. Aussi, le choix de confier à l’association et à la collectivité le soin de prévoir, dans le cadre de la convention qu’elles auront conclue, la prévision de la part de subvention me paraît équilibré.
Ensuite, période électorale oblige, je saluerai les ajouts du Sénat concernant la liste des associations pouvant bénéficier de l’excédent du compte de campagne aux articles 3 bis A et 3 bis B.
S’agissant du Fonds de développement de la vie associative, je saluerai, comme lors de la première lecture, l’ouverture de la participation des parlementaires aux collèges départementaux de la commission régionale du FDVA. C’est une décision dont nous devrons nous saisir pour venir appuyer les projets locaux.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le travail mené de concert par les deux chambres aura pris du temps, mais il est à saluer. Il permettra de multiplier les sources de financement des associations, mais également d’accompagner la montée en charge du Fonds de développement de la vie associative que nous appelons de nos vœux.
Aussi, les élus du groupe RDSE voteront à l’unanimité ce texte.

La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous terminons aujourd’hui l’examen de deux propositions de loi sur la vie associative.
Permettez-moi de saluer l’ensemble des acteurs associatifs. Leur engagement nous est précieux, par tous les temps, davantage encore depuis un an. Eux aussi sont en première ligne face à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques et sociales ; en première ligne pour lutter contre les inégalités et l’exclusion qui s’accroît ou pour maintenir ou recréer de la solidarité et du lien social, dont nous mesurons particulièrement en ce moment l’importance.
Le Sénat avait adopté cette proposition de loi en première lecture le 9 juillet 2019. Notre groupe s’était alors abstenu, le passage du texte en séance en ayant considérablement affaibli la portée. Je tiens donc à saluer le travail de conciliation qui a été fait entre les deux chambres.
Voilà des années maintenant que les associations voient leurs financements publics diminuer, alors que, paradoxalement, elles se voient déléguer de plus en plus de missions et de responsabilités.
La crise sanitaire a exacerbé cet effet ciseaux et les premières indications sur la baisse inquiétante du nombre d’adhésions dans les associations font craindre une amplification du phénomène. Cette proposition de loi apporte des avancées face à cela. La possibilité de conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée en est une.
C’est une suite logique de nos travaux, dès le début de la crise sanitaire, permettant aux collectivités de maintenir leurs subventions, malgré l’annulation d’événements culturels ou associatifs. Saluons, d’ailleurs, l’engagement fort de ces collectivités, aux côtés des associations, dans ce contexte.
Concernant l’article 1er bis, nous sommes satisfaits, madame la rapporteure, que vous ayez obtenu une rédaction de compromis qui permet à la fois de sécuriser les associations et les collectivités en fixant un délai de versement des subventions, et d’introduire la souplesse nécessaire pour que ces collectivités puissent établir des échéanciers de règlement, via des conventions. Cela sera utile tant aux associations pour lancer leurs projets qu’aux collectivités pour les accompagner dans la durée.
Cette proposition de loi aura aussi été utile pour faire avancer la possibilité de récupérer les fonds dormant sur des comptes inactifs au bénéfice des associations, même si cela s’effectue par un autre véhicule législatif. Cette demande du Mouvement associatif, assez ancienne maintenant, semble encore plus légitime dans le contexte actuel.
Cela permettra de pallier les insuffisances notoires du FDVA : celui-ci satisfait moins de la moitié des demandes de soutien qui lui sont adressées et, je le rappelle, finance moins les réseaux associatifs que ne le faisait la réserve parlementaire, quoi qu’on puisse penser de celle-ci. Nous resterons vigilants à ce que cette bouffée d’oxygène pour les associations ne vienne pas justifier une nouvelle baisse de la contribution de l’État.
La rédaction de l’article 5 a été revue par un amendement de notre groupe. En prenant en compte le temps particulièrement long de l’élaboration de ce texte, nous avons cherché à rester dans son esprit initial et à permettre d’évaluer les conséquences, pour les associations, des réformes fiscales portées en début de ce quinquennat.
Je le rappelle également, ce début de quinquennat a été marqué par la suppression d’un nombre considérable d’emplois aidés, pourtant indispensables au tissu associatif qui s’est trouvé déstabilisé et fragilisé, alors qu’il n’avait vraiment pas besoin de cela.
Plus récemment, d’autres mesures sont venues inquiéter le Mouvement associatif, telles que certaines dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Les associations estiment ainsi que, en s’engageant, lors de toute demande de subvention, à respecter les valeurs et principes de la charte des engagements réciproques, elles prennent une obligation contractuelle suffisamment forte pour qu’il ne soit pas besoin de confirmer cet engagement en signant le contrat d’engagement républicain créé par ce texte.
Certaines d’entre elles y voient même une suspicion dangereuse par rapport à leurs activités, alors que, bien évidemment, la très grande majorité des initiatives associatives, qu’elles soient sportives, culturelles ou autres, a précisément pour vocation de consolider la cohésion sociale et de lutter contre toutes formes de séparatisme.
Quoi qu’il en soit, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, nous soutiendrons cette proposition de loi, qui apporte quelques améliorations tout à fait concrètes et bienvenues pour tous les militants associatifs.

La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour le groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d’un processus législatif particulièrement long, qui a permis d’aboutir au meilleur compromis, afin d’adopter la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations.
Les enjeux soulevés par cette proposition sont nombreux et ont nécessité un travail approfondi. Le Sénat partage les préoccupations des auteurs du texte initial, qui actent la baisse continue des financements publics à destination des associations depuis une quinzaine d’années, et souhaitent pallier les difficultés rencontrées par le monde associatif.
Rappelons que notre pays compte 1, 5 million d’associations et que ce nombre augmente de plus de 2 % par an, selon l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Les associations sont connues pour les services qu’elles rendent, les causes qu’elles défendent, mais leurs impacts sur le territoire vont bien au-delà. Elles ont un rôle dans le développement des échanges et du lien social. Elles contribuent à l’animation et à l’attractivité du territoire ainsi qu’à l’information, l’éducation et la formation.
Ainsi, 76 % des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de coconstruction pour répondre collectivement aux enjeux des territoires. Il y a une forte convergence entre les attentes des maires et les réponses que peuvent y apporter les associations. Ces dernières ont une forte capacité à être à l’écoute de leur territoire et à savoir répondre en cohérence avec les besoins qu’elles y captent.
Les associations savent apporter des réponses adaptées aux fragilités prioritaires de leur territoire : l’attractivité sur les territoires ruraux et la réduction des inégalités en territoire urbain. La capacité à la fois à réduire les fragilités et à faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi adaptés à la spécificité de leur territoire est l’une des grandes valeurs ajoutées des associations.
Malgré de faibles moyens, les petites associations, qui représentent 70 % de l’ensemble, jouent un rôle important dans de multiples domaines de la vie sociale.
Nous le savons : plus les associations disposent de moyens financiers, plus elles sont en capacité d’agir et de multiplier leurs efforts sur le territoire.
Afin de préserver cette richesse, il était nécessaire de garantir les sources de financement, de simplifier les relations avec les autorités administratives et d’accompagner la montée en puissance du Fonds de développement pour la vie associative.
Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois, a été particulièrement attentive à la question de la conciliation des intérêts des associations avec ceux des collectivités territoriales. Le Sénat a voulu, dès la première lecture, enrichir le texte afin de préserver cette relation de confiance.
Nous nous félicitons que l’Assemblée nationale ait respecté les modifications apportées par notre chambre, notamment le renforcement des obligations en matière de transparence des comptes, lorsque l’association conserve tout ou partie d’une subvention publique non consommée. Cette disposition assure que les relations conventionnelles avec les collectivités sont équilibrées.
Les articles 3 bis A et 3 bis B, inspirés par notre collègue Henri Leroy, ont été conservés. Ils permettent aux candidats ayant recours à une association de financement électorale ou à un mandataire physique de reverser l’excédent de leur compte de campagne à des associations d’intérêt général, et non plus seulement à une formation politique ou à une association particulière.
Enfin, le Sénat a obtenu la suppression de l’article qui visait à exclure du champ du droit de la préemption les donations de biens immobiliers effectuées au profit des associations et des fondations.
Je tiens à saluer l’excellent travail de Jacqueline Eustache-Brinio, qui a réalisé, en parallèle, le rapport sur le projet de loi relatif au respect des principes de la République. Ce dernier établit de nouvelles relations financières entre collectivités et associations, au travers du contrat d’engagement républicain. Je salue également les échanges constructifs qui ont eu lieu avec vous, madame la secrétaire d’État.
Les mesures tendant à faciliter la gestion de la trésorerie des associations, telles qu’elles figurent dans la présente proposition de loi, paraissent alors d’autant plus appropriées. Le souci des associations a été entendu. Il a pu être concilié avec l’intérêt des communes, qui doivent pouvoir s’assurer de la transparence financière de l’utilisation des subventions, à l’heure où les budgets sont de plus en plus contraints.
Cette proposition de loi arrive à point nommé au moment où, après une année de mise en sommeil en raison de la crise sanitaire et de forte réduction des aides des collectivités, l’activité de nombreuses associations pourra reprendre.
Le Sénat fait ici encore preuve de son pragmatisme, de sa connaissance du terrain et des préoccupations des collectivités.
Pour l’ensemble de ces raisons, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions. – M. Pierre-Antoine Levi applaudit également.

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations.
La proposition de loi est adoptée.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, en faveur de l’engagement associatif (proposition n° 486 [2018-2019], texte de la commission n° 578, rapport n° 577).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
I. – (Non modifié) Après le 2° du I de l ’ article L. 312 -20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu ’ il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l ’ établissement lui communique les informations qu ’ il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d ’ application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
II. – (Non modifié) L ’ article 15 de la loi n° 2014 -617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d ’ assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l ’ État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative. »
III (nouveau). – Le 5 du I de l ’ article 150 -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « cinquième alinéa du I de l ’ article L. 312 -20 du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « même sixième alinéa ».
IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du VI de l ’ article L. 312 -20, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 743 -2, L. 753 -2 et L. 763 -2 est ainsi rédigée :
L. 312-20
Résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la trésorerie des associations
(Suppressions conformes)
(Conforme)
Le livre III du code de l ’ éducation est ainsi modifié :
1° L ’ article L. 312 -15 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « à la vie associative et » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une information destinée à la communauté éducative, pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires, est éditée par le ministère chargé de l ’ éducation nationale. » ;
2° L ’ article L. 371 -1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312 -15, » est supprimée ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« L ’ article L. 332 -5 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L ’ article L. 312 -15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l ’ engagement associatif. » ;
3° L ’ article L. 373 -1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312 -15, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L ’ article L. 312 -15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l ’ engagement associatif. » ;
4° L ’ article L. 374 -1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312 -15, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L ’ article L. 312 -15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l ’ engagement associatif. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
(Suppressions conformes)

Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pendant sept minutes, et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a trois ans, mes anciens collègues du groupe MoDem de l’Assemblée nationale auquel j’appartenais, dont l’un d’entre eux, Sylvain Waserman, est aujourd’hui en tribune, ont déposé cette proposition de loi. Ce texte voit enfin la ligne d’arrivée de son long et persévérant parcours, qui signe notre engagement vis-à-vis du monde associatif.
Je porte naturellement un grand intérêt à cette proposition de loi en faveur de l’engagement associatif et pour laquelle j’ai le privilège de porter la voix du Gouvernement. Cette mobilisation est également le reflet de l’attachement des sénateurs au développement de la vie associative partout sur nos territoires.
Essentielles au bon fonctionnement de notre société, les associations jouent, depuis 1901, un rôle primordial dans notre pays. Comme vous l’avez dit à plusieurs reprises, mesdames, messieurs les sénateurs, elles sont le cœur battant de notre pays et permettent de contribuer aux liens sociaux sur nos territoires.
J’aimerais profiter de la tribune qui m’est offerte aujourd’hui pour saluer votre engagement ainsi que celui des collectivités territoriales, qui sont souvent leurs premiers interlocuteurs. Il me semble à ce titre nécessaire de rappeler à haute voix que leur soutien est quotidien. Dans la période que nous traversons, notre rôle est plus que jamais de soutenir et d’accompagner la mise en œuvre des projets des structures associatives, dans leur diversité.
Il est de notre devoir de ne pas laisser les associations seules face à ce risque d’effacement et de délitement de l’engagement des dirigeants et aux conséquences que cela entraînerait, que ce soit sur l’emploi ou sur les solidarités locales. Pour cette raison, le Gouvernement a accompagné les associations tout au long de la crise sanitaire, par des mesures économiques, par leur intégration dans le plan de relance, par des mesures spécifiques aux secteurs les plus touchés et par des mesures sectorielles.
Ces mesures d’accompagnement conjoncturelles doivent toutefois être accompagnées par des mesures structurelles, en continuant à travailler sur les conséquences de cette crise sanitaire. Nous estimons que reconnaître les valeurs et compétences des associations est une façon de les protéger. Parce que les associations sont spécifiques dans leur fonctionnement, il serait injuste de ne pas adapter le droit à ces spécificités. Je souhaite donc saluer la qualité des travaux du rapporteur aujourd’hui au banc – ainsi que du promoteur et de la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale – et les liens que nous avons entretenus.
Ce texte a ainsi permis de rappeler qu’il est indispensable de revoir la responsabilité juridique des présidents bénévoles d’association, pour que s’installe à leur égard non pas un sentiment d’injustice, mais plutôt un véritable soutien, une reconnaissance et un accompagnement concret et malléable. De la même manière, il est absolument essentiel de mettre en œuvre un cadre bienveillant à leur égard, afin que la responsabilité financière des dirigeants bénévoles susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de « simple négligence », ne le soit plus.
Une fois la crise sanitaire passée, ces mesures devront redonner aux citoyens le goût de s’investir, du monde associatif et des responsabilités associatives, sans qu’ils aient à craindre des conséquences sur leur patrimoine personnel.
Cette proposition de loi a également pour ambition de faciliter le renouvellement des dirigeants dont la moyenne d’âge avance. Ce renouvellement ne peut fonctionner que s’il y a transmission et protection. Seule cette garantie permet la pérennité de leurs actions.
Une fois adoptée, la proposition de loi permettra d’envoyer un signal fort aux associations, à celles qui œuvrent au quotidien dans nos territoires, tout particulièrement toutes celles qui ont été très éprouvées ces deux dernières années. Il permettra également de redonner de l’élan, un second souffle à l’engagement des citoyens et des bénévoles, véritable trésor que nous devons protéger, accompagner et reconnaître.
Or donner le goût de l’engagement et de la philanthropie commence dès le plus jeune âge et constitue une priorité. Si des initiatives locales existent déjà dans de nombreux territoires, le Gouvernement soutient vivement la sensibilisation à la vie associative dès le collège. J’avais, par ailleurs, déjà soutenu cette proposition dans mon rapport, remis au Premier ministre de l’époque, sur la philanthropie à la française, étant persuadée que celle-ci est nécessaire au développement de l’engagement citoyen.
Valoriser le bénévolat et les associations en inscrivant la sensibilisation à la vie associative dans le cadre de l’enseignement moral et civique des élèves de collège et lycée, au même titre que le service civique, est donc plus qu’une nécessité. C’est avec elles que nous construisons un projet de société et que nous dessinons le monde de demain.
Poumon de nos territoires, trésor de notre République, les associations font vivre chaque jour des projets et des actions d’intérêt général, avec des visages variés qui se complètent. Elles participent à une économie plus humaine, contribuent à l’éducation des enfants de la République, favorisent l’accès à la culture, aux soins, au droit et font vivre la démocratie au quotidien.
Cette proposition de loi, j’en suis certaine et il est utile de le rappeler, est la démonstration que le Parlement souhaite davantage accompagner, faciliter et encourager le bon fonctionnement de notre vivre ensemble. Elle va en effet permettre de mieux accompagner l’engagement de tous en faveur des projets de ceux qui sont aussi des maillons essentiels du bon fonctionnement de notre pays.
Ce texte est l’illustration parfaite de ce dont notre société a réellement besoin, à savoir un renouveau de l’engagement citoyen, car il représente un espoir pour notre société et notre jeunesse qui doit et peut le porter.
En votant ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs, vous adresserez un message extrêmement positif, d’ambition et de passion, à toutes les générations qui composent notre société. La proposition de loi doit contribuer à ce que chacun – jeunes et moins jeunes, dirigeants, bénévoles – trouve sa place au sein du monde associatif et puisse jouer son rôle dans notre société, sans crainte excessive.
Vous l’aurez compris, ses dispositions ont pour objectif de reconnaître et d’accompagner l’apport des bénévoles dans notre société. Plus qu’un signal, c’est une étape, en cette année où nous fêterons les cent vingt ans de la loi de 1901.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « plus encore qu’une liberté, l’association est une réalité qui a puissamment contribué à façonner la société française tout au long de ce siècle, à y renforcer la tolérance, la solidarité, l’innovation. Une réalité qui s’affirme […] reflétant, dans toute leur diversité, l’engagement des Français, leur sens de l’action collective, leur souci de solidarité comme d’ailleurs leur volonté d’épanouissement personnel ». Ces mots de Jacques Chirac, prononcés à l’occasion du centenaire de la loi de 1901, sont plus que jamais d’actualité.
Je tiens ici à rendre hommage à l’ensemble des bénévoles, des cadres et des dirigeants associatifs, qui, souvent, ne comptent pas leur temps pour faire vivre leurs associations, tisser, maintenir le lien social, animer les territoires.
La commission de la culture en a la conviction : la crise de la covid-19 a montré le rôle essentiel joué par les associations. Cependant, la pandémie ne les a pas épargnées : les informations que j’ai pu recueillir à l’occasion de mes auditions témoignent d’une forte incertitude pesant sur le secteur associatif.
Certes, ce secteur a fait preuve d’une très forte résilience après le premier confinement. Même si les événements n’ont pas pu avoir lieu, la plupart des subventions ont été maintenues par l’État et par les collectivités locales, ce que je salue. En mai et juin 2020, les bénévoles sont revenus, les activités ont repris, l’emploi dans le secteur associatif est reparti à la hausse, alors que le reste du secteur privé continuait à peiner. Mais le deuxième confinement a marqué un nouvel arrêt brutal pour un grand nombre d’associations. Les remontées du terrain témoignent des doutes existants : les conseils d’administration ont du mal à se tenir, il n’est pas sûr que les bénévoles reviennent. La motivation a chuté. En outre, de nombreuses associations employeuses sont menacées de disparition. Or le secteur associatif est un acteur économique important de notre pays : un salarié du secteur privé sur dix y est employé.
Ce tableau sombre ne doit toutefois pas masquer certains points de satisfaction et des lueurs d’espoir.
Tout d’abord, un fonds d’urgence doté de 30 millions d’euros pour le secteur de l’économie sociale et solidaire, accessible aux associations, a été instauré par le quatrième collectif budgétaire. Il est opérationnel depuis la fin du mois de janvier 2021. J’y vois la reprise d’une recommandation effectuée par la commission de la culture dans ses travaux sur la pandémie de la covid. L’enjeu est désormais de faire connaître ce fonds aux associations concernées.
Ensuite, l’élargissement progressif de la vaccination fait émerger de nouvelles questions relatives au mélange de bénévoles et d’un public de vaccinés et de non-vaccinés. Cela témoigne d’une volonté de relance des activités et de la vie associative.
Enfin, cette pandémie a montré l’envie de s’engager d’une partie importante de la population, notamment de la jeunesse, ainsi que la nécessité d’accompagner les associations, pour les aider à se développer et répondre aux attentes des nouveaux bénévoles.
La proposition de loi en faveur de l’engagement associatif répond à un certain nombre de ces préoccupations et à plusieurs demandes du monde associatif : elle atténue la responsabilité financière des dirigeants des associations en cas de faute de gestion ; elle s’adresse à la jeunesse, afin de mieux lui faire connaître le monde associatif ; elle complète le dispositif d’abondement par les comptes en déshérence du FDVA, qui finance notamment la formation des bénévoles. Je rappelle que 2021 est la première année de mise en œuvre d’un abondement de ce fonds par un pourcentage des comptes en déshérence. Lors de mes auditions, il m’a été indiqué que cette mesure représenterait 19 millions d’euros supplémentaires pour 2021. La commission de la culture ne manquera pas de faire un bilan de cette première année d’application, des difficultés rencontrées comme des améliorations possibles.
La proposition de loi traduit l’émergence d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Sans doute ce texte aurait-il pu aller plus loin. La commission a fait le choix d’une adoption rapide pour soutenir un secteur associatif fortement malmené par la pandémie. Aussi, alors que nous allons prochainement commémorer les cent vingt ans de la loi de 1901, j’espère, madame la secrétaire d’État, que cette proposition de loi et celle visant à améliorer la trésorerie des associations, que nous venons de voter, constituent une étape, et non l’aboutissement de l’action du Gouvernement en faveur des associations. Je tiens d’ailleurs à souligner que, si un très large consensus s’est dégagé au sein de notre commission pour une adoption rapide de ce texte, nous sommes également nombreux à noter les bouleversements qui ont ballotté, voire percuté les associations ces dernières années, y compris indépendamment de la pandémie.
Les associations font partie de notre quotidien et maillent l’ensemble du territoire français. Leur existence, leurs actions semblent aller de soi à chacun. Leurs problèmes et leurs besoins demeurent toutefois trop souvent invisibles.
En première lecture, le Sénat avait souhaité faciliter la reconnaissance de leur rôle d’intérêt général au niveau local, mais la disposition proposée posait de nombreuses questions, raison pour laquelle la commission de la culture n’a pas proposé son rétablissement.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, le monde associatif a besoin de soutien de la part de la Nation. Ces dernières années, le Haut Conseil à la vie associative a fait plusieurs propositions pour améliorer cette reconnaissance. J’espère que vous y serez sensible, tout comme à l’ensemble des interventions des différents groupes politiques sur ce sujet.
Le cœur de l’association, c’est l’humain, l’engagement d’un individu en faveur des autres. Sans bénévoles, il n’y a pas d’association. La transmission de la volonté de s’engager d’une génération à l’autre représente donc un défi. Le texte prévoit une découverte et une sensibilisation dès le plus jeune âge au rôle des associations et au bénévolat.
L’encouragement et la reconnaissance du bénévolat étaient également l’objet de plusieurs amendements adoptés par le Sénat en première lecture. Nous n’avons pas souhaité les rétablir en commission, parce qu’ils suscitaient un certain nombre d’interrogations. La situation économique des entreprises a également fortement évolué depuis 2019.
En revanche, les représentants d’associations que j’ai pu rencontrer, qu’il s’agisse de têtes de réseau ou d’associations locales, m’ont indiqué la nécessité d’encourager le bénévolat et ont souligné l’investissement en temps des bénévoles. Ces derniers y passent des soirées et, souvent, tous leurs week-ends – je pense aux dirigeants et encadrants des associations sportives, par exemple – ou encore une partie de leurs vacances. D’ailleurs, l’une des inquiétudes des associations porte sur le retour des bénévoles qui auront redécouvert les week-ends et soirées libres de tâches associatives…
Comme l’a rappelé notre collègue Michel Savin en commission, le statut de bénévole doit être mieux reconnu et valorisé, notamment par des actes. On ne peut en rester là, sans faire de proposition pour l’avenir. Aussi, permettez-moi de conclure mon propos par une proposition, madame la secrétaire d’État : prendre en compte l’engagement associatif dans le calcul de la retraite. Dans notre système de retraite universelle, ce serait une reconnaissance par la Nation d’un don de temps et d’énergie au service de la collectivité fait plus tôt dans sa vie.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Lucien Stanzione, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, le tissu associatif qui maille notre territoire et l’ensemble des associations qui le composent sont au cœur des enjeux pour notre pays. Mobilisant des millions de personnes, les associations font partie du quotidien de nos concitoyens et répondent à leurs besoins sociaux, notamment en entretenant un lien social, d’autant plus important dans les périodes difficiles que nous traversons.
Les associations font face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. Le rapport de la commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif en faisait déjà le constat en 2014. L’année 2020 a toutefois été particulièrement ardue pour nombre d’entre elles. Le Mouvement associatif a ainsi indiqué que 66 % des associations avaient dû suspendre leurs activités ou revoir leur mode de fonctionnement au printemps 2020 et que près de 30 000 risquaient le dépôt de bilan dès l’automne.
Outre l’aspect financier, la crise sanitaire a également touché les associations sur le plan de l’emploi : 55 000 associations indiquaient, en septembre 2020, ne pas pouvoir maintenir leurs effectifs salariés en l’état. N’oublions pas que ces difficultés s’inscrivent dans un contexte déjà en peine, la baisse drastique des contrats aidés – 36 % en 2017 et 50 % en 2018 – ayant fortement affaibli le secteur.
La création des associations a connu une baisse de 40 % en 2020 et, dans les secteurs du sport, du loisir et de la culture, les adhésions sont en recul de 25 % à 40 %, sans parler du bénévolat des seniors, particulièrement vulnérables à la covid-19.
Tous ces chiffres représentent autant d’impacts sur le lien social de notre pays.
La vie en société place tout être humain, dès sa naissance, dans une relation d’interdépendance avec les autres, et la solidarité constitue, à tous les stades de la socialisation, le socle de la liaison de l’homme aux autres et à la société. Nos associations sont les instruments et les vecteurs de cette socialisation, en particulier de la solidarité nationale. S’associer correspond à s’unir, à faire participer, à former un ensemble, cet ensemble dont nous avons tellement besoin aujourd’hui.
La présente proposition de loi ne permet malheureusement que quelques avancées, relatives à l’atténuation de la responsabilité financière des cadres associatifs en cas de faute de gestion ou à l’éligibilité au service civique des ressortissants algériens ou encore permettant de relever de dix à vingt le plafond de salariés pour pouvoir bénéficier de l’offre de service « impact emploi ». Ces dispositions ont fait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat dès la première lecture.
Le travail réalisé en commission à l’occasion de la deuxième lecture permet également de voir émerger un consensus concernant les dispositifs de sensibilisation à l’engagement associatif dans le temps scolaire et relatifs aux comptes associatifs en déshérence. À ce propos, je tiens à saluer le travail de mon collègue Jacques-Bernard Magner, qui avait déposé un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 tendant à la remise d’un rapport pour étudier les possibilités d’affecter les montants des comptes inactifs des associations au Fonds pour le développement de la vie associative. Cette mesure a depuis été intégrée à la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, qui vient d’être examinée par notre assemblée.
Quelques réserves peuvent être émises.
On peut ainsi s’interroger sur la façon dont la question de l’engagement associatif sera traitée dans les faits, notamment au vu de l’inflation des programmes scolaires. Cela soulève également une interrogation quant à la pertinence, pour le Parlement, de légiférer sur le contenu des programmes quand existe un organisme, le Conseil supérieur des programmes, dont la mission principale consiste justement à élaborer les programmes.
Une autre réserve concerne la suppression, à l’Assemblée nationale, de la possibilité de dérogation à la limitation du nombre de stagiaires dans les structures associatives. Si cette disposition est protectrice pour l’emploi, en ce qu’elle limite le recours aux stages précaires et mal rémunérés, on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette suppression, notamment dans le contexte de difficultés actuelles du secteur, dont j’ai parlé précédemment, et ce pour une durée limitée, le temps de sortir de la crise sanitaire.
Pour autant, on ne peut que se féliciter des petites avancées que ce texte permet. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain l’a d’ailleurs toujours soutenu et le soutiendra encore aujourd’hui. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous devons nous prononcer ce matin sur une proposition de loi en faveur de l’engagement associatif. Quel important sujet !
Nous vivons dans une société qui a une tendance naturelle au repli sur soi et dans laquelle l’individualisme est un comportement de plus en plus partagé. Les interactions avec les autres de nos concitoyens se développent au travers du filtre des écrans et des réseaux dits « sociaux ». Ces relations numériques favorisent bien souvent une forme d’agressivité individuelle et permettent à tout un chacun de se bercer de l’illusion qu’il n’a pas besoin de collectif pour s’exprimer ou pour faire.
Nous vivons dans une société où la violence et même l’hyperviolence se développent à une vitesse inimaginable. Cette violence prend de court notre entendement, mais aussi nos autorités, incapables de réactions adaptées. L’issue vers laquelle ce glissement violent de notre société nous entraîne semble tellement irréelle qu’il est plus facile de la nier que d’essayer de l’éviter ou de se préparer à y faire face.
Nous vivons dans une société où les inégalités sociales et économiques se creusent. Les divisions entre les gagnants de la mondialisation, de l’ubérisation ou de la nouvelle économie et ceux qui s’en estiment les victimes ou qui en paient réellement les conséquences n’ont jamais été aussi grandes.
Nous vivons dans une société dans laquelle de nouvelles fractures territoriales apparaissent : entre le monde urbain et le monde rural, entre les villes et leurs périphéries… Tout le monde se sent oublié. En réalité, beaucoup vivent leur situation comme le résultat d’un mauvais traitement, d’une politique qui sépare les territoires et voudrait leur imposer des modes de vie différents des leurs. Bref, ils se sentent injustement considérés.
Nous vivons dans une société qui ne distingue bientôt plus les valeurs des principes, qui ne considère plus l’autorité et n’a que trop peu recours au respect de l’autre, qui pose les croyances individuelles au-dessus des règles de la vie collective.
Derrière ce diagnostic, pessimiste – je vous l’accorde, mes chers collègues – et pas assez nuancé – je vous l’accorde également –, il existe tout de même des points positifs auxquels se raccrocher, des comportements à encourager, des valeurs humaines et humanistes, qui laissent à penser que la seule solution n’est pas le déclin si nous savons nous appuyer sur ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous. Le fait est que l’engagement pour l’intérêt général et l’altruisme sont encore des notions vivantes, qu’il convient de soutenir et de développer. L’avenir de notre monde – ce que certains appellent « le monde d’après » – dépendra pour beaucoup de la générosité dont nous saurons faire preuve dans le monde actuel et face à ses réalités.
La vie associative est l’une des principales richesses de notre pays. On estime à 13 millions le nombre de bénévoles présents dans au moins une des quelque 1, 3 million d’associations aujourd’hui actives en France. Chaque année, 70 000 associations sont créées, et le nombre de bénévoles était en augmentation ces dernières années. Ces quelques éléments éclairent d’un espoir nouveau le tableau de notre société que j’ai dressé de manière un peu sombre.
Pourtant, depuis un an, une partie de ce monde associatif est pratiquement à l’arrêt. La crise sanitaire que nous traversons a révélé à la fois un aspect peu glorieux de notre humanité, mais aussi une capacité à la solidarité, à l’innovation sociale et à la bienveillance sans précédent. Il est de notre devoir d’élus et de citoyens d’encourager ces comportements civiques et solidaires, qui se retrouvent le plus souvent sous la forme d’un engagement associatif.
Retrouver, à la prochaine rentrée, un niveau d’engagement bénévole au moins équivalent à ce qu’il était avant la crise, faire retrouver le chemin des clubs aux jeunes licenciés du monde sportif ou culturel : voilà des enjeux majeurs. Il est à notre portée d’y répondre.
S’appuyer sur les expériences et les nouvelles solidarités qui se sont également exprimées durant cette période, pour construire un monde meilleur et tourné vers les autres, est un autre des enjeux auxquels nous nous devons de répondre.
Cette proposition de loi a pour objectif de faciliter et d’encourager l’exercice de fonctions associatives, en atténuant la responsabilité financière des dirigeants associatifs bénévoles en cas de faute de gestion, en sensibilisant les élèves de l’enseignement secondaire à la vie associative ou en relevant de dix à vingt le seuil à partir duquel une association peut bénéficier du dispositif « impact emploi ». Ce programme semble bien maigre par rapport aux enjeux de la vie associative, mais toute avancée doit être prise en considération.
L’engagement désintéressé de millions de bénévoles contribue à donner du sens à notre vie collective. Donner de son temps, de son expérience ou de ses compétences au profit d’une cause, qu’elle soit sociale, caritative, sportive, culturelle ou civique, c’est faire don aux autres d’une partie de soi, et c’est justement cela « faire société ».
Il est aisé de réunir un consensus autour de ces valeurs d’engagement, pour favoriser le bénévolat ou le volontariat, pour reconnaître l’engagement associatif ou bénévole, au sein des sapeurs-pompiers par exemple, bien que la proposition de loi n’aborde pas les engagements de ce type, qui auraient probablement eux aussi mérité que l’on s’y attarde. Nous partageons donc la motivation et les intentions de ce texte, tout en regrettant l’extrême modestie de son contenu. Même s’il est raisonnable de penser que la situation de l’engagement associatif ne sera guère différente après son adoption, l’intention est bonne : toute avancée, aussi minime soit-elle, mérite d’être engrangée ; tout signe de reconnaissance envers l’engagement associatif, aussi minime soit-il, mérite d’être considéré. C’est si peu, mais c’est déjà quelque chose !
Pour ces raisons, malgré quelques réserves et les regrets que le texte lui a inspirés à l’issue de la première navette parlementaire, notre groupe votera cette proposition de loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise sanitaire fait vaciller le monde associatif. La plupart des associations culturelles et sportives ont été contraintes de fermer leurs portes et de suspendre leurs activités durant les confinements successifs. Des milliers d’entre elles risquent une cessation d’activité, car leur fonctionnement repose souvent sur l’obtention de subventions, sur la perception de cotisations, sur le bénévolat et sur l’organisation de manifestations. Tout leur modèle économique est mis à mal. La dernière enquête réalisée par Recherches et solidarités indique que la plupart des associations ont dû revoir leur fonctionnement, notamment à travers la mise en place d’outils numériques, pour développer le « télébénévolat ».
Pourtant, la crise sanitaire et l’isolement contraint de beaucoup de nos concitoyens ont démontré la pertinence des actions du secteur associatif pour animer la vie locale et favoriser le lien social. Dans nos villes et nos villages, une association locale est souvent le dernier rempart contre la solitude et la première école de la démocratie.
Cette proposition de loi, déposée par Sylvain Waserman, a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Je souhaite remercier l’auteur de cette initiative, dans laquelle je retrouve l’esprit de certaines propositions du rapport intitulé Des associations, en général … Vers une éthique sociétale, que Jean-Pierre Raffarin m’avait commandé et que je lui avais remis en mai 2005.
Ce rapport préconisait, entre autres dispositifs, de renforcer l’accès à la formation des dirigeants associatifs et la sensibilisation du public au bénévolat. Plus de quinze ans après sa publication et l’extension du chèque emploi associatif, nous restons dans l’expectative d’une réforme globale du secteur associatif, afin de favoriser son développement au service de la société.
Le texte que nous examinons en deuxième lecture contient des mesures visant à encourager la prise de responsabilité associative et l’engagement de la jeunesse. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient cette initiative.
Le réseau associatif français compte près de 13 millions de bénévoles et 1, 8 million de salariés, dont l’action est organisée par les dirigeants d’association. Ces derniers manquent trop souvent d’accompagnement technique et de connaissances en matière de gestion comptable et administrative. L’article 1er de la proposition de loi, en étendant l’exception de négligence applicable aux dirigeants d’entreprise en cas de faute de gestion conduisant à une insuffisance d’actifs aux dirigeants d’association, permettra de rendre plus attractif l’exercice de responsabilités à titre bénévole.
J’ai soutenu les propositions de Michel Savin visant à valoriser l’engagement associatif des salariés à travers la compensation par l’employeur d’une journée de bénévolat par an ainsi que le dispositif tendant à créer un crédit d’impôt pour responsabilité associative. Je regrette que ces dispositions ne soient plus présentes dans le texte que nous examinons, bien que je comprenne les motifs de leur retrait.
L’article 2 porte sur la sensibilisation des jeunes au bénévolat, du CM2 au lycée. Je pense que nous devons aller plus loin et étendre les mesures de reconnaissance de l’engagement associatif des étudiants aux lycéens.
Enfin, l’article 3 ouvre à bon escient l’accès au service civique aux ressortissants algériens résidant en France.
Cette proposition de loi, aux contours modestes, apportera de nouvelles garanties afin de favoriser le renouvellement des dirigeants bénévoles et l’engagement de la jeunesse. Pour aller plus loin, il nous faudrait améliorer la lisibilité fiscale des dispositions applicables aux associations, dont la complexité est souvent un obstacle à leur appropriation.
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière », disait l’abbé Pierre. Le monde associatif est ce sourire adressé à la société, loin de toutes considérations mercantiles, un lieu particulier dans lequel s’exerce la première de nos libertés : celle d’agir pour aider son prochain et s’inscrire dans une aventure humaine.
À l’heure de la montée des tensions communautaires, l’engagement est un art de vivre. C’est l’« arche d’alliance » décrite par Albert Camus, dont la tâche consiste à éviter que « le monde ne se défasse ».

La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le parcours parlementaire de cette proposition de loi a démarré voilà maintenant trois ans. Avec cette deuxième lecture, le voici désormais quasiment parvenu à son terme.
Le secteur associatif attend que cette proposition de loi aboutisse rapidement, et, après les mois extrêmement durs que nous venons de traverser, nous espérons son entrée en vigueur le plus tôt possible. En effet, comme la proposition de loi visant à améliorer leur trésorerie, que nous venons de voter, ce texte comporte des avancées très attendues par les associations.
Tout d’abord, l’élargissement de l’exception de négligence aux dirigeants associatifs est de nature à rassurer les bénévoles qui s’engagent dans la gestion quotidienne d’une structure. Cela favorisera la prise de responsabilités, parfois lourdes, qu’impliquent les fonctions de président ou de trésorier, quand plus de la moitié des associations indiquent qu’elles ont du mal à renouveler leurs instances dirigeantes – vous en avez parlé, madame la secrétaire d’État.
Ensuite, l’extension du dispositif « impact emploi » à toutes les associations de moins de vingt salariés, contre dix actuellement, facilitera les démarches administratives en matière sociale et fiscale pour les petites structures. Rappelons que l’ensemble du secteur associatif représente 1, 8 million d’emplois en France.
Enfin, l’article 1er bis permettra d’allouer les avoirs des comptes inactifs des associations au FDVA. Ce soutien financier pour accompagner la formation des bénévoles est essentiel.
Au cours de son examen en commission, nous avons pu constater que les mesures de ce texte faisaient l’unanimité sur toutes les travées. Nous nous en réjouissons, et c’est logiquement que le groupe écologiste votera en sa faveur.
Pour autant, l’avenir est loin d’être rose pour les associations. Bien au contraire, il s’assombrit.
La pandémie a tout d’abord mis de nombreuses associations culturelles et sportives totalement à l’arrêt. Alors que les contraintes se desserrent tout juste depuis hier, une question se pose : comment faire revenir les adhérents, éloignés depuis parfois un an ? Comment faire revivre les clubs de foot, de chant, de danse ?
Ajoutons à cela l’inquiétude au sujet des subventions. Si, en 2020, les collectivités ont été au rendez-vous pour maintenir leur soutien aux associations – il faut le saluer –, les premières remontées pour 2021 sont inquiétantes : les associations craignent parfois de faire office de variable d’ajustement face à la pression qui pèse sur les budgets locaux.
Surtout, un coup terrible et cynique a été porté dans cet hémicycle voilà quelques semaines. Ici même, lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, la majorité sénatoriale et le Gouvernement ont, main dans la main, durci les règles pour les associations et installé une mécanique administrative qui fait peser sur tout le secteur et ses millions de bénévoles une forme de suspicion généralisée : contrat d’engagement républicain obligatoire pour toucher une subvention, contrat d’engagement républicain obligatoire pour recevoir un agrément, contrat d’engagement républicain obligatoire ne serait-ce que pour avoir une salle à disposition !
Des millions de bénévoles sont désormais suspects. Ce sont 1, 3 million d’associations que vous avez regardées globalement comme des niches de l’islamisme radical. Ces associations font pourtant vivre tous les jours la promesse républicaine dans notre pays ! Certaines assurent le travail de lien social dans les quartiers où l’État a fait reculer les services publics.
Les mesures proposées dans le texte que nous examinons aujourd’hui sont nécessaires, mais on ne peut pas, d’un côté, louer le rôle primordial et la place des associations dans notre République et, de l’autre, instaurer un carcan qui fait peser une incertitude permanente sur les associations et leurs bénévoles. Le mois dernier, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Mouvement associatif ainsi que des ONG demandaient l’abandon du contrat d’engagement républicain, véritable menace sur la liberté d’association. Aujourd’hui, vous ignorez ces alertes.
Mes chers collègues, le monde associatif est un acteur essentiel de notre société, y compris quand, par certaines de leurs méthodes d’engagement, certaines associations nous bousculent, nous alertent, remettent en cause nos certitudes et font avancer la société. Ne les affaiblissons pas. Gardons ce dynamisme associatif qui fait notre grandeur et notre richesse démocratique.
J’espère retrouver la même unanimité, lors de la nouvelle lecture du projet de loi Séparatisme, pour refuser le contrat d’engagement républicain et tant d’autres artifices qui vont corseter le monde associatif.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, faciliter le fonctionnement de nos associations, de même que leur développement, en agissant sur le plan de la trésorerie, tel était l’objectif du texte que nous venons d’examiner. Il est désormais adopté.
Faciliter l’engagement associatif, tel est l’objet de la présente proposition de loi, examinée elle aussi selon la procédure de législation en commission. Là encore, l’issue devrait être positive. Tant mieux !
De quoi parlons-nous ? De l’essentiel. Nous nous adressons, depuis le début de la matinée, à plus de 1, 3 million de structures, à un Français sur quatre qui est engagé bénévolement, à près de 2 millions de salariés. Nous parlons de plus de 22 milliards d’actifs et d’un budget annuel de 170 milliards d’euros.
Ce tissu associatif remarquable a été soumis, ces derniers mois, à rude épreuve. Il a été en première ligne et mobilisé à chaque instant – je pense aux entités sociales ou sanitaires. Il a aussi été mis à l’arrêt, parfois du jour au lendemain, comme, nous le savons, dans les domaines culturels et touristiques. Je pense notamment aux centres de séjours scolaires, aux auberges de jeunesse, aux théâtres…
Finalement, plus d’une association sur deux a perdu des revenus, et probablement des bénévoles, depuis le début de la crise. Deux impératifs s’imposent par conséquent aux responsables politiques que nous sommes : répondre présent et simplifier la continuité ou la reprise des activités ; soutenir l’engagement, et ce dès le plus jeune âge.
Les députés auteurs du texte – je pense notamment à M. Erwan Balanant, mon collègue finistérien – ont rappelé à juste titre, lors de son dépôt en 2018, que les associations répondent pleinement « aux besoins sociaux et sociétaux » et participent au maintien des liens entre les personnes. Je le disais, nous parlons de l’essentiel.
Cette proposition de loi, comme la précédente, fait écho à plusieurs objectifs défendus dans un rapport remis par le Mouvement associatif au Premier ministre, toujours en 2018. Ce rapport préconisait une soixantaine de mesures pour développer une stratégie globale pour la vie associative. Le président du Mouvement associatif avait alors déclaré : « Il est temps que nous ayons en France une politique publique digne de ce nom, ambitieuse et moderne, pour soutenir la création, la vitalité et la croissance de la vie associative. » Il ajoutait : « Il y a un enjeu crucial à retrouver de la cohésion sociale, d’une part, et à investir dans les transitions vers une économie plus juste et plus soutenable, d’autre part. »
Il faut encore ajouter à cela la fragilisation occasionnée par la crise sanitaire. C’est pourquoi nous saluons la position de la commission de permettre une adoption rapide du texte pour soutenir le monde associatif fortement malmené.
En première lecture, la Haute Assemblée a intégré plusieurs dispositions qui ont été votées conformes par l’Assemblée nationale ou qui ont fait l’objet de simples modifications rédactionnelles. Ce dispositif vise, finalement, un seul objectif : encourager la prise de responsabilité associative et tenir compte de la réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes.
Les auteurs de cette proposition de loi ont également souhaité valoriser le bénévolat en inscrivant la sensibilisation à la vie associative dans le cadre de l’enseignement moral et civique des élèves du secondaire, au même titre que le service civique.
Madame la secrétaire d’État, ces mesures viennent en complément du texte discuté à l’instant, que vous aviez déposé, en tant que députée, à la suite des annonces faites à destination du monde associatif.
Favoriser le bénévolat, l’engagement, c’est préserver la richesse du tissu associatif français. C’est aussi maintenir ou créer des activités, des services de la vie dans nos territoires ruraux. Je veux profiter de mon temps de parole pour rendre hommage aux bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur savoir et qui vont parfois jusqu’à mettre leur vie en danger pour les autres – je pense aux bénévoles du sauvetage et, en tant que Finistérienne, plus particulièrement à ceux de la SNSM.
Ne laisser aucune association de côté pour qu’aucune personne qui les sollicite ne soit à son tour laissée de côté, tel est l’objectif noble qui nous rassemble ce matin.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à quelques jours des cent vingt ans de la fameuse loi fondatrice du droit à la liberté d’association, c’est un honneur pour un radical de porter la voix du groupe du RDSE. Cette loi consacre encore aujourd’hui le tissu associatif français, animé par plus de 13 millions de bénévoles. C’est une richesse exceptionnelle, qui a encore prouvé sa force, sa vitalité et son utilité au cours de la crise sanitaire et économique que nous traversons.
Le monde associatif est au cœur du quotidien de nos concitoyens, qu’ils soient bénévoles ou bénéficiaires. Il a démontré son rôle d’amortisseur social. Nous savons tous ici combien ces 1, 3 million de structures contribuent à l’équilibre de nos territoires, en œuvrant largement à leur attractivité. Le besoin d’engagement que nous voyons chaque jour en est la preuve vivante.
Bien souvent, les associations jouent un rôle de cohésion ou d’assistance sociale, de médiation ou de production culturelle, ou encore de veille pour la protection de l’environnement. Ces missions primordiales doivent pouvoir se déployer le plus librement possible. Tous les bénévoles qui se dévouent généreusement méritent bien notre respect. Pourtant, les associations ont souffert de la réduction du nombre d’emplois aidés, de la diminution des dotations aux collectivités ou encore de plusieurs réformes fiscales, qui ont affecté le niveau des dons.
La conjoncture difficile dans laquelle évolue aujourd’hui le monde associatif doit retenir toute notre attention. Cela apparaît même crucial au regard de son utilité sociale et économique. Les pouvoirs publics doivent donc agir de façon à valoriser et à encourager le dévouement d’une grande partie de la société civile. Le Gouvernement et les collectivités territoriales l’ont bien compris cette année en apportant le soutien nécessaire à la survie d’un grand nombre d’associations. Il faut aussi souligner la générosité accrue de nos concitoyens.
La portée de cette proposition de loi est certes modeste, mais elle apporte une aide non négligeable à l’essor de la vie associative.
Parmi les obstacles rencontrés figure notamment la trop lourde responsabilité financière des dirigeants des associations en cas de faute de gestion. Les auteurs de ce texte y ont répondu à l’article 1er. Cette insécurité juridique est source de préoccupations dans le milieu associatif et freine le renouvellement des instances dirigeantes. Je ne parle pas de la nécessaire vigilance à apporter aux activités lucratives qui, sous couvert d’associations de circonstances, ne rémunèrent que le seul promoteur ou les proches du responsable d’association.
L’article 2 permet la mise en place d’un module théorique et d’un support méthodologique destinés à aider les enseignants dans la présentation de la vie associative. Il est crucial de mieux sensibiliser les élèves de collège et de lycée dans le cadre de l’enseignement moral et civique et, ainsi, de les inciter à s’engager afin de former le vivier du milieu associatif et de citoyens de demain.
C’est l’occasion également de relever l’esprit de coopération qui a animé nos deux assemblées parlementaires pour la construction de ce texte. Ainsi, le Sénat a relevé à vingt le nombre de salariés permettant à une association de bénéficier de l’offre de service « impact emploi » de l’Urssaf, qui assouplit les formalités de gestion salariale. Cette disposition, reprise à l’Assemblée nationale, va dans le bon sens en faveur d’un accompagnement plus fort de la part de l’administration.
Pour toutes ces raisons, nous nous associons pleinement aux propositions contenues dans ce texte. Cependant, il faut aller au-delà, car, sans le soutien de l’État et des collectivités territoriales, le secteur non lucratif, auquel sont confiées de plus en plus de missions de service public, ne peut agir de manière efficace. Pour donner un nouveau souffle au bénévolat et au tissu associatif, peut-être serait-il temps de mieux les accompagner en supprimant les trop nombreux formulaires bureaucratiques et en valorisant davantage le service civique ?
Ce texte nous permet d’envoyer un signal fort aux associations et de reconnaître qu’elles constituent un vecteur essentiel de l’engagement citoyen et un moyen d’action à la portée de tous au sein de la société civile. Et puis, n’oublions pas que la vie associative permet aussi aux retraités de continuer à être des citoyens « actifs ». Leur disponibilité et leurs compétences sont une richesse. Nous savons aussi mesurer les bienfaits de leur épanouissement au sein des associations sur la qualité de leur vieillissement et, par conséquent, sur les économies à en attendre en termes de dépenses de santé.
« C’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à personne », disait Descartes. L’engagement associatif en est une belle illustration.

La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d’un processus législatif long de trois ans. Il serait souhaitable que la commission mixte paritaire soit conclusive, car le mouvement associatif attend les mesures dont nous débattons aujourd’hui.
Ce texte permettra notamment d’atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs en cas de faute de gestion en leur étendant l’exception de négligence. Ce dispositif existe déjà pour les dirigeants d’entreprise ; on comprendrait mal que les dirigeants associatifs, bénévoles pour l’essentiel, n’en bénéficient pas également.
L’application de ce principe de négligence et la prise en compte, en cas de condamnation, des conditions matérielles de soutien administratif constituent de véritables avancées. Souhaitons que cette protection permette à davantage de bénévoles de prendre des responsabilités, car, chacun le sait, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui acceptent de siéger au bureau des associations ou de les présider.
L’élargissement des conditions pour prétendre au dispositif « impact emploi » de l’Urssaf est aussi une avancée. Établir les formalités administratives d’embauche ou des fiches de salaire demande des compétences particulières. Même si l’on peut saluer la montée en compétence des militants associatifs, leur offrir de tels services nous semble tout à fait utile.
Je salue également l’ouverture du service civique aux jeunes ressortissants algériens. Ce dispositif fait partie de ceux qui peuvent participer à la construction de la citoyenneté.
Chacun voit bien également l’intérêt de donner aux jeunes une meilleure connaissance du rôle des associations et du tissu associatif local afin de les éveiller à l’engagement et, à terme, souhaitons-le, d’apporter du sang neuf aux diverses associations. Attention cependant à ne pas surcharger le programme de l’enseignement moral et civique, qui ne bénéficie, je vous le rappelle, que d’une demi-heure hebdomadaire.
En revanche, il est regrettable que la disposition permettant de rémunérer le congé associatif, adoptée en première lecture au Sénat, ait été supprimée au cours de la navette. Il faut relativiser la charge que cela représenterait pour les entreprises : il ne s’agit que d’une journée par an et par bénévole. Cette rémunération permettrait sans doute à davantage de salariés de devenir responsables associatifs.
On le sait bien, prendre la direction d’une association implique différentes missions – rencontres, échanges, actes de gestion… – qui ont souvent lieu lors des horaires de travail. Ce n’est pas sans raison que nombre de nos associations sont dirigées et animées par des retraités. Ils y ont évidemment toute leur place, mais favoriser l’implication des actifs amènerait, là encore, du sang neuf.
Le congé associatif existe bien, mais il est aujourd’hui synonyme de perte de revenu pour des salariés, ce qui en limite l’utilisation par la plupart des responsables associatifs.
Cette proposition de loi ne suffira malheureusement pas à résoudre la crise de l’engagement, qu’on ne peut mettre sur le seul compte du développement de l’individualisme et du repli sur soi que les confinements successifs auront sans doute amplifié. La précarisation croissante, le développement de formes brèves de travail, la multiplication des horaires décalés, les temps de transports allongés laissent peu de place à l’engagement citoyen, quel qu’il soit.
Si vous me permettez une petite digression, je dirai que le peu de considération à l’égard des corps intermédiaires, un mode de gouvernance de plus en plus solitaire au plus haut niveau du pouvoir, le dos tourné aux propositions citoyennes pourtant sollicitées, les entorses de plus en plus fréquentes à nos libertés fondamentales ne contribuent pas à donner goût à l’engagement – au contraire !

Pourtant, dans ce contexte peu réjouissant, la crise semble avoir accéléré l’engagement des jeunes, avec un fort besoin de se sentir utile et, quelque part, de trouver sa place dans la société. Maintenant, il faut transformer l’essai.
La crise sanitaire a aussi accentué la crise des associations : alors que, depuis vingt ans, 70 000 associations étaient créées en moyenne chaque année, on annonce une baisse de 40 % en 2020. Les adhésions sont également en nette diminution selon les secteurs, avec toutes les conséquences que cela implique, y compris financières, pour les associations.
Dans ces circonstances, les apports de ce texte sont à saluer. Nous voterons cette proposition de loi, tout en continuant à travailler, avec tous ceux qui le souhaitent – je sais qu’ils sont nombreux ici –, sur le statut de bénévole, qui doit être mieux reconnu et valorisé, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je commencerai mon propos en saluant cette proposition de loi et son auteur, Sylvain Waserman, présent en tribune. Ce texte permet de poser et d’examiner des mesures concrètes au bénéfice du monde associatif, largement malmené, qui connaît aujourd’hui une réelle carence d’engagement. Je remercie également notre rapporteur, Pierre-Antoine Levi, de son excellent travail.
Pour la commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée, en 2014, d’étudier les difficultés du monde associatif, le renouvellement des dirigeants bénévoles est la première difficulté recensée par les associations : 53 % d’entre elles indiquent avoir du mal à renouveler leurs instances dirigeantes. Rappelons que les ressorts principaux de l’engagement sont avant tout la volonté d’être utile à autrui et à la société, de lutter contre les injustices. Les valeurs essentielles en sont la fraternité et la solidarité. Mais les bénévoles d’aujourd’hui, sur qui repose largement le fonctionnement des associations, souhaitent aussi que leur engagement leur apporte un épanouissement personnel et qu’il donne un sens à leur vie.
Pour ces raisons, le mode de fonctionnement des associations et l’appétence à s’engager se devaient d’être interrogés.
En ce qu’elles jouent un large rôle de vecteurs de lien social, synonymes de cohésion territoriale et sociétale, il était important que les associations, qui pallient aussi parfois les manquements de l’État en jouant un rôle de service public, et le monde associatif en général soient l’objet du texte qui nous préoccupe aujourd’hui afin de corriger ce biais carentiel d’engagement.
Nous le savons, le fonctionnement des associations repose largement sur le bénévolat, qui en est la véritable « matière première », gage de leur pérennisation. L’un des maillons essentiels en est d’ailleurs le dirigeant bénévole, qui, outre un engagement sans faille en termes de disponibilité, doit notamment disposer de compétences solides en matière fiscale et juridique, eu égard aux responsabilités dont il est débiteur. Il était donc primordial de lutter contre une insécurité juridique délétère et de lui offrir un cadre stable en atténuant sa responsabilité financière en cas de faute de gestion due à de simples négligences.
Je salue l’abondement du FDVA, qui va dans le bon sens. Je rappelle que le Haut Conseil à la vie associative estime à 100 millions d’euros les sommes qui pourraient ainsi être mobilisées.
Par ailleurs, et de manière plus large, cette proposition de loi vise à favoriser l’engagement associatif auprès des plus jeunes en permettant la mise en place d’un module théorique et d’un support méthodologique pour aider les enseignants dans la présentation de la vie associative et aider ainsi les élèves de collège et de lycée à s’engager et à développer une fibre d’engagement citoyen. En effet, c’est bien d’éveil dont il est question : il faut que nos jeunes aient une réelle connaissance et soient largement sensibilisés à ce type d’organisation, en leur permettant de s’engager pour une cause et de faire vivre une passion.
Malgré les engagements positifs de cette proposition de loi, la fatalité de l’existant est réelle et de nombreux points restent en suspens et doivent nous interroger en termes de viabilité, d’efficacité et de pérennisation de la vie associative.
Le secteur associatif a été rudement éprouvé par les mesures prises depuis le début du quinquennat avec le retrait des contrats aidés, la diminution des moyens publics, l’impact sur la générosité de la suppression de l’ISF et les conséquences de la crise sanitaire. À cela s’ajoutent, de façon plus structurelle, des complexités et tracasseries administratives associées à une valorisation timorée de l’engagement associatif.
Tous ces aspects continueront de peser négativement sur l’engagement associatif et de grever les actions mêmes des associations. Or il faut justement répondre aux besoins spécifiques de toutes les associations : celles qui emploient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de salariés, mais aussi les plus petites, qui jouent souvent un rôle décisif dans la vie économique et sociale au niveau local. Lors de l’examen de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de budget pour 2021, j’ai largement pointé le manque, à la fois, de signal positif et d’une ligne politique claire de la part du Gouvernement en direction du milieu associatif.
Il est d’une impérieuse nécessité de développer une reconnaissance de l’engagement associatif au-delà de ce qu’il est aujourd’hui possible de faire et qui, je le précise, est très largement méconnu. À ce titre, je regrette la suppression, en deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, de deux ajouts du Sénat, à savoir l’allégement des contraintes des associations quant au nombre de stagiaires qu’elles peuvent accueillir et la reconnaissance du caractère d’intérêt général des associations par le préfet.
Malgré cela, et dans un souci de pérenniser rapidement les avancées qu’offre cette proposition de loi, le groupe Union Centriste, au nom duquel j’interviens aujourd’hui, votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi en faveur de l’engagement associatif.
La proposition de loi est adoptée.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux un bref instant.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix-neuf, est reprise à douze heures vingt et une.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (projet n° 523, texte de la commission n° 558 rectifié, rapport n° 557) et du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (projet n° 522, texte de la commission n° 559, rapport n° 557).
La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.
Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, soumis à votre examen aujourd’hui, poursuit trois objectifs clairs : la protection des œuvres et des retransmissions sportives, à travers le renforcement de la lutte contre le piratage ; la modernisation de la régulation des contenus ; la préservation de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Il s’inscrit dans une démarche globale de réforme du secteur audiovisuel, lancée par le Président de la République depuis 2017.
Vous le savez, cette réforme devait initialement prendre forme à travers le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, porté par mon prédécesseur Franck Riester et présenté en conseil des ministres en décembre 2019. La crise sanitaire et le bouleversement du calendrier parlementaire n’ont pas permis de poursuivre le processus législatif de ce texte. Je sais qu’il est très attendu par le Sénat, qui compte beaucoup d’experts des enjeux audiovisuels.
Malgré la suspension de l’examen de ce texte, l’ambition du Gouvernement est restée intacte.
Tout d’abord, grâce à la promulgation de la loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne, dite « Ddadue », le Gouvernement est habilité à transposer plusieurs directives européennes importantes par voie d’ordonnances. Très attendues par les professionnels, les ordonnances permettent d’accélérer leur mise en œuvre.
L’ordonnance relative aux services de médias audiovisuels a été promulguée le 21 décembre dernier. Son décret d’application, dit « décret SMAD », sera publié très prochainement. Conformément à l’engagement du Président de la République, les plateformes étrangères qui ciblent notre territoire contribueront au financement de la création cinématographique et audiovisuelle française dès 2021.
Les ordonnances permettant de transposer la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et la directive dite « Câble et satellite » sont en cours. J’ai ainsi présenté en conseil des ministres, la semaine dernière, une première ordonnance permettant de transposer les articles 17 à 23 de la directive Droit d’auteur. Deux autres suivront très prochainement.
Ensuite, la transformation de l’audiovisuel public, si elle ne se fait plus par voie législative, se poursuit : les objectifs de renforcement des coopérations entre les différentes entreprises ont été confirmés dans les contrats d’objectifs et de moyens de ces sociétés, que j’ai signés voilà quelques semaines.
Enfin, il restait un certain nombre de dispositions urgentes et consensuelles qui nécessitaient un véhicule législatif. Or, vous le savez, ce n’était pas gagné d’avance : dans un calendrier parlementaire particulièrement encombré, j’ai réussi à obtenir le temps nécessaire pour présenter ce projet de loi devant le Parlement – nous y sommes ! Il s’agit donc du projet de loi, resserré et recentré, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Trois enjeux forts structurent ce texte.
Le premier est le renforcement de la lutte contre le piratage. Ces dispositions trouvent une acuité renforcée en raison des pratiques culturelles actuelles, mais aussi dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. L’offre numérique culturelle a été fortement sollicitée pendant cette période, confirmant la tendance qui se dégage depuis une dizaine d’années. Mais cette forte augmentation de la consommation de biens culturels dématérialisés s’est accompagnée d’une hausse des pratiques illicites, ce qui justifie d’autant plus les dispositions prévues par ce projet de loi.
La lutte contre le piratage se voit renforcée par plusieurs dispositions qui ciblent, non pas les internautes, mais les sites internet qui tirent un profit commercial de la mise en ligne d’œuvres, en violation des droits des créateurs. Le projet de loi prévoit ainsi que soit dressée une « liste noire » des sites internet dont le modèle économique repose sur l’exploitation massive de la contrefaçon. Il permet également de lutter plus efficacement contre les « sites miroirs », c’est-à-dire ceux qui reprennent en totalité ou de manière substantielle les contenus d’un site jugé illicite. C’est la philosophie de ce texte.
Parallèlement, le Gouvernement et les ayants droit s’attachent à tirer le meilleur parti des outils juridiques existants, notamment de « l’action en cessation », qui permet de faire bloquer ou déréférencer, par les fournisseurs d’accès ou les moteurs de recherche, les sites pirates. Cette collaboration est particulièrement fluide avec les moteurs de recherche. Elle l’est moins avec les fournisseurs d’accès, ce qui est à la fois regrettable et paradoxal de la part d’opérateurs nationaux, mais j’ai bon espoir qu’elle progresse rapidement.
Vous comprendrez donc l’opposition du Gouvernement à l’introduction d’un dispositif de transaction pénale. Je ne doute pas que nous aurons l’occasion d’en débattre longuement, mais je veux appeler à la prudence sur ce sujet. Outre le fait que le succès de cette transaction n’est pas garanti, le niveau de sensibilité du grand public sur la question de la répression des pratiques des internautes reste élevé, et ce dispositif toucherait surtout notre jeunesse, qui connaît déjà de grandes difficultés en raison de la crise sanitaire.
Le projet de loi prévoit également un dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage sportif : il exige la mise en place de mesures adaptées, qui tiennent particulièrement compte de l’urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives. C’est pourquoi le projet de loi instaure un mécanisme ad hoc de référé, susceptible de produire des effets dans la durée.
Le deuxième enjeu est de moderniser la régulation des contenus audiovisuels et numériques. Pour mener à bien ces nouvelles missions en matière de lutte contre le piratage, mais aussi pour mieux accommoder la convergence progressive de l’audiovisuel et du numérique, le texte fusionne la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et le Conseil supérieur de l’audiovisuel en une nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom.
Ce nouveau régulateur sera compétent sur l’ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques, qu’il s’agisse de lutter contre le piratage, de protéger les mineurs ou de défendre les publics contre la désinformation et la haine en ligne. Il sera aussi mieux armé et plus efficace avec des missions élargies et des pouvoirs de contrôle et d’enquête étendus.
La composition de son collège doit également être adaptée. Vous le savez, le Gouvernement est très attaché à la présence de deux magistrats, non pas par idéologie, mais parce qu’elle est indispensable au bon fonctionnement de la future autorité. Ces magistrats seront notamment chargés de mettre en œuvre la réponse graduée, qui est une procédure prépénale, aujourd’hui confiée, d’ailleurs, à des magistrats.
Compte tenu de la sensibilité des atteintes à la vie privée et à la liberté de communication que peut impliquer la réponse graduée, cette présence paraît indispensable. Plus largement, le renforcement des missions du régulateur en matière de régulation des contenus en ligne, que ce soit en matière de fausses informations ou de contenus haineux, engagé par plusieurs textes nationaux et européens, justifie pleinement que le collège de l’Arcom puisse bénéficier de l’expertise de deux membres magistrats.
Les préoccupations que vous avez exprimées en commission sur le nombre de désignations par le Parlement sont également légitimes. En tant qu’ancienne parlementaire, je ne peux qu’y être sensible. Nous aurons un débat sur cette composition, mais je crois vraiment que nous pouvons converger sur cette question, et des amendements ont été déposés en ce sens par certains d’entre vous.
Enfin, le troisième enjeu auquel répond ce texte est la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.
Les catalogues de nos œuvres cinématographiques et audiovisuelles constituent notre patrimoine. Le public a aujourd’hui la garantie d’avoir accès aux œuvres françaises, car les producteurs, établis en France, qui les possèdent sont tenus à une obligation de « recherche d’exploitation suivie » : elle leur impose de conserver les supports des œuvres en bon état et de fournir leurs meilleurs efforts pour que l’œuvre puisse être exploitée et, donc, vue par le public, en France et à l’étranger.
Or il existe aujourd’hui le risque que de grandes sociétés de production ou simplement leurs catalogues soient rachetés par des entreprises éloignées de tout objectif culturel et non soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie, comme des fonds d’investissement, notamment étrangers. Ces acheteurs pourraient décider de retirer temporairement du marché certaines œuvres, pour en faire monter les prix, ou décider d’exploiter seulement les films les plus rentables d’un catalogue et laisser les autres en déshérence.
L’article 17 du projet de loi étend donc à toutes les personnes qui rachètent une ou plusieurs œuvres françaises l’obligation de recherche d’exploitation suivie, qui existe aujourd’hui uniquement pour les producteurs établis en France. Il prévoit également que tout projet de cession d’œuvre doit faire l’objet d’une notification préalable auprès des services du ministère de la culture, au moins six mois avant la date de l’opération envisagée. Ces six mois permettront de vérifier que l’acheteur présente bien toutes les garanties pour assurer la recherche d’exploitation suivie. Si ce n’est pas le cas, certaines obligations garantissant l’exploitation suivie des œuvres françaises de ces catalogues peuvent lui être imposées.
Cet article est vraiment important pour préserver notre souveraineté culturelle. Reste que j’ai entendu les craintes exprimées par certains producteurs. Le Gouvernement proposera donc d’apporter quelques précisions par voie d’amendement afin d’y répondre.
Ces trois chapitres sont donc étroitement liés entre eux. La lutte contre le piratage et la protection des catalogues participent d’un même objectif de défense de notre création culturelle. Elles visent à permettre au public d’accéder aux œuvres dans des conditions respectueuses des droits des créateurs. Or il faut un régulateur solide et puissant pour mettre en œuvre les nouveaux outils innovants et ambitieux de lutte contre le piratage. La création de l’Arcom marque la volonté, à la fois, de passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre les sites pirates et d’inscrire cette action dans une politique plus large de régulation des contenus en ligne.
Vous avez souhaité en commission élargir le périmètre du projet de loi à différents enjeux, comme la distribution des chaînes, les procédures d’autorisations d’émettre ou les seuils anti-concentration. Vous soulevez des questions légitimes, et je suis tout à fait prête à en débattre avec chacune et chacun d’entre vous durant les prochaines heures.
En revanche, et je vous l’ai indiqué très clairement lors de mon audition le 13 avril dernier, il est indispensable de rester sur un projet de loi cohérent et resserré. Cohérent autour des trois objectifs énumérés : la lutte contre le piratage, la modernisation de la régulation et la protection des œuvres culturelles. Resserré, avec un nombre d’articles limité pour permettre la poursuite du processus législatif et l’adoption définitive du projet de loi dans le temps parlementaire imparti. J’aurai donc systématiquement, au cours de nos débats, une attention particulière au respect du périmètre initial du texte.
Je souhaite également évoquer France 4 et la décision prise par le Président de la République de son maintien.
Je veux saluer l’engagement de l’ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, à ce sujet. Vous avez été nombreux à exprimer vos inquiétudes et votre soutien au maintien d’une chaîne jeunesse, qui a su se réinventer et faire la preuve de son utilité.
Ce maintien est avant tout une excellente nouvelle pour les plus jeunes téléspectateurs et leurs parents, puisqu’ils pourront continuer à regarder une chaîne de service public proposant des programmes dédiés aux enfants, sans publicité. C’est aussi une excellente nouvelle pour l’animation et la création françaises, qui continueront ainsi d’être exposées quotidiennement sur France 4.
En outre, la nouvelle offre de France 4, depuis le 3 mai dernier, combine une programmation jeunesse et éducative en journée et une programmation culturelle en soirée. Cette nouvelle offre en soirée permet de capitaliser sur le succès de la chaîne éphémère Culturebox, qui a su toucher son public en donnant à la scène française une exposition inédite. Cela permettra de continuer à exposer le spectacle vivant sous toutes ses formes le soir, pour donner envie au public d’aller à la rencontre de nos artistes et de toutes nos esthétiques sur scène.
Avant de conclure, je voudrais revenir sur le travail mené avec M. le rapporteur au cours des dernières semaines. Ce n’est pas une surprise, nous avons et nous aurons encore, probablement, à l’issue de ces débats, des désaccords. Malgré ces divergences, je crois pouvoir dire que nous avons eu un dialogue de qualité, avec nos équipes respectives, permettant des échanges réguliers, nourris et francs. Je ne peux que m’en réjouir.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce texte est très important. Il apporte des réponses concrètes à trois enjeux majeurs dans le domaine de la communication audiovisuelle : la protection des droits des auteurs, des artistes, des producteurs, des diffuseurs ou des fédérations sportives ; l’organisation de notre régulation, qui doit être rationalisée et modernisée ; enfin, la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, dans un contexte où la demande d’œuvres n’a jamais été aussi forte. Il rassemble des dispositions consensuelles et attendues par les professionnels. J’espère donc qu’il recevra un large soutien dans cet hémicycle.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’oserai dire que nous revenons de loin. Il y a une semaine, notre commission examinait un projet de loi au contenu, certes, utile, mais très modeste compte tenu des enjeux auxquels est confronté le secteur des médias. La semaine écoulée a vu le groupe TF1 annoncer sa fusion avec le groupe M6, le géant Amazon rendre public le rachat du studio MGM et Warner se rapprocher de Discovery.
Ces grandes manœuvres confirment l’accélération des changements dans un secteur où les Américains sont en train de préempter l’offre de plateformes, tandis que les Européens peinent à s’organiser, empêtrés qu’ils sont dans des réglementations hors d’âge. Si le millésime 1986 est probablement très appréciable pour certains breuvages élevés en fûts de chêne, il en est très différemment en matière d’audiovisuel. En effet, il est des lois très opportunes lors de leur adoption, mais qui vieillissent mal.
Madame la ministre, le projet de loi déposé au Sénat était, à l’évidence, en retard de plusieurs guerres. Il comprenait, certes, des mesures utiles sur la régulation et la lutte contre le piratage, mais rien sur la gouvernance de l’audiovisuel public, malgré l’excellent travail de Franck Riester, votre prédécesseur, qui s’inspirait de nos propositions de 2015, rien sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public, rien sur la réglementation de la production. Vous pouvez certes évoquer la directive SMA, qui prévoit de mettre à contribution les plateformes pour les obliger à investir dans la production française, mais, si cette avancée devrait profiter aux producteurs, elle ne s’accompagne d’aucune modernisation réelle du cadre réglementaire qui s’impose aux chaînes de télévision, sauf à se satisfaire des ajustements modestes prévus par le décret TNT en cours de négociation.
Notre commission de la culture a fait de nombreuses propositions depuis une dizaine d’années pour permettre de moderniser le cadre juridique défini en 1986, quand il n’y avait que six chaînes, une myriade de producteurs fragiles, pas d’internet et encore moins de Netflix. Le cadre adopté à l’époque réservait les droits des programmes aux producteurs et les fréquences aux chaînes. Ce « Yalta » ne correspond évidemment plus du tout à la situation actuelle, dans laquelle les diffuseurs, pour survivre, doivent pouvoir transformer leurs investissements en patrimoine et maîtriser leurs catalogues pour les mettre en valeur sur tous les supports et à l’international.
Compte tenu des échéances électorales à venir en 2022, il ne sera pas possible de discuter d’une nouvelle loi audiovisuelle avant 2023, voire 2024. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui constitue donc la dernière opportunité pour permettre de redonner un peu d’air aux entreprises françaises de l’audiovisuel. Que contient ce projet de loi ?
La principale disposition du texte concerne le rapprochement entre le CSA et la Hadopi, pour créer l’Arcom, le grand régulateur des médias et du numérique. II s’agit d’une avancée, même si la composition du collège prévue par le texte ne peut nous satisfaire puisqu’elle minore le rôle du Parlement. Nous discuterons d’un amendement de compromis qui devrait permettre de résoudre ce problème.
Le deuxième apport de ce projet de loi concerne la lutte contre les différentes pratiques de piratage, qu’il s’agisse des contenus culturels ou sportifs. C’est sans doute là l’aspect le plus intéressant de ce texte et celui qui recueille notre assentiment le plus large, d’autant que notre commission a été pionnière pour accompagner la prise de conscience d’une nécessaire action législative en la matière.
Le troisième apport important du projet de loi aurait dû être constitué par l’article 17 relatif au contrôle de la cession des catalogues. La disposition envisagée dans l’avant-projet de loi laissait penser qu’un dispositif protecteur pour notre exception culturelle allait pouvoir être adopté. Malheureusement, l’examen par le Conseil d’État de cette disposition semble avoir eu raison de cette ambition, laquelle, il faut bien le reconnaître, mettait à mal les droits de propriété.
Au-delà de ces trois dispositions, que devons-nous faire de ce projet de loi ?
Vous souhaitiez, madame la ministre, que nous ne touchions pas au périmètre de ce projet de loi, qui, je le rappelle, a trait à la fois à la régulation du secteur de l’audiovisuel et à l’accès aux œuvres culturelles. Nous avons décidé de traiter ce périmètre, rien que ce périmètre, mais tout ce périmètre.
La régulation de l’audiovisuel ne se cantonne pas à définir les contours de l’Arcom. La régulation, c’est-à-dire l’organisation et le fonctionnement du secteur, renvoie aussi aux règles de concentration, à la réglementation de la production et aux normes techniques de diffusion.
L’accès aux œuvres culturelles ne peut, de la même manière, se limiter à une disposition sur les catalogues de programmes, surtout lorsqu’elle a été largement vidée de son contenu. Cet accès aux œuvres doit aussi concerner l’offre du service public, notamment en programmes de qualité à destination de la jeunesse, ainsi que la capacité des chaînes à maîtriser la diffusion des programmes qu’elles financent.
En somme, le projet de loi devait avoir pour ambition d’aider les acteurs français à répondre au défi que leur lancent les plateformes américaines.
La quinzaine d’articles additionnels adoptés par la commission donne du muscle à ce texte, qui en était fort dépourvu.
Pourrons-nous trouver un accord avec vous, madame la ministre, et avec nos collègues de l’Assemblée nationale ? Permettez-moi de donner mon avis personnel et de répondre par l’affirmative, puisque même le Président de la République semble maintenant être attentif à nos travaux, comme l’illustre son annonce de lundi dernier concernant le maintien de France 4, qui constituait une des mesures emblématiques du texte adopté en commission la semaine dernière.

Alors que le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions, sur lequel nous avions émis, ici, au Sénat, un avis défavorable et que vous aviez signé au mois de février, prévoyait encore la suppression de cette chaîne, nous nous réjouissons que le chef de l’État se soit rallié à notre proposition de maintenir une chaîne dédiée à la jeunesse dans la journée et une programmation culturelle en soirée sur le modèle de Culturebox.

Nous espérons maintenant que d’autres rapprochements seront possibles, en particulier concernant l’indispensable rééquilibrage des relations entre les éditeurs de programmes et les producteurs.
Prenons l’exemple du service public de l’audiovisuel. Les chiffres transmis par France Télévisions démontrent que la société publique ne retire quasiment rien des 500 millions d’euros qu’elle consacre chaque année au financement de la création audiovisuelle et du cinéma. Pour une part significative, la contribution à l’audiovisuel public est donc devenue une contribution à la production privée. Je ne suis pas certain que nos concitoyens, qui payent la redevance, soient conscients de financer ainsi des sociétés qui, pour les plus importantes, ne sont même plus détenues par des capitaux français.
Dans le nouveau monde des médias numériques, les chaînes ont besoin de pouvoir continuer à travailler avec les producteurs indépendants – il ne s’agit pas de revenir sur ce point –, mais elles doivent pouvoir conserver des droits à 360 degrés, soit pour développer de nouvelles offres numériques, comme Salto, soit pour se déployer à l’international, comme c’est le cas de Canal+. Le texte adopté en commission vise donc à rétablir l’équité de la concurrence entre les acteurs et à faire confiance à la négociation professionnelle entre ces mêmes acteurs.
Enfin, une troisième mesure très significative, qui figure à l’article 1er du texte, vise à mettre en place une transaction pénale pour les internautes contrevenants. Il s’agit d’une demande qui fait l’unanimité, des ayants droit aux producteurs, en passant par les chaînes. Cette disposition permettra enfin de responsabiliser l’internaute et de bien souligner que le piratage constitue une faute qui n’est pas dépourvue de sanction. J’ai le sentiment que l’adoption de cette mesure donnerait enfin de la densité à ce projet de loi.
Au-delà de ces trois apports majeurs, le texte adopté par notre commission comprend de nombreux ajustements de la loi de 1986 qui visent à rendre plus supportable le report d’une réforme de grande ampleur de cette loi, laquelle ne pourra pas avoir lieu avant 2023, voire 2024.
Plusieurs amendements déposés à l’occasion des échanges en séance publique permettront également d’ouvrir le débat sur des évolutions technologiques en lien avec la TNT.
Le projet de loi tel qu’il pourrait être enrichi à l’issue de nos travaux serait à la fois cohérent et raisonnable compte tenu des attentes des acteurs. Nos propositions constituent une chance pour un secteur qui a de fortes attentes vis-à-vis des pouvoirs publics.
Je forme le vœu que nous puissions faire converger nos analyses, afin de trouver un accord au terme de la procédure législative.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la réforme de l’audiovisuel public était très attendue. Depuis trente ans, les pratiques et les contenus culturels connaissent une forte mutation, sous l’effet de la diffusion du numérique dans nos sociétés. Ces mutations sont porteuses de nouvelles opportunités pour favoriser l’accès à la culture, mais présentent aussi un certain nombre de dérives, notamment la diffusion virale de contenus haineux, de fausses informations et le piratage des contenus.
Le projet de loi présenté par votre prédécesseur, madame la ministre, avait pour ambition de réformer la loi dite « Léotard » du 30 septembre 1986, devenue inadaptée à l’ère numérique, afin d’accompagner la transformation des médias et de protéger les acteurs et les consommateurs des dérives constatées. Cette ambition a été contrariée par la crise sanitaire, ce que nous regrettons, car la préservation de notre souveraineté culturelle nécessite une refonte globale de la gouvernance, du financement et des missions de l’audiovisuel public.
Les transpositions en urgence par voie d’ordonnances de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins et la directive sur les services de médias audiovisuels, ou directive SMA, ont permis d’avancer tant bien que mal sur la voie de la protection de la propriété intellectuelle sur internet et du financement plus équilibré de la création française.
Le projet de loi que nous examinons possède un périmètre très restreint par rapport au texte initial. L’essentiel des mesures proposées porte sur la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’Arcom, nouvelle autorité publique indépendante aux compétences renforcées. L’autorité sera dotée de deux nouvelles missions : d’une part, créer une liste noire des sites ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins, afin d’assécher leurs ressources financières, sur la base du modèle américain ; d’autre part, mettre en place un nouveau mécanisme pour lutter contre les sites miroirs, en lien avec les dispositions de la loi Avia. Le régulateur pourra ainsi être saisi pour étendre une décision judiciaire aux sites miroirs et pourra agir sur leur référencement par l’intermédiaire des moteurs de recherche. Le texte dote les futurs agents du régulateur de capacités d’action renforcées pour caractériser les sites contrevenants.
La commission de la culture a significativement renforcé la portée de l’action de lutte contre le piratage de l’Arcom, ajoutant une transaction pénale au mécanisme de réponse graduée. Actuellement, le mécanisme de lutte contre le piratage repose essentiellement sur des mesures pédagogiques, en raison, notamment, de l’encombrement des tribunaux. L’instauration d’une pénalité de 350 euros viendrait mettre un terme au sentiment d’impunité des récidivistes. Cette mesure est très attendue de la part des créateurs de contenus.
Je souhaite également appeler votre attention sur la nécessité de maintenir une chaîne dédiée à la jeunesse. C’est la raison pour laquelle je me réjouis de la décision récente en la matière. France 4 a montré son utilité sociale lors des confinements.
J’évoquerai également le problème de l’augmentation artificielle du nombre d’écoutes sur les plateformes. Cette pratique, loin d’être un phénomène anecdotique, fausse la visibilité des artistes, tout en captant de façon indue les rémunérations. Pour lutter contre ce phénomène de fraude dommageable à l’ensemble de la chaîne de valeur, l’Arcom pourrait se voir confier une nouvelle mission. Tel est le sens des amendements que je vous présenterai.
Je défendrai également un ensemble d’amendements en faveur des radios indépendantes. Les transformations profondes au sein du secteur audiovisuel, accentuées par la crise liée au covid, imposent une réflexion sur la protection des droits des radios et de leur valorisation, afin de sortir d’un modèle tout publicitaire pour les radios commerciales privées.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte, tel qu’il est proposé par la commission de la culture du Sénat.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le numérique bouleverse nos vies. Le monde de la culture ne fait pas exception.
Ce projet de loi présente quelques évolutions, dont certaines sont bienvenues. Toutefois, je ne peux que souligner son manque d’ambition. Il est difficile de se saisir d’un sujet aussi majeur sur la base d’un texte comme celui-ci, qui laisse de côté des questions cruciales, comme l’évolution de l’audiovisuel public et son financement, mais aussi le partage de la valeur ajoutée entre les acteurs du secteur culturel, ainsi que la juste rémunération des artistes et des auteurs.
Ce débat aurait pu être l’occasion de réfléchir à de nouveaux modèles économiques et de soutenir la production culturelle, afin de favoriser l’accès de tous et de toutes à la culture, dans un monde aux usages numériques grandissants. Dix ans après la création de la Hadopi, il aurait été bienvenu de rouvrir le débat sur la licence globale, à l’aune de ce que nous avons appris pendant cette décennie. Malheureusement, nous ne débattrons pas ici d’une grande loi audiovisuelle. C’est une petite loi, qui introduit essentiellement des ajustements au modèle existant, sans vision politique ambitieuse.
La fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’Arcom a du sens. Mais la loi manque d’une véritable réflexion sur l’évolution des missions et des moyens attribués à cette nouvelle agence de régulation.
S’agissant de ses missions, je regrette que la future Arcom reprenne intégralement celles de la Hadopi. L’ambition du texte est de prioriser et de renforcer la lutte contre les sites contrevenants, ceux qui tirent profit du piratage. C’est plus efficace et plus juste que le ciblage d’internautes individuels.
Les nouveaux moyens prévus dans ce texte pour améliorer la réactivité concernant le blocage des sites sont tout à fait bienvenus. Dès lors, pourquoi conserver le système de la réponse graduée et les « avertissements de la Hadopi » au sein de la nouvelle Arcom ? Ce système est contraire à la philosophie du texte et coûtera plusieurs millions d’euros par an. Surtout, il est inefficace : le nombre de téléchargements en peer to peer détecté par la Hadopi a diminué. Pourquoi ? Parce qu’il est contourné par les internautes avertis et largement compensé par le boom d’autres méthodes de piratage. Nous pourrions être honnêtes, mes chers collègues, et admettre que la réponse graduée de la Hadopi était déjà dépassée au moment de sa création. C’est un système qui prend le problème par le mauvais bout et dont les effets réels sur les revenus du secteur culturel sont, au mieux, très incertains.
Ce projet de loi ne s’attaque pas au problème de la concentration des médias et risque au contraire de le renforcer. Un amendement déposé en commission a relevé le seuil de diffusion des chaînes locales à 30 millions d’habitants, ce qui permettra à certaines chaînes d’information en continu de s’imposer sur la majorité du territoire. Peut-on encore parler de chaînes locales à ce niveau ?
Alors que nous assistons aujourd’hui au projet de fusion entre TF1 et M6, alors que la majorité des médias sont possédés par une poignée de milliardaires, alors que la diversité et l’indépendance sont essentielles pour la démocratie, ce texte n’offre aucune réponse. C’est une occasion manquée.
J’espère que nous en retirerons pourtant quelques évolutions positives, notamment au travers des amendements portant sur l’audiovisuel public, telles que le renforcement de la visibilité des chaînes publiques et, surtout, la pérennisation de la seule chaîne de l’audiovisuel public consacrée à la jeunesse, à savoir France 4, dont la disparition aurait été dommageable pour notre service public.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une chaîne publique dédiée à la jeunesse. L’idée de pérenniser le programme Culturebox sur le même canal en soirée est également un geste fort à l’égard des acteurs culturels, particulièrement sinistrés par la crise sanitaire.
Je remercie M. le président de la commission de la culture, Laurent Lafon, ainsi que M. le rapporteur, Jean-Raymond Hugonet, d’avoir été à l’initiative d’une tribune transpartisane demandant le maintien de France 4. Il semble que cet appel ait été entendu par le Président de la République. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir confirmé aujourd’hui son maintien.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel du texte, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oriente vers une abstention sur ce texte.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, certes, le texte que nous examinons aujourd’hui ne réforme pas la gouvernance ou le financement de l’audiovisuel public, mais imputer ce fait à un manque de volonté politique du Gouvernement me paraît relever d’une injustice. Au départ, le texte comprenait bel et bien une telle réforme. La crise sanitaire a chamboulé l’agenda parlementaire, nous contraignant à le repenser.
La crise sanitaire a eu pour conséquence d’amplifier certaines tendances et certaines pratiques. Elle a notamment engendré une augmentation inédite des usages du numérique, qu’il s’agisse de l’utilisation de services de streaming, d’achats en ligne ou de recours au télétravail.
Parallèlement, on a observé une hausse sans précédent du piratage audiovisuel. Le 6 mai dernier, une étude de la Hadopi révélait que 12, 7 millions d’internautes avaient visité, en 2020, chaque mois, des sites proposant des contenus manifestement contrefaisants. Cela représente, mes chers collègues, près d’un quart des internautes. Le pic a été atteint en mars, lors du premier confinement, avec 14, 2 millions d’internautes, soit 27 % du total.
Ces chiffres éloquents témoignent malheureusement de l’incapacité de la Hadopi à lutter contre les nouveaux vecteurs du piratage des contenus audiovisuels.
En d’autres termes, la crise sanitaire nous a conduits à reconsidérer l’ordre des priorités, pour sauver le secteur de l’audiovisuel, dans le cadre d’un calendrier parlementaire fortement contraint.
C’est là précisément l’objet de ce projet de loi, qui fait de la lutte contre le piratage audiovisuel une priorité. Ce texte est donc à la fois un texte d’urgence et un texte pragmatique, qui apporte des solutions innovantes et concrètes. Je pense au dispositif des listes noires que pourra dresser l’Arcom ou à la possibilité pour cette autorité de demander le blocage ou le déréférencement d’un site miroir sur saisine d’un ayant droit lorsqu’il existe une décision passée en force de chose jugée. Vous le savez, les sites miroirs, c’est-à-dire la reproduction exacte d’un autre site pour contourner une décision judiciaire, sont aujourd’hui un fléau contre lequel nous ne parvenons pas à lutter, faute d’instrument législatif adéquat.
Je citerai également, sans prétention à l’exhaustivité, le dispositif spécifique du référé que crée ce projet de loi pour lutter contre le piratage sportif, ainsi que les dispositions sur les droits voisins et sur la protection de nos catalogues : une série de dispositions à la fois efficaces, utiles et attendues par le secteur.
La commission de la culture a enrichi ce texte ; certains ajouts nous paraissent bienvenus. C’est le cas, par exemple, des dispositions qui maintiennent l’attractivité de la TNT. D’autres ajouts nous semblent au contraire inopportuns, comme l’instauration d’une transaction pénale. Nous aurons certainement un débat tout à l’heure sur ce point : notre volonté est de sanctionner, d’empêcher, de prévenir l’existence des sites contrevenants, les sites miroirs notamment, mais pas de nous en prendre aux internautes eux-mêmes.
De la même manière, l’éviction des deux magistrats initialement prévus par le projet de loi dans le collège de l’Arcom ne nous paraît pas pertinente. J’ai proposé à ce titre un amendement de compromis. Monsieur le rapporteur, vous avez bien voulu le mentionner, affirmant qu’un chemin existait ; proposer une solution, pour la Haute Assemblée, cela me paraît bénéfique. Certes, nous en sommes à la première lecture, mais cela n’empêche pas le Sénat d’avancer de manière équilibrée sur ce sujet en proposant dès maintenant une solution qui pourra être reprise par l’Assemblée nationale. Je souhaite que nous y parvenions, et j’en accepte l’augure.
J’aimerais rappeler enfin que ce texte s’adresse évidemment d’abord et avant tout aux créateurs, aux artistes, à la production intellectuelle et artistique, qu’il faut protéger. Coco Chanel disait, d’une formule fameuse : « Volez mes idées, j’en aurai d’autres. » Mais, en l’espèce, il ne s’agit pas d’idées : il s’agit d’œuvres. Une idée, on la lance, elle peut être reprise. Là où il s’agit d’œuvres et de création, en revanche, à défaut d’une protection renforcée, il existe, dans un monde qui fait la part belle au piratage audiovisuel, un risque d’appauvrissement : appauvrissement de la qualité artistique, de la diversité et du rayonnement audiovisuel, artistique et même intellectuel de la France.
Pour lutter contre un tel risque d’appauvrissement, ce texte, en ce qu’il renforce la lutte contre le piratage, est extrêmement utile ; il est en outre extrêmement attendu par tous les créateurs.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication demeure la grande référence du cadre régissant la défense des libertés de communication, le pluralisme de l’information ou encore la qualité des contenus audiovisuels. Entre-temps, cependant, la révolution numérique est passée par là, avec ses incroyables possibilités mais aussi ses dangers. En effet, d’un côté, le monde numérique a ouvert un potentiel immense en matière de diffusion et d’accès à l’information. De l’autre, il a ouvert la porte à de nouveaux acteurs dont il faut réguler l’activité, ainsi qu’au développement d’usages malveillants qu’il faut contrer.
Dans ce nouveau monde, l’équilibre des industries culturelles est bouleversé. Je pense en particulier à la question du droit de la propriété intellectuelle, qu’il faut régulièrement adapter et protéger face aux évolutions technologiques. Ce droit est essentiel : son respect est une condition tant de la viabilité économique de certains médias que de la survie de la création française.
Nos collègues rapporteurs l’ont rappelé : le Parlement attendait un grand projet de loi concernant l’ensemble du secteur audiovisuel. Las, le premier confinement est venu stopper cette ambition. Dans ces conditions, on pourrait regretter la modestie du texte qui nous est soumis aujourd’hui. Considérons néanmoins qu’il constitue une étape, d’autant plus que le numérique a la particularité de générer des mutations en permanence et d’attirer chaque jour un peu plus son public. Près d’un Français sur six pratique déjà le « tout numérique » en matière culturelle. Netflix compte aujourd’hui plus d’abonnés que Canal+, et ce n’est sans doute qu’un début…
Par ailleurs, cela a été dit, je rappellerai que la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins et celle du 14 novembre 2018 sur les services de médias audiovisuels, dont nous avons approuvé la transposition en droit français, offrent des avancées notables, parmi lesquelles la contribution des plateformes en ligne à la production d’œuvres européennes.
Aussi, mes chers collègues, le RDSE se réjouit-il des différents dispositifs proposés dans le cadre du présent projet de loi, qui renforceront l’arsenal existant. Nous accueillons notamment de manière favorable la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui va donner naissance à l’Arcom ; pourvu que cette nouvelle autorité dispose des moyens nécessaires de sa politique. À cet égard, je relève que la commission est allée dans le bon sens en prévoyant l’élargissement des pouvoirs d’enquête des agents de l’Arcom. Un tel élargissement est nécessaire au regard de modes de piratage toujours plus astucieux, tels que les sites miroirs.
Si l’on observe globalement une baisse du piratage grâce à la mobilisation des pouvoirs publics, on sait que les pratiques illicites concernant le sport sont en revanche en hausse. Je salue à ce titre le travail effectué par la commission dans le domaine du sport, la consolidation de l’article 3 visant à lutter contre le piratage des retransmissions en direct. Nous savons combien le sport a souffert des conséquences de la pandémie, entre la disparition des recettes de billetterie et la baisse du nombre d’adhésions – et je ne parle pas de la crise des droits TV, qui affecte particulièrement le football français.
Le dispositif de protection de l’accès du public aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques est également une bonne chose. Le nécessaire équilibre entre droit de propriété et conservation du patrimoine français semble trouvé.
Il est en revanche regrettable que la question de l’audiovisuel public soit absente du texte, malgré les quelques apports de la commission. Il faudra s’attaquer au problème de la place du service public, de son organisation, de son contenu et de son financement, si l’on souhaite que celui-ci survive dans un paysage audiovisuel de plus en plus pléthorique.
Mes chers collègues, en attendant d’autres réformes qui seront inévitables, ce projet de loi apportera quelques outils qui permettront de mieux garantir la souveraineté et l’exception culturelle de notre pays. Le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, du projet de loi déposé par le Gouvernement à la fin de l’année 2019 et discuté à l’Assemblée nationale l’an dernier, il ne reste plus grand-chose. Je sais que la majorité sénatoriale – elle a commencé à le faire en commission – va intégrer certaines dispositions du projet de loi présenté par le précédent ministre de la culture. Il reste donc principalement trois éléments.
Premièrement, la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’Arcom est logique à bien des égards, puisque le CSA se voit confier une mission de régulation d’internet.
Toutefois, trois doutes persistent.
Tout d’abord – c’est une rumeur persistante –, cette fusion pourrait n’être qu’une étape avant la création d’un super-régulateur médiatique, l’Arcep ayant déjà été enrichie voilà deux ans. Une telle usine à gaz poserait des problèmes pratiques et logistiques, mais aussi philosophiques.
Ensuite, il me semble dangereux de transférer au CSA un outil qui fait toujours l’objet de recours devant le Conseil d’État et la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la régulation d’internet par le CSA n’est pas sans poser question, le CSA ne délivrant pas d’autorisation préalable de diffusion.
Deuxièmement, concernant la création d’un mécanisme de protection des œuvres culturelles françaises, la directive européenne SMA va obliger les plateformes comme Netflix à participer à la création ; c’est une bonne chose. Cela ne doit pas pour autant leur servir d’excuse pour multiplier les droits exclusifs sur les contenus sans en assurer l’exposition. Si le dispositif prévu va dans le bon sens, il pèche selon moi à deux égards.
Tout d’abord, je regrette que le Conseil d’État ait dissuadé le Gouvernement d’aller plus loin en l’autorisant à bloquer une vente par un mécanisme d’autorisation préalable. Ensuite, me semble-t-il, il faudra bien que l’on pose, à un moment, la question de l’accessibilité des contenus.
Troisièmement, concernant la lutte contre le piratage, plus que celui du piratage en tant que tel, c’est bien le problème du manque à gagner financier qui doit être traité. J’avais évoqué ce sujet en commission en prenant l’exemple de la NBA, qui a décidé d’arrêter sa lutte contre le piratage, faisant le calcul que cette pratique lui rapportait en définitive de l’argent.
Nous avons conscience d’être à la croisée des chemins. La télévision connaît aujourd’hui ce qu’ont connu jadis, en leur temps, le théâtre et, dans une moindre mesure, le cinéma : l’arrivée de concurrents féroces et le détournement d’une partie de son audience.
Le service public de l’audiovisuel, victime de coupes budgétaires de plus en plus importantes, se retrouve en grande difficulté face à ces nouveaux acteurs, mais aussi face à un secteur privé bien mieux armé. Tout communiste que je suis, je ne peux d’ailleurs que regretter que le secteur privé de l’audiovisuel soit lui aussi aux abois devant les coups de boutoir qu’il subit.
On le voit bien, les choses avancent, et pas dans le bon sens. Certains pensent qu’en se réunissant ils constitueront des empires à même de concurrencer les nouveaux acteurs de l’audiovisuel. Ainsi, Vincent Bolloré veut se rapprocher d’Europe 1 ; la fusion entre TF1 et M6, ces derniers jours, va dans le même sens.
Cette stratégie est perdante sur tous les tableaux, et ce d’autant plus que des initiatives de coopération pourraient tout à fait exister. Salto, bien que largement perfectible, en est un parfait exemple.
Elle est perdante face aux géants Netflix, Discovery ou Disney+, qui auront toujours la puissance financière pour écraser ces empires. En 2021, Netflix va investir 19 milliards de dollars dans ses productions, soit cinq fois plus que le chiffre d’affaires cumulé des groupes TF1 et M6…
Elle est perdante face aux nouveaux acteurs comme YouTube et Twitch, qui, par ailleurs, appartiennent aux géants financiers Google et Amazon, et elle l’est pour deux raisons. Ces acteurs attirent une nouvelle audience, la jeunesse, et ont su se renouveler. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si toutes les chaînes de télévision possèdent aujourd’hui une chaîne YouTube. Surtout, ces plateformes sont venues combler pour partie le vide qu’on ne peut que regretter dans l’audiovisuel traditionnel, ou y apporter un coup de frais. Arte et France Télévisions ont été en la matière précurseurs en intégrant tout récemment à leur grille de programmes des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques et historiques reconnus et en leur laissant une liberté de ton.
La volonté acharnée d’aseptiser l’audiovisuel en créant des empires unis par une seule ligne éditoriale va totalement à contre-courant de ce que recherche aujourd’hui la majorité de nos concitoyens, sans donner pour autant aux intéressés les moyens de lutter économiquement.
Au vu de tous ces éléments, et sous réserve du sort qui sera réservé à nos amendements, notre groupe s’abstiendra en retenant notamment, parmi les dispositions du texte, la protection des catalogues.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.