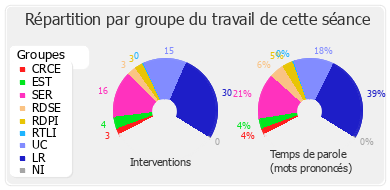Séance en hémicycle du 25 janvier 2022 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Prise en charge du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (voir le dossier)
- Situation particulièrement préoccupante de l'accès aux soins dans le département de l'ariège (voir le dossier)
- Dysfonctionnements dans la nièvre à la suite du transfert du centre de réception et de régulation des appels 15 en côte-d'or (voir le dossier)
- Éligibilité des dépenses de déneigement au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (voir le dossier)
- Financement du matériel nécessaire à l'ouverture de nouvelles lignes de trains de nuit (voir le dossier)
- Épidémie de brucellose en haute-savoie et nécessité de procéder à l'abattage total des bouquetins du bargy (voir le dossier)
- Détournement des missions de l'inspection du travail au nom de « la lutte contre le séparatisme » (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 20 janvier 2022 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

La parole est à Mme Françoise Gatel, auteur de la question n° 1982, transmise à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

J’appelle l’attention du Gouvernement sur une politique très positive qu’il a mise en œuvre : l’école inclusive.
Nous savons tous, cependant, que subsistent un certain nombre de difficultés, notamment depuis la décision du Conseil d’État en 2020. Celle-ci précise que, sur le temps périscolaire – cantine et garderie –, il appartient aux autorités qui en sont organisatrices, c’est-à-dire aux communes, de mettre à disposition les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) dont la présence est prescrite par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Cela nous pose de véritables difficultés, monsieur le secrétaire d’État, car la MDPH décide, mais ce sont les communes qui doivent trouver le personnel et le financer.
Or au-delà du financement, il est difficile de trouver du personnel sur le temps du midi, pour une durée d’une heure ou d’une heure et demie, et cela freine l’accueil des enfants handicapés à l’école.
Nous devons donc, à mon sens, réfléchir à l’évolution de ce service. Sous réserve de l’accord des départements, et dès lors que ceux-ci disposeront des financements nécessaires, ne pourrait-on pas expérimenter la mise en place d’un service mutualisé d’AESH à leur niveau ? Cela offrirait de plus des perspectives de carrière et de formation à ces personnels qui jouent un rôle extrêmement important auprès des enfants handicapés et des familles.
Madame la sénatrice, je vous réponds au nom de Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel.
Depuis 2017, l’école inclusive est, non pas une « obsession », mais une priorité du Gouvernement, car l’école de la République se doit d’accueillir tous les enfants de la République ; qui pense le contraire n’est pas républicain.
Le service public de l’école inclusive a pour objectif d’assurer une scolarité de qualité à tous les élèves, de la maternelle au lycée. En 2021, ce sont ainsi plus de 400 000 élèves en situation de handicap qui ont été scolarisés. Aux côtés des professeurs et de l’ensemble des personnels, 125 000 AESH interviennent quotidiennement, vous l’avez rappelé.
Vous nous interrogez sur le financement de ces postes et, plus précisément, sur la pertinence d’engager une évolution de ce dispositif afin de le confier en totalité aux départements.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été accompli ces dernières années s’agissant notamment du statut de ces personnels.
Votre proposition peut s’entendre sur le plan de la responsabilité globale d’une politique de solidarité, dans la mesure où le département intervient dans le champ de l’enfance et du handicap depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont nous célébrerons l’anniversaire.
En effet, le département assure désormais la tutelle administrative et financière des maisons départementales des personnes handicapées, lesquelles délivrent des prescriptions d’aide humaine aux élèves en situation de handicap.
La proposition que vous formulez aurait pu, après avoir fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des parties, être discutée dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS, adopté en première lecture au Sénat puis à l’Assemblée nationale.
Ce débat n’a pas eu lieu, mais il y en a eu de nombreux autres. Dès lors, la ligne de partage entre ce qui relève de la compétence de l’État et du service public de l’éducation, d’une part, et de celle de la collectivité qui organise le service périscolaire, d’autre part, doit être préservée.
Toutefois, la réflexion que vous appelez de vos vœux, madame la sénatrice, pourrait être menée dans les semaines ou dans les mois à venir.

Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Nous avons su faire preuve d’audace dans le cadre du projet de loi 3DS, s’agissant du transfert de personnels d’État vers les collectivités, quand le bon sens le commandait ; nous n’avons toutefois pas pu le faire sur ce sujet, parce qu’il appartient au Gouvernement de lever le gage.
Je souhaite qu’une réflexion soit engagée sur les AESH, car, comme vous l’avez très justement indiqué, on ne peut pas imposer cela aux départements sans que ceux-ci soient volontaires et que les conditions le permettent.
En tout état de cause, je forme le vœu que l’on ouvre ce débat afin de conduire une expérimentation dans quelques départements.

La parole est à M. Michel Savin, auteur de la question n° 2079, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et transposant en droit français la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a été définitivement ratifiée par le Parlement le 16 février 2021, lui donnant force de loi.
Cette ordonnance s’accompagne de trois textes d’application parus au Journal officiel, lesquels ouvrent la voie à l’accès partiel aux professions médicales ou paramédicales, comme les techniciens de laboratoire médical, les pédicures-podologues, les orthophonistes, les opticiens, les aides-soignants, les ambulanciers ou encore les assistants dentaires.
Ces textes permettent à un professionnel d’un pays de l’Union européenne d’exercer sa profession dans un autre pays même si celle-ci n’est pas encore reconnue en tant que telle. C’est le cas, par exemple, des prothésistes dentaires cliniciens et des hygiénistes dentaires.
De ce fait, ces métiers devraient être intégrés dans le code de la santé publique français.
Or, aujourd’hui, un prothésiste dentaire clinicien installé dans un pays de l’Union européenne et souhaitant revenir exercer en France ne parvient pas à obtenir de réponse de l’administration.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce type de demandes d’installation.
Monsieur le sénateur, l’accès partiel désigne cette possibilité, pour un professionnel formé dans un État membre de l’Union européenne – ou un État partie à l’Espace économique européen –, d’exercer une partie des activités relevant du champ d’une profession réglementée en France.
Conformément au droit européen et à sa transposition à l’article L. 4002-3 du code de la santé publique, l’accès partiel à une profession de santé peut-être accordé lorsque trois conditions sont remplies.
Premièrement, le professionnel doit disposer, dans son État d’origine, des qualifications professionnelles spécifiques à l’exercice de la profession de santé concernée.
Deuxièmement, il faut que les mesures de compensation qui pourraient être demandées ne suffisent pas à couvrir la différence substantielle entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État d’origine et la profession correspondante en France.
Troisièmement, enfin, l’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite cet accès doit pouvoir objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France.
La mise en œuvre de cette procédure est appréciée au cas par cas, au regard des qualifications professionnelles détenues par le demandeur. Dès lors, les conditions dans lesquelles les métiers de prothésiste dentaire clinicien et d’hygiéniste dentaire pourraient permettre un tel accès partiel nécessitent un examen approfondi.
Je rappelle également que le mécanisme d’accès partiel ne s’applique que lorsque celui qui en fait la demande en France est titulaire d’une qualification professionnelle délivrée par un État membre ou partie autre que la France.
Enfin, comme l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes le 9 février 1994, la reconnaissance d’un titre de la part d’un État membre n’engage pas les autres États membres à reconnaître le même titre avec les mêmes prérogatives.
Ce sujet est technique et complexe, mais les services du ministère se tiennent à votre disposition, monsieur le sénateur, si vous souhaitez poursuivre cet échange.

Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, ces sujets sont techniques et complexes, c’est la raison pour laquelle il n’est pas normal que l’administration n’ait pas donné de réponse au bout d’un an.
Peut-être faut-il de nouveau la solliciter, afin que des explications soient apportées à ces professionnels français qui sont expatriés et qui veulent revenir travailler en France ?
Il s’agit de garantir leur activité professionnelle, laquelle est reconnue techniquement puisque ces personnes disposent des diplômes nécessaires. Si vous pouviez intervenir auprès de l’administration de sorte qu’elles obtiennent une réponse définitive, cela constituerait une avancée importante.

La parole est à M. Frédéric Marchand, auteur de la question n° 2081, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, le traitement biologique de l’eau de piscine publique, écartant ou limitant l’usage de produits chimiques, notamment au travers du système innovant de traitement par filtration biominérale, permet une filtration plus rapide que les systèmes classiquement utilisés pour filtrer l’eau des baignades artificielles.
Plusieurs collectivités françaises, pionnières en la matière et soucieuses du bien-être de leurs habitants, en particulier la ville de Coudekerque-Branche, dans le Nord, ont intégré dans leur projet de piscine publique un traitement biologique de l’eau par filtration biominérale.
L’interprétation des textes en vigueur par les différentes agences régionales de santé (ARS) suscite toutefois des interrogations : le traitement au chlore des bassins dépend de la réglementation des piscines, alors que le traitement biologique, au sujet duquel un décret a été pris début avril 2019 sur rapport du ministère des solidarités et la santé, dépend, quant à lui, de la réglementation de la baignade.
Les porteurs de projet ont donc un impérieux besoin d’obtenir une clarification de la situation, ce que ne permet pas le décret d’avril 2019. Celui-ci limite en effet considérablement la fréquentation maximale instantanée et journalière des piscines, ce qui ne rend pas l’exploitation de la piscine publique économiquement viable. Dans le cadre du dispositif France Expérimentation, un dossier a été déposé afin d’augmenter ces plafonnements en baignade artificielle en système fermé.
La direction générale de la santé, au vu du caractère innovant des systèmes de filtration biominérale, a émis un avis de principe favorable quant à leur utilisation, et cet avis a été confirmé par un courrier du ministre des solidarités et de la santé en date de mai 2021.
Toutefois, le protocole expérimental que doit présenter France Expérimentation dans un cadre interministériel, soumis ensuite à l’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) n’a toujours pas été délivré à ce jour. Alors que les chantiers de construction des équipements sont en cours, ce vide juridique met en péril la réalisation définitive et l’ouverture des sites.
Ce traitement innovant, permettant de se baigner à la piscine comme dans un lac de montagne, est de toute évidence une source de progrès pour les habitants, pour les usagers, mais aussi pour les personnels des centres aquatiques, et il va dans le sens de la transition écologique.
Monsieur le secrétaire d’État, dans quel délai l’encadrement de cette démarche expérimentale pourra-t-il être défini, et toutes les incertitudes, levées ?
Monsieur sénateur, vous appelez l’attention du ministère sur l’utilisation de ce traitement par filtration biominérale développé par la société Aquatic Science France pour des projets d’ouverture de centres aquatiques portés par plusieurs collectivités.
Ces projets, eu égard à leur nature, doivent répondre aux règles sanitaires applicables aux baignades dites « artificielles ». Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de déroger à certaines dispositions réglementaires relatives à la fréquentation de baigneurs et au caractère innovant du procédé de traitement envisagé, les porteurs de projets ont été invités à les soumettre au dispositif France Expérimentation.
Un accord de principe pour la mise en place d’expérimentations a été accordé par le cabinet du Premier ministre fin octobre dernier, sous réserve que les travaux préparatoires à venir permettent de s’assurer que le projet ne présente pas de risque sanitaire pour les baigneurs. La mise en expérimentation pourrait alors être définitivement actée.
Comme vous l’avez indiqué, monsieur le sénateur, si la direction générale de la santé a émis un avis de principe favorable et si l’intégration de ces dossiers au dispositif France Expérimentation a été actée par le cabinet du Premier ministre, il reste encore à définir et à encadrer les modalités de mise en œuvre concrète de ces projets.
À cet effet, une première réunion, pilotée par les services de France Expérimentation, qui réunira l’ensemble des acteurs concernés, dont les services de la direction générale de la santé, est prévue demain 26 janvier, afin d’échanger sur l’encadrement de cette démarche expérimentale et d’arrêter un calendrier prévisionnel pour donner de la visibilité aux porteurs aux porteurs de projets.
Je ne doute pas que vous continuerez à être associé à ces discussions, ou du moins, à en être tenu informé.

La parole est à Mme Catherine Deroche, auteure de la question n° 2085, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Ma question concerne la prise en charge de la douleur. Si la lutte contre la douleur est un objectif consacré dans la loi depuis 2002, force est de constater l’existence d’une crise majeure de santé publique liée à la mauvaise prise en compte de celle-ci.
Dans un rapport récent, la commission des affaires sociales a d’ailleurs renouvelé le constat du déficit de culture palliative et de moyens y afférents dans notre pays.
À l’occasion de l’évaluation du troisième plan national d’amélioration de la prise en charge de la douleur, qui a couvert la période 2006-2010, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a formulé plusieurs recommandations pour l’élaboration d’un futur plan douleur, mais celui-ci n’a pas été renouvelé.
Pourtant, le besoin est avéré. Les recommandations publiées en novembre 2019 par la Haute Autorité de santé (HAS) sur les parcours de soins de patients douloureux chroniques s’appuient sur des données statistiques : parmi les 12 millions de personnes souffrant de douleurs chroniques dans notre pays, 70 % ne reçoivent pas de traitement approprié et moins de 3 % bénéficient d’une prise en charge dans une structure « douleurs chroniques » d’établissement.
Un nouveau plan serait donc nécessaire. Il pourrait reposer sur trois axes : la recherche sur la douleur, mais aussi sur les pathologies qui la causent ; l’organisation des soins, avec un premier palier de prise en charge constitué par les soins de ville en partenariat avec les structures spécialisées dans la douleur chronique ; la diffusion des bonnes pratiques auprès des professionnels de santé.
Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement s’agissant de l’élaboration d’un nouveau plan contre la douleur ?
Madame la sénatrice Deroche, avec un Français sur trois qui souffre de douleurs chroniques, la prise en compte de la douleur peut être qualifiée de véritable phénomène de société. Cela représente, pour des millions de personnes, une dégradation considérable de leur qualité de vie au quotidien. Il s’agit d’un enjeu réel de santé publique et d’un critère de qualité de vie.
En 2016, la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a permis d’améliorer la prise en compte de la douleur et d’avancer en matière de prévention collective et individuelle de la douleur.
Ce texte précise notamment les missions du médecin généraliste relatives à l’administration et à la coordination des soins visant à soulager la douleur, si nécessaire en relation avec des structures spécialisées, en les intégrant pleinement aux missions de l’équipe de soins en la matière.
En 2020, le dispositif national dédié au soulagement de la douleur comptait 278 structures « douleurs chroniques », dont 7 structures exclusivement pédiatriques, et 36 spécialisées en pédiatrie, c’est-à-dire dotées de pédiatres dédiés, sachant que toutes les autres structures accueillent les enfants en première intention.
Ces structures de recours sont destinées à prendre en charge les patients adressés par leur médecin traitant lorsque leurs douleurs demeurent réfractaires aux traitements administrés en ville.
Un groupe de travail a par ailleurs été constitué afin de mener une réflexion sur la modernisation et l’adaptation du financement des prises en charge ambulatoires. Les prestations dites « frontières » en hôpital de jour sont en effet particulièrement fréquentes pour les douleurs chroniques.
Une autre réflexion, sur les parcours patients, est également en voie de finalisation.
Enfin, la récente création d’une formation spécialisée transversale en médecine de la douleur doit permettre de mieux former tous les professionnels de demain à ces enjeux.
J’ajoute qu’un cinquième plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie, couvrant la période 2021-2024, a bien été annoncé. Structuré autour de quinze actions et de trois axes, il permettra de favoriser l’appropriation des droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie, de conforter l’expertise en soins palliatifs et de définir des parcours de soins gradués et de proximité.
Notre objectif est clair, madame la sénatrice : plus un seul département ne doit être dépourvu de structure palliative à l’horizon 2024.

Je note bien les efforts nécessaires réalisés en matière de soins palliatifs, mais tous les patients atteints de douleurs chroniques ne relèvent pas – heureusement pour eux ! – de soins de fin de vie.
Il s’agit d’un vrai sujet, qui concerne des gens qui sont éloignés de l’emploi et dont la vie sociale, familiale et professionnelle est très complexe. La crise des opioïdes aux États-Unis a offert un exemple paroxystique du mésusage de certains médicaments.
Les structures « douleurs chroniques », qu’elles soient pédiatriques ou non, sont en nombre insuffisant et, pour la plupart, saturées.
Comme l’indiquent les rapports du HCSP, de la HAS, du ministère et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il faut maintenant passer à l’action, notamment sur la prise en charge.

La parole est à M. Didier Marie, auteur de la question n° 2087, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous alerter sur la situation des hôpitaux publics en Normandie, où la population est vieillissante, et l’espérance de vie, plus faible qu’ailleurs. Cette région est la deuxième de France métropolitaine qui présente les indicateurs de densité médicale les plus défavorables, avec 292 médecins pour 100 000 habitants et une répartition des professionnels de santé qui pose de véritables difficultés d’inégalité d’accès aux soins.
L’enjeu du renforcement de l’attractivité des établissements de santé y représente également un défi majeur, puisque les hôpitaux publics normands sont ceux qui manquent le plus de personnel, en particulier en médecine d’urgence, en psychiatrie, en gériatrie et en médecine générale.
Ces hôpitaux étaient déjà en difficulté financière avant le covid, mais la pandémie a aggravé la situation. D’après une récente enquête de la Fédération hospitalière de France (FHF), les dépenses dues au covid s’élèvent ainsi à 49 millions d’euros en 2021, alors que 28 millions d’euros seulement seraient couverts à ce jour pour onze établissements, dont les plus importants : les centres hospitalo-universitaires (CHU) de Rouen et de Caen, l’hôpital de Dieppe, ainsi que celui d’Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
En juillet 2020, le Gouvernement a annoncé un plan d’investissement de 19 milliards d’euros pour la période 2021-2030, qui a été décliné localement par le ministre des solidarités et de la santé. Cet effort est bienvenu, mais les montants annoncés méritent d’être analysés.
Pour le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, le ministre a par exemple annoncé 11 millions d’euros d’aides à l’investissement, alors qu’il ne s’agit principalement que d’un rebasage de la dette, à raison de 1 million d’euros pendant neuf ans, soit 9 millions d’euros. Seulement 2 millions d’euros de subventions seront donc réellement consentis afin d’étendre le secteur de la réanimation. C’est insuffisant.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement prévoit-il de réévaluer les subventions d’investissement là où celles-ci semblent insuffisantes ? Envisage-t-il d’accompagner les hôpitaux par une compensation des surcoûts liés à la crise sanitaire, en attendant une hypothétique réforme de la tarification ?
Monsieur le sénateur, merci d’avoir mis en lumière le plan d’investissement ambitieux de 19 milliards d’euros adopté par le Gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé en faveur de notre système de santé.
En Normandie, 650 millions d’euros seront ainsi consacrés au soutien de 68 hôpitaux et de très nombreux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La reconstruction totale du CHU de Caen qui est en cours a notamment fait l’objet de l’aide la plus forte accordée à une opération hospitalière en métropole.
Une large concertation a été menée tout au long du processus de décision avec l’ensemble des collectivités. À l’issue de celui-ci, en décembre 2021, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Normandie a émis un avis favorable quasi unanime sur les choix effectués dans le cadre de cette stratégie régionale d’investissement.
Je me permets également de souligner l’engagement de la région, à hauteur de 200 millions d’euros, et les manifestations d’intérêt d’autres collectivités, tout à fait bienvenues.
L’ARS de Normandie financera pour sa part des projets de modernisation des Ehpad à hauteur de 60 millions d’euros. En 2021, 16, 5 millions d’euros ont ainsi été alloués à la conduite des dix premières opérations.
Les accords du Ségur comportaient aussi des mesures de revalorisation des rémunérations prises pour reconnaître l’engagement sans faille des professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux, pour un montant de 8, 2 milliards d’euros au niveau national. En Normandie, 91 000 soignants ont ainsi vu leurs salaires revalorisés.
Vous le constatez, monsieur le sénateur, l’impact du Ségur pour la Normandie est évident et puissant ; il permettra d’améliorer les parcours de soins de l’ensemble de ses habitants.

Monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien vos propos, mais il reste deux problèmes à traiter.
Le premier est le rebasage des déficits des hôpitaux, lesquels se sont élevés à 112 millions d’euros en 2021 et devraient atteindre 95 millions d’euros en 2022.
Le second concerne le plan d’investissement, effectivement nécessaire, qui doit être réévalué hôpital par hôpital, car certains d’entre eux ne sont pas suffisamment pourvus.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 2076, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, la presse s’est fait l’écho d’une baisse des ventes de cigarettes en 2021, laissant penser que cette diminution voudrait dire qu’il y a moins de fumeurs en France. C’est oublier, pourtant, l’importance des achats frontaliers, en augmentation par rapport à 2020, année durant laquelle les déplacements étaient interdits.
Si le plan national de lutte contre le tabac 2018-2022 a eu des effets, le nombre de fumeurs est reparti à la hausse l’an dernier : un Français sur trois fume toujours, soit près de 15 millions de personnes. Nous restons de loin le pays d’Europe de l’Ouest qui fume le plus, deux fois plus que le Royaume-Uni, par exemple, alors que nos deux pays connaissaient la même prévalence tabagique il y a vingt ans.
La baisse des dernières années ne doit pas non plus occulter le report significatif des fumeurs vers les alternatives, telles que la cigarette électronique et le tabac à chauffer.
J’estime toutefois qu’il est utopique de penser que 15 millions de personnes veulent et peuvent s’arrêter de fumer.
À la veille d’un nouveau plan pluriannuel, la responsabilité du Gouvernement est de faire évaluer ces alternatives sans combustion, afin de vérifier si celles-ci sont moins dangereuses pour la santé, sans jamais oublier qu’elles ne doivent pas jouer un rôle initiateur, en particulier pour les jeunes.
Cela irait dans le sens de l’avis rendu début janvier par le Haut Conseil de la santé publique, qui appelait à étudier ces alternatives afin de déterminer si elles pourraient constituer une sorte de troisième voie entre cigarette et sevrage.
Comment, et à quelle échéance, le Gouvernement entend-il faire évaluer ces alternatives sans combustion, notamment le vapotage et le tabac à chauffer, dans le cadre du futur plan de lutte contre le tabac ?
Madame la sénatrice, le tabagisme a un coût très élevé pour notre société, en termes de décès prématurés, de maladies et de perte de qualité de vie.
Les mesures mises en place, notamment dans le cadre du plan national de lutte contre le tabac pour les années 2018-2022, ont tout de même permis d’amoindrir le nombre de fumeurs quotidiens de 1, 9 million entre 2014 et 2019.
S’agissant des pratiques liées, il ne faut pas confondre les produits de vapotage, avec ou sans nicotine, avec les produits de tabac à chauffer, qui suppose la combustion de bâtons de tabac par un dispositif électronique. L’argument, mis en avant par les cigarettiers, d’un moindre risque par rapport au tabac classique n’est pas étayé scientifiquement. En tout état de cause, le ministère n’y souscrit pas.
Concernant le vapotage, le HCSP conclut que cette technique n’a pas fait la preuve de son utilité dans l’aide au sevrage tabagique, un constat partagé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’exception de populations très spécifiques souffrant d’une forte dépendance et n’adhérant pas aux traitements médicamenteux qui existent par ailleurs.
Les données actuelles montrent qu’une majorité des utilisateurs des produits de vapotage continue d’ailleurs à consommer du tabac.
Enfin, elles démontrent également que le vapotage est un déterminant d’initiation ou d’usage du tabac chez les adolescents. En France, la moitié des jeunes l’ont expérimenté en 2018, contre un tiers en 2015.
Concernant la toxicité des produits de vapotage, l’Anses est chargée d’analyser la composition de ceux qui contiennent de la nicotine et d’identifier les risques liés aux substances chimiques entrant dans leur composition.
Pour le consommateur et pour son entourage, ces constats justifient le maintien du cadre français, en particulier l’interdiction de vente aux mineurs ainsi que les règles relatives à la publicité et à la promotion du vapotage.
Je sais que vous partagez notre volonté de veiller à ce que les politiques de santé publique s’appuient sur des données probantes, validées et établies sur le fondement de connaissances scientifiques.
C’est pourquoi les dispositions relatives au vapotage qui seront incluses dans le prochain plan national de lutte contre le tabac, dont l’élaboration commencera cette année, s’appuieront sur les recommandations du HCSP ainsi que sur les analyses de l’Anses.

Monsieur le secrétaire d’État, j’évoquais la possibilité d’entreprendre des études scientifiques, aussi bien françaises qu’internationales, de manière à déterminer si ces produits constituent ou non de véritables alternatives.
Je ne fume pas moi-même, mais je connais des personnes qui refusent d’arrêter de fumer. J’estime que nous devons nous efforcer d’évaluer ces alternatives scientifiquement pour ces personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, auteur de la question n° 1768, transmise à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, après le tabac, passons au chanvre !
Vous avez bien voulu, via un arrêté du 30 décembre 2021, préciser la réglementation applicable à la culture, à l’importation et à l’utilisation du chanvre. Le nouveau cadre réglementaire, que nous saluons, maintient un haut niveau de protection des consommateurs et préserve la politique ambitieuse de lutte contre les trafics de stupéfiants mise en œuvre depuis 2019, tout en permettant le développement sécurisé de nouvelles activités économiques liées à la culture et à la production industrielle d’extraits de chanvre ainsi qu’à la commercialisation de produits qui en intègrent.
En particulier, le cannabidiol (CBD) étant considéré comme un nouvel aliment, celui-ci et les denrées alimentaires en contenant ne peuvent être commercialisés sans évaluation préalable par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et sans autorisation.
Or, à ce jour, plusieurs dossiers sont en cours d’évaluation par l’EFSA. Compte tenu de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne rendue sur le sujet, de la réalité du marché et de ses contraintes actuelles, comment et dans quel délai comptez-vous clarifier la situation réglementaire concernant les compléments alimentaires qui se trouvent actuellement en zone grise ?
Des mesures transitoires peuvent-elles être envisagées pour permettre la mise en place rapide d’un cadre national pour les compléments alimentaires contenant du cannabidiol ? En effet, le chanvre est assurément un produit intéressant pour les terres agricoles pauvres.
Monsieur le sénateur de Nicolaÿ, comme vous l’indiquez, en tant que denrées alimentaires, ces compléments alimentaires sont régis par le cadre européen applicable aux nouveaux aliments. Leur commercialisation est interdite en l’absence d’une évaluation préalable et d’une autorisation délivrée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Ce cadre européen a pour but de favoriser une harmonisation maximale ; les autorités françaises ne peuvent y déroger. Il n’est donc pas possible de mettre en place, à l’échelon national, des mesures transitoires pour autoriser, même sous certaines conditions ou de manière anticipée, la commercialisation de compléments alimentaires qui contiendraient du cannabidiol.
Il va de soi que les autorités françaises sont en contact étroit avec la Commission européenne et ses partenaires quant à l’interprétation de ces règles européennes. Nous continuerons de l’être, car comme vous l’avez mentionné, certains points doivent être clarifiés. L’enjeu, important, est de garantir, à tous les égards, la santé des consommateurs français, et plus largement, européens.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 2006, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Je souhaite attirer l’attention de monsieur le secrétaire d’État sur les inégalités de cotisations qui portent préjudice aux retraités en matière de complémentaire santé.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui n’est entrée en vigueur qu’en 2016, instaure l’obligation de souscrire à une complémentaire santé d’entreprise. Depuis le 1er janvier 2016, la totalité des salariés et de leurs ayants droit bénéficient de la prise en charge par leur employeur d’une somme correspondant au minimum à 50 % du montant de leur cotisation.
Par ailleurs, ils peuvent déduire de leurs revenus imposables le montant de la cotisation personnellement supporté, dans la limite de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Je note que les travailleurs indépendants peuvent également bénéficier d’une déduction fiscale dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cependant, lorsque le travailleur arrive à l’âge de la retraite, il doit supporter la totalité de la cotisation pour sa complémentaire santé et ne peut bénéficier d’aucune déduction de cette charge sur ses revenus.
J’ai donc l’honneur de vous demander, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour que les retraités puissent également bénéficier d’une déduction fiscale sur le montant de leur cotisation de complémentaire santé.
Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, nous partageons votre souci de garantir à tous nos concitoyens un accès à une couverture complémentaire santé abordable. Cette vigilance doit sans doute être redoublée à l’égard de nos concitoyens âgés.
Toutefois, nous ne croyons pas que la déduction fiscale soit un outil adéquat, car il est fort probable que son application conduirait les organismes complémentaires à augmenter les prix. Or les retraités sont souvent captifs des contrats individuels qu’ils ont souscrits, de sorte que la déduction bénéficierait sans doute, non pas aux clients des organismes complémentaires, mais à ces organismes eux-mêmes.
Un encadrement souple des tarifs des contrats individuels souscrits par les retraités nous semble plus efficace. La loi n° 88-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Évin, impose d’ores et déjà aux organismes assureurs de maintenir les garanties des complémentaires santé des anciens salariés à un tarif encadré.
Le décret du 21 mars 2017 a consolidé cet encadrement en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans, après le départ à la retraite des salariés.
Les retraités les plus modestes peuvent, par ailleurs, accéder à la complémentaire santé solidaire. Ce dispositif remplace depuis le 1er novembre 2019 la couverture maladie universelle complémentaire et l’aide au paiement d’une complémentaire santé. Sous condition de ressources, il permet à des foyers modestes de disposer d’une complémentaire santé gratuite ou à très faible coût.
Enfin, permettez-moi de rappeler les nombreux chantiers engagés durant le quinquennat, qui visent à renforcer la lisibilité des contrats, le droit de résiliation des assurés et la concurrence entre les organismes complémentaires. Les retraités qui ont souscrit des contrats individuels en sont les premiers bénéficiaires.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de vos explications. Il n’en reste pas moins qu’il existe une inégalité au détriment des retraités en matière de complémentaire santé. J’entends votre argument relatif au risque d’augmentation des prix. Toutefois, l’inégalité subsiste, et j’espère qu’on parviendra à la réduire.

La parole est à M. Jean-Jacques Michau, auteur de la question n° 2015, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la situation particulièrement préoccupante de l’accès aux soins dans le département de l’Ariège.
En effet, ce département, comme d’autres, est touché de plein fouet par les effets d’une désertification médicale galopante qui ne cesse d’inquiéter la population, les personnels soignants et l’ensemble des élus de ce territoire. Cette pénurie de médecins conduit bon nombre d’Ariégeois à ne plus disposer de médecin référent.
En parallèle, nos hôpitaux se trouvent eux aussi en grande difficulté. C’est le cas notamment du centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC) et du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (Chiva).
S’agissant du CHAC, j’ai sollicité le ministre des solidarités et de la santé par écrit, il y a plusieurs semaines, et j’attends sa réponse.
Je souhaite évoquer avec vous les difficultés rencontrées par le Chiva et de son service d’urgences qui manque cruellement de personnel, particulièrement de médecins urgentistes.
Six médecins font défaut, ce qui a conduit la direction à fermer les urgences du site de Lavelanet. Cette situation est intolérable, car celles-ci desservent non seulement le pays d’Olmes, mais aussi des zones montagneuses, comme le Quérigut, le pays de Sault ou le Chalabrais, situées dans le département voisin de l’Aude.
Les habitants de ces zones se trouvent à plus d’une heure du service d’urgences du Chiva, ce qui augmente les risques de mortalité. C’est d’ailleurs ce que montre la récente étude réalisée par l’Association des maires ruraux de France : en milieu rural, on vit deux ans de moins qu’en ville.
Monsieur le secrétaire d’État, en ce qui concerne le département de l’Ariège, il est temps de programmer au plus vite la nécessaire réouverture des urgences du site de Lavelanet en renforçant les équipes soignantes du Chiva. On ne peut accepter qu’une partie de la population du pays d’Olmes et au-delà soit laissée sans accès aux soins d’urgence.
Monsieur le sénateur, vous vous faites l’écho de l’inquiétude qu’inspirent à nombre de nos compatriotes la démographie médicale en baisse depuis plusieurs années et les conséquences que cela emporte en termes d’accès aux soins. L’Ariège n’échappe pas à ce constat, dont le caractère rural explique sans doute le manque d’attractivité pour certains jeunes soignants, notamment les médecins.
Afin d’améliorer l’accès aux soins, l’agence régionale de santé d’Occitanie met en œuvre plusieurs mesures qui relèvent du plan Ma santé 2022, débattu dans cette enceinte, et du projet régional de santé pour la médecine de ville. En effet, la question des urgences – vous le savez bien – inclut celle des soins en amont.
S’agissant de la médecine de ville, l’agence régionale de santé a reconnu l’ensemble du département comme prioritaire du fait de la baisse de la démographie médicale que l’on observe depuis quatre ans. Grâce au futur zonage des médecins, une aide à l’installation de 50 000 euros sera proposée à tous les médecins, ainsi qu’aux dentistes, car le problème de démographie touche également les spécialistes.
Les deux établissements hospitaliers, le CHAC et le Chiva, bénéficient des dispositifs réglementaires visant à améliorer l’attractivité de l’hôpital public.
Les membres de la commission paritaire régionale interprofessionnelle d’Occitanie ont mené une réflexion dès 2018 pour développer l’attractivité du territoire, et des propositions concrètes ont été avancées en ce qui concerne l’hôpital public, dont certaines rejoignent les mesures prises dans le cadre de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
Depuis l’automne 2020, une expérimentation régionale tend à favoriser et à réguler les pratiques de remplacement médical dans les établissements publics de santé du département. Par ailleurs, les coopérations entre les professionnels de santé sont facilitées via des protocoles de délégation de tâches, dont deux nouveaux sont en cours d’instruction. L’exercice des dix-neuf maisons de santé pluriprofessionnelles que l’agence régionale de santé accompagne est un autre exemple des mesures prises afin d’améliorer l’attractivité de ce territoire.
Enfin, le développement de la télémédecine complète l’offre et réduit les contraintes géographiques auxquelles le département peut être confronté.
Grâce à ce panel de mesures, monsieur le sénateur, nous pourrons répondre aux enjeux que soulève la situation de votre territoire, que l’on retrouve aussi ailleurs dans notre pays.

Monsieur le secrétaire d’État, j’entends toutes vos considérations, mais en Ariège il y a des gens qui souffrent et que l’on met en danger. Les pompiers prennent parfois plus de trois heures pour transporter les patients jusqu’au Chiva, ce qui aggrave la situation des personnes qui ont besoin d’être secourues.
C’est à l’État qu’il revient d’aider les territoires à régler cette question.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, auteure de la question n° 1985, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la prise en charge des effets secondaires, dont les cas de myocardite et de péricardite dus au vaccin contre la covid, qui ont conduit certains adolescents et jeunes adultes en soins intensifs ou en réanimation.
Ces maladies sont certes reconnues comme effets secondaires du vaccin, mais les données sur leur fréquence et leur évolution ne sont pas accessibles, ce qui laisse les familles encore plus démunies face aux conséquences de ces pathologies.
Pourtant, il est confirmé que pour les moins de 18 ans et les jeunes adultes, la vaccination, dans la mesure où elle vise à protéger des formes graves de la maladie et à réduire la tension hospitalière, n’a pas de sens, car ceux-ci ne sont concernés ni par l’un ni par l’autre de ces objectifs.
De plus, passe sanitaire puis vaccinal oblige, ils sont plus de 4 millions à être vaccinés, sans surveillance des effets secondaires. L’étude EPI-PHARE sur le sujet s’arrête au 20 juillet dernier, alors que les jeunes n’ont été incités à se faire vacciner que depuis la mise en place du passe sanitaire, le 9 août dernier. Elle n’est donc pas fiable.
En revanche, les données du système de pharmacovigilance américain Vaers (Vaccine A dvance E vent R eporting S ystem) font état de chiffres préoccupants. Pour l’année 2021, elles recensent 499 cas de myocardite chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans, contre seulement 16 cas les années précédentes.
Nous ne pouvons pas ignorer que les bénéfices du vaccin sont quasi nuls pour cette partie de la population, alors que les risques sont en revanche bien réels.
Les problèmes cardiaques chez les jeunes pourront avoir des conséquences invalidantes dans leur vie quotidienne, alors qu’ils étaient en parfaite santé. Quelle sera la suite ? Ils ne peuvent plus faire de sport, ils souffrent d’une fatigue inhabituelle et invalidante et présentent des risques de séquelles nécessitant des contrôles réguliers au moyen d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les conséquences peuvent être dramatiques et constituer un grave préjudice pour leur scolarité, leur santé mentale et, au-delà, pour leur avenir.
Monsieur le secrétaire d’État, les familles m’interrogent et s’inquiètent. Ma question est donc la suivante : par quels moyens ces jeunes seront-ils pris en charge et accompagnés à moyen et long terme ?
Madame la sénatrice, nous avons tous, quel que soit notre âge, besoin d’être protégés contre le virus, car même des enfants en bas âge se trouvent hospitalisés ou en réanimation. Le nombre de cas est, fort heureusement, très réduit, mais aucun parent, père ou mère, ne souhaite voir son enfant hospitalisé.
L’incidence de la myocardite se situe entre un et dix cas pour 100 000 personnes par an. Le risque le plus élevé concerne les hommes âgés de 18 à 30 ans, plus particulièrement les individus actifs et en bonne santé. Il est à noter que l’infection naturelle au covid-19 peut elle-même provoquer des myocardites chez les sujets infectés. Selon l’agence américaine de santé publique, le risque de développer une myocardite après une infection au covid-19 est de l’ordre de 146 cas pour 100 000 personnes.
D’après le rapport du comité d’évaluation des risques en pharmacovigilance, les myocardites et les péricardites sont considérées comme un effet indésirable pouvant survenir très rarement à la suite de l’injection d’un vaccin à ARN messager contre la covid.
La vaccination par ce type de vaccin est associée chez les personnes âgées de 12 à 50 ans à une légère augmentation des risques de myocardite et de péricardite, dans les sept jours qui suivent la vaccination, pouvant entraîner des hospitalisations.
Le risque de myocardite apparaît plus marqué chez les jeunes hommes âgés de moins de 30 ans, notamment après qu’ils ont reçu la deuxième dose de vaccin et lorsque celui-ci est de la marque Moderna.
Toutefois, le nombre de cas attribuables au vaccin apparaît peu fréquent au regard du nombre de doses administrées – je rappelle que, à ce jour, plus de 120 millions de doses ont été injectées en France.
L’évolution clinique des cas de myocardite et de péricardite post-vaccinales apparaît généralement favorable, la durée d’hospitalisation étant de deux à quatre jours en moyenne.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) recommande à toute personne venant de se faire vacciner et présentant des symptômes, tels qu’un essoufflement, des douleurs dans la poitrine, des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier, de consulter rapidement un médecin.
En conclusion, la myocardite consécutive à la vaccination anti-covid est rare, et le risque est beaucoup plus faible que pour les myocardites liées à l’infection naturelle par le SARS-CoV-2. À ce jour, les données de pharmaco-épidémiologie ne remettent pas en cause le rapport bénéfices-risques des vaccins à ARN messager contre la covid-19.

La parole est à Mme Sonia de La Provôté, auteure de la question n° 2019, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation du centre hospitalier de Lisieux et j’associe à cette question, une fois n’est pas coutume, ma collègue députée Nathalie Porte.
Le service de médecine interne du centre hospitalier de Lisieux doit désormais fusionner avec le service de gastroentérologie par manque de médecins. Quelque 25 lits seront fermés, soit 10 % de la capacité de l’hôpital.
L’été dernier, les urgences de nuit ont fermé pendant trois semaines. La semaine dernière, les urgences pédiatriques ont fermé partiellement, avec pour conséquence la perte de 3 lits de néonatologie. Le centre hospitalier de Lisieux est pourtant l’hôpital référent pour l’accueil local des enfants prématurés.
Depuis juillet 2020, on dénombre au total une perte de plus de 30 lits, de sorte qu’il n’en reste plus que 255. Malheureusement, la tendance se poursuit et d’autres services sont sous la menace d’une réorganisation du fait des départs à la retraite, notamment en pneumologie et en réanimation.
Certes la crise sanitaire a des conséquences lourdes en termes de ressources humaines, mais elle n’explique pas tout, car seuls 3 lits de réanimation sont occupés par des patients atteints du covid.
Récemment, l’ARS a proposé des réponses conjoncturelles comme le report de congés, la majoration des émoluments ou la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires. Or le plan blanc doit rester un dispositif d’urgence et ne peut, par nature, devenir pérenne.
Tout le monde le sait et vous aussi, monsieur le secrétaire d’État, le problème est structurel. Au-delà du centre hospitalier de Lisieux, partout, l’hôpital public est confronté au même problème. En atteste constitution d’une commission d’enquête sénatoriale sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France, dont les travaux sont en cours.
Au-delà des murs, au-delà même des moyens dégagés par le Ségur de la santé, aussi importants soient-ils, c’est dans l’humain qu’il faut investir, dans les médecins et les soignants.
Qu’est-il prévu, monsieur le secrétaire d’État, pour améliorer le fonctionnement du centre hospitalier de Lisieux, le plus rapidement possible, car il est indispensable aux habitants ? Il faut fixer des objectifs en matière de calendrier, de chiffres et de montants.
Madame la sénatrice, le centre hospitalier de Lisieux connaît en effet des difficultés de recrutement médical, qui l’ont conduit à adapter temporairement l’organisation de ses activités, pour garantir la sécurité des prises en charge tout en assurant la gestion de l’épidémie, tant pour les soins que pour la vaccination.
En lien avec le CHU de Caen, l’unité de formation et de recherche (UFR) Santé et l’ARS, il mène une politique active pour stabiliser les équipes médicales et assurer leur renouvellement.
Un certain nombre de mesures ont été prises, dont la proposition faite aux jeunes médecins d’effectuer un post-internat, notamment en temps partagé avec le CHU, l’ouverture de postes d’internes pour faire connaître l’établissement aux jeunes qui sont en formation, l’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne, la création d’un vivier de remplaçants et la mise en place de la prime de solidarité territoriale pour inciter les praticiens hospitaliers à consacrer une partie de leur temps de travail à des remplacements.
Le centre hospitalier de Lisieux occupe une place essentielle au sein du groupement hospitalier de territoire Normandie Centre. C’est la raison pour laquelle l’établissement compte parmi les plus soutenus de la région, au titre du Ségur.
Il bénéficiera ainsi d’une aide de l’État d’un montant de 26 millions d’euros afin d’assurer la pérennité de son offre de soins et de renforcer son attractivité. Un projet de modernisation et de mise aux normes impliquant le réaménagement de son bâtiment principal d’hospitalisation pourra ainsi être conduit. De plus, 11 millions d’euros lui seront alloués afin de restaurer ses capacités financières et de garantir ainsi une reprise durable de l’investissement courant.
Par ailleurs, l’investissement de l’agence régionale de santé auprès du centre hospitalier de Lisieux s’inscrit dans la durée. Une aide de 1, 3 million d’euros accompagnera le projet de reconstruction du service d’urgences. Des investissements du quotidien à hauteur de 700 000 euros, en 2021, ont déjà permis de financer des verticalisateurs, des brancards, des fauteuils de dialyse, entre autres matériels. L’établissement a également reçu un soutien de 2 millions d’euros en crédits non reconductibles pour faire face à des difficultés de trésorerie.
Un travail global est en cours qui porte véritablement sur la qualité des soins et sur l’activité professionnelle.

Monsieur le secrétaire d’État, merci de votre réponse, mais le plus bel hôpital du monde ne soignera bien que s’il dispose de soignants à l’intérieur. Même si l’investissement est important, le véritable sujet reste celui du fonctionnement.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 1833, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la revalorisation des visites à domicile pour SOS Médecins.
L’avenant n° 9 à la convention médicale, négocié entre la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et les syndicats de médecins libéraux, a abouti à l’été 2021 à la revalorisation des visites à domicile, mais SOS Médecins a été étrangement exclu du dispositif.
Pourtant, la visite à domicile est dans l’ADN de SOS Médecins, qui organise une permanence de soins depuis 1966, en activité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, qui reçoit 6 millions d’appels par an, générant 3 millions d’actes, et qui regroupe 1 300 médecins.
Si des négociations ont effectivement débuté à l’automne dernier pour la revalorisation du forfait pour la permanence des soins ambulatoires, elles n’ont en réalité, pour l’heure, toujours pas abouti. Entre-temps, trois associations de SOS Médecins ont dû fermer dans le Rhône, par manque d’effectifs.
Dans mon département des Alpes-Maritimes, SOS Médecins Nice accomplit ses missions avec seulement deux médecins sur six ; SOS Médecins Cannes ne réalise plus de visite certains jours ; SOS Médecins Antibes n’accomplit plus de garde la nuit.
Alors que le système de santé de ville est embouteillé, entraînant une raréfaction de la visite à domicile, celle-ci reste pourtant essentielle pour les premières urgences, pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et celles souffrant de pathologies lourdes.
Monsieur le secrétaire d’État, où en sont les négociations avec la CNAM sur la revalorisation de la visite à domicile ? Qu’entendez-vous mettre en œuvre pour pérenniser SOS Médecins à l’échelle nationale ? Que propose le Gouvernement pour mieux articuler l’activité de consultation et les visites à domicile, afin d’attirer de nouveaux médecins ?
Madame la sénatrice, l’intervention de professionnels de santé à domicile est un enjeu majeur, dont vous avez dessiné les contours. Elle est essentielle pour les personnes en perte d’autonomie et pour prévenir la dépendance, sujet dont on sait l’importance pour l’avenir de notre société.
C’est pourquoi le Gouvernement a demandé à l’assurance maladie de conclure un nouvel accord avec les médecins libéraux. L’avenant n° 9, signé l’été dernier par les syndicats de médecins de ville, prévoit le doublement de la rémunération des visites à domicile effectuées par les médecins traitants, passant de 35 euros à 70 euros pour le suivi des personnes âgées de plus de 80 ans souffrant d’une affection de longue durée (ALD). Il s’agit là d’un investissement de près de 150 millions d’euros dans la visite à domicile.
Je souhaite saluer, à cette occasion, l’engagement des médecins pour répondre à la demande de soins urgents de nos concitoyens.
Organiser cette réponse, tel est l’objectif du service d’accès aux soins (SAS) proposé dans le cadre du pacte de refondation des urgences et réaffirmé lors du Ségur de la santé. Il s’agit de répondre à la demande de soins urgents de la population, partout, à toute heure, grâce à une chaîne de soins qui soit lisible et coordonnée entre les acteurs de santé de l’hôpital et de la ville – vous savez, en effet, que la question des urgences va bien au-delà des seules urgences.
Les médecins libéraux de SOS Médecins ont toute leur place au sein du SAS et bénéficieront pleinement des financements prévus par l’avenant n° 9.
Je rappelle qu’à la fin du mois de décembre dernier, un arrêté a revalorisé de 20 % les astreintes effectuées par les médecins dans le cadre de la permanence des soins.
En outre, dans la perspective des travaux de la future convention médicale, la CNAM a proposé à SOS Médecins d’établir un « groupe contact » pour identifier les enjeux liés à cette nouvelle convention, qui pourront concerner SOS Médecins et la visite à domicile.
Enfin, le ministre Olivier Véran a demandé aux agences régionales de santé de soutenir les associations de médecins qui organisent la réponse médicale non programmée à domicile. Plus de 5 millions d’euros ont ainsi été débloqués à cet effet.
Nous sommes donc mobilisés pour répondre aux attentes du secteur sur l’ensemble de ces problématiques.

À ce jour, cette mobilisation reste encore insuffisante. SOS Médecins est débordé et contraint de limiter le nombre d’appels.
Le système tourne en rond, la visite à domicile est véritablement en danger et il est indispensable de lui redonner sa juste place dans le parcours de soins des patients.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1911, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous interpeller au sujet de la disparition administrative de l’enfant défunt et du statut administratif de ses parents.
En effet, en France, lorsqu’un enfant décède, l’administration le supprime des formulaires administratifs, pour lesquels seuls comptent les enfants à charge, que ce soit pour les caisses d’allocations familiales, pour la sécurité sociale ou pour les impôts, et cela, même si son nom reste visible avec la mention « décédé » sur les écrans des agents.
Cet effacement est inapproprié, voire irrespectueux, pour de nombreux parents, qui souhaitent que l’administration laisse le nom de leur enfant décédé visible sur les dossiers administratifs et rétablisse leur composition familiale.
Il suffirait pour cela de créer une ligne administrative pour faire figurer les nom et prénom de l’enfant tout en spécifiant « non à charge » ou « décédé ». Une place pour l’enfant défunt serait ainsi conservée, et le parent d’un enfant unique décédé serait reconnu comme ayant été un parent.
Alors que la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 a accordé aux parents d’un enfant né sans vie le droit de lui donner un nom, ce souhait d’autres pères et mères, eux aussi touchés par le deuil, de ne plus effacer les enfants décédés sur les dossiers administratifs paraît légitime.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, entendez-vous œuvrer contre l’absence de trace administrative de l’enfant défunt et celle de statut administratif de ses parents ?
Monsieur le sénateur, je suis personnellement très investi sur ce sujet, en tant que secrétaire d’État à l’enfance et aux familles et pour avoir pris part aux discussions avec les organisations syndicales et, surtout, avec les associations de parents, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de votre collègue député Bricout visant à instaurer un congé de deuil parental – l’expression est impropre.
À l’occasion de mes rencontres avec les associations de parents, j’ai pu comprendre ce qui relève en réalité de l’évidence, à savoir que l’on reste parent même après la mort de son enfant. C’est une évidence, et pourtant jamais je n’avais entendu personne la formuler de manière aussi éclatante.
C’est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de dispositions pour accompagner les familles endeuillées par le décès d’un enfant, parmi lesquelles l’allongement de ce « congé de deuil » pour lequel il faudrait trouver un autre nom, la création d’une allocation forfaitaire pour toutes les familles, d’un montant de 2 000 euros, qui met fin aux disparités territoriales en fonction des politiques des caisses d’allocations familiales, un meilleur accompagnement psychologique non seulement des parents, mais aussi des fratries, trop souvent oubliées dans ces situations, ou encore la mise en place d’un « parcours décès » visant à améliorer l’accompagnement des familles dans l’ensemble de leurs démarches par les travailleurs sociaux.
L’enjeu se situe également au niveau des entreprises, car les employeurs et les salariés doivent être davantage sensibilisés à ce genre de situations, afin de pouvoir accompagner leurs collègues concernés.
Dans le cadre des discussions que nous avons eues, les familles endeuillées nous ont fait part d’insuffisances dans la prise en compte de leur situation, notamment d’une certaine complexité dans le parcours administratif, par la demande répétée de mêmes informations et de toute sorte de détails dont on ne perçoit pas la violence quand on ne vit pas soi-même ce type de situation.
Monsieur le président, je risque de dépasser le temps de parole sur ce sujet important et je vous prie par avance de m’en excuser.
Avec Amélie de Montchalin, nous avons missionné en mars dernier la direction interministérielle de la transformation publique pour travailler sur les parcours administratifs des parents endeuillés, avec pour objectif d’identifier des points de simplification et d’amélioration. Un plan d’action nous a été présenté en juin 2021. Il appartient désormais aux acteurs concernés – les CAF, mais aussi les services des impôts et l’ensemble des administrations – de le mettre en œuvre.
Un premier point d’étape a été réalisé en octobre dernier, au cours duquel la question la disparation administrative a été évoquée. Les échanges font apparaître la nécessité de pouvoir s’adapter aux situations particulières, …
Je conclus en vous disant que la mention « décédé » sera intégrée dans les choix d’options lors de l’élaboration des formulaires administratifs.
Je me tiens à votre disposition pour poursuivre cet échange, si vous le souhaitez, monsieur le sénateur.

Je ne prendrai que quelques secondes pour remercier M. le secrétaire d’État des avancées qui sont en cours.

La parole est à Mme Véronique Guillotin, auteure de la question n° 2053, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, cette question intervient à la suite d’une proposition de l’Association des maires ruraux de France, au sujet du forfait de participation aux urgences du patient. Mis en place depuis le 1er janvier 2022, celui-ci prévoit l’acquittement d’une somme forfaitaire de 19, 61 euros pour chaque passage aux urgences sans hospitalisation.
Quelques exonérations sont possibles, notamment pour les femmes enceintes, pour les bénéficiaires de pension d’invalidité ou encore pour les nourrissons. D’autres patients peuvent se voir attribuer le montant minoré de 8, 49 euros, comme les personnes souffrant d’une affection de longue durée.
Lors du vote du forfait patient urgences (FPU), à la fin de 2020, je vous avais fait part de mes réticences. En effet, faute de mesures complémentaires et sans un accès aux soins performant en amont des urgences, ce forfait ne remplira pas son rôle de désengorgement des urgences.
Ces montants sont certes intégralement remboursés par les complémentaires santé, mais 5 % de la population n’en possèdent pas.
Cette difficulté s’ajoute dans de nombreux cas à celle de la désertification médicale, qui touche malheureusement de nombreux Français.
Comme le souligne très justement l’Association des maires ruraux de France, les urgences sont pour nombre de nos concitoyens le seul recours en l’absence d’un médecin généraliste déclaré. Or, selon l’assurance maladie, plus de 5 millions de Français n’ont pas de médecin traitant et ce chiffre a plutôt tendance à s’aggraver qu’à s’améliorer.
Des mesures ont été engagées par le Gouvernement pour y remédier, que j’ai majoritairement soutenues parce qu’elles étaient nécessaires. Cependant, à l’instar de l’augmentation du numerus clausus, elles mettront du temps à porter leurs fruits.
Ce nouveau forfait ne doit pas être perçu comme une double peine pour ceux qui éprouvent déjà des difficultés à se faire soigner et qui n’ont pas ou plus de médecin traitant référent, faute de praticien de proximité.
Ma question est simple : le ministère envisage-t-il de réexaminer ces critères d’exclusion du forfait de participation aux urgences et d’exonérer de cette contribution les patients qui ne trouvent pas de médecin traitant ? Ce ne serait, selon moi, qu’une mesure de bon sens et de justice.
Madame la sénatrice Véronique Guillotin, je vous remercie de m’offrir l’occasion de m’exprimer de nouveau sur cette question. Nous partageons votre préoccupation, et c’est pourquoi nous veillons à garantir l’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire.
Permettez-moi de rappeler que les assurés acquittaient déjà une participation au titre de leur passage aux urgences. Le forfait patient urgences n’augmente pas les restes à charge des patients, notamment ceux résidant dans les communes rurales. Ce nouveau dispositif simplifie néanmoins les modalités de calcul, en prévoyant, non plus un ticket modérateur proportionnel à l’intensité de la prise en charge, mais une participation forfaitaire.
Cette forfaitisation offre une meilleure protection des usagers nécessitant des soins complexes – leur participation pouvait atteindre auparavant un montant de 60 euros.
Le forfait patient urgences est pris en charge par les complémentaires santé : la question des restes à charge est donc davantage liée à l’accès aux mutuelles. Comme vous le savez, seuls 4 % des assurés n’en disposent pas.
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour faciliter le recours à ces organismes, notamment à la complémentaire santé solidaire, destinée aux assurés les plus précaires, comme en témoignent les mesures adoptées par le Sénat dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
La qualité et la sécurité du parcours de soins des patients ne sont pas altérées par la mise en place du forfait patient urgences : l’accès aux urgences est toujours possible pour les patients qui ne disposent pas de leur carte Vitale ou de leur pièce d’identité, de même que pour ceux ayant des difficultés à consulter un médecin en ville.
Bien sûr, il nous faut continuer à agir pour un meilleur accès aux soins de tous les patients : c’est là une priorité constante du Gouvernement.
En tout état de cause, durant ces quatre dernières années nous avons essayé de résoudre ensemble les difficultés structurelles que vous évoquez : nous avons ainsi encouragé le développement de l’exercice coordonné de la médecine, grâce à la mise en œuvre des communautés professionnelles territoriales de santé, et nous avons favorisé la création de postes d’assistants médicaux, le déploiement de 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires ainsi que la mise en place du service d’accès aux soins. Nous continuerons à déployer l’ensemble de ces mesures.

La parole est à Mme Laurence Garnier, auteure de la question n° 2014, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur le parc éolien des Quatre Seigneurs, situé sur le territoire des communes de Nozay, Puceul, Abbaretz et Saffré, au nord de la Loire-Atlantique.
Depuis plusieurs années, des éleveurs ont signalé des problèmes de santé touchant leurs animaux : plusieurs d’entre eux sont morts, tandis que d’autres souffrent de mammites, engendrant des baisses très nettes de la production de lait.
De plus, certains riverains du site ont fait état de troubles de santé tels que des maux de tête ou des troubles du sommeil.
Prenant acte de ces difficultés, le ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture ont demandé à l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de réaliser une enquête. Selon les conclusions de celle-ci, publiées le mois dernier, un lien entre l’implantation des éoliennes et les difficultés rencontrées par les éleveurs apparaît hautement improbable, voire exclu.
Pourtant, l’Anses ne conteste pas les difficultés et les troubles de santé, bien réels, constatés sur le territoire.
De quelle manière envisagez-vous d’approfondir les recherches, monsieur le secrétaire d’État ?
L’Anses suggère la création d’un observatoire recensant toutes les perturbations liées à la présence d’éoliennes à proximité des élevages. Pensez-vous suivre cette recommandation de l’Agence ? Sinon, quel dispositif comptez-vous mettre en place ?
Sur place, les éleveurs et les riverains du site, de même que les maires et les élus locaux, attendent des réponses. Plus largement, nous avons tous besoin de comprendre ce qui se passe sur ce site, car cette situation alimente les inquiétudes et les doutes suscités par le développement du parc éolien français. Je vous remercie par avance de vos réponses, monsieur le secrétaire d’État.
Madame la sénatrice, je souhaite en préambule revenir sur l’ensemble des conclusions – récentes ou plus anciennes – établies au sujet du parc éolien des Quatre Seigneurs et des troubles touchant les bovins rapportés par deux éleveurs.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail avait été saisie par le Gouvernement en mai 2019 ; elle a rendu son avis le 16 décembre dernier, concluant que les troubles rencontrés ne sont très probablement pas liés à la présence des éoliennes.
Les conséquences de l’implantation de parcs éoliens sur la santé humaine ont fait l’objet de plusieurs expertises. La dernière porte plus particulièrement sur le bruit émis par ces dispositifs.
Dans un avis rendu en 2017, l’Anses précisait que les données disponibles ne mettaient pas en évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires qui seraient liés à l’exposition aux infrasons et aux basses fréquences émis lors du fonctionnement des éoliennes.
Par ailleurs, dans son rapport de 2017, l’Académie nationale de médecine indiquait que les nuisances sanitaires des éoliennes terrestres semblent avant tout d’ordre visuel et, à un moindre degré, sonore.
Sachez par ailleurs qu’une étude épidémiologique est en cours, madame la sénatrice : il s’agit du projet de recherche sur les impacts du bruit éolien sur l’humain, dit RIBEolH, mené par l’université Gustave-Eiffel, qui a pour objectif d’étudier les effets sur la santé du bruit émis par les éoliennes. Une étude psycho-acoustique et physiologique sera menée afin de comprendre les mécanismes auditifs qui sont associés à la gêne due aux infrasons.
Les résultats de cette étude, attendus pour 2025, devraient apporter des éléments scientifiques complémentaires au sujet des effets de l’éolien sur la santé humaine. Nous disposerons ainsi de données complètes et vérifiées.

La parole est à M. Patrice Joly, auteur de la question n° 2050, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, depuis le 2 octobre 2018, le projet régional de santé arrêté par l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté a confié au CHU de Dijon la régulation médicale des appels au centre 15, afin de « garantir à la fois la qualité de la régulation des appels d’urgence et un renfort à distance des équipes médicales d’urgence nivernaises par les équipes du CHU de Dijon ».
Trois ans plus tard, nous disposons du recul nécessaire pour évoquer les nombreux dysfonctionnements résultant de ce transfert, dont les Nivernais sont malheureusement victimes.
Les personnels et les élus, que j’ai consultés, sont unanimes.
Tout d’abord, ils nous ont tous fait part des grandes difficultés rencontrées par les Nivernais pour joindre le centre 15 de Dijon, très engorgé, parfois injoignable et n’offrant régulièrement aucun accès à un médecin urgentiste régulateur.
De plus, ils ont constaté que les délais d’intervention se sont allongés en raison d’imprécisions dans les informations transmises du fait d’une méconnaissance du territoire – erreurs dans les adresses communiquées, méconnaissance des hôpitaux de proximité pouvant accueillir les victimes, incohérences dans les données médicales fournies.
Ces retards sont susceptibles d’entraîner des pertes de chance et, pour certains, constituent d’ores et déjà la cause d’un certain nombre de décès qui auraient pu être évités.
Les situations au cours desquelles les pompiers se retrouvent totalement seuls face aux victimes se multiplient : ils doivent alors prodiguer des soins en l’absence de médecins urgentistes, qu’ils attendent en vain, ou composer entre les instructions parfois contradictoires du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre et du centre 15.
Enfin, on observe également des difficultés de régulation entre les ambulances privées et les pompiers, difficultés qui compromettent encore la rapidité des interventions et entraînent une plus forte mobilisation des pompiers.
Vous l’aurez compris, cette situation participe d’un sentiment d’abandon et d’insécurité de la population nivernaise, qui se sent une nouvelle fois isolée et fragilisée sur le plan de la santé. De plus, les pompiers volontaires sont démotivés.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle analyse faites-vous de ces difficultés ?
Monsieur le sénateur, le regroupement de la régulation médicale des appels au centre 15 de la Nièvre et de la Côte-d’Or visait à répondre au constat récurrent de dysfonctionnements graves – je pense que nous pourrons nous rejoindre sur ce point.
Il a été réalisé dans la concertation avec l’ensemble des acteurs de l’urgence sur le terrain et grâce à l’engagement remarquable des équipes du CHU de Dijon. La réussite de ce travail partenarial a d’ailleurs été saluée au mois d’octobre 2020 par le président du conseil d’administration du SDIS de la Nièvre lui-même, ainsi que par le président de l’association départementale des transports sanitaires urgents de la Nièvre.
Loin de concourir, comme vous l’avez indiqué, à un « abandon » de la population nivernaise, cette nouvelle organisation place directement les équipes du CHU de Dijon au service des Nivernais. Elle garantit la plus stricte égalité de la qualité de la régulation médicale des appels d’urgence – que ces appels proviennent du cœur du Morvan ou du centre-ville de Dijon.
J’ajoute que le centre 15 du CHU de Dijon fait partie des vingt-deux sites pilotes nationaux qui ont été retenus pour déployer le service d’accès aux soins : les habitants de la Nièvre bénéficieront ainsi de la primeur de ce nouveau service.
Enfin, le projet régional de santé arrêté par l’agence régionale de santé prévoit une évaluation externe et approfondie de ce regroupement, portant sur toutes les dimensions de la transformation. Engagée depuis la fin de l’année dernière, cette évaluation associe un nombre important d’acteurs de terrain – je crois que vous y êtes vous-même associé, monsieur le sénateur, ou, qu’en tout cas, vous avez été invité à participer à ces travaux.
Je ne peux que vous encourager à y prendre part et à poursuivre le dialogue avec l’agence régionale de santé afin d’évaluer cette réorganisation sur des bases techniques, précises et objectives : nous souhaitons tous améliorer la qualité du service rendu aux Nivernais, quelle que soit leur localisation.

Je participerai prochainement à cette évaluation. Vos propos, monsieur le secrétaire d’État, laissent à penser qu’en théorie les choses fonctionnent bien. Mais ce qui se passe dans la Nièvre ne correspond pas à la situation du pays imaginaire que vous avez décrite.

La parole est à Mme Laurence Rossignol, auteure de la question n° 2058, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO).
La population de ce bassin de vie voit depuis très longtemps l’état de son groupement hospitalier se dégrader, et cette dégradation s’est encore accélérée depuis le début de la crise sanitaire.
La désertification de la médecine de ville et la fusion des sites hospitaliers de Senlis et de Creil, imposée par les autorités sanitaires, ont créé les conditions d’un basculement sans retour lorsque l’épidémie est apparue.
La diminution du nombre de lits d’hôpitaux, les transferts de compétences incompréhensibles, les fermetures de services par souci d’économie de façade, comme pour la maternité, ou par manque de personnel, comme pour le service de cardiologie ainsi que l’envoi du personnel d’un site à l’autre – et donc d’une ville à l’autre : Creil et Senlis sont deux villes distantes d’une dizaine de kilomètres ! – en fonction des urgences ont entraîné la fuite des personnels épuisés par leurs conditions de travail et ont plongé les habitants de ce bassin de vie dans une grande précarité sanitaire – une précarité supplémentaire dont ils n’avaient pas besoin !
Durant l’été 2021, le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a été suspendu – de manière temporaire heureusement – en raison du manque de ressources médicales. Durant les fêtes de fin d’année, le service des urgences de Senlis a été fermé à son tour.
La fusion des maternités devait permettre de créer une « super maternité » à l’échelle de l’agglomération. Or le nombre d’accouchements a chuté de 30 %, puisque les femmes se déplacent désormais vers le nord de l’Oise et choisissent des cliniques privées, ou se rendent directement en Île-de-France.
Un plan de relance a été annoncé récemment, de même que le recrutement d’un nouveau directeur – l’intérim étant assuré par le directeur de l’hôpital de Beauvais.
Tel est le contexte dans lequel s’inscrivent mes questions.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle sera la feuille de route de la nouvelle équipe ? Sera-t-elle en mesure de mener l’exécution des travaux du dernier étage de l’hôpital ? Quand le nouveau matériel promis aux équipes arrivera-t-il ?
La ville de Creil est devenue délégataire de service public de l’État en matière de dépistage et de vaccination. La totalité des frais engagés depuis le début de l’épidémie de covid-19 lui sera-t-elle remboursée ?
Le moratoire sur la dette de l’hôpital attendu de longue date sera-t-il mis en place ?
Enfin, envisagez-vous la réouverture de la maternité de Creil ?
Madame la sénatrice, votre question dense et précise appelle une réponse de même teneur !
La feuille de route adressée au nouveau directeur par intérim porte notamment sur deux chapitres : d’une part, la situation aux urgences, et, d’autre part, la rédaction du projet stratégique et médical.
Permettez-moi de rappeler que l’ARS est intervenue spécifiquement sur le service d’accueil des urgences : une délégation de personnes-ressources expertes a travaillé dès le mois de novembre 2021 avec les équipes de l’établissement pour proposer une organisation sécurisée des urgences et du SMUR de Creil.
L’ARS conduit d’ailleurs une réflexion sur l’organisation globale du GHPSO ; elle mettra à la disposition du directeur par intérim les moyens et l’expertise nécessaires pour poursuivre la réflexion sur les restructurations indispensables à court et moyen terme.
Le projet médico-soignant constitue l’outil pour parvenir à ces objectifs. Il devra formaliser les filières intrahospitalières de prise en charge des patients en aval des urgences, ainsi qu’entre les sites de Creil et de Senlis. Par ailleurs, il devra consolider le schéma directeur des investissements pour engager la modernisation tant attendue des établissements, notamment des derniers étages du site de Creil.
Les premiers travaux préfigurateurs ont été menés : ils doivent être poursuivis par les instances pour finaliser le projet. Il convient de ne pas perdre de vue que le projet architectural doit être au service du projet médical et non le contraire. Je rappelle d’ailleurs qu’une aide de 35 millions d’euros, au titre des investissements structurants, a été prévue pour ce projet.
Il sera également nécessaire de porter une attention particulière à la filière gériatrique du territoire, eu égard aux caractéristiques de la population, que vous connaissez bien.
Il conviendra en outre de constituer le dossier de présentation du projet au dispositif du Ségur de la santé, au titre du soutien aux investissements prioritaires – la clé de voûte de la nouvelle gouvernance du GHPSO.
En lien avec les acteurs locaux, celle-ci devra notamment consolider les coopérations avec les centres hospitaliers du territoire et rechercher des partenariats indispensables avec les professionnels de santé de ville pour faciliter et développer l’ensemble des parcours de soins.
Concernant les surcoûts, l’établissement a indiqué que la compensation couvrait les charges engagées.
Enfin, un éventuel moratoire sur la dette n’est pas du ressort de l’ARS ou de l’établissement : ce dernier est contraint de rembourser ses prêts, sous peine d’être fiché à la Banque de France et d’être déclaré interdit bancaire.
Tels sont les premiers éléments de réponse que je souhaitais porter à votre connaissance, madame la sénatrice.

La parole est à M. Christian Bilhac, auteur de la question n° 2030, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la question de la responsabilité pénale des maires, des présidents d’intercommunalités et des présidents de conseils départementaux qui salarient des médecins.
Face à la pénurie de médecins en milieu rural ou hyper-rural, de nombreuses collectivités choisissent en effet de recruter des médecins salariés pour pallier l’absence de médecins libéraux. Ainsi, en Occitanie, le conseil régional a décidé de lancer un plan de soutien aux collectivités pour lutter contre les déserts médicaux.
Bien que ces médecins soient employés par une collectivité territoriale, leurs salaires sont généralement indexés sur ceux de la fonction publique hospitalière – c’est le cas par exemple en Saône-et-Loire dans le centre médical départemental. Ils disposent ainsi d’un régime de rémunération différent de tous les autres employés territoriaux.
Il semble par ailleurs déraisonnable que les médecins salariés des centres de santé territoriaux soient assujettis aux mêmes contraintes et aux mêmes lois que ceux exerçant dans des hôpitaux publics, eu égard à la différence de moyens, de matériel et d’encadrement existant entre les deux systèmes.
Ces médecins ont dès lors un statut ambigu, car ils répondent aux contraintes et devoirs spécifiques relatifs à la profession médicale, notamment à la prise en charge des patients, mais ils sont également soumis aux mêmes règles que n’importe quel agent territorial.
Bien que responsable des actes de tous ses agents, comme le prévoit l’article L. 121-3 du code pénal, l’employeur public se trouve face à un agent qui possède des caractéristiques spécifiques et des compétences que lui-même ne maîtrise pas. Tous les maires ne sont pas médecins !
Nombre d’entre eux s’interrogent : leur responsabilité pénale pourrait-elle être engagée en cas de problème lié à cette activité ? Un délai trop long d’intervention, une erreur de diagnostic ou encore un manque de moyens du cabinet médical pourraient-ils être invoqués ? Madame la ministre, pouvez-vous rassurer les maires ?
Monsieur le sénateur Christian Bilhac, comme vous le soulignez, l’accès aux soins pour tous et sur tout le territoire, notamment en milieu rural, est au cœur des préoccupations des Français. Dans le cadre de la stratégie Ma santé 2022, le Gouvernement a engagé une réforme des soins de proximité visant à y répondre.
Pour faire face à des besoins spécifiques sur leur territoire, les collectivités et leurs groupements peuvent recruter, au sein notamment des centres de santé dont elles sont gestionnaires, des médecins généralistes salariés. Les conditions de recrutement et d’emploi seront précisées notamment par les articles 33 et 34 du projet de loi 3DS.
En principe, la responsabilité pénale peut être recherchée à l’égard des professionnels de santé, des établissements et des services et organismes de santé.
La responsabilité pénale d’un professionnel de santé peut en effet être recherchée dans le cas où il est l’auteur direct d’une infraction par commission d’une faute ou d’un manquement qui se trouve directement à l’origine du dommage, ou dans le cas où il est l’auteur indirect d’une infraction par commission d’une faute ou d’un manquement qui a contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage.
Par ailleurs, certains délits susceptibles d’engager la responsabilité pénale d’un professionnel de santé sont totalement indépendants de toute notion de dommage, comme la mise en danger d’autrui.
Toutefois, dans le cas que vous évoquez, il semblerait qu’aucune jurisprudence n’ait, à ce jour, admis la responsabilité pénale d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du fait d’une faute commise par un professionnel de santé salarié de la commune ou de l’EPCI.
En effet, la responsabilité pénale est personnelle, comme le prévoit l’article L. 121-1 du code pénal aux termes duquel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». C’est donc bien la responsabilité pénale du professionnel de santé qui sera recherchée en premier lieu.

La parole est à M. Éric Gold, auteur de la question n° 2039, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, nous voici en plein cœur de l’hiver et, dans certaines régions, la neige a fait son apparition depuis déjà plusieurs semaines, parfois de manière très abondante.
L’entretien des routes communales faisant partie des attributions des mairies, les services municipaux ont pour obligation d’assurer le déneigement des voies. Or cette mission est considérée comme une dépense de fonctionnement, et non d’investissement, ce qui ne la rend pas éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Comme le balayage, le déneigement est assimilé à une dépense visant à assurer des conditions normales de circulation, et non comme un travail d’entretien et de réparation de la voirie. Les communes ne peuvent donc pas l’imputer sur le compte « entretien et réparation – voirie » créé en 2016, qui permet d’identifier les dépenses d’entretien de la voirie éligibles au FCTVA.
Certes, ces opérations bénéficient du taux réduit de TVA à 10 %, mais leur coût, qui demeure élevé, pèse sur le budget des communes.
J’ai ainsi été interpellé par plusieurs maires de mon département, pour qui les dépenses de déneigement constituent une lourde charge chaque hiver. De plus, dans ces territoires ruraux, l’offre de prestataires est limitée, ce qui empêche toute négociation des tarifs à la baisse.
Les gouvernements successifs ont jusqu’à présent refusé de procéder à une réforme visant à rendre le déneigement éligible au FCTVA. La situation a toutefois évolué. Aujourd’hui, nos collectivités font face, comme le reste de la population, à une forte inflation, notamment à une envolée des prix de l’énergie, qui entraînent pour certaines communes des dérapages de budget difficiles à assumer, dans un contexte de crise déjà tendu.
Aussi, nous sommes nombreux à considérer qu’un geste de l’État serait particulièrement bienvenu dans cette période compliquée. L’entretien de la voirie pourrait aisément être considéré comme une dépense d’investissement, puisqu’elle permet d’éviter d’autres dépenses à moyen et à long terme.
Madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement quant à l’éligibilité des dépenses de déneigement au FCTVA ?
Monsieur le sénateur Éric Gold, le FCTVA vise par principe à soutenir l’investissement local en compensant la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d’investissement. À titre dérogatoire, le FCTVA a été ouvert à certaines dépenses de fonctionnement, telles que les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux.
Or les coûts liés aux opérations de déneigement constituent des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas rattachables aux dépenses d’entretien de la voirie, qui permettent de maintenir la voirie dans des conditions normales de circulation. Par conséquent, du fait de leur nature, au même titre que les dépenses de nettoyage des locaux, les dépenses de déneigement n’entrent pas dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA.
En outre, les dépenses de déneigement sont souvent des contrats de prestations de services, réalisées par une entreprise extérieure : elles ne sont donc pas davantage éligibles que les contrats de maintenance, prévus par exemple pour l’entretien des installations de sécurité des bâtiments publics.
Les dépenses de déneigement bénéficient toutefois d’un taux de TVA réduit à 10 %, notamment sur les remboursements et les rémunérations versés aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques. De cette manière, l’État soutient indirectement les collectivités dans les dépenses qu’elles engagent à ce titre, le coût de cette réduction de TVA étant de l’ordre de 8 millions d’euros pour l’État.
Si le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA à certaines catégories de dépenses d’entretien, il n’est pas prévu, à ce stade, d’ouvrir l’éligibilité du fonds à des dépenses d’une autre nature.
Ce nouvel élargissement de l’assiette interviendrait dans le contexte de la mise en œuvre progressive de la réforme de l’automatisation du FCTVA, amorcée le 1er janvier 2021 et qui se poursuivra jusqu’en 2023. Dans ce contexte, il paraît préférable de privilégier une stabilité de l’assiette, conformément à l’objectif de neutralité budgétaire de la réforme.

La parole est à Mme Marie Mercier, auteur de la question n° 1838, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur la situation financière des communes rurales qui sont privées de dotations d’État. Leurs difficultés sont considérables et les maires se sentent asphyxiés, mais surtout abandonnés.
Ils se sentent asphyxiés pour une raison simple : ils n’ont pas de moyens. Ils ont beau voter des budgets avec des charges de fonctionnement toujours plus réduites, ils ne peuvent plus rien faire !
Mais, avant tout, ces maires se sentent abandonnés.
Ayant été saisie par le maire d’une commune de Saône-et-Loire, Massilly, qui compte 361 habitants, j’ai écrit à votre ministère le 5 juillet dernier. Je n’ai reçu de réponse ni à ce courrier, ni à la question écrite que je vous ai adressée le 7 octobre.
Madame la ministre, j’ose espérer que ce matin vous pourrez m’apporter une réponse pour ces maires. Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour éviter que la situation ne se reproduise ?
Madame la sénatrice Marie Mercier, les communes rurales bénéficient tout particulièrement des choix opérés depuis 2017 : les concours financiers de l’État ont été stabilisés, le soutien à l’investissement local a été renforcé et l’effort de solidarité a progressé.
Je souligne que seul un nombre anecdotique de communes rurales n’ont plus reçu de dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2021 : à peine 1 % des communes de moins de 3 500 habitants – 436 sur 31 578 – est concerné. Cette situation résulte du fait que leur dotation forfaitaire est nulle et que leurs indicateurs de richesse, notamment leur potentiel financier par habitant, sont meilleurs que ceux de leurs homologues, ce qui les exclut de la péréquation.
Les communes rurales sont, dans leur immense majorité, bien dotées par l’État.
J’en veux pour preuve que la dotation de solidarité rurale (DSR) atteindra près de 1, 88 milliard d’euros en 2022, contre 421 millions d’euros en 2004. La loi de finances pour 2022 prévoit une augmentation de 95 millions d’euros de cette dotation par rapport à 2021, soit un effort encore supérieur à celui réalisé l’an passé.
De 2017 à 2021, la « DSR cible », dont bénéficient les 10 000 communes rurales les plus fragiles, a par ailleurs augmenté de 57 %, tandis que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui a permis de soutenir plus de 20 000 projets en 2020, s’élève à 1, 046 milliard d’euros en 2022.
Les communes rurales bénéficient également de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), qui atteindra le montant historique de 873 millions d’euros en 2022.
Enfin, comme toutes les communes, les communes rurales ont largement bénéficié des dotations d’investissement instituées dans le cadre du plan de relance, comme en témoignent l’abondement exceptionnel de la DSIL pour les années 2020 et 2021 à hauteur de 950 millions d’euros ainsi que la dotation de soutien à la rénovation thermique des bâtiments communaux d’un montant de 650 millions d’euros. Ces deux dotations ont aujourd’hui été intégralement engagées au profit du bloc communal.
Ces quelques exemples illustrent la politique volontariste de soutien aux communes rurales menée par le Gouvernement.

Madame la ministre, vous semblez estimer que la situation des communes dont je me fais l’écho serait « anecdotique », mais elle ne l’est certainement pas pour les maires et les administrés de ces communes !
Vous évoquez – entre autres – la DSR et la DGF. Madame la ministre, personne ne comprend plus rien au mode de calcul, qui est devenu illisible et manque de transparence ! Nous essayons de nous rapprocher des trésoreries et des directions départementales des finances publiques (DDFiP). Malgré tout, les règles ne sont pas claires.
Les maires sont des gens pratiques et des gens du terrain. Ils savent compter, or il y a du manquant, comme on dit chez moi !
Vous soutenez que la DGF a augmenté, mais c’est faux ! La Saône-et-Loire subit une baisse globale de 0, 8 %. Certes, vous pourrez toujours prétendre que celle-ci est anecdotique. Mais quel est le sens de ce mot lorsqu’on gère une commune et que la démocratie de proximité s’appuie, jour et nuit et 365 jours par an, sur les maires ? Le sacerdoce que les maires vouent à leur commune n’est pas anecdotique !
Je souhaite vraiment que le Gouvernement prenne la mesure de ces difficultés financières et ne plus jamais entendre ce mot : « anecdotique » !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, auteure de la question n° 2067, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés de gestion de l’eau rencontrées par les municipalités qui ont choisi d’en conserver la compétence jusqu’en 2026, comme le prévoit la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
Ce choix a été fait par certaines communes rurales pour lesquelles le transfert de cette compétence à l’EPCI n’était pas opportun au regard de leur organisation.
Toutefois, dans le cadre de l’exercice de cette faculté, nombre d’entre elles se sentent aujourd’hui abandonnées par l’État et complètement dépassées aussi bien dans l’adoption d’un mode de gestion que pour faire face aux coûts qu’implique le maintien des compétences eau et assainissement.
Or la gestion de l’eau est capitale.
À titre d’exemple, le maire de la commune de Chapois, dans le département du Jura, hésite à lancer d’importants travaux sur le réseau, lesquels seraient pourtant plus que nécessaires pour la pérennité de l’approvisionnement en eau.
De tels travaux ont un coût élevé, or la quasi-totalité des agences de l’eau excluent du mécanisme d’aide les communes qui ont décidé de ne pas transférer leur compétence.
Les élus attendent un véritable soutien de l’État. Ils veulent d’abord être accompagnés dans la conduite technique et financière de ces travaux. Compte tenu des enjeux liés aux sécheresses, ils espèrent également une aide prospective à la décision en termes de gestion de l’eau.
Avant d’engager des travaux, les petites communes ont besoin de conseils techniques fiables. Or aucun document-cadre n’a à ce jour été édité par les services déconcentrés, ce qui laisse les communes livrées à elles-mêmes, dans l’incertitude. Tout juste les renvoie-t-on à la réalisation d’études prospectives qu’elles n’ont pas les moyens de mener ou pour lesquelles elles ne trouvent pas de spécialistes.
Madame la ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour mettre fin aux inquiétudes des communes rurales et faire en sorte qu’elles ne se trouvent pas démunies face aux investissements durables qu’elles doivent réaliser ?
Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, nous partageons le constat qu’il est nécessaire d’investir massivement dans les réseaux d’eau et d’assainissement pour garantir leur fiabilité et assurer ainsi un meilleur service aux usagers.
Dans cette perspective, plusieurs outils sont à la disposition des acteurs locaux.
Les communes rurales sont ainsi éligibles aux aides des agences de l’eau. Des critères de priorisation des dossiers ont été instaurés pour accompagner le transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI. Mais les communes qui ont fait le choix de conserver ces compétences peuvent également être financièrement accompagnées pour l’entretien de leurs réseaux.
Vous évoquez la commune de Chapois. Cette ville de 219 habitants peut également bénéficier de l’aide conventionnelle proposée par le département du Jura qui, depuis 2019, a renforcé son action en la matière via l’agence Territoires Ingénierie Jura.
Dans ce cadre, la commune peut obtenir une assistance technique en matière d’assainissement, qu’il s’agisse de la gestion patrimoniale de son système d’assainissement collectif ou de l’organisation du contrôle des installations autonomes.
Les compétences eau et assainissement sont des compétences historiques, non pas de l’État, mais des communes. La situation que vous décrivez confirme cependant le bien-fondé de la démarche d’intercommunalisation que promeut le Gouvernement.
La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes que vous avez citée ouvre une possibilité de report, afin de bien préparer le transfert de ces compétences. Dans cette perspective, le Gouvernement se tient à l’écoute des communes rurales qui sollicitent un temps de préparation.
Toutefois, seule la mutualisation des moyens des communes permet d’améliorer le service rendu aux usagers et de faire face aux besoins en termes d’ingénierie et d’investissement indispensables sur les réseaux.

Madame la ministre, à l’évidence, les agences de l’eau se penchent sur les difficultés des métropoles et pas sur celles des petites communes. Ce que vous venez de me dire reste donc à démontrer.

La parole est à M. Philippe Tabarot, auteur de la question n° 2025, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, le 18 novembre 2021, à l’occasion du Congrès des maires, le Président de la République affirmait que « conformément aux engagements pris, la dotation globale de fonctionnement [avait] été sanctuarisée ».
Après les 700 millions d’euros de baisse de cette importante aide de l’État aux communes, la plus importante même sous le quinquennat Hollande-Macron – M. Macron était alors ministre des finances –, cette sanctuarisation de façade annoncée par Emmanuel Macron-président cache en fait une réalité bien différente, en trompe-l’œil.
En effet, plus de la moitié des communes, 53 % d’entre elles exactement, subissent encore une diminution de leur dotation globale de fonctionnement. Cette baisse concerne 55 % des communes de moins de 1 000 habitants, même si l’on part du niveau le plus bas atteint depuis 2017.
Vous hiérarchisez les communes en opposant les quelques rares gagnantes aux nombreuses perdantes. Le « quoi qu’il en coûte » s’est visiblement arrêté au perron des mairies.
Pourtant, cela fait deux ans que les communes, eu égard aux moyens dont elles disposent, sont absolument exemplaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, palliant ainsi la longue inertie de l’État.
Aujourd’hui, les maires doivent gérer de plus en plus de champs d’action, notamment pour le compte de l’État, et ce, malgré une pression financière croissante. À la différence de l’État, ils ont en outre l’obligation de voter leur budget en équilibre.
Après de longues années de pertes financières, on aurait pu s’attendre à une forme de reconnaissance budgétaire. Cet espoir a été douché par un État ingrat, qui demande toujours beaucoup, aide toujours moins, et étouffe progressivement les collectivités.
Madame la ministre, quand le Gouvernement sanctuarisera-t-il réellement, voire augmentera-t-il la DGF, après cette longue période de détérioration, de sorte qu’aucun maire ne voit sa dotation baisser de nouveau ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Monsieur le sénateur Tabarot, le Gouvernement a fait le choix de mettre un terme à la baisse unilatérale des dotations de l’État aux collectivités territoriales, particulièrement à celle de la DGF.
Depuis 2018, la DGF versée aux communes est stable au niveau national. C’est un engagement que nous avons tenu : le Président de la République a donc raison de le rappeler.
Bien entendu, et vous le savez très bien, monsieur le sénateur, les règles de répartition peuvent conduire à des variations dans les attributions individuelles aux communes, à la hausse comme à la baisse.
La DGF doit rester une dotation « vivante », calculée chaque année pour tenir compte de la réalité de la situation de chaque collectivité à partir de critères objectifs de ressources et de charges. Je crois que ce fonctionnement correspond à la demande des élus.
Si nous figions la DGF de chaque commune, cela signifierait que certaines communes gagnantes, par exemple des communes rurales pauvres ou des villes dont la population augmente fortement, ne verraient pas leurs dotations suivre, ce qui serait profondément injuste.
J’ajoute que la sanctuarisation de l’enveloppe de la DGF s’accompagne d’un effort assumé en faveur de la péréquation et, donc, d’une forme de solidarité en direction des communes les moins dotées.
De 2017 à 2021, environ 740 millions d’euros ont ainsi été redéployés des composantes historiques ou figées de la DGF vers les dispositifs de la péréquation communale.
Par ailleurs, considérer les variations individuelles du montant brut de la DGF n’a que peu de sens. Si cette dotation représente en moyenne 15 % des recettes de fonctionnement des communes, cette proportion varie très fortement d’une commune à l’autre. Il faut en réalité la rapporter au budget de chacune pour en avoir une perception fidèle. Depuis 2017, dans près de 3 700 communes, la hausse de la DGF a ainsi été supérieure à 5 % des recettes de fonctionnement.
Enfin, en réponse à votre attaque contre un gouvernement, le nôtre, qui ne soutiendrait pas les collectivités en ces temps de crise, je rappelle que l’ensemble des dotations hors DGF – je pense notamment à la DETR, à la DSIL, à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la DSR – ont augmenté ces deux dernières années.

Je ne dois pas avoir de chance, madame la ministre, parce que les communes de mon département que je connais le mieux subissent toutes une diminution de leur dotation par rapport à 2020 : pour Grasse, la baisse est de 400 000 euros ; pour Vallauris, elle atteint 110 000 euros ; pour Le Cannet, enfin, elle s’élève à 100 000 euros.
La mise sous tutelle se poursuit, madame la ministre : en témoigne la réalité édifiante de mon département !

La parole est à Mme Vivette Lopez, auteur de la question n° 2018, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la ministre, ma question a trait aux souscriptions de contrats d’assurance, notamment pour les dommages aux biens des collectivités.
Plusieurs assureurs habituels semblent en effet mener une politique de plus en plus restrictive auprès des collectivités, tout spécialement à l’égard des communes situées dans des zones jugées à risque élevé. Nous le constatons en particulier dans le Gard.
Les élus se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des appels d’offres infructueux, ce qui les inquiète vivement quant à l’assurabilité de leurs biens.
Aussi, et notamment du fait de la hausse de la sinistralité climatique, de nombreuses collectivités font désormais face à une situation particulièrement inconfortable, qui pourrait les pousser à contractualiser avec des assureurs situés hors de France, et ce, sans avoir la garantie que leurs contrats seront bien gérés.
Au vu de cette situation qui touche un nombre croissant de collectivités, pourriez-vous préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre, madame la ministre, non seulement pour rassurer les maires, mais aussi pour assurer nos biens communs ?
Madame la sénatrice Lopez, votre question soulève une difficulté qui nous a été remontée par quelques collectivités, même si elle reste très localisée au niveau de certains territoires dans lesquels les risques naturels sont très importants.
Rappelons quelques éléments de contexte pour bien comprendre la situation.
Dans un passé récent, un grand nombre d’assureurs se sont intéressés aux risques subis par les collectivités. Parfois, on a même observé qu’une dizaine d’entreprises répondaient aux appels d’offres. Il en a résulté une pression à la baisse sur les tarifs des polices d’assurance.
Depuis quelques années, cependant, les collectivités font face à une sinistralité croissante, du fait d’incendies ou d’événements climatiques graves, notamment dans les régions montagneuses du sud du pays.
L’augmentation du coût des risques assurables a donc conduit certains acteurs à se retirer du marché. Parallèlement, les assureurs restant sur le marché ont augmenté leurs tarifs, en relevant les franchises, par exemple.
À terme, cette situation pourrait présenter deux risques.
En premier lieu, certaines collectivités pourraient renoncer à souscrire une police d’assurance.
En second lieu, l’État pourrait être contraint d’aider les collectivités à négocier leurs contrats ou de contribuer à leur paiement, ce qui n’est pas son rôle, et ce qui ne serait pas conforme à l’esprit de la décentralisation. Surtout, une telle démarche serait inefficace, puisque le subventionnement des assurances ne conduirait sans doute qu’à une hausse de leur coût.
Le rôle de l’État est avant tout d’accompagner les collectivités dans la définition de projets d’aménagement de leur territoire permettant d’identifier les risques et d’anticiper le changement climatique afin d’améliorer leur résilience.
Il a également pour mission de les accompagner dans la mise en œuvre de travaux de protection contre les risques et d’aménagements urbains résilients – je pense aux mises aux normes incendie, à la prévention des inondations, à la renaturation des sols ou des friches.
Des financements existent : subventions d’investissement, comme la DSIL, crédits des agences de l’eau ou du fonds pour le recyclage des friches – le fonds Friches –, mobilisation de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi).
Ce soutien permet de prévenir les risques et les coûts potentiels qui y sont associés et partant, de réduire le coût de l’assurance.

Madame la ministre, je regrette votre réponse, qui a manifestement été préparée à l’avance. Vous n’avez fait que lire des informations…
En attendant, les maires ne peuvent plus souscrire de contrat d’assurance. Peut-être qu’à un moment donné, ils ne chercheront même plus à le faire ou le feront auprès d’assureurs étrangers, ce qui est un peu dommage.
Tout comme mes deux précédents collègues, Marie Mercier et Philippe Tabarot, je vous alerte sur le fait que nos collectivités souffrent profondément du manque d’intérêt que vous leur portez, que ce soit pour les subventions ou pour les aides.
Le maire d’une commune vient encore de m’interpeller, parce que, depuis le 3 octobre dernier, à la suite des inondations… Je m’arrête là, madame la ministre, car je constate que ce que je vous dis ne vous intéresse pas ! Vous êtes sur votre téléphone portable : cela doit être plus important que ce que j’ai à vous dire…

La parole est à M. Michel Canévet, auteur de la question n° 2000, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interpeller sur les conséquences des dégâts occasionnés par certaines espèces animales sur l’activité agricole.
Vous le savez, pour bien connaître le sujet, les agriculteurs sont aujourd’hui en grande difficulté, non seulement parce qu’ils ne tirent pas de leurs ventes des prix suffisamment rémunérateurs, mais aussi parce qu’ils doivent faire face à un certain nombre de dommages causés à leur production, ce qui est particulièrement regrettable.
Parmi les espèces à l’origine de ces dégâts, il y a notamment les choucas, ces corvidés qui dégradent souvent les parcelles au moment des semences. Les agriculteurs ne sont du reste pas les seuls à être affectés par les ravages occasionnés par ces volatiles : quand ils vont nicher dans les cheminées, ils peuvent aussi provoquer des incendies dans les maisons.
J’ai déjà eu l’occasion d’interroger le Gouvernement à ce sujet. On m’avait répondu que des études étaient en cours, notamment une étude diligentée par l’université de Rennes pour évaluer l’importance de cette population.
Madame la secrétaire d’État, où en sont ces études ? Quelles sont les premières mesures que le Gouvernement envisage de prendre ? Va-t-on enfin faire en sorte que les choucas, dont la population s’accroît à grande vitesse, cessent d’occasionner de tels dégâts ? En d’autres termes, va-t-on parvenir à réguler cette espèce ?
Monsieur le sénateur Canévet, le problème que vous décrivez nous pousse à nous mobiliser depuis de nombreux mois pour trouver des réponses adéquates.
En Bretagne, les dégâts causés par le choucas des tours sont très importants. Ces volatiles constituent une réelle source d’inquiétude pour tous ceux qui sont concernés. C’est pourquoi les agriculteurs, les associations, les collectivités, les services de l’État sont tous mobilisés à ce sujet.
Nous faisons tout d’abord en sorte de disposer d’une meilleure connaissance des effectifs et du comportement de cette population. Sur ce point, les travaux ont pris du retard – je vais y revenir.
Nous menons ensuite des actions de prévention, notamment en anticipant, dans les constructions, ce qui pourrait constituer ultérieurement un habitat pour ces oiseaux.
Enfin, nous prenons des mesures en matière de régulation, notamment via des arrêtés autorisant des prélèvements dérogatoires, qu’il nous faudra préciser sur le fondement des connaissances acquises.
Face aux dégâts causés par le choucas, nous avons non pas une, mais plusieurs solutions à proposer.
Il faut tout d’abord rendre les méthodes de prélèvement, qu’elles prennent la forme de tirs ou de piégeages, plus efficaces.
Il importe aussi de mieux connaître l’écologie de l’espèce.
Ainsi, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Bretagne a lancé une étude visant à acquérir des connaissances sur les spécificités bioécologiques du choucas, laquelle devait initialement durer deux ans, pour la période 2020–2021.
Cette étude a hélas dû être prolongée, et pour cause : le ministère de la transition écologique et la Fondation François Sommer, qui la financent, ont fait face à des retards dus essentiellement au premier confinement, ainsi qu’à un problème matériel affectant les GPS qui équipaient les oiseaux, et qui étaient destinés à évaluer leurs distances de déplacement afin de cibler les interventions.
Nous avons donc été obligés de conduire de nouvelles opérations de terrain à la suite de ces retards dus, je le répète, aux confinements successifs et aux problèmes techniques rencontrés au niveau du matériel de balisage, qui ont empêché toute collecte de données exploitables.
Les résultats de l’étude seront transmis à la Dreal le 5 février prochain ; leur restitution aux partenaires est prévue au tout début du mois de mars 2022. L’étude sera ensuite présentée aux organisations agricoles, ainsi qu’au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Un plan régional d’action pour la prévention des choucas, qui intégrera toutes ces données, sera présenté…

Je demande à chacun de respecter le temps de parole qui lui est imparti.
La parole est à M. Michel Canévet, pour la réplique.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces explications.
Il est important que nous agissions vite, car la période des semences va commencer. Il faut absolument que les actions que vous citez aboutissent, d’autant que, je l’ai dit tout à l’heure, les agriculteurs ne parviennent pas à obtenir des prix suffisamment rémunérateurs et qu’à chaque fois qu’ils font face à des dommages au niveau de leur production ce sont autant de pertes d’exploitation qu’ils subissent.
En attendant que nous puissions réellement dresser un bilan de ces études, il nous faut prendre des mesures : je pense à l’éventuelle mise en place de dispositifs d’aide aux calamités agricoles.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 1656, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur les dysfonctionnements persistants de la plateforme MaPrimeRénov’.
Cette plateforme centralise les demandes des ménages qui souhaitent bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement dans leurs démarches de rénovation énergétique.
Depuis plusieurs mois, elle doit gérer un nombre élevé de dossiers et n’apparaît pas dimensionnée pour y répondre, si bien que le processus pose aujourd’hui de multiples difficultés aux usagers.
Ainsi les ménages sont-ils confrontés à une dégradation du service en termes de conseil et d’accompagnement comme de traitement des dossiers, à des bugs informatiques répétés et à des délais inadaptés, notamment pour le versement des aides.
La situation est devenue très problématique tant du côté des usagers que des conseillers, qui ne peuvent faire face à cet afflux de demandes et de critiques quant au fonctionnement de la plateforme.
Les désillusions et les mécontentements vont grandissant, sans compter que le choix du « tout numérique » s’est traduit par une exclusion de fait des ménages situés dans l’hyper-ruralité, en raison d’un manque d’accès ou de maîtrise d’internet. C’est toute la notion de service public de la rénovation énergétique qui est actuellement en danger.
Madame la secrétaire d’État, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour corriger ces dysfonctionnements ?
Madame la sénatrice Sollogoub, en 2021, plus de 760 000 dossiers ont été déposés sur cette plateforme et près de 660 000 sont aujourd’hui en cours d’instruction pour un montant de près de 2 milliards d’euros : je crois que l’on peut convenir que MaPrimeRénov’ est un succès incontestable. Celui-ci ne saurait être éclipsé par les quelques dossiers en souffrance que vous évoquez, pour le traitement desquels nous nous mobilisons.
Les enquêtes de satisfaction sont sans conteste : 89 % des bénéficiaires se sont déclarés satisfaits du dispositif et 77 % de la facilité des démarches en ligne. Cela mérite également d’être souligné.
Cela étant, je vous rejoins sur un point : des bugs informatiques et une très forte demande ont créé des dysfonctionnements et suscité des retards dans le traitement de certains dossiers dits « en difficulté ». Il faut cependant savoir que ces dossiers ne représentent que 0, 5 % de l’ensemble des dossiers déposés en 2021.
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a été sollicitée pour les débloquer dans les meilleurs délais. Ainsi, sur les 3 000 dossiers identifiés en souffrance en octobre, 2 575 ont déjà été résolus au 11 janvier 2022 grâce à une équipe dédiée.
Nous avons en outre pris différentes mesures pour répondre à cette situation de surchauffe : tout d’abord, les points de contacts locaux ont été transférés vers le central d’appel de l’ANAH ; des guides en ligne et des foires aux questions ont été complétés et précisés ; des primes exceptionnelles ont été versées ; enfin, l’instauration cette année de France Rénov’, le nouveau service public de la rénovation de l’habitat, contribuera à simplifier les démarches, grâce à une plateforme internet unique et un numéro unique pour 450 guichets répartis sur tout le territoire.
Dans le cadre de MaPrimeRénov’, il est également prévu qu’un mandataire puisse réaliser la demande en ligne pour le compte des ménages, que ce soit un proche ou l’entreprise choisie pour réaliser les travaux. D’après une étude réalisée par Ipsos, une telle démarche concernerait 45 % des dossiers. Cette proportion tout à fait significative prouve qu’il était utile d’autoriser cette procédure de demande en ligne par procuration.
Vous le voyez, madame la sénatrice, le dispositif MaPrimeRénov’ a été soutenu et renforcé. Nous nous attelons à offrir le meilleur accès et à assurer le plus grand succès possible à cette politique de rénovation énergétique des logements, au service des Français bien entendu, mais aussi de la lutte contre le réchauffement climatique.

Madame la secrétaire d’État, j’attire votre attention sur le fait que trois départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, parmi lesquels la Nièvre dont je suis élue, ne peuvent pas bénéficier de la prime dite de « surchauffe » pour des raisons administratives liées à la nature des financements qu’ils perçoivent et qu’ils n’ont pas choisis, ce qui est particulièrement injuste. En outre, pour ceux qui en sont bénéficiaires, le versement n’interviendra qu’en avril 2022.
Permettez-moi également une remarque sur les dispositifs. D’« Habiter mieux », on est passé à « MaPrimeRénov’ », puis maintenant à « France Rénov’ », tandis que, sur le terrain, les acteurs interviennent avec différentes casquettes : espaces Faire, agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), agences départementales d’information sur le logement (ADIL), etc. Il y a là de quoi noyer tout le monde ! Un peu de clarté et de stabilité seraient donc les bienvenues.
Enfin, l’ANAH a annoncé une grande campagne de communication sur la refonte des aides dès le début de cette année. Il serait souhaitable que les effets de cette campagne, notamment en termes de volume d’appels, soient anticipés de manière à éviter d’éventuelles surchauffes.

La parole est à M. Jean Sol, auteur de la question n° 1962, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur le besoin de financement nécessaire à l’ouverture de nouvelles lignes de trains de nuit.
L’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire (TET), datée du mois de mai 2021, insistait sur la nécessité d’investir dans le matériel roulant, tel que des voitures et des locomotives.
En effet, pour un réseau de 25 trains de nuit, l’étude préconisait l’acquisition de 600 voitures et de 60 locomotives, pour un montant de 1, 5 milliard d’euros.
Or, depuis 2018, 144 millions d’euros seulement ont été investis en faveur des trains de nuit. Ce montant semble insuffisant au regard des fortes attentes des usagers et des collectivités, comme en témoigne la pétition « Oui au train de nuit » signée par plus de 200 000 personnes.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement a annoncé un ambitieux projet de multiplication des trains de nuit entre 2026 et 2030, pour un montant total de 800 millions d’euros.
À quelle hauteur l’exécutif entend-il investir pour le matériel nécessaire à l’ouverture de ces nouvelles lignes de trains de nuit ? Plus précisément, compte-t-il renouveler le matériel vétuste de la ligne Paris-Latour-de-Carol ? Enfin, pouvez-vous me dire si le concept d’« hôtel sur rails » est à l’étude, au-delà du projet de la start-up française Midnight Trains ?
Monsieur le sénateur Sol, c’est avec beaucoup de plaisir et de joie que je réponds à votre question, puisque, alors députée et rapporteure du projet de loi d’orientation des mobilités, j’avais moi-même défendu l’indispensable relance des trains de nuit et élaboré un rapport, qui me permet de vous présenter aujourd’hui les nombreuses avancées et les perspectives tout aussi enthousiasmantes en la matière.
Cette offre de transport est effectivement nécessaire, non seulement en termes d’aménagement du territoire, mais aussi pour remédier à l’absence d’alternatives. Il s’agit d’une offre de transport longue distance à la fois écologique et sociale.
En 2017, il ne restait que deux lignes de trains de nuit au niveau national. Ces lignes ont tout d’abord été remises en service par le Gouvernement, au printemps 2021 pour le Paris-Nice, et depuis quelques semaines pour le Paris-Tarbes-Lourdes. Les voyageurs sont au rendez-vous, puisque nous disposons de très bons chiffres de fréquentation.
Nous avons en outre annoncé la relance du train de nuit Paris-Aurillac pour la fin 2023.
De son côté, la SNCF, avec ses partenaires allemand et autrichien, a mis en place, en décembre 2021, le train de nuit Paris-Vienne. Elle envisage désormais de relancer la ligne Paris-Berlin pour fin 2023.
L’élan en faveur de la mise en place d’un nouveau réseau de trains de nuit se poursuit, puisque de nouvelles lignes sont annoncées d’ici 2030.
Le développement de ces lignes implique, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, un renouvellement du matériel roulant, dont le coût s’élèverait au total, selon nos estimations, à 800 millions d’euros.
Les réflexions sont en cours pour affiner les besoins. L’objectif d’un développement des lignes de trains de nuit sera visé à la fois au niveau national et pour toute l’Europe.
Pour terminer, j’évoquerai l’effort consenti en faveur de la ligne de nuit Paris-Latour-de-Carol, qui bénéficie de la rénovation de son matériel roulant.
Ce programme qui concerne toutes les lignes nationales s’achèvera au milieu de l’année 2023 et représente un investissement global de 130 millions d’euros, montant qui sera intégralement financé par l’État, dont 100 millions d’euros le seront dans le cadre de France Relance.
C’est vous dire, monsieur le sénateur, tout l’intérêt que nous portons au redéploiement des trains de nuit.

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Comme vous le savez, les lignes de trains de nuit répondent à un véritable besoin. Celles-ci sont en effet créatrices d’emplois, écologiques, abordables et nécessaires au développement des territoires. Elles sont aussi et surtout indispensables pour désenclaver et relier les territoires les plus éloignés des grands axes de circulation.
Nous ne pouvons donc pas attendre et comptons sur votre réactivité et, surtout, sur votre volonté d’agir le plus rapidement possible pour nos usagers.

La parole est à M. Laurent Lafon, auteur de la question n° 2083, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur les importantes difficultés de circulation rencontrées dans la commune de Rungis.
Cette ville, véritable poumon économique de notre département du Val-de-Marne et, plus largement, de l’ensemble de la région Île-de-France, avec près de 35 000 emplois pour 5 700 habitants, entourée par le marché international de Rungis, impénétrable, ainsi que par les autoroutes A86, A10 et A106, saturées et non connectées entre elles, ne peut plus supporter, aussi bien pour ses habitants que pour ceux qui y travaillent, de flux de circulation supplémentaires compte tenu de la voirie existante.
Or il existe actuellement de nombreux projets économiques autour de Rungis, qui présentent tous un réel intérêt : je pense à la création de 170 000 mètres carrés d’entrepôts au niveau du marché d’intérêt national (MIN), à l’installation d’un nouveau siège des douanes et d’un hôtel à l’entrée de la Sogaris, ou encore à l’arrivée du plus gros logisticien mondial à l’entrée du MIN, avec 600 emplois à la clé.
À construction nouvelle une infrastructure de transport nouvelle s’impose.
Les embouteillages actuels ne sont pas dus aux Rungissois sortant de la ville, mais bien plutôt à la multiplicité des axes convergeant vers elle, notamment au niveau de deux carrefours, celui de l’Europe et celui de la République. Ces deux carrefours ne sont pas du ressort de la commune. Or ils impliquent, pour résorber les bouchons, que l’on crée des voies de délestage en amont et en aval.
Des solutions existent. Par exemple, on pourrait créer une voie de contournement, via la voie des Avernais au sud, ou une bretelle d’accès de Rungis vers Paris sur l’A106, comme il en existe une dans l’autre sens.
Bruno Marcillaud, maire de Rungis, travaille depuis son élection sur ce dossier complexe, en mettant en relation les décideurs et en cherchant les financements idoines. Le conseil départemental s’est d’ores et déjà engagé à réaliser des études et à trouver des solutions. Les villes voisines sont elles aussi associées à la démarche. Des pistes ont aussi été évoquées avec Mme Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne.
Néanmoins, pour l’heure, aucune solution n’a été entérinée, et ce, alors même que les projets économiques sont là.
Ma question est simple, madame la secrétaire d’État : comment l’État compte-t-il s’engager aux côtés des acteurs de terrain pour agir sur la fluidité des axes routiers qui entourent la ville de Rungis ?
Monsieur le sénateur Lafon, Rungis est effectivement le véritable poumon économique du Val-de-Marne, et plus largement de l’Île-de-France.
C’est pourquoi nous devons nous mobiliser au sujet des difficultés de circulation qui l’affectent, que tout le monde constate et subit.
La commune est un pôle d’échange national et international, qui draine aussi une circulation et des flux régionaux et locaux très importants.
L’État reconnaît le besoin que vous mentionnez d’améliorer autant que possible la fluidité de la circulation : il s’agit vraiment d’un enjeu partagé.
Au niveau national, nous avons déjà conduit un certain nombre d’actions.
Tout d’abord, nous nous sommes résolument engagés à développer le report modal – à cet égard, nous pouvons tous nous réjouir de la remise en service du train des primeurs, ce fameux Perpignan-Rungis, qui est une première réponse pour réduire le nombre de poids lourds.
D’autres projets suivront : je pense évidemment au projet de transport combiné avec le marché international de Rungis, en cours de développement.
Au niveau local, vous l’avez évoqué, monsieur le sénateur, les services de l’État travaillent étroitement avec les collectivités.
À la mi-décembre, la préfète du Val-de-Marne a reçu le maire de Rungis. Il a été convenu que cette problématique pourrait être traitée dans le cadre du projet partenarial d’aménagement d’Orly. Cette réunion a été l’occasion, non seulement de discuter des flux de circulation autour de Rungis, mais surtout de montrer la volonté de l’État d’accompagner la commune et l’ensemble des partenaires locaux dans ces réflexions.
Il est important que ce dialogue étroit se poursuive dans les semaines qui viennent.
Je vous le redis, vous pouvez compter sur la mobilisation des services de l’État aux côtés des collectivités pour améliorer cette situation et remédier aux difficultés de trafic autour de Rungis.

La parole est à M. Thomas Dossus, auteur de la question n° 2066, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.

Ma question porte sur le projet d’aménagement de l’autoroute A46 Sud.
Ce projet, porté par l’État et la société Autoroutes du Sud de la France, prévoit d’élargir l’autoroute A46 Sud, qui contourne la métropole lyonnaise par le sud-est, en la passant à deux fois trois voies et en aménageant plusieurs nœuds routiers, comme celui de Manissieux.
En amont de ces travaux, cet été, s’est déroulée une concertation préalable au projet.
La quasi-totalité des élus locaux, l’écrasante majorité des territoires concernés sont opposés à ce projet d’élargissement, tous bords politiques confondus. Il en va de même des habitants et des associations locales, également dans leur très grande majorité – j’ai reçu récemment un courrier du maire de Givors, qui a fait voter un vœu à l’unanimité contre le projet.
Le bilan de cette concertation est donc sans appel.
Au cours de celle-ci, certaines alternatives ont en outre pu être étudiées, notamment l’option ferroviaire, qui attend la réalisation du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise pour le transport de marchandises. Ce projet, dont l’utilité publique a été reconnue en 2012 pour la partie nord, peine toujours à se concrétiser. Il permettrait pourtant de contribuer aux objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, prévoyant un « doublement de la part modale du fret ferroviaire ».
En France, il est toujours plus difficile de dérouler du rail que du bitume !
Malgré tout cela, le 21 décembre 2021, le Gouvernement a confirmé vouloir poursuivre les études relatives à la mise en œuvre de l’élargissement de l’A46.
Ma question est simple, madame la secrétaire d’État : pourquoi vous entêter dans ce projet, qui va à l’encontre des engagements climatiques de la France et augmentera la pollution de l’air dans l’Est lyonnais, déjà bien touché ?
La concertation menée à l’été 2021 sur le projet de mise en deux fois trois voies de l’autoroute A46 Sud et de réaménagement du nœud de Manissieux, sous l’égide des garants désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP), a mis en lumière les attentes exprimées en matière de mobilité dans l’Est lyonnais, notamment l’intérêt de développer, en complément des actions menées en faveur de la mobilité des personnes, un fret ferroviaire et fluvial.
Il convient tout de même de souligner le consensus des différentes parties prenantes sur deux points : d’une part, la nécessité d’améliorer les conditions de circulation sur l’A46 Sud – où elles étaient particulièrement dégradées – et sur les réseaux secondaires, touchés par des congestions récurrentes ; d’autre part, les gains à attendre de cette opération de réaménagement en matière de sécurité routière, lesquels constituent un objectif que l’on ne peut méconnaître.
Les échanges ont révélé un besoin de vigilance environnementale – je ne peux évidemment que vous rejoindre sur ce point, monsieur le sénateur Dossus. Sont plus spécifiquement concernées les questions du bruit et de la pollution de l’air. Nous y serons particulièrement attentifs.
Il faut également veiller à une bonne articulation entre ce projet et les autres grands projets d’infrastructure prévus sur l’aire lyonnaise.
Dans ce contexte, le ministre délégué chargé des transports a décidé d’engager une nouvelle phase d’échange, avec les autorités organisatrices de la mobilité et les acteurs de la mobilité du territoire, notamment, et sous l’égide du préfet de région. L’objectif est de pouvoir apporter des réponses réellement claires au regard des observations faites et des attentes exprimées en termes de mobilité.
Par ailleurs, une concertation continue sera mise en place avec les riverains et les usagers pour continuer de préciser les effets du projet d’aménagement de l’A46 Sud.
Cette démarche respectera également, pour l’ensemble des impacts environnementaux identifiés, la mise en œuvre d’une séquence « éviter, réduire, compenser », une attention particulièrement étant bien évidemment portée à la première étape, celle de l’évitement. Nous nous attacherons, à ce titre, aux études de trafic, à l’évaluation de la qualité de l’air et au traitement du bruit, qui feront l’objet d’échanges réguliers.

Vous confirmez le projet étatique d’élargissement de l’A46, madame la secrétaire d’État. Pourtant, on l’a vu à peu près partout, on ne luttera pas contre la congestion en rajoutant des voies.
La transition, c’est faire des choix, changer de modèle. Or vous continuez de financer ou d’encourager un certain nombre de projets routiers dans de nombreux points du territoire français, que ce soit ici, au sud de Lyon, ou à Rouen, Avignon, Orléans, etc.
On fonce dans le mur, et vous restez dans le déni, méprisant, cette fois-ci, la démocratie locale. Soyez à la hauteur : abandonnez ces projets, et engagez des solutions alternatives. En somme, faites le choix de la transition !

La parole est à M. Cyril Pellevat, auteur de la question n° 2088, transmise à Mme la ministre de la transition écologique.

Ma question porte sur l’épidémie de brucellose en Haute-Savoie et sur la nécessité de trouver une réelle solution, viable et pérenne, à ce problème.
Un nouveau cas de brucellose – une maladie dangereuse pour l’homme, qui peut être contaminé par le biais de produits laitiers – a été détecté dans un élevage de vaches laitières du massif du Bargy, en Haute-Savoie.
Les scientifiques sont unanimes, la vache séropositive a été contaminée après avoir été en contact avec des bouquetins porteurs de la maladie. Il est en effet connu que la prévalence de la maladie est élevée dans le troupeau de bouquetins se trouvant sur le massif.
Pour éviter tous risques pour l’homme, le troupeau de vaches a dû être entièrement abattu, ce qui entraîne des conséquences économiques désastreuses pour l’éleveur, mais aussi pour l’ensemble de la filière du fromage non pasteurisé, notamment celle du reblochon.
Voilà maintenant neuf ans que ce malheureux feuilleton dure.
L’Anses a été saisie à de nombreuses reprises pour essayer de déterminer la solution la plus adaptée. Dans chacun de ses avis, et même si elle a proposé des solutions alternatives, qui ont d’ailleurs toutes été essayées et qui ont toutes échoué à permettre une élimination de la séroprévalence dans le troupeau de bouquetins, l’abattage total du troupeau est toujours le scénario à l’issue duquel la probabilité d’une extinction de l’épidémie est la plus haute.
Malgré cela, et en dépit des nombreux échecs de cette méthode et de nos réticences, c’est à nouveau la voie de la constitution d’un noyau sain qui a été retenue.
Vous me direz, madame la secrétaire d’État, que la solution d’un abattage total du troupeau de bouquetins présente un risque pour la conservation de l’espèce.
L’Anses, elle-même, relève que, d’après le Groupe national bouquetin, la France compterait une quarantaine de populations de bouquetins, pour environ 10 000 individus. Ainsi, l’abattage des bouquetins du massif du Bargy ne remet pas en cause la conservation de l’espèce, surtout si l’on envisage une réintroduction ultérieure.
Vous pourriez aussi dire que cette solution présente un risque de fuite des bouquetins vers d’autres massifs.
Pourtant, toujours dans le même avis, l’Anses indiquait que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, jugeait possible d’empêcher les fuites d’animaux par les couloirs identifiés, en y mettant les moyens appropriés. D’après cet avis, les experts considèrent le risque de fuite comme très faible si des moyens importants sont mis en œuvre. Je m’étonne, d’ailleurs, que ce point n’ait pas été repris dans le dernier avis de novembre 2021.
Enfin, le dernier argument qui pourrait être opposé à cette solution est que le scénario de l’abattage total risque d’empêcher la surveillance de la maladie, car seul un petit nombre de bouquetins réussira à y échapper. Toutefois, même si l’exercice sera moins aisé, rien n’empêchera la surveillance si des bouquetins sont de nouveau repérés sur le massif.

Va-t-on enfin pouvoir trouver une solution, madame la secrétaire d’État ?
La contamination par la brucellose d’un élevage en Haute-Savoie, confirmée au début du mois de novembre, a conduit à l’abattage total d’un troupeau. Les services déconcentrés de l’État se sont pleinement mobilisés dans cette opération, et je les en remercie, pour indemniser les pertes économiques, mais surtout apporter une aide psychologique et soutenir la filière du reblochon, qui est impactée.
La souche brucellique identifiée est bien la même que celle qui circule parmi la population de bouquetins du massif du Bargy.
Le foyer est surveillé depuis une dizaine d’années, et des avis scientifiques ont conduit à prendre des mesures de captures et de tirs des bouquetins. Par ces actions, la séroprévalence au sein de cette population a été divisée par dix en une décennie, passant de 40 % en 2012 à 4 % en 2021. Les bouquetins capturés sont testés, puis marqués et relâchés en cas de test favorable. Ils sont évidemment abattus, en cas de test défavorable.
L’Anses, saisie à deux reprises, a examiné neuf scénarios de gestion, couplant tirs et/ou captures sur plusieurs années, dans le but de parvenir à une extinction naturelle de la maladie, tout en conservant un noyau d’animaux sains, le bouquetin étant une espèce protégée.
Avec l’éclairage des avis les plus récents de l’agence, des mesures vont être mises en œuvre pour obtenir, à l’horizon de 2022, un noyau sain de bouquetins marqués, maintenir une surveillance et renforcer ce noyau sain dans les années suivantes, avec de larges opérations de captures et de tests.
L’obtention de ce noyau sain nécessite des opérations importantes de captures et de tirs, car la population de bouquetins demeure encore largement non marquée. Par ailleurs, la surveillance de cette population rejoint celle d’autres animaux de la faune sauvage, comme les chamois et les cervidés, qui sera également renforcée.
L’abattage total des bouquetins que vous préconisez, monsieur le sénateur Pellevat, a été modélisé par l’Anses.
Il présente, comme vous le soulignez, un risque de déplacements d’individus possiblement infectés vers d’autres massifs.
La mise en œuvre opérationnelle de cette solution n’est, de plus, pas très réaliste, puisque l’on sait les difficultés à atteindre l’ensemble d’une telle population, avec des effets collatéraux qui pourraient compromettre, à moyen terme, les chances d’éradiquer la brucellose, notamment par une baisse de la qualité de la surveillance.
Enfin, la solidité juridique de cette solution est mince en cas de recours contentieux.
Or il y va de notre crédibilité à tous ; les opérations de ce genre doivent être réalistes et juridiquement solides.

La parole est à M. Arnaud Bazin, auteur de la question n° 1965, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Le huitième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes modifie la rédaction de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime en ce sens : « La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. »
Ainsi, sont exclues de la vente en ligne à titre onéreux les personnes visées par les articles L.214-6-1 et L.214-6-5 du même code, c’est-à-dire les fondations et associations de protection animale, avec et sans refuge.
Par ailleurs, le code civil, dans ses articles 893 et 1107, indique que la cession à titre gratuit ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.
Les particuliers éleveurs à titre non commercial d’animaux de compagnie autres que chiens et chats sont également concernés par cette exclusion. A contrario, les particuliers peuvent céder en ligne à titre onéreux des chiens et des chats dont ils détiennent la femelle reproductrice, étant alors considérés comme des éleveurs.
Cette exclusion a évidemment des conséquences. Or celle-ci découlant d’un amendement gouvernemental – je me réfère à l’amendement n° 162, déposé par le Gouvernement lors de l’examen au Sénat –, je souhaite interroger celui-ci sur ses intentions.
Madame la secrétaire d’État, si les intentions du Gouvernement étaient bien celles qui ont été affichées, comment assurer la survie des associations ? Ces dernières ne pourront plus utiliser les annonces en ligne ou devront céder les chiens et les chats sans contrepartie, ce qui pose le problème de leurs ressources, donc de leur pérennité.
Par ailleurs, pour les animaux de compagnie autres que chiens et chats, pour lesquels les particuliers ne peuvent plus passer d’annonces à titre onéreux, ne craignez-vous pas d’assister à des lâchers d’espèces potentiellement invasives dans la nature ?
Si, donc, le Gouvernement n’avait pas comme intention d’engendrer de telles conséquences, comment allons-nous remédier à la situation ?
La lutte contre la maltraitance animale et le renforcement des liens entre les animaux et les hommes étaient au cœur de la loi promulguée le 30 novembre 2021, qui a permis des avancées majeures.
Le renforcement du contrôle de la vente d’animaux en ligne faisait en particulier l’objet d’attentes très fortes.
L’article 4 sexies que vous avez cité, monsieur le sénateur Bazin, prévoyait que soient précisées, dans le décret d’application rédigé par le pouvoir exécutif, les modalités de mise en œuvre de ces cessions en ligne.
Pour répondre précisément et sans délai à votre question, les services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation échangent d’ores et déjà avec les associations concernées.
Je vous confirme que l’objectif du Gouvernement est bien de s’assurer, à travers la rédaction du décret, que les associations de protection animale sans but lucratif pourront poursuivre leurs activités de cessions en ligne, afin de lutter contre l’abandon des animaux de compagnie. En revanche, l’article prévoit effectivement que ces cessions en ligne resteront possibles, uniquement si elles sont réalisées à titre gratuit.
Notre objectif est bien de réduire les trafics issus des cessions onéreuses et de limiter les abandons via les cessions gratuites.
Le contenu du décret d’application sera donc établi en concertation avec les associations de protection animale, considérées comme cédants à titre gratuit, ce qui implique qu’elles pourront seulement exiger la prise en charge des frais inhérents à l’adoption.
La notion de contrat à titre onéreux est définie à l’article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».
Il importe donc, dans le cas des associations susmentionnées, que l’absence de réciprocité soit voulue et volontaire, la condition pour qu’une cession soit considérée comme une cession à titre onéreux étant la relative équivalence de la valeur des contreparties.
Selon la loi du 30 novembre 2021, pour pouvoir effectuer des cessions en ligne, les associations, dont celles qui ne disposent pas de refuge, devront donc céder les animaux à titre gratuit. Elles pourront faire payer les frais de vaccination et d’identification, voire une adhésion, mais elles devront pouvoir justifier du caractère gratuit de cette cession et établir un document signé en ce sens.

Je dois vous interrompre, madame la secrétaire d’État, car vous avez dépassé le temps de parole qui vous est imparti.

La parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la question n° 1872, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur l’approvisionnement en grumes de chêne des scieries françaises.
Les scieurs connaissent un niveau d’activité satisfaisant, avec une demande grandissante sur le marché domestique, mais également à l’exportation.
Toutefois, force est de constater qu’un quart de la récolte de grumes de chêne quitte notre territoire sans subir la moindre transformation et, donc, sans engendrer la moindre valeur ajoutée. De plus, cette essence est exportée en Asie, principalement en Chine, à un prix supérieur de 25 % à 30 % au prix que les scieurs français sont en mesure d’offrir pour rester compétitifs.
Pour les transformateurs, c’est la double peine : ils souffrent du manque de matières premières et peinent à proposer des tarifs concurrentiels aux propriétaires forestiers.
Or, depuis dix années, les scieurs ont investi massivement, notamment dans mon département de l’Ain, pour rester compétitifs et répondre à une demande soutenue, tout en améliorant les conditions de travail. Des investissements structurants sont encore à l’étude, mais le manque de certitude quant à l’approvisionnement pourrait les compromettre, placer en difficulté ce secteur et priver notre pays d’un outil de transformation pourtant essentiel, avec des emplois à la clé et des incidences fortes pour la filière du bâtiment.
Alors que la France est le premier producteur de chêne en Europe et le troisième producteur mondial, pouvez-vous nous indiquer, madame la secrétaire d’État, quelles mesures urgentes le Gouvernement envisage de prendre pour permettre aux scieurs de chêne de retrouver confiance en l’avenir, en étant assurés qu’ils pourront être suffisamment approvisionnés en cette essence de bois, selon des conditions qui soient à la fois satisfaisantes et équilibrées ?
Monsieur le sénateur Chaize, on observe depuis une dizaine d’années une dynamique à l’export dans le secteur des grumes de chêne, avec des pics en 2015 et 2018 ayant appelé une réponse forte.
Sur les dix premiers mois de l’année, le cumul des exportations de chêne vers la Chine a atteint un record, une progression de 31 % étant constatée par rapport à 2020. Tous pays confondus, ces exportations atteignent sur la même période 48 623 mètres cubes.
Cette situation engendre évidemment deux difficultés principales : du point de vue structurel, une hausse des prix du bois pour les transformateurs et scieurs français ; du point de vue conjoncturel, des difficultés en termes de disponibilité de la matière première et, donc, de capacité de ces mêmes acteurs à constituer un stock suffisamment stable pour poursuivre leurs activités.
Face à ce constat, nous nous sommes mobilisés.
Nous l’avons d’abord fait au niveau européen, puisque, c’est parfaitement normal, la régulation aux frontières est une compétence de l’Union européenne, la libre circulation des biens et personnes à l’intérieur de l’Union ayant fait sa force et apporté paix et prospérité depuis quatre-vingts ans.
Nous avons notamment saisi la Commission européenne dès cet été sur le sujet. Elle travaille à nos côtés pour appliquer des clauses de sauvegarde ou des barrières tarifaires en vue de limiter ces exportations de grumes.
La priorité est aussi, évidemment, de lutter contre les traders, qui spéculent sur les tensions du marché et le perturbent au niveau international.
Pour cela, nous avons introduit dans la loi Climat et résilience du 22 août 2021 un article prévoyant la mise en place de « cartes d’exportateur ». Il s’agit, non pas d’interdire toute exportation, mais de mieux encadrer les conditions d’exportation des bois ronds sans transformation au sein de l’Union européenne – j’insiste sur cette absence de transformation.
Il n’est ni souhaitable du point de vue écologique ni soutenable sur le plan économique d’envoyer des grumes de chêne dans des usines de transformation à l’autre bout du monde, a fortiori quand celles-ci nous reviennent ensuite transformées.
Nous sommes donc au rendez-vous. Je mentionnerai en particulier le label « Transformation UE », par lequel l’État, en tant que propriétaire forestier, ou les communes forestières peuvent conditionner leurs ventes à une première transformation locale, …
… mais d’autres dispositifs seront déployés dans les mois à venir.

J’ai bien entendu votre réponse, madame la secrétaire d’État, mais il faut passer à des actes concrets !
Aujourd’hui, les exportations se poursuivent, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, et la pénurie continue. Peut-être faut-il avancer, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, des solutions pérennes – certains États membres ont déjà pris des mesures drastiques. Si le conventionnement est une solution, la régulation en est une autre.
En tout cas, il faut arrêter de parler de souveraineté, et agir pour la souveraineté. Je suis persuadé que la biodiversité ne s’en portera que mieux !

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteure de la question n° 2068, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques.

Je souhaite interroger le Gouvernement, madame la secrétaire d’État, sur les pratiques des concessions autoroutières ou de la SNCF concernant l’accès à leurs infrastructures numériques, pratiques qui, semble-t-il, restreignent la concurrence.
Les tarifs pour utiliser ces infrastructures sont effectivement prohibitifs. De fait, la protection des gestionnaires quant à l’usage de leurs fourreaux, pourtant largement amortis et loués à des conditions désavantageuses, empêche certains opérateurs de proximité du numérique d’emprunter ces infrastructures.
Ces derniers sont alors contraints d’utiliser les offres éclairées ou inactivées – la fibre optique noire – d’opérateurs tiers, pour la plupart non européens, ces offres étant proposées à des tarifs non régulés, ne permettant pas de créer des conditions d’une concurrence locale, telle que souhaitée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) sur le marché des entreprises, des professionnels et des collectivités. Je rappelle que, dès 2017, ce marché a été qualifié par l’Arcep de « parent pauvre » de la régulation.
Il serait pourtant possible, madame la secrétaire d’État, de capitaliser sur une démarche plus vertueuse et plus souveraine en matière d’économie circulaire : les besoins des opérateurs de proximité bénéficieraient à des acteurs nationaux européens, contribuant ainsi au développement et à la pérennité d’un secteur essentiel à la relance économique de notre pays.
Or les opérateurs alternatifs se retrouvent aujourd’hui dans une situation où la création de valeur est captée par des acteurs le plus souvent américains, ce qui contribue à asseoir encore un peu plus la domination mondiale de ces acteurs sur ces infrastructures essentielles.
Madame la secrétaire d’État, comment envisagez-vous de rendre ce marché plus transparent ? Instaurerez-vous des tarifs adaptés pour l’accès des opérateurs de proximité à ces infrastructures ?
Comme vous le savez, madame la sénatrice Loisier, les offres d’accès aux infrastructures de génie civil commercialisées par les sociétés autoroutières pour le déploiement des réseaux de communications électroniques doivent respecter certaines règles, en application de la directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, directive ayant été transposée dans le droit français.
Les conditions d’accès doivent être fournies selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables.
L’orientation du tarif vers les coûts n’est toutefois pas imposée dans ce cadre. En cas de différend entre les parties, notamment sur le volet tarifaire, il est bien prévu que l’Arcep puisse être saisie pour se prononcer sur ce différend. À la connaissance du Gouvernement, aucune demande en ce sens n’a été à ce jour adressée à l’autorité de régulation.
S’agissant de la régulation ex ante opérée par l’Arcep, il est à noter que le marché de la fourniture en gros d’accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement des réseaux de communications électroniques n’est pas inclus dans la liste des marchés pertinents recensés dans la recommandation n° 2014/710/UE de la Commission européenne.
Néanmoins, au terme des travaux menés dans le cadre du sixième cycle d’analyse des marchés, l’Arcep a estimé nécessaire de maintenir une régulation ex ante asymétrique de ce marché, qu’elle a précisément délimité et sur lequel elle a mis en évidence des barrières élevées et non provisoires à l’entrée, avec une absence de perspectives d’évolution vers une concurrence effective à l’horizon du cycle d’analyse. Elle a également souligné l’insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux dysfonctionnements constatés.
Dans sa décision n° 2020-1445 de décembre 2020, l’Autorité a défini les limites du marché pertinent, en retenant les offres d’accès aux infrastructures de génie civil, souterraines ou aériennes, proposées par des opérateurs de communications électroniques, des collectivités territoriales ou Enedis, dès lors qu’elles sont mobilisables pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte.
La même décision identifie un opérateur puissant, Orange, et lui fixe des obligations.
Les offres d’accès aux infrastructures de génie civil des réseaux autoroutiers n’ont pas été retenues dans la délimitation du marché pertinent. En effet, elles ne présentent pas la même capillarité que les offres d’accès proposées par les opérateurs de communications électroniques ou les collectivités territoriales pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte.
Il serait donc vraiment disproportionné de soumettre les sociétés d’autoroute à des obligations excessivement contraignantes, notamment d’orientation sur les coûts…
De telles obligations ne se justifient pas sur un plan juridique dans des conditions très précises et pour un opérateur exerçant une influence significative.

Je vous remercie de respecter votre temps de parole, madame la secrétaire d’État.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour la réplique.

J’entends vos explications, madame la secrétaire d’État. Mais, à l’heure où l’on parle de réindustrialisation de nos territoires, il est véritablement regrettable de se priver de ces réseaux qui maillent l’ensemble de nos territoires. La question ne me semble absolument pas clarifiée. Je vous invite donc à l’évoquer avec l’Arcep – ce que, pour ma part, je ferai.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, auteur de la question n° 2084, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance a récemment déclaré que l’explosion des prix de l’énergie n’était pas soutenable pour les particuliers et les entreprises. Il ne faudrait pas que les collectivités locales soient, une fois de plus, les grandes oubliées !
Face à la hausse inédite du prix de l’énergie, le Gouvernement a proposé une série de mesures s’adressant aux particuliers. Nous ne nions pas leur utilité. Mais qu’en est-il de nos collectivités locales, tout particulièrement de celles qui négocient actuellement le renouvellement de leur contrat de fourniture et voient les prix qui leur sont proposés multipliés, selon elles, par quatre, voire cinq ?
Depuis de nombreuses années, nos collectivités ont beaucoup investi pour une meilleure gestion de leur consommation et accéléré la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Force est de constater, aujourd’hui, que les économies réalisées sont complètement masquées par cette hausse du prix de l’énergie.
Dans ces conditions, comment amorcer sereinement les discussions budgétaires ?
L’explosion des coûts de fonctionnement contraindra nombre de nos communes à accroître leur fiscalité locale ou à freiner leurs investissements. La commande publique s’en trouvera ralentie, ce qui affectera encore un peu plus nos entreprises, déjà bien mises à mal.
Au regard de cette situation inédite, les communes sollicitent, en complément de l’allégement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), qui est insuffisante, une compensation de l’État.
Celui-ci a répondu à cette demande par la mise en place d’un groupe de travail – un classique ! – pour mesurer l’impact et réfléchir à des mesures. Les maires et les présidents des collectivités concernées ne peuvent pas se satisfaire de cette réponse, car cette décision ne peut pas attendre.
Une fois de plus, le manque d’anticipation du Gouvernement risque de conduire de nombreuses communes dans l’impasse.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement entend-il réellement prendre cette question de la hausse du prix de l’énergie à bras-le-corps ? Nos communes pourront-elles encore assurer, demain, les services essentiels à leur population, tout en préservant la fiscalité locale et les investissements ? Il faut prendre leurs inquiétudes au sérieux.
La hausse sans précédent des prix de l’énergie s’inscrit effectivement dans un contexte de tension sur la disponibilité des installations de production électrique française et sur l’approvisionnement gazier en Europe.
Face à cette situation, le Gouvernement a décidé des mesures exceptionnelles pour préserver, à la fois, le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises. Je citerai notamment le chèque énergie, l’indemnité inflation et le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité.
S’agissant du gaz, les tarifs réglementés ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021, et ce pour tout l’hiver, avec, au besoin, un report de l’échéance à la fin de l’année 2022. L’État prendra en charge le surcoût induit par ce gel pour les fournisseurs, conformément aux dispositions que vous avez bien voulu adopter dans le cadre de la loi de finances pour 2022.
S’agissant de l’électricité, la hausse des tarifs réglementés du début de l’année 2022 sera limitée à 4 %, au lieu de près de 35 % si rien n’avait été fait. La taxation sur l’électricité est réduite pour un an à son niveau minimum prévu par le droit européen, à compter du 1er février prochain. Cela représente un coût budgétaire pour l’État de 8 milliards d’euros, directement au bénéfice des particuliers, des collectivités et des entreprises.
Des mesures complémentaires ont été annoncées en janvier. Nous avons décidé, à titre exceptionnel, d’augmenter de 20 térawattheures le volume d’électricité vendu à un prix réduit via le mécanisme de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Arenh) qui sera livré en 2022, afin que l’ensemble des consommateurs bénéficient de la compétitivité du parc électronucléaire français.
Ces volumes seront accessibles à tous les consommateurs – particuliers, collectivités, professionnels –, et ce quel que soit leur fournisseur. Les fournisseurs devront en effet répercuter intégralement l’avantage retiré au bénéfice des consommateurs ; ce point fera bien sûr l’objet d’une surveillance étroite, en lien avec la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.
Dans le même temps, pour assurer une juste rémunération de l’outil de production, qui contribue à la protection de l’ensemble des consommateurs français, le prix de ces volumes additionnels d’Arenh sera révisé à 46, 20 euros par mégawattheure. Ce prix couvre les coûts de production d’EDF, y compris les coûts de démantèlement et de gestion des déchets des centrales.
Les autorités européennes ont été informées de cette décision, qui s’inscrit dans le cadre de mesures exceptionnelles d’adaptation à une situation de crise.

Merci de ce rappel, madame la secrétaire d’État, mais ma question portait essentiellement sur les collectivités locales, dont les charges en termes d’énergie explosent. C’est, me semble-t-il, une dimension particulière de ce dossier et une problématique qu’il faut prendre à bras-le-corps.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, auteur de la question n° 2002, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Depuis des années, madame la secrétaire d’État, les maires ont dû assumer auprès de leurs concitoyens de nombreuses fermetures ou transferts de services publics, décidés sans concertation.
Une fois de plus, je suis saisi par un maire de l’Essonne – Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau – du projet de fermeture du bureau de poste situé dans le quartier Lozère.
Les élus et les habitants de ce quartier s’opposent bien évidemment à cette fermeture, et ce d’autant plus que le groupe La Poste s’était engagé en 2015 au maintien de son service postal au moins cinq matinées par semaine.
Faut-il rappeler, ici, la mission première de La Poste en matière de service public d’aménagement du territoire, au titre de laquelle elle est tenue de maintenir un réseau d’au moins 17 000 points de contact sur le territoire national ?
La Poste est amenée à adapter son réseau, et on peut le comprendre, mais elle doit le faire au bénéfice des usagers, en concertation avec les élus.
Le quartier Lozère accueille plus de 6 000 habitants, avec une forte proportion de seniors, dont le déplacement en centre-ville est particulièrement difficile. La présence d’un service postal de proximité leur est essentielle.
Aussi, pour lutter contre le projet de fermeture de ce bureau de poste, les élus et habitants de Palaiseau se mobilisent : ils sont plus de 1 000 à avoir déjà signé la pétition en ligne.
Que comptez-vous faire, madame la secrétaire d’État, pour lutter contre la désertification des services publics de proximité ?
Monsieur le sénateur Hugonet, cette crise sanitaire a confirmé, s’il en était besoin, le caractère essentiel des services postaux.
La Poste, dans ses missions de service public, doit évidemment, tout en adaptant celui-ci, assurer aux usagers un service de haute qualité. D’ailleurs, cette présence postale et le maintien d’un maillage fin de tous les territoires par les points de contact postaux et des horaires d’ouverture adaptés sont essentiels pour garantir cet accès à tous.
À cet égard, la loi fait obligation à La Poste de maintenir au moins 17 000 points de contact sur le territoire, répartis de telle sorte que 90 % de la population d’un département se trouve à moins de cinq kilomètres ou de vingt minutes en voiture de l’un d’entre eux.
Cette obligation légale est respectée dans le département de l’Essonne, puisque 99, 1 % de la population est à moins de cinq kilomètres et à moins de vingt minutes en voiture d’un point de contact. Au 1er janvier 2021, cette offre postale s’appuie sur 151 points de contact, 95 bureaux en gestion directe, 35 agences postales gérées par des agents territoriaux dans le cadre de conventions et 21 relais poste gérés par des commerçants dans le cadre de conventions de partenariat.
La Poste doit effectivement faire face à l’évolution de nos habitudes, à la baisse de fréquentation de ses bureaux et, par conséquent, adapter les modalités de sa présence physique en fonction des spécificités des territoires. Comme vous, nous sommes attentifs à cette proximité.
Interrogée par mes services, La Poste nous a indiqué que, dans l’Essonne, un projet de transformation est en cours de discussion, celui du bureau de poste de Palaiseau-Lozère, une ville qui dispose aujourd’hui de quatre points de contact pour 39 000 habitants.
Les consultations se poursuivent, et un nouveau rendez-vous a été proposé au maire de la ville.
Je me veux donc rassurante : il n’existe aucun autre projet de transformation de bureaux de poste dans le département. La direction régionale de La Poste a d’ailleurs, le 10 novembre dernier, adressé une réponse en ce sens au maire de Viry-Châtillon.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie. Je conçois que, entre le secrétariat d’État chargé de la biodiversité et La Poste, il y ait une marge et que vous soyez contrainte par les deux minutes dont vous disposez pour votre réponse.
J’engage toutefois respectueusement la personne qui a rédigé votre réponse à venir en Essonne quand elle le souhaite afin de constater exactement ce qu’il en est.
En tout état de cause, ce ne sont pas des confettis de paroles qui vont rassurer les élus !

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteure de la question n° 2077, adressée à Mme la ministre de la culture.

Madame la secrétaire d’État, permettez-moi d’appeler l’attention de la ministre de la culture sur la situation d’abandon, depuis dix-huit ans, du musée Hébert, situé dans le VIe arrondissement de Paris.
Ce dossier m’a été signalé par le maire de l’arrondissement, Jean-Pierre Lecoq.
Inauguré en 1978, ce musée national a fermé en 2004 pour des raisons de sécurité. Il est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Installé dans un hôtel particulier dont la façade est classée monument historique, le musée abrite les œuvres d’Ernest Hébert, portraitiste mondain renommé de la seconde moitié du XIXe siècle.
Ce musée est issu des donations consenties à l’État pour ses collections et à la Réunion des musées nationaux pour son bâtiment par René Patris d’Uckermann, fils adoptif de la veuve de l’artiste, qui, en outre, a institué la Fondation de France légataire universel en l’absence d’héritiers directs.
Un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles sur l’avenir du musée Hébert proposait en 2017 une solution qui permettait sa réouverture dans les conditions acceptées par l’État. Madame la secrétaire d’État, pourquoi cette voie n’a-t-elle pas été suivie ?
Madame la sénatrice Dumas, vous le soulignez, la situation du musée national Ernest Hébert est très particulière et très délicate.
Depuis sa fermeture, en 2004, parce que les conditions pour accueillir le public en toute sécurité n’étaient plus réunies, l’État, en particulier le ministère de la culture, n’a cessé de rechercher des solutions. Diverses pistes ont été explorées, sans toutefois qu’aucune d’entre elles se soit imposée et ait abouti.
Cette situation tient essentiellement à l’enchevêtrement à la fois des responsabilités et des problématiques à résoudre entre les différentes parties que sont l’État, qui possède la collection, le musée d’Orsay, auquel est rattaché le musée national Ernest Hébert, l’établissement public de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, qui possède l’immeuble de la rue du Cherche-Midi, et, enfin, la Fondation de France, qui est légataire universel du donateur René Patris d’Uckermann, et qui veille à ce titre au respect des volontés de ce dernier.
Toute avancée dans ce dossier suppose donc de trouver une solution équilibrée qui convienne à l’ensemble des parties. Celle-ci devra tenir compte à la fois des enjeux culturels – la valorisation de l’œuvre du peintre –, des enjeux patrimoniaux, pour permettre à la collection d’être conservée dans de bonnes conditions, des enjeux juridiques, afin de respecter les volontés du donateur, et des enjeux financiers.
Le ministère de la culture, loin d’abandonner ce musée, s’emploie très activement, avec l’ensemble des parties, à rechercher cette issue pérenne. La mairie du VIe arrondissement de Paris, dont les efforts pour contribuer à trouver une solution sont à saluer, en sera informée dès que celle-ci se dessinera.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, mais permettez-moi de regretter que la ministre de la culture n’ait pas pu venir répondre à cette question importante, qui concerne un dossier pendant depuis fort longtemps.
Le 28 juillet dernier, j’ai adressé une lettre à la direction générale des patrimoines et de l’architecture pour lui demander de me transmettre les conclusions de l’étude qu’elle a menée : je ne les connais toujours pas !
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’indiquer à votre collègue chargée de la culture qu’il conviendrait de réunir tous les acteurs du dossier, notamment la mairie du VIe arrondissement, pour faire le point rapidement afin de sauvegarder ce remarquable bâtiment parisien.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, auteure de la question n° 1914, adressée à Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Madame la ministre, la lutte contre le terrorisme doit bien évidemment mobiliser tous les moyens de l’État, mais dans le respect de l’État de droit, notamment, si cela est nécessaire – et nous savons que tel est le cas –, en accroissant les moyens du renseignement.
Or on observe une utilisation dévoyée d’autres moyens de l’État, notamment de l’inspection du travail. Plus grave encore, en période de pandémie, alors qu’elle devrait se consacrer pleinement à ses missions de protection des salariés, on a demandé à certains inspecteurs d’effectuer des contrôles qui ne relèvent pas de leurs missions. Cela contrevient non seulement aux règles de l’État de droit, mais aussi aux conventions internationales qui nous lient, en particulier celles de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Madame la secrétaire d’État, quels moyens ont été mis en œuvre pour que soient respectées les missions de l’inspection du travail, ce qui est essentiel pour la préservation de notre État de droit ? La réforme de l’organisation territoriale de l’État n’induit-elle pas des effets pervers majeurs, notamment par la mise à disposition, sous le couvert des préfets et des préfètes, de moyens de l’inspection du travail, qui devrait être indépendante, au risque de faire peser un grave danger sur la protection des salariés ?
Madame la sénatrice, je peux vous assurer que les agents de l’inspection du travail exercent leur activité dans un cadre leur permettant de garantir leur indépendance, conformément à l’article 6 de la convention n° 81 de l’OIT, que vous mentionnez.
Le code du travail prévoit que les agents de contrôle de l’inspection du travail ont pour mission de contrôler l’application du droit du travail ; ils n’ont pas, dans ce cadre, pour mission de lutter contre le séparatisme.
Je le dis clairement : les agents de l’inspection du travail n’ont pas vocation à être mobilisés dans le cadre d’actions ayant pour seule fin la lutte contre le séparatisme et n’ayant aucun lien avec la protection des travailleurs et le respect de la législation du travail.
Pour autant, ces agents peuvent être amenés à contribuer, dans le cadre de leurs missions et prérogatives, à des actions coordonnées en lien avec leurs missions habituelles, comme la lutte contre le travail illégal. En effet, les directions départementales et régionales de l’emploi participent aux différentes instances de coordination interministérielle, notamment les comités opérationnels départementaux anti-fraude (Codaf).
Par ailleurs, il faut rappeler que chaque inspecteur du travail qui aurait connaissance de faits susceptibles de constituer un délit en dehors du droit du travail doit le porter à la connaissance du parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
L’inspection du travail peut donc être amenée à contribuer indirectement à des actions ayant pour visée la lutte contre le séparatisme, mais toujours dans le plein respect de ses prérogatives, de ses capacités d’action et, bien sûr, de son indépendance.

Madame la ministre, le nombre d’inspecteurs du travail a baissé ces dernières années, cependant que les salariés expriment des besoins très forts pour que soit garantie la protection de leur santé et de leurs droits.
Il est urgent d’agir pour que ces moyens ne soient pas dévoyés, surtout si c’est pour mener une politique de harcèlement sans visée réelle et sans qu’il soit possible de savoir si le cadre légal a été respecté.

La parole est à M. Rémi Cardon, auteur de la question n° 1996, adressée à Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Madame la ministre, voilà déjà un an, je déposais une proposition de loi tendant à ouvrir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) dès 18 ans pour répondre au péril qui menace de notre jeunesse.
À l’époque, vous aviez jugé, en dépit de l’urgence sociale, des difficultés liées à la crise sanitaire, de sa détresse financière et psychologique, des files d’attente devant les banques alimentaires, que notre jeunesse méritait mieux qu’un RSA.
Alors, madame la ministre, je vais peut-être vous surprendre, mais, sur ce point, je suis d’accord avec vous. Hélas ! le mieux est l’ennemi du bien, et vous l’avez démontré.
Vous nous avez annoncé la garantie jeunes universelle, qui pourrait être un bon dispositif si elle ne se limitait pas à 200 000 bénéficiaires.
Puis, vous avez annoncé un nouveau dispositif, le revenu d’engagement pour les jeunes, bizarrement devenu « contrat d’engagement jeune », qui devait bénéficier à 1 million des jeunes. Finalement, 400 000 en bénéficieront, dont 300 000 sont déjà attributaires de la garantie jeunes ou relèvent de l’accompagnement intensif des jeunes (AIJ).
Une année plus tard, j’ai un sentiment de déjà-vu. Un jeune sur six a arrêté ses études, 26 % des jeunes sont au chômage et un tiers d’entre eux renoncent parfois à se soigner. Sans compter que les files d’attente réapparaissent, pour notre plus grande honte.
Madame la ministre, quand comptez-vous aller au-delà des effets d’annonce et, enfin, non pas accompagner la jeunesse, mais lui porter secours, alors qu’elle est plus que jamais en souffrance ? L’urgence est là.
Monsieur le sénateur, vous proposez un RSA jeune ; nous, nous préférons le contrat d’engagement jeune. D’ailleurs, l’Assemblée nationale, à deux reprises au cours de cette législature, a rejeté l’idée d’un RSA jeune.
Nous croyons en effet dans la capacité de tous les jeunes à accéder à un emploi durable. L’objectif du Gouvernement, avec le contrat d’engagement jeune, est de garantir à chaque jeune une insertion professionnelle réussie.
Le constat de départ, c’est qu’en France, la période entre la fin de la scolarité et le premier emploi, en particulier pour les décrocheurs, est trop longue.
Pour changer cela, la première étape est de réussir à remettre le jeune en activité le plus vite possible, par des formations, des immersions en entreprise, des services civiques et un accompagnement soutenu. C’est pour cela que nous créons un dispositif cohérent qui allie accompagnement intensif et mise en activité, bien sûr en sécurisant financièrement le jeune lorsqu’il en a besoin.
Monsieur le sénateur, vous faites également référence aux invisibles, qui sont les plus en difficulté. Nous ne les oublions pas, au contraire : nous estimons qu’il faut mener des politiques conçues sur mesure pour eux.
Le premier défi, c’est d’aller les chercher. Pour y arriver, le service public de l’emploi ne suffit pas. Beaucoup de jeunes, en particulier les plus éloignés, ne passent plus les portes des missions locales et de Pôle emploi.
C’est pourquoi nous souhaitons nous appuyer sur les associations de lutte contre la pauvreté pour leur proposer un parcours sur mesure. Ces jeunes bénéficieront d’un accompagnement non seulement professionnel, mais aussi social. Enfin, ils pourront bénéficier chaque mois d’une allocation de 500 euros.

Madame la ministre, vous avez essayé de répondre à la question, mais vous avez oublié de revenir sur les faits, c’est-à-dire les chiffres que je vous ai indiqués. De fait, la situation n’a pas changé depuis un an, malgré vos prétendues actions.
Vous avez parlé des jeunes qui ne sont « ni en emploi, ni en études, ni en formation » (NEET). On en compte aujourd’hui 1, 2 million ! Or votre dispositif s’adresse à 300 000 ou 400 000 jeunes. Qu’en est-il des autres ?

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, auteur de la question n° 1993, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail.

Madame la ministre, d’après l’Insee, le niveau de vie médian des retraités est légèrement supérieur à celui du reste de la population, mais ce constat cache de fortes disparités parmi les retraités. En effet, 37 % d’entre eux perçoivent une pension mensuelle de droit direct inférieure à 1 000 euros brut par mois, ce qui correspond au seuil de pauvreté pour une personne seule.
Certaines catégories socioprofessionnelles sont particulièrement concernées par cette précarité économique. Il s’agit notamment des non-salariés et de certains indépendants, comme les exploitants agricoles et leurs conjoints collaborateurs, ou encore les artisans et les commerçants.
Pour le secteur agricole, la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, depuis le 1er novembre 2021, aux exploitants agricoles de percevoir une pension à hauteur de 85 % du SMIC, ce qui reste peu.
Après l’abandon par le Gouvernement du projet de réforme des retraites, la question de la revalorisation des petites retraites n’a pas été envisagée dans son ensemble. Aujourd’hui encore, d’autres retraités perçoivent une pension d’un montant trop faible et sont ainsi proches du seuil de pauvreté, alors qu’ils ont travaillé et cotisé tout au long de leur carrière.
C’est notamment le cas de certains artisans et commerçants, qui, souvent, découvrent la faiblesse de leur future pension quelques mois seulement avant leur départ à la retraite, comme le relève le rapport Turquois-Causse sur les petites pensions de retraite, remis au secrétaire d’État chargé des retraites et de la santé au travail le 10 mai 2021.
Aussi, madame la ministre, je vous interroge sur les solutions envisagées par le Gouvernement pour revaloriser les pensions les plus faibles des artisans et commerçants, que ce soit par la réhabilitation des cotisations sociales ou par le biais de mécanismes de solidarité. Est-il envisagé, sur le modèle de ce qui a été fait pour les exploitants agricoles, de leur garantir une retraite minimale ?
Monsieur le sénateur, vous rappelez que, grâce à notre modèle de protection sociale, le niveau de vie des retraités est globalement plus élevé que celui du reste de la population. Nous devons le protéger.
Il existe néanmoins un nombre important de petites retraites : c’est l’objet du rapport remis à Laurent Pietraszewski par les députés Causse et Turquois. Le faible montant de ces retraites est avant tout dû aux interruptions de carrière ou aux temps partiels prolongés. Les travailleurs indépendants, dont les anciens commerçants, sont concernés en raison de l’émergence tardive d’un régime obligatoire de retraite complémentaire.
Le Gouvernement, à travers deux propositions de loi votées à l’unanimité, a déjà œuvré en faveur des petites pensions en revalorisant les minima de pension des retraités agricoles.
Permettez-moi aussi de rappeler les mesures mises en place durant ce quinquennat en faveur du pouvoir d’achat des retraités modestes, à savoir l’augmentation de 100 euros du minimum vieillesse, qui dépasse désormais les 900 euros mensuels pour une seule personne, mais aussi l’amélioration continue du droit à l’information, qui permet d’anticiper en amont le niveau de sa retraite.
Concernant la mise en place d’une garantie de pension minimale pour les artisans et commerçants, dans la droite ligne des enseignements du rapport Turquois-Causse, l’approche des minima de pension ne peut être que globale, la question des petites retraites touchant tous les publics. La réponse à cette difficulté d’une grande complexité technique nécessite un véhicule législatif spécifique ainsi qu’un financement dédié.
Le coût d’un tel dispositif sera nécessairement important – jusqu’à 2, 5 milliards d’euros selon le rapport précité. C’est pourquoi le Président de la République a appelé de ses vœux une réforme des retraites qui permettrait à une personne ayant effectué une carrière complète de percevoir une pension mensuelle égale à au moins 1 000 euros, indépendamment de son statut.

La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 2065, transmise à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Madame la ministre, de nombreuses communes rurales rencontrent des difficultés à recruter des secrétaires de mairie.
La maire d’une commune du pays de Bray me disait récemment le refus du centre de gestion de Seine-Maritime d’affecter une personne sur un poste de remplacement au motif de sa prétendue timidité. Résultat : la commune a dû faire appel à Pôle emploi.
Il manque une cinquantaine de secrétaires de mairie dans mon département. Combien au niveau national ? C’est ma première question.
Appui essentiel des élus, les secrétaires de mairie ont vu leur cadre d’emploi s’éteindre. Dans les communes de plus de 2 000 habitants, elles ont été reconnues comme fonctionnaires de catégorie A, mais, dans les plus petites communes, ce sont des catégories B et C qui constituent le « gros des troupes », si je puis dire.
Elles – car ce sont souvent des femmes – disent manquer de formation pour assurer la multiplicité de leurs missions, très étendues, et pour faire face à l’isolement qu’elles vivent du fait du recul des services publics et de la présence de l’État en milieu rural.
Leur grille indiciaire est très éloignée de leurs responsabilités, avec un traitement à peine plus élevé que le SMIC dans beaucoup de cas.
Du fait du manque d’attractivité du métier, il sera difficile de remplacer les départs à la retraite massifs prévus dans les prochaines années.
Face à cela, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) a formulé des propositions, mais le changement de nom, annoncé par le Gouvernement, et une maigre revalorisation salariale risquent de ne pas suffire.
Madame la ministre, quelles autres pistes envisagez-vous pour revaloriser ce métier ? Envisagez-vous de créer un véritable cadre d’emploi permettant une meilleure reconnaissance ? Quels moyens le Gouvernement est-il prêt à consentir aux communes rurales pour qu’elles puissent concrétiser des augmentations de revenus ?
Madame la sénatrice, les secrétaires de mairie constituent effectivement un maillon essentiel au bon fonctionnement des communes.
Le Gouvernement est particulièrement engagé sur ce sujet. Ainsi, Amélie de Montchalin et Jacqueline Gourault ont pris plusieurs mesures à l’issue de nombreuses concertations et rencontres avec les secrétaires de mairie, comme cela a été annoncé lors d’un récent déplacement dans le Loiret de la première, accompagnée de son collègue Joël Giraud.
En premier lieu, une revalorisation des fonctions de secrétaire de mairie entrera bientôt en vigueur. La nouvelle bonification indiciaire des secrétaires exerçant dans les communes de moins de 2 000 habitants sera revalorisée à hauteur de 15 points d’indice majoré.
Cette revalorisation s’accompagnera effectivement d’une nouvelle dénomination de ces fonctions, plus valorisante, et permettant mieux d’identifier l’intérêt des missions qu’elles recouvrent pour les candidats potentiels : celles de secrétaire général de mairie.
En second lieu, s’agissant du volet recrutement et formation, Amélie de Montchalin a mobilisé le directeur général de Pôle emploi pour accompagner les communes dans le recrutement des secrétaires de mairie et pris l’initiative de coordonner un échange entre les différents acteurs concernés, notamment Pôle emploi, l’AMF et la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCDG) afin de soutenir les besoins de recrutement des communes et la montée en compétences des secrétaires de mairie.
Concrètement, ces échanges permettront de consolider les dispositifs déjà mis en place sur notre territoire, le plus souvent sur l’initiative des collectivités et de leurs élus, pour dynamiser le recrutement des secrétaires de mairie.

La revalorisation salariale que vous évoquez est évidemment bienvenue, même si elle me semble insuffisante, mais ma question portait aussi sur le soutien aux communes.
Chaque fois que le traitement des secrétaires de catégories C, par exemple, est revalorisé pour atteindre le niveau du SMIC, c’est à la seule charge des communes, dont on connaît l’état des finances. Il faut que l’État soutienne les communes pour leur permettre de financer ces augmentations et, ainsi, revaloriser les carrières.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, auteur de la question n° 2086, adressée à Mme la ministre des armées.

Madame la ministre, ma question, quelque peu technique, porte sur la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, plus particulièrement sur son article 25, qui concerne les archives publiques, sur lequel le Conseil constitutionnel a émis deux réserves majeures d’interprétation.
Premièrement, il a indiqué que ce dispositif ne saurait être rétroactif. Pour dire les choses clairement, toutes les archives qui étaient communicables avant ce texte le resteront après.
Ma question est simple : comment allez-vous, concrètement et pratiquement, assurer le respect de cette obligation ?
Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a considéré que la constatation matérielle du délai glissant qui concerne certaines installations pouvait être faite par d’autres moyens qu’un acte publié, ce que prévoit le texte de loi. Quelles instructions allez-vous donner à vos services pour que la fin de l’affectation des installations en question puisse être contrôlée par d’autres moyens que ceux qui sont indiqués dans la loi ?
En outre, lors des débats dans l’hémicycle, la ministre des armées nous avait indiqué que les missions de renseignement exercées à titre principal seraient sans doute limitées au service du premier et du deuxième cercles, cette précision devant être apportée par un décret en Conseil d’État publié à la fin de ce mois. Qu’en est-il ?
Enfin, les services se sont aperçus que cette loi, qui devait ne concerner que très peu d’actes, en concerne en fait énormément. Ainsi, près de deux kilomètres linéaires d’archives resteront inaccessibles.
Monsieur le sénateur, les dispositions relatives à l’accès aux archives les plus sensibles s’appliquent depuis six mois.
Rassurez-vous, le Service historique de la défense (SHD) n’a pas bloqué la consultation des archives susceptibles d’être concernées par un allongement du délai de cinquante ans ; au contraire, l’examen de la communicabilité de chaque archive est mené au fil de l’eau, en fonction de chaque demande d’accès.
Cette mise en œuvre requiert un surcroît d’engagement de la part des personnels, que je tiens à saluer, mais n’entraîne aucune difficulté majeure avérée.
Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, que vous avez évoquées, ne soulèvent pas non plus de difficultés particulières.
Si les informations contenues dans un document classifié sont déjà connues du public, alors aucune prolongation de l’incommunicabilité au-delà de cinquante ans n’est possible.
De même, est pleinement mis en œuvre le principe de non-application de la loi nouvelle aux documents non classifiés ou formellement déclassifiés : les documents qui étaient déclassifiés le restent.
La seconde réserve n’exige aucune démarche particulière de la part des archives et du Service historique de la défense. Les services compétents doivent constater par un acte la désaffection de toute installation militaire, acte qui sera signalé au SHD.
Si une installation devait se trouver désaffectée sans que cela ait été officiellement constaté, l’usager pourrait apporter lui-même la preuve de cette désaffection, le SHD ne pouvant écarter celle-ci au seul motif de l’absence d’une constatation officielle.
Enfin, concernant le décret d’application désignant les services de renseignement du ministère de l’intérieur concernés par ces nouvelles dispositions, il sera publié en mars prochain.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1954, adressée à Mme la ministre des armées.

Madame la ministre, membre du Conseil supérieur de la réserve militaire, j’ai été, à ce titre, interpellé sur le sujet de l’honorariat au grade supérieur pour les réservistes opérationnels devant quitter la réserve par atteinte de la limite d’âge.
Lorsqu’ils quittent la réserve militaire ou quand ils en sont radiés, les officiers, sous-officiers et militaires du rang peuvent, à leur demande, se voir accorder l’honorariat du dernier grade détenu à titre définitif.
Depuis le 30 septembre 2019, les militaires qui quittent la réserve opérationnelle et demandent l’honorariat de leur grade peuvent dorénavant être proposés par l’autorité militaire au grade immédiatement supérieur dans leur corps d’appartenance. Dès lors, aucune démarche individuelle ne serait nécessaire. La sélection, qui resterait exceptionnelle, serait opérée par la direction des ressources humaines, la direction du personnel de l’armée ou la direction ou le service d’appartenance parmi les postulants les plus méritants remplissant les conditions.
Dans les faits, il s’avère que ce nouveau décret connaîtrait des difficultés d’application ; il semblerait que les services attendent qu’une instruction soit prise.
La réserve opérationnelle est un acteur majeur du travail de nos armées dont les personnels dévoués ne comptent ni leur temps ni leur énergie. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que les compétences professionnelles qu’ils apportent sont souvent décisives au bon déroulement du service et viennent compléter le travail des militaires d’active, facilitant leur quotidien ou permettant ponctuellement de soutenir les opérations.
En outre, la réserve opérationnelle est un élément essentiel du lien entre l’armée et la Nation.
En tout état de cause, il apparaît nécessaire de la valoriser et de faciliter son développement.
Ma question est simple, madame la ministre : pourquoi la mise en œuvre des dispositions encadrant le passage à l’honorariat au grade supérieur connaît-elle des difficultés ? Quels projets portez-vous pour valoriser la réserve opérationnelle ?
Monsieur le sénateur, vous le savez, le ministère des armées a mis en place le dispositif d’honorariat au grade immédiatement supérieur par décret du 30 septembre 2019 afin de valoriser l’engagement des réservistes opérationnels les plus méritants.
Intégré à l’article R. 4211-6 du code de la défense, il est aujourd’hui immédiatement applicable par les autorités militaires qui souhaiteraient proposer leurs réservistes au regard de cette condition.
Cependant, l’obtention de l’honorariat au grade immédiatement supérieur n’est pas de droit. C’est ce caractère exceptionnel de l’attribution qui constitue l’essence même de cette mesure, en assurant une meilleure valorisation des engagements qui, par leur fréquence, leur durée et leur qualité, appellent une reconnaissance particulière.
La procédure décrite par le code de la défense sera prochainement révisée, à la lumière des conclusions et des recommandations du groupe de travail constitué de représentants de l’ensemble des forces armées et des formations rattachées.
Par souci d’équité et de reconnaissance de l’engagement de tous les militaires, il convient de veiller à la cohérence des critères conduisant à l’attribution de l’honorariat au grade immédiatement supérieur, notamment afin d’éviter qu’un réserviste opérationnel puisse ainsi obtenir un grade dans des conditions moins restrictives que celles qui sont prévues pour la promotion des militaires d’active.
Vous le savez, la garde nationale a fait un important travail sur les sujets de la réserve opérationnelle et des formes d’engagement. C’est bien la singularité du statut des réservistes opérationnels, militaires à part entière lorsqu’ils accomplissent leur engagement, qui permet cette intégration. Ils sont ainsi assujettis aux mêmes obligations et aux mêmes droits que leurs camarades d’active, et perçoivent à ce titre la même solde.
Enfin, la relation avec les employeurs des volontaires dans les réserves opérationnelles constitue le noyau fort des politiques menées au titre de la garde nationale.
Nous serons donc attentifs à cette question, mais – vous le comprenez parfaitement –, il nous faut garder un équilibre.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. J’espère simplement que la situation évoluera assez rapidement, dans la mesure où le même type de réponse a déjà été apporté par le passé.
Je connais les difficultés liées à ce dossier, mais je souhaite que vous le suiviez de près pour qu’il puisse avancer, car nos réservistes doivent être intégrés dans les meilleures conditions.
Je n’ai par ailleurs pas prétendu que l’accession à l’honorariat devait être automatique : elle revêt au contraire un caractère tout à fait exceptionnel.

La parole est à Mme Martine Filleul, auteure de la question n° 2017, adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Madame la ministre, au Moyen-Orient, la violence qui s’abat sur les Palestiniens s’accroît inexorablement.
Depuis près de quatorze ans, le gouvernement israélien impose à Gaza un blocus aux conséquences désastreuses. Les activités de colonisation, y compris l’annexion de fait de la Cisjordanie par Israël, les démolitions et les expulsions se poursuivent, réduisant chaque jour les perspectives d’une solution négociée entre les parties.
Le 22 octobre 2021, le gouvernement israélien a inscrit six organisations palestiniennes de défense des droits humains sur sa liste des organisations terroristes, arguant de leurs liens avec le Front populaire de libération de la Palestine. Cette décision, prise sans fournir aucun élément de preuve et dénoncée par l’ONU, va assécher les ressources de ces organisations et priver de nombreux bénéficiaires de l’aide qu’elles apportent.
Plus grave encore, dans un récent rapport, l’organisation Human Rights Watch indique que la domination systématique des Israéliens sur les Palestiniens, l’ensemble des actions discriminatoires menées à leur encontre, combinées à une répression particulièrement sévère, équivalent aux crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution – j’y insiste ! – tels que définis par le droit international.
Cette organisation a également documenté de graves violations des lois de la guerre et d’apparents crimes de guerre lors des hostilités de mai dernier, notamment des frappes israéliennes à Gaza qui ont tué de nombreux civils.
Madame la ministre, où est donc la France dans la dénonciation de ces crimes ? Que fait-elle réellement pour les empêcher ?
Je vous prie de bien vouloir excuser, madame la sénatrice, l’absence de M. Jean-Yves Le Drian, empêché, qui m’a demandé de vous apporter la réponse suivante.
Permettez-moi, tout d’abord, de rappeler l’attachement de la France à la liberté d’expression et d’action des organisations de la société civile, dont le rôle est indispensable à la vie démocratique, en Israël et dans les territoires palestiniens comme partout dans le monde.
En ce sens, nous souhaitons que les sociétés dans toutes leurs composantes, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), puissent bénéficier d’un espace et de conditions respectueuses de l’État de droit et des libertés fondamentales.
Il est de la responsabilité des États de préserver un environnement libre, sûr et ouvert pour que les organisations de la société civile puissent jouer pleinement leur rôle et poursuivre leur travail. C’est une position que nous rappelons avec clarté et exigence à l’occasion de chacun de nos contacts avec les autorités israéliennes comme auprès de l’Autorité palestinienne, à titre bilatéral et aux côtés de nos partenaires européens.
Nous prenons la pleine mesure de la désignation par les autorités israéliennes de six organisations non gouvernementales palestiniennes humanitaires et de défense des droits de l’homme comme organisations terroristes, ainsi que des conséquences de cette décision pour le travail humanitaire et la défense des droits de l’homme en Israël et dans les territoires palestiniens.
La porte-parole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a exprimé publiquement, le 26 octobre dernier, nos préoccupations au sujet de cette décision, qui concerne notamment une ONG ayant reçu le prix des droits de l’homme de la République française en 2018. Cette décision contribue au rétrécissement de l’espace de la société civile dans les territoires palestiniens.
Nous avons donc engagé des démarches pour demander des éclaircissements aux autorités israéliennes sur les raisons de cette décision, et nous leur avons fait part, conjointement avec nos partenaires européens, de nos préoccupations quant à ses conséquences sur le terrain.
Soyez assurée, madame la sénatrice, que la France demeure mobilisée en faveur de ces organisations et continuera de leur apporter son soutien, en pleine conformité avec la législation française et avec les exigences rigoureuses de contrôle et de vérification qu’elle emporte.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1777, adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Madame la ministre, plus de 200 enfants et leurs mères sont actuellement détenus dans les camps de Roj et d’Al-Hol dans le nord-est de la Syrie. Cette situation qui s’éternise est humainement inacceptable. Notre pays doit prendre ses responsabilités pour les sortir de ces prisons aux conditions de vie extrêmement dégradées. Il s’agit de mineurs français en situation de détresse matérielle et morale, et de danger grave et immédiat.
De plus en plus de voix s’élèvent pour que ces enfants ne soient pas abandonnés. Le Parlement européen a notamment voté une résolution en février de l’an passé, appelant au rapatriement de tous les enfants européens dans leur « intérêt légitime ».
Belgique, Finlande et Danemark ont annoncé leur décision de faire revenir l’ensemble de leurs ressortissants. L’Allemagne et l’Italie ont commencé à faire de même. États-Unis, Russie, Kosovo, Ukraine, Bosnie et Albanie agissent de manière identique.
Très récemment, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik appelait opportunément le Président de la République à rapatrier ces enfants ainsi que leurs mères. Ces dernières font déjà l’objet d’une procédure judiciaire antiterroriste et d’un mandat d’arrêt international délivré par un juge français. Elles seraient donc incarcérées et jugées sur notre territoire.
Nous sommes convaincus que laisser ces femmes et ces enfants dans les camps syriens peut mener irrémédiablement au terrorisme de demain.
Les enfants ne sont pas responsables des erreurs et des fautes des adultes : leur retour sur notre territoire national s’impose afin qu’ils soient entourés, protégés, éduqués et bénéficient d’un indispensable soutien affectif.
C’est pourquoi je vous demande, madame la ministre, d’agir sans délai pour le rapatriement de l’ensemble de ces enfants, ainsi que de leurs mères.
Monsieur le sénateur, nous concevons l’incompréhension et le désarroi de ceux qui ont vu partir un fils ou une fille. J’en mesure l’étendue, surtout dans les circonstances humainement très dures que vous évoquez.
Les personnes adultes, hommes et femmes, qui sont aujourd’hui détenues ou retenues dans des camps de réfugiés et de déplacés du Nord-Est syrien ont pris la décision de rejoindre les rangs de Daech, organisation terroriste qui s’est livrée à des exactions avant tout contre ses victimes syriennes et irakiennes.
Il ne saurait y avoir d’impunité pour de tels crimes. Ces hommes et ces femmes doivent être jugés au plus près du lieu où ils ont commis leurs crimes. C’est une question de sécurité et de justice à l’égard des victimes.
Il s’agit d’un véritable défi juridique international. La lutte contre l’impunité de ces combattants de Daech doit être traitée collectivement avec nos partenaires de la coalition internationale, et nous y travaillons, en tenant compte du caractère à la fois très grave et proprement exceptionnel des actes commis dans cette région entre la création du califat territorial de Daech et sa chute.
À la différence de leurs parents, les enfants n’ont pas choisi de rejoindre la cause d’une organisation terroriste.
Notre priorité absolue est de ramener ces enfants. Ces opérations de rapatriement sont extrêmement difficiles à mener, car il s’agit d’une zone de guerre, encore très dangereuse, sur laquelle nous n’avons aucun contrôle effectif. Dès que nous le pouvons, nous organisons de telles opérations, mais cela demande un travail de préparation très ardu et de longues négociations avec les forces locales.
Nous soutenons par ailleurs le travail précieux que les organisations humanitaires internationales mènent à leur endroit.

Madame la ministre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) doit statuer très prochainement sur le respect des droits de l’enfant par la France dans ce dossier.
Il serait bon que nous prenions des décisions rapides. Je sais que les rapatriements ont commencé. Il faut véritablement les accentuer pour que notre pays ne soit pas condamné par la justice européenne.

La parole est à M. Didier Rambaud, auteur de la question n° 1997, adressée à M. le ministre délégué ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.

Madame la ministre, je souhaite vous interpeller au sujet du label « station classée de tourisme ».
L’arrêté du 16 avril 2019, modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, impose désormais, sur le territoire des communes candidates à ce classement, la présence de certains commerces : plus précisément, de services de restauration, de commerces de bouche, d’un service bancaire, d’un service de consommation courante, d’un marché forain hebdomadaire en haute saison touristique et d’une pharmacie.
Sur le point précis de la présence d’une pharmacie, la rédaction de l’arrêté de 2008 prévoyait « la présence d’un professionnel de santé ou d’une offre de soins dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile ». La différence de rédaction entre les deux arrêtés est primordiale.
En effet, si les communes touristiques peuvent et doivent agir pour répondre au cadre posé par l’État, cela ne peut s’entendre que dans les domaines où elles ont une capacité réelle à agir.
On peut par exemple imaginer de la part des communes candidates pour accéder au label « station classée de tourisme » une mobilisation pour assurer la présence d’un restaurant, d’un commerce de bouche ou encore d’un marché forain.
En revanche, l’implantation d’une officine de pharmacie est des plus complexes. En effet, entre autres critères, le code de la santé publique indique que l’ouverture d’une officine n’est possible que dans les communes de plus de 2 500 habitants.
Par conséquent, la nouvelle rédaction de l’arrêté de 2019 interdira de fait l’accès au label « station classée de tourisme » à toutes les communes de moins de 2 500 habitants.
À l’heure où le Gouvernement annonce des plans de reconquête et de transformation du tourisme, une telle mesure inquiète.
J’ai été saisi de telles craintes par plusieurs communes, notamment celle de Vaujany, dans mon département. Ce sont au total plus d’une trentaine de communes qui sont en phase de perte de classement au niveau national. Vous comprendrez que pour celles-ci, la perte du label « station classée de tourisme » constituerait un mauvais signal économique.
Madame la ministre, quelle réponse pouvez-vous apporter aux craintes de ces petites communes de montagne ?
Je vous prie de bien vouloir excuser, monsieur le sénateur, l’absence de M. Jean-Baptiste Lemoyne, empêché, qui m’a demandé de vous apporter la réponse suivante.
La qualification de station classée constitue, pour une commune, la reconnaissance d’une politique touristique d’excellence et de la qualité des services rendus aux touristes. Le classement en station de tourisme est le second niveau de reconnaissance de l’État en matière touristique, le premier étant la dénomination en commune touristique.
L’article L. 133-13 du code du tourisme dispose : « Seules les communes touristiques […] qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme[.] »
Cette reconnaissance d’excellence ne peut donc être décernée qu’à des communes remplissant l’ensemble des critères définis par la réglementation.
Depuis l’arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008, les critères ont été simplifiés. La réforme a permis de les rationaliser et de supprimer les moins pertinents : 23 critères sont désormais à remplir, contre 45 auparavant.
Parmi ces critères, l’attention a été portée sur une meilleure prise en compte des besoins et attentes des touristes, notamment pour ce qui concerne l’accès aux services de proximité.
À ce titre, il a été admis que la présence d’une pharmacie sur le territoire d’une commune prétendant au classement en station de tourisme constituait un service de proximité indispensable. S’agissant des autres professionnels de santé, ils peuvent se trouver dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile.
De plus, l’établissement de ces critères a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs institutionnels du tourisme, notamment les représentants des élus des territoires touristiques. Ces derniers ont validé ces critères, y compris celui portant sur l’implantation d’une pharmacie.

Je vous remercie, madame la ministre, mais vous n’apportez pas de réponse à l’interpellation de ces petites communes de montagne qui risquent de perdre ce label, ce qui serait regrettable. Nous allons continuer nos démarches…

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.