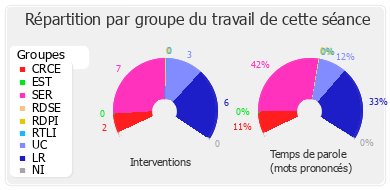Séance en hémicycle du 5 octobre 2010 à 9h45
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Rentrée scolaire 20102011 dans le département de savoie : orientations budgétaires (voir le dossier)
- Graves difficultés des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées et âgées (voir le dossier)
- Marché de fourniture de médicaments dérivés du sang entre le service de santé des armées et une société suisse (voir le dossier)
- Difficultés rencontrées par les services départementaux d'incendie et de secours pour le calcul des contributions communales et intercommunales au sdis (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures quarante.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 977, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, le règlement européen n° 479/2008 prévoit la suppression des droits de plantation à compter de 2015 assortie d’une possible prorogation pour les États membres qui le souhaiteraient jusqu’en 2018 au plus tard. Cette disposition est extrêmement préoccupante pour un secteur d’activité à l’économie fragile. Les enjeux tant économiques qu’environnementaux sont très importants : désertification des zones rurales, recentrage des zones de production, captation de la notoriété par des produits sans signes de qualité mais élaborés dans la même région.
Après plusieurs mois de réflexion, les organismes professionnels ont conclu que le système actuel de maîtrise de la production viticole via les droits de plantation était le seul moyen efficace pour éviter une surproduction. Ils souhaitent également mettre en exergue le fait que ce dispositif ne coûte rien à la collectivité, à la différence des mécanismes d’intervention – par exemple, la distillation – et des instruments de régulation du marché. Ils soutiennent enfin que la régulation de la production doit être globale et viser l’ensemble de la production, c’est-à-dire tous les vins, qu’ils soient sous signe de qualité ou non. Les viticulteurs charentais sont opposés à la disparition de cette réglementation, opposition à laquelle je m’associe pleinement.
Les dispositions retenues par la Commission lors de l’adoption du règlement européen l’ont été dans un cadre décisionnaire qui a évolué. En effet, aujourd’hui, les décisions agricoles sont soumises à codécision : le Parlement doit donc entériner les règlements proposés par la Commission.
Le Parlement européen a pris récemment sur ce sujet une position forte, qui va dans le sens des défenseurs des vins d’appellation. Pour autant, l’issue des discussions est loin d’être acquise, puisqu’une majorité d’États membres, particulièrement les États producteurs, restent à convaincre. Pour cela une implication très forte de la France et des actions de sensibilisation en direction des autres ministres européens de l’agriculture seront nécessaires.
En conséquence, monsieur le ministre, ma question est simple : quelles mesures le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour obtenir une majorité qualifiée ou, au minimum, une minorité de blocage sur ce sujet crucial pour l’avenir de la vitiviniculture française, notamment charentaise ?
Enfin, je profite de cette intervention pour rappeler le dossier très sensible de la fiscalité applicable au pineau des Charentes : l’iniquité fiscale entre ce dernier et les produits industriels concurrents n’a toujours pas trouvé d’issue favorable. Plusieurs réunions de travail, notamment avec les services de votre collègue François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, ont eu lieu, mais aucune proposition concrète n’a été formulée à ce jour. Gageons que nous arriverons à trouver un terrain d’entente prochainement.
Monsieur le sénateur, je répondrai tout d’abord à votre interrogation concernant la fiscalité du pineau des Charentes : nous y travaillons avec M. François Baroin. Ce sujet, comme vous l’avez dit, est très complexe, et j’espère que nous arriverons à un terrain d’entente.
J’en viens à la question des droits de plantation. Permettez-moi de la replacer dans un cadre plus général, celui de la bataille que je livre, depuis maintenant plus de quatorze mois, pour la régulation européenne des marchés agricoles.
Nous avons besoin de régulation des marchés si nous voulons maintenir une production agricole et un revenu satisfaisants pour les producteurs agricoles, toutes filières confondues.
Cette bataille de la régulation, nous sommes en train de la gagner : la position commune franco-allemande rappelle l’importance que nous attachons à la régulation des marchés ; le commissaire européen M. Dacian Cioloş s’apprête à faire des propositions législatives européennes qui intégreront des moyens de régulation ; en outre, le Parlement européen lui-même s’est prononcé à une forte majorité en faveur de la régulation des marchés agricoles. Nous sommes donc en passe de gagner cette bataille.
Il en va exactement de même pour les droits de plantation. Je le dis avec beaucoup de fermeté, le gouvernement français est totalement opposé à la libéralisation des droits de plantation.
Quelles seraient les conséquences d’une telle libéralisation ? Nous verrions immédiatement le paysage viticole européen se transformer totalement. Nous verrions des appellations comme l’appellation Champagne se développer dans des cantons et des départements sans aucun rapport avec la Champagne.
Nous verrions les terres les plus compétitives absorber l’ensemble de la production viticole au détriment d’autres terres qui ont des rendements sans doute moins favorables mais qui ont d’autres qualités à faire valoir.
En conséquence, nous sommes totalement opposés à cette libéralisation.
J’ai demandé à Mme Catherine Vautrin de nous remettre d’ici à quelques semaines un rapport sur les conséquences de la libéralisation des droits de plantation. Je pourrai ainsi présenter des arguments techniques solides à la Commission pour faire évoluer sa position sur ce sujet.
Par ailleurs, comme vous le savez, l’Allemagne est, elle aussi, opposée à cette libéralisation des droits de plantation. Nous ferons front commun sur ce sujet pour expliquer la situation à la Commission. J’ai bon espoir que nous obtiendrons gain de cause.
La libéralisation des droits de plantation est une mauvaise idée et une mauvaise orientation pour une Europe agricole qui a besoin de plus de règles et d’une meilleure organisation des marchés.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse et de votre détermination. J’espère de tout cœur que vos démarches aboutiront s’agissant tant des droits de plantation que de la fiscalité du pineau des Charentes, question très importante pour notre région.

La parole est à M. Alain Fauconnier, auteur de la question n° 987, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, ma question porte sur les problèmes que rencontre l’apiculture en France, sujet qui n’a rien d’anecdotique tant sont importantes ses conséquences sur le maintien de la biodiversité.
L’hiver 2009-2010, après nombre d’autres hivers, a été particulièrement préjudiciable aux exploitations apicoles en zone d’élevage. De nombreux ruchers ont été décimés, entièrement ou partiellement. Or, les déclarations de mortalité faites auprès de la Direction des services vétérinaires, ou DSV, ne reflètent pas l’importance des dégâts, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, beaucoup de petits apiculteurs – exploitant moins de dix ruches – n’ont pas réagi face à cette mortalité. Lorsque la DSV envoyait ses experts apicoles, ces petits apiculteurs répondaient à ces derniers qu’ils n’avaient plus de ruches. Ils ont donc été rayés des listes de la DSV et ces ruches n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la mortalité.
Par ailleurs, certains apiculteurs ne désirent pas que les pourcentages de pertes sur leur exploitation soient connus. Nous savons ainsi que des pertes importantes n’ont pas été déclarées.
Enfin, les pertes qui sont intervenues après le début du printemps n’ont pas été ajoutées aux précédentes pertes déclarées.
Pour le département de l’Aveyron, la fourchette de destruction des ruches, sur le seul hiver 2009-2010, a été de 3 500 à 5 000 ruches. Si un département en compte autant, qu’en est-il à l’échelon national ? De quelle manière peut-on évaluer la destruction de l’ensemble des ruchers, puisque les prélèvements de mortalité adressés, par l’entremise de la DSV, à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, ne sont pas satisfaisants ? En effet, les réponses données par cet organisme sont toujours des réponses d’analyses pathologiques. Or, ce qui semble le plus important, ce sont les analyses toxicologiques.
Prenons un exemple local. Un rucher de l’Aubrac composé de trente-cinq ruches neuves, avec de nouveaux cadres et des essaims de l’année, a été totalement décimé à l’issue de l’hiver. La réponse de l’AFSSA mentionnant « quelques traces de varroa » ne peut pas nous satisfaire : il est impossible que cela soit la cause d’une telle mortalité – à moins que nos apiculteurs soient mauvais, ce qui n’est pas le cas !
Certains apiculteurs, face à cette mortalité extraordinaire, ont réalisé des prélèvements qu’ils ont adressés directement au CNRS, sans donner de piste de recherche.
Il a été découvert des traces importantes de deltaméthrine. Cette molécule ainsi que la perméthrine sont les composantes principales des traitements contre la fièvre catarrhale ovine. Or, cette analyse n’est pas prise en compte parce que les prélèvements n’ont pas été faits dans les règles procédurales requises.
De plus, d’autres signes ont pu être relevés par plusieurs apiculteurs : des diminutions progressives du nombre d’abeilles malgré un couvain normal, certaines ruches ayant mis plus de temps que d’autres pour se vider totalement ; des désertions de ruches malgré des réserves abondantes ; des abeilles traînantes, incapables de voler ; une agitation anormale devant les ruches ou encore des situations complètement anormales sur les ruchers.
De manière succincte et résumée, il faut savoir que les abeilles ont besoin, pour leur élevage, de matières azotées qu’elles vont notamment chercher sur les fumiers. Une fois dans la ruche, la deltaméthrine reste dans les cires. À une température de 27 degrés, les abeilles récupèrent une activité normale, après ce que l’on appelle le knock-down. À 17 degrés, le knock-down s’achève par la mort d’un nombre significativement plus élevé d’abeilles, et la baisse de la température augmente ce phénomène. C’est notamment pour ces raisons que les phénomènes de mortalité ont quasiment tous été constatés à la fin de l’hiver.
S’il est vrai que ces causes ne sont pas les seules intervenant en matière de mortalité des abeilles, il est tout de même fondamental que des mesures soient prises concernant le traitement d’éventuels nids infectieux représentés par les fumiers et leur épandage.

Ce phénomène a pour conséquence une baisse significative de la production, alors même que les Français sont les plus petits consommateurs de miel.
Je mentionnerai un autre point, et non des moindres : le frelon asiatique, apparu il y a trois années et aujourd’hui bien implanté en France, cause des dégâts catastrophiques sur les ruches.
Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour permettre à l’apiculture de retrouver des productions correctes et pour mettre un terme à tous ces dégâts ?
Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer sur notre détermination à défendre le secteur de l’apiculture et à lutter contre la mortalité des abeilles : nous suivons ce sujet de manière très attentive.
Ainsi, mon ministère a notamment apporté tout son soutien aux travaux sur les facteurs de surmortalité des abeilles conduits par l’Institut scientifique et technique de l’abeille et de la pollinisation, l’ISTAP, mis en place en début d’année pour compléter les travaux de l’AFSSA sur lesquels vous avez émis des interrogations.
S’agissant de la perméthrine, molécule utilisée notamment contre la fièvre catarrhale ovine. elle constitue le seul élément dont nous disposons pour lutter efficacement contre cette épidémie touchant l’ensemble de l’élevage français. Nous ne voulons pas baisser la garde dans cette lutte.
Nous avons soumis la perméthrine à un processus d’évaluation. Des inquiétudes étaient en effet apparues, dont vous vous êtes fait l’écho. Nous avons donc conduit une enquête épidémiologique sur le sujet.
Les résultats de cette enquête ne permettent pas d’établir une corrélation entre la mortalité des abeilles et les traitements insecticides utilisés dans le cadre de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine.
Je vous rassure, nous poursuivrons l’enquête épidémiologique. Nous avons mis en place des dispositifs de vigilance très étroits sur ce sujet et nous veillerons à ce qu’il n’y ait aucune incidence entre l’utilisation des insecticides prévue dans le cadre de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine et la mortalité des abeilles. S’il devait apparaître un lien de causalité, nous en tirerions toutes les conséquences.
Quant au frelon asiatique, qui constitue un sujet d’inquiétude, mon ministère s’est associé à l’ensemble des ministères concernés pour conduire une lutte la plus efficace possible.
Le ministère chargé de l’écologie a ainsi lancé le 10 février dernier une consultation des services de l’État pour identifier les pistes d’expérimentation.
Cela nous permettra, je l’espère, de faire le point d’ici à la fin de l’année, d’une part, sur la connaissance et la diffusion de cette espèce – le phénomène étant nouveau, nous avons pour le moment peu d’indications – et, d’autre part, sur les risques encourus du point de vue tant de la sécurité que des incidences sur les activités économiques ainsi que sur le milieu naturel.
Nous disposerons des résultats de ces évaluations d’ici à la fin de l’année 2010. C’est sur cette base que nous élaborerons un plan d’action le plus efficace possible.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je constate que vous avez l’intention de prendre un certain nombre de décisions concernant l’apiculture.
Cela étant, je vous rappelle combien les apiculteurs sont inquiets. Ils avaient fait porter leurs espoirs sur le Grenelle de l’environnement, en particulier concernant le problème des pesticides. Aujourd’hui, ils constatent une situation très paradoxale : le biotope des abeilles est nettement meilleur en ville qu’à la campagne ! C’est invraisemblable !

On trouve, à Paris, des ruchers extraordinaires, alors qu’on enregistre en milieu rural des pertes catastrophiques !
Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour faire en sorte que, très rapidement, les apiculteurs retrouvent espoir en l’avenir.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 1007, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, comme vous le savez, la viticulture du Languedoc-Roussillon est frappée depuis des années par une crise sans précédent, par sa durée et par son intensité.
La filière viticole du Languedoc-Roussillon ne reste pas pour autant sans réagir. Elle souhaite retrouver de la compétitivité sur les marchés, notamment à l’export, tout en se donnant les moyens de continuer à garantir une qualité soutenue de ses vins.
Or, l’irrigation de la vigne pourrait constituer pour cette filière une bonne mesure d’accompagnement, favorable à son maintien, d’abord, et à son développement, ensuite. Ce serait sans nul doute l’une des réponses à apporter à la problématique que je viens d’exposer.
Pour la profession, notamment pour M. Guy Giva, président de la chambre régionale de l’agriculture, ainsi que pour le conseil régional et son délégué à la viticulture, M. Fabrice Verdier, il s’agit, par l’irrigation, d’une part, « d’accompagner le développement de la filière viticole et de répondre de façon ciblée à la demande des marchés et de regagner une compétitivité […]. », et, d’autre part, « de garantir la qualité par une régulation du stress hydrique et de sécuriser la viticulture [du Languedoc-Roussillon] dans un contexte de réchauffement climatique ».
Il est vrai, monsieur le ministre, que la filière est dans une situation extrêmement préoccupante, avec des revenus en très forte baisse et des arrachages massifs. Ce sont des pans entiers de notre économie régionale qui sont en train de disparaître.
Pour permettre le développement de l’irrigation, la filière a besoin de bénéficier de l’accompagnement de l’Union européenne, afin de financer l’extension des réseaux d’irrigation.
Or, l’obtention de ces financements européens nécessite de modifier la mesure 125-B du Programme de développement rural hexagonal, le PDRH.
Monsieur le ministre, comptez-vous apporter une réponse positive à cette demande des professionnels de la région Languedoc-Roussillon, en l’intégrant dans le PDRH, pour transmission, ensuite, à l’Union européenne ? Je crois savoir que vous devez recevoir une délégation de responsables professionnels de cette région, le jour même, d’ailleurs, où je m’adresse à vous. Cette demande de la profession est soutenue par de nombreux parlementaires du Languedoc-Roussillon, par les présidents de conseil général, dont Marcel Rainaud qui siège à mes côtés, et par le président du conseil régional.
Monsieur le ministre, ma question est simple : dans le contexte difficile que nous connaissons, quelle suite entendez-vous réserver à cette demande qui conditionne en partie l’avenir de ce secteur principal de l’économie pour notre région ?
Monsieur le sénateur, pour lever toute ambiguïté, je commencerai par préciser ce qu’est le projet hydraulique agricole européen – vous l’avez souligné, je recevrai tout à l’heure une délégation des responsables professionnels du Languedoc-Roussillon à cette fin – : il s’agit d’un important plan de soutien financier européen dont l’objectif est de réduire la pression sur les ressources hydrauliques en Europe. Pour pouvoir bénéficier des avantages qu’il propose, il faut être plus économe en eau. Ainsi y sont éligibles soit les créations de retenue d’eau permettant de réaliser des économies en captant l’eau et en la stockant pour les mois d’été, soit tous les travaux de modernisation de réseaux d’irrigation conduisant également à une réduction de la pression hydraulique.
Monsieur le sénateur, j’ai parfaitement conscience des difficultés que connaît la filière viticole en Languedoc-Roussillon. C’est pourquoi je veux l’aider à bénéficier de ce projet hydraulique agricole européen et construire avec elle des projets lui permettant d’élargir le périmètre du PDRH et d’y inclure la région. Tel est le sens de ma démarche aujourd’hui.
Mon ministère a déjà adressé au mois d’août dernier une première proposition de modification du PDRH pour soutenir les infrastructures de transfert en provenance de ressources plus abondantes et les opérations de création de nouveaux périmètres d’irrigation économes en eau. J’ai examiné avec attention le projet présenté par la région Languedoc-Roussillon ; mes services travaillent à son amélioration afin que cette proposition intègre le périmètre du PDRH, qu’elle s’inscrive bien dans la problématique de réduction de la pression hydraulique et que la région puisse bénéficier des crédits européens. J’ai bon espoir que, avec une argumentation solide et un travail approfondi, une issue favorable soit trouvée sur ce sujet.
Si l’irrigation et le bénéfice du PDRH constituent certes des enjeux très importants – mes services sont d’ailleurs là pour aider la région à construire des projets répondant à la problématique européenne –, il faut également poursuivre les efforts engagés par la filière pour gagner en compétitivité et lui permettre de conquérir des parts de marché à l’exportation.
Beaucoup a déjà été fait en matière de coût du travail, avec les exonérations totales de charges applicables aux travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi ; c’est un point positif. Une réorganisation de la filière viticole est également en cours, notamment sous l’impulsion de Jérôme Despey, de FranceAgriMer. Tout cela progresse.
Je suis là pour aider la filière viticole à poursuivre sa réorganisation – elle est déjà engagée –, à être plus compétitive et capable de créer des volumes stables lui permettant de gagner des parts de marché à l’exportation. Je suis également là pour l’aider à trouver de nouveaux marchés, et, disant cela, je pense en particulier aux marchés asiatiques qui sont en plein développement.
Si nous parvenons à la fois à répondre aux problèmes hydrauliques, à réorganiser la filière, à conquérir des parts de marché à l’exportation, notamment en Chine, je suis optimiste pour la filière viticole en général et pour la filière viticole en Languedoc-Roussillon en particulier.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je vous indique que, parmi les pistes que nous explorons, se trouve le projet « Aqua Domitia » qui pourrait être de nature à résoudre une grande partie des problèmes hydrauliques de la région.

La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question n° 1009, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je souhaite souligner les difficultés rencontrées en Savoie lors de la dernière rentrée scolaire, difficultés qui illustrent les conséquences négatives entraînées par les orientations décidées à l’échelon national.
La première difficulté, consécutive à la baisse du nombre d’emplois aidés dans l’éducation nationale, résulte de la diminution drastique du nombre de postes d’éducateur de vie scolaire, ou EVS : 60 postes ont été pourvus cette année contre 175 l’année dernière. La situation est d’autant plus inacceptable que les personnes intéressées ont souvent appris brutalement la disparition de leur poste, quelquefois même la veille de la rentrée scolaire !
Cette réalité, alors même que certaines personnes avaient une promesse d’embauche en main, est humainement difficile à concevoir, emporte des effets négatifs sur le fonctionnement des écoles et compromet la réussite des élèves, en particulier dans les établissements scolaires localisés en zones urbaines sensibles. Je rappelle que cette aide administrative avait été obtenue en 2006 à la suite d’un accord sur la direction des écoles primaires et avait fait l’objet d’un protocole entre le ministre de l’éducation nationale et le syndicat majoritaire.
À la suppression de 32 postes de médiateur de vie scolaire intervenant auprès des élèves les plus en difficultés s’ajoutent les conséquences de la suppression envisagée des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, dont peu d’équipes sont au complet et dont le manque de psychologues scolaires et de maîtres G a été pointé. L’aide individualisée ou les stages de remise à niveau qui ont été mis en place ne profitent pas aux élèves en ayant le plus besoin et ne sont pas adaptés aux enfants qui connaissent de lourdes difficultés et sont en situation d’échec scolaire.
Par ailleurs, plusieurs parents d’enfant handicapé m’ont fait part de l’absence d’assistant de vie scolaire, ou AVS, affecté auprès de leur enfant, et ce malgré une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. J’ajoute que la professionnalisation et la pérennisation des AVS par la création d’un nouveau métier de l’accompagnement répondant aux besoins des jeunes en situation de handicap n’ont toujours pas été menées à leur terme.
L’année dernière a également été marquée par un taux très important – de l’ordre de 16 % – de non-remplacements de ces personnels dans le département. À l’heure où la suppression de 16 000 postes supplémentaires est annoncée, l’inquiétude est légitimement grande chez les parents et les enseignants qui redoutent que cette situation ne s’aggrave encore dans les mois à venir.
De façon globale, cette rentrée scolaire est marquée par la question des enseignants stagiaires nommés à temps plein sans aucune formation préalable puisqu’ils sortent de formations universitaires classiques, d’autant que le dispositif de formation académique, construit sur la base de personnels en surnombre et sur des heures supplémentaires, est extrêmement fragile. Elle est aussi marquée du sceau de la précarité grandissante du métier d’enseignant : beaucoup de principaux de collège ont dû se transformer en urgence, à la fin de l’été, en chasseurs de têtes pour trouver à la hâte, parmi les personnes sans emploi, avec le soutien de Pôle emploi, la « perle rare » qui accepterait de devenir enseignant au pied levé, sans formation préalable à l’enseignement, avec un contrat de travail de moins de six heures par semaine.
Monsieur le ministre, dans ce contexte de forte diminution des moyens qui affectera tout particulièrement les élèves les plus fragiles, compromettant par là même leur avenir, je souhaite relayer auprès de vous les inquiétudes, voire la colère des parents, des enseignants et du personnel d’encadrement des études scolaires, qui se trouvent démunis face aux lourdes conséquences qu’entraîne pour eux une telle situation.
Je vous demande donc de réexaminer la situation du département de Savoie au regard du nombre de postes d’EVS, d’AVS auprès des enfants handicapés et du taux de non-remplacement des enseignants absents.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Luc Chatel, retenu ce matin par d’autres obligations.
M. le ministre de l’éducation nationale m’a fait parvenir des éléments précis de réponse à vous transmettre.
Comme vous le savez, dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement a fait le choix de protéger nos élèves les plus fragiles en concentrant les moyens sur ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Cette décision est effective dans votre département de Savoie.
Si le nombre de médiateurs y est en effet en recul, c’est parce que d’autres dispositifs se mettent en place. En revanche, je vous annonce que, dans votre département, aucun enfant handicapé ayant reçu une notification d’auxiliaire de vie individuel par la maison départementale des personnes handicapées ne se trouve aujourd’hui sans auxiliaire de vie scolaire. Les moyens ont donc été déployés.
Il est vrai que des difficultés ont été rencontrées au moment de la rentrée. Elles résultent notamment de la nécessaire reconstitution des viviers à cette époque de l’année, dans un contexte qui voit Pôle emploi peiner à présenter un nombre suffisant de candidatures, et ce alors que les prescriptions de la maison départementale des personnes handicapées sont en hausse.
Aujourd’hui, je tiens à vous rassurer : les recrutements ont repris à un rythme normal et les services académiques suivent de très près les prescriptions de la maison départementale des personnes handicapées. Les chiffres témoignent d’ailleurs de cet effort d’accompagnement auprès des élèves handicapés. Ainsi, en un an, le nombre de postes d’assistant de vie scolaire est passé de 16 à 19, celui des contrats aidés dédiés à l’accompagnement des élèves handicapés de 134 à 142. En outre, deux classes d’insertion scolaire ont été créées.
Monsieur le sénateur, vous le constatez, l’accompagnement des élèves handicapés reste bien une priorité du Gouvernement, et, même si des difficultés ont pu être rencontrées au moment de la rentrée scolaire, les mesures qui s’imposaient ont été prises pour apporter les réponses nécessaires.
Par ailleurs, les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, ou RASED, comptent autant de postes cette année qu’à la rentrée précédente, dont 27 psychologues. Quant à l’emploi de contractuels, s’il est vrai qu’il augmente dans votre département, il demeure marginal en chiffre global. M. Luc Chatel entend améliorer la situation de ces personnels non titulaires en étudiant, en concertation avec les organisations syndicales, de nouvelles pistes.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement entend ne laisser personne sans réponse, en particulier les élèves qui se trouvent dans les situations les plus fragiles, notamment dans votre département de Savoie.

Monsieur le ministre, je ne peux pas vous tenir rigueur du caractère partiel de la réponse apportée à ma question. Vous être le porte-voix, si je puis dire, de M. le ministre de l'éducation nationale et vous m’avez transmis les éléments préparés à votre attention par ses services.
Autant je note avec satisfaction qu’aucun enfant handicapé ne se trouvera privé d’AVS, autant je regrette qu’aucune réponse ne m’ait été fournie sur l’explosion du nombre de personnes qui, alors qu’elles étaient inscrites à Pôle emploi, se trouvent du jour au lendemain désignées comme professeur sans forcément avoir une prédisposition à l’enseignement. Cette situation est malheureusement due au fait que de moins en moins de nos compatriotes développent l’appétit d’enseigner dans notre pays.

Par ailleurs, des personnes en contrats aidés ayant reçu une promesse d’embauche au mois de juillet ou d’août se sont vues demander, le 31 août, de ne pas se présenter, faute de crédits délégués à l’établissement scolaire dans lequel elles devaient prendre leurs fonctions.

Dans mon département, ce sont plus d’une centaine de personnes qui se retrouvent « grugées » par un chef d’établissement ne pouvant tenir son engagement. La conséquence est celle-ci : ce seront autant de projets pédagogiques qui ne seront pas mis en place dans les établissements.

Enfin, je suis obligé de constater une précarisation de l’enseignement, tout particulièrement dans les collèges.

La parole est à M. Marcel Rainaud, auteur de la question n° 983, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.

Madame le secrétaire d’État, l’objectif affiché par le Gouvernement est de ramener le déficit public de 8 % du PIB cette année à 6 % l’année prochaine.
L’ambition est bien entendu louable, et des choix budgétaires doivent être effectués afin d’atteindre cet objectif.
Dans ce contexte, une réflexion sur les mesures de restriction des dépenses de l’État est bien évidemment nécessaire, mais elle serait insuffisante si elle ne s’accompagnait pas d’une réelle et profonde analyse des possibilités pour l’État de disposer de ressources nouvelles.
Je ne reviendrai pas ici sur la position gouvernementale concernant la suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux – nous en mesurons les effets néfastes au quotidien sur la sécurité comme sur la dégradation des conditions des études des jeunes, …

… de la maternelle au lycée –, si ce n’est pour souligner qu’il s’agit là d’un recul historique de l’État, qui abandonne progressivement certaines de ses fonctions régaliennes. Mais nous aurons l’occasion d’aborder ces questions lors du très prochain débat sur le projet de loi des finances pour 2011.
L’essentiel des mesures jusque-là dévoilées porte sur la non-reconduction du plan de relance, le rattrapage de recettes fiscales éventuelles en misant sur « l’après-crise », et sur un ensemble de dispositions visant à générer 10 milliards d’euros de nouvelles recettes.
Ont ainsi été annoncées un certain nombre de mesures telles que la suppression de l’abattement de quinze points sur les cotisations patronales des ménages déclarant leurs employés au salaire réel. Ces cotisations concernent notamment les activités de garde d’enfants et de ménage.
Sur le même registre, ont été présentés lors du dernier conseil des ministres le projet de suppression des déclarations de revenus multiples pour les impôts l’année du mariage, du PACS ou du divorce, ainsi que la suppression de la rétroactivité de trois mois précédant la demande pour une aide au logement.
L’allocation pour adulte handicapé serait elle aussi touchée, puisque sa revalorisation serait inférieure à ce qui avait été indiqué initialement.
Sur certaines annonces faites antérieurement, le Gouvernement a sagement décidé de revoir sa position, à l’image de la question de l’aide personnalisée au logement pour les familles d’étudiants.
Sur le fonds, ces mesures sont discutables. Elles paraissent profondément injustes…

… dans la mesure où elles ne s’accompagnent pas d’une remise en cause du dispositif du bouclier fiscal qui protège les plus fortunés.

Au total, le relèvement de la fiscalité, estimé à 10 milliards d’euros, sera profondément défavorable aux ménages.
L’observatoire français des conjonctures économiques estime, dans l’une de ses simulations, que l’incidence directe de ces mesures fiscales sur les ménages sera de l’ordre de 4, 1 milliards d’euros.
Ce même observatoire précise « que sur les 5, 9 milliards d’euros touchant les entreprises, ce sont 3, 4 milliards qui potentiellement pourraient être répercutés sur les ménages », faisant ainsi reposer 75 % de l’effort financier sur ces derniers.
En cette période de crise économique, il n’est pas envisageable que ces 10 milliards d’euros de ponctions fiscales supplémentaires épargnent les personnes les plus aisées.
La hausse de l’impôt est bien là, elle est annoncée.
Dans ce contexte, le Gouvernement ne pourra pas s’entêter à maintenir un bouclier fiscal dont le caractère injuste est chaque jour un peu plus évident.

Cette dimension est curieusement absente, ou insuffisamment abordée.
Le caractère socialement injuste des mesures annoncées est d’autant plus évident que ces dernières viennent s’ajouter au projet de réforme des retraites qui, lui aussi, est marqué par une répartition déséquilibrée de l’effort financier.
Madame le secrétaire d’État, je vous demande, de vous positionner très clairement sur ce dossier et de nous préciser si le Gouvernement entend, au regard du contexte économique et social, supprimer le bouclier fiscal, ou s’il s’obstinera à maintenir les privilèges des plus aisés, qu’il finance en mettant à contribution les ménages des classes moyennes.
Monsieur le sénateur, l’engagement du Gouvernement, à travers le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, de revenir à 6 points de PIB de déficit public en 2011 et d’atteindre 3 % du PIB en 2013 représente un effort sans précédent dans l’histoire de nos finances publiques.
La stratégie qui a été adoptée dans ce cadre est claire et cohérente avec la politique menée depuis le début de la législature. Pour réduire les déficits, le Gouvernement a choisi de diminuer la dépense et non d’augmenter les impôts. Réduire les déficits par le recours à de nouveaux prélèvements – alors que le niveau des prélèvements obligatoires en France est l’un des plus élevés de l’OCDE –…
… aurait un impact négatif sur la croissance, ce qui n’est pas souhaitable en cette période de sortie de crise.
Ainsi, l’effort de réduction des niches fiscales et sociales proposé par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 porte sur un ensemble de mesures de l’ordre de 10 milliards d’euros.
Si le Gouvernement a préservé les dépenses fiscales qui soutiennent l’emploi et celles qui protègent les publics fragiles, et s’il est attaché à ce que l’effort soit équitablement réparti entre les entreprises et les ménages, il a toutefois tenu à ce que l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui bénéficient du bouclier fiscal, participent à l’effort. Ainsi, la contribution sur les hauts revenus et sur les revenus du capital, qui est destinée à financer la réforme des retraites, et la réduction de 10 % appliquée à un ensemble cohérent de niches fiscales seront placées hors du champ des impôts pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal.
Par ailleurs, si la suppression du bouclier fiscal ne figure pas au nombre des mesures proposées par le Gouvernement, c’est parce que ce dispositif répond d’abord et avant tout à un principe d’équité fiscale, reconnu par le Conseil constitutionnel et qui vaut pour tous les contribuables.
M. Jean-Pierre Michel rit.
En effet, il n’est pas normal que le montant total des impositions d’un contribuable puisse représenter plus de la moitié du montant de ses revenus. L’impôt deviendrait alors confiscatoire.
À cet égard, il ne faut pas oublier que 52 % des bénéficiaires du bouclier fiscal sont des ménages modestes ayant des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois.
Je précise que le Gouvernement a veillé, par des dispositions expresses figurant dans le projet de loi de finances, à ce que les bénéficiaires du bouclier fiscal soient soumis tant au rabot de 10 % sur certaines niches qu’à la contribution de 1 % sur les hauts revenus et les revenus du capital.
Enfin, l’équité fiscale ne se mesure pas à l’aune d’un seul dispositif, mais est le fruit de différentes mesures complémentaires. Ainsi, sur les 36 millions de foyers fiscaux que compte la France, seuls 15, 6 millions paient effectivement l’impôt sur le revenu, 500 000 d’entre eux payant 43 % du montant total de l’impôt sur le revenu. Voilà la preuve indéniable de la participation des personnes les plus aisées à l’effort de solidarité nationale.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Permettez-moi à mon tour de regretter que M. Baroin ne soit pas là pour me répondre.
Force est de constater que la politique menée par le Gouvernement s’est éloignée des promesses faites lors des élections présidentielles de 2007. Il était alors question de hausse du pouvoir d’achat et de baisse des impôts. Aujourd’hui, c’est bien le contraire qui nous est annoncé.

La hausse des impôts est bien là, le coup de rabot que vous vous apprêtez à opérer sur les niches fiscales suscitera, croyez-moi, de vives réactions chez les contribuables. Ils attendent de vous que vous mettiez, de votre propre initiative, un terme à l’injustice du bouclier fiscal, sans attendre la mise en œuvre de la convergence fiscale avec l’Allemagne.

La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 1006, adressée à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a un peu plus d’un an, le Sénat adoptait au terme d’un débat passionné le projet de loi autorisant, pour les salariés volontaires, le travail dominical dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations dénommées « périmètres d’usage de consommation exceptionnel ».

J’avais alors souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur les disparités existant entre les différentes catégories de salariés travaillant le dimanche, en termes notamment de majoration salariale et de repos compensateur, et sur la nécessité de procéder à une harmonisation, compte tenu de la grande différence des situations selon les cas.
J’avais donc déposé un amendement visant à intégrer dans le rapport annuel du comité chargé de veiller au respect du principe du repos dominical, créé par la loi, un « point sur les différentes contreparties dont bénéficient les salariés travaillant le dimanche et les mesures de nature à permettre leur harmonisation ».
À la demande du Gouvernement et du rapporteur, j’avais accepté de retirer cet amendement. Le Gouvernement, qui avait en effet engagé la procédure accélérée, souhaitait fortement un vote conforme sur cette proposition de loi venant de l’Assemblée nationale.
En contrepartie, lors de la séance du 22 juillet 2009, le ministre avait pris l’engagement de transmettre au Sénat les éléments relatifs « aux différentes contreparties du travail dominical, à leur nature et à leur niveau » dans un volet spécifique du bilan annuel de la commission nationale de la négociation collective.
Le bilan annuel a bien été transmis au Parlement, mais aucune information relative aux contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche ni aucune piste d’harmonisation ne semblent figurer dans ce document.
Pour autant, l’objectif d’une harmonisation des contreparties accordées en termes de salaires et de journées de repos ne doit pas être perdu de vue.
Aussi, madame la secrétaire d’État, je souhaiterais savoir pourquoi cet engagement pris par le Gouvernement n’a pas été tenu.
Quand le Parlement disposera-t-il des informations qui auraient déjà dû lui être transmises ?
Quelles propositions le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour harmoniser les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche ?
Au-delà, je regrette une fois encore le fait que, de plus en plus souvent, le Gouvernement, pour obtenir le retrait d’un amendement, prenne des engagements comme celui-ci – parfois même ces engagements sont inscrits dans la loi – pour très souvent – trop souvent – les oublier aussi vite !
Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous apporter la réponse d’Éric Woerth, ministre du travail de la solidarité et de la fonction publique, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.
Vous avez attiré son attention sur les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en termes de majoration salariale et de jours de récupération, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 août 2009 relative au repos dominical.
Un bilan complet de la mise en œuvre de la loi sera réalisé par le comité parlementaire de suivi instauré par la loi, sous la présidence du parlementaire Pierre Méhaignerie. Dans cette perspective, le ministre du travail a adressé le 22 juin dernier au comité de suivi parlementaire, dans le respect des délais nécessaires à ses travaux, un document recensant les premiers éléments quantitatifs et qualitatifs ainsi que les réponses au questionnaire. De plus, le directeur général du travail a été auditionné le 16 septembre dernier.
Un certain nombre d’éléments concernant les contreparties pour les salariés, au sein tant des périmètres d’usage de consommation exceptionnel que des communes et zones touristiques, ont ainsi été communiqués.
S’agissant des périmètres d’usage de consommation exceptionnel – il y en a une vingtaine aujourd’hui –, environ un tiers des demandes de dérogation déposées dans les préfectures sont fondées sur un accord collectif. Les autres demandes sont formulées sur la base d’une décision de l’employeur approuvée par référendum auprès des salariés. Dans ce dernier cas, c’est la loi qui prévoit les contreparties minimales pour les salariés : doublement de la rémunération et repos compensateur. En ce qui concerne les accords collectifs, les stipulations conventionnelles prévoient généralement des contreparties répondant à la même logique de majoration salariale et de repos supplémentaires accordés au salarié travaillant le dimanche.
On peut citer, à titre d’exemple, l’accord interbranches conclu par l’UPE 13, la CFE-CGC, la CFTC et FO pour la zone de Plan-de-Campagne, située dans les Bouches-du-Rhône.
Cet accord prévoit : d’une part, pour chaque heure travaillée le dimanche, une majoration de salaire égale au montant du SMIC, avec une indemnité supplémentaire pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à dix-huit mois ; d’autre part, deux jours de repos en compensation du dimanche travaillé et six à quinze dimanches non travaillés par an, selon les entreprises.
En ce qui concerne les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il convient de rappeler que, dès avant la loi du 10 août 2009, de nombreux salariés amenés à travailler le dimanche, dans une boulangerie ou chez un fleuriste par exemple, bénéficiaient déjà de stipulations conventionnelles fixant des contreparties.
Au niveau des entreprises, de grands groupes ont fait le choix de négocier des contreparties au travail du dimanche s’appliquant quelle que soit la localisation de l’établissement, dans une commune touristique ou dans un PUCE. C’est le cas, par exemple, du groupe Décathlon, signataire d’un accord le 4 décembre 2009 avec la CGT et la CFDT, et de la société Kiabi Europe, qui, le 29 janvier 2010, a conclu un accord avec l’UNSA et la CGC pour permettre l’ouverture de ses établissements.
L’examen de ces accords montre que la très grande majorité d’entre eux prévoit une majoration de 100 % des heures travaillées le dimanche.
Des accords locaux ont également pu être négociés, comme c’est le cas à Saint-Malo intra-muros depuis 2007.
Enfin, pour les autres dérogations temporaires au repos dominical accordées par le préfet, la loi a prévu que les salariés concernés bénéficient obligatoirement de contreparties conventionnelles ou légales, alors que le droit antérieur était silencieux sur ce point.
En tout état de cause, monsieur le sénateur, je vous prie de croire que la direction générale du travail reste à la disposition des parlementaires pour tout élément d’actualisation qu’ils jugeraient nécessaires.

Madame la secrétaire d’État, votre réponse confirme qu’il existe une très grande diversité de situations au niveau des contreparties prévues : certaines sont légales, d’autres conventionnelles ; ici, elles conduisent à une majoration de 100 % de la rémunération, là, le montant est moindre.
Je réitère donc la demande, que j’avais formulée voilà un peu plus d’un an lors du débat parlementaire, de disposer d’un document qui recense la palette des contreparties accordées en termes aussi bien de rémunération que de repos compensateur, puisque, en cette matière, les différences sont également très grandes. Conformément à ce que m’avait promis le ministre à l’époque, je souhaite que puissent être étudiés les moyens pour harmoniser progressivement, dans la mesure du possible, toutes ces situations extrêmement différentes.
J’ai bien noté que des éléments avaient d’ores et déjà été transmis au comité chargé de veiller au respect du repos dominical. J’espère que l’ensemble des parlementaires pourra en être destinataire. Je les attends personnellement avec une grande impatience !
Aujourd’hui, il importe véritablement de mettre fin à une disparité beaucoup trop grande entre des salariés qui se trouvent finalement dans des situations assez comparables.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la question n° 1004, adressée à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent les établissements et services médico-sociaux chargés d’accueillir des personnes âgées et handicapées, difficultés qui sont consécutives aux conditions de financement prévues pour 2010.
En effet, les suppressions temporaires de crédits médico-sociaux gérés en 2010 par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, cumulées avec le « débasage » des enveloppes médico-sociales pour les crédits reçus les années précédentes et en attente d’affectation, semblent se traduire dans plusieurs régions par un certain désordre. D’après les renseignements qui m’ont été communiqués, la signature de l’État n’est pas honorée partout. Promesses avaient pourtant été faites, d’une part, de créer des lits et des places médico-sociales, notamment en Aquitaine, PACA et Alsace, mais aussi en Franche-Comté, ma région, et, d’autre part, de débloquer des crédits de médicalisation en faveur des maisons de retraite, en particulier en Alsace.
Ces situations sont contraires aux engagements du Gouvernement, pris notamment lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 après que plusieurs associations se sont inquiétées du risque de ne plus pouvoir financer ceux qui avaient été annoncés antérieurement.
En conséquence, je vous demande, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir m’indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier rapidement, c’est-à-dire avant la fin de l’année, à cette situation. Il est en effet fort regrettable que le démarrage des nouvelles agences régionales de santé soit entaché de telles « mauvaises expériences », car ce sont autant d’arguments apportés à ceux qui craignent que la prédominance des questions sanitaires et de médecine de ville n’impacte de façon défavorable celles qui ont trait à l’accompagnement médico-social des personnes âgées et des personnes handicapées.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer : je puis vous dire avec certitude que les engagements de l’État relatifs à la création de places dans les établissements et services médico-sociaux et à la médicalisation desdits établissements seront respectés.
Comme vous le savez, les créations de places sont inscrites dans les SROSM, les schémas régionaux de l’offre sociale et médico-sociale. Elles seront honorées en fonction de listes prioritaires préalablement établies.
Les retards qui ont été constatés ne sont pas liés à un prétendu non-respect par l’État de ses engagements. Ils s’expliquent par le fait que 2010 est une année de transition, avec, vous l’avez vous-même signalé, la mise en place des agences régionales de santé. Celle-ci nous permettra d’évoluer vers un système d’appels d’offres pour les créations de places et la médicalisation des établissements.
C’est d’ailleurs l’élaboration des budgets dans son ensemble qui répondra à une nouvelle méthodologie, appelée à se substituer à la procédure classique.
Pour l’avenir, des autorisations de dépense viennent gager de futures autorisations. Il s’agit d’« autorisations d’engagement » dans le champ de l’État, qui prennent la forme pour nous d’« enveloppes anticipées », notifiées par la CNSA aux agences régionales de santé. Ces crédits permettent notamment de garantir les futures autorisations pour les projets à venir, et donc de les anticiper dès à présent, en lançant, par exemple, les appels à projets autorisés par la publication du décret du 26 juillet dernier pour la mise en œuvre des objectifs des plans gouvernementaux. Une telle visibilité est essentielle.
Les crédits de paiement de l’année en cours sont bien inscrits en loi de financement de la sécurité sociale au travers de l’ONDAM, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Répartis entre les agences régionales de santé, ce sont eux qui permettent le financement effectif, par dotation ou au prix de journée, des milliers d’établissements et services médico-sociaux ouverts, installés, et qui fonctionnent effectivement dans l’année.
L’absence de distinction entre ces deux types de crédits adossés pourtant à deux calendriers de dépenses distincts est directement à l’origine de la sous-exécution constatée de manière récurrente sur l’ONDAM médico-social. C’est bien pour y mettre fin qu’a été diligentée une enquête conjointe de l’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et de l’inspection générale des finances, l’IGF, sur les crédits non consommés de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Et c’est sur la base des préconisations de cette enquête qu’ont été définis, d’une part, la nouvelle méthodologie de construction de l’ONDAM 2011, et, d’autre part, le quantum des crédits auxquels il devait être strictement ajusté. Ce quantum a en effet été calé sur la base des déclarations des services eux-mêmes, à partir de l’identification de leurs besoins pour l’année, soit le total des places déjà installées et des places nouvelles à ouvrir ou à installer pour 2011.
Il est toutefois exact que la répartition régionale du retrait temporaire des crédits correspondant aux ouvertures postérieures à 2010, effectué sur la base de l’enquête IGAS-IGF, a pu créer des tensions dans certaines régions, dès lors que les éléments financiers recueillis à l’été 2009 pouvaient avoir connu, depuis, des modifications non prises en compte.
C’est précisément pour y faire face que viennent d’être notifiés, en septembre, 30 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur des régions ayant indiqué à la CNSA des insuffisances de crédits. Ainsi l’Alsace se verra-t-elle attribuer à cet effet 9, 5 millions d’euros, l’Aquitaine, un peu plus de 2 millions d’euros, et PACA, un million d’euros.
À l’aune de ces éléments complémentaires, monsieur le sénateur, je vous prie donc de bien vouloir m’accorder que, si la campagne budgétaire 2010 a connu quelques difficultés ou retards, avec, d'une part, la mise en place de ces acteurs institutionnels nouveaux que sont les agences régionales de santé, et, d'autre part, la prise en compte de nouvelles règles, cette campagne permet, de manière essentielle, de créer actuellement un cycle vertueux entre les crédits inscrits en loi de financement de la sécurité sociale, leur gestion au niveau national, les autorisations données par les ARS et leur engagement une fois les projets réalisés.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de cette réponse longue et argumentée. Vous vous doutez bien qu’elle était attendue par nombre de directeurs d’établissements médico-sociaux et d’associations œuvrant dans ce domaine.
Force est de constater que des progrès tangibles ont été réalisés, notamment au niveau des crédits destinés à l’accompagnement médico-social des personnes âgées, étant entendu que celui des personnes handicapées pose aujourd’hui des problèmes qui restent plus difficiles à régler.
J’espère donc que, avec les nouveaux crédits qui ont été débloqués et dont les ARS ont été destinataires, un certain nombre de promesses qui datent depuis longtemps seront honorées. Dans ma région, une maison d’accueil spécialisée à orientation psychiatrique, que je connais bien, a été ouverte en 2007 : sur les quarante places théoriquement offertes, seules onze sont financées pour l’instant ; et l’année dernière, le préfet nous a prévenus que rien ne serait fait…
J’ai cru comprendre que l’ARS de Franche-Comté aurait obtenu les crédits nécessaires et qu’elle commencerait par honorer les engagements pris, mais pas encore remplis. J’espère qu’il en sera de même dans les différentes régions et que les difficultés y seront rapidement résolues.

La parole est à M. Alain Milon, auteur de la question n° 961, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Madame la ministre, créé par la loi du 21 décembre 2006 résultant d’une initiative parlementaire soutenue très largement par le gouvernement de l’époque, l’ordre national des infirmiers s’est progressivement mis en place.
Après la publication dans le courant de l’année 2007 des principales dispositions réglementaires indispensables à son fonctionnement, les premières élections des conseillers ordinaux se sont tenues à la fin de l’année 2008.
Cette institution s’est vu confier une mission de service public fondamentale : garantir la compétence, la moralité et la qualité de l’exercice professionnel des infirmiers. Plus de 500 000 dans notre pays, ceux-ci assurent une mission sanitaire et sociale de premier plan.
Les soins infirmiers ont connu depuis plusieurs décennies des évolutions majeures liées à celles de notre système de santé, faisant du métier de soigner une véritable profession. Qu’une institution telle que l’ordre puisse garantir la déontologie et la qualité des pratiques des soins infirmiers est une nécessité à mes yeux incontournable.
Pourtant, depuis sa mise en place, l’ordre national des infirmiers n’a cessé de subir l’obstruction des pouvoirs publics et les invectives des syndicats. Encore récemment, une proposition de loi, qui a reçu, semble-t-il, un soudain soutien verbal du ministère de la santé, a été déposée à l’Assemblée nationale afin de réserver l’ordre aux seuls infirmiers d’exercice libéral, en dépit des principes d’unité et de garantie de l’exercice professionnel qui justifient l’existence d’une institution ordinale.
L’ordre des infirmiers est le délégataire de missions et de tâches que les services de l’État, notamment en région, engagés dans un processus de restructuration au travers de la création des agences régionales de santé par la loi du 21 juillet 2009, ne peuvent plus et ne veulent plus assumer : il s’agit de l’inscription des professionnels au tableau, de la validation des diplômes étrangers, du recensement ou du suivi démographique.
Pour assumer ses missions, un ordre ne peut compter que sur les cotisations des professionnels concernés. Malgré une cotisation faible, fixée à soixante-quinze euros, l’ordre des infirmiers a subi, de la part des services du ministère de la santé et des syndicats, des pressions et une campagne de dénigrement sans précédent.
Les employeurs, publics notamment, ne contribuent pas au respect de la loi, se rendant par ce fait complices de l’exercice illégal des professionnels qui refusent de s’inscrire. L’État n’intervient pas, laisse faire, voire cautionne cet état de fait. Force est pourtant de reconnaître qu’un ordre ne fait aucunement appel aux deniers publics pour assurer la mission de service public qui lui a été déléguée, ce qui, en la période actuelle d’exigence de rigueur budgétaire, devrait être salué et soutenu.
En conséquence, madame la ministre, je vous demande de bien vouloir m’indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour faire respecter tant par les professionnels que par leurs employeurs la loi en la matière.
Monsieur le sénateur, j’ai, en effet, trouvé en héritage la création de l’ordre infirmier. Dès sa mise en place, le niveau de cotisation de 75 euros annuels a posé problème.
Vous avez rappelé que la cotisation en cause n’avait pas d’influence sur les deniers publics. Encore heureux ! Car, par définition, un ordre ne fait pas appel à une subvention de l’État ! Sinon ce ne serait plus un ordre… Ce serait même un désordre !
Sourires
Avant même que ce taux ne soit arrêté, j’avais conseillé â l’ordre de fixer une cotisation d’un montant symbolique, d’environ 20 euros par an. Ce montant était d’ailleurs, à quelques euros près, celui qui avait été évoqué lors des débats parlementaires.
Il m’apparaît essentiel, pour les infirmiers et infirmières, mais aussi pour l’ordre lui-même, que le montant de la cotisation ne représente pas un obstacle pour les personnes que cette institution a vocation à défendre.
Je n’ai cessé, depuis, de conseiller â l’ordre de réviser ce montant. J’ai aussi introduit dans la loi du 21 juillet 2009, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, une disposition permettant à l’ordre de moduler le montant des cotisations. J’espérais qu’il pourrait ainsi proposer une cotisation réduite pour les salariés qui disposent déjà de structures de régulation et de sanction.
Malheureusement, l’ordre infirmier n’a pas suivi ce conseil de bon sens, que je n’ai d’ailleurs pas été la seule à lui donner.
Depuis, les difficultés se sont accumulées. La majorité des infirmiers refusent de payer la cotisation de 75 euros annuels, disproportionnée par rapport à leurs revenus, mais aussi par rapport à ce qu’ils attendent de cette institution.
Contrairement à ce que vous dites, l’ordre n’a fait l’objet d’aucune campagne de dénigrement, ni de ma part ni de la part du Gouvernement.
Les services du ministère ont toujours été présents et à l’écoute, notamment lors des conseils nationaux de l’ordre infirmier. J’ai reçu, ainsi que les membres les plus éminents de mon cabinet, les instances de l’ordre, notamment sa présidente, et cela à plusieurs reprises. La dernière rencontre remonte à quelques jours seulement.
Je tiens aussi à rendre hommage aux efforts que les parlementaires ont consentis, avec le Gouvernement, pour permettre à l’ordre infirmier de trouver ses marques.
Malgré ces efforts, malgré les demandes insistantes de la profession, malgré les appels à la raison des organisations syndicales, dont les prises de position à l’égard de l’ordre sont très respectables, aucun geste n’a été fait par l’ordre infirmier jusqu’à ce jour pour se faire accepter par les infirmiers.
Le montant de la cotisation est resté, comme en 2009, fixé â 75 euros.
Pourtant, je le répète, au-delà de la contrainte introduite par la loi, un ordre doit se faire accepter aussi par ceux qu’il représente. Je regrette de constater que tel n’est pas encore le cas chez les infirmiers, comme le prouve le faible nombre d’adhésions.
Or les infirmiers peuvent adhérer et cotiser sans aucune contrainte, directement sur le site internet de l’ordre infirmier. Il n’y a et il n’y a jamais eu aucune obstruction des pouvoirs publics ! Je vous mets au défi de trouver la moindre obstruction dans ce domaine !
En outre, l’ordre a lui-même assuré une communication massive. Compte tenu des risques juridiques qu’ils encourent, les employeurs n’encouragent absolument pas l’exercice illégal. Je me félicite des choix mesurés que les décideurs hospitaliers font au quotidien.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, je suis ce dossier quotidiennement. Je suis certaine que l’ordre entendra nos appels et que, ensemble, nous allons trouver une solution acceptable pour tous les acteurs.

Je remercie Mme la ministre de sa réponse. Pour en avoir suffisamment discuté ici dans le cadre de la loi HPST, je le sais, le véritable problème, c’est la cotisation.
Ce que je crains le plus, c’est que cette difficulté ne finisse par mettre en cause l’existence même de l’ordre et qu’à un moment ou à un autre cela ne fasse tache d’huile menaçant la pérennité d’autres ordres.

La parole est à Mme Muguette Dini, auteur de la question n° 972, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la rétinopathie diabétique est une cause importante de malvoyance et la première cause de cécité chez les sujets de moins de soixante ans, en population générale, dans l’ensemble des pays industrialisés.
Surtout, la prévalence de la rétinopathie diabétique augmente avec la durée du diabète. Après vingt ans d’évolution du diabète, plus de 90 % des diabétiques de type 1 et plus de 60 % des diabétiques de type 2 ont une rétinopathie diabétique.
Cette évolution handicapante est due à la prise en charge souvent trop tardive de cette affection. En effet, la rétinopathie diabétique est une maladie silencieuse pendant de nombreuses années. Les symptômes n’apparaissent qu’au stade des complications.
Pour prévenir cette complication oculaire, un examen annuel du fond d’œil est préconisé pour tout patient diabétique depuis le début des années quatre-vingt-dix par un grand nombre de pays, dont la France.
Cependant, les enquêtes de la Caisse nationale d’assurance maladie ont montré que moins de 50 % des patients diabétiques avaient consulté un ophtalmologiste durant l’année précédente.
Les causes de l’absence de dépistage sont multiples : le manque d’information des patients, la sensibilisation insuffisante des médecins traitants, la diminution régulière du nombre des ophtalmologistes et, surtout, le désagrément de l’examen.
En effet, ce dernier a l’inconvénient d’être long. En outre, la dilatation de la pupille entraîne une baisse de la vision gênante pour une demi-journée.
La solution plébiscitée par les acteurs concernés, principalement l’académie d’ophtalmologie, l’Organisation pour la prévention de la cécité et l’association Valentin Haüy est celle de la rétinographie sans mydriase différée.
Cet acte consiste en la photographie du fond de l’œil du patient diabétique par un infirmier ou un orthoptiste, l’envoi de celle-ci sous format numérique à l’ophtalmologiste pour interprétation, en l’absence du patient.
Des expérimentations sont menées en ce sens dans des structures de soins variées et financées, notamment, par le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville.
À la demande de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM, la Haute Autorité de santé, la HAS, a évalué l’acte d’interprétation des photographies du fond d’œil, suite à une rétinographie avec ou sans mydriase.
Dans un avis rendu en juillet 2007, la HAS a jugé suffisant le service attendu de cet acte. Toutefois, depuis cette date, l’UNCAM n’a pris aucune décision en faveur de son inscription à la classification commune des actes médicaux, la CCAM, et aux nomenclatures générales des actes professionnels, NGAP, concernées.
Quelle est votre position, madame la ministre, sur ce sujet, qui apparaît important en termes de santé publique, compte tenu de la prévalence du diabète, estimée par l’assurance maladie à 3, 95 %, et du très grand nombre de diabétiques atteints de rétinopathie diabétique ?
Je rappelle que cette dernière maladie détectée tardivement aboutit à une cécité, handicap très grave.
Madame la sénatrice, vous l’avez rappelé excellemment, le diabète est une maladie chronique fréquente, en pleine progression. Plus de 2, 5 millions de personnes reçoivent pour cela un traitement médicamenteux, et un diabétique sur cinq ne serait, hélas, pas diagnostiqué comme tel.
La prévention et le dépistage du diabète, ainsi que la prévention des complications sont inscrits dans les politiques de santé publique. Parmi ces dernières, je citerai le programme d’actions de prévention diabète 2002-2005, la loi relative à la politique de santé publique de 2004 et le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique, plan que j’ai lancé en arrivant au ministère de la santé en 2007 et dont nous jugerons les résultats fin 2011.
Il a été montré qu’équilibrer parfaitement le diabète permettait d’éviter ou de retarder l’apparition de la rétinopathie. C’est pourquoi j’attache une attention toute particulière â l’éducation thérapeutique du patient, disposition qui a été sacralisée dans la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009.
Cette éducation doit, d’une part, permettre de diminuer l’incidence des complications du diabète, dont la rétinopathie, et, d’autre part, sensibiliser ces patients à la nécessité de l’examen du fond d’œil annuel.
En effet, la particularité de la rétinopathie diabétique est son évolution progressive. Longtemps asymptomatique, elle évolue à bas bruit. C’est pourquoi le dépistage est indispensable afin de mettre en place, avant l’évolution ultime vers la cécité, un suivi et des mesures thérapeutiques.
La loi relative à la politique de santé publique de 2004 a d’ailleurs posé comme objectif que 80 % des patients bénéficient d’un suivi annuel ophtalmologique, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Cet objectif n’est pas encore atteint.
L’examen du fond d’œil par un ophtalmologiste après dilatation de la pupille est la méthode la plus fréquemment utilisée. La rétinographie, la photographie numérique du fond d’œil, avec ou sans dilatation de la pupille, est également pratiquée. En juillet 2007, la Haute Autorité de santé a jugé suffisant le service rendu par cet examen pratiqué par du personnel non médical, sur un site fixe ou itinérant, avec lecture différée des clichés par un ophtalmologiste.
Au-delà de cet avis portant sur la pratique de l’examen, la direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de santé sur la stratégie de dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée de photographie du fond d’œil. Ces travaux sont en cours de finalisation.
Au regard de cette recommandation de santé publique, mais également des évolutions prévues par la loi HPST dans les domaines de la coopération entre professionnels et de la télémédecine, il faudra envisager, ainsi que vous le soulignez, l’inscription de ces actes aux nomenclatures concernées – classification commune des actes médicaux, la nouvelle CCAM, et nomenclature générale des actes professionnels, la NGAP – avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Nous nous engageons dans cette démarche, madame la sénatrice. Je souhaite que les conclusions de la Haute Autorité de santé nous permettent d’aboutir très rapidement, dans les prochaines semaines ou, à tout le moins, dans quelques mois.

Je remercie Mme la ministre de ses paroles rassurantes. J’avais été contactée par l’association Valentin Haüy, qui est très inquiète de l’augmentation des cécités consécutives à l’insuffisance de la prévention de cette maladie auprès des diabétiques.
Bien entendu, cette prévention sera beaucoup moins coûteuse que le handicap qui suit éventuellement la non-prise en charge et qui est, dans bien des cas, la cécité complète. Je pense que sa mise en place entraînera vraiment une amélioration positive !

La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la question n° 986, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Madame la ministre, je suis particulièrement impatient de connaître votre sentiment sur une affaire qui a engendré une vive inquiétude dans le milieu des donneurs de sang bénévoles, dont je suis d’ailleurs.
Impatient, car j’avais relayé cette inquiétude par une question écrite en date du 5 février 2009 et par une relance en date du 8 octobre 2009, sans réponse de votre part. Il s’agit de l’attribution de plusieurs « marchés » de fournitures de médicaments dérivés de sang issu de prélèvements importés et rémunérés à des multinationales opérant en France.
Ce fut par un communiqué du 14 novembre 2008 qu’une société pharmaceutique suisse bien connue annonçait avoir remporté un marché avec notre service de santé des armées. Cela était, me semble-t-il en contradiction avec l’article L. 5121-11 du code de santé publique, qui n’autorise l’importation de médicaments issus de sang rémunéré que s’il y a pénurie ou s’ils apportent une amélioration en termes de qualité pour les malades.
C’est la raison pour laquelle je vous avais interpellée à l’époque, souhaitant que vous me confirmiez que le Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, avait été dans l’impossibilité, pour une raison ou pour une autre, d’assurer cette fourniture.
Dans le cas contraire, j’étais curieux, et je le suis encore, de savoir si un choix délibéré avait consisté à favoriser une multinationale, créant ainsi un précédent pour le moins malheureux. En effet, n’est-il pas permis de considérer qu’il y a atteinte à la solidarité et à l’altruisme du don, spécificité qui honore notre pays, s’il y a eu choix délibéré de produits issus de prélèvements rémunérés importés, collectés auprès de populations défavorisées et vulnérables, en violation du principe éthique de non-commercialisation de l’humain ?
Madame la ministre, vous devez comprendre cette inquiétude et la faire vôtre. Ce n’est pas nouveau : régulièrement, les industriels producteurs de médicaments dérivés du sang prélevé à l’étranger sous rémunération se permettent de critiquer le système éthique français et de plaider pour « la rémunération des donneurs ». Notre pays ne va tout de même pas céder devant ce honteux lobbying par négligence, car je n’ose croire que ce soit par choix !
Monsieur le sénateur, vous êtes donneur de sang, et moi aussi : au moins nous rejoignons-nous dans cette implication citoyenne !
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l’attribution de marchés de fourniture de médicaments dérivés du sang à des sociétés internationales opérant en France.
Les dispositions législatives en matière de fourniture des médicaments dérivés du sang sont claires. Au titre des dispositions de l’article L. 5124-14 du code de la santé publique, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels suivants : « lorsque des médicaments équivalents en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ». Vous comprendrez que nous souhaitions préserver cette exception !
Dans ces cas, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, peut être amenée à délivrer des autorisations de mise sur le marché dérogatoires, pour une durée de deux ans, à d’autres firmes que le LFB. L’AFSSAPS vérifie, dans ce cadre, le caractère rémunéré ou non des dons de sang dont sont issus les médicaments. Il a été vérifié que, dans le cas que vous soulevez, monsieur le sénateur, le médicament était un facteur antihémorragique fabriqué à partir de collecte de sang non rémunérée.
Il faut souligner, d’une façon générale, qu’il revient naturellement aux établissements de santé d’engager une procédure d’appel d’offres pour s’approvisionner en médicaments dérivés du sang. L’offre la plus satisfaisante est alors retenue, ce qui a dû être le cas pour le service de santé des armées, que vous avez cité.
Nous nous devons d’assurer l’approvisionnement du marché français en médicaments dérivés du sang pour que tous les malades puissent recevoir les produits dont ils ont besoin, notamment dans des situations exceptionnelles. Ce n’est aucunement une renonciation aux principes éthiques que je défends et continuerai à défendre ; bien au contraire !
Ces situations exceptionnelles rendent nécessaire une mise en concurrence d’autres fournisseurs ; à défaut, les malades seraient pénalisés en premier. Il faut cependant toujours vérifier qu’il s’agit de collecte non rémunérée, que la concurrence entre les fournisseurs est équitable et que nous faisons appel au moins-disant.

Madame la ministre, j’ai bien entendu votre réponse, et celle-ci ne m’a pas surpris. Permettez-moi, toutefois, de ne pas me sentir rassuré pour autant.
De telles affaires deviennent trop fréquentes, de l’avis de tous ceux qui sont légitimement attachés à notre pratique éthique. Je vous avais d’ailleurs interrogée à nouveau en juillet dernier sur l’acquisition par la société anonyme LFB d’un groupe autrichien qui collecte du plasma sanguin contre rémunération, en Autriche et en Tchéquie. Cette opération, en contradiction totale avec les principes éthiques du système transfusionnel français, aurait été réalisée avec votre accord ! Avec la Fédération française pour le don de sang bénévole, je déplore qu’aucune solution alternative basée sur l’acquisition par le LFB de plasma éthique n’ait été recherchée.
Je suis consterné par le précédent ainsi créé, qui ouvre un véritable boulevard aux multinationales aux dents longues œuvrant, depuis des années, à faire éclater le système transfusionnel français, qui est un modèle international sur le plan éthique et sanitaire.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 1002, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur la situation des orthophonistes.
Il y a actuellement 18 000 orthophonistes dans notre pays, parmi lesquels 3 800 exercent en tant que salariés et 15 000 en libéral. Cette profession de santé assure la responsabilité de la prévention, de l’évaluation, du traitement et de l’étude scientifique des déficiences et des troubles de la communication humaine à tous les âges de la vie. Elle est aussi très active dans la mise en œuvre des grands plans de santé publique, comme le plan Alzheimer, le plan cancer ou encore le plan autisme.
Ces acteurs de santé responsables répondent, depuis de nombreuses années, aux efforts qui leur sont demandés par le Gouvernement et par les caisses d’assurance maladie. Je tiens notamment à rappeler que les engagements conventionnels ont toujours été respectés avec, par exemple, un taux de télétransmission proche de 80 %.
Malgré cela, les orthophonistes sont en voie de précarisation. La Fédération nationale des orthophonistes dénonce des conditions de travail et de rémunération qui se dégradent depuis de nombreuses années. En effet, la profession n’a connu aucune revalorisation de ses honoraires depuis le 1er janvier 2003, et le montant de l’indemnisation de ses frais de déplacements est bloqué depuis presque dix ans ! Dans le même temps, leurs charges sont en constante augmentation. À titre d’exemple, de 2003 à 2009, les charges de loyer ont augmenté de plus de 24 % et les charges personnelles de plus de 30 %.
Par ailleurs, les orthophonistes bénéficient actuellement d’une formation qualifiante de quatre ans à l’université, sans se voir reconnaître le grade de master. De ce fait, et malgré les responsabilités qui sont les leurs, les orthophonistes salariés de la fonction publique hospitalière sont classés en catégorie B et débutent leur carrière avec un salaire légèrement au-dessus du SMIC.
Cette situation injuste, comme vous en conviendrez, madame la ministre, est dénoncée depuis de nombreuses années par ces professionnels de santé. C’est dans ce contexte que les orthophonistes de Poitou-Charentes ont manifesté à Poitiers, le 3 juillet dernier. Ils n’ont pas reçu, à ce jour, de réponses concrètes de la part du Gouvernement.
J’aimerais donc savoir, madame la ministre, quelles réponses vous comptez apporter face à la cure d’austérité que traversent actuellement les orthophonistes et, plus précisément, si une reconnaissance du niveau master de cette profession, ainsi qu’une revalorisation des salaires et de l’acte médical orthophonique, l’AMO, sont envisagées.
Madame la sénatrice, la valorisation constante de la profession d’orthophoniste et la prise en charge optimale des soins dispensés constituent une des priorités constantes de mon ministère.
Vous m’interrogez sur les conditions de travail et la rémunération de ces professionnels. Comme vous le savez, il appartient aux syndicats représentatifs de la profession des orthophonistes de négocier avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM. Il n’appartient pas aux ministres d’interférer dans ces négociations, si ce n’est pour examiner la légalité des conventions et avenants signés. Je ne doute pas que l’UNCAM, lors des discussions de renouvellement de la convention qui sont en cours, saura reconnaître le rôle des orthophonistes dans le parcours de soins.
Toutefois, alors que toute revalorisation des tarifs doit s’envisager avec attention, compte tenu de la situation actuelle des finances de l’assurance maladie, d’importantes mesures ont d’ores et déjà été prises en faveur de cette profession.
Ainsi, à la suite de l’approbation par arrêté du 17 août 2006 de l’avenant n° 9 à la convention nationale des orthophonistes, une décision de nomenclature de l’UNCAM a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2006, permettant une revalorisation tarifaire de seize actes différents d’éducation et de rééducation orthophonique. Le coût de ces revalorisations représente environ 9 millions d’euros en année pleine.
En outre, l’avenant n°11, signé le 15 novembre 2007 par la Fédération nationale des orthophonistes et l’UNCAM, comporte un article unique, relatif à la revalorisation de la lettre-clé AMO, qui passe ainsi de 2, 37 à 2, 40 euros.
Ces revalorisations tarifaires ont permis une augmentation, non négligeable, de plus de 6, 3 % des honoraires des orthophonistes entre 2007 et 2008. Ainsi, les honoraires moyens annuels d’un orthophoniste libéral s’élevaient, en 2008, à près de 49 575 euros.
D’autres mesures ont, par ailleurs, été prises par l’Assurance maladie afin de soutenir les orthophonistes. Ainsi, près de 2 millions d’euros ont été engagés par an pour favoriser la formation continue, soit plus de 760 euros par professionnel.
Les contrats de bonne pratique ont été prorogés jusqu’à la fin de 2010 et ont donné lieu à un versement de près de 600 euros par contrat en 2009.
Enfin, différentes mesures témoignent également de l’attention que portent le ministère et l’Assurance maladie à cette profession, notamment en ce qui concerne la simplification et l’informatisation des procédures. Ainsi, les orthophonistes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient désormais d’une aide pérenne à la télétransmission de 300 euros par an.
Concernant la formation, enfin, je rappellerai que cette profession figure parmi les premières dans la programmation de la réingénierie des diplômes, dans le cadre du processus licence-master-doctorat. Cette démarche a vocation à être conduite, en étroit partenariat avec le ministère de la santé, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, puisque cette formation est déjà intégrée, comme vous le savez, à l’université. La reconnaissance du caractère universitaire des diplômes ne relève pas de mon ministère.
Conformément aux principes décrits dans le protocole du 2 février 2010, les orthophonistes bénéficieront, comme les autres paramédicaux et rééducateurs suivant au moins trois ans de formation, d’un passage en catégorie A dès lors que leur formation aura été rénovée. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Vous n’ignorez pas que la reconnaissance du caractère universitaire d’un diplôme n’est pas simplement liée à une durée d’études, mais à une refonte complète des maquettes d’enseignement, ce qui implique son examen par la Conférence des présidents d’universités et une vérification régulière par l’Agence d’évaluation de la recherche de l’enseignement supérieur, l’AERES. Il ne s’agit pas, dans le cadre de ce processus, d’accorder des diplômes universitaires au rabais. Mais je sais, madame la sénatrice, que je prêche une convaincue !

La parole est à Mme Esther Sittler, auteur de la question n° 948, adressée à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Madame le ministre, j’ai souhaité attirer l’attention M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, pour le calcul des contributions communales et intercommunales.
Ces contributions sont généralement fixées par habitant. Les chiffres des populations retenus pour le calcul de ces contributions sont ceux du recensement de 1999, actualisés en 2002, tels qu’ils ont servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Or l’actualisation des bases démographiques des SDIS pour le calcul des contributions 2009 n’a pas été possible, car les résultats du recensement ont été rendus publics postérieurement au vote de ces contributions par les conseils d’administration des SDIS.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, « le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation [...] ».
Or, dans la série « Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac », cet indice des prix à la consommation de référence, utilisé par de nombreux SDIS, notamment celui du Bas-Rhin, a diminué d’environ 0, 65 % entre juillet 2008 et juillet 2009.
Dans sa réponse du 26 novembre 2009 à la question écrite n° 9379 de Philippe Richert, le ministre de l’intérieur suggérait la possibilité de changer d’indice de référence, en utilisant le taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances. Or l’indice de référence a bien souvent fait l’objet d’une contractualisation dans le cadre des conventions de transfert des centres de première intervention, et ne peut donc être changé en cours de contrat.
Les SDIS concernés sont ainsi privés des recettes supplémentaires qui leur auraient été nécessaires pour faire face à l'augmentation du nombre d'interventions et des charges liées à l'accroissement démographique.
Ne conviendrait-il pas, par conséquent, de modifier les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales pour qu’il soit possible de tenir compte non seulement des variations indiciaires annuelles de l'IPC mais aussi des variations démographiques ? Il conviendrait de veiller à ce que le budget des SDIS concernés ne soit pas grevé et qu’il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles qui ont présidé à la constitution des corps départementaux.
Madame le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, M. Brice Hortefeux, qui m’a chargée de vous transmettre sa réponse.
Le dispositif prévu par la loi relative à la démocratie de proximité de 2002, confirmé par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, vise, à terme, à faire du département le principal financeur du SDIS, en prévoyant que le conseil général fixe lui-même sa contribution au SDIS et y dispose de la majorité des sièges au conseil d'administration.
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, auquel vous faites référence, a eu pour effet de faire porter par le département, à compter de l'exercice 2003, la charge de toutes les dépenses supplémentaires du SDIS.
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008, l'État a souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents communaux soit maintenu. Au moment où le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile était pérennisé, il n'a en effet pas semblé opportun d'accompagner ce dispositif d'un signal inflationniste.
S'agissant de l'indice des prix à prendre en compte pour le calcul de l'évolution des contingents communaux, en application de l'article L. 1424-35 du CGCT, il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des EPCI au vu des critères qu'il définit. Comme l’a précisé le ministre de l’intérieur dans sa réponse à une question écrite de M. Philippe Richert, rien n'interdit au conseil d'administration de décider, lors de l'élaboration du budget, de l'indice des prix à prendre en compte annuellement. Il peut utiliser soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois, soit le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne des prix à la consommation des ménages – hors tabac – associé au projet de loi de finances.
Au nom du principe de la libre administration des collectivités locales, il paraît préférable de laisser la possibilité aux élus du conseil d'administration du SDIS de décider annuellement, en fonction du contexte et des circonstances locales, du choix de l'indice à prendre en compte, et de ne pas imposer à l'ensemble des SDIS des modalités uniformes de calcul des contributions communales.
En tout état de cause, dans le contexte budgétaire contraint qui conduit les départements à modérer leur contribution, il est important de souligner que les budgets des SDIS sont stabilisés depuis trois ans, la progression de leurs dépenses totales étant de 3 % depuis 2007. En outre, l'examen des budgets primitifs de ces établissements publics fait apparaître une hausse très modérée – 1, 36 % hors inflation – par rapport aux budgets primitifs de 2009.
C'est cette voie de la modération de la dépense publique qu'il convient de privilégier par la mise en œuvre de mesures visant à une meilleure maîtrise des dépenses des SDIS : réduction des coûts de formation, développement des mesures de mutualisation des achats et des fonctions supports avec les autres services.
C'est dans ce sens, madame le sénateur, que doit se poursuivre la réflexion dans laquelle la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur s'est engagée en soutien des élus et des SDIS.

Madame le ministre, je vous prie de remercier M. Hortefeux de cette réponse. Le département du Bas-Rhin n’étant pas connu pour être dispendieux, je suis sûre que le président du conseil général en comprendra le bien-fondé.
Cependant, je sais aussi que notre département compte un grand nombre de sapeurs-pompiers et que la fin du bénévolat, la création des corps départementaux et l’instauration des vacations – y compris pour les corps de première intervention – ont renchéri le coût de cette sécurité civile. Comme celui du Haut-Rhin, notre département est connu pour avoir un fort contingent de sapeurs-pompiers volontaires, lequel justifie la préoccupation du président de notre conseil général.
Je transmettrai assurément cette réponse à M. Kennel, qui est lui aussi très conscient des efforts de gestion à réaliser. C’est en effet l’un des rares présidents de conseil général à ne pas appeler à la révolte contre l’État au sujet des finances locales. C’est un ami personnel et je suis intimement convaincue qu’il agira au mieux, dans l’intérêt des sapeurs-pompiers, de notre sécurité civile et du département.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteur de la question n° 995, adressée à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales.

J’ai souhaité attirer l’attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003 – plus particulièrement de ceux de mon département de l’Essonne – et sur l'absence de suites données jusqu’ici au débat organisé au Sénat le 1er avril dernier.
Des engagements avaient en effet été pris par le Gouvernement, dont celui de reverser aux sinistrés le reliquat de l'aide exceptionnelle de 2006, soit 1, 7 million d'euros. Sept mois se sont écoulés depuis lors, et l’ensemble des préfectures sont toujours dans l'attente de nouvelles instructions pour procéder à cette réattribution. Quant aux sinistrés, ils attendent toujours que l'on se soucie d'eux et de leur situation souvent dramatique.
Voilà en effet sept années que des familles ont tout perdu, qu’elles ont vécu des drames psychologiques et financiers, qu'elles se sont battues – et se battent encore – pour leur dignité et contre l'injustice. De loi de finances en loi de finances et de question parlementaire en question parlementaire, ce sont sept années profondément douloureuses que ces familles ont traversées, dans l'attente et l’espoir qu’enfin une évolution survienne et que leur situation soit prise en compte. Aujourd’hui, elles ne peuvent plus et ne doivent plus attendre.
Le 28 août dernier, des représentants des associations de victimes ont été reçus par des conseillers du ministère de l'économie et du budget. Ce jour-là, en entendant ces derniers, quelle ne fut pas leur stupeur de constater que rien n'avait encore été engagé !
En conséquence, je vous saurais gré, madame la ministre, de bien vouloir nous indiquer l'état d'avancement actuel du dispositif. Dans quels délais les préfectures seront-elles en mesure, en collaboration avec les associations que j’évoque, de rouvrir le dossier de l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003 et de distribuer le reliquat qui existe ? Quels critères de répartition seront retenus ? Quel montant sera octroyé à chacune d’entre elles ?
Madame la ministre, nous attendons maintenant des éléments précis, des dates, des chiffres, et non plus de vagues engagements, qui ne convainquent plus personne : ni la parlementaire que je suis, ni surtout les sinistrés eux-mêmes.
Madame le sénateur, vous avez attiré l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003.
Conscient de l'ampleur de ce phénomène, le Gouvernement, dans le cadre de l’article 110 de la loi de finances de 2006, a mis en œuvre un dispositif exceptionnel de solidarité nationale, doté de 218 millions d'euros, en faveur des sinistrés des communes non reconnues, qui ne pouvaient prétendre, en principe, à aucune indemnisation. Ce crédit a été mis en place à titre provisionnel auprès des préfets des départements concernés.
Lors du débat organisé le 1er avril dernier au Sénat sur les conséquences de la sécheresse de 2003, le Gouvernement s'est engagé à ce que les crédits non distribués par les préfets, estimés à environ 2 % de l'enveloppe initiale, soient répartis entre les départements où l'instruction des dossiers révélerait une sous-estimation significative des besoins initiaux.
Néanmoins, la majorité des préfets n'est pour l’instant pas en mesure de déterminer le montant définitif des crédits nécessaires aux sinistrés de leur département au titre de l'article 110. En effet, le versement des aides est conditionné à la production de factures relatives aux travaux réalisés. Or, tous les justificatifs de paiement n'ont pas encore été présentés par les victimes de la sécheresse. Les préfectures ne peuvent donc pas clôturer les dossiers et redéployer l'éventuel reliquat entre les sinistrés qui se trouvent toujours en situation de légitime désarroi.
Aussi, madame le sénateur, le ministre de l’intérieur réfléchit actuellement à la possibilité de fixer une date limite de production, par les sinistrés faisant l'objet de l'aide initiale, des factures de réalisation de leurs travaux, afin de pouvoir donner suite dans les meilleurs délais aux demandes qui n'auraient pas encore été prises en compte.

Je vous remercie, madame la ministre, de la réponse que vous m’avez faite au nom de M. Alain Marleix. Vous avez bien exposé l’ensemble de la procédure, mais je ne peux pas accepter ce qui a été dit concernant la non-production des justificatifs de travaux réalisés.
S’agissant de mon département, dont je suis les dossiers depuis de longues années, en relation avec des représentants tant essonniens que nationaux, il n’est pas acceptable d’entendre dire que de nombreuses factures n’ont pas été présentées par les sinistrés. Il n’est pas non plus acceptable d’entendre annoncer qu’une date butoir de production des justificatifs va être fixée !
Des dossiers ont déjà été fournis par de nombreux sinistrés, et ce dans tous les départements concernés. Les associations ont clairement exprimé leurs attentes, notamment lors de la rencontre du 28 août. Je relaierai évidemment les informations, très précises et très inquiétantes, que vous me donnez ce matin, en particulier au sujet de la date butoir précédemment évoquée. Permettez-moi de dire qu’elles ne correspondent pas à la réalité du terrain, et que nous ne pouvons donc pas les accepter.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1000, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

Madame la ministre, ma question s'adressait à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Je tiens donc par avance à vous remercier d'avoir bien voulu y répondre, tout en regrettant l'absence de M. Lellouche.
Le 13 juillet dernier, le parlement luxembourgeois a adopté une loi portant réforme de la politique luxembourgeoise d'allocations familiales des travailleurs frontaliers. Souhaitée par le gouvernement souverain de M. Juncker dans le cadre de sa politique de rigueur budgétaire, cette loi va entraîner de lourdes conséquences pour les travailleurs frontaliers.
En effet, elle prévoit la suppression des allocations familiales pour les frontaliers ayant des enfants de plus de 18 ans qui poursuivent encore des études. Elle prévoit également la modification des conditions d'attribution du « boni pour enfant », entraînant, pour les travailleurs français, la suppression de fait de cette prestation d'un montant de 922, 56 euros par an et par enfant. Elle ne sera désormais versée qu'aux enfants qui perçoivent une aide de l'État pour poursuivre leurs études, cette aide étant réservée aux étudiants résidant au Luxembourg depuis plus de cinq ans. Enfin, elle prévoit la suppression pure et simple de l’allocation de rentrée scolaire dès l'âge de 18 ans.
Après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010, à l'initiative du Gouvernement et notamment de Mme Morano, du décret relatif aux modalités de calcul et de versement de l’allocation différentielle pour les travailleurs frontaliers français, dont l’application fut reportée au lendemain des élections régionales et l’on sait pourquoi, cette loi luxembourgeoise vient encore aggraver la situation des 70 000 Lorrains qui travaillent au Grand-Duché. Ainsi, une famille ayant deux enfants de 21 et 22 ans enregistrera une perte pouvant atteindre 4779 euros par an : il s’agit là d’une somme considérable, particulièrement en période de crise.
De plus, cette loi, qui émane d’un État souverain – je le rappelle –, instaure une discrimination, inadmissible au sein de l'espace européen, entre travailleurs résidents et non résidents, puisqu'elle revient à rompre l'égalité des droits des salariés suivant leur nationalité.
Face à cette situation, j'aimerais donc, madame la ministre, que vous m'indiquiez la position du Gouvernement et que vous me précisiez les différentes dispositions que celui-ci compte prendre afin de veiller à l'intérêt de nos ressortissants.
Par exemple, reviendrez-vous, comme cela serait souhaitable, sur le décret relatif aux modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle pour les frontaliers français ?
Monsieur Todeschini, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes, qui m’a demandé de vous transmettre sa réponse.
Dès sa nomination, Pierre Lellouche a souhaité que soit engagée une réflexion sur la politique transfrontalière de la France.
Dans cette perspective, le rapport de la mission parlementaire confiée par le Premier ministre au député de l’Ain Etienne Blanc et à la sénatrice du Bas-Rhin Fabienne Keller, accompagnés de la députée européenne Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, dresse des constats édifiants sur la perte de compétitivité de nos territoires frontaliers et formule des propositions ambitieuses, que le Gouvernement étudie actuellement. Ce rapport, remis au Premier ministre en juin dernier, est disponible en ligne sur le site internet du Quai d’Orsay.
Dans ce cadre, la réforme de la politique d’allocations familiales décidée dernièrement par le gouvernement luxembourgeois soulève un certain nombre de questions, s’agissant notamment du respect des principes de libre circulation et d’égalité de traitement posés par le droit européen.
Il convient de rappeler que notre législation nationale comprend, en matière de prestations familiales, un dispositif protecteur pour les personnes résidant en France mais relevant à titre principal de la législation de sécurité sociale d’un autre État membre. Il s’agit de l’allocation différentielle, l’ADI, qui peut être versée par les caisses d’allocations familiales aux frontaliers qui résident en France et travaillent dans un autre État membre de l’Union européenne. L’éligibilité à l’ADI est constatée dès lors que les prestations familiales servies par cet État sont inférieures à celles qui sont versées en France. Le montant de cette allocation correspond à la différence entre les deux niveaux de prestation.
Ce dispositif garantit donc aux intéressés la perception d’un montant global de prestations au moins égal au montant total des prestations françaises qu’ils percevraient s’ils travaillaient en France, et ce quelles que soient les évolutions du niveau des prestations luxembourgeoises.
À cet égard, la réforme récente, par le gouvernement français, du mode de calcul de l’ADI vise à permettre un traitement plus équitable des bénéficiaires de nos prestations familiales qui résident en France, en réduisant les possibilités de cumul de prestations et en rétablissant l’égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires. Le changement du mode de calcul de l’ADI s’inscrit donc pleinement dans le cadre d’un plus grand respect des règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale et d’égalité de traitement.
Par ailleurs, soucieux de faciliter un développement harmonieux et plus équilibré des échanges entre les régions frontalières des deux pays, le Gouvernement a conclu le 26 janvier dernier avec son homologue du Grand-Duché une convention portant création d’une commission intergouvernementale pour le renforcement de la coopération transfrontalière. Le Gouvernement a souhaité associer le plus étroitement possible les élus des territoires concernés à la recherche, avec nos partenaires luxembourgeois, de solutions permettant de lever les difficultés de tous ordres qui pourraient exister.
C’est pourquoi Pierre Lellouche a proposé au président du conseil régional de Lorraine, aux présidents des conseils généraux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, aux députés des trois circonscriptions frontalières du Luxembourg et au président tournant du Sillon lorrain de faire partie de la délégation française au sein de cette commission, aux côtés du secrétaire d'État et de représentants de l’État.
Une fois la réponse de tous ces élus connue, et la composition de la délégation formellement arrêtée et notifiée à nos partenaires luxembourgeois, il leur sera proposé de tenir rapidement la réunion inaugurale de la nouvelle commission.
L’impact des mesures qui font l’objet de votre question sur la situation de nos compatriotes travailleurs transfrontaliers figurera à l’ordre du jour de cette réunion.

Le principal intéressé n’étant pas là, je ne vous ferai pas grief, madame la ministre, de la réponse que vous avez transmise !
Il est clair que le secrétaire d’État chargé des affaires européennes ne répond pas à ma question, alors même qu’il y a urgence. Certes, l’État souverain du Luxembourg a le droit de prendre les décisions qu’il souhaite. On aurait cependant pu faire remarquer qu’il existe désormais deux régimes d’aide familiale pour des personnes qui travaillent dans un même État.
Les résidents frontaliers lorrains qui travaillent au Luxembourg contribuent au financement de l’État luxembourgeois et à sa politique sociale par leurs impôts sur le revenu, qu’ils paient au Luxembourg. Il serait donc urgent, selon moi, non pas d’attendre la réunion de cette commission, mais que le Gouvernement français fasse connaître sa position et annonce ce qu’il compte faire pour défendre nos ressortissants.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, auteur de la question n° 1001, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question, qui s’adresse à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte sur la situation financière des départements.
Lors de la deuxième conférence sur le déficit du 20 mai dernier, le Président de la République a annoncé que les concours de l’État aux collectivités territoriales évolueront en 2011 selon une norme de stabilité en valeur.
Cependant, l’état des finances départementales ne permet pas de faire face à une telle rupture. Remis le 26 avril dernier au Premier ministre, le rapport Jamet met en évidence que la situation budgétaire des départements est contrastée, notamment concernant les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Parfois aggravée par le profil démographique, elle fait craindre un « désajustement » structurel entre les recettes et des prestations sociales dont la montée en puissance perdure.
Le rapport confirme que les départements subissent une dégradation très brutale de leurs comptes. Il dresse la liste des onze départements les plus gravement touchés par l’accroissement des dépenses sociales et la faiblesse des ressources. Parmi ceux-ci, la Creuse possède le taux le plus élevé de personnes âgées de plus de 75 ans et une dépense sociale par habitant de 579 euros.
Les effets de la crise sur la baisse des recettes se poursuivent et se cumulent à la progression non maîtrisable des dépenses obligatoires liées aux allocations universelles de solidarité : revenu de solidarité active, RSA ; allocation personnalisée d’autonomie, APA ; et prestation de compensation du handicap, PCH.
Les transferts de charges non compensés et l’impact financier de l’évolution des normes complètent un tableau très sombre. Face à ces tensions, les départements, dont l’autonomie fiscale a été réduite, ne disposent plus du levier fiscal pour mettre partiellement en adéquation ressources et dépenses.
Enfin, s’agissant des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les finances locales, les engagements du Gouvernement n’ont pas été tenus ; je pense en particulier à la « clause de revoyure » prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2010 et relative à la mise en œuvre de mécanismes d’ajustement et de péréquation en faveur des collectivités pénalisées.
Le 1er juin dernier, recevant une délégation de l’Assemblée des départements de France, le Premier ministre a annoncé la mise en place, à compter de septembre 2010, d’une mission d’appui aux départements, qui pourrait proposer des avances du Trésor. Il a également évoqué une réforme de l’APA. Or les départements sont à la veille de subir un effet de ciseau encore plus violent que ce que nous avons connu ces dernières années.
Madame la ministre, l’État entend-il prendre pleinement en considération, et ce dès 2011, le caractère d’urgence de la situation de péril des départements les plus exposés ? Pouvez-vous nous préciser les mesures structurelles envisagées pour y répondre durablement ?
Monsieur Lozach, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de François Baroin, qui n’a pu être présent ce matin.
Vous avez évoqué la situation des départements, et, plus généralement, le niveau des dotations de l’État aux collectivités territoriales, ainsi que la clause de revoyure dont le principe avait été retenu au moment de la réforme de la taxe professionnelle.
Sur la stabilité en valeur des concours de l’État aux collectivités locales, je vous répondrai que le Gouvernement a traduit dans le projet de loi de finances les décisions qui avaient été prises lors de la conférence sur les déficits publics présidée par le Président de la République et que l’État s’impose à lui-même cette même règle de stabilité en valeur, hors dette et pensions. Elle est nécessaire pour le redressement des comptes publics.
Toutefois, cette stabilité en valeur doit s’accompagner d’une plus grande péréquation au sein de l’enveloppe, afin de protéger les plus fragiles. Le Gouvernement propose donc de renforcer la péréquation départementale, tout en s’assurant qu’aucun département ne verra sa dotation globale de fonctionnement, baisser.
Concernant la clause de revoyure adoptée lors de la réforme de la taxe professionnelle, vous vous inquiétez, monsieur le sénateur, de ce que le Gouvernement n’aurait pas respecté son engagement à cet égard. Il est vrai que la loi de finances de l’an dernier prévoyait un rendez-vous législatif cet été ; nous avons néanmoins décidé, en accord avec les parlementaires en mission sur la taxe professionnelle, de le reporter au moment de l’examen du prochain projet de loi de finances, afin de pouvoir disposer des dernières simulations et tirer le meilleur parti des rapports des inspections et des parlementaires.
Des dispositions relatives à la péréquation horizontale figurent donc dans le projet de loi de finances pour 2011, notamment à l’échelle départementale, qui vous préoccupe. Le Gouvernement présentera en outre une amélioration du mécanisme de péréquation des DMTO, lequel avait été introduit l’an dernier par vos collègues de l’Assemblée nationale. Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne nationale – c’est le cas de la Creuse – pourront dès lors bénéficier de la reprise du marché immobilier, qui, comme chacun sait, n’est pas uniforme sur le territoire. J’en profite pour indiquer que les DMTO, au vu des chiffres disponibles à la fin du mois d’août, progresseraient de 39 % de 2009 à 2010, ce qui est une bonne nouvelle pour les départements.
Vous le savez, monsieur le sénateur, le Gouvernement est vigilant concernant la situation des départements, comme M. le Premier Ministre a eu l’occasion de l’indiquer à l’Assemblée des départements de France avant l’été. La mission d’appui qui avait été annoncée lors de cette rencontre est désormais opérationnelle. Tout département rencontrant des difficultés financières peut se rapprocher de cette mission, qui pourra proposer le cas échéant un contrat de stabilisation. Celui-ci devra permettre d’accompagner, via un système d’avances, les départements qui connaîtraient des difficultés importantes en 2010. Le Gouvernement présentera en projet de loi de finances rectificative pour 2010 les dispositions permettant de mettre en œuvre concrètement ces avances.
De façon plus structurelle, comme l’ont déjà annoncé le Président de la République et le Premier ministre, nous avons décidé d’un moratoire sur les normes, afin de mettre un frein à l’effet inflationniste que celles-ci peuvent avoir sur les dépenses des départements. Enfin, passée la réforme des retraites, le Gouvernement entend mener la réforme de la dépendance, afin de faire face à ce défi démographique, social et financier, qui concerne bien évidemment nos départements

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Vous avez perçu, me semble-t-il, le sens de mon interpellation : le rapport Jamet ne doit pas rester lettre morte mais être véritablement suivi d’effets.
Les difficultés des finances départementales ont été bien pointées. Un certain nombre de départements, notamment les départements ruraux à faible densité de population, traversent de graves difficultés qui relèvent de handicaps structurels.
C’est la raison pour laquelle nous sommes véritablement en attente de mesures pérennes. À cet égard, je doute que le « frémissement » que connaissent aujourd’hui les droits de mutation à titre onéreux soit véritablement suffisant pour faire face aux difficultés sociales et économiques que rencontre le pays. À mon avis, il importe de redonner davantage de liberté d’action et d’efficacité à l’ensemble de nos collectivités.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 1005, adressée à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Madame la ministre, je souhaite réagir face à l’alourdissement considérable des taxes spécifiques dues par les étrangers extracommunautaires en situation régulière en France.
En effet, en application du décret n° 2010-689 du 24 juin 2010, le montant de la taxe de primo-délivrance d’un titre de séjour passera de 300 euros à 340 euros, soit une augmentation de 13 %, et celui de la taxe de renouvellement de titre de séjour, de 70 euros à 110 euros, soit une augmentation de 57 %.
On peut se poser la question de la légitimité de telles taxes au regard de l’égalité de traitement des citoyens, puisque ces citoyens étrangers qu’on impose inconsidérément restent soumis aux autres taxes – taxe d’habitation, TVA –, ainsi qu’aux impôts dus par tous les habitants du pays. Quand ces mêmes taxes spécifiques subissent des augmentations aussi lourdes, une telle situation n’est définitivement plus acceptable.
N’est-ce pas encore condamner les plus pauvres et les plus précaires que de les stigmatiser par l’argent en grevant leurs maigres finances dès leur projet d’installation ?
Le décret précise que ces taxes sont affectées à l’OFII, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, chargé principalement, comme chacun sait, des mesures d’intégration, d’accueil et de suivi des étrangers après leur arrivée sur le sol français. Quel cynisme dans cette pratique, qui revient à pratiquer des saignées pour faciliter les transfusions !
Enfin, a-t-on pensé, madame la ministre, aux conjoints étrangers de Français qui, lors d’un long séjour en France, se voient eux aussi inconsidérément taxés ?
Par ailleurs, a-t-on pensé aux répercussions, toujours possibles, sur la situation des Français établis hors de France ? A-t-on mesuré les conséquences de l’augmentation de ces taxes pour nos compatriotes qui résident à l’étranger, désormais à la merci de mesures de rétorsion de la part des gouvernements étrangers ?
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Éric Besson, qui n’a pu être présent ce matin.
Comme vous le savez, le Gouvernement a décidé la création, en 2009, d’un nouvel opérateur public en matière d’immigration et d’intégration, à savoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, qui a succédé à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, l’ANAEM, avec des missions accrues.
Il a également décidé, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2009, de procéder à une réforme profonde des ressources propres de cet établissement, en remplaçant un système complexe de redevances payées par les étrangers par un système plus simple comportant un nombre limité de taxes affectées à l’OFII.
Un décret pris le 24 juin 2010 a augmenté le tarif de certaines taxes dues par les étrangers auxquels un titre de séjour est délivré ou renouvelé. La taxe de délivrance du premier titre passe ainsi à 340 euros, tandis que la taxe de renouvellement passe à 110 euros.
Ces nouveaux tarifs restent compris dans la fourchette de taux fixée par la loi. Ils ne sont ni les plus bas ni les plus élevés d’Europe ; ils sont – pour autant que les systèmes soient comparables – plus élevés qu’en Belgique ou qu’en Italie, du même ordre de grandeur qu’en Allemagne et très inférieurs aux montants atteints aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande ou en Grèce.
En outre, cette augmentation des tarifs ne concerne qu’une partie des étrangers demandeurs d’un titre de séjour. Vous connaissez la priorité accordée par le Gouvernement à l’accueil des étudiants étrangers, et qui s’est traduite concrètement, en 2009, par l’arrivée de près de 12 % d’étudiants en plus par rapport à 2008.
Nous avons fait le choix ne pas leur appliquer d’augmentation de taxe. Il en est de même pour les réfugiés.
Enfin, je veux vous rassurer sur les raisons de cette augmentation des ressources propres de l’OFII : il s’agit bien de renforcer les moyens déployés par cet établissement public pour l’intégration des étrangers. L’OFII est l’opérateur de l’État pour la mise en œuvre du contrat d’accueil et d’intégration ; il offre chaque année à 100 000 étrangers primo-arrivants une formation civique, une formation linguistique et une session d’information sur la vie en France.
C’est ce gouvernement qui, par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, a renforcé les prestations offertes aux primo-arrivants. Ainsi, depuis 2009, l’OFII propose un bilan de compétences professionnelles à tous les signataires du contrat d’accueil et d’intégration qui le nécessitent, soit 55 618 bilans prescrits en 2009 et probablement plus de 60 000 en 2010. De même, pour les migrants familiaux, nous avons instauré une préparation du parcours d’intégration dans le pays de résidence et, s’ils ont des enfants, un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille.
Toutes ces formations sont proposées par l’OFII à titre gratuit, ce qui nous distingue de la plupart de nos voisins étrangers.
Au total, la moitié des moyens de l’OFII, soit 84 millions d’euros en 2010, sont consacrés à l’intégration des étrangers.
Madame la sénatrice, le régime de taxes de l’OFII est en application depuis deux ans ; il mérite quelques adaptations, objet d’une disposition du projet de loi de finances pour 2011. Mais l’enjeu principal pour le Gouvernement, sa priorité, c’est de réussir l’intégration des immigrés en situation légale. Jamais, dans notre pays, les primo-arrivants n’ont bénéficié d’un tel niveau de prestations pour assurer leur intégration.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse détaillée. J’aimerais cependant vous citer l’extrait d’un courrier que j’ai reçu de l’un de nos compatriotes, citoyen français résidant à Taïwan et marié à une ressortissante taïwanaise, diplomate et femme d’affaires.
Voici les termes de ce courrier : « Venus habiter quelques mois en France avec mon épouse, nous avons été profondément choqués par diverses pratiques de l’État français à l’égard de mon épouse. Pour que vous compreniez notre colère commune, partagée par de nombreux couples dits “mixtes”, lors de notre premier séjour long en France, en 2008, il nous a été demandé la somme de 300 euros pour une carte de séjour au nom de ma compagne. Récemment, lors d’un second séjour, nous avons eu la surprise de constater que la taxe OFII était passée, pour assurer le renouvellement du titre de séjour de mon épouse, de 70 euros à 110 euros. Vous comprendrez aisément que les épouses et époux de Français et de Françaises se sentent traités par l’État français comme des “ressources financières” et non comme des êtres humains à droits égaux avec leurs conjoints. »

La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 1008, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le devenir de l’observatoire de Haute Provence, installé à Saint-Michel-l’Observatoire, dans le département dont je suis l’élu.
En effet, il est question de retirer à l’observatoire de Haute-Provence son statut d’unité de recherche pour le rattacher à une structure de service basée à Marseille, qui centraliserait les différents pôles de recherche de la région.
Je souhaiterais savoir si ce projet est susceptible de modifier le statut de ce centre en environnement et en astronomie ; autrement dit, va-t-il conserver sa caractéristique de lieu de recherche pluridisciplinaire ou bien risque-t-il de devenir un simple site d’observation ?
Je souligne que l’observatoire de Haute-Provence mène actuellement plusieurs projets de développement dans les Alpes de Haute-Provence et travaille en partenariat avec de nombreuses entreprises locales innovantes, notamment dans l’industrie et dans l’énergie solaire.
Le personnel de l’observatoire et les élus locaux s’inquiètent unanimement de cette mesure qui semble être annoncée, mesure dont les conséquences seraient néfastes pour le département. Aussi, madame la ministre, je vous demande de bien vouloir me fournir des informations tangibles sur ce sujet sensible.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité m’interroger sur le devenir de l’observatoire de Haute-Provence. Celui-ci a été créé en 1936. Ses activités de recherche, initialement astronomiques, se sont élargies au fil des ans à l’observation pour les sciences de la planète et de l’univers, avec notamment l’étude de l’atmosphère et de l’environnement.
Cet observatoire va être regroupé avec les autres structures d’observation des sciences de l’univers de l’université Aix-Marseille, l’ensemble conduisant à la création, le 1er janvier 2012, de l’institut Pythéas.
Ce regroupement permettra de constituer une structure à rayonnement international rassemblant des moyens importants pour la recherche, la formation et l’observation dans des domaines tels que l’astronomie et l’environnement.
Aix-Marseille Université et le Centre national de la recherche scientifique se sont engagés à ce que le site de l’observatoire de Haute-Provence soit un site pluridisciplinaire de référence au sein de cette nouvelle structure pour les sciences de l’univers, l’écologie et l’environnement. Par exemple, les recherches concernant l’énergie photovoltaïque ont vocation à se développer sur le site de Saint-Michel-l’Observatoire, en particulier dans le cadre de travaux à caractère partenarial.
Monsieur le sénateur, vous pouvez être rassuré : l’intégration de l’observatoire de Haute-Provence dans la nouvelle structure Pythéas va non seulement renforcer ses activités scientifiques actuelles, mais aussi élargir ses futures thématiques de recherche.
Les cinq chercheurs localisés sur le site de l’observatoire de Haute-Provence vont être rattachés administrativement au laboratoire d’astronomie de Marseille. Je vous rappelle que ce rattachement avait été vivement recommandé lors de l’exercice de prospective quadriennal qui s’est tenu dans le domaine de l’astrophysique, voilà quelques mois.
Mais je veux dissiper tout malentendu : il n’est pas question de déplacer ces chercheurs à Marseille ; ceux-ci resteront localisés à Saint-Michel-l’Observatoire.
De plus, le directeur de l’observatoire de Haute-Provence, qui assurera entre autres la direction administrative de l’observatoire, sera aussi directeur adjoint de Pythéas, et ce afin d’assurer une cohérence organisationnelle, fonctionnelle et scientifique au sein de la nouvelle structure.
Monsieur le sénateur, il est hors de question de réduire les activités scientifiques de l’observatoire de Haute-Provence ; il s’agit au contraire de renforcer son attractivité, d’élargir son périmètre de recherche et de l’intégrer dans un ensemble doté d’une visibilité internationale.

Madame la ministre, je vous remercie de ces propos rassurants, mais, après l’abandon des projets de desserte autoroutière de Digne et de liaison autoroutière entre Sisteron et Grenoble, vous comprendrez que les élus du département des Alpes de Haute-Provence, lequel a été très régulièrement frappé par la révision générale des politiques publiques et a enregistré de très nombreuses fermetures de services, soient inquiets à la perspective de toute fermeture ou de tout rattachement à Marseille d’un service public situé sur son territoire.
Cela dit, je suis certain que mes collègues élus locaux et le personnel de l’observatoire de Haute-Provence seront rassurés par vos propos.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.