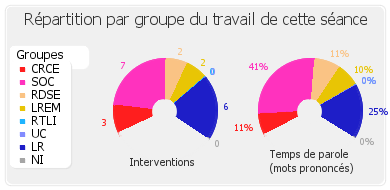Séance en hémicycle du 6 mai 2008 à 10h10
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Désignation d'un sénateur en mission
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Avenir du financement par l'état de l'association scènes et territoires en lorraine (voir le dossier)
- Maintien et développement de l'offre de formation publique dans l'enseignement agricole (voir le dossier)
- Projet d'abandon de la garnison du 7e bataillon de chasseurs alpins à bourg-saint-maurice (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures dix.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Par courrier en date du 29 avril 2008, le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Hubert Haenel, sénateur du Haut-Rhin, en mission temporaire auprès de M. le secrétaire d’État chargé des transports.
Cette mission portera sur l’organisation du système ferroviaire.
Acte est donné de cette communication.

J’informe le Sénat que la question orale n° 180 de M. Francis Grignon est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance de ce jour, pour être reportée à la séance du 20 mai.
J’informe par ailleurs le Sénat que les questions orales n° 237 de M. José Balarello, n° 239 de M. Jean Boyer et n° 240 de M. Simon Sutour sont inscrites à l’ordre du jour de la séance du 20 mai et que la question orale n° 233 de M. Bernard Cazeau est retirée de l’ordre du jour de cette même séance.
Acte est donné de ces communications.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 196, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le terme programmé, pour la fin 2008, du Plan Maladies Rares.
Ce plan, bien que perfectible, a constitué une avancée importante pour les malades et pour leurs proches.
Quatre millions de Français souffrent d’une ou de plusieurs des 8 000 maladies orphelines répertoriées. En dépit d’une grande hétérogénéité, ces maladies présentent des caractéristiques communes. Très souvent graves, chroniques et évolutives, elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou impliquer une perte d’autonomie.
Encore difficilement, tardivement identifiables et prévisibles, elles engendrent bien souvent chez les malades et leur famille un sentiment d’exclusion et génèrent une souffrance morale due à l’absence de traitement.
Ces maladies, délaissées par la recherche médicale, étaient comptabilisées grâce au point indice synthétique d’activité, ISA – j’ignore, madame la ministre, s’il en est de même avec la tarification à l’activité, T2A – dans le groupe homogène de malades, GHM. Il est quelque peu paradoxal qu’une maladie orpheline, qui nécessite un personnel spécifique, soit comptabilisée dans un groupe homogène de malades !
L’objet de ma question est de savoir si le Gouvernement a l’intention de prolonger ce plan et d’obtenir des assurances sur certains points.
Vous m’avez indiqué, en réponse à un récent courrier, que vous réuniriez ce mois-ci le comité de suivi du Plan et qu’un premier bilan serait disponible en septembre 2008.
Les représentants des associations de malades y participeront-ils ? Dans le cadre de la nouvelle comptabilité hospitalière, ces maladies feront-elles l’objet d’un traitement à part ? Enfin, insisterez-vous particulièrement sur les efforts à faire en matière de recherche médicale ? D’ailleurs, ce point n’est pas sans rapport avec la question que j’ai posée la semaine dernière portant sur la recherche en matière de sang de cordon.
Madame la sénatrice, vous avez bien voulu m’interroger sur le devenir du plan maladies rares et je vous en remercie, car c’est un point qui, à juste titre, intéresse beaucoup les parlementaires, d’ailleurs nombreux à me questionner sur ce sujet soit directement, soit par le biais de questions écrites.
Vous le disiez, le plan maladies rares a permis des avancées inespérées. Avant qu’il ne soit élaboré, la prise en charge des 7 000 à 8 000 maladies rares et orphelines, dont près de 80 % sont d’origine génétique, n’était malheureusement pas organisée.
Comme vous le soulignez, ce plan a ainsi permis des avancées majeures dans le diagnostic et dans la prise en charge des patients et de leur famille. La preuve en est que certaines associations dédiées à ces maladies rares n’ont pas hésité à lancer une pétition pour qu’il soit reconduit.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il a été doté d’un financement public à hauteur de 108, 5 millions d’euros, dont 40 millions d’euros destinés à faciliter l’accès aux soins et 43 millions d’euros pour la recherche.
Il a notamment permis la création de plus d’une centaine de centres de référence, qui maintenant permettent de faire un diagnostic et une prise en charge des patients plus précoce et de meilleure qualité.
De plus, les patients atteints de maladies rares bénéficient également du plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. Ce plan, programmé de 2007 à 2011 et piloté par un comité national présidé par Marie-Thérèse Boisseau, que vous connaissez bien, prend en compte les aspects médico-sociaux des maladies chroniques, ce qui est très important.
Je tiens en outre à préciser que le plan maladies rares a permis à la France d’acquérir une position de leader en Europe sur ce thème, ce qui vaut à notre pays d’être cité en référence lors des conseils des ministres européens de la santé, et la plupart des pays européens, à notre suite, ont élaboré ou sont en train d’élaborer leur propre plan.
Nous allons jouer un rôle moteur pour les maladies rares à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, à partir du 1er juillet 2008. Cette thématique est un sujet fédérateur, pour lequel la dimension européenne peut apporter une réelle plus-value et que j’ai mis au menu de nos travaux. La communication lancée par la Commission européenne devrait pouvoir être adoptée par le Conseil des ministres pendant notre présidence.
La France soutient par ailleurs le développement des coopérations entre États membres en matière non seulement de recherche sur les maladies rares, mais aussi de partage des connaissances et de diffusion de l’expertise au travers de réseaux européens de centres de référence.
Vous conviendrez, madame la sénatrice, qu’on ne saurait imaginer que l’effort engagé par la France dans le cadre du plan maladies rares soit interrompu ; il sera évidemment poursuivi au-delà de 2008 afin de consolider les acquis du premier plan.
L’impulsion donnée à la recherche ne sera pas non plus interrompue, pour toutes les raisons que l’on sait, mais aussi parce que la recherche sur les maladies rares sert la recherche sur les maladies fréquentes.
J’ai confié une mission d’évaluation du plan 2005-2008 au Haut Conseil de la santé publique. Les modalités de la poursuite des actions déjà engagées s’appuieront sur cette évaluation.
Je n’envisage pas non plus que les associations mobilisées sur ce sujet ne soient pas consultées de façon continue. J’ai mis, vous le savez, l’écoute et la participation des associations de malades au cœur de ma politique de santé.
Bien entendu, dans le cadre des nouvelles règles de tarification sur l’hôpital, les maladies rares seront traitées de la façon qui convient et leur spécificité sera reconnue.

Madame la ministre, je vous remercie de votre implication.
Je veux également remercier M. le président du Sénat et les services de notre assemblée d’avoir accepté de parrainer prochainement un colloque sur les maladies rares dont nous transmettrons les conclusions.
Puisque vous avez évoqué la question européenne, je ferai, madame la ministre, une observation sur une problématique spécifique, celle de la recherche en matière de médicaments.
Sachant que les médicaments contre les maladies orphelines – comme d’ailleurs les médicaments pédiatriques – n’intéressent pas les laboratoires pharmaceutiques, vous pourriez peut-être organiser à l’occasion de la présidence française un dialogue avec l’agence européenne des médicaments et différents laboratoires pour déterminer quels efforts concrets pourraient être accomplis et faire avancer les choses en matière de recherche comme en matière médicale et sociale.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, auteur de la question n° 226, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Madame la ministre, j’attire votre attention sur la situation des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, les PARM.
Ces permanenciers sont les collaborateurs des médecins régulateurs et ils participent pleinement à l’activité de service public qu’est l’aide médicale urgente, l’AMU.
Ils ont pour mission de réceptionner tous les appels du centre de réception et de régulation des appels, le centre 15, de la demande de renseignement à l’appel urgent, de répondre aux demandes de secours à personnes en provenance du 18 et de gérer la permanence de soins du département.
Chaque appel est bien évidemment enregistré et fait l’objet d’un dossier informatisé.
Les PARM sont incontestablement les intermédiaires entre l’appelant et le médecin, et leur rôle est primordial dans la gestion de l’appel.
Ce rôle est multiple puisqu’ils doivent impérativement localiser le problème, identifier la ou les victimes, questionner l’appelant afin de déterminer le degré d’urgence ainsi que la nature de la demande et de faciliter l’interrogatoire médical, envoyer les moyens de secours après décision médicale, suivre les interventions et assurer l’accueil du patient en milieu hospitalier ou autre.
Les PARM sont donc des éléments essentiels de la chaîne des secours.
Bien qu’ayant conscience de la fragilité du dispositif de l’AMU et des difficultés auxquelles doivent faire face les SAMU, les PARM souhaitent ardemment que leur profession soit revalorisée, avec une reconnaissance statutaire spécifique correspondant à la catégorie B de la fonction publique hospitalière et un reclassement systématique en catégorie B des agents en poste.
Enfin, le métier de PARM nécessitant des compétences pluridisciplinaires et comportant un haut niveau de responsabilités, les permanenciers demandent à ce qu’une formation initiale au métier leur soit dispensée.
Au regard de ces éléments, quelle réponse entendez-vous apporter, madame la ministre, aux 1 600 permanenciers auxiliaires de régulation médicale en France.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu attirer mon attention sur la situation des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, plus couramment appelés les PARM.
Vous l’avez rappelé, les PARM constituent aujourd’hui un corps de catégorie C de la filière administrative. Ils sont recrutés par concours sur épreuves ou sur une liste d’aptitude sur laquelle peuvent, sous certaines conditions, être inscrits les standardistes, ainsi que les aides-soignants et aides-soignantes.
Ils tiennent un rôle majeur dans la prise en charge des urgences, raison pour laquelle le plan urgences 2004-2008 a prévu la création de 600 postes de PARM entre 2007 et 2008.
Cette première marque de reconnaissance, que je qualifierai de « démographique », n’étant pas suffisante, le plan prévoyait également une revalorisation de la profession, notamment avec à court terme l’octroi aux PARM d’une nouvelle bonification indiciaire de vingt points par agent.
Ainsi, les agents qui occupent des fonctions de PARM touchent une bonification indiciaire de 60 euros nets chaque mois.
En outre, le plan ouvrait la fonction de PARM aux professionnels paramédicaux et administratifs de catégorie B. Dans les faits, ce sont le plus souvent aujourd'hui des secrétaires médicales et des infirmières.
Le plan prévoyait également un recrutement au niveau du baccalauréat, avec une formation d’adaptation à l’emploi : une formation obligatoire pour les agents nouvellement recrutés a été mise en place en janvier 2005.
Ces avancées sont tout à fait notables et méritaient d’être rappelées devant cette assemblée. J’entends cependant qu’elles ne correspondent pas à une reconnaissance en catégorie B, comme le souhaitent les PARM.
Les services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative étudient actuellement cette évolution. Dans cette perspective, ils ont notamment rencontré les organisations syndicales représentatives sur ce sujet.
Par ailleurs, je tiens à souligner que l’actualisation du métier, au sein du répertoire des métiers de la fonction publique, sera présentée cet été à l’observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière.
Enfin, je souhaite que l’ensemble de cette réflexion s’intègre dans celle, plus large, du rapprochement des régulations des urgences et de la permanence des soins, conformément à ce qui a été annoncé par le Président de la République à Neufchâteau, le 17 avril dernier.
La question du statut des PARM, qui suscite tout mon intérêt, prend donc place dans un cadre plus large et je vous remercie, monsieur le sénateur, de m’avoir permis, en la soulevant, de rappeler le rôle éminent de ces professionnels de santé indispensables.

Je remercie Mme la ministre de ses réponses qui n’appellent de ma part pas d’autres questions ni de commentaires.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 219, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la ministre, depuis quelque temps, j’essaie d’attirer l’attention du Gouvernement sur une question délicate, celle des enfants nés sans vie.
Aujourd’hui, je souhaite plus précisément attirer celle de Mme le garde des sceaux sur les conséquences des trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février 2008 concernant les conditions d’établissement des actes d’enfants sans vie.
C’est bien sincèrement, madame la ministre, que je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à mes interrogations.
En supprimant le seuil inférieur prévu pour l’établissement d’un acte d’enfant sans vie jusqu’à présent fixé par la circulaire du 30 novembre 2001 conformément aux recommandations de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire vingt-deux semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes, la Cour de cassation bouleverse le régime juridique actuellement applicable aux enfants nés sans vie et pousse à la réorganisation de tout un système.
Ce système avait déjà beaucoup évolué depuis la loi du 8 janvier 1993, sous l’impulsion de trois principaux facteurs : la sensibilité des individus développée notamment par les progrès de l’imagerie médicale et de la chirurgie in utero ; la connaissance accrue des questions de deuil pathologique ; enfin, l’évolution des pratiques des établissements de santé et de certaines municipalités en matière de devenir des corps.
Les arrêts de la Cour de cassation mettent le Gouvernement et le Parlement au pied du mur. Il semble en effet urgent de reconstruire un cadre clair, car les officiers de l’état civil ont besoin de règles sûres.
À cet égard, il faudrait au moins nous interroger sur la fixation d’un seuil minimal, sur le caractère facultatif ou obligatoire de la déclaration, ainsi que sur le contenu et la nature de l’acte d’enfant sans vie.
En France, le régime juridique des enfants nés sans vie se caractérise notamment par la faible portée qu’il attribue à « l’acte d’enfant sans vie » établi par les services de l’état civil lors de la déclaration d’enfants mort-nés ou nés sans vie.
A contrario, comme le montre l’étude de législation comparée réalisée à ma demande et qui vient d’être publiée par le Sénat, il semble que d’autres législations européennes autorisent la reconnaissance légale d’un enfant né sans vie avec pour conséquence la possibilité de déterminer une filiation, d’attribuer un nom et d’inscrire l’enfant sans restriction dans le livret de famille.

Depuis 2005, le Médiateur de la République pointe lui aussi la nécessité de clarifier et d’améliorer le régime juridique des enfants nés sans vie. Il a déjà formulé plusieurs propositions en ce sens et préconise la constitution d’un groupe de travail, piloté par le ministère de la justice, ayant pour mission d’explorer les possibilités de faire évoluer le droit français.
Je souhaite donc savoir où en est la réflexion du ministère de la justice sur ce sujet et quelles sont ses intentions pour faire face aux conséquences des arrêts de la Cour de cassation.
Monsieur le sénateur, l’indisponibilité de ma collègue Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, me donne le plaisir de répondre à une question qui entre largement dans mes fonctions ministérielles et m’interpelle à ce titre.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février dernier, qui ont supprimé tout critère pour établir un acte d’enfant sans vie, suscitent, comme vous le soulignez très justement, de nombreuses interrogations.
Les praticiens et les officiers de l’état civil ont besoin d’un cadre clair pour établir de tels actes.
Nous devons aussi, et même surtout, répondre à la souffrance des familles, confrontées à cette situation très douloureuse.
Mais, sur une question aussi délicate et sensible, il convient d’éviter de légiférer sous le coup de l’émotion et dans la précipitation.
Élever des seuils de viabilité au titre de norme dans le code civil peut paraître la solution la plus simple. Toutefois, la fixation de seuils, fussent-ils ceux de l’OMS, se révélerait, par sa rigidité, source de discriminations et de nouvelles difficultés.
Fixer un seuil, c’est toujours introduire un effet couperet, dont nous pouvons tous comprendre les conséquences négatives.
Des familles pourraient se voir enlever toute possibilité d’établir un acte d’enfant sans vie, pour une question de jours, ce qui ne ferait qu’accroître leur détresse.
Par ailleurs, inscrire dans une norme les critères de viabilité reviendrait à se priver, et surtout à priver les familles, de la souplesse qu’imposent les progrès quotidiens de la médecine.
C’est pourquoi s’est engagée une réflexion interministérielle qui associe les différents ministères concernés, dont notamment le ministère de la santé, mais aussi le ministère de la justice, ainsi que le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Tous ensemble, nous étudions les solutions les plus appropriées pour répondre, d’une part, aux attentes soulevées par les arrêts de la Cour de cassation du 6 février que vous évoquiez dans votre question, monsieur le sénateur, et, d’autre part, aux propositions formulées par le Médiateur de la République.
Il s’agit de dégager des solutions qui, en plus d’être pragmatiques et équilibrées, devront être globales afin de prendre en compte l’ensemble des problèmes ; je pense aux funérailles de l’enfant ou aux conséquences sociales de la délivrance d’un acte d’enfant sans vie.
Ainsi, je puis vous indiquer qu’un décret est en cours de préparation. Les préoccupations que vous exprimez ne resteront pas sans réponse et nous saurons trouver la solution la plus appropriée à chaque situation de détresse. Vous pouvez constater, monsieur le sénateur, que vos préoccupations légitimes sont prises en compte et qu’un travail interministériel actif est en train de s’élaborer.

Madame la ministre, si nous comprenons le problème, nous sommes dans un regrettable vide juridique.
Je sais qu’il est toujours difficile d’établir un seuil inférieur, mais tous les pays européens en ont fixé un. En France, la demande d’inscription sur le livret de famille d’un enfant né sans vie peut commencer dès le début de la grossesse, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.
En outre, nul ne sait comment la cour d’appel de Nîmes va réagir, même si je suppose qu’elle ira dans le sens de la Cour de cassation.
Par ailleurs, il y a des différences entre les départements, les inscriptions sur les livrets de famille se faisant en fonction des décisions préfectorales.
Dès lors, madame la ministre, nous devons faire évoluer la législation, ce qui, nous le savons, est très compliqué. Dans un premier temps, il faudrait revenir à la circulaire de l’OMS, qui n’a pas soulevé autant de problèmes qu’on a bien voulu le dire, même si, bien sûr, il faut tenir compte de la détresse des familles.
Il nous faudra légiférer très rapidement, car nous risquons de connaître des situations dramatiques lors de demandes d’inscription sur les livrets de famille d’enfants dits morts-nés, qui ne sont pas des enfants viables et qui, pour certains, sont des embryons. Ce serait rouvrir le débat sur le statut de l’embryon.
En résumé, il me semble nécessaire de légiférer très vite dans ce domaine et, en attendant, de revenir à la circulaire pour sécuriser le parcours des officiers d’état-civil.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, auteur de la question n° 197, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.

Madame la ministre, l’hôtellerie familiale, qui représente un inestimable patrimoine culturel et touristique dans notre pays, décline au profit, soit de la vente par appartements, soit de la location de meublés, moins contraignante et jugée plus rentable ; ce constat vaut en particulier pour la Haute-Savoie, où, chacun le sait, le tourisme occupe une place extrêmement importante pour l’équilibre économique et social de ce département.
La profession concernée estime qu’actuellement, dans notre pays, un hôtel familial ferme ses portes chaque jour. Les conséquences de cet état de fait sont, à l’évidence, particulièrement préjudiciables à cette branche de notre économie.
En effet, ce sont des emplois qui disparaissent et, avec eux, un savoir-faire culinaire et tout un art de vivre, une irremplaçable animation de nos villes, villages et stations touristiques.
C’est pourquoi, madame la ministre, nous avons, me semble-t-il, le devoir de réagir vigoureusement pour éviter que notre patrimoine touristique ne soit amputé d’un de ses fleurons les plus prisés des vacanciers.
Cette réaction s’impose aussi pour assurer la pérennité de la formation professionnelle hôtelière, qui ne saurait se limiter à un simple enseignement théorique.
Seul un dispositif de mesures appropriées me semble pouvoir inverser la tendance et, parmi les remèdes, je pense à un allégement significatif des droits de succession destiné à favoriser la transmission des entreprises, ou encore à une réduction importante de la TVA sur les services ; ces mesures ne sont d’ailleurs rien d’autre que des dépenses d’investissement et de soutien à l’emploi, et non pas de solidarité envers telle ou telle catégorie socioprofessionnelle.
Quelle est, madame la ministre, sur ces deux dispositifs, la position du Gouvernement ? A-t-il, en particulier, la volonté de requérir de l’Union européenne les accords nécessaires en ce qui concerne la TVA ? Plus globalement, quelle politique envisage-t-il pour assurer l’avenir de cette activité économique, ô combien nécessaire à la bonne santé de notre économie touristique et de nos emplois dans ce secteur ?
Monsieur le sénateur, votre question me donne le plaisir de vous répondre au nom de mon collègue Hervé Novelli. Je le fais d’autant plus volontiers que le fait de parler d’art de vivre est plutôt un signe sympathique adressé à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative !
Il est vrai, monsieur le sénateur, que l’hôtellerie familiale constitue à la fois, en Haute-Savoie et ailleurs, un savoir-faire culinaire et tout un art de vivre qu’il nous faut préserver.
Le Gouvernement s’y emploie. Le dossier TVA pour le secteur des hôtels, cafés, restaurants est ouvert et continue à mobiliser le Gouvernement. C’est ainsi que, le 13 novembre dernier, les ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne ont pris la décision de proposer une directive sur la réduction du taux de TVA dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, dont, bien sûr, celui des hôtels, cafés et restaurants.
Les discussions sur ce sujet devraient avoir lieu sous la présidence française de l’Union européenne, lors du second semestre de 2008.
Au-delà de la TVA, votre question soulève également le problème de la transmission et de la reprise de ces hôtels familiaux.
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, les pouvoirs publics ont pris de nombreuses mesures destinées à réduire les droits de mutation à titre gratuit. En ligne directe, l’abattement par bénéficiaire a été porté par la loi d’août 2007 de 50 000 à 150 000 euros ; ce triplement de l’abattement est considérable.
Afin de faciliter la préparation en amont des successions, les donations sont encouragées par la réduction des droits de 50 %, lorsque le donateur n’a pas atteint 70 ans.
En outre, les hôtels familiaux peuvent également bénéficier des mesures dites du « pacte Dutreil », qui aboutissent, en cas de succession ou de donation, à ne taxer que 25 % de la valeur de l’entreprise, dès lors que les titres ont fait l’objet d’un pacte d’actionnaire – engagement collectif de conservation des titres.
La durée de l’engagement de conservation a d’ailleurs été réduite dans la dernière loi de finances.
Enfin, des dispositions fiscales ont été adoptées à la suite de la signature du contrat de croissance en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants en 2006.
En particulier, un nouveau dispositif a été créé qui consiste en un report d’imposition sur les plus-values réalisées par des personnes exerçant leur activité dans ce secteur lors de la cession de leur actif immobilier à une société d’investissements immobiliers cotée ou à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de l’économie prévoit plusieurs mesures en faveur des transmissions, qui profiteront également aux hôtels familiaux.
Les droits de mutation à titre onéreux sont ainsi abaissés de 5 % à 3 % pour les SARL et pour les fonds de commerce.
De plus, les transmissions familiales ou aux salariés sont exonérées de droits de mutation sous plafond.
J’ajoute que les repreneurs pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur les intérêts de l’emprunt lié à l’acquisition d’une société deux fois plus importante qu’auparavant, et qu’ils auront désormais à acquérir non plus 50 %, mais seulement 25 % du capital pour en bénéficier.
Enfin, le Gouvernement réfléchit aux moyens de favoriser le développement des outils de capital-risque dans l’industrie touristique.
Par conséquent, monsieur le sénateur, toutes ces mesures vont dans le même sens : sauvegarder un pan très important de notre économie en matière non seulement de préservation, mais également d’attractivité de notre pays dans le cadre de cet art de vivre dont vous êtes l’un des ardents défenseurs.

Je tiens à vous remercier, madame la ministre, de votre réponse précise et complète.
Je souhaite simplement que la présidence française de l’Union européenne permette dans les mois à venir une avancée significative et attendue en ce qui concerne la TVA.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 220, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.
Nous serons très heureux d'écouter la réponse de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui nous honore de sa présence.
Le Sénat apprécie toujours la présence d'un ministre important !
Sourires.

M. le président. Mais ils sont souvent absents ! Quand vous serez ministre, vous vous en souviendrez !
Nouveaux sourires.

Si ma question s’adressait à Mme la ministre de la culture, je connais, madame la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, vos compétences infinies en la matière. C’est donc avec un grand intérêt que j’entendrai votre réponse.
Je souhaite ici attirer l’attention sur la diminution très importante du financement accordé à l’association Scènes et Territoires en Lorraine.
Il s’agit là, à ma connaissance, d’une association unique en France, qui fut créée voilà une dizaine d’années sur l’initiative des fédérations d’éducation populaire de l’ensemble des départements de Lorraine et qui développe le spectacle vivant en milieu rural, et uniquement en milieu rural.
La philosophie qui sous-tendait cette initiative était d’assurer la diffusion culturelle de l’art du spectacle vivant dans ces milieux ruraux et d’améliorer en quelque sorte la connaissance des élus ruraux en matière culturelle.
En décembre 2000, le ministère de la culture, par l’intermédiaire de la direction régionale d’action culturelle, la DRAC, reconnaissait en cette association une « Scène multi- sites » avec laquelle elle signait une convention pour le spectacle vivant. Cette convention, qui était valable pour trois ans, a été renouvelée en 2004 et concerne donc les années 2004, 2005 et 2006.
Cette reconnaissance de l’État s’est assortie d’une subvention pouvant aller jusqu’à 74 000 euros pour un budget qui, à l’époque, atteignait 700 000 euros, ce qui a permis à l’association, d’une part, de renforcer des liens de confiance avec l’ensemble des partenaires locaux qui participent largement au financement et, d’autre part, de développer son action. De cette façon, l’État était présent aux confins de nos territoires ruraux.
Or, dès 2006 – et plus encore en 2007 –, le soutien financier de l’État a diminué, et, en 2008, il a été annoncé que la dotation ne serait plus que de 30 000 euros, c’est-à-dire moins de la moitié, ce qui remet d’ailleurs en cause pour une part le soutien européen au travers du Fonds européen de développement régional, le FEDER.
Dans ces conditions, comment l’association Scènes et Territoires pourrait-elle poursuivre son travail de diffusion culturelle en milieu rural à des tarifs attractifs pour tous ?
Étrangement, les demandes réitérées par l’association pour renouveler le conventionnement depuis plus d’un an sont restées sans réponse, alors même que la directive nationale d’orientation pour 2008 qui avait été transmise aux DRAC précisait que, dans le champ territorial, priorité serait donnée au renforcement des actions qui sont menées pour développer l’éducation artistique et culturelle, ce qui correspondait tout à fait au champ d’action de cette association.
Dès lors, ma question est simple : compte tenu de la baisse des crédits alloués à cette association et de l’absence de nouveaux conventionnements, peut-on encore aujourd’hui parler d’une volonté de l’État de diffuser le spectacle vivant en milieu rural ?
Quelle est la raison de cette diminution exceptionnelle de crédits à l’association Scènes et Territoires en Lorraine, et pourquoi n’y a-t-il aucune nouvelle convention ? Le ministère est-il prêt à réétudier cette décision, alors même qu’aucune évaluation de ces six années de travail n’a effectivement été réalisée ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de ma collègue Christine Albanel, ce qui me donne le plaisir de répondre à votre question. L’éducation populaire est au cœur des responsabilités de mon ministère
J’ai ainsi à ma disposition une direction de la jeunesse et de l’éducation populaire et beaucoup de gens ignorent que dans l’acronyme « CREPS », les lettres « EP » signifient non pas « éducation physique », mais « éducation populaire ».
Monsieur le sénateur, vous interpellez Christine Albanel au sujet de Scènes et Territoires, qui fédère des associations appartenant, notamment, au réseau de l’éducation populaire, dont l’activité vise à irriguer le milieu rural lorrain dans le domaine du spectacle vivant, par la diffusion de spectacles, par des résidences d’artistes et par un important maillage d’actions culturelles.
Cette association a bénéficié depuis 2000 d’une convention – renouvelée en 2004, pour s’achever à la fin de 2006, puis prolongée d’un an en 2007 –, avec la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, de Lorraine, dans le cadre du programme des scènes conventionnées.
En dépit des contraintes qui pèsent sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sur lequel se trouve inscrite l’association et qui a vu ses charges s’accroître, tout particulièrement en faveur de l’éducation artistique et culturelle, l’association a fait l’objet d’une attention particulière de la part de la DRAC de Lorraine.
Le président de Scènes et Territoires, M. Pierre Charles, ainsi qu’une délégation des membres de cette association ont été reçus le 11 avril dernier par le directeur des affaires culturelles de la Lorraine. Ce dialogue a permis de convenir d’une réinscription de cette structure au programme des scènes conventionnées pour les années 2008 à 2010, avec une subvention revenue à 38 000 euros par an.
Ces trois années supplémentaires de conventionnement avec l’État permettront à l’association Scènes et Territoires de reprendre sereinement le dialogue avec les collectivités locales, et donc de mieux préparer son avenir.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Il est exact que la réunion que vous avez évoquée, qui a eu lieu le lendemain du jour où j’ai déposé ma question, a réglé partiellement le problème.
Néanmoins, j’ai creusé un peu la question, au-delà de ce cas de figure, et je me suis rendu compte que la direction de l’aménagement du territoire du ministère de la culture avait été supprimée, de même que la plupart des crédits dont elle disposait, ce qui n’est pas un hasard.
En clair, cette évolution signifie que les moyens que l’État consacre à la diffusion culturelle dans les territoires, notamment ruraux, ont très sensiblement diminué. Naturellement, on attend que les collectivités locales participent à cette action, et elles le font déjà très largement : j’ai déjà indiqué que les quatre cinquièmes, sinon les neuf dixièmes, du budget annuel de l’association, qui tourne autour de 700 000 euros en moyenne, sont couverts par les subventions des collectivités territoriales et la participation aux frais des spectateurs.
L’effort de l’État était donc déjà très mesuré. Sa disparition présente une signification politique, sur laquelle je voulais attirer l’attention, madame la ministre, afin qu’il soit apporté à ce problème une réponse politique.

La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 230, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la multiplication des fermetures de services publics, ou des menaces qui pèsent sur eux, en milieu rural, dans de nombreux secteurs tels que la santé, l’éducation nationale, la justice, la gendarmerie, les finances, la perception, La Poste, EDF, entre autres.

Il s'agit là d’une des principales inquiétudes exprimées par les élus que je rencontre. Pour m’en tenir à la visite que j’ai effectuée le week-end dernier, M. le maire de Saint-André-les-Alpes m’a parlé de la poste de sa commune, qui perd deux emplois sur trois, et de l’insuffisance des effectifs dans l’administration du collège. Je pourrais malheureusement évoquer bien d’autres exemples.
La réforme de la carte judiciaire, appliquée de façon brutale et arbitraire, s’est traduite par des suppressions de tribunaux. La présence postale se trouve fortement fragilisée par des fermetures effectives ou programmées et par des réductions ou de regrettables et inappropriées adaptations d’horaires.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, la presse a annoncé le regroupement éventuel du centre d’instruction et d’entraînement au combat de montagne de Barcelonnette avec le Centre national d’aguerrissement de Briançon, sans la moindre concertation. Cette décision se traduirait, dès cet été, par la perte de vingt-cinq emplois pour Barcelonnette.
Monsieur le secrétaire d'État, pour bien connaître la vallée de l’Ubaye, vous savez que la suppression de vingt-cinq emplois, pratiquement imperceptible dans les bureaux ministériels, est perçue à Barcelonnette, à juste titre, comme catastrophique, surtout si, comme on me l’a annoncé, la même unité militaire se trouve susceptible de subir les effets plus redoutables encore de la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Pour les hôpitaux, les récentes déclarations gouvernementales et le rapport de notre collègue Gérard Larcher font redouter de nouvelles mises en cause de services et des suppressions d’emplois.
Par exemple, les agents du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, issu de la fusion des hôpitaux de Sisteron et de Gap, expriment depuis plusieurs semaines leur inquiétude quant à l’avenir de cet établissement. Cette semaine, la « une » d’un hebdomadaire local titrait d'ailleurs : « Hôpital de Digne : 50 emplois en péril ». Malheureusement, les exemples de ce type ne manquent pas !
Monsieur le secrétaire d'État, nous souhaiterions connaître votre implication et votre rôle, en tant que membre du Gouvernement chargé de l’aménagement du territoire, dans la réflexion sur la révision générale des politiques publiques et la diminution du nombre de fonctionnaires par le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Quelle est votre réaction face à ces deux mesures, qui risquent fort de déséquilibrer les services au public en milieu rural ?
Au-delà de la logique économique, tiendrez-vous compte des situations spécifiques, pour mettre un frein au désengagement progressif des services publics et rassurer les populations concernées ?

En un mot, le Gouvernement a-t-il l’intention de continuer à privilégier la dimension humaine et la proximité ?
Monsieur le sénateur, vous avez posé une question essentielle pour l’aménagement du territoire.
Vous avez évoqué diverses réformes, concernant notamment les cartes judiciaire, militaire et hospitalière. Je vous le dis clairement : ces réformes sont indispensables ! Il est nécessaire d’adapter nos services publics sur le terrain, en tenant compte de la situation actuelle de notre pays, sur l’arc méditerranéen, en Europe et plus largement dans le cadre de la mondialisation.
Pour autant, je suis le secrétaire d’État du lien avec les territoires. Je vous garantis que je saurai créer un juste équilibre entre les territoires et entre les gens qui y vivent. Je sais très bien que nous sommes aussi des élus locaux. Je connais parfaitement cette problématique, pour avoir été maire d’une commune rurale pendant dix-huit ans. Les zones rurales couvrent 70 % du territoire français et les deux tiers des communes du pays sont rurales. Mon rôle consistera à faire prendre en compte la réalité du terrain.
C’est pourquoi, monsieur le sénateur, ma ligne de conduite sera de concilier les impératifs propres à chaque service public, y compris les contraintes économiques, avec le maintien d’un maillage qui favorise le développement, la qualité et l’identité de chacun de nos territoires.
La recherche de cet équilibre ne se fera pas selon une approche uniforme décidée depuis Paris. Le Président de la République a d'ailleurs rappelé à Cahors, le 8 avril dernier que l’unité, ce n’est pas l’uniformité, et que l’égalité, ce n’est pas l’uniformité. Le Premier ministre a également souligné que le Gouvernement veillerait à ce que soit prise en compte la situation spécifique des territoires qui pourraient pâtir d’une accumulation de restructurations de services publics.
Je m’inscris bien évidemment dans ces orientations. Notre politique doit être au service des territoires et, dans cette perspective, nous devons écouter les élus locaux, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur. La décision ne doit pas descendre du haut vers le bas ; elle doit être prise en concertation avec le bas, c'est-à-dire avec ceux qui vivent le territoire au quotidien.
C’est pourquoi je serai particulièrement attentif à ce que les équilibres relatifs au service du public soient négociés à l'échelle locale.
Ce travail de proximité doit permettre à chacun de retrouver confiance dans tous les territoires, y compris les plus fragiles, en recherchant des solutions innovantes, en particulier la mutualisation de certains dossiers, en fonction des nécessités du terrain, le regroupement des services publics et le recours aux technologies de l’information et de la communication. Nous avons tout à gagner à ces évolutions.
Je vous rejoins donc sans ambiguïté, monsieur le sénateur. Le Gouvernement entend mener une politique active et adaptée en faveur des services publics, et je suis un adepte du service public garanti sur l’ensemble des zones rurales. J’ai d'ailleurs demandé un audit sur la situation de chacun de ces territoires, afin d’avoir une idée précise de la façon dont les services publics pourront y être adaptés.
Croyez-moi, nous veillerons à maintenir un maillage de services publics dense et équilibré entre les territoires ruraux, les grandes métropoles et les villes moyennes. Nous travaillons en ce sens, et j’y serai particulièrement attentif dans les responsabilités qui sont les miennes.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, qui est pleine de bonnes intentions et qui prend en compte les inquiétudes de la population et des élus qu’ils représentent. Nous vous jugerons sur vos actes !

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 212, adressée à Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie.

En janvier 2003, lors de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, j’avais rappelé quelques chiffres vertigineux concernant les dégazages ou déballastages sauvages et autres pollutions par rejets de résidus d’hydrocarbures auxquels se livraient en Méditerranée certains capitaines de navires, qualifiés à l’époque de « voyous des mers ».
J’avais indiqué alors que, selon certaines études, un million de tonnes d’hydrocarbures sont rejetées chaque année en Méditerranée par des bateaux qui dégazent, ce qui représente environ quinze fois la cargaison du Prestige – le mal nommé ! – ou cinquante fois le fioul lourd rejeté par l’Erika en 1999, et une surface polluée de 150 000 kilomètres carrés.
De surcroît, ces déballastages ne représentaient qu’une partie de l’ensemble des déversements constitués, pour l’essentiel, de résidus de combustibles fabriqués par tous les bateaux.
J’avais relevé que, chaque année, 1 700 déversements intentionnels étaient comptabilisés par l’Union européenne, dans une mer fragile, quasiment fermée, qui ne représente que 1 % de la surface des mers mais sur laquelle transitent 30 % du transport maritime.
Doit-on préciser que, dans le cas des marées noires provoquées par le Prestige ou l’Erika, il s’agissait d’accident, alors qu’en Méditerranée il s’agit d’actes volontaires !
Bien évidemment, de telles pollutions ne sont pas neutres pour le milieu marin et la chaîne alimentaire tout entière.
C’est pourquoi, avec mon groupe, j’avais soutenu le projet de loi relatif à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Ce texte, examiné par le Sénat au mois de janvier 2003, avait été présenté en conseil des ministres, dès le 27 février 2002, par M. Yves Cochet.
Il était alors apparu au Sénat, de manière unanime d’ailleurs, que cette loi constituerait une réelle avancée, puisqu’elle permettrait de rendre applicables toutes les mesures coercitives à l’intérieur de la zone de protection, alors qu’antérieurement celles-ci ne pouvaient l’être que dans la zone des douze milles, c’est-à-dire à l’intérieur des eaux territoriales françaises, ce qui expliquait que seules 1 % des opérations illicites étaient alors sanctionnées.
Voilà environ cinq ans que cette loi a été votée et cela fait plus de quatre ans que le décret en Conseil d’État portant création d’une zone de protection écologique au large des côtes de la République en Méditerranée a été publié. En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, il me semble possible de dresser aujourd’hui un premier bilan sur les aspects positifs de la mise en place de cette zone de protection écologique et notamment de connaître le nombre d’interpellations réalisées, de sanctions prononcées ou de décisions d’éloignement des « navires poubelles » ayant pu présenter un danger ou une menace ayant été prises.
Plus encore, il importe de savoir si la création de cette zone de protection écologique et l’aspect dissuasif des sanctions encourues – peines d’emprisonnement et fortes amendes – ont permis une réduction sensible des faits de pollution.
Ce dernier point m’amène à demander au Gouvernement, comme je l’avais fait lors de l’examen du projet de loi relatif à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, si les moyens, légers ou lourds, de surveillance, de contrôle et de dissuasion des personnels, bateaux, hélicoptères, avions sont en nombre suffisant. En effet, l’efficacité du dispositif est subordonnée à l’ensemble de ces moyens.
Ce qui compte également, ce sont les équipements portuaires permettant aux navires de rejeter proprement leurs déchets, afin d’éviter qu’ils ne procèdent à des dégazages sauvages. En 2003, de ce point de vue, c’était plutôt la misère, si je puis m’exprimer ainsi. Monsieur le secrétaire d’État, où en sommes-nous aujourd’hui ?
Il est un autre point de préoccupation que je souhaite aborder. Je rappelle qu’entre 20 % et 30 % du trafic maritime international transite par la Méditerranée. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à souligner que cette mer est un « couloir à hydrocarbures ». Nous ne sommes donc nullement à l’abri d’un sinistre majeur. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur les délais d’intervention du remorqueur basé à Toulon au cas où un accident surviendrait au large des côtes du Languedoc-Roussillon. De même, est-il possible d’en savoir plus sur la présence ou non, en Méditerranée, d’un nouveau navire antipollution, comme cela avait été évoqué en 2003 ?
Enfin, ma dernière interrogation concerne la mise en œuvre des mesures prévues par la Commission européenne, dans le cadre du « paquet Erika II », rendant obligatoire, sur les bâtiments circulant dans les eaux communautaires, l’équipement de transpondeurs, qui sont de véritables systèmes d’identification automatique permettant l’amélioration du signalement et du suivi des navires.
Dans la mesure où les dégazages effectués la nuit sont plus difficilement repérables et les contrevenants moins facilement identifiables, l’application de cette mesure, qui me paraissait indispensable à l’époque, me semble toujours aussi impérieuse.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie des précisions que vous voudrez bien m’apporter sur l’ensemble de ces points.
Monsieur le sénateur, vous posez une question générale – ô combien intéressante ! – sur une mer qui nous est chère, comme à M. le président et à bon nombre de vos collègues, …
Je sais bien ! C’est la raison pour laquelle j’ai associé à mon propos l’ensemble de vos collègues ! Au demeurant, pour ce qui nous concerne, nous avons la particularité, que nous ne renions pas, d’être des enfants de la Méditerranée.
La loi du 15 avril 2003 a créé en Méditerranée une zone de protection écologique, la ZPE, afin de permettre à la France d’exercer une action répressive à l’encontre des auteurs de pollutions marines au-delà des eaux territoriales.
Ainsi, depuis 2003, quatorze poursuites ont été engagées par le parquet de Marseille à l’encontre de capitaines de navires pris en flagrant-délit de rejet illicite et neuf condamnations ont été prononcées, donnant lieu à 3, 72 millions d’euros d’amendes. Trois dossiers sont en cours d’instruction et deux jugements restent en attente de délibéré. Auparavant, les procédures transmises à l’État du pavillon n’aboutissaient pas, comme vous l’avez fort justement rappelé, monsieur le sénateur.
L’effet dissuasif de cette politique répressive peut être mesuré par la baisse du nombre d’infractions constatées, lequel a été divisé par quatre – douze en 2003 contre trois en 2007. Ce n’est pas négligeable, même si nous sommes d’accord pour reconnaître que ce n’est pas encore satisfaisant. Le nombre de pollutions signalées a également baissé de 40 % depuis la création de la zone de protection écologique.
Ces chiffres indiquent clairement un changement de comportement des capitaines de navires dans les eaux sous juridiction française. La France est désormais citée en exemple par l’Agence européenne de sécurité maritime pour l’efficacité de son dispositif répressif, qui comporte quatre composantes : spatiale, aérienne, navale et terrestre.
La composante spatiale comprend le service européen d’imagerie satellite pour la détection des déversements d’hydrocarbures et la surveillance des eaux européennes, qui est mis à la disposition des États membres depuis le mois d’avril 2007, en application de la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer Méditerranée, le CROSS-MED, est l’un des trois centres opérationnels français participant au système.
La composante aérienne du dispositif met en œuvre l’ensemble des services de l’État en mer, qu’ils soient civils ou militaires. Le CROSS bénéficie du concours de l’avion de télédétection POLMAR II des douanes, dont les capacités d’identification nocturne sont en cours de modernisation, ce qui est important. Il peut également faire appel aux avions de patrouille maritime de la marine nationale basés à Nîmes et à Lorient. Plusieurs vols quotidiens sont effectués dans la zone de protection écologique, pour un total de 2 000 heures de vol par an. Il est également fait appel aux hélicoptères de la marine nationale, des douanes, de la gendarmerie et de la sécurité civile.
La composante navale du dispositif a été renforcée par la marine nationale. Ainsi, le remorqueur d’intervention Abeille Flandre et le bâtiment de dépollution Ailette sont affectés depuis 2005 à la surveillance du littoral méditerranéen, en remplacement du Mérou.
Enfin, le CROSS-MED et la préfecture maritime de la Méditerranée bénéficieront, dès le mois de septembre prochain, du renforcement du système d’identification automatique, l’AIS, dans le cadre du programme SPATIONAV. Ce déploiement s’effectue en cohérence avec la directive européenne 2002/59/CE, issue du « paquet Erika II », relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, qui prescrit pour tout navire de commerce faisant escale dans un port d’un État membre l’emport d’un système d’identification automatique. Cette directive renforce les prescriptions de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite « convention SOLAS », de l’organisation maritime internationale. L’AIS fournit automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés, l’identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse ainsi que ses conditions de navigation.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons tous pris conscience de l’état de la Méditerranée et de ses problèmes. D’importants efforts ont déjà été accomplis, même s’il reste beaucoup à faire, j’en conviens, pour protéger cette mer qui nous est chère à tous.

M. Roland Courteau. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse. J’ajouterai simplement, après un célèbre Narbonnais, Charles Trénet, et comme le répètent très souvent les nouveaux élus de la ville de Narbonne, en particulier la première adjointe : puisse la Méditerranée continuer à « danser le long des golfes clairs »…
Sourires

M. le président. Mon cher collègue, nous voilà dans le lyrisme le plus total !
Nouveaux sourires.

M. le président. D’habitude, vous répétez plutôt cette phrase d’un homme politique célèbre : « Un bon discours m’a quelquefois fait changer d’avis, jamais de vote » !
Rires

La parole est à Mme Catherine Procaccia, en remplacement de M. Philippe Richert, auteur de la question n° 206, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Monsieur le président, je vous remercie, au nom de mon collègue Philippe Richert, de m’autoriser à poser cette question à laquelle il tient beaucoup et qui porte sur la réglementation des donations à titre gratuit de parcelles agricoles. Certes, je suis aujourd’hui élue de la région parisienne, mais j’ai travaillé pendant plus de trente ans dans les organismes agricoles et je suis donc très au fait des problèmes liés aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER.
En l’état actuel du droit, le code rural octroie aux SAFER un droit de préemption à l’occasion d’aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole. Ce droit de préemption peut s’exercer grâce à une obligation de déclaration préalable auprès de la SAFER par le vendeur.
Si l’aliénation est à titre gratuit, par donation ou par partage, aucune déclaration préalable n’est nécessaire. La SAFER n’a donc aucune prise sur l’opération, ce qui n’est pas scandaleux en soi, puisque ces donations se font généralement entre membres d’une même famille.
Or, dans la circonscription de mon collègue Philippe Richert, plus précisément dans le village de Lohr, cette faculté a été détournée de son but. Ainsi, un agriculteur a fait don de terrains agricoles, qui plus est déclarés constructibles, à un agriculteur résidant et exploitant à vingt kilomètres de là, avec lequel, semble-t-il, il n’entretient aucun lien. Vous imaginez sans peine, monsieur le secrétaire d’État, la réaction de la SAFER, mais aussi celle du jeune agriculteur voisin, qui aurait pu agrandir son domaine grâce aux parcelles agricoles en cause !
Cette pratique n’est pas du tout illégale ; elle trouve simplement son fondement dans les lacunes de notre législation, qui ne précise pas que le champ d’intervention de la SAFER s’arrête lorsqu’il s’agit de cession gratuite au sein d’une même famille.
Dans le cas d’espèce, la géographie et la topographie des parcelles incriminées auraient entraîné sans aucun doute l’exercice du droit de préemption par la SAFER. Il s’agit donc bien d’un détournement volontaire et très étudié de la loi, auquel il faut remédier rapidement.
C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, au nom de mon collègue Philippe Richert, je souhaite que vous indiquiez quelles sont les mesures envisagées pour parer à cette situation et donner aux collectivités les moyens d’exercer un droit de préemption sur les biens concernés.
Madame le sénateur, permettez-moi de vous présenter les excuses de mon collègue Michel Barnier, qui, inaugurant ce matin un salon de l’agriculture en Aquitaine, m’a chargé de répondre à votre question.
Le droit de préemption conféré aux SAFER ne peut être exercé qu’à l’occasion d’aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole. Il ne peut donc intervenir que lorsqu’un propriétaire, ayant décidé de mettre en vente son bien, terrain, exploitation, siège d’exploitation ou bâtiment d’exploitation vendu isolément, maintient sa décision de vendre.
Tout propriétaire a effectivement la possibilité de retirer son bien de la vente lorsque la SAFER, assortissant sa préemption d’une révision de prix, présente une contre-offre de prix inférieure. Certaines aliénations faisant l’objet d’une exemption au droit de préemption des SAFER, limitativement prévues par les dispositions de l’article R. 143-9 du code rural, doivent leur être notifiées à titre déclaratif, aux fins d’information. Les transmissions par donation n’entrent pas dans le champ de ce dispositif.
Si des donations viennent à être opérées entre personnes sans liens de famille, et même s’il est permis de supposer qu’elles n’ont pas lieu de façon totalement désintéressée, la SAFER ne peut pas intervenir, sauf si elle prouve qu’il s’agit bien de donations fictives et de ventes déguisées, destinées à éluder intentionnellement son droit de préemption.
Pour l’heure, il n’est pas envisagé de modifier le droit de préemption des SAFER sur ce point précis, qui touche directement le droit de propriété.

Il m’est difficile de répondre à M. le secrétaire d’État, car la question émane de mon collègue Philippe Richert. Cependant, à sa place, en ma qualité de parlementaire, je déposerais un amendement ou une proposition de loi tendant à modifier la disposition en cause. Mon collègue avisera.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 234, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la suppression de postes dans les lycées soulève une forte incompréhension de la part des lycéens, des parents d’élèves, des enseignants et des professionnels du monde agricole. Élèves et enseignants de Tours viennent de manifester plusieurs fois contre la suppression de postes d’enseignants.
Le 15 mai prochain, les écoles, collèges et lycées seront en grève. Cinq fédérations de l’éducation ont appelé à cette journée pour protester contre la politique budgétaire et éducative du Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d’État, la situation de l’enseignement agricole public se dégrade également de façon continue depuis près de six ans. Elle risque malheureusement de subir une chute brutale si vous ne prenez pas les mesures indispensables. Elle est tellement critique que votre collègue, le ministre de l’agriculture et de la pêche, a lui-même renoncé à l’aggraver davantage, en annonçant à l’intersyndicale le rétablissement de 130 postes sur les 319 initialement supprimés. Je souhaite que vous m’apportiez confirmation de ce rétablissement et que vous m’indiquiez à partir de quelles dotations le financement de ces postes est-il envisagé.
Quoi qu’il en soit, un certain nombre de points noirs subsistent un peu partout en France, et la région Centre n’est pas épargnée. Je voudrais m’y attarder quelques instants. Les trois exemples que je vais développer témoignent d’engagements pris par le ministère qui n’ont été accompagnés d’aucun moyen pour y faire face.
Pourquoi le lycée agricole de Bourges, qui dispense une formation d’analyse et de conduite des systèmes d’exploitation, au succès indéniable, et qui refuse chaque année des candidats, se verrait-il aujourd’hui contraint de supprimer cette classe ? Comment interpréter votre engagement en faveur des filières de production si, d’un autre côté, vous engagez la disparition d’une telle formation ? La profession a besoin de cadres formés pour gérer les exploitations et vous ne pouvez ignorer les contraintes de plus en plus complexes rencontrées par le monde agricole. Le rétablissement d’une telle formation me semble aujourd’hui impératif, pour l’agriculture berrichonne notamment.
La direction régionale de l’agriculture et de la forêt, la DRAF, a annulé, le 22 avril dernier, la création d’un BTS « gestion et maîtrise de l’eau » à Fondettes, alors que les inscriptions à ce brevet sont ouvertes sur le site du ministère depuis la fin du mois de février, que les collectivités territoriales, comme l’État, ont émis un avis favorable et que les financements nécessaires sont prévus.
Vous comprendrez, monsieur le secrétaire d’État, mon étonnement face à ce brusque revirement, qui intervient sans aucune explication. J’attends que les inscriptions soient maintenues et que la classe soit bien ouverte, d’autant que le Grenelle de l’environnement a mis l’accent sur cette question déterminante.
Les agriculteurs sont souvent montrés du doigt sur les questions de pollution des eaux. On ne peut à la fois stigmatiser la profession et ne pas lui donner les moyens de mieux répondre à ce besoin de préservation de notre environnement.
Pour ce qui concerne Montargis, en 2007, M. Bussereau, alors en charge de ce secteur, avait promis, à grand renfort de publicité dans les médias, qu’une classe préparatoire « technologie et biologie » serait créée. Ce fut chose faite, sur décision ministérielle. Il s’avère, à ce jour, que cette classe, unique dans l’enseignement agricole, aura certes une suite, mais sans financement complémentaire de l’État. Son financement sera donc pris sur la dotation de la région Centre, ce qui aura une implication sur d’autres projets.
Ces situations relevées dans la région Centre se répètent malheureusement dans de nombreux lycées agricoles publics de notre pays, et ce de façon plus grave parfois, comme c’est le cas dans la région Midi-Pyrénées, où douze classes vont être supprimées, comme je viens de l’apprendre.
Monsieur le secrétaire d’État, que comptez-vous faire pour permettre à notre enseignement agricole public de répondre aux besoins de l’agriculture et de l’environnement dans nos différentes régions, mais aussi à l’avenir de nos jeunes qui souhaitent se former à ces métiers ?
monsieur le président, je souhaite présenter au Sénat les excuses de M. Barnier, qui se trouve actuellement au salon de l’agriculture de l’Aquitaine.
Madame le sénateur, vous interrogez le Gouvernement sur la situation de certains établissements d’enseignement agricole public de la région Centre à la rentrée scolaire 2008-2009.
Le Gouvernement est très sensible à l’intérêt que vous portez à l’enseignement agricole, qui est reconnu tant pour l’efficacité de sa pédagogie, pour la réussite de ses élèves aux examens de tous niveaux et pour ses résultats en matière d’insertion professionnelle que pour sa capacité à innover et à s’adapter aux mutations de l’agriculture, du monde rural et aux attentes de notre société. Comme nous avons déjà pu le constater à l’occasion de la question posée par M. Domeizel, aujourd’hui, ces mutations sont importantes ; le monde rural doit donc évoluer, tout en maintenant un équilibre entre le développement et la préservation des ressources.
L’enseignement agricole est un élément essentiel pour la conduite des politiques qui sont placées sous la responsabilité du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le Gouvernement entend le faire évoluer en réaffirmant ses missions et ses priorités.
Il souhaite vous apporter des précisions en ce qui concerne les questions que vous avez posées, madame le sénateur, sur les lycées de Bourges, Tours et Montargis et certaines de leurs formations.
L’information qui vous a été communiquée sur la fermeture du brevet de technicien supérieur agricole « analyse et conduite des systèmes d’exploitation », le BTSA ACSE, à Bourges est partiellement erronée. Cette formation est actuellement dispensée en un an et en deux ans. Désireuse de former des professionnels de l’agriculture de la meilleure manière, la direction régionale de l’agriculture et de la forêt a proposé au Gouvernement de fermer la formation en un an et d’orienter les étudiants sur la seule formation en deux ans. Dans la mesure où cette filière de production est maintenue dans l’enseignement public dans le Cher dans de meilleures conditions, le Gouvernement a validé cette proposition.
S’agissant du BTSA « gestion et maîtrise de l’eau » de Tours-Fondettes, le Gouvernement a effectivement donné un avis favorable à son ouverture à la rentrée 2008. Pour autant, cette ouverture suppose la mise en place d’installations techniques, comme des laboratoires, qui n’existent pas sur le site et ne seront pas construits à la prochaine rentrée scolaire. Le conseil régional, dont c’est la responsabilité, n’aura, semble-t-il, pas le temps d’achever les travaux d’ici au mois de septembre.
Dans ces conditions, est-il raisonnable d’accueillir des étudiants à la prochaine rentrée ? Je ne le pense pas ; c’est pourquoi le report d’ouverture de cette formation à la rentrée 2009 me semble la solution la plus sage. Il va s’en dire que l’ouverture en 2009 est d’ores et déjà acquise.
Enfin, je ne peux vous laisser affirmer que la deuxième année de classe préparatoire « technologie biologie » du lycée agricole de Montargis n’est pas financée, ne serait-ce que par respect pour les étudiants actuellement scolarisés en première année et qui comptent poursuivre leur formation. Ce sont ces jeunes que le Gouvernement veut rassurer, afin qu’ils étudient dans des conditions sereines. Je peux leur dire que l’autorité académique dispose des moyens nécessaires pour faire fonctionner cette deuxième année à la prochaine rentrée scolaire.
Attiser des craintes ne me semble pas la meilleure manière de convaincre les familles de scolariser leurs enfants dans l’enseignement agricole public. J’ai, pour ma part, une grande ambition pour cet enseignement d’avenir et de grande qualité et, au nom du ministre de l’agriculture et de la forêt, je veux assurer ses personnels, les élèves, les étudiants et les apprentis de l’engagement du Gouvernement et de son soutien.
Madame le sénateur, il est des sujets qui doivent être abordés de manière consensuelle, positive et sereine, dans l’intérêt de notre pays. L’enseignement agricole en est un. En notre qualité d’élus locaux, nous savons ce qu’il apporte au maintien de l’identité de tous les territoires, à leur préservation et à leur développement. Je sais pouvoir compter sur votre intérêt et sur votre appui afin de préserver la spécificité de l’enseignement agricole au sein du système éducatif, sa qualité et, surtout, son ancrage dans les territoires ruraux.

Monsieur le secrétaire d’État, mon attachement à l’enseignement agricole ne s’est jamais démenti, même lorsque je n’étais pas encore élue sénatrice.
En revanche, je peux vous dire que les réponses que vous avez apportées ne correspondent pas à la réalité. Avant de poser ma question, j’ai pris le temps de regarder quelle était la situation sur le terrain.
Actuellement, à Montargis, 2 200 heures de cours seraient nécessaires pour assurer la poursuite de la formation en question. Malheureusement, pour le moment, les moyens adéquats ne sont pas disponibles.
Pour ce qui concerne Fondettes, la région Centre a inscrit dans son budget la somme de 250 000 euros, afin que les moyens financiers nécessaires pour réaliser les équipements que requiert l’ouverture du BTS « gestion et maîtrise de l’eau » soient mis à disposition. Aujourd’hui, rien n’impose de supprimer cette formation. Des étudiants s’y sont déjà inscrits. Si le ministère maintient sa position, il devra leur proposer des solutions pertinentes, faute de quoi ces jeunes risquent de se retrouver dans l’impossibilité d’exercer le métier qu’ils ont choisi, métier passionnant et plus que jamais d’actualité depuis le Grenelle de l’environnement. Par ailleurs, monsieur le ministre, au moment où se déroule le débat sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, de ma région, il serait dommage de ne pas donner un signe.
Il en va de même en ce qui concerne Bourges : je n’ai malheureusement pas d’information selon laquelle, s’il y a fermeture de la formation au BTS ACSE en un an, il y aura maintien de la formation en deux ans.
Cela signifie bien que des problèmes se posent sur le terrain et que les choses ne sont pas aussi claires que les services du ministère le croient. Je me réserve le droit de vous interroger à nouveau si la façon dont elles se déroulent sur place ne correspond pas à ce que votre réponse laisse espérer.

La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question n° 225, adressée à M. le ministre de la défense.

C’est par des fuites relayées par la presse nationale que nous avons appris, en Savoie, le projet de délocalisation de la garnison du 7e bataillon de chasseurs alpins basée à Bourg-Saint-Maurice, à l’horizon 2010.
Une telle éventualité a suscité d’abord la surprise, puis l’incompréhension, devant l’ampleur des bouleversements dans les implantations de notre armée, tout particulièrement en ce qui concerne les troupes de montagne.
Alors que les travaux de la commission du livre blanc sur la défense laissent systématiquement de côté la question des fermetures éventuelles de casernes malgré les demandes répétées des parlementaires qui y participent, la révision générale des politiques publiques semble très avancée sur cette même question, et ce alors qu’aucune concertation, qu’aucun échange avec les élus de la nation et ceux des territoires concernés n’a eu lieu.
Cette décision de fermeture ou de transfert, si elle se trouvait confirmée, aurait des conséquences irréversibles pour le territoire intéressé, en l’occurrence une zone de montagne : elle comporte directement, et par effet de cascades, un risque de fragilisation de la haute vallée de la Tarentaise.
En effet, même si l’activité touristique est le moteur de son développement économique, cette vallée n’en serait pas moins fragilisée, car les familles des militaires du 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice contribuent à l’activité sociale et au développement des communes qui les accueillent, notamment par la scolarisation des enfants, le chiffre d’affaires généré dans les commerces et l’implication du bataillon lui-même dans les événements sportifs locaux ou ses interventions à l’occasion de difficultés rencontrées par les communes en Tarentaise.
Ces familles concourent également au dimensionnement et à la pérennité des services publics, elles sont prises en compte dans les bases de calcul pour les dotations financières d’État versées chaque année aux communes où elles résident : ainsi, pour le calcul de la DGF, ce sont 2 200 personnes liées à la caserne qui sont prises en compte sur une population totale de 7 600 habitants.
Certes, l’insuffisance des logements à loyer modéré a pu pénaliser certaines familles de militaires, mais il appartient à l’État de contribuer à susciter, là aussi, une offre plus forte sur ce territoire.
Par ailleurs, et dans un souci de cohérence plus globale, il serait paradoxal, à l’heure où la France se propose d’envoyer de nouvelles troupes à l’extérieur du territoire national, en particulier en Afghanistan, de se priver de l’excellence reconnue, pour ce théâtre d’opération montagnard, de troupes formées elles-mêmes en montagne.
Elles sont en effet demandées, sollicitées, parce que aguerries, expérimentées sur la base d’entraînements en milieu naturel, similaire aux milieux qui les accueilleront pour plusieurs mois ou plusieurs années pour des actions militaires coordonnées à l’échelle internationale.
Le chef d’état-major des armées afghanes me l’avait confirmé de vive voix lui-même, à l’occasion d’un dîner chez le chef d’état-major des armées françaises, voilà quelques semaines, en faisant une nette différence avec d’autres corps de troupes présents sur le sol afghan.
De façon plus générale, les troupes alpines sont régulièrement présentes sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures, notamment en Afrique, où leur professionnalisme est prouvé et apprécié.
En conséquence, quelques mois seulement après la réforme imposée de la carte judiciaire, qui a déjà touché durement la Savoie, je souhaite, monsieur le secrétaire d’État, que vous puissiez nous dire que les fermetures envisagées du fait de la révision générale des politiques publiques ne sont pas décidées et qu’elles ne sauraient l’être avant un débat associant les parlementaires et les élus locaux. C’est au cours de ce débat que l’État devrait indiquer, en préalable, les contreparties proposées aux territoires qui verraient le départ de leurs bases militaires, lesquelles sont aussi des bases fiscales et des bases d’activités professionnelles.
Par ailleurs, la décision sera-t-elle prise rue Saint-Dominique ou à l’Élysée ? Qui doit-on interpeller ?
Monsieur le secrétaire d’État, j’espère que les craintes des élus savoyards, particulièrement de la Haute-Tarentaise, pourront être apaisées par votre réponse, même si l’on dit que, d’ores et déjà, des infrastructures auraient été aménagées à Vars, dans l’Isère, pour recevoir prochainement deux premières compagnies du 7e BCA.
Monsieur le sénateur, comme l’ensemble des administrations concernées par le processus de révision générale des politiques publiques, le ministère de la défense, sous l’impulsion de M. Hervé Morin, entreprend une réforme ambitieuse et indispensable à la sécurité du pays, qui doit faire face aux nouvelles menaces de ce siècle, ce qui implique que nos armées s’adaptent à de nouvelles missions.
Par ailleurs, le contexte budgétaire contraint dans lequel se trouve la France nous oblige à trouver nous-mêmes, au ministère de la défense, des marges de manœuvre pour assurer l’équipement des forces et améliorer la condition du personnel militaire et civil. Vous avez évoqué tout à l’heure la situation des forces présentes sur des théâtres extérieurs : il convient qu’elles soient capables de remplir leur mission. Au demeurant, le ministère de la défense a obtenu le rare avantage d’effectuer cette réforme à budget constant : ainsi, les économies qui, progressivement, année après année, seront réalisées grâce au nouveau format des armées profiteront aux équipements, aux matériels, à la condition militaire.
Un autre élément nous pousse à la réforme : nous avons un système d’organisation trop dispersé, trop cloisonné, qui nous fait perdre en réactivité et en efficacité.
Nous n’avons pas tiré toutes les conséquences de la professionnalisation sur notre organisation. Aujourd’hui, il nous faut parachever la réforme afin d’orienter les flux de financement disponibles vers l’équipement des forces et un meilleur rendement du soutien, comme je le disais à l’instant.
Le livre blanc auquel vous faites allusion inspire notre démarche mais n’a pas vocation à indiquer où devraient intervenir des suppressions de garnisons ou des réorganisations.
Le dialogue avec les parlementaires et les élus locaux a commencé depuis peu seulement : il n’y avait pas lieu de lancer un dialogue tant que nous ne disposions pas nous-mêmes d’éléments pour l’alimenter. Les choses se font à leur rythme. Ce dialogue va se poursuivre.
Il s’établira autour des trois grands axes de réorganisation qui articulent la réforme des armées : une densification des unités, pour rationaliser leur stationnement, une mutualisation et une interarmisation, particulièrement dans le domaine de l’administration générale et du soutien.
Je sais, comme vous, à quel point les populations sont attachées au 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice. Moi qui ai fait une partie de mon service militaire au 13e BCA, que vous connaissez bien, je partage votre point de vue : les troupes alpines, de par leur entraînement, leur adaptation au terrain montagneux, ont une excellence reconnue et sont sollicitées pour des actions militaires à l’échelle internationale en milieu naturel similaire à celui dans lequel elles ont coutume d’évoluer. Cela, le nouveau format des armées ne le remettra pas en cause. On ne peut pas dire qu’elles seront pour autant à l’abri de toute réorganisation, c’est évident.
L’abandon de la garnison du 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice fait partie des hypothèses envisagées par les services du ministère de la défense dans le cadre de cette réforme, c’est vrai. En effet, sa situation isolée et l’indispensable prise en compte des critères liés à la condition du personnel, intimement associée aux problématiques de recrutement et de fidélisation, qui sont des défis permanents pour l’armée de terre professionnelle, conduisent à envisager le transfert de cette garnison.
Cependant, à ce jour, aucune décision définitive n’est arrêtée. En effet, les conclusions du livre blanc sur la défense nationale et la sécurité intérieure devraient être rendues d’ici à quelques semaines, puis faire l’objet d’une présentation devant les commissions parlementaires et d’un débat devant la représentation nationale. C’est à l’issue de ces travaux que les arbitrages définitifs seront rendus par le Président de la République, probablement à la mi-juin. Le ministre de la défense pourrait ainsi annoncer les mesures nouvelles au cours de la seconde quinzaine dudit mois.
Quoi qu’il en soit, pour chacune des implantations qui, in fine, connaîtront une réduction ou une fermeture – aucune région ne sera épargnée, nous le savons – les mesures d’accompagnement, qu’elles concernent la date de prise d’effet ou l’aménagement du territoire – M. Falco est associé à cette démarche – sont actuellement discutées avec les élus au ministère de la défense. Notre volonté est d’associer le Parlement et les élus locaux à la mise en œuvre de cette réforme essentielle pour la modernisation de notre outil de défense.

M. Thierry Repentin. Je m’attendais à une réponse prudente, surtout en ce jour de la sainte Prudence !
Sourires

J’ai bien noté aussi que c’est le chef des armées qui rendra les arbitrages et non le ministre de la défense. Nous savons donc où se trouve la clé du maintien – ou du départ – du 7e bataillon de chasseurs alpins. Inutile de dire que, dans deux jours, autour des monuments aux morts de la vallée de la Tarentaise, cet éventuel départ suscitera beaucoup de discussions !
Vous avez indiqué que nos armées devaient s’adapter aux nouvelles menaces qui frappent notre pays, y compris à l’échelon international. Les chasseurs alpins sont fortement mobilisés sur ce théâtre d’opérations extérieures, leur compétence professionnelle étant reconnue. C’est un argument que nous invoquerons lorsque nous plaiderons pour leur maintien.
Vous avez précisé également que la réforme des armées s’articulait autour de trois grands axes de réorganisation, l’un étant la densification des unités. Vous pouvez indiquer à M. le ministre que Bourg-Saint-Maurice est candidate pour une telle densification sur le territoire de la Tarentaise.
Enfin, vous annoncez qu’il y aura des discussions, des échanges. Je note que ces échanges ont commencé aujourd’hui, même si ce n’est que par le biais d’une question orale. Selon moi, tous les parlementaires du département devraient y être associés, qu’ils soient députés ou sénateurs, ces derniers étant – je le rappelle – les représentants des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Nicole Bricq, auteur de la question n° 221, adressée à Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie tout d’abord d’être présente pour me répondre. Je souhaite vous interroger sur les inégalités de ressources entre travailleurs en établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, anciennement « centres d’aide par le travail », selon qu’ils bénéficient ou non de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH.
Aux termes de la loi du 11 février 2005 a en effet été mise en place une rémunération garantie pour les travailleurs en ESAT. Celle-ci est comprise entre 55 % et 110 % du SMIC, compte tenu d’une aide au poste maximale fixée à 50 % du SMIC, en application du décret du 16 juin 2006.
Cette rémunération garantie est cumulable avec l’AAH dans certaines limites. En effet, seules les personnes dont le taux d’incapacité permanente est évalué à 80 % peuvent prétendre au bénéfice de l’AAH. Par conséquent, une personne en situation de handicap dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % dispose, à travail égal au sein d’un ESAT, de ressources inférieures à celles d’une personne bénéficiant de l’AAH. Cet écart peut atteindre 50 %.
Comme moi, vous êtes certainement attachée au principe « à travail égal, salaire égal ». Or je constate que, dans mon département de Seine-et-Marne – cela doit être le cas dans d’autres départements – la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est très fréquemment sollicitée pour accorder un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % aux travailleurs en ESAT, quelle que soit l’application stricte du guide barème.
Je rappelle que l’AAH a été revalorisée très modestement, eu égard aux engagements présidentiels. Mais cette revalorisation, qui est la bienvenue pour ceux qui en bénéficient, pourra avoir un effet pervers dans la mesure où les disparités entre les travailleurs en ESAT s’en trouveront accrues.
Face à cette imperfection, voire cette incohérence, du dispositif, quelles sont les évolutions qui peuvent être envisagées pour le rendre plus homogène ? Les commissions locales n’ont pas vocation à corriger ces incohérences. Elles sont déjà en difficulté quand elles doivent appliquer le barème face à ces travailleurs, qui, je le rappelle, sont loin de pouvoir être classés dans la catégorie des salariés moyens ou riches : ils gagnent environ 600 euros.
Sur cette situation qui est source de problèmes, non pas techniques, mais politiques et humains, j’aimerais entendre votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Madame la sénatrice, vous savez toute l’importance que le Gouvernement attache à la question des ressources des personnes handicapées. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons engagé une véritable concertation, dans le cadre du Comité de suivi de la politique du handicap, afin de dégager des propositions pour améliorer le pouvoir d’achat des personnes handicapées, et ce en vue de la Conférence nationale du handicap, qui se tiendra le 10 juin prochain.
Pour réfléchir à tous ces aspects, y compris celui que vous venez d’évoquer, toute une série de commissions et de groupes de travail thématiques ont été mis en place, lesquels regroupent l’ensemble des opérateurs de terrain, notamment les associations et les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans le cadre de cette réflexion, les personnes accueillies en ESAT ne sont donc pas oubliées. Il nous paraît en effet indispensable que celles-ci – lourdement handicapées puisque l’accès à de telles structures n’est possible que pour celles et ceux dont la capacité de travail est inférieure au tiers de la normale – soient encouragées à développer leurs capacités professionnelles grâce à une rémunération juste et équitable.
À cet égard, la loi du 11 février 2005 a considérablement amélioré les ressources des personnes accueillies en ESAT, et ce d’un triple point de vue.
Tout d’abord, vous l’avez rappelé, la rémunération garantie versée par l’établissement peut désormais atteindre 110 % du SMIC, contre 100 % auparavant, niveau qui permet alors à la personne de subvenir à ses besoins par ses seuls revenus d’activité sans recourir à l’allocation aux adultes handicapés.
Ensuite, le système de rémunération en ESAT est désormais conçu pour encourager la personne concernée à développer ses capacités : l’aide au poste versée par l’État ne diminue plus systématiquement chaque fois que l’ESAT fait un effort pour améliorer la rémunération directe de la personne.
Enfin, un mécanisme incitatif de cumul entre la rémunération en ESAT et l’allocation aux adultes handicapés a été créé, afin d’encourager les personnes accueillies à progresser dans leurs activités.
En réalité, madame la sénatrice, les disparités que vous avez relevées dans la rémunération des personnes accueillies en ESAT proviennent de la législation sur l’AAH elle-même : en effet, les personnes ayant un taux d’invalidité supérieur à 80 % bénéficient d’un abattement supplémentaire sur leurs ressources, et cela conduit à majorer l’allocation qui leur est versée.
L’objectif du travail de remise à plat engagé dans le cadre du comité de suivi précité est bien d’examiner la pertinence des différences de traitement dans l’accès à l’allocation aux adultes handicapés : si certaines d’entre elles sont sans doute légitimes, d’autres le sont nettement moins, à l’image de la condition d’inactivité d’un an exigée parfois pour l’obtention de l’AAH, dont la suppression a d’ailleurs été annoncée par le Président de la République.
Pour étayer mon propos, je prendrai l’exemple d’une personne percevant l’allocation aux adultes handicapés et titulaire d’un contrat à durée déterminée de trois mois : si ce dernier n’est pas renouvelé, cette personne devra attendre un an avant de pouvoir de nouveau bénéficier de l’AAH. C’est précisément l’une des difficultés que nous nous sommes engagés à étudier dans le cadre du comité de suivi mis en place pour réfléchir de manière globale à la question de l’articulation entre ressources du handicap, retour à l’emploi et travail en ESAT, quelles que soient les situations rencontrées.
Ce groupe de travail rendra ses conclusions définitives le 10 juin prochain, à l’occasion de la Conférence nationale présidée par le Président de la République. Conformément à ce que nous avions précisé lors de la présentation du comité de suivi, l’objectif est d’éliminer toutes les situations dans lesquelles l’accès ou le retour à l’emploi d’une personne handicapée est « désincité » par une mauvaise articulation entre des revenus du handicap et le mode de rémunération. Plus globalement, telle est aussi l’ambition du revenu de solidarité active.
Madame la sénatrice, sachez en tout cas que ce sujet est véritablement au cœur de nos préoccupations et que des mesures précises ne tarderont pas à être annoncées.

Madame la secrétaire d’État, nous attendrons donc le 10 juin prochain pour savoir ce qu’il en sera réellement.
Cela étant, je me suis interrogée sur l’opportunité de ma question après avoir lu attentivement, hier soir, le Livre vert que votre collègue Martin Hirsch a consacré au revenu de solidarité active, sujet sur lequel ce dernier sera auditionné tout à l’heure par la commission des finances. Si j’ai bien compris, son ambition, qui, d’ores et déjà, a été profondément réduite en termes de financement, était d’intégrer dans le calcul du RSA l’ensemble des prestations sociales, y compris, d’ailleurs, l’AAH, puisqu’il s’agit, là aussi, d’encourager le travail, conformément à la philosophie affichée du dispositif d’ensemble.
Si cela est confirmé, ma préoccupation serait tout de même quelque peu « décalée » par rapport à la réalité. Mais je continue à m’interroger, puisque l’on ne connaît toujours pas le périmètre exact du RSA. Du reste, ce n’est pas vous qui allez pouvoir m’éclairer sur ce point aujourd’hui !
J’étudierai donc avec beaucoup d’attention les propositions qui ressortiront de la Conférence nationale du 10 juin prochain. En tout état de cause, il ne faudrait tout de même pas, comme c’est malheureusement devenu une habitude, déshabiller l’un pour habiller – très mal ! – l’autre.
Madame la secrétaire d’État, je vous fais confiance, car je connais votre volonté tenace de régler le problème. Mais je ne suis pas totalement confiante à l’égard des arbitrages qui seront rendus.
Madame Bricq, lorsque nous avons mis en place ce groupe de travail, nous y avons associé les équipes de Martin Hirsch afin de disposer d’une vision cohérente pour tout ce qui touche à l’articulation entre des ressources liées soit à une inactivité, soit au handicap, et l’accès ou le retour à l’emploi.
Cela signifie, non pas que l’ensemble des prestations sociales seront intégrées dans le calcul du RSA, mais que notre démarche se veut logique et cohérente. À nos yeux, il ne doit pas y avoir de perdants parmi ceux qui souhaitent accéder à l’emploi.
Dans le cadre du handicap, vous le savez, il n’y a pas que l’AAH. Il nous faut également tenir compte de la compensation du handicap et de sa spécificité. Si la question du handicap est un volet particulier de notre action, nous souhaitons travailler sur ce sujet en cohérence avec les différentes politiques qui visent à la solidarité.

La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la question n° 223, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur le vif mécontentement que provoquent parmi les étudiants en travail social les modalités de mise en œuvre du décret du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise, pris en application de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Vous le savez, ce texte prévoit de rémunérer certains stagiaires à hauteur de 30 % du SMIC, mais uniquement à compter du troisième mois de stage, ce qui signifie, concrètement, que cette rémunération n’est due qu’à compter du premier jour du quatrième mois de stage.

Cela revient à gratifier le stagiaire d’une somme de 398 euros, c’est-à-dire 99, 50 euros mensuels pour les trois premiers mois.
Outre le peu de considération accordé au stagiaire au regard de la modestie d’une telle somme, alors que celui-ci va accomplir un travail réel, le décret incriminé pose d’autres problèmes. En effet, il institue une inégalité de traitement en fonction des filières choisies par les étudiants.
Celles-ci sont en effet plus ou moins longues selon que l’intéressé souhaite devenir assistant social, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur ou aide médico-psychologique. Certains de ces étudiants ne bénéficieront d’ailleurs d’aucune gratification. De plus, certaines catégories d’étudiants sont de fait exclues du dispositif. Il s’agit des étudiants qui poursuivent un diplôme de niveau 4, ceux qui sont allocataires des ASSEDIC, en congé individuel de formation ou boursiers. Les organismes de caractère associatif qui accueillent ces stagiaires sont dans l’incapacité de les financer ; quant à l’État, il refuse d’appliquer cette règle à ses propres services.
Tout cela n’est pas sans conséquence. Des structures ont gelé les stages faute de financement : les étudiants concernés se retrouvent, de ce fait, dans l’impossibilité de valider leurs diplômes puisque ceux-ci supposent des formations, dites en alternance, avec obligation de stages pratiques. Certains étudiants envisagent d’ailleurs d’abandonner leur cursus en cours.
Voilà pourquoi, madame la secrétaire d’État, je vous demande instamment de bien vouloir me préciser les mesures que vous comptez prendre pour que, sans tarder, l’État débloque les financements nécessaires aux gratifications liées à ces stages, pour que celles-ci soient cumulables avec toute autre allocation, pour qu’elles puissent être perçues à compter du premier jour de stage sans distinction aucune entre les différentes filières sociales choisies et pour qu’en même temps des compensations financières soient accordées aux structures de type associatif permettant ainsi le versement des gratifications.
Monsieur Foucaud, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Xavier Bertrand, qui a souhaité que je le représente pour vous faire part des éléments de réponse suivants.
Tout d’abord, il partage votre volonté de permettre aux étudiants concernés d’achever leur cursus de formation. Les dernières dispositions que nous avons prises ont pour objectif de valoriser les stages. Il ne s’agit en aucun cas de tarir l’offre.
C’est pourquoi, concernant le montant de la gratification, la démarche que le Gouvernement a adoptée en vue d’appliquer la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a été pragmatique, concertée et équilibrée, avec le souci de donner une portée réelle à la gratification obligatoire votée par le Parlement, et ce sans déséquilibrer les formations.
En prenant le décret du 31 janvier 2008, le Gouvernement a fixé le montant minimal de la gratification à 12, 5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 30 % du SMIC. Le stagiaire perçoit la gratification dès le premier jour, et non plus seulement à partir du début du quatrième mois de stage.
Ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, nous l’avons par conséquent déjà fait !
M. Thierry Foucaud fait un signe de dénégation.
Ensuite, le champ d’application de cette réglementation inclut les entreprises publiques, les établissements publics industriels et commerciaux, ainsi que les associations.
En effet, la loi pour l’égalité des chances ne concernait pas les stages dans les administrations. Toutefois, André Santini examine cette question et il rencontrera d’ailleurs prochainement le Comité des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires.
Cette loi ne modifiait pas non plus le régime des stages de la formation professionnelle continue, accomplis par des salariés ou des demandeurs d’emploi qui n’ont pas le statut d’étudiant. Il n’y a donc pas lieu, monsieur Foucaud, d’incriminer le décret sur ce point.
Dans la mesure où, je le rappelle, avant 2006, il n’existait aucune garantie pour les stagiaires, on peut dire que le Gouvernement offre ainsi une réelle avancée sociale aux étudiants et une valorisation de leur investissement dans le monde du travail.
J’en viens à la situation des étudiants en travail social qui effectuent souvent leur stage dans des associations gérant des établissements ou des services d’action sociale. Je rappelle que la gratification n’est obligatoire que pour les stages de plus de trois mois consécutifs.
Dans les structures qu’il finance, l’État a pris toutes ses responsabilités pour garantir que les stages puissent avoir lieu dans les établissements et services médico-sociaux. Les dépenses correspondant aux gratifications obligatoires sont prises en charge, notamment au titre de l’assurance maladie. Le financement existe donc bien, il est intégré dans la tarification des établissements et services. Xavier Bertrand a donné, dès le mois de février, des instructions très claires en ce sens aux services déconcentrés, et cet engagement qui s’applique dès cette année vaut, bien entendu, pour l’avenir.
Pour réussir l’accompagnement de la dépendance, du handicap, de la petite enfance et des personnes en difficulté, nous avons besoin de former des travailleurs sociaux, et je sais que les conseils généraux partagent pleinement ce souci. C’est la raison pour laquelle de nombreux conseils généraux ont choisi une approche pragmatique, en facilitant l’application de la gratification obligatoire dans les établissements et services qu’ils financent ; nous les y encourageons de telle sorte qu’aucun étudiant ne soit mis en situation de ne pouvoir accomplir son stage.
Xavier Bertrand a adressé un courrier en ce sens à M. Lebreton, président de l’Assemblée des départements de France, l’ADF, avec laquelle ses services restent en contact pour examiner les modalités d’application et faire en sorte que les stages prévus puissent avoir lieu, afin de ne pas compromettre les formations dont le secteur a besoin.
Quant au cumul de la gratification de stage avec les bourses d’étude pour les étudiants en travail social, c’est aux conseils régionaux qu’il appartient de préciser les règles d’attribution des bourses.
Voilà la réponse que Xavier Bertrand souhaitait vous apporter, monsieur Foucaud, pour rétablir les choses sur ce sujet qu’il suit avec beaucoup d’attention.

Madame la secrétaire d’État, je ne suis, bien sûr, pas satisfait de votre réponse.
Tout d’abord, vous affirmez que Xavier Bertrand souhaite que les stagiaires puissent finir leur stage. C’est bien la preuve qu’il existe un malaise réel chez ces étudiants, notamment à propos des questions de rémunération.
Si l’on en croit vos propos, tout est pour le mieux, tout va dans le bon sens, et ceux qui s’interrogent travestissent la réalité. Dans ce cas, pourquoi les étudiants des instituts du développement social, les IDS, ont-ils prévu une journée nationale de mobilisation avec manifestation, à Paris, le 13 mai ? Vous pourrez alors mesurer par vous-même leur mécontentement et leur détermination.
Votre réponse s’inscrit naturellement dans la politique gouvernementale, dont la caractéristique majeure est l’inégalité de traitement qu’elle instaure entre nos concitoyens : vous accordez 15 milliards de cadeaux fiscaux, au travers de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, aux plus nantis, et vous opposez une réponse négative à la demande de versement d’une gratification mensuelle de 398 euros pour les stagiaires !
Or il faudrait accorder une contrepartie financière dès le premier jour pour tous les stages effectués par les étudiants, comme ceux-ci le souhaitent. Nous proposons que cette contrepartie soit fixée selon un barème national défini dans le cadre d’une négociation nationale.
Nous proposons en outre que les déplacements donnent lieu, selon les besoins, à des indemnités de transport, de repas et de logement.
Enfin, j’ai retenu de votre intervention que vous vouliez faire payer, une fois de plus, les départements et les régions.

La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 198, adressée à M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique.

Je souhaite, tout d’abord, dire à Mme la secrétaire d’État que j’ai écouté avec beaucoup d’attention la réponse « en deux temps » qu’elle a faite à la question de Mme Nicole Bricq et que je l’ai beaucoup appréciée.
Le sujet que je vais aborder est tout autre.
La fonction publique territoriale a été reconnue par la loi du 26 janvier 1984. Des lois successives ont fait évoluer son statut : celles de 1987, 1994, 1996, 2001 et celle de 2005, qui a introduit les contrats à durée indéterminée.
Malgré toutes ces évolutions, un nouveau texte a paru nécessaire afin de tenir compte de l’évolution des missions qui sont aujourd’hui confiées à la fonction publique territoriale. Il s’agit de la loi du 17 février 2007, qui comporte un grand nombre de dispositions très importantes concernant la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et la clarification du paysage institutionnel de la fonction publique territoriale. Un des objectifs affichés est bien de renforcer l’attractivité des métiers.
Cependant, certains agents demeurent exclus du bénéfice de ces évolutions successives. Il existe des emplois spécifiques, créés sur la base de l’article L. 412-2 du code des communes, qui n’ont pu bénéficier, au moment de la constitution des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, d’une intégration dans ces cadres d’emploi. La nature même de l’emploi spécifique ne permet ni mutation ni détachement, ce qui limite le déroulement de carrière au cadre défini par la délibération qui a institué l’emploi.
Certes, la loi adoptée en 2007 a permis d’intégrer automatiquement les titulaires d’emploi spécifique, mais au seul bénéfice de la catégorie A, sous réserve que soient remplies certaines conditions. Or il existe des emplois spécifiques qui concernent les catégories B et C.
Un traitement identique de tous les agents titulaires d’emploi spécifique, quelle que soit la catégorie, semble relever de la simple équité et mettrait un terme à une situation extrêmement pénalisante pour des agents, au demeurant peu nombreux, qui ne peuvent ni évoluer dans leur carrière ni envisager de mobilité.
Malgré une mise en œuvre récente de ce nouveau dispositif, ne serait-il pas possible d’envisager d’étendre l’intégration automatique de ces agents, dès lors que sont remplies les conditions de diplômes et de durée de carrière ?
Je profite de cette intervention pour renouveler les préoccupations, dont j’ai fait part récemment par courrier, relatives au déroulement de carrière et de rémunération des personnels de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il me semble en effet essentiel de veiller à la situation de ces personnels, qui constituent la catégorie la plus modeste de la fonction publique territoriale. Les agents des petites collectivités sont souvent bloqués dans leur carrière, compte tenu de la taille même de la collectivité, d’autres ont entamé une seconde carrière dans la fonction publique territoriale et certains assument des missions qui dépassent largement leur cadre d’emploi. Les compétences sont réelles, le mérite certain, néanmoins, les perspectives de déroulement de carrière sont peu encourageantes.
La refonte des échelles de rémunération de la catégorie C a certes permis des améliorations, mais de nombreux agents restent encore pénalisés par des perspectives d’évolution quasiment inexistantes pour certains grades, situation engendrée par l’application même de ces nouveaux dispositifs. M. le secrétaire d’État m’a indiqué qu’il avait pris bonne note des remarques que je lui transmettais et que ce dossier serait soumis à un examen attentif.
Je sais pouvoir compter sur l’intérêt attentif du Gouvernement, d’autant plus que vient de paraître le livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, issu de la réflexion de la Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique installée par M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, M. le Premier ministre et M. le ministre du budget, dans l’objectif de faire des services publics et de la fonction publique des atouts pour la France.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sur les emplois spécifiques de la fonction publique territoriale.
Ces emplois dits spécifiques sont ceux qui ont été créés antérieurement à l’institution des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, en application de la loi du 26 janvier 1984.
La situation des titulaires de ces emplois a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers des cadres d’emplois publiés depuis 1987 a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l’intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque les fonctionnaires ne remplissaient pas en totalité celles-ci, ils pouvaient présenter une demande d’intégration qui faisait alors l’objet d’une procédure spécifique d’instruction.
Les statuts particuliers des cadres d’emplois classés en catégorie A prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d’une commission nationale d’homologation ad hoc lorsque l’une au moins des conditions de diplôme ou d’ancienneté n’était pas remplie. Cette commission n’existe plus, mais il demeure un certain nombre de fonctionnaires territoriaux occupant des emplois spécifiques de catégorie A qu’il convient d’intégrer.
C’est ce qui a notamment justifié le dépôt, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, d’un amendement d’origine parlementaire visant à créer, dans la loi du 26 janvier 1984, un article 139 ter qui dispose : « Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret ».
En revanche, les statuts particuliers des cadres d’emplois classés en catégorie B ou C prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, de la commission administrative paritaire compétente, notamment quand les intéressés ne possédaient pas le diplôme prévu ou n’avaient pas l’ancienneté de services exigée mais une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d’un grade statutaire.
De par cette procédure, nettement moins lourde que pour les titulaires d’emplois du niveau de la catégorie A, les fonctionnaires qui occupaient des emplois spécifiques relevant du niveau des catégories B ou C ont généralement pu être intégrés, dès lors qu’ils le demandaient, directement dans les cadres d’emplois de même catégorie avec, le cas échéant, une simple consultation de cette commission.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que M. André Santini m’a demandé de porter à votre connaissance. J’espère qu’ils vous satisferont. Je ne manquerai pas, pour ma part, de lui transmettre les informations complémentaires dont vous nous avez fait part, à la fin de votre question, sur la situation des agents de catégorie C et lui demanderai de vous répondre par écrit sur ce point.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir bien voulu me communiquer la réponse de M. Santini. Cette réponse précise mérite d’être lue attentivement afin de déterminer quelles suites éventuelles il faudra lui donner.
Je tiens à vous remercier également pour l’engagement que vous avez bien voulu prendre.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 231, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

J’ai souhaité interroger M. le ministre du budget sur les modalités de facturation des numéros surtaxés des services publics.
En effet, de nombreuses administrations - caisses primaires d’assurance maladie, caisses d’allocations familiales, Assedic - ne sont joignables par les citoyens que par le biais de ces numéros.
Dans la mesure où les appels adressés à ces organismes sont toujours guidés par la nécessité, on peut s’interroger sur le fait que les temps d’attente, qui sont souvent longs, soient facturés à l’usager. Est-ce à lui de supporter ces contraintes de fonctionnement ? Est-il bien normal que certains citoyens payent plus cher pour entrer en contact avec leur hôpital, lorsque celui-ci a fait le choix d’un numéro surtaxé ?
Le Gouvernement a apporté un début de réponse à cette question, en janvier dernier, dans la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, qui a modifié l’article L. 121-84-3 du code de la consommation en prévoyant la gratuité du temps d’attente pour les usagers qui appellent les services clientèle, technique ou après-vente d’un opérateur de téléphonie. Il s’agissait de mettre fin aux abus constatés et dénoncés de certains opérateurs.
Nous sommes un certain nombre à avoir constaté que le temps d’attente était désormais gratuit vers les opérateurs. Certes, mais lorsqu’on les appelle, une personne vous indique immédiatement qu’elle recherche votre dossier ou qu’elle transmet votre appel. À partir de ce moment-là, l’appel est payant puisque vous avez été mis en communication avec quelqu’un « au bout du fil », et pourtant le temps d’attente n’est pas terminé pour autant ! Cela fera sans doute l’objet d’une autre question adressée à M. Chatel !
Lors du débat relatif au projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, un certain nombre d’entre nous – j’en faisais partie – avaient interrogé M. Chatel sur le temps d’attente payant vers les services publics.
Il nous avait alors répondu que les services publics avaient recours à des opérateurs de téléphonie parce que ceux-ci leur vendaient des plateformes clés en main. La permutation vers un système de décompte entre attente et communication était donc très compliquée et impossible à mettre en œuvre immédiatement. Je sais que M. le ministre du budget travaille sur ce dossier depuis le mois de septembre dernier, mais il n’empêche que les citoyens doivent toujours payer pour consulter la CAF ou pis les ASSEDIC, alors qu’ils sont dans une situation financière difficile.
Finalement, on ne paie pas pour appeler sa hotline lorsque l’on a un problème avec Internet ou le téléphone, mais on paie pour entrer en contact avec un service public !
À la suite des engagements pris par M. Chatel et des réflexions engagées par M. Woerth, j’aimerais savoir quelles mesures ont été prises pour encourager les services publics à entreprendre les modifications de leur système afin d’instaurer un temps d’attente gratuit et quels délais ont été fixés pour leur mise en œuvre ?
Au demeurant, j’espère que les services publics ne procéderont pas aux mêmes détournements que ceux que j’ai dénoncés tout à l’heure.
Madame le sénateur, vous avez appelé l’attention d’Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur la réduction du coût des appels surtaxés et sur la gratuité du temps d’attente.
La réduction de la facture téléphonique des usagers est un sujet prioritaire sur lequel s’est engagé le Gouvernement. Vous l’avez rappelé, dès janvier 2008, le Gouvernement a mis fin à la surtaxation des appels vers les services d’assistance des opérateurs téléphoniques et a rendu gratuit le temps d’attente vers ces services.
Reconnaissons-le, ce sont deux mesures concrètes en faveur du pouvoir d’achat des Français qui ont été votées dans le cadre de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Néanmoins, cette gratuité du temps d’attente n’est possible que si l’on peut déterminer de manière précise le moment où un appel est « décroché ». Cela nécessite que l’ensemble de la chaîne de réponse soit traitée par le même opérateur. Or, pour l’administration, les réponses aux usagers sont traitées en interne, alors que l’acheminement des appels est géré par des opérateurs téléphoniques.
Dans les conditions actuelles, il n’est techniquement pas possible d’appliquer la gratuité du temps d’attente vers les administrations. Pourtant, pour ce qui concerne le coût des centres d’appels des administrations, le Gouvernement a décidé de ne pas en rester là. En effet, il a choisi de s’attaquer à la pratique des appels surtaxés dans les administrations. Aussi, dès le 6 septembre dernier, M. Woerth a donné instruction pour ramener à une tarification locale l’ensemble des services téléphoniques placés sous sa responsabilité.
Conformément à ces engagements, le coût des appels vers les centres impôts-services a été ramené à celui d’un appel local. Concrètement, c’est une division par quatre de la facture des usagers, pour plus de 3 millions d’appels reçus ! Cette décision est en train de se généraliser dans les autres centres d’appels des ministères, dont les coûts d’appels passeront au coût d’un appel local au fur et à mesure du renouvellement des contrats passés avec les opérateurs.
Vous le voyez, le Gouvernement est convaincu de la nécessité de continuer d’agir sur ce sujet et de renforcer l’action engagée par Éric Woerth. Il y va de l’accès des services publics par tous ainsi que du pouvoir d’achat des Français.
Quoi qu’il en soit, je me ferai l’écho de votre intervention précise et détaillée, madame le sénateur, afin que nous accroissions nos efforts dans le secteur tant privé que public.
Comme vous l’avez souligné, nous aurons l’occasion d’aller plus loin encore, lors de débats à venir, pour faire en sorte que les services publics soient vraiment accessibles à tous.

Je vous remercie, madame le secrétaire d’État, de m’avoir précisé qu’il appartenait aux ministères chargés des différentes administrations de prendre les décisions. C’est donc vers eux que je me tournerai.
Toutefois, je m’interroge plus particulièrement sur les hôpitaux.Ceux-ci dépendent, me semble-t-il, de l’Assistance publique. Relèvent-ils du ministère de la santé pour ce qui concerne la question des appels téléphoniques, qui est scandaleuse ? Je ne le sais pas. S’agissant des ASSEDIC, il va falloir se tourner vers le nouvel opérateur qui s’occupe directement du ministère de l’emploi.
Pour avoir souscrit des contrats dans des entreprises, je sais que les délais peuvent être très longs, de trois ans à cinq ans. Si les administrations viennent de signer leur contrat, la différence de traitement avec les opérateurs privés de téléphonie va donc durer. Je déplore cette situation. Toutefois, un contrat peut se renégocier ! Pourquoi n’a-t-on pas demandé aux ministères de renégocier leurs contrats ? Comme vous me l’avez suggéré, madame le secrétaire d’État, je poserai cette question à M. le ministre du budget lors de débats ultérieurs.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.