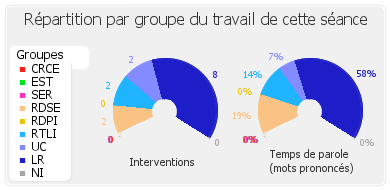Séance en hémicycle du 19 décembre 2006 à 10h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1137, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le ministre, à la suite de la diffusion, en octobre 2004, des conclusions de la mission que j'avais réalisée à la demande du Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, afin d'évaluer le dispositif législatif et réglementaire garantissant l'équilibre entre les différentes formes de commerce, j'ai déposé la proposition de loi n° 174, que le Sénat a adoptée, en première lecture, lors de sa séance du 16 juin 2005 - vous représentiez d'ailleurs ce jour-là le Gouvernement, monsieur le ministre. Dès le lendemain, ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale.
Le dispositif retenu par la Haute Assemblée était le résultat d'une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés. Il répondait très largement aux considérations que vous avez énoncées, monsieur le ministre, lors de votre conférence de presse du 7 septembre dernier, s'agissant, en particulier, des principes directeurs de l'équipement commercial, puisqu'il visait à promouvoir un aménagement urbain équilibré, à protéger l'environnement, à satisfaire les besoins des consommateurs et à participer au développement de l'emploi.
En outre, il précisait les critères sur lesquels se fonderaient à l'avenir les décisions des commissions d'équipement commercial, c'est-à-dire, notamment, les considérations architecturales et esthétiques et la cohérence urbaine du projet.
Cela étant, le 5 juillet 2005, soit quelques jours à peine après l'adoption de ce texte par le Sénat, la Commission européenne adressait une lettre de mise en demeure à la France, la sommant de mettre sa législation en conformité avec la directive « Services ».
C'est pourquoi, monsieur le ministre, vous avez pris l'initiative de constituer un groupe de travail sur ce sujet, auquel je participe, ainsi que toutes les parties concernées. Même si la création de cette structure a suscité un certain scepticisme chez les professionnels du commerce, les élus et les représentants associatifs - ils ont craint qu'elle ne conduise à reporter sine die l'adoption d'une réforme très attendue et déjà engagée -, ce groupe a tenu deux réunions plénières, et ses conclusions seront rendues publiques fin janvier.
À ce stade, je souhaiterais savoir, en particulier, quels nouveaux critères, conformes aux exigences européennes, vous paraissent souhaitables afin d'arrêter la prolifération des mètres carrés de grandes surfaces à laquelle nous assistons ces derniers temps. D'ailleurs, je vous remercie de bien vouloir nous donner des indications chiffrées sur ce phénomène.
Enfin, puisque la troisième réunion plénière du groupe de travail doit se tenir demain, dans les locaux du ministère dont vous êtes en charge, avez-vous l'intention de demander, dans les meilleurs délais, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat ? Naturellement, le rapporteur de ce texte pourrait alors y introduire toutes les modifications préconisées par le groupe de travail.
Monsieur le ministre, je ne saurais trop rappeler l'absolue nécessité d'adopter une nouvelle législation dans ce domaine d'ici à la fin de la présente législature.
Monsieur Fouché, vous le savez, la législation française sur l'urbanisme commercial qui a été mise en oeuvre depuis trente ans, c'est-à-dire à partir de la loi Royer, n'a pas prouvé son efficacité. Le texte le plus récent, la loi dite « Raffarin », qui devait assurer une meilleure régulation, n'a pu atteindre cet objectif.
Par exemple, le nombre de mètres carrés demandés chaque année aux CDEC, les commissions départementales d'équipement commercial, est passé de 1, 7 million en 1996, année au cours de laquelle a été adoptée cette loi, à plus de 3, 7 millions en 2005, et le nombre de mètres carrés autorisés chaque année a été multiplié par trois en dix ans, passant de un million en 1996 à 3, 5 millions en 2005.
La prise en compte prioritaire des critères de surface de vente a conduit à multiplier les petites et moyennes surfaces et à constituer des zones commerciales en laissant peu de place aux considérations architecturales esthétiques, paysagères, ou d'aménagement urbain. Certaines entrées de ville ont été défigurées, et ce phénomène ne se limite plus aujourd'hui aux grandes agglomérations, mais affecte aussi toutes les villes moyennes.
L'objectif de la préservation de l'équilibre entre la grande distribution et les petits commerces de centre-ville n'a pas été atteint. La législation a trop souvent conduit à opposer les centres-villes et les périphéries urbaines, là où le développement urbain appelle la mise en oeuvre de coopérations entre ces formes de commerces.
Le dispositif législatif en vigueur n'est pas toujours effectivement appliqué. Les sanctions pénales prévues par la loi sont très rarement mises en oeuvre, notamment en raison de la lourdeur de la procédure judiciaire prévue et des possibilités très larges de régularisation a posteriori offertes aux CDEC.
Enfin, la conformité de la législation française aux règles communautaires se trouve contestée, comme vous l'avez souligné, monsieur Fouché.
À l'issue de deux années d'échanges contradictoires entre la direction générale « Marché intérieur » et mon administration, dans une lettre du 5 juillet 2005, la Commission européenne a établi que certaines dispositions de la loi Raffarin relative à l'équipement commercial n'étaient pas compatibles avec l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne, qui porte sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services.
J'ajoute, car ce point est important, que le projet de directive communautaire relative aux services dans le marché intérieur, qui vient d'être adopté par le Parlement européen, conforte la position de la Commission. Il interdit, en particulier, toute procédure consistant à analyser les besoins du marché, alors que la législation française consiste précisément, pour chaque projet, à subordonner l'autorisation de construction à la preuve de l'existence d'une nécessité économique.
La réforme de notre droit ne peut donc se limiter à un ajustement des procédures existantes, comme le prévoit la proposition de loi que vous avez évoquée, monsieur Fouché, et qui a été adoptée par le Sénat le 16 juin 2005.
Les dérives constatées depuis dix ans, la procédure engagée par la Commission européenne en juillet 2005, et surtout l'adoption récente de la directive « Services » appellent un réexamen beaucoup plus important et ambitieux de notre législation.
Il serait contre-productif, alors même que les discussions sur la directive « Services » ne sont pas achevées à Bruxelles, d'engager une réforme partielle et insatisfaisante de notre législation nationale. Le bon ordre à suivre, c'est la discussion et l'adoption de la directive d'abord, sa transposition dans la loi ensuite !
Je crois donc que le calendrier que nous avons retenu est le bon. Dès le 24 octobre dernier, j'ai réuni une commission de modernisation de l'urbanisme commercial, en associant à ses travaux l'ensemble des acteurs concernés.
Monsieur Fouché, vous avez accepté, et je vous en remercie, d'assurer la vice-présidence de cette commission, qui est composée d'élus locaux, de professeurs, d'avocats spécialisés, d'aménageurs, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de promoteurs d'immobilier commercial, et de représentants des chambres consulaires, des fédérations du commerce et des associations de défense de l'environnement. Tous ceux qui sont intéressés par ce sujet pourront donc s'exprimer.
Une deuxième réunion a eu lieu le 22 novembre 2006. Je réunirai de nouveau cette commission les 20 décembre et 17 janvier prochains.
Cette commission suivra trois axes de travail : tout d'abord, l'insertion de la procédure d'urbanisme commercial à l'intérieur de la procédure d'urbanisme général, afin d'éviter les incohérences actuelles ; ensuite, la refonte des critères de délivrance des autorisations, qui reposeraient non plus sur l'analyse des besoins du marché, mais sur un schéma de développement commercial qui deviendrait opposable et comporterait des critères d'aménagement du territoire, de développement durable, d'intégration écologique, architecturale, paysagère et sociale ; enfin, la recomposition des instances de délivrance des autorisations.
La proposition de loi adoptée le 16 juin 2005 par le Sénat ne comportait pas ces trois axes, mais était, à mon avis, bonne, et certains de ses éléments, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle administratif des surfaces illicites, pourront utilement être repris. Toutefois, la commission de modernisation de l'urbanisme commercial doit aujourd'hui travailler à une réforme beaucoup profonde.

Les mètres carrés de grandes surfaces, vous en êtes convenu, monsieur le ministre, se sont multipliés. C'est une raison supplémentaire pour faire inscrire le plus rapidement possible à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette proposition de loi. En effet, les conclusions du groupe de travail reprennent pour l'essentiel - ses comptes rendus en font foi - les dispositions de la proposition de loi qui a été votée par le Sénat, avec quelques modifications liées à la directive européenne. Ce texte peut donc être rapidement examiné par l'Assemblée nationale, me semble-t-il.

La parole est à M. Dominique Braye, auteur de la question n° 1178, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le ministre, le problème de l'ouverture des magasins le dimanche est aujourd'hui largement débattu, vous en conviendrez. Il concerne le secteur commercial, mais aussi nos concitoyens, dont tous les sondages nous affirment qu'ils sont très majoritairement favorables à l'ouverture du dimanche - dès lors, bien sûr, que les employés des magasins concernés sont volontaires -, et ce tout simplement parce que nombre d'entre eux ne peuvent faire leurs courses que le week-end !
L'ouverture dominicale des magasins ne peut plus aujourd'hui être écartée d'un revers de main, sous prétexte de protection du petit commerce. Elle répond, en France comme chez nos voisins européens, qui la pratiquent plus largement, à l'évolution des modes de consommation et à une nécessité économique, face à la concurrence des magasins automatiques et du commerce électronique par Internet, dont l'activité est permanente, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365.
Cette question se pose avec une acuité particulière dans les grandes agglomérations et leurs périphéries, où nos concitoyens travaillent tard et rentrent tard chez eux, du fait notamment de la longueur des temps de transport. Inévitablement, ils ne peuvent donc faire leurs achats que le week-end.
Or, comme je le constate dans ma commune de Buchelay, les zones commerciales sont totalement saturées le week-end, ce qui empêche tout report de l'activité dominicale sur le samedi. Tous ceux qui l'observent peuvent l'affirmer ! L'interdiction d'ouverture dominicale pénalise donc gravement les enseignes concernées et leurs salariés, mais aussi, et peut-être surtout, leurs clients.
Comme vous l'avez souligné dans votre réponse précédente, monsieur le ministre, l'ouverture dominicale des magasins dans les zones commerciales périurbaines ne peut être autorisée que dans le seul respect d'un équilibre entre le commerce de centre-ville et le commerce des zones périphériques, afin de préserver le petit commerce de proximité et l'animation des centres-villes. Mais ceux-ci ne dépendent nullement de l'ouverture des centres des zones périphériques le dimanche ; ils dépendent de la répartition des commerces entre la périphérie et le centre-ville.
C'est précisément cet équilibre qu'ont voulu instaurer les élus de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines que j'ai l'honneur de présider, en interdisant l'implantation dans les zones commerciales d'enseignes concurrentes des commerces de centre-ville concernant, par exemple, l'alimentation spécialisée, l'équipement et les soins de la personne.
Sous cette réserve, et sous celle de fonder le travail dominical exclusivement bien entendu sur le volontariat et sur une compensation financière substantielle, l'ouverture dominicale est, nous le savons tous, inéluctable, et il appartiendra au législateur de se saisir de ce sujet.
En attendant cette nécessaire évolution, permettez-moi, monsieur le ministre, d'attirer votre attention sur l'exemple représentatif des zones commerciales de Buchelay, dans les Yvelines, dans la grande couronne parisienne, avec une activité concentrée le week-end, pour les raisons que j'ai précédemment évoquées.
Tous les acteurs et observateurs concernés constatent une application ubuesque, inéquitable et incompréhensible de la réglementation relative au régime d'autorisation d'ouverture dominicale.
Pourquoi ce régime varie-t-il, sur le plan régional, d'un département à l'autre ? Ainsi, dans le département de l'Essonne, la zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois voit ses commerces bénéficier régulièrement, tous les deux ans, du renouvellement de ses autorisations, ce qui n'est pas le cas des zones commerciales du département limitrophe, les Yvelines.
Vous en conviendrez, monsieur le ministre, cette situation est déjà surprenante et totalement injuste, mais peut s'expliquer par le fait que chaque département dépend d'une autorité compétente différente, à savoir le préfet, qui peut avoir son idée personnelle, voire originale, sur la manière de lire et d'appliquer la loi.
Mais ce qui est encore plus surprenant, encore plus inéquitable et encore plus inexplicable, c'est que, au sein d'un même département, les Yvelines, la même autorité, le préfet, peut, pour les mêmes activités commerciales, sur la même zone de chalandise, traiter de façon différente des commerces appartenant au même secteur d'activité.
Ainsi, à Buchelay, des responsables se voient refuser l'autorisation d'ouverture dominicale, et sont donc contraints de fermer leur magasin, tandis que leurs concurrents à Flins-sur-Seine ou à Orgeval et à Plaisir, des villes situées entre cinq minutes et quinze minutes en voiture dans la même zone de chalandise, restent ouverts sans être aucunement inquiétés.
Comment expliquer de telles disparités de traitement, qui semblent être pratiquées « à la tête du client » et qui faussent la loyauté de la concurrence ? Comment les services de l'État peuvent-ils créer et accepter de telles injustices ? Ne heurtent-elles pas, monsieur le ministre, votre sens de l'équité républicaine ?
Plus grave encore, les services de l'État, qui souhaitent aujourd'hui la fermeture dominicale des magasins de Buchelay, après l'avoir autorisée pendant sept ans, voire quinze ans, ont-ils mesuré les conséquences économiques et sociales d'une telle décision ?
Pendant toutes ces années, ils ont laissé ces magasins s'organiser, investir et recruter en fonction de l'ouverture dominicale, et viennent maintenant les menacer d'interdiction d'ouverture et de sanctions, ce qui signifierait, pour les magasins concernés, une perte de chiffre d'affaires de 20 % ; pour les salariés volontaires, une baisse de rémunération mensuelle de 20 % ; pour la cinquantaine d'étudiants employés à temps partiel, le licenciement et des difficultés pour financer leurs études, comme ils me l'ont tous confié ; et, pour les clients, enfin, une grande insatisfaction et une totale incompréhension devant cette politique de Gribouille.
Incompréhension, inéquité et révolte, tels sont les mots qui reviennent actuellement non seulement chez les responsables de ces magasins et les salariés, mais également chez les clients.
Quelles mesures entendez-vous prendre, monsieur le ministre, pour rétablir un minimum d'équité et de lisibilité concernant le régime des autorisations d'ouverture dominicale et pour ne pas pénaliser l'activité économique, l'emploi et les consommateurs ?
Je vous le dis tout de go, monsieur le sénateur, je ne suis pas fermé à une évolution de la législation relative au repos dominical. Mais, s'agissant d'un sujet aussi sensible, nous devons veiller à trouver le bon équilibre.
La règle du repos dominical est ancienne et ancrée dans nos comportements culturels. Elle est souvent liée à la vie familiale, mais elle se justifie également d'un point de vue économique.
Si, aujourd'hui, nous libéralisions totalement l'ouverture des magasins le dimanche, les petits commerces, qui sont bien souvent tenus par un couple, ne pourraient pas travailler sept jours sur sept et concurrencer les grandes surfaces qui peuvent, elles, organiser la rotation des salariés, selon la réglementation hebdomadaire du travail. Ainsi, perdant une part de leur chiffre d'affaires, ils disparaîtraient par milliers. Or, nous ne voulons pas - tout comme vous, monsieur le sénateur - supprimer toutes ces petites entreprises, qui sont aujourd'hui souvent prospères en France, et tous les emplois qui y sont liés.
La loi prévoit, je le rappelle, des dérogations à la règle du repos dominical pour le commerce alimentaire de détail et pour certains secteurs dans lesquels l'ouverture le dimanche est « nécessaire à une vie économique et sociale minimale ». À ce titre, un décret du 2 août 2005 a récemment élargi cette dérogation permanente à des secteurs comme l'assistance informatique, la surveillance, les ports de plaisance, la location de vidéo ou la jardinerie.
Des dérogations sont également prévues dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.
Enfin, un contingent de cinq dimanches par an peut être ouvert par arrêté municipal.
Nous sommes conscients qu'il y a aujourd'hui des aberrations non seulement dans la législation elle-même, mais également dans son application, comme vous l'avez, à juste titre, indiqué, monsieur le sénateur, en prenant l'exemple de votre département.
Le Premier ministre a saisi d'une demande d'avis sur ce sujet le Conseil économique et social - instance appropriée qui réunit les organisations syndicales et patronales -, qui lui remettra ses propositions à la fin du mois de février prochain.
Je suis convaincu que nous pourrons alors, sans attendre, apporter des réponses de bon sens à cette question difficile, tout en tenant compte de l'évolution des attentes de nos concitoyens et de la légitime préoccupation des commerçants.

Monsieur le ministre, je tiens à dire que mon intervention est très mesurée par rapport aux réactions de révolte que j'ai recueillies sur le terrain aussi bien parmi les salariés, qui sont tous volontaires et voient leur salaire diminuer de 20 % du jour au lendemain à cause de la décision d'un technocrate, que parmi les étudiants et les clients.
Je suis tout à fait d'accord pour que l'ouverture dominicale des magasins fasse l'objet d'un large débat, qui serait constructif, au Parlement. Mais il ne faut pas le repousser aux calendes grecques !
Par ailleurs, pour vivre ces problèmes sur le terrain, je ne partage pas votre analyse, monsieur le ministre. La concurrence entre le petit commerce et le commerce de périphérie dépend non pas des heures d'ouverture, mais de la répartition des secteurs d'activité.
S'il n'existe pas de magasin spécialisé en équipement de la personne dans une zone périphérique, les clients iront en centre-ville. Si nous avions adopté les dispositions législatives adéquates pour répartir correctement les commerces dans les agglomérations, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui ! Nous sommes responsables de cette situation, monsieur le ministre, et nous devrions en tirer des conclusions.
En revanche, vous n'avez pas répondu à la question centrale que je vous ai posée et que je continuerai à poser tant que je n'aurai pas obtenu de réponse.
Je souhaite que la législation soit appliquée de manière juste. Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures : soit, dans le même secteur d'activité, les magasins sont tous fermés soit ils sont tous ouverts ! C'est aussi simple que cela !
Monsieur le ministre, pour quelles raisons objectives un préfet peut-il autoriser, dans une même zone de chalandise, l'ouverture d'un magasin de bricolage le dimanche et la refuser à un autre ? Personnellement, je ne comprends pas, tout comme mes concitoyens et les responsables de ces magasins. Mais je ne doute pas que les hautes sphères politiques seront à même de me donner des explications !
Monsieur le ministre, je vous demande donc de faire respecter l'application de la loi et de nous apporter des réponses en la matière.

La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 1167, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par certains commerçants, artisans, professions libérales et autres responsables de PME pour se prémunir contre des opérations de démarchage forcé.
Si l'article L. 121-20 du code de la consommation a institué un droit de rétractation au profit du consommateur, il reste muet quant à la protection des professionnels. Pourtant, une décision de justice du 6 janvier 1993 et un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en date du 27 octobre 1995 ont respectivement reconnu cette possibilité à un groupement agricole d'exploitation en commun et à la sphère associative.
La taille de telles entreprises étant incompatible avec la présence d'un service juridique, leur dirigeant demeure bien souvent démuni face à certaines techniques de commercialisation.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser les mesures que vous envisagez de prendre pour étendre les dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation à certaines personnes morales de droit privé.
Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir posé cette question pertinente. Je vais vous apporter quelques précisions pour que vous puissiez les communiquer aux intéressés qui, bien souvent, ne connaissent pas les dispositions en vigueur.
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession.
L'application des dispositions de l'article L. 121-20 ralentirait les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. La généralisation à l'ensemble des professionnels du droit de rétractation ouvert aux particuliers par l'article L. 121-20 du code de la consommation risquerait d'aboutir au résultat inverse de l'objectif fixé, en retardant et en complexifiant le processus de production et de vente des biens et services. Une telle généralisation introduirait un risque juridique considérable pour de très nombreuses PME sous-traitantes de grands groupes industriels.
En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions dudit article sont pleinement applicables, et le professionnel bénéficie alors du même droit de rétractation que le particulier.
C'est ainsi que, dans l'arrêt du 6 janvier 1993 que vous avez cité, madame la sénatrice, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui était faite sortant du cadre spécifique de son activité.
Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel, ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourra donc conduire à la nullité de l'acte.

Monsieur le ministre, lorsqu'il s'agit de la même activité professionnelle - par exemple un boulanger qui se voit proposer un four ou un pétrin -, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Il n'en va pas de même lorsqu'il ne s'agit pas de la même activité.
Certes, monsieur le ministre, les démarcheurs ne sont pas tous de mauvaise foi - là n'est pas mon propos -, mais quelques-uns, hélas ! profitent d'un pic d'activité pour proposer à un commerçant un contrat de maintenance pour un appareil. Il n'existe pas encore de protection dans ce cas.
Permettez-moi d'insister sur ce point, les responsables d'entreprise sont souvent seuls pour assurer la gestion administrative de leur activité et pour affronter les difficultés qui en découlent. Je crains que l'information ne suffise pas : je compte sur vous, monsieur le ministre.

La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 1172, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Madame la ministre, dernièrement, le quotidien l'Humanité publiait la cartographie nationale de ce qu'il convient d'appeler une nouvelle « hécatombe économique » dans le secteur industriel, puisque, depuis le début du mois de septembre dernier, 25 000 emplois sont en passe d'être supprimés et 20 000 emplois se voient menacés à court terme.
Délocalisations, restructurations larvées, externalisations, non-remplacement des départs en retraite sont autant de stigmates d'une gestion industrielle qui reste dangereusement destructrice d'emploi, dans un contexte où le secteur des services ne compense plus les pertes d'emplois industriels.
Je souhaite donc attirer votre attention sur les conséquences qu'entraîne cette situation dans la métropole lilloise, madame la ministre. En six mois, pas moins de quinze entreprises ont fermé ou ont prévu de fermer leurs portes. Les plans de restructuration, ou ce que l'on appelle maintenant « les plans de sauvegarde de l'emploi », se multiplient de façon particulièrement inquiétante. Plus de mille salariés sont concernés, et je ne compte pas les emplois indirects.
Encore une fois, c'est le secteur industriel qui est le plus touché : le textile, encore et toujours, mais également - et c'est nouveau - les équipementiers automobiles et l'industrie graphique.
L'usine Plasty de Roubaix en donne un exemple instructif. Elle a été reprise au mois de mars dernier par le groupe tchèque Kartsit, qui, depuis, n'a réalisé aucun véritable investissement. Aujourd'hui, l'entreprise est en redressement judiciaire et quatre-vingt-dix-sept salariés vivent dans l'inquiétude de perdre leur emploi, puisque le groupe envisage de transférer quatre des cinq machines en République tchèque. En reprenant cette usine, la stratégie du groupe Kartsit était-elle de maintenir la production ou bien de récupérer les commandes et les clients de l'entreprise ?
En la matière, il existe un autre exemple particulièrement parlant, celui de la filière graphique, qui met en oeuvre deux stratégies parallèles à l'échelon mondial. La première consiste tout simplement à fermer les unités de production dont la rentabilité est jugée insuffisante, alors même que leur carnet de commande est rempli. La seconde revient à mettre en concurrence les différentes usines à l'intérieur d'un même groupe, afin de faire pression sur les salaires, d'augmenter la productivité et de mettre en concurrence les territoires pour obtenir des aides publiques plus importantes.
À ce jeu, la métropole Lilloise est la grande perdante. La cartonnerie Pacofa d'Halluin licencie trente-cinq salariés. La cartonnerie Sonoco de Marquette-lez-Lille est délocalisée en Grèce ; plus de soixante-deux salariés sont concernés. L'imprimerie Quebecor World d'Hellemmes-Lille est délocalisée à Charleroi, soit cinquante kilomètres plus loin : deux cent soixante-dix salariés seront licenciés. Cette entreprise a été attirée en Belgique par les fonds européens que notre pays n'a plus. La question est donc de savoir à quoi, dans ces conditions, servent les fonds européens.
En citant ces exemples de fermeture et de restructuration, je tiens à montrer de quelle manière et à quelle vitesse se poursuit la désindustrialisation de la métropole lilloise, comme celle de notre pays. Quel que soit le niveau, le déclin industriel de la France s'accentue, sans que rien ne soit réellement entrepris pour enrayer ce processus.
La métropole lilloise s'est lancée depuis de nombreuses années dans le développement de la filière tertiaire, notamment grâce à l'arrivée du TGV et du tunnel sous la Manche. Certes, cette politique a permis la création de nombreux emplois, mais force est de constater que le taux de chômage reste particulièrement élevé, puisqu'il est, pour la zone d'emploi de Lille et celle de Roubaix-Tourcoing, respectivement de 11, 8 % et de 14 %.
La dynamique de compensation des emplois tertiaires n'opère plus. Ainsi, Lille et sa métropole ont enregistré en 2005 un solde d'emploi négatif particulièrement préoccupant.
Si l'économie industrielle locale s'appuyait naguère sur un salariat issu en grande partie du bassin d'emploi de la métropole lilloise et sur ses savoir-faire, cette mutation ne lui permet plus aujourd'hui de remplir ce rôle, en particulier dans les quartiers populaires où le taux de chômage dépasse fréquemment 30 %.
Il faudrait donc réaliser des efforts bien plus importants en termes de formation et de reconversion des salariés. Cela passe, selon nous, par la création d'un dispositif très volontariste de sécurisation des parcours professionnels.
Mais, au-delà de cet aspect, c'est peut-être sur l'ensemble de la politique économique qu'il faut s'interroger. Comme le montre l'exemple de la métropole lilloise, en délaissant l'industrie, notre pays a favorisé l'émergence d'une structure économique déséquilibrée : forte dépendance au secteur tertiaire, tissu économique composé essentiellement de PME-PMI, disparition des grands groupes industriels.
Nous le savons bien aujourd'hui, maintenir et développer une politique industrielle doit permettre de consolider et de diversifier notre économie. C'est à ce titre que je vous demande de nous indiquer, madame la ministre, les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour s'opposer à cette fatalité, suivant laquelle nous serions impuissants face à cette logique de désindustrialisation.
Madame la sénatrice, permettez-moi de rappeler quelques éléments factuels sur la zone d'emploi de Lille, sur laquelle vous m'interrogez.
La zone d'emploi de Lille intègre la métropole lilloise et regroupe cent communes. Elle représente plus de 750 000 habitants, soit près de 20 % de la population de la région Nord-Pas-de-Calais. Elle compte 249 778 emplois salariés, dont 34 000 salariés dans l'industrie, soit 14 %.
L'emploi industriel y a connu une forte baisse entre 1998 et 2003 - de l'ordre de 16 % -, supérieure à celle de l'ensemble de la région, qui était de 6 %. À l'inverse - vous l'avez souligné, madame la sénatrice -, le secteur tertiaire concentre plus de 79 % de l'emploi salarié en 2003, le tiers étant consacré aux services aux entreprises. J'attire votre attention sur l'intérêt de l'activité dans le secteur tertiaire, dont une grande partie n'est souvent pas délocalisable.
Dans cette région, le tissu industriel présente un profil diversifié : les industries des équipements mécaniques, les entreprises agroalimentaires, chimiques et textiles constituent les principaux secteurs représentés et pèsent chacune entre 10 % et 15 % des emplois industriels de la zone d'emploi.
Le tissu industriel compte, quant à lui, un très faible nombre de très grandes entreprises, mais est formé d'un grand nombre d'établissements industriels de moins de deux cent cinquante salariés.
Cette situation de l'emploi industriel est le reflet de trois évolutions distinctes : d'abord, une forte externalisation des activités de services aux entreprises, ensuite, d'importantes restructurations au cours des dernières années, notamment dans le secteur textile, enfin, la forte urbanisation de la zone, qui rend le foncier peu disponible et souvent cher, les terrains libérés par les fermetures d'usines se trouvant souvent en plein centre-ville.
Pour compenser cette désindustrialisation, l'une des solutions réside dans la création d'emplois de service. À cet égard, nous constatons que la zone d'emploi de Lille bénéficie d'une forte progression de ces emplois, ce qui rattrape, au moins pour partie, les pertes d'emplois industriels. En outre, pour la plupart, ces emplois de service présentent la caractéristique de ne pas être délocalisables.
Les chiffres du chômage que j'ai à ma disposition proviennent du ministère de l'emploi et diffèrent légèrement des vôtres, madame la sénatrice. Ainsi, à la fin du mois de juin 2006, le taux de chômage de la zone d'emploi est de 11, 2 %, ce qui représente une baisse de 0, 9 point sur un an. Il est en cela inférieur de 1, 5 point à la moyenne régionale.
Vous avez également évoqué les questions de formation, madame la sénatrice. Je souhaite, pour ma part, axer ma réponse sur la recherche et le développement.
La métropole de Lille concentre l'essentiel des moyens régionaux en recherche et développement publics : elle compte notamment 250 laboratoires de recherche publics et parapublics, dont 60 sont rattachés au CNRS. S'y trouvent également une fraction importante des entreprises innovantes de la région ainsi que les pôles de compétitivité.
Pour ce qui est des créations d'entreprises - car il faut également s'y intéresser -, la zone d'emploi de Lille a enregistré 2 604 créations d'entreprises nouvelles en 2005, soit 32 % des créations régionales. En 2004, les créations de la zone étaient réparties en trois principaux secteurs : 46, 2 % pour le commerce, 40, 2 % pour les services, et 13, 6 % pour le secteur secondaire.
Cependant, le maintien d'une industrie forte et ciblée reste un objectif du Gouvernement. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de maintenir tous les secteurs industriels en vie, voire en survie. À cet effet, le Gouvernement a mis en oeuvre une politique de renforcement de la compétitivité de nos industries. Celle-ci passe par la réforme de la taxe professionnelle, qui profite aux établissements industriels, d'une part, par la politique d'innovation et de compétitivité portée en particulier, outre l'Agence nationale pour la recherche et l'Agence de l'innovation industrielle, par les pôles de compétitivité, qui encourage l'effort en faveur de la recherche et du développement, d'autre part.
La métropole lilloise est ainsi au coeur de quatre des six pôles de compétitivité régionaux : I-Trans - pour la construction d'équipements et de systèmes ferroviaires - Nutrition Santé Longévité, UpTex - pour le textile haute performance -, Industries du commerce. Plus de 1, 5 milliard d'euros a été mobilisé au service de ces pôles de compétitivité, afin d'encourager les mises en convergence à la fois du secteur public par ces organismes de recherche, des entreprises et des organismes de formation qui sont très présents et très actifs dans la région.
Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner qu'il ne s'agit pas simplement de prévenir les situations douloureuses que vous avez évoquées, il faut aussi anticiper. En ce qui concerne les salariés, l'Observatoire régional des mutations économiques a pour vocation, auprès du préfet de région et en lien avec les collectivités locales, d'anticiper et d'accompagner collectivement les mutations observées. Au sein des entreprises, il appartient aux comités d'entreprises, aux comités centraux d'entreprises et, parfois, aux comités de groupes européens d'adopter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permette d'assurer à chaque salarié son adaptation et son employabilité face aux évolutions des postes de travail que les nouvelles technologies rendent inéluctables.
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que je viens de former un groupe de haut niveau, destiné non seulement à anticiper les effets de la mondialisation pour une meilleure information, mais surtout à mieux prévoir les grandes tendances de l'industrie et de tous les secteurs de notre économie affectés par la mondialisation.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse très détaillée et argumentée, qui rejoint, pour l'essentiel, l'analyse que j'ai faite.
Certes, les pôles de compétitivité sont une solution de rechange. Mais je crains qu'ils ne soient anéantis par la désindustrialisation qui se poursuit. Actuellement, très peu d'investissements sont engagés dans le secteur industriel, ce qui est très inquiétant. Il nous faut être plus offensifs pour maintenir notre tissu industriel.
Par ailleurs, le secteur des services qui ne s'appuie pas sur le secteur industriel actuel reste très fragile. C'est un motif d'inquiétude supplémentaire sur lequel nous vous alertons depuis très longtemps. En outre, même si des créations d'emploi ont eu lieu, les poches de chômage restent très importantes dans les quartiers populaires, où, auparavant, les emplois industriels se trouvaient.
À la lecture du journal régional ce matin, nous constatons que les services se délocalisent. Je pense, en particulier, aux centres d'appels qui sont installés au Maroc et qui représentent des milliers d'emplois. Nous déplorons les conséquences qui en résulteront pour les salariés français.
Il faut nous montrer très offensifs vis-à-vis du secteur industriel. La métropole lilloise et la région possèdent un savoir-faire qu'il ne faut surtout pas laisser disparaître.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 1177, adressée à M. le ministre délégué à l'industrie.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'organisation territoriale de La Poste.
La réduction programmée du fonds postal national de péréquation territoriale, dont les moyens passeraient de 150 millions d'euros à 100 millions d'euros ou 120 millions d'euros, la représentation réduite des maires ruraux dans les commissions départementales de présence postale territoriale sont des premières mesures pénalisantes.
Mais pis ! les élus s'inquiètent surtout de l'avenir des bureaux de poste périphériques, situés autour des bureaux centraux des cantons ou des arrondissements, qui deviendraient, selon le projet TERRAIN, des bureaux secondaires ; en cas de réduction des heures d'ouverture - ce qui est probable -, leurs employés seraient regroupés dans les bureaux centraux et auraient pour tâche d'assurer le service de ces bureaux de proximité en utilisant leur véhicule personnel, sans que leur déplacement soit pris en compte s'il ne répond pas à une obligation professionnelle.
Le projet précité est complété et aggravé par le projet « Facteur d'avenir », modulant le nombre d'agents en fonction du volume du courrier et mettant en place l'autoremplacement des agents. Cette mobilité entraînera certains jours, ipso facto, un manque de personnel dans le bureau central.
Les maires ruraux sont particulièrement alarmés par ces mesures qui leur paraissent être la première marche vers un regroupement total et définitif, c'est-à-dire vers la rétrogradation de leurs propres bureaux de poste en Relais Poste ou en agences postales communales ou, pis encore ! vers leur suppression.
Madame la ministre, il est inutile que je développe le coup que porte ainsi la disparition d'un service public essentiel à l'aménagement du territoire et à la vie économique du monde rural.
Monsieur le sénateur, la loi relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005 a précisé la mission d'aménagement du territoire de La Poste. Ses dispositions s'inscrivent dans un cadre européen, qui prévoit l'ouverture du marché des services postaux en Europe.
La norme d'accessibilité prévue par la loi oblige La Poste à conserver un maillage départemental tel que 10 % de la population d'un département ne se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres des plus proches points de contact de La Poste et ne doive pas effectuer un trajet automobile, dans des conditions de circulation normales, de plus de vingt minutes pour s'y rendre.
Avec plus de 17 000 points de contact, La Poste satisfait, dans la plupart des départements, l'obligation d'accessibilité qui résulte de la loi. Le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 prévoit que les commissions départementales de présence postale territoriale rendent annuellement un avis sur le projet du maillage territorial de La Poste visant notamment à bien vérifier le respect de la contrainte d'accessibilité posée par la loi.
La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a instauré un mode de financement spécifique pour ce maillage territorial, en prévoyant la constitution du fonds postal national de péréquation territoriale. Ce fonds contribue au financement de la mission de présence postale territoriale. Ses ressources proviennent de l'allégement de fiscalité dont La Poste bénéficie, au titre des taxes locales, par le biais d'un abattement de 85 % sur les bases d'imposition. Pour l'année 2006, le montant de cet abattement fiscal est estimé à 136 millions d'euros.
Mais cette obligation d'aménagement du territoire ne fait pas obstacle à ce que La Poste fasse évoluer l'organisation et le statut de ses points de contact, en étroite concertation avec les élus. À cet égard, les agences postales communales constituent une formule adaptée pour assurer le maintien du service public dans les petites communes. Il en existe aujourd'hui plus de 3 000. De même, les 1 200 Relais Poste, qui sont installés chez les commerçants, contribuent également au maintien d'un service postal de proximité, en particulier grâce à des horaires d'ouverture importants.
Pour les communes rurales où l'activité postale est très réduite, les élus et les responsables de La Poste procèdent à une analyse objective, qui tient compte des besoins et des réalités locales. C'est seulement sur la base d'un tel constat partagé qu'il est proposé auxdites communes soit de transformer le bureau concerné en agence postale communale ou en Relais Poste, soit d'en réduire l'amplitude horaire pour l'adapter aux besoins constatés.
Dans leur grande majorité, les élus sont satisfaits de cette adaptation de la présence postale. Selon une enquête réalisée par la SOFRES au mois de juin dernier auprès de 716 maires ayant une agence postale communale ou un Relais Poste dans leur commune, 87 % des élus interrogés se déclarent satisfaits de cette forme de présence postale et prêts à la recommander à d'autres élus.
S'agissant, plus particulièrement, de l'organisation du réseau des points de contact et de son évolution dans l'ensemble des départements, La Poste revoit actuellement l'organisation de son réseau en mettant en place des territoires d'attractivité et d'initiative, les TERRAIN, qui regroupent un ensemble de points de contact - bureaux propres, Relais Poste ou agences postales - permettant une plus grande proximité avec ses clients et une meilleure accessibilité aux offres de produits et de services postaux.
Cette organisation de présence territoriale, dans le respect des obligations d'accessibilité prévues par la loi, s'efforce ainsi de prendre en compte la réalité des besoins et des usages des populations, en particulier dans le monde rural, en recherchant une complémentarité de l'offre de services accessibles dans chaque point de contact.
Ces évolutions sont conduites dans le souci du dialogue avec les élus, en particulier dans le cadre des commissions départementales de présence postale territoriale, confirmées dans la loi relative à la régulation des activités postales, au sein desquelles figure un représentant de l'État chargé, notamment, de veiller au bon déroulement de la procédure d'information et de concertation préalable aux adaptations de la présence postale.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, mais, manifestement, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Vous appréciez la situation au regard de la loi européenne et nationale. Pour ma part, mon analyse s'appuie sur mon expérience d'élu rural sur le terrain.
De surcroît, nos sources sont différentes. Selon vous, 87 % des maires seraient satisfaits des agences communales. J'estime, pour ma part, que le nombre d'insatisfaits est supérieur à celui des satisfaits.
L'agence communale consiste, en quelque sorte, pour une commune, en la perspective de devoir prendre en charge l'agent postal, qui va devenir un agent communal. Même si son salaire est pris en charge en partie par La Poste pendant neuf ans, à l'issue de ce laps de temps, il sera intégralement assumé par la commune.
Quant aux Relais Poste, le transfert du bureau de poste dans un commerce de proximité ne permet pas d'assurer une confidentialité suffisante notamment aux opérations financières réalisées par des personnes âgées. Si le Relais Poste est situé dans le café du coin, tout le pays sera au courant !
Le projet TERRAIN va mettre les maires face à une alternative douloureuse. Ils devront choisir soit d'installer une agence communale, qu'ils devront financer, soit de supprimer le bureau de poste.
Le projet Facteur d'avenir conduit à réduire les équipes de remplaçants et à mettre en place l'autoremplacement au sein des équipes, formule qui ne peut pas satisfaire davantage les postiers. Il prévoit également la modulation du nombre d'agents en fonction du volume du courrier. Les équipes, de ce fait, seront peut-être amenées à travailler moins le lundi et plus le samedi, jour qui serait réservé au traitement des plis publicitaires, parce que les clients seraient, paraît-il, plus disponibles.
La directive instaurant le programme Cap qualité courrier entraîne le regroupement des centres de tri départementaux au sein de grandes plates-formes industrielles de courrier.
Le projet Développement et compétitivité des centres prévoit de supprimer 1 000 emplois par an sur les 18 000 postes des centres régionaux financiers.
La Poste, en tant que service public, obéissant peut-être aux lois européennes, est en train de se désengager et de déserter les campagnes. Dans la Nièvre, resteront à peu près trente bureaux de poste, c'est-à-dire un par canton. Tous les autres seront soit transformés en agence communale, soit supprimés.
Une telle situation ne peut pas satisfaire les maires. Madame la ministre, je le répète, je suis surpris que vous estimiez que 87 % des élus locaux l'approuvent.

La parole est à Mme Catherine Tasca, auteur de la question n° 1170, adressée à M. le garde des sceaux.

Je souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux sur le droit de nos concitoyens à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Cette dernière est fondamentale pour garantir la qualité et l'équité du service public de la justice sur l'ensemble du territoire. Elle ne peut fonctionner sans les moyens adéquats, alors même qu'elle est de plus en plus sollicitée, en raison de l'appauvrissement d'une part croissante de la population.
Hier, nous avons assisté, en moins de deux mois, à la quatrième journée « justice morte », lancée par le principal syndicat de magistrats et par les organisations d'avocats, appelant à une réforme de l'accès au droit et à une revalorisation de l'aide juridictionnelle pour défendre les plus démunis.
Dans le département des Yvelines, les 600 avocats du barreau de Versailles ont signé un texte demandant l'accroissement des moyens financiers. Cet effort paraît urgent et légitime. Par rapport à l'année dernière, pour reprendre l'exemple du barreau de Versailles, on constate une augmentation de 11, 5 % du nombre d'interventions des avocats. En outre, il est incontestable que la qualité de la prestation, que tout justiciable est en droit d'attendre, est aussi liée à une juste rémunération du travail fourni par les avocats.
La Chancellerie s'était engagée, au mois de janvier 2003, à ce que l'indemnisation des avocats soit augmentée de 15 % en 2004, puis de 5 % les années suivantes. C'est donc une hausse de 25 % qui devait être envisagée pour 2006 par rapport à 2003. Cela aurait fait passer la rémunération des avocats de 182 euros à 227 euros pour un dossier représentant 10 à 15 heures de travail. Or, dans le projet de loi de finances pour 2007, l'augmentation prévue n'a été que de 6, 6 %, ce qui a provoqué le découragement de nombreux avocats.
Je suis au regret de rappeler que la France, avec ce retard pris à l'égard des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle, figure parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne en termes d'accès au droit et de répartition équitable de la charge que cela représente.
J'ai bien pris acte que, grâce à la mobilisation de nombreux parlementaires, notamment des sénateurs socialistes du Sénat, l'augmentation a finalement été portée à 8 %. Mais cela paraît encore insuffisant.
Face à ce problème récurrent, je souhaite savoir quelles mesures nouvelles compte prendre M. le garde des sceaux pour permettre un fonctionnement normal et efficace des services de l'aide juridictionnelle, qui est une des conditions de l'égalité entre nos concitoyens et du rétablissement de leur lien de confiance envers la justice, confiance aujourd'hui considérablement entamée pour de multiples raisons, que vous connaissez.
Madame la sénatrice, M. le garde des sceaux ne pouvant être présent ce matin dans cet hémicycle, il vous prie de bien vouloir l'excuser et m'a demandé de répondre à votre question.
Permettez-moi de vous rappeler qu'à la suite du protocole d'accord signé avec la profession des avocats au mois de décembre 2000 plusieurs réformes ont contribué à améliorer la rémunération de l'avocat perçue au titre de l'aide juridictionnelle.
Ainsi, en 2001, le barème de rétribution a été revalorisé dans dix-sept procédures et la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue a été augmentée. L'effort budgétaire de cette réforme a représenté un coût de 56 millions d'euros en année pleine et de manière récurrente.
Par ailleurs, conformément aux objectifs définis pour les professions judiciaires dans la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et à la suite des travaux engagés avec les instances représentatives de la profession d'avocat, au cours desquels il avait été envisagé plusieurs hypothèses de travail, notamment l'augmentation de l'unité de valeur de référence que vous avez évoquée, diverses mesures ont permis d'améliorer les conditions de rémunération des avocats.
Ainsi, le barème de rétribution a été rééquilibré dans une proportion plus importante que celle qui était initialement prévue. Il a également été décidé de revaloriser de 2 % le montant de l'unité de valeur à compter de 2004. Cet effort budgétaire récurrent a représenté un coût de 15, 8 millions d'euros en année pleine.
Soucieux de poursuivre cet effort, M. le garde des sceaux a annoncé, en septembre dernier, l'inscription dans le projet de loi de finances pour 2007 d'une mesure tendant à revaloriser d'au moins 6 % le montant de l'unité de valeur de référence. Conscient des difficultés rencontrées par les avocats, qui le lui font bien savoir, il a émis un avis favorable sur l'amendement parlementaire, auquel vous-même avez fait allusion, lequel visait à accorder une revalorisation supplémentaire de 2 % de ce montant.
Cette revalorisation permettra de porter le montant de l'unité de valeur à 22, 50 euros en 2007. Ainsi, depuis la conclusion du protocole d'accord le 18 décembre 2000, la revalorisation s'élève à près de 12 %, l'effort exceptionnel accompli en 2007 représentant, à lui seul, plus du double de ce qui a été fait pendant les sept années précédentes.
J'ajoute que, pour les aides juridictionnelles totales, cette hausse sera amplifiée par l'effet de la majoration prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le montant moyen de l'unité de valeur s'élèvera donc à 24, 32 euros, et non à 22, 50 euros.
Pour autant, dans un souci de modernisation du dispositif, M. le garde des sceaux a décidé de réunir, le 30 janvier prochain, les Assises de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit. Ce sera l'occasion d'échanger les points de vue avec les représentants de la profession d'avocat sur les niveaux de rétribution à l'aide juridictionnelle, sur la qualité de la défense ou, encore, sur l'assurance de protection juridique.
À cet égard, madame la sénatrice, M. Clément m'a demandé de vous préciser qu'un projet de réforme de l'assurance de protection juridique doit être examiné au Sénat le 23 janvier 2007. Il est prévu de développer cette assurance en faveur, notamment, des classes moyennes, qui, exclues de tout type d'aide juridictionnelle, ne peuvent pas pour autant accéder facilement à la justice.
Enfin, je tiens à le souligner, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dans son rapport publié en 2006, met clairement en avant le fait que, parmi les quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, la France figure aux toutes premières places pour l'importance du budget qu'elle consacre à la justice.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Tout à l'heure, j'ai moi-même pris acte de l'augmentation budgétaire de 8 % en faveur de l'aide juridictionnelle prévue dans le projet de loi de finances pour 2007. Mais, je le répète, cette augmentation, obtenue grâce au Parlement, reste insuffisante eu égard aux engagements de l'État sur cette question, aux retards accumulés ces dernières années et, surtout, à la crise de confiance exprimée par nos concitoyens à l'endroit du service public de la justice. Je note d'ailleurs que vous avez surtout évoqué, vous faisant sans doute le porte-parole de M. le garde des sceaux, les améliorations apportées en la matière avant l'actuel gouvernement.
La réunion des Assises de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit, annoncée par M. Clément pour la fin du mois de janvier prochain, constitue sans doute une contribution utile, mais est loin de répondre aux attentes urgentes et concrètes des professionnels de la justice et de l'ensemble des Français.
J'ajoute que la charge financière de l'aide juridictionnelle est importante non seulement pour les avocats qui acceptent d'intervenir dans ce cadre, mais également pour les ordres qui sont amenés à subventionner le déficit de fonctionnement. À mon sens, le Gouvernement doit réellement prendre conscience du malaise dans lequel sont aujourd'hui plongés nombre de nos magistrats et de nos avocats et qu'a bien illustré la journée d'action largement suivie hier dans toute la France.
Madame la ministre, vous avez justement rappelé les réformes apportées notamment par le gouvernement de Lionel Jospin en 2000 et en 2001. Avec mes collègues du groupe socialiste, je continuerai donc d'être vigilante, à l'avenir, pour que l'État tienne ses engagements et apporte, en matière d'aide juridictionnelle, un renfort qui est aujourd'hui indispensable dans notre pays. Nos concitoyens sont, en effet, de plus en plus nombreux à se retrouver démunis et à ne pas avoir les moyens de défendre justement leurs droits. Au final, ils ont de plus en plus de mal à faire confiance à la justice.
Quant au satisfecit donné à la France sur les moyens dédiés à la justice, il ne peut en aucun cas porter sur le niveau des moyens de l'aide juridictionnelle que nous avons évoqué ce matin.

La parole est à M. Simon Sutour, auteur de la question n° 1171, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une question qui préoccupe vivement la filière viticole du Languedoc-Roussillon, à savoir le nécessaire soutien aux investissements productifs.
En effet, au plus mauvais moment de la crise que subit la filière viticole, et alors que se négocient les contrats de projets et les programmes européens, l'État semble prendre des orientations budgétaires qui ne favorisent pas les investissements productifs. Si cela était confirmé, ce serait une atteinte grave portée à la filière, aux caves coopératives et aux vignerons.
L'adaptation de la filière au marché mondialisé ne peut se faire qu'en privilégiant trois actions importantes : l'investissement en matériels industriels autour de pôles de regroupement, l'appui au développement des entreprises, et le soutien à la conquête de parts de marchés.
Pourtant, dans le cadre des contrats de projets État-région qui engagent l'avenir jusqu'en 2013, l'État se désengage des aides de type POA, la prime d'orientation agricole, en diminuant de 40 % les crédits d'orientation accordés à VINIFLHOR, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture.
Au regard de la situation actuelle de la filière en Languedoc-Roussillon, une telle décision est proprement inadmissible. Il est temps d'arrêter le saupoudrage des aides. Il faut, au contraire, redéployer prioritairement les budgets sur les mesures structurantes. Ce redéploiement est d'autant plus important que, dans le cadre de la réforme de l'OCM vitivinicole, la Commission européenne évoque elle-même le soutien aux investissements. L'État doit donc se mobiliser pour renforcer la position française et mobiliser les crédits européens.
C'est pourquoi je vous demande, madame la ministre, si le Gouvernement compte favoriser le développement autour des outils techniques de vinification et l'accompagnement des investissements commerciaux des entreprises leaders sur leur territoire. Il y va en effet de l'avenir des milliers d'hommes et de femmes qui vivent de la vigne et du vin.
Monsieur Sutour, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Dominique Bussereau, qui assiste actuellement, à Bruxelles, au conseil européen consacré à l'agriculture. S'il n'en avait été empêché, il se serait bien sûr fait un plaisir de répondre directement à votre question, tant il apprécie le Sénat et les sujets concernant la viticulture.
Je suis moi-même ravie de pouvoir vous apporter des éléments de réponse, car il m'arrive souvent, à travers le monde, de représenter la viticulture, notamment celle du Languedoc-Roussillon. Je peux vous l'assurer, dans plusieurs pays, tout particulièrement en Chine, certains viticulteurs de votre région font de très belles choses, et je les admire beaucoup.
Pour autant, la crise que traverse actuellement le secteur viticole nécessite incontestablement une restructuration des outils de vinification. C'est en particulier le cas dans la coopération.
Vous le savez, les modalités de financement de la POA, la prime d'orientation agricole, ont été redéfinies au niveau communautaire. Celle-ci devra notamment être plus ciblée sur des investissements ou sur des unités de dimensions plus restreintes.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement, conscient de l'importance de cette restructuration des outils de vinification, a décidé de mettre en place une enveloppe particulière de 5 millions d'euros, dans le cadre du plan d'ensemble annoncé par M. le ministre de l'agriculture et de la pêche le 29 mars dernier.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, comme vous le savez sans aucun doute aussi, M. le Premier ministre a annoncé le 8 décembre dernier, à l'occasion d'un déplacement en Languedoc-Roussillon, qu'il apporterait un soutien aux entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions du marché. De même, il a lancé une expérience nouvelle de financement des soutiens à l'exportation, en déconcentrant au préfet de région une enveloppe de 2, 5 millions d'euros pour soutenir l'exportation des vins de cette région. Mes services ont d'ailleurs pris contact avec la préfecture de la région pour assurer, dans le cadre d'une vraie stratégie, la bonne coordination des mesures mises en place.
Ainsi, au-delà des aides conjoncturelles importantes pour améliorer la trésorerie des viticulteurs, qu'il s'agisse de la prise en charge d'une partie de leurs cotisations sociales ou de l'imposition à la taxe sur le foncier non bâti, le Gouvernement a également pris en compte les besoins des entreprises, en particulier des coopératives, et a adopté des mesures structurelles devant permettre une véritable adaptation de l'ensemble de la filière viticole, selon les trois axes que vous avez vous-même indiqués.

Madame la ministre, je vous remercie d'avoir bien voulu me communiquer ces éléments de réponse, mais ceux-ci avaient déjà été rendus publics et je les connaissais. La réponse du Gouvernement ne me semble donc pas à la hauteur de l'ampleur de la crise que nous subissons.
Nos viticulteurs, notamment en Languedoc-Roussillon, ont été particulièrement déçus de la visite du Premier ministre. Nous pensions que ce dernier venait dans notre région pour annoncer des mesures importantes. Tel n'a pas été le cas puisqu'il n'a fait que confirmer des dispositions déjà connues.
Au demeurant, madame la ministre, je suis au regret de constater que vous n'avez pas répondu à l'essentiel de ma question : pourquoi l'État se désengage-t-il des aides de type POA, en diminuant de 40 % les crédits d'orientation accordés à VINIFLHOR ? De ce point de vue, c'est malheureusement toujours le même constat qui prévaut.

Madame Lagarde, monsieur Estrosi, avant de passer à la question suivante, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui parmi nous, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de vos collègues. Les membres du Gouvernement doivent faire l'effort de venir devant le Sénat. Certains regretteront de ne pas l'avoir fait davantage...

La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 1159, adressée à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.

Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire, que je remercie de sa présence. Je m'interroge sur le financement des équipements structurants sportifs, qui, dans le cadre du prochain programme FEDER 2007-2013, ne pourraient plus bénéficier des crédits européens.
Ainsi, en région Centre, le projet de programme opérationnel, daté du 19 septembre 2006, ne prévoit de soutenir que quelques équipements structurants dans les domaines du tourisme et de la culture, à l'exclusion des équipements sportifs, qui « ne seront plus financés par les crédits FEDER ».
Cette situation est problématique et ne paraît pas correspondre aux besoins réels des territoires, tout spécialement dans mon département du Cher, qui a absolument besoin de voir son attractivité territoriale améliorée et son image modernisée et corrigée. À ce titre, le développement des équipements sportifs est indispensable. Cette situation est même inquiétante, car des installations sportives sont encore à réaliser, et, sans aide extérieure importante, elles ne pourront être financées.
Or, la réalisation de tels équipements est créatrice d'emplois et d'activités. Cela contribuerait à améliorer la situation du Cher sur les plans économique et démographique, qui est actuellement difficile : ces dernières années, les jeunes adultes ont en effet quitté le département en grand nombre, faute d'attractivité et d'équipements sportifs suffisants.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si ce projet de programme opérationnel est conforme au cadre de référence stratégique national communiqué à Bruxelles. Si oui, pouvez-vous me préciser les possibilités de financement, en l'absence de crédits FEDER, des équipements structurants sportifs dans les années à venir ? En effet, nous le savons très bien, les budgets communaux, départementaux et régionaux ne pourront suffire.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur Pointereau, je partage bien sûr votre sentiment sur l'importance des équipements sportifs dans les territoires ruraux. Nos concitoyens cherchent un équilibre de vie, qui passe, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, par la pratique d'activités sportives. Ce n'est tout de même pas moi qui vous dirai le contraire !
Sourires
S'agissant des moyens dont nous disposons à cette fin, il était possible jusqu'à présent - vous l'avez souligné - d'utiliser les crédits structurels versés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Or les modalités ont changé pour les crédits FEDER de nouvelle génération : ceux-ci ne sont désormais accordés que si les projets concernés s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, autrement dit s'ils visent à améliorer la compétitivité des territoires, le développement durable ainsi que la cohésion sociale et territoriale. Cela signifie que les équipements sportifs n'entrent plus dans ce cadre.
Si la stratégie de Lisbonne interdit le financement des équipements sportifs par le FEDER, il existe, en revanche, à l'échelon national, des outils financiers permettant de soutenir les initiatives des collectivités territoriales à cet égard. Ainsi, ces dernières pourront passer un contrat directement avec le ministère de la jeunesse et des sports, en dehors des contrats de projets État-région en cours de finalisation. Cela signifie notamment que cette contractualisation se fera sur la base de crédits budgétaires venant en complément de ceux des contrats de projets et nous permettra d'intégrer totalement les équipements sportifs.
En outre, dans le cadre des pôles d'excellence rurale que nous avons mis en oeuvre, de nombreux projets comprenant la réalisation d'équipements sportifs ont été retenus. La plupart de ces opérations s'inscrivent dans la dynamique des services à la personne et dans l'accueil de nouvelles populations, et contribuent donc de façon positive à l'aménagement du territoire.
C'est ainsi que, dans le projet de pôle d'excellence rurale de la communauté de communes Vals du Cher et d'Arnon, en pays de Vierzon, que vous connaissez bien, monsieur Pointereau, il est prévu de créer, afin d'augmenter l'attractivité de ce territoire, trois équipements de loisirs culturels et sportifs : un théâtre, une médiathèque et un gymnase. Cet exemple vous démontre que, si les fonds structurels ne peuvent être utilisés pour les équipements sportifs, l'outil financier que constituent les pôles d'excellence rurale s'y substitue pour continuer à aider les territoires ruraux à investir dans des équipements culturels ou sportifs. Ces projets étant la face publique d'un ensemble très cohérent qui comprend, au titre de l'attractivité et du développement des entreprises, de nombreux partenariats privés, il nous a semblé logique de soutenir ces actions dans le cadre des pôles d'excellence rurale.
Par ailleurs, de nombreux projets sont fondés sur l'utilisation d'équipements sportifs en milieu rural, non seulement pour satisfaire les besoins de la population locale, mais aussi pour asseoir le développement économique de ces territoires. Je pense au Mécanopôle de Nogaro, dans le Gers, qui s'appuie sur le circuit automobile Paul Armagnac pour créer un véritable centre de recherches et d'essais industriels destiné aux entreprises liées à la mécanique automobile.
Lorsqu'un territoire est dépourvu d'équipements sportifs mais abrite d'autres activités, notre logique consiste à s'appuyer sur ces dernières, par exemple pour labelliser un pôle d'excellence rurale, et à en profiter pour financer un équipement sportif. En revanche, lorsqu'il existe un équipement sportif, celui-ci doit servir de base au lancement d'activités créatrices d'emplois, notamment d'activités industrielles.
Ainsi, à Nogaro, le circuit automobile était utilisé seulement pour des compétitions sportives. J'ai donc proposé que des industriels, tel Michelin, installent sur ce site des ateliers de recherche et de développement. Telle est la dynamique que je souhaite mettre en place en territoire rural.
Cette logique des pôles d'excellence ruraux que nous avons labellisés a notamment été appliquée à plusieurs projets, dans les Alpes ou les Pyrénées, les collectivités territoriales utilisant leurs installations sportives de pleine nature comme un moyen d'attractivité touristique favorisant l'implantation d'investissements extérieurs importants.
J'évoquerai enfin, tout près du département du Cher, l'implantation, dans la partie solognote du Loir-et-Cher, d'un centre aquatique ouvert à la population locale, qui a permis la construction d'une résidence Pierre et Vacances, investissement de plus de 20 millions d'euros en milieu rural. Il faut souligner ici le soutien sans faille apporté par le Centre national de développement du sport, le CNDS, aux équipements sportifs figurant dans les pôles d'excellence rurale.
Soyez donc rassuré, monsieur le sénateur, quant à la volonté du Gouvernement de soutenir le développement des équipements sportifs dans les territoires ruraux.
J'ai cherché à créer des dynamiques transversales. Nous pouvons désormais compter non seulement sur la Charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural, qui a permis d'imposer des règles du jeu là où régnait la jungle parmi tous les opérateurs de service public, mais aussi sur la nouvelle carte des zones de revitalisation rurale, les pôles d'excellence rurale, le nouveau Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, tel que je l'ai présenté dans le projet de loi de finances pour 2007.
Monsieur Pointereau, je vous sais grand défenseur de la ruralité. Les projets sportifs étaient auparavant largement financés par les crédits européens. Or, à partir du moment où la stratégie de Lisbonne conduit à affecter ces derniers non directement au sport, mais à d'autres projets dans les territoires ruraux, je souhaite, en contrepartie, que nous puissions réaliser des économies sur des lignes budgétaires qui bénéficiaient jusqu'à présent à l'industrie et au développement durable notamment, et les affecter au financement des équipements sportifs.
L'addition des crédits du FEDER pour la compétitivité des territoires, des crédits dégagés sur le Fonds national pour le développement du sport et sur le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, et de la logique des pôles d'excellence permet de créer des synergies propres à stimuler le tourisme, la culture, le sport et l'attractivité des territoires.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Les pôles d'excellence rurale constituent en effet des initiatives très intéressantes pour nos territoires ruraux. Malheureusement, tous les territoires n'ont pas la chance d'en posséder un.
Je souhaite donc que cette politique s'intensifie dans les années à venir, et je salue l'action du Gouvernement en ce domaine.

Bien sûr !
S'agissant des contrats de projet État-région, nous rencontrons dans nos territoires des difficultés pour dialoguer avec les régions. Il est d'autant plus difficile de négocier le financement de tels équipements dans le cadre de contrats de projets État-région que des disparités très fortes existent, au sein même des régions, entre les départements.
Il vous faudra donc peut-être mettre en place une régulation des fonds européens afin d'éviter l'arrosage de plantes qui poussent déjà bien et d'instaurer un mécanisme de compensation au bénéfice des départements les plus défavorisés.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre action, et surtout pour la création des pôles d'excellence rurale.

La parole est à M. Rémy Pointereau, en remplacement de Mme Esther Sittler, auteur de la question n° 1152, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Mme Sittler, qui souffre d'une rage de dent, ne peut malheureusement être présente aujourd'hui.

Monsieur le ministre, Mme Sittler, souffrante, vous prie de bien vouloir excuser son absence et m'a chargé de vous transmettre les éléments de sa question.
Ma collègue souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences du décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 portant modification de la réglementation relative aux rave-parties. Ce décret porte de 250 à 500 l'effectif prévisible de personnes présentes sur le lieu du rassemblement et donnant lieu à obligation de déclaration.
Ce retour en arrière laisse circonspect, d'autant plus que le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 visait à combler les lacunes d'une législation de 1995 fixant ce seuil à 1 500 personnes.
De nombreuses communes rurales du département de Mme Sittler, le Bas-Rhin, ont subi dès cet été les conséquences de ce relèvement de seuil. Ainsi, à Kertzfeld, des rave-parties se sont succédé plusieurs week-ends de suite, avec un niveau sonore important tenant en éveil durant toute la nuit la population de plusieurs villages sur un rayon de dix kilomètres, sans que la gendarmerie puisse intervenir puisque le nombre de participants était inférieur à 500 personnes.
Dans ce type de situation, d'une part, la population n'est nullement informée de la nuisance sonore qu'elle va subir et, d'autre part, le maire se trouve dans l'incapacité d'assurer la tranquillité publique.
Monsieur le ministre, pourriez-vous indiquer à Mme Sittler les raisons qui, dans le contexte actuel - rappelons que Mme la ministre de l'écologie et du développement durable a fait de la lutte contre le bruit une priorité nationale ! -, ont conduit M. le ministre de l'intérieur à relever ce seuil à 500 personnes ? En outre, ne conviendrait-il pas de soumettre l'ensemble des rave-parties à déclaration ? En effet, les nuisances sonores sont bien souvent indépendantes du nombre de participants et le lieu choisi n'est pas toujours suffisamment isolé.
Il semblerait normal que la population puisse au moins être avertie des nuisances qu'elle va subir. Une telle disposition permettrait de concilier la protection des libertés fondamentales et le respect de la tranquillité publique.

M. le président. Comme nous n'avons jamais participé à de telles manifestations, vous allez nous expliquer comment cela marche, monsieur le ministre délégué !
Sourires
Je souhaite à Mme Sittler un prompt rétablissement.
Mme Sittler désire connaître les raisons qui ont conduit le Gouvernement à porter de 250 à 500 personnes présentes sur un lieu de rassemblement de type rave-partie le seuil à partir duquel une déclaration doit être faite en préfecture, conformément au décret du 3 mai 2002 modifié par le décret du 21 mars 2006.
L'État s'est efforcé, depuis 2002, de nouer un dialogue avec les médiateurs du mouvement « techno » qui compte plus de 300 000 adeptes, en majorité des jeunes majeurs - nous pourrions donc en faire partie, monsieur le président !
Sourires
Avant 2002, il n'existait aucune réglementation couvrant ce type de manifestations. Ce vide juridique donnait lieu à d'innombrables difficultés, liées à des envahissements sauvages qui suscitaient la colère, bien compréhensible, des élus locaux. Dans ces conditions, l'État se devait de prendre les dispositions de sauvegarde nécessaires, afin de limiter les risques pour les personnes et les biens, ainsi que les troubles à l'ordre public.
Ainsi, en vertu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et de son décret d'application du 3 mai 2002, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, tels que les rave-parties ou les free-parties, doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, à la salubrité, à l'hygiène et à la tranquillité publiques.
La loi a posé, au travers de cette procédure, le principe d'une concertation entre les pouvoirs publics et les organisateurs de ces rassemblements, avec la finalité d'assurer le bon déroulement de ces derniers. Quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif, il apparaît que des progrès ont été réalisés, permettant de limiter les risques concernant l'ordre public et d'atténuer la mise en cause de l'État, lequel était jusqu'alors accusé à la fois de rester passif face à ces manifestations et de ne rien faire pour accompagner ce qu'une partie de l'opinion considère, à juste titre, comme un phénomène de société.
Toutefois, les grands rassemblements, en particulier les teknivals, continuent de poser des problèmes d'ordre public et peuvent s'avérer très coûteux pour l'État. Au vu de l'expérience acquise sur ce type de manifestations, il apparaît que c'est à partir d'un seuil de 500 personnes que se posent la majorité des problèmes d'ordre public, étant précisé que les rassemblements de moins de 500 participants représentent 85 % des manifestations tenues en 2004.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a entendu éviter que les difficultés d'organisation de rassemblements dont les effectifs sont peu importants ne favorisent un accroissement excessif du nombre de participants lors des grands rassemblements, notamment les teknivals. Tel est l'objet du décret du 21 mars 2006, qui porte de 250 à 500 l'effectif prévisible de personnes présentes sur le lieu de rassemblement à partir duquel une déclaration doit être faite en préfecture.
En ce qui concerne plus particulièrement les rassemblements signalés par Mme Sittler, qui se sont tenus récemment dans la commune de Kertzfeld et ses environs, je peux vous apporter les précisions suivantes.
Sur la commune de Kertzfeld, une soirée rave s'est tenue dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 hors agglomération, dans une clairière, à l'intérieur d'un champ privé. Rassemblant une centaine de personnes venues à bord d'une quarantaine de voitures, elle a donné lieu à l'intervention de la compagnie de gendarmerie de Sélestat, qui a pris contact avec les organisateurs présumés, fait baisser le volume de la sonorisation et relevé les immatriculations des véhicules.
Sur les communes avoisinantes, plusieurs soirées se sont tenues ces derniers mois. À Kogenheim et à Obenheim-Sand, les gendarmes sont intervenus, au cours de soirées qui réunissaient moins de 100 personnes, pour faire baisser la sono et relever les immatriculations des participants.
À Osthouse, deux soirées rave ont été organisées dans les nuits du 17 au 18 septembre 2006, puis du 23 au 24 septembre 2006. La première, rassemblant 150 personnes, a donné lieu à un procès-verbal pour occupation illicite et dégradations légères. La seconde, rassemblant 240 personnes venues à bord de 80 véhicules, a provoqué l'évacuation du site par 20 militaires et le contrôle de 105 personnes.
Je tiens à assurer Mme la sénatrice que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, et ses services sont conscients de la gêne que peut constituer, pour une population locale, rurale et paisible, ce genre de manifestations impromptues. Toutefois, dans la mesure où le nombre de participants a été régulièrement inférieur à 250, vous conviendrez que le relèvement du seuil réglementaire obligatoire à 500 participants a eu peu d'effet sur la situation locale.
J'ajoute enfin que, même si un rassemblement n'est pas soumis à l'obligation de déclaration en préfecture, ses organisateurs ne sont en rien exonérés de fait des obligations et responsabilités qui sont les leurs, conformément au droit commun, y compris sur le plan pénal, qu'il s'agisse de l'occupation illicite d'une propriété privée ou des nuisances sonores. Il en va ainsi des rave-parties comme de tout autre type de rassemblement festif susceptible de se tenir dans une commune.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces éléments de réponse que je transmettrai à Mme Sittler.
Cet été, un teknival, qui s'est déroulé dans le Cher, a coûté fort cher à l'État, et une rave-partie a eu lieu dans ma commune. Nous connaissons donc un peu les problématiques de ce genre de manifestations qui mettent en émoi les populations, les maires et les agriculteurs. Il faudra un jour soit y mettre un terme, soit trouver des lieux dédiés, tels des aérodromes désaffectés ou des terrains militaires, en tout cas des zones à faible population, comme le Larzac, par exemple, où José Bové serait peut-être d'accord pour accueillir ce type de rassemblement !
Sourires

La parole est à M. Rémy Pointereau, en remplacement de M. Bruno Sido, auteur de la question n° 1162, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, M. Sido, retenu dans son département, vous prie de bien vouloir l'excuser et m'a chargé de vous transmettre les éléments suivants.
L'épidémie de fièvre catarrhale ovine et bovine touche dix-sept départements du nord-est de la France, dont le département de la Haute-Marne. Avec cette nouvelle crise sanitaire, les éleveurs de ces départements ont fait office de « boucliers sanitaires » afin de protéger l'ensemble de l'élevage français, conformément aux directives européennes.
Pour répondre au plus vite aux inquiétudes de la profession, le Gouvernement, dès le 2 octobre, a mis en oeuvre un premier dispositif d'aide au maintien des veaux et des broutards dans le périmètre de protection en dégageant une enveloppe exceptionnelle de 1, 5 million d'euros.
Toutefois, la complexité de ce dispositif, l'exclusion de certains animaux, dont les bovins reproducteurs, les ovins et les caprins ont limité l'impact de cette mesure chez les éleveurs touchés par cette crise. J'en veux pour preuve que, sur les 1 000 éleveurs haut-marnais situés dans la zone réglementée, 55 dossiers ont été déposés à ce jour !
Le 10 novembre, de nouvelles mesures ont été annoncées par le Gouvernement à destination des agriculteurs en difficulté. Un fonds d'allégement de charges de 1 million d'euros a été mis en place. Néanmoins, cette aide exige un taux de spécialisation de 50 %, taux bien trop élevé et mal adapté à l'agriculture haut-marnaise située en « zone intermédiaire », porteuse des spécificités de polyculture-élevage que vous connaissez bien.
Enfin, le 7 décembre, à Sarreguemines, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche a annoncé un plan d'indemnisation des éleveurs avec l'octroi d'une nouvelle enveloppe de 7, 5 millions d'euros, ces mesures venant en complément des mesures précédemment annoncées. Une nouvelle fois, certains animaux, comme les bovins reproducteurs et les ovins, semblent être exclus de cette mesure. Cette filière ovine et ses coopératives spécialisées sont depuis longtemps marginalisées dans cette crise, et M. Sido avait appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur ce point dès le 13 novembre.
Si les mesures annoncées depuis le début de la crise sont certes importantes, ce que la profession reconnaît très aisément, elles sont malheureusement ternies par leurs circulaires d'application qui compliquent ces différents dispositifs et les rendent trop sélectifs.
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est, à de nombreuses reprises, engagé avec force et détermination en faveur de la simplification administrative. Sur le terrain, toutes les mesures annoncées ne sont pas comprises du fait de leur complexité.
À toute cette confusion administrative s'ajoute la difficulté liée à l'application du plafond de minimis de 3 000 euros par exploitation, qui risque en réalité de ruiner tout espoir d'indemnisation pour la quasi-totalité des élevages du département de la Haute-Marne, lourdement touché par la sécheresse de 2003.
Il faut souligner, de surcroît, la non-application de la transparence dans les groupements d'exploitation en commun, les GAEC, telle qu'elle a été inscrite dans la dernière loi d'orientation agricole et reconnue récemment par Bruxelles.
Aussi, et malgré cette série de mesures, de nombreuses inquiétudes subsistent pour l'avenir. La profession souhaite une méthode de compensation simple, rapide et équitable, fondée sur une aide forfaitaire pour les animaux dont la commercialisation a été pénalisée par rapport à la situation normale du reste du territoire. Les éleveurs touchés par cette crise veulent non pas une aumône, mais une indemnisation correcte et un plan d'action avec des échéances pour s'organiser et se projeter dans l'avenir.
Monsieur le ministre, cette situation sanitaire et épidémiologique française semble aujourd'hui maîtrisée. Face à toutes ces incertitudes et ces inquiétudes, la profession, qui espère retrouver au plus vite une situation normale, souhaiterait enfin connaître les prévisions et les règles sur le statut saisonnièrement indemne afin d'ouvrir une fenêtre de commercialisation avant l'été 2007.
Pouvez-vous, sur toutes ces questions, nous préciser les mesures administratives et financières envisagées par le Gouvernement pour prendre en compte les pertes des éleveurs se trouvant dans cette zone réglementée ?
Monsieur le sénateur, la confirmation des foyers français de fièvre catarrhale ovine, ou FCO, a conduit le Gouvernement à mettre en place des zones réglementées et des mesures sanitaires pour les cheptels infectés. Des zones de protection et de surveillance ont également été mises en place. La situation sanitaire relative à la fièvre catarrhale ovine est stable en France, avec six foyers. La période hivernale, notamment la baisse des températures, permet de réduire les risques de transmission de la maladie.
L'action du Gouvernement a toujours consisté à faciliter l'activité économique locale tout en maintenant un haut niveau de protection pour éviter la diffusion de la maladie à de nouvelles régions d'élevage.
Compte tenu des avis scientifiques et du droit communautaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de permettre plus largement l'abattage d'animaux hors des zones réglementées, et élargi progressivement le champ des dérogations aux interdictions de mouvements des animaux. Sont ainsi possibles, sous certaines conditions, la sortie des périmètres interdits vers la zone de protection ainsi que les passages de la zone de protection vers la zone de surveillance, avec des protocoles variant suivant les types d'animaux et leur utilisation.
L'adaptation des mesures sanitaires se poursuit. L'inactivité vectorielle constatée ces derniers jours sur le terrain par des piégeages d'insectes permet désormais de fusionner les zones de protection et de surveillance en une zone réglementée unique, redéfinie sur la base des cantons au lieu des arrondissements. Cela permet de libérer de toute contrainte environ quatre-vingt-quinze cantons.
Il est possible aussi, pour plus de lisibilité dans les mesures sanitaires, d'indiquer dès à présent que la sortie des animaux vers le reste du territoire national pourra se faire sous conditions dès le 15 janvier 2007, après un dépistage favorable, et, dès le 15 février 2007, sans test préalable.
Les protocoles de dérogation aux mouvements des animaux seront bien sûr simplifiés pendant la période hivernale du fait de l'absence des insectes vecteurs de la maladie. Les mesures sanitaires seront réexaminées au printemps en fonction de la reprise de l'activité de ces insectes et de la situation épidémiologique au regard de cette maladie.
Sur le plan économique, les difficultés de commercialisation des viandes bovines et ovines provenant des zones réglementées créent une baisse de prix des animaux maigres, en particulier du broutard, par rapport aux autres régions.
Comme l'a rappelé M. le Premier ministre le 10 novembre dernier en Haute-Saône, le Gouvernement sera aux côtés des éleveurs dans cette crise sanitaire. Les éleveurs, tout particulièrement les éleveurs naisseurs des périmètres interdits - dans les Ardennes, l'Aisne, la Meuse et le Nord -, ont subi des pertes en raison de la baisse des cours de veaux de huit jours et de broutards. Les commerçants en bestiaux ont une activité réduite.
Les organisations de producteurs, les abattoirs et les entreprises de sélection en génétique subissent aussi des perturbations importantes. Un premier dispositif d'aide au maintien des veaux et des broutards dans le périmètre de protection a été mis en oeuvre dès le 2 octobre, dans le cadre d'une enveloppe de 1, 5 million d'euros.
Ce premier dispositif constitue une indemnisation des pertes pour les éleveurs ayant conservé leurs animaux sur l'exploitation. Les éleveurs peuvent déposer une demande d'aide dans le cadre de ce premier dispositif jusqu'au 31 décembre prochain. Le Gouvernement a décidé de compléter ce dispositif par des mesures immédiates de soutien en trésorerie.
Des reports et des prises en charge tant des cotisations de la Mutualité sociale agricole que des intérêts bancaires sont mis en place pour les éleveurs en difficulté dans les dix-sept départements réglementés.
Les coûts d'analyses, de visites vétérinaires et de tests pour les mouvements des animaux provenant des périmètres interdits, prévus dans le cadre des dérogations, seront pris en charge. Ils concernent notamment les béliers reproducteurs. Les coûts de chômage partiel seront pris en compte à 80 % pour les entreprises du secteur.
Enfin, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche a annoncé le 7 décembre dernier, lors d'un déplacement à Sarreguemines, en Moselle, que les éleveurs des zones réglementées pourront prétendre à une indemnisation des pertes de chiffre d'affaires constatées entre le ler septembre et le 30 novembre 2006 pour les veaux de huit jours, les broutards, les broutardes et les animaux de race allaitante.
Ce soutien spécifique aux éleveurs sera plafonné à 3 000 euros dans le cadre du régime de minimis. Il tiendra compte du nombre d'animaux vendus par l'exploitant au cours de cette période passée. Une enveloppe de 7, 5 millions d'euros sera réservée à cette action. Conscient que le plafond du régime de minimis n'offre pas de solutions satisfaisantes pour permettre l'indemnisation directe des pertes des éleveurs, le ministre de l'agriculture et de la pêche a adressé un mémorandum à la Commission européenne pour permettre la mise en place de mesures exceptionnelles.
Ces dispositions témoignent de la ferme volonté du Gouvernement d'accompagner les différents maillons des filières bovines et ovines dans leurs difficultés actuelles.

M. le président. Monsieur Pointereau, le sénateur issu du bitume que je suis tressaille de joie en apprenant ces nouvelles, qui doivent vous satisfaire...
Sourires

La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach, auteur de la question n° 1185, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ma question s'adressait à M. Bussereau, mais je suis ravi qu'il y soit répondu par l'un des ministres les plus sportifs du Gouvernement, même s'il est plus proche des chevaux-vapeur que des équidés... (Sourires.)
Ma question concerne les règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles, plus particulièrement des centres équestres et des clubs hippiques.
Selon la réglementation en vigueur, les centres équestres sont assimilés à des exploitations agricoles, et donc soumis, me semble-t-il, au règlement sanitaire départemental, qui impose aux bâtiments agricoles nouvellement construits des distances d'éloignement par rapport aux habitations déjà existantes.
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, dans sa réponse à une question écrite de Mme le député Marie-Jo Zimmermann - cette réponse a été publiée au Journal officiel du 31 janvier dernier - a rappelé que le même éloignement s'impose aux habitations nouvelles par rapport aux bâtiments existants.
Monsieur le ministre, pourriez-vous me confirmer que la règle de l'éloignement et ce principe de réciprocité prévus pour les bâtiments agricoles proprement dits s'appliquent également aux carrières d'entraînement dépendant d'un centre équestre ou d'un cercle hippique ? Je souligne à cet égard qu'il s'agit d'espaces ouverts permettant l'évolution des chevaux, et que la concentration et l'activité des équidés en ces lieux sont susceptibles d'entraîner des troubles de toute nature.
A contrario, ces éventuels troubles à la tranquillité recherchée à juste titre par les habitants des constructions nouvelles édifiées à proximité de ces centres, notamment des aires d'évolution des chevaux, peuvent être source de manifestations et de réclamations de nature à nuire à l'exploitation normale des centres équestres concernés.
Monsieur le sénateur, la filière équine m'intéresse au plus haut point. J'ai ainsi fait labelliser un pôle de compétitivité sur la filière équine en Normandie, ainsi que plusieurs pôles d'excellence rurale. Ce domaine constitue en effet, à mon sens, un élément fort d'attractivité et d'aménagement du territoire.
Avec le vote de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'ensemble des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ont été reconnues comme des activités agricoles, à l'exception de celles qui relèvent du spectacle. Ainsi, la définition agricole est étendue notamment aux entraîneurs de chevaux, aux activités de débourrage et de dressage, aux centres équestres, aux cavaliers professionnels, aux activités de traction hippomobile.
Cette mesure permet une harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales pour les entreprises de la filière cheval ; elle offre des règles claires, compréhensibles et transparentes. Avec ses conséquences notamment fiscales, elle favorise la création d'emplois pour les territoires ruraux.
S'agissant des règles de constructibilité, les carrières d'entraînement d'un centre équestre ou d'un cercle hippique ne sont pas soumises à permis de construire, ni même à déclaration de travaux, car elles ne sont pas considérées comme des constructions au sens des règles d'urbanisme.
De ce fait, les dispositions de l'article L.111-3 du code rural relatives aux règles dites de la réciprocité des bâtiments d'élevage ne concernent pas les carrières d'entraînement.
De la même façon, les centres équestres ne relèvent pas de la réglementation relative aux installations classées.
En revanche, ils peuvent être concernés par les règlements sanitaires départementaux. En effet, ces règlements peuvent édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique. Ils peuvent donc éventuellement réglementer l'éloignement des constructions des centres équestres, telles que les box ou les manèges, la règle de réciprocité étant alors applicable.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de la qualité et de la précision de votre réponse, même si celle-ci ne va pas dans le sens que je souhaitais...

La parole est à M. Gérard Delfau, auteur de la question n° 1166, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication, qui est aujourd'hui à Bruxelles.
Ce sera donc M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, qui vous répondra, mon cher collègue.

Le Gouvernement est un, monsieur le président !
Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de donner une place à l'expression de la famille de pensée rationaliste et humaniste dans les grilles de programme de l'audiovisuel public, au titre de la liberté de conscience, de la laïcité, principe de notre Constitution, ainsi que du respect du pluralisme d'expression des courants d'opinion.
En effet, comme la loi le prévoit, un temps d'antenne est réservé aux émissions religieuses et à l'expression « des principaux cultes en France », notamment dans le cadre du service public de la télévision, sans pour autant donner aux familles de pensée rationalistes l'opportunité d'y présenter, à leur tour, leur approche philosophique, alors qu'elles représentent un nombre considérable de Français et qu'elles sont les héritières directes de ceux qui fondèrent la République sur la base de la séparation des Églises et de l'État, en 1905.
La laïcité - et les valeurs qu'elle porte depuis les Lumières - n'a jamais été autant d'actualité : lutte en faveur des droits des femmes et contre toute forme de discrimination, place de l'école publique au coeur du système éducatif, garantie de la liberté de conscience pour les croyants, comme pour les athées, agnostiques ou indifférents, affirmation de l'humanisme contre la toute-puissance de l'argent sont autant de chantiers urgents et pour lesquels la laïcité demeure facteur de paix civile, de non-discrimination et d'égalité entre citoyens.
Or le service public de l'audiovisuel est l'un des outils à la disposition de la République pour réaffirmer ce rôle central de la laïcité, en donnant la parole à toutes les familles de pensée, sans exception. C'est pourquoi je demande quelles initiatives, par le biais d'un projet de loi, de recommandations aux chaînes publiques ou par tout autre biais, M. le ministre de la culture et de la communication compte prendre pour que soit réservé dans l'audiovisuel public un temps d'antenne régulier à l'expression des familles rationalistes et humanistes, en somme à toutes les formes de libre pensée, au même titre qu'à l'expression des représentants des cultes et religions.
Monsieur le sénateur, permettez-moi d'abord de vous transmettre les excuses de mon collègue Renaud Donnedieu de Vabres, qui est retenu ce matin à Bruxelles pour la promulgation, avec le président de la Commission européenne, de la charte pour la diversité.
Vous évoquez dans votre question l'une des propositions formulées dans le rapport, datant de 2003, de la commission présidée par M. Bernard Stasi, proposition qui visait à « donner aux courants libres penseurs et humanistes rationalistes un accès équitable aux émissions télévisées de service public ».
Certains programmes de l'audiovisuel public apportent une réponse satisfaisante à la question que vous soulevez. À titre d'exemple, France Culture permet ainsi l'expression des différents courants agnostiques, athées, rationalistes ou maçonniques dans le cadre de son émission hebdomadaire Divers aspects de la pensée contemporaine.
Comme vous le rappelez, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait obligation, en son article 56, à la société France 2 de programmer le dimanche matin des émissions à caractère religieux. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants des cultes.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition que les « principaux cultes pratiqués en France ». Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, la pensée rationaliste ne peut être considérée comme en faisant partie.
Une modification de la loi serait donc nécessaire pour accéder à votre proposition et accorder un temps d'antenne régulier à l'expression des familles rationalistes et humanistes.
Si nous partageons bien naturellement votre attachement à la laïcité, nous estimons qu'une telle modification soulèverait d'importantes difficultés.
Cette proposition pose d'abord des problèmes pratiques considérables. Le nombre de courants de pensée se rattachant à l'expression rationaliste et humaniste est en effet beaucoup trop important pour que les chaînes publiques, compte tenu de leurs impératifs de programmation, puissent leur accorder à tous des temps d'émission égaux.
Cette proposition pose ensuite des problèmes juridiques très difficiles tenant à la définition précise de ces courants de pensée permettant d'en réglementer l'accès aux antennes, à supposer la première difficulté résolue.
C'est pour ces raisons que, depuis 1986, le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion est garanti par d'autres moyens. En dehors, naturellement, des dispositions spécifiques permettant l'expression des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles, la réglementation actuelle renvoie à la responsabilité éditoriale des chaînes publiques le soin d'assurer le respect de l'expression du caractère pluraliste des courants de pensée.
Il s'agit donc non pas d'imposer la diffusion de tels programmes produits sous la responsabilité de tiers, mais de veiller au respect de cette expression au nom de la programmation naturelle de ces chaînes, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, instance de régulation indépendante.

Monsieur le ministre, si j'ai choisi de vous interpeller ce matin à propos du respect du pluralisme dans l'audiovisuel public, c'est non seulement pour attirer votre attention sur le fait que ce principe ne reçoit pas sa pleine application, mais aussi parce que le grand maître du Grand Orient de France, qui, parmi d'autres, est à l'origine de cette interrogation, s'est, comme vous préconisez de le faire dans votre réponse, déjà adressé en décembre 2005 au président de France Télévisions, M. de Carolis, mais n'a pu, malgré des courriers répétés, obtenir de réponse que le 4 octobre 2006.
Il a donc fallu, et je le regrette, pratiquement un an pour que le responsable de la chaîne publique daigne répondre à cette requête alors que cette dernière émanait d'une structure dont la représentativité est unanimement reconnue. Je pense d'ailleurs que, s'il y a finalement eu une réponse, c'est parce qu'entre-temps le ministre de culture et de la communication a manifesté, par une démarche adéquate, le souhait qu'il y en ait une.
Ma question vise à pousser un peu plus loin le débat. Au passage, il me paraît particulièrement opportun de vous la soumettre alors qu'est aujourd'hui promulguée une charte de la diversité à l'échelle européenne, qui trouvera sans doute là l'une de ses possibles applications.
Je me fonderai sur deux éléments : le premier, c'est la recommandation du rapport Stasi, qui est souvent repris dans ses grandes lignes, par le Gouvernement notamment ; le second, c'est que cette question, comme vous l'avez dit vous-même, a déjà reçu un début de réponse dans le cadre de France Culture.
Notre préoccupation, monsieur le ministre, est que France 2 puisse offrir le même pluralisme à cette famille de pensée. Or, puisque c'est possible dans le cadre de France Culture, c'est forcément possible dans le cadre de la chaîne publique de télévision ! Je n'argumenterai pas davantage, mais les problèmes d'organisation et les aspects juridiques que vous évoquez ne sauraient entraver l'application du principe de laïcité et de liberté des consciences, principe qui s'étend à l'ensemble des Français, qu'ils soient agnostiques, athées, indifférents ou croyants.
Votre réponse, vous vous en doutez, monsieur le ministre, ne me satisfait pas, et je pense que la solution relève non pas de la loi, mais d'un consensus qui doit être mis en oeuvre à partir d'une discussion largement conduite. Je reviendrai donc sur ce dossier, car il me semble que, sur ce plan au moins, notre démocratie reste imparfaite.

La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 1139, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences financières qui découlent pour les petites communes rurales des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et du décret n° 86-425 du 12 mars 1986, qui définissent les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune.
Ainsi, ces dispositions permettent aux parents de scolariser leurs enfants hors de leur commune de résidence dans plusieurs cas : soit la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, soit l'état de santé de l'enfant le nécessite, soit les parents ont des obligations professionnelles qui ne leur laissent pas d'autres possibilités. Enfin, si les parents ont scolarisé un enfant, frère ou soeur, dans une autre commune que celle de leur résidence, la dérogation est de droit pour les autres enfants. La plupart des coûts qui résultent de cette situation dérogatoire sont alors à la charge de la commune de résidence.
Monsieur le ministre, je suis parfaitement conscient que cet article de loi avait été initialement prévu pour pallier les difficultés ou les contraintes rencontrées par certaines familles. Malheureusement, les budgets des petites communes pâtissent de plus en plus de ce dispositif. Régulièrement, je suis interpellé par des maires, qui ne comprennent pas toujours qu'ils doivent payer pour un enfant scolarisé dans une autre commune que la leur, surtout lorsque la somme due est importante, et qui le comprennent d'autant moins qu'ils doivent encore participer aux charges de fonctionnement de leurs propres bâtiments scolaires.
Bien souvent, ils se sont battus avec ténacité pour conserver, rénover ou agrandir leurs établissements scolaires. Ces travaux, importants pour leurs budgets, n'ont qu'un seul but : doter la commune d'infrastructures permettant d'accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions. Je prendrai l'exemple significatif d'une commune de mon département, Marcilly-le-Châtel, où des enfants ont obtenu des dérogations pour être scolarisés à Savigneux. Or, le coût d'un élève à Marcilly-le-Châtel est de 450 euros alors que le coût d'un élève à Savigneux est de 640 euros...
Les élus n'oublient pas que la présence de classes et la qualité des cours sont souvent des critères déterminants pour les parents dans la décision de s'installer sur tel ou tel territoire. Mais aujourd'hui, non seulement les dérogations appauvrissent notablement les communes en grevant les budgets, mais encore le coût différentiel qui en résulte pénalise les enfants et les parents qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants là où ils résident.
Tout cela contribue à accélérer la fermeture des classes dans les petites communes rurales et le regroupement des élèves dans les écoles importantes des grandes villes. Il paraît évident que de plus en plus de familles qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne essayent de profiter de ce système : elles ont ainsi les avantages de la campagne mais inscrivent leurs enfants dans des établissements scolaires urbains, souvent réputés de meilleur niveau. Je suis tenté de dire que c'est un détournement de la carte scolaire !
Or - on ne le répétera jamais assez - l'attractivité et la vie de nos villages dépendent considérablement du nombre d'enfants qui y sont scolarisés !
En conséquence, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître votre avis sur ce sujet et savoir s'il n'est pas possible, à tout le moins, de réformer ce dispositif de telle sorte qu'un enfant scolarisé dans une commune d'accueil ne coûte pas plus cher que s'il était inscrit dans sa commune de résidence.
Monsieur le sénateur, vous avez très bien décrit la situation, et je n'y reviendrai pas.
Je voudrais simplement vous faire observer qu'un certain nombre de dispositions ont été prises justement en faveur de la commune de résidence.
En premier lieu, le calcul de la contribution financière de la commune de résidence tient compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves qui sont scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux activités périscolaires ; les dépenses d'investissement sont donc exclues de la répartition.
À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et, si le montant de la contribution demandée par la commune d'accueil est trop élevé par rapport aux ressources de la commune de résidence, le préfet peut la diminuer.
En second lieu, l'article L. 212- 8 du code de l'éducation, dans sa rédaction modifiée par l'article L. 113 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, prévoit des dispositions tendant à réduire la contribution financière de la commune de résidence, cette dernière n'étant tenue de participer financièrement que dans des cas limitativement énumérés.
S'agissant des fermetures d'écoles ou de classes, je tiens à affirmer que, outre les données démographiques et sociales, les données territoriales, dont la ruralité fait partie, sont bien prises en compte dans la répartition interacadémique des moyens d'enseignement et d'encadrement pédagogique.
Cette méthode a été utilisée pour répartir les emplois inscrits au budget de 2006. C'est ainsi que 1 000 emplois ont été attribués à l'enseignement du premier degré pour faire face, notamment, à l'augmentation des effectifs d'élèves et pour préserver le maillage des écoles sur le territoire national.
Le maintien, l'amélioration et le développement de la présence des services publics en milieu rural sont autant d'éléments qui constituent l'un des axes de la politique d'aménagement du territoire du Gouvernement. Tel est, en tout cas, l'objectif fixé par la charte sur l'organisation de l'offre des services publics en milieu rural signée le 23 juin 2006 entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs des services publics. Cette charte met d'ailleurs particulièrement l'accent sur la nécessité de « rechercher toutes les formules de mutualisation et de regroupement » et d'assortir tout projet de réorganisation du service public d'une amélioration de sa qualité.
Monsieur le sénateur, je puis vous assurer que c'est exactement dans cette perspective que les inspecteurs d'académie préparent la rentrée de 2007.

Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, de votre réponse assez précise.
Toutefois, je ne vous cacherai pas que je reste un peu sur ma faim, tant l'inquiétude ressentie par les maires de certaines petites communes rurales, dont je viens de me faire l'écho, est importante. En effet, ces élus ruraux trouvent illogique d'avoir à supporter, pour des enfants inscrits dans un établissement situé à l'extérieur de leur commune de résidence, un coût plus élevé que celui qu'ils devraient payer si l'enfant était scolarisé sur place.
Il y a là une espèce d'injustice sur laquelle il conviendra de réfléchir et dont nous devrons rediscuter ultérieurement.

La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, auteur de la question n° 1160, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le ministre, je souhaite ici évoquer le manque de moyens humains, matériels et financiers de la médecine scolaire en France, plus particulièrement, en Haute-Vienne.
Ce département, qui comptait l'an dernier douze médecins scolaires, n'en a plus que huit aujourd'hui. Quatre d'entre eux sont titulaires, dont un à temps partiel ; deux sont vacataires à temps plein ; un est vacataire à mi-temps ; quand au médecin scolaire conseiller technique auprès de l'inspection académique, il n'est pas sur le terrain. Cela correspond en fait à 5, 8 postes équivalents temps plein.
En un an, quatre postes de vacataires ont été supprimés, contre plus de 300 au niveau national au cours des deux dernières années. La Haute-Vienne comptant plus de 56 000 élèves, il n'y a donc qu'un seul médecin scolaire pour plus de 7 000 élèves, soit un pour 9 000, si l'on raisonne en termes de postes équivalents temps plein.
Si la situation n'est, certes, pas aussi catastrophique que dans un certain nombre de départements où il n'y a qu'un médecin scolaire pour plus de 10 000 élèves, il reste qu'elle s'est considérablement dégradée en un an.
Comme bon nombre de leurs collègues, les médecins scolaires haut-viennois ne sont plus en mesure de remplir de manière satisfaisante l'ensemble de leurs missions.
Ainsi, faute de temps, seulement 60 % des élèves de grande section de maternelle ou de cours préparatoire passent la visite médicale pourtant obligatoire entre cinq et six ans, contre quelque 75 % des enfants sur le plan national.
Monsieur le ministre, la médecine scolaire manque cruellement de moyens.
Faute de crédits suffisants, l'informatisation des services est abandonnée et les frais de déplacements ne sont pas toujours remboursés. Alors qu'aucune création de poste n'a eu lieu depuis 2004, la loi de finances pour 2007 n'en prévoit seulement qu'une dizaine pour toute la France, ce qui, j'insiste, est très insuffisant.
En effet, près de 80 postes sont à ce jour non pourvus et plus de 30 sont vacants à la suite de départs à la retraite ou de mutations.
Tandis que les missions des médecins scolaires se multiplient et qu'il est question de visites de contrôle plus fréquentes au cours de la scolarité, les moyens alloués à la médecine scolaire sont en baisse depuis trois ans. Cela n'est pas acceptable, monsieur le ministre.
Je souhaiterais donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour maintenir un service public de la médecine scolaire répondant aux exigences définies par le législateur sur l'ensemble du territoire, plus particulièrement en Haute-Vienne.
Monsieur le sénateur, afin de réduire le nombre de médecins en situation précaire intervenant en milieu scolaire ou dans le domaine de la santé scolaire, j'ai prévu, pour la période 2006-2008, l'organisation d'un concours ouvert aux médecins titulaires ou non titulaires de la fonction publique, y compris les contractuels ou vacataires exerçant au sein de l'éducation nationale et justifiant de trois ans au moins de service public effectif, ou de l'équivalent temps plein accompli au cours des huit années précédentes pour les médecins vacataires.
Ce dispositif permettra de maintenir une partie des médecins non titulaires exerçant au sein de l'éducation nationale et de garantir la pérennité des actions de santé scolaire, grâce à la réduction des effectifs en situation précaire. Le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement organisés en 2006 est ainsi de 111 postes.
Par ailleurs, il convient de noter qu'à compter du 1er janvier 2006 les crédits de vacations des médecins de l'éducation nationale sont désormais inscrits au titre 2 du programme « Vie de l'élève ». Cela signifie qu'ils sont globalement délégués aux recteurs au sein de la masse salariale du budget opérationnel de programme académique qui leur est alloué.
Il appartient donc à chaque recteur de mettre en place les crédits destinés à la prise en charge des vacations de médecin scolaire, compte tenu à la fois des priorités éducatives nationales et des situations locales.
Je ne doute pas que les autorités académiques, prenant en compte le voeu exprimé en matière de médecine scolaire par le conseil général de la Haute-Vienne, lors de sa réunion du 30 octobre dernier, réserveront une attention particulière à la situation des personnels de santé et des personnels sociaux, notamment à celle des médecins scolaires exerçant dans ce département.
En outre, le projet de budget pour 2007 prévoit, dans le cadre de la mission « Enseignement scolaire », la création de 300 nouveaux postes d'infirmières scolaires et de 50 assistantes sociales. Je me suis engagé à ce qu'une partie de ces créations de postes soit consacrée au renouvellement et à la consolidation de postes de médecins scolaires. L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, confirmée par le Sénat, tendant à créer 10 postes de médecins scolaires vient d'ailleurs renforcer cet engagement, monsieur le sénateur.

J'entends bien ce que vous me dites, monsieur le ministre.
Toutefois, les postes mis au concours ne permettront que de titulariser des contractuels, ce qui n'augmentera pas le nombre de médecins scolaires.
Par ailleurs, étant donné la faiblesse des moyens dont dispose l'éducation nationale depuis que vous êtes au pouvoir, les crédits destinés à la médecine scolaire, s'ils sont délégués aux recteurs, serviront de variable d'ajustement pour les budgets rectoraux.
Dès lors, je ne vois pas très bien comment les recteurs pourront augmenter le nombre de médecins scolaires.
En conséquence, monsieur le ministre, je suis au regret de constater que la médecine scolaire figurera toujours, si cette politique est poursuivie, parmi les parents pauvres de l'éducation nationale !
Franchement, monsieur le sénateur, cette conclusion hâtive, même si elle a le mérite d'être concise, est erronée.
En effet, en prenant des mesures en faveur des médecins en situation précaire, l'on crée des vocations. À ce titre, monsieur le sénateur - je vous réponds en ces termes, puisque vous adoptez un ton polémique -, il convient, me semble-t-il, de remédier à la situation précaire de certains personnels que nous a laissée le gouvernement précédent !
Pour ma part, je préfère, et de loin, titulariser certains de ces médecins. Ainsi, naît une vraie vocation avec de réelles perspectives.
Quant au second point, pénétrez-vous de la LOLF pour en constater tout l'intérêt, notamment en matière de fongibilité, en vue de répondre aux besoins du terrain. Or qui mieux que les inspecteurs connaissent ces besoins et sont en mesure d'y répondre ? À cet égard, la fongibilité permet précisément d'apporter de vraies réponses.

Certes, mais le Gouvernement peut s'exprimer quand il le veut, alors que nous sommes, nous, soumis au règlement. Par conséquent, je suis désolé de vous refuser la parole en cet instant, mais je suis dans mon droit.

La parole est à M. Paul Girod, auteur de la question n° 1180, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ma question s'adressait à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, mais, étant donné qu'il ferraille en ce moment même à Bruxelles pour défendre nos pêcheurs, je vous remercie, monsieur de Robien, de bien vouloir m'apporter les éléments de réponse qu'il vous a tranmis.
Dans l'Aisne - cela touchera sans doute le Picard que vous êtes et que je suis d'ailleurs aussi ! -, trente-cinq communes réclament que l'on revienne sur la suppression de l'appellation « champagne » qui leur avait été opposée en 1905 et 1930. Elles demandent, en conséquence, le reclassement d'un certain nombre de ces communes appartenant aux cantons de Braine et Vailly.
Au mois de mars dernier, j'avais déjà adressé une question à M. le ministre de l'agriculture pour lui demander où en était ce dossier, puisque rien ne bougeait. Il m'avait répondu au mois de juillet, de manière fort intéressante d'ailleurs, mais cette réponse était surtout d'ordre administratif, puisqu'il me décrivait toute la procédure, que je connaissais tout de même un peu ! Quant à sa conclusion, il s'agissait pratiquement de la transmission d'un accusé de réception de l'Institut national des appellations d'origine sur le sujet.
Or, aucun progrès n'ayant encore été réalisé en novembre, je me suis permis de réitérer ma question afin d'obtenir des explications complémentaires sur l'état d'avancement de ces travaux.
Je suis ravi de savoir depuis le mois de juillet que l'INAO a reçu le dossier, mais j'aimerais que vous me disiez, monsieur le ministre, comment il le traite et selon quel calendrier.
Je vous remercie par avance des éclaircissements que vous pourrez m'apporter à ce sujet.
Monsieur Girod, comme j'aime vous entendre vanter les qualités et les mérites de la Picardie et affirmer votre appartenance à cette région en même temps que votre attachement à ses produits à travers les appellations d'origine contrôlée !
Comme vous le savez, les procédures de définition des conditions de production des appellations d'origine contrôlée, les AOC, dont fait partie l'aire géographique de production, sont définies par le code rural. Il appartient ainsi à l'Institut national des appellations d'origine de proposer les conditions de production des AOC, qui font ensuite l'objet d'une homologation par décret.
Concernant en particulier la révision de l'aire géographique de production des AOC Champagne et Coteaux Champenois, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO a nommé une commission d'experts, composée d'universitaires en histoire, en géographie, en géologie, en phytosociologie et en botanique, ainsi que d'un ingénieur agronome.
C'est à partir du travail de cette commission que sera définie l'aire géographique. La commission d'experts présentera au comité national de l'INAO le projet d'aire géographique ainsi défini sur la base de critères objectifs. Ensuite, le projet de la nouvelle aire, qui aura été approuvé par l'INAO, sera soumis à enquête afin de permettre aux intéressés, le cas échéant, de déposer des réclamations. Les experts examineront ces dernières et proposeront pour approbation l'aire géographique définitive au comité national de l'INAO qui, en application des dispositions législatives et réglementaires, demandera son homologation par décret.
Cette procédure n'est autre que celle qui est fixée par le code rural pour toutes les appellations d'origine. Elle constitue, pour les professionnels, la garantie de l'indépendance du fonctionnement de l'INAO.

Je donne acte à M. le ministre de la réponse qu'il a bien voulu m'apporter.
Cela étant dit, tout en reconnaissant volontiers que la procédure se déroule, je regrette un peu que M. le ministre n'ait pas pu me donner d'indication quant aux dates auxquelles elle devrait aboutir, car tout cela est assez long.
Autant que je sache, la fameuse commission évoquée a été mise en place au mois de mars dernier. Or, lorsque l'on analyse les perspectives, il est difficile de déterminer clairement la date à laquelle tout cela devrait se terminer, surtout compte tenu de la période de réclamations, d'objections et d'observations...
Nous sommes presque au début de l'année 2007. Or, si tout pouvait être terminé à la fin de l'année 2008, la situation serait encore convenable compte tenu de l'évolution des choses. Il faut en effet planter, lancer les vignobles, ce qui est assez long.
En conséquence, monsieur le ministre, pourriez-vous demander à M. Dominique Bussereau de bien vouloir nous confirmer que l'année 2008 sera la date butoir pour le règlement de ce problème ?

La parole est à Mme Adeline Gousseau, auteur de la question n° 1182, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la difficulté que rencontre l'association EndoFrance à faire reconnaître l'endométriose par les pouvoirs publics et le corps médical.
Je vous rappelle ainsi que la première description histologique de cette maladie douloureuse et handicapante a été faite en 1860. Cette dernière touche aujourd'hui près de 10 % des femmes en âge de procréer et induit des maladies auto-immunes, endocriniennes et atopiques, aux répercussions psychologiques très lourdes.
Quelques éléments sont reconnus comme des facteurs de risque : une part héréditaire - le risque de développer une endométriose est sept fois plus élevé chez les soeurs des femmes atteintes que dans la population générale -, un environnement riche en dioxines, des anomalies enzymatiques, des cellules endométriales, des malformations utérines acquises ou innées.
De plus, il s'agit d'une maladie évolutive, aux symptômes souvent difficilement identifiables en raison d'un déficit initial de formation des médecins et du grand public. En effet, cette maladie demeure très largement méconnue, n'étant abordée qu'en seconde année de médecine, souvent de manière très superficielle, d'ailleurs.
En outre, cette pathologie recèle une difficulté supplémentaire : elle ne concerne que les femmes en période d'activité génitale, et les principaux symptômes conduisant au diagnostic d'endométriose ne sont pas spécifiques à la maladie : algoménorrhée, douleurs pelviennes, dyspareunies profondes, douleurs rectales, hémorragies, stérilité. Dès lors, le traitement est hormonothérapique, dans les formes mineures, ou chirurgical, dans les formes majeures, qui surviennent parfois en raison des difficultés diagnostiques précitées.
Ces problématiques ont conduit les parlementaires à prendre en compte l'endométriose dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cette pathologie gynécologique est ainsi citée parmi les cent objectifs figurant dans le rapport annexe à la loi et pour lesquels ont été définis, en juin 2005, des indicateurs de suivi.
Par ailleurs, le comité de pilotage du plan relatif à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques a veillé à ce que soient intégrées, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, l'attention clinique nécessaire au diagnostic et la dimension humaine en matière de qualité de vie, deux éléments indispensables à la prise en charge optimale de ces personnes.
Néanmoins, de nombreux efforts restent à fournir en vue de renforcer l'information à destination du corps médical et des adolescentes et afin de prévenir, dès l'apparition des premiers symptômes, les éventuelles évolutions liées à ce type de pathologie. Je tiens en particulier à souligner la nécessité de mettre en place une véritable politique de prévention à l'égard de cette maladie.
En conséquence, monsieur le ministre, où en est actuellement la prise en charge de cette pathologie ? Quelles actions le Gouvernement entend-il mener à l'avenir pour la reconnaître davantage et pour mettre en oeuvre une véritable politique de formation et de traitement d'une pathologie trop souvent méconnue parce que simplement confondue avec les naturelles perturbations liées aux cycles féminins ?
Madame le sénateur, permettez-moi de vous répondre au nom de Xavier Bertrand.
L'endométriose est effectivement une affection gynécologique dont le diagnostic clinique est souvent difficile et tardif. Les symptômes sont multiples et dépendent plus de la localisation des lésions que de leur étendue. Cette affection peut être très douloureuse pour les femmes et conduire malheureusement à l'infertilité, d'où l'importance de son diagnostic le plus précoce. C'est pourquoi les actes diagnostiques d'imagerie - échographie ou imagerie par résonance magnétique -, et thérapeutiques, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux - la cystectomie partielle ou l'hystérectomie -, sont pris en charge par l'assurance maladie.
Par ailleurs, cette affection figure parmi les cent objectifs de santé publique mentionnés dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, de sorte que la proportion de traitements conservateurs soit augmentée et que la qualité de vie des femmes atteintes de cette pathologie en soit ainsi améliorée.
En outre, les traitements médicamenteux de l'endométriose génitale ont fait l'objet d'une recommandation de bonne pratique en 2005 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui a jugé bon d'insister sur des critères tels que l'âge, le syndrome douloureux et l'infertilité. Cette bonne pratique a pour objet une meilleure stratégie thérapeutique, évaluée au cas par cas, pour chaque patiente.
Xavier Bertrand doit annoncer prochainement la prise en compte, dans le plan national stratégique pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, de l'ensemble des pathologies chroniques dans l'endométriose afin d'améliorer notamment les connaissances épidémiologiques de ces mêmes pathologies. Comme vous le souhaitez, il s'agit tout d'abord de mieux former les professionnels de santé au repérage et à la prise en charge continue des pathologies et douleur chroniques, puis de développer l'éducation à la santé et thérapeutique et, enfin, de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des malades.
À ce titre, en 2005, les services de M. Xavier Bertrand ont reçu les représentants de l'association EndoFrance. À cette occasion, ils ont proposé à ces derniers de préparer un projet, en vue d'atteindre lesdits objectifs d'information, pouvant recevoir le soutien du ministère de la santé. Par mon intermédiaire, ces mêmes services renouvellent cette proposition pour l'année 2007.
Comme vous le voyez, madame le sénateur, le Gouvernement est très attentif et agit pour une meilleure prise en charge de ces maladies.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre réponse. Je pense qu'un grand pas a déjà été fait en faveur de ces malades. Je tiens tout de même à insister sur la formation du corps médical et sur la nécessité d'un diagnostic très précoce.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.