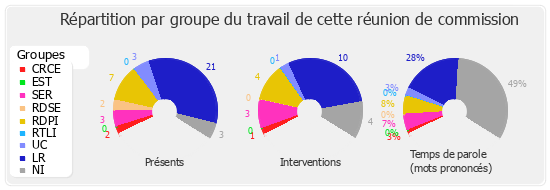Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 28 janvier 2015 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. christian eckert secrétaire d'état au budget sur les résultats de l'exercice 2014 (voir le dossier)
- Pouvoirs de sanction des régulateurs financiers
- Audition conjointe de m. rémi bouchez président de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution mme marie-anne frison-roche professeur des universités à l'institut d'études politiques de paris m. gérard rameix président de l'autorité des marchés financiers m. jean-luc sauron conseiller d'état délégué au droit européen du conseil d'état ainsi que mme corinne bouchoux sénatrice ancienne rapporteure au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois (voir le dossier)
La réunion

Nous recevons Christian Eckert pour la traditionnelle audition sur l'exécution de l'exercice précédent, que nous tenons chaque année fin janvier ou début février.
Il est précieux pour la commission des finances d'entendre le secrétaire d'État au budget en ce début d'année et alors que l'actualité, la plus immédiate et la plus dramatique, est riche en événements pouvant avoir des conséquences budgétaires. Je pense aux annonces de la semaine dernière sur le renforcement des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme.
Je pense aussi, dans un tout autre domaine, aux conséquences des élections en Grèce sur les programmes financiers mis en oeuvre par les pays européens depuis 2010.
Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, parce qu'il en est encore temps, une bonne année 2015. Nous sommes dans la saison des voeux, qui appelle à se projeter sur les douze prochains mois : pour ce faire, il est utile d'avoir les idées claires sur ce qui précède. Je suis donc heureux de répondre à votre invitation ce matin et je m'attacherai à répondre aux questions qui sont les vôtres.
La tradition veut qu'en début d'année, le ministre du budget vienne devant le Parlement présenter les premiers résultats de l'exécution. Cet exercice me semble présenter un double intérêt : d'abord, vous rendre compte avec la plus grande précision possible des données dont nous disposons maintenant sur l'exécution budgétaire ; ensuite, mettre les faits en perspective avec la politique que nous menons depuis 2012. Je rappelle que les comptes de l'État ne seront définitivement arrêtés qu'en avril, en vue de la loi de règlement : de légers ajustements ne sont pas à exclure par rapport aux chiffres que je m'apprête à commenter.
Je commencerai par présenter les résultats obtenus en matière de maîtrise de la dépense de l'État. Sur le champ de la norme de dépenses en valeur, qui comprend les dépenses du budget général de l'État et les prélèvements sur recettes, hors charge de la dette et hors contribution aux pensions des fonctionnaires, les dépenses seront inférieures de 121 millions d'euros à l'objectif de dépense, de façon cohérente avec la dernière loi de finances rectificative de fin d'année. Elles s'élèveront en effet à 276,9 milliards d'euros. Les comparaisons avec le passé sont à ce titre nécessaires, mais elles posent la question du point de repère choisi : certains ne comparent qu'avec la loi de finances initiale, je voudrais pour ma part mettre l'exécution 2014 en regard de l'exécution 2013. Les dépenses ont ainsi, en exécution, baissé de 3,3 milliards d'euros : il s'agit bien d'une diminution des dépenses en valeur, ou comme pourraient le dire certains, « en euros de ma grand-mère », c'est-à-dire en vrai euros, et non par rapport à une tendance ou à une prévision. Sur le champ de la norme de dépenses en volume, soit les dépenses du budget général, les prélèvements sur recettes, la charge de la dette et les pensions, la diminution est encore plus importante puisqu'on observe une baisse de 4 milliards d'euros par rapport à l'exécution 2013 à périmètre constant. À notre connaissance, cette réduction de la dépense de l'État sur le champ des normes n'a pas de précédent depuis la création de ces normes en 2003. Nous avons eu l'occasion de débattre longuement cet automne des questions de tendanciel de la dépense et de modalités de calcul des économies ; les résultats que je vous livre aujourd'hui ne font référence à aucun indice tendanciel d'évolution de la dépense mais se fondent bien sur une comparaison d'exécution à exécution.
Il faut également rappeler que l'année 2014 constituait le troisième budget que le Gouvernement a eu à exécuter : quel bilan pouvons-nous dresser de notre action sur la dépense de l'État depuis 2012 ? Hors éléments de dépenses exceptionnels, la dépense a diminué entre 2011 et 2014. Sur ces trois années, les dépenses des ministères ont ainsi baissé de 3,2 milliards d'euros, et compte tenu de la modération des taux d'intérêt qui résulte de notre situation économique et financière mais qui traduit aussi la crédibilité de notre politique, la charge de la dette a diminué de 3,1 milliards d'euros. Ces baisses sont supérieures à la dynamique des prélèvements sur recettes et des pensions, ce qui explique que la dépense totale de l'État a été en 2014 inférieure de 1,8 milliard d'euros à celle de 2011. Là encore, il ne s'agit pas d'une économie calculée en tendanciel, mais bien d'une comparaison d'exécution à exécution. C'est la traduction des efforts importants réalisés par les ministères pour être toujours plus efficients. Ces économies ont permis de dégager des moyens pour financer les priorités du Gouvernement : c'est bien à cela que servent aussi les économies, pouvoir renforcer les secteurs que nous jugeons cruciaux pour notre économie. Depuis 2012, des emplois ont été créés dans l'éducation, la justice, la police et la gendarmerie. C'est un investissement, à l'origine d'une légère hausse de 250 millions d'euros de la masse salariale en 2014, à hauteur de 0,3 % hors charge de retraite. Nous assumons cette augmentation, financée par des économies sur d'autres dépenses de l'État. Depuis 2012, ont également été menées plusieurs opérations extérieures, dont le coût total pour 2014 a dépassé le milliard d'euros. Ces dépenses ont été financées par redéploiement au sein des ministères. Ont enfin été augmentés le nombre des contrats aidés, de services civiques, et les minima sociaux ont été relevés dans le cadre du « Plan pauvreté ». Toutes ces actions, nous les finançons en réalisant des économies par ailleurs.
En matière budgétaire, la réalité ce sont les chiffres, et les chiffres sont incontestables : en 2014, la dépense de l'État a diminué, par rapport à 2013 mais aussi par rapport à 2011. Pour autant, nous avons mobilisé les ressources nécessaires à notre politique.
S'agissant des recettes de l'État, nous avions constaté dans le courant du mois d'août, comme vous le savez, une dégradation de la situation macro-économique caractérisée notamment par une inflation très basse, ce qui nous avait conduits à réviser les prévisions de recettes dès le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. Ces prévisions ont été ajustées à la marge par la loi de finances rectificative de fin d'année. Par rapport à cette dernière prévision, nous constatons une plus-value de 2 milliards d'euros sur les recettes fiscales nettes. L'impôt sur le revenu (IR) s'établit à 69,2 milliards d'euros, en plus-value par rapport à la dernière loi de finances rectificative de 925 millions d'euros. Concernant l'impôt sur les sociétés (IS), il devrait s'élever à 35,3 milliards d'euros en 2014, soit une hausse de 764 millions d'euros par rapport à la même référence. Cela laisse penser que le bénéfice fiscal a été supérieur aux prévisions. Le coût budgétaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), devrait quant à lui être en ligne avec les prévisions, autour de 6 milliards d'euros - bien qu'il faille noter que l'étalement de la créance sur trois ans, notamment pour les plus gros contribuables, créé une dissymétrie entre le montant de la créance fiscale et celui de la dépense budgétaire. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) atteindrait 138,4 milliards d'euros, en augmentation de 678 millions d'euros par rapport aux prévisions.
L'examen plus détaillé et l'analyse plus fine de ces résultats seront établis à l'occasion du projet de loi de règlement. Il est d'ores et déjà possible d'affirmer que nos prévisions de recettes étaient prudentes, et la plus-value qui s'esquisse est une bonne nouvelle pour les finances publiques. Elle ne doit cependant pas nous détourner des efforts entrepris en matière de maîtrise de la dépense, qui constituent la condition d'un assainissement durable de nos finances publiques.
Au total, le déficit de l'État devrait donc s'établir à 85,6 milliards d'euros, soit une amélioration de 3,4 milliards d'euros par rapport aux prévisions de la dernière loi de finances rectificative. Par rapport à 2013, si l'on déduit les 12 milliards d'euros de versements aux opérateurs du programme d'investissements d'avenir (PIA), le déficit est réduit de 1,3 milliard d'euros, de 73,6 milliards contre 74,9 milliards d'euros. Le déficit public agrège déficit de l'État, déficit de la sphère sociale et déficit des collectivités territoriales : les résultats sont encore en cours de consolidation et devraient être connus de façon définitive autour de la mi-mars.
Tels sont les premiers éléments d'exécution du budget de l'État. Des résultats depuis 2012 ont été obtenus en matière budgétaire et cet exercice le prouve à nouveau. Ceci doit nous encourager à poursuivre l'assainissement de nos comptes publics : il s'agit d'apurer les déficits accumulés par notre pays depuis plus de trente ans.

Merci pour cette présentation de l'exécution du budget 2014. Je prends acte de la maîtrise des dépenses pour 2014.
Ma première question porte sur les dépenses et, en particulier, sur les crédits de personnel. En effet, à l'automne, le Gouvernement a pris un décret d'avance à hauteur de 327 millions d'euros pour l'enseignement scolaire et la défense, ce qui est assez classique. Cependant, des annulations de crédits ont eu lieu en fin d'année pour un montant significatif, plus de 500 millions d'euros, au titre des crédits de titre 2 sur les missions « Enseignement scolaire » et « Défense ». Pourriez-vous nous en expliquer les raisons ? S'agit-il d'une difficulté de calibrage initial des dépenses de personnel ? Serait-ce lié à des créations de postes dans l'éducation qui n'ont pas eu lieu ?
Ma deuxième question porte sur les recettes fiscales, et concerne notamment l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. En effet, par rapport à la loi de finances initiale, une moins-value d'environ 10 milliards d'euros est constatée. Avez-vous pu identifier les principales causes expliquant ces écarts de prévision ? Cela est-il imputable, par exemple, à un problème conjoncturel lié à la situation économique ou à une difficulté pour estimer le poids des mesures nouvelles et les changements d'attitude des acteurs économiques, en matière d'impôt sur le revenu notamment ?
Ma dernière question relative à l'exercice 2014 porte sur le CICE. Le comité de suivi du CICE fait état d'une faible consommation fiscale de ce crédit d'impôt. Les estimations initiales prévoyaient un montant de 10 milliards d'euros fin 2014. Or, en septembre, 5,2 milliards d'euros seulement ont été consommés. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cet écart ?
Enfin, s'agissant de l'exercice 2015, le Bureau de la commission des finances a souhaité travailler de manière transversale sur la question du logement. Le Gouvernement et la Cour des comptes rappellent régulièrement l'importance de ce sujet tant en termes de dépenses fiscales que budgétaires. Vous avez annoncé récemment le lancement de revues de dépenses ainsi que la remise d'un rapport au Parlement avant le 1er mars 2015 sur les résultats de ces revues. Pourriez-vous préciser le calendrier de ces revues de dépenses ainsi que les thèmes retenus au titre de ces travaux ?

On ne peut que se réjouir, comme l'a dit le rapporteur général, de la maîtrise de la dépense publique qui est indispensable pour la réduction du déficit. Cependant, cette maîtrise de la dépense qui permet une exécution meilleure que prévu dans la dernière loi de finances rectificative pour 2014 est-elle principalement due à une réduction des dépenses de fonctionnement ou l'effort porte-t-il surtout, comme cela est le cas depuis trop longtemps, sur l'investissement, avec les difficultés que cela peut poser à l'avenir ?
Ma deuxième question a trait à la charge de la dette. Vous avez indiqué que la charge de la dette avait diminué de 3,1 milliards d'euros entre 2011 et 2014. Pourriez-vous nous indiquer le montant de ce « gain » par rapport à ce qui était attendu dans le projet de loi de finances ? En d'autres termes, pourriez-vous préciser le montant imputable à la baisse des taux d'intérêt ?
Enfin, s'agissant des recettes, vous n'avez pas évoqué la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Dispose-t-on d'éléments permettant de mesurer la corrélation avec l'évolution de l'activité économique et la baisse du prix des produits pétroliers ?

Au nom d'un certain nombre de nos collègues, je souhaiterais exprimer notre satisfaction devant l'énoncé de ce résultat pour 2014 qui montre que la politique suivie, qui n'est ni une politique d'austérité ni une politique laxiste, commence à porter ses fruits en matière budgétaire. Les critiques sont nombreuses, mais quand les résultats sont au rendez-vous, il me semble important de les souligner. Ma première question est à la fois budgétaire et économique et traduit des questionnements et des inquiétudes qui me semblent largement partagés. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les perspectives de croissance de la France ?
Ma deuxième question porte sur les conséquences de la parité euro, dollar, franc suisse. En effet, la parité dollar-euro est une question importante pour nos importations et nos exportations. Celle entre l'euro et le franc suisse intéresse particulièrement le Sénat, dans la mesure où un nombre important d'emprunts contractés par les collectivités territoriales a été libellé en francs suisses. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les conséquences attendues de ces évolutions et les mesures envisagées par le Gouvernement pour y répondre ?

Vous nous avez indiqué que, sur la période 2011-2014, la baisse des dépenses s'était élevée à 3,2 milliards d'euros au total. Vous nous avez ensuite rappelé que la charge de la dette avait diminué sur cette même période de 3,1 milliards d'euros. Pourriez-vous nous préciser si ce montant est compris dans les 3,2 milliards d'euros ?
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la dernière loi de finances rectificative pour 2014, qui est intervenu mi-décembre, vous nous avez présenté des prévisions de recettes considérées comme « prudentes ». Or, on constate une recette d'impôt sur le revenu supérieure de près d'un milliard d'euros à ces prévisions. Dans la mesure où les déclarations sont transmises avant la mi-juin, je souhaiterais que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles les services fiscaux ne sont pas en mesure de prendre ces éléments en compte. S'agirait-il de redressements qui interviendraient en fin d'année ?
Enfin, je souhaiterais savoir quelle est la part des 12 milliards d'euros d'investissements d'avenir consacrée à la défense nationale.

Est-il possible d'évaluer le montant de ce surcroît de recettes imputable à la lutte contre la fraude ? De manière plus prospective, la France va devoir rembourser un milliard d'euros d'aides à l'agriculture. Si cela est confirmé, pourriez-vous nous préciser sur quel exercice ce remboursement aura lieu et avec quel financement ? Enfin, la possibilité du dépôt d'un projet de loi de finances rectificative au printemps à la suite des recommandations définitives de la Commission européenne sur le budget 2015 est souvent évoquée ; pourriez-vous nous indiquer si cela sera le cas ?
Concernant les crédits de personnels, le rapporteur général a évoqué la réalisation d'inscriptions puis d'annulations de crédits. Il s'agit d'une opération assez technique, qui porte sur 500 millions d'euros. Les ouvertures de crédits, un plus larges que nécessaires, étaient indispensables afin de ne pas avoir de difficultés à honorer les salaires au mois de décembre - en la matière, la prudence s'impose. C'est pourquoi, sur les deux postes que vous avez évoqués, l'enseignement scolaire et la défense, nous avions des prévisions confortables, mais nous avons ensuite procédé à l'annulation ce qui était excédentaire. Nous avons en effet constaté des économies, parfois liées à des postes non pourvus, et en conséquence des annulations de crédit ont été réalisées début janvier.
S'agissant des recettes fiscales, il faut noter que la loi de finances pour 2015 prévoit une inflation de 0,9 %, mais que celle-ci sera très probablement inférieure à ce niveau. Les conséquences de cette moindre inflation en matière de recettes sont simples : elle engendre mécaniquement une plus grande difficulté pour atteindre le niveau de recettes attendu, notamment s'agissant de la TVA. Pour l'impôt sur le revenu, celui-ci étant perçu avec une année de décalage, il sera probablement moins impacté par une faible inflation en 2015.
En matière de dépenses, l'effet d'une inflation faible est contraire et tend à desserrer la contrainte budgétaire pour les ministères. Dans la mesure où les différents acteurs calculent souvent les économies par rapport à un tendanciel, une inflation plus faible que prévu tend à minorer les économies réalisées si aucune correction n'intervenait pour prendre en compte ce contexte macro-économique nouveau. Nous sommes en train de travailler sur cette question, notamment dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2016. De même, la baisse du prix du pétrole implique de moindres dépenses pour les ministères. Mais il est difficile, même pour un secrétaire d'État au budget volontariste, de dire à des ministères, à qui un certain niveau de dépense a été autorisé, que des annulations de crédits vont être effectuées car les dépenses sont moins importantes que prévu.
Ainsi, nous devons convaincre l'ensemble des acteurs de la sphère publique qu'une faible inflation nécessite des ajustements en matière budgétaire.
Pour revenir à votre question sur les prévisions de recettes, s'agissant de l'impôt sur les sociétés par exemple, la situation de telle ou telle grosse entreprise peut fortement influer sur le montant du dernier versement de l'année. Il y a ainsi eu ces derniers mois des versements très supérieurs à ce qui était attendu.
S'agissant de l'impôt sur le revenu, son plus faible rendement qu'attendu s'explique notamment par le faible niveau enregistré au titre des revenus immobiliers, en termes de plus-values notamment, qui ont été très largement inférieures à ce qui était prévu. Ils avaient augmenté de 30 % en 2012 et ont chuté de moitié en 2013. Les mesures nouvelles, et en particulier la réduction d'impôt exceptionnelle d'1,3 milliard d'euros approuvée en loi de finances rectificative, ont également pesé. Il y a également un effet base de l'exécution 2013 qui mécaniquement, par report, dégrade l'exécution 2014.
Nous sommes en train d'analyser plus finement et plus précisément les causes de ces mouvements par rapport aux prévisions.
Sur le CICE, je rappelle que les entreprises qui paient l'impôt sur les sociétés peuvent déduire le CICE de l'impôt qu'elles ont à payer, et que celles qui n'en payent pas, car elles n'ont pas de résultats suffisants pour être taxées, perçoivent quant à elle un crédit d'impôt. La créance totale accumulée, dont le montant prévisionnel était de 12 milliards euros la première année, se décompose ainsi en une dépense budgétaire, qui est d'environ 6 milliards d'euros, en ligne avec nos prévisions, et une dépense fiscale. Nous sommes aujourd'hui face à une créance accumulée de 11 milliards d'euros, proche de la prévision qui avait été établie.
Il y a des entreprises qui ne demandent pas le CICE mais cela ne veut pas dire qu'elles ne le demanderont pas à l'avenir, étant donné que ce crédit d'impôt est récupérable sur trois ans. Certaines entreprises, pour diverses raisons, comme par exemple le cumul avec d'autres crédits d'impôt ou des raisons techniques, n'ont pas encore demandé à bénéficier du CICE. Ceci explique que les prévisions faites n'aient pas été révisées à la baisse.
Concernant le logement, il s'agit d'une des priorités du Gouvernement dans le cadre de ses réflexions sur la revue des dépenses. La France consacre un peu plus de 40 milliards d'euros, soit environ 2 % de son PIB, à soutenir le logement sous diverses formes : des dépenses fiscales, c'est-à-dire des réductions d'impôt, qui sont très nombreuses, des aides à la pierre, des taux réduits de TVA de 5,5 % pour le logement social et de 10 % pour le logement intermédiaire, des allocations logement versées aux locataires voire aux propriétaires. Nous sommes l'un des pays qui consacre le plus d'argent au logement en part de PIB. Or nous sommes aussi l'un des pays où le logement, aussi bien à l'accession qu'à la location, est le plus cher, ce qui pèse sur notre compétitivité. Nous devons donc réfléchir très fortement sur cette question, pas seulement pour faire des économies, mais aussi afin d'être davantage efficients. Il faut toutefois tenir compte du fait que nous sommes un pays dont la population augmente, ce qui rend la problématique du logement particulière, par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne, où la population diminue. En outre, la part de l'immobilier dans le patrimoine des français est très importante. La question du logement nous paraît donc cruciale et nous serons, bien attendu, attentifs à toutes les propositions que vous pourrez faire à ce sujet.
Pour répondre à Michel Bouvard, la charge de la dette était de 44,9 milliards d'euros en 2013 et de 43,2 milliards d'euros en 2014, ce qui représente une baisse d'1,7 milliard d'euros d'exécution à exécution. S'agissant de la TICPE, son exécution est globalement en ligne avec les prévisions de la loi de finances rectificative, en légère moins-value de 100 millions d'euros. Nous sommes en train d'analyser l'effet que pourrait avoir la baisse du prix du pétrole sur le rendement de cette taxe.
En réponse à la question de Jean Germain, je rappelle que le Gouvernement ne remet pas en cause, à ce stade, sa prévision de croissance pour l'année 2015, qui est de 1 %. Vous observez comme moi les prévisions diverses et variées qui fleurissent plusieurs fois par mois : nous sommes en ligne avec ces prévisions, et ne sommes donc pas inquiets. Il existe en revanche une vraie interrogation sur l'effet de l'inflation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Quant à la parité euro-dollar, nous nous réjouissons bien sûr de la situation actuelle, qui peut avoir un effet tout à fait bénéfique sur les exportations de la France - d'autant que cette situation s'ajoute à la baisse du prix du pétrole, qui évite un renchérissement de la facture énergétique.
La crise du franc suisse a des effets divers. Les travailleurs transfrontaliers n'en sont probablement pas fâchés... Pour ce qui est des emprunts toxiques, j'aurai l'occasion d'y répondre de façon plus approfondie demain à l'occasion de deux questions d'actualité. C'est un sujet qui préoccupe le Gouvernement, et je rappelle qu'il touche des collectivités locales mais aussi des établissements publics, notamment hospitaliers. Nous sommes, avec le ministre des finances, en train d'évaluer les choses. Une certaine stabilité est nécessaire, car l'évolution de la situation a été très brutale, et se calme aujourd'hui avec un retour du franc suisse à un niveau - légèrement - moins élevé. Je ne veux pas avancer des chiffres qui seraient répétés, déformés et amplifiés, mais ce sont plusieurs milliards d'euros qui sont en jeu - dans une fourchette comprise entre un et dix milliards d'euros. Un fonds de sortie de 1,5 milliard d'euros sur quinze ans a été créé, soit 100 millions d'euros par an : comment adapter son utilisation à la nouvelle donne ? Certains emprunts sont affectés par la nouvelle parité du franc suisse, et d'autres non. Pour certaines petites collectivités, la situation est proprement insupportable, tandis que d'autres peuvent plus facilement absorber le choc, même si cela reste difficile. Avec les responsables du Fonds, nous sommes en train d'étudier les propositions qui peuvent être faites. Nous travaillons avec la société de financement local (SFIL), et nous recevrons les associations d'élus. Le fonds est ouvert jusqu'à fin avril pour les collectivités qui souhaiteraient y faire appel. Nous aurons à ce moment-là des évaluations plus précises, afin d'adapter la doctrine à la nouvelle donne. Ce travail est en cours, il serait difficile d'en dire plus à ce stade.
En réponse à la question de Vincent Delahaye, je confirme que les 3,2 milliards d'euros de diminution de dépenses des ministères s'ajoutent bien aux 3,1 milliards d'euros de diminution de la charge de la dette. Toutefois, d'autres dépenses sont plus dynamiques, notamment les dépenses exceptionnelles et les pensions. Les chiffres vous seront communiqués et nous reviendrons au cours des futurs débats sur les prévisions de recettes.
En réponse à la question d'André Gattolin, je rappelle que le Gouvernement remettra bientôt un rapport détaillé sur la lutte contre la fraude. Le bon fonctionnement du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) a été souligné à plusieurs reprises, et les réalisations correspondent aux prévisions. Le Parlement a adopté, à l'initiative du Gouvernement, une disposition qui oblige à un versement dans les six mois qui suivent le dépôt du dossier : nous espérons que ceci permettra d'accélérer les choses. En effet, sur les 35 000 dossiers déposés à ce jour, nous en traitons seulement 5 000 ou 6 000 par an : outre la question des moyens humains, c'est la complexité des dossiers qui est en jeu. Ceux-ci donnent lieu à de nombreux échanges et corrections, afin notamment de distinguer les fraudeurs « actifs » des fraudeurs « passifs ».
La part du ministère de la défense dans le programme d'investissements d'avenir (PIA) est de 2 milliards d'euros en 2014, soit 1,5 milliard d'euros en loi de finances initiale, 250 millions d'euros en première loi de finances rectificative et 250 millions d'euros en seconde loi de finances rectificative.
Le remboursement des aides agricoles s'élève à un milliard d'euros. Ce montant a failli atteindre 4 milliards d'euros. Je rappelle à cet égard - et sans polémique - que ces aides remontent à la période 2008-2012, et que ce remboursement s'ajoute aux autres contentieux que nous avons à assumer, par exemple celui des OPCVM, qui se compte aussi en milliards d'euros. Voilà qui fait au moins six ou sept Ecomouv', si l'on cumule tout... Nous avons obtenu de rembourser ces aides agricoles - 1,078 milliard d'euros très exactement - sur une durée de trois années. Cet apurement nous a été notifié le 6 janvier ; il était bien sûr connu avant, puisqu'il a fait l'objet de discussions avec la Commission européenne. Un travail a été mené sur les surfaces agricoles, notamment à partir de photos aériennes. Il y a probablement eu des excès, mais dans les deux sens, la Commission européenne s'étant montrée très sévère dans sa première analyse. Le ministère de l'agriculture a mené un important travail d'explication afin de réduire le montant du contentieux. J'ajouterai que la France n'est pas le seul pays concerné, et que le remboursement est inférieur à 2 % du montant initial des aides. La somme est de 2 % pour l'Allemagne et le Luxembourg, 5 % à 15 % pour la Grèce, 3 % à 5 % pour le Royaume-Uni, 2 % à 10 % pour l'Italie, 8 % à 10 % pour le Danemark, 5 % pour la Pologne, 3 % pour les Pays-Bas. La France étant l'un des principaux bénéficiaires de la politique agricole commune (PAC), le montant en valeur absolue atteint tout de même un milliard d'euros.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué qu'en dépenses et en exécution, nous étions en dessous des dernières prévisions à hauteur de 121 millions d'euros. Toutefois, à la fin de l'année, sur le sujet du logement que je suis particulièrement, les services du ministère nous avaient signalé qu'il y aurait, vis-à-vis du Fonds national d'aide au logement, le FNAL, une dette de 200 millions d'euros en 2014.
La technique des reports de crédits a-t-elle été utilisée ailleurs, et avec quelle ampleur ? Nous souhaiterions, dans l'idéal, examiner un jour un budget exempt de tout report de crédits, pour être certains que les chiffres présentés en matière d'exécution soient complets, sincères et véritables.

Le Gouvernement Tsipras a annoncé ce matin qu'il demandait une restructuration immédiate de la dette grecque. Votre ministère travaille-t-il sur d'éventuels scenarii afin d'estimer les risques budgétaires que cela ferait peser sur la France ?

Dans le prolongement de l'interrogation de Jean Germain tout à l'heure, sur l'impact du taux de change entre euro et franc suisse sur les emprunts détenus par les collectivités territoriales, je souhaiterais faire deux remarques. Tout d'abord, avec des taux d'intérêt sur les emprunts structurés qui atteignent 25 % et parfois plus, la technique du fonds de soutien peut s'avérer inopérante ou en tous cas d'utilité très limitée. Ma deuxième observation concerne la situation de la SFIL : les produits liés au franc suisse représenteraient à peu près la moitié des risques liés aux emprunts toxiques dans les comptes de la SFIL, soit à peu près 3 milliards d'euros.

Je souhaite tout d'abord souligner que c'est la première fois que la France parvient à contrôler et à infléchir les dépenses de l'État. J'ai par ailleurs deux questions. D'une part, vous avez indiqué que le financement des opérations extérieures avait nécessité des « redéploiements » de crédits. Quelle est la provenance de ces crédits ainsi redéployés ? D'autre part, l'inflation devrait s'élever en 2015 à 0,9 %. Quelle est l'estimation actuelle de l'inflation constatée en 2014 ?

Vous avez indiqué qu'un rapport serait prochainement remis concernant la fraude et l'évasion fiscale. J'aimerais pour ma part en savoir davantage quant au retour de sommes, jusqu'alors détenues à l'étranger, sur le territoire français. Les fonds rapatriés devraient en effet permettre de générer, à terme, des recettes fiscales ainsi qu'un surcroît d'activité économique. Quel impact ces fonds rapatriés pourraient-ils avoir sur le solde de l'État ? L'amnistie fiscale dite « Balladur » avait permis de ramener sur le territoire environ 2,5 milliards de francs, qu'en est-il aujourd'hui ?

Vous vous réjouissez de la plus-value de 2 milliards d'euros sur les recettes fiscales. J'observe qu'elles ont été plusieurs fois révisées à la baisse pendant l'année - si je comprends bien que ces diminutions ont correspondu à l'observation de la situation macro-économique, je note que ce sont elles qui permettent de constater aujourd'hui des plus-values.
Vous avez rappelé le fonctionnement du CICE, qui représente 12 milliards d'euros de créance fiscale, dont 6 milliards d'euros de décaissement, avec un mécanisme d'étalement sur trois ans qui s'applique notamment aux grandes entreprises. Serait-il possible de nous préciser le montant de la créance non décaissée de CICE ?
Par ailleurs, vous avez indiqué que les dépenses des ministères étaient maîtrisées, avec une baisse de 3,2 milliards d'euros depuis 2011. À la suite de mon collègue Michel Bouvard, je m'interroge sur la part de l'investissement dans ces économies. Sont-elles structurelles ? Au surplus, quelle est l'importance des reports de crédits ?

Le discours du Gouvernement au sujet du CICE a connu une inflexion. Il devait contribuer à créer des emplois, mais les derniers chiffres du chômage dont on dispose sont très inquiétants. J'aimerais donc savoir quels indicateurs sont mis en place pour le suivi de la relation entre création d'emplois et CICE.
Ma deuxième question concerne Ecomouv' : sur quel compte seront payées les indemnités de résiliation pour Ecomouv', qui seront décaissées, il me semble, à la fin du mois de février ?

Je souhaiterais pour ma part évoquer les discussions entre le Gouvernement français et la Commission européenne sur le budget 2015 et la trajectoire budgétaire des années qui suivent. Lorsque la copie française avait été envoyée à Bruxelles, certains se sont crus autorisés à penser qu'elle ferait rapidement l'objet de corrections de la part des autorités de Bruxelles, du fait d'hypothèses de travail insuffisamment exigeantes.
Les autorités de Bruxelles, que nous avions rencontrées à la fin de l'année 2014, nous avaient indiqué qu'elles attendaient de connaître le socle sur lequel on bâtissait le projet de budget pour 2015, soit la réalité des données budgétaires pour 2014. Cette réalité telle qu'elle ressort des dernières données est un peu améliorée par rapport aux hypothèses de travail de novembre.
Dès lors, doit-on s'attendre à un regard favorable de la part de Bruxelles, rendant superflu le dépôt d'un projet de loi de finances rectificative dans les mois à venir ?

Notre collègue Maurice Vincent est revenu brièvement sur la question des emprunts toxiques - je souhaiterais d'ailleurs que nous employions plutôt le terme usuel d'emprunt structuré, et que nous laissions celui d'emprunt « toxique » aux journalistes, car il me semble quelque peu romancé...

D'un roman variable, à tout le moins ! J'aimerais tout d'abord savoir si le ministre pourrait nous éclairer sur l'état de la SFIL en tant que banque, ainsi que sur la consolidation de la SFIL par rapport aux risques dont elle est porteuse. Au surplus, la forte volatilité des taux de ces emprunts rend partiellement inopportune la solution consistant à racheter les emprunts. Pourquoi ne pas privilégier le rachat d'annuités ? Pour un coût moindre, le rachat d'annuités tient compte du fait que les collectivités ont déjà remboursé leurs emprunts pendant sept ans. Pour des prêts qui sont contractés sur une durée d'environ vingt ans, on peut considérer qu'à partir de la dixième année, le capital engagé, et donc le risque associé, sont moindres. Il ne reste ainsi plus que deux ou trois ans de risque important pour les collectivités territoriales : ces annuités pourraient être rachetées.
En réponse aux questions de Philippe Dallier et de Fabienne Keller sur les reports de crédits, je rappelle qu'il ne s'agit pas là de pratiques inhabituelles. Nous veillons à ce que les délais de paiement de l'État ne pénalisent pas les entreprises. Je crois pouvoir dire - vous disposerez de tous les documents nécessaires à l'occasion de la loi de règlement - que les reports de crédits fin 2014 n'ont pas été sensiblement supérieurs à ceux des exercices 2013 ou 2012. Je n'irai pas jusqu'à parler d'« épaisseur du trait », mais nous n'avons pas augmenté les reports pour tenir des objectifs budgétaires.
La question posée par Roger Karoutchi sur la Grèce a déjà été posée sept ou huit fois à l'Assemblée nationale. Nous y avons répondu, mes collègues du Gouvernement et moi-même, en fonction des éléments dont nous disposons à ce stade des discussions. La France n'entend pas pratiquer d'abandon de créance, et je crois que l'Union européenne non plus. En revanche, nous avons toujours été ouverts à des discussions et à des aménagements sur les modalités, notamment sur la durée et le taux des emprunts. Le préalable posé en 2010 était que la Grèce revienne d'abord à l'équilibre primaire, c'est-à-dire à des recettes supérieures aux dépenses hors charge de la dette. C'est chose faite aujourd'hui. Les discussions peuvent donc s'ouvrir, et Michel Sapin était hier à Bruxelles avec ses homologues. Nous sommes engagés dans un processus commun avec nos partenaires, et il n'est pas question que la France prenne seule une décision. Il serait donc prématuré de donner aujourd'hui des détails sur le taux, la durée et les effets exacts attendus. On peut toutefois considérer que ces effets seront seulement de trésorerie, ce qui est moins gênant qu'un abandon de créance. De plus, le nouveau Gouvernement grec vient à peine d'être installé. Il existe une volonté de mettre en place un système fiscal qui tienne enfin debout, ce qui - je le dis sans porter de jugement - n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a de grandes marges de progression : régime fiscal équilibré, « lutte contre la rente », comme le formulent les responsables grecs eux-mêmes, réformes souhaitées par la plupart des partenaires européens... Le président de la République a invité le Premier ministre grec à le rencontrer rapidement.
Maurice Vincent et Claude Raynal ont raison de parler d'emprunts « structurés » et non pas « toxiques ». En effet, les paramètres de certains emprunts restent très favorables. Là encore, le sujet est trop récent et volatil pour permettre une réponse définitive. Il me semble que vous posez deux questions.
La première question est celle de la SFIL. Je vous rappelle que celle-ci a des actionnaires publics qui ont tous demandé à bénéficier de la garantie de l'État pour entrer au capital. Je l'ai dit solennellement au Parlement : une défaillance de la SFIL aurait des conséquences immédiates sur le budget de l'État, qui pourraient être comprises entre 10 et 20 milliards d'euros. À ce stade, la SFIL n'est pas affectée par les derniers événements ; elle pourrait l'être si les contentieux venaient à se multiplier, ce qui conduirait peut-être les commissaires aux comptes à exiger des provisions supplémentaires et donc une recapitalisation. Il est trop tôt pour se prononcer à ce stade. Certaines collectivités ont été « désensibilisées », comme par exemple Asnières, la Seine-Saint-Denis ou encore Saint-Etienne...

Il faut un texte de loi pour empêcher les abus. Certaines collectivités avaient notamment pu profiter des décisions du tribunal de Nanterre, qui se fondaient sur l'absence de mention du taux effectif global, pour retrouver une position confortable...
Le fonds n'a pour l'instant versé aucune somme, il est en cours de mise en route. Il y a eu une renégociation pour certaines collectivités, d'autres demeurent en difficulté.
A priori, il n'y a donc pas de risque majeur sur la SFIL, à l'exception du sujet que j'évoquais à l'instant.
La deuxième question est celle des collectivités concernées. En raison de la volatilité de la situation, le « moment de sortie » doit être choisi pour être le plus favorable possible, ou en tout cas le moins défavorable possible. Est-ce le bon moment ? Peut-être pas. C'est pour cela que nous hésitons sur la marche à suivre. Nous étudions actuellement la possibilité d'accompagner les collectivités les plus fragiles, afin qu'elles puissent franchir le cap de l'année en cours, jusqu'à ce que les conditions de sortie soient plus favorables. Il s'agit de sujets très techniques, sur lesquels nos services travaillent en ce moment.
Pour répondre à Richard Yung, le surcoût lié aux opérations extérieures a en effet été financé par des redéploiements qui ont concerné l'ensemble des ministères, y compris le ministère de la défense, qui ont parfois été effectués sur la réserve de précaution.
Jacques Chiron a évoqué la question du retour des avoirs détenus à l'étranger. Je précise que ces avoirs ne sont pas tous rapatriés en France. En effet, il n'est pas interdit de détenir un compte à l'étranger dans la mesure où celui-ci est déclaré en France. On assiste cependant, dans de nombreux cas, à un rapatriement de ces avoirs, même si cela n'a pas encore été quantifié. Dès qu'elles sont déclarées, ces sommes entrent dans le patrimoine et peuvent être soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune par exemple. Par ailleurs, ces avoirs produisent souvent des revenus également taxables au titre de l'impôt sur le revenu.
Je rappelle que les montants sont en moyenne de 900 000 euros par dossier pour un total de 35 000 dossiers, soit une assiette supplémentaire de 30 milliards d'euros, même si le montant moyen par dossier a tendance à diminuer légèrement.
Pour répondre à la question de Fabienne Keller, je ne me suis pas « réjoui » des deux milliards d'euros supplémentaires constatés en recettes, j'ai simplement indiqué qu'à partir du mois d'août nous avons procédé à un réajustement des prévisions pour tenir compte de l'inflation. Ces prévisions avaient été raisonnablement réduites.
Vincent Delahaye s'interrogeait sur l'écart entre les prévisions inscrites dans la loi de finances rectificative votée en décembre et l'exécution. Je rappelle que les montants votés en décembre résultent de prévisions réalisées en octobre voire en septembre. Le Gouvernement pourrait amender son texte en dernière minute, mais il me semble préférable de s'appuyer sur des prévisions prudentes.
S'agissant de la question de Marie-Hélène Des Esgaulx sur les pénalités versées à la société Ecomouv', 400 millions d'euros doivent être payés au premier trimestre 2015, le reste sera étalé sur dix ans. Je précise que 300 millions d'euros ont été inscrits sur le budget de l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Les 100 millions d'euros restant seront financés par des redéploiements en gestion.
Pour répondre à François Marc, la Commission européenne avait indiqué qu'elle serait attentive à l'exécution 2014. S'agissant de l'exécution du budget de l'État, les résultats sont encourageants. S'agissant des autres administrations publiques, nous attendons encore les chiffres. L'hypothèse d'un déficit public de 4,4 % du PIB semble toutefois confortée.
Nous continuons à avoir des échanges pour 2015 et pour 2016. Le programme de stabilité sera transmis mi-avril à la commission, nous aurons alors l'occasion d'y revenir. On nous annonce l'apocalypse régulièrement, je vous rappelle que la France a retrouvé un niveau de PIB identique à celui de 2008 très tôt, ce qui n'est pas le cas de nombreux pays européens. Ainsi, si la croissance au Royaume-Uni atteint 3 % à 4 %, son déficit public s'élève à près de 5 % et il n'a retrouvé son niveau de PIB de 2008 que récemment. Il n'y a pas d'alerte, ni d'optimisme délirant, mais bien un dialogue permanent.
J'espère avoir répondu à vos questions et je vous remercie pour votre présence.
Pouvoirs de sanction des régulateurs financiers
Audition conjointe de M. Rémi Bouchez président de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution Mme Marie-Anne Frison-roche professeur des universités à l'institut d'études politiques de paris M. Gérard Rameix président de l'autorité des marchés financiers M. Jean-Luc Sauron conseiller d'état délégué au droit européen du conseil d'état ainsi que Mme Corinne Bouchoux sénatrice ancienne rapporteure au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois

Cette audition sur les pouvoirs de sanction des régulateurs financiers est importante car elle s'inscrit dans le cadre de travaux attendus, notamment en raison de la position qu'a adoptée le Sénat et, à sa suite l'Assemblée nationale, sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) adopté en décembre dernier.
Ce projet de loi comportait essentiellement des habilitations à transposer par voie d'ordonnance des directives et règlements européens en matière bancaire, assurantielle et financière.
La plupart de ces textes européens comportent un volet « sanctions », qui impliquent une transposition ou une mise en cohérence du droit interne mais laissent une assez large marge d'appréciation aux États membres, s'agissant notamment du montant des pénalités financières susceptibles d'être prononcées par les autorités de régulation.
À l'initiative de Richard Yung, qui était notre rapporteur sur ce texte, le Parlement a restreint les habilitations sollicitées par le Gouvernement en excluant expressément la question des sanctions.
Outre la spécificité de la matière répressive, l'une des principales raisons qui a conduit à ce choix est le fait que le Sénat menait une mission d'information sur ces sujets dont on peut penser qu'elle débouchera sur une série de propositions voire, si nécessaire, sur une initiative législative.
Je crois effectivement important que le Parlement ne se dessaisisse pas de sa compétence sur ces sujets : la question de la régulation du secteur financier, et donc des pouvoirs répressifs des autorités publiques, se pose encore de manière très vive. On observe que les États-Unis et le Royaume-Uni ont durci leur politique répressive et prononcent des amendes record à l'encontre des établissements financiers qui manquent à leurs obligations. L'Union europénne ne cesse de préciser les règles applicables sur son territoire. Le législateur ne peut se contenter d'un rôle passif sur ce sujet.
Je vous rappelle que la mission d'information sur les pouvoirs de sanction des régulateurs financiers était à l'origine menée conjointement par notre commission et la commission pour l'application des lois, et avait été confiée à notre ancien collègue Philippe Marini, alors président de la commission des finances, et à notre collègue Corinne Bouchoux, pour la commission pour l'application des lois.
Ceux-ci ont entamé une série d'auditions mais ne sont malheureusement pas en mesure d'achever ce travail, en raison d'un concours de circonstances assez exceptionnel découlant du dernier renouvellement sénatorial. Tout d'abord, Philippe Marini a quitté la commission des finances pour la commission de la culture et a récemment démissionné de son mandat de sénateur.
Ensuite, la commission pour l'application des lois a cessé son activité. Corinne Bouchoux se trouve donc mécaniquement empêchée de poursuivre son travail de rapporteur, que cela soit au titre de cette commission ou de la nôtre, car elle appartient à la commission de la culture.
La commission des finances a estimé que ce travail méritait d'être achevé et a donc désigné en son sein deux nouveaux rapporteurs : Albéric de Montgolfier et Claude Raynal.
La présente audition ouvre leurs travaux et nous permettra d'entendre successivement notre collègue Corinne Bouchoux, qui nous présentera l'état de sa réflexion sur le sujet, Marie-Anne Frison Roche, professeur à Science-Po Paris et spécialiste du droit de la régulation financière, Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Rémi Bouchez, président de la Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Luc Sauron, conseiller d'État, délégué au droit européen pour la section du rapport et des études du Conseil d'État.

La mission d'évaluation que la commission pour l'application des lois et la commission des finances nous avaient confiée, à Philippe Marini et à moi-même, portait sur les dispositions législatives relatives aux pouvoirs de sanction de l'AMF et de l'ACPR. Il s'agissait en particulier d'évaluer la mise en oeuvre des dispositions introduites par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, notamment la création d'un pouvoir de transaction de l'AMF, à travers la procédure dite de « composition administrative » ; le relèvement de 10 à 100 millions d'euros du plafond des pénalités financières susceptibles d'être prononcées par l'AMF et l'ACPR ; la modernisation de la procédure de sanction, pour un meilleur respect du droit à un procès équitable.
Avant que notre travail ne soit interrompu par le renouvellement sénatorial, nous avons mené plusieurs auditions, notamment des représentants de l'AMF et de l'ACPR, dont Gérard Rameix et Rémi Bouchez ici présents.
Ce travail, inachevé, nous a permis d'identifier plusieurs points sur lesquels le législateur devrait prochainement intervenir, d'autant que la nécessité de transposer diverses directives européennes en matière financière lui en donnera l'occasion.
Quant à moi, je souhaiterais souligner tout d'abord l'importance de la prévention.
Je crois en effet qu'une régulation et un système de sanction efficaces doivent reposer d'abord sur une prévention active des conflits d'intérêts et des manquements aux règles. À cet égard, je crois que la formation des acteurs du monde de la finance et de la banque devrait être renforcée en matière d'éthique. Certes, il existe d'ores et déjà des règles déontologiques applicables à chaque catégorie, qui sont approuvées par l'AMF. Cependant, je crois que cet apprentissage d'une « éthique de la finance » devrait être effectué, de façon encore plus systématique, dans le cadre des formations financières dans les universités et les écoles.
Le deuxième point sur lequel je souhaite insister concerne la confiance. Une étude récente, publiée dans la revue Nature en 2014, a montré que les employés des banques avaient une tendance plus importante à jouer avec la norme lorsque leur identité professionnelle de banquiers est mise en avant. Comme si la malhonnêteté était, dans une certaine mesure, associée au métier de banquier par les banquiers eux-mêmes ! Dans le même ordre d'idées, une autre étude a récemment montré que les groupes homogènes ethniquement et sexuellement avaient une plus forte tendance à la prise de risque inconsidérée que des groupes diversifiés, car le contrôle implicite des uns sur les autres y est plus fort, et le mimétisme moins présent.
Ainsi, il y a encore du chemin à parcourir pour établir une atmosphère de prudente confiance qui soit partagée par les acteurs du milieu financier et par le public. De ce point de vue, je me permets de tracer deux pistes.
La première concerne la place des lanceurs d'alerte et des « repentis ». Le milieu, où règne parfois un certain entre-soi, marginalise les discours hétérodoxes qui sont pourtant nécessaires pour procéder à une analyse systémique et originale qui permet, me semble-t-il, de prévenir certains comportements, erreurs d'appréciation des risques ou de gouvernance.
La seconde piste, qui découle d'une appréciation toute personnelle, concerne la composition des organes chargés de prononcer les sanctions, où siègent essentiellement des professionnels de grande qualité, accompagnés de magistrats. Leur compétence est incontestable, mais il pourrait être salutaire de briser cet entre-soi, qui peut laisser penser qu'il incite à l'indulgence, en élargissant la composition de ces organes à des personnalités qualifiées telles que des universitaires, dont le travail n'a pas toujours la visibilité qu'il mérite.
Ce ne sont là que des pistes de réflexion, autour de ces deux « notions » de prévention et de confiance, afin de repenser cette question de l'efficacité du pouvoir de sanction dans le cadre plus global des pratiques et de l'éthique du milieu financier.
S'agissant maintenant de l'organisation des poursuites, l'un des principaux enjeux auxquels sont confrontés les régulateurs, en particulier l'AMF, est la question du non bis in idem. Aujourd'hui, il est possible, en France, de poursuivre le même fait à la fois devant l'autorité de régulation dans le cadre d'une procédure disciplinaire et devant le juge dans le cadre d'une procédure pénale. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, dans un arrêt important du 4 mars 2014 (arrêt Grande Stevens), condamné l'Italie pour avoir engagé des poursuites pénales parallèlement à des poursuites disciplinaires pour un même délit boursier, en se fondant sur le principe du non bis in idem.
Cette évolution jurisprudentielle signifie-t-elle que nous devrons faire le choix entre les poursuites pénales et les poursuites administratives ? Sonne-t-elle le glas de l'AMF comme autorité de sanction ?
À cet égard, je souligne que la décision de la CEDH, qui est une décision de principe, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas où un même délit fait l'objet d'une poursuite administrative et d'une sanction pénale - pas seulement en matière de régulation financière mais aussi, par exemple, en matière fiscale.
Il s'agit d'un problème bien identifié par l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés, qui s'y penchent d'ailleurs au sein de groupes de travail communs. Je n'ai pas de proposition concrète à ce stade, car le sujet mérite encore d'être approfondi, mais je pense qu'il doit être possible de concilier les deux poursuites, qui me semblent toutes deux légitimes, dès lors que leurs missions respectives seraient mieux définies.
S'agissant de la composition administrative, le bilan semble positif. Comme prévu, cette procédure permet de faire l'économie d'une longue procédure devant la commission des sanctions. Contrairement à ce que certains craignaient, les sommes versés par les auteurs de manquement en application d'un accord transactionnel sont d'un montant équivalent à celui des pénalités prononcées par la commission des sanctions de l'AMF pour des faits équivalents.
En l'état de la pratique, la composition administrative permet ainsi de gagner en rapidité et simplicité et ne fait pas perdre en sévérité.
Je rappelle en outre que les accords de composition administrative font obligatoirement l'objet d'une publication alors que la commission des sanctions peut décider de ne pas faire la publicité des sanctions qu'elle prononce, même si elle use rarement de cette faculté.
Compte tenu de ces éléments, se pose donc la question de l'élargissement du champ de la composition administrative.
La généralisation à l'ensemble des manquements professionnels ne semble pas poser de difficulté. En revanche, l'instauration d'une procédure équivalente pour les abus de marché soulève des questions de principe et est très controversée.
Il faut tout de même signaler que les sanctions record infligées par les autorités américaines et anglaises le sont dans le cadre d'une forme de « plaider coupable » et qui n'est pas dans ce cas le synonyme de laxisme et d'arrangements entre amis. Or c'est la menace de poursuites pénales contre les individus ou de retrait d'agrément qui fait plier les sociétés financières et les conduit à transiger rapidement.
L'élargissement de la composition administrative ne peut donc, à mon sens, se concevoir sans prendre en compte la question de l'articulation entre répression administrative et répression pénale et donc celle du non bis in idem.
La nécessité d'une meilleure coopération entre le régulateur et l'autorité judiciaire se fait également sentir pour ce qui concerne la lutte contre les réseaux organisés, parfois de type mafieux, qui flouent l'épargnant, que cela soit par des abus de marché - délit d'initié notamment - ou des escroqueries de type FOREX.
Enfin, j'estime, au terme de mon travail d'auditions et de réflexion sur le sujet, qu'un des principaux enjeux d'une réforme sera celui du plafond des sanctions.
Je vous rappelle que le plafond des sanctions est aujourd'hui fixé, pour les professionnels, à 100 millions d'euros ou au décuple des gains réalisés dans le cas de l'AMF, ou à 100 millions d'euros pour l'ACPR. Cependant, ce plafond doit selon moi être révisé, sous l'effet de deux évolutions que je laisse à votre appréciation.
Tout d'abord, les évolutions des règles européennes engagent un mouvement de plafond exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement. Ainsi, le règlement européen CRD IV a d'ores et déjà imposé la fixation d'une amende maximale pour les banques, en matière prudentielle, dont le plafond est fixé à 10 % du chiffre d'affaires. Surtout, la directive et le règlement sur les abus de marché (MAD-MAR) permettent également la fixation de sanction proportionnelle au chiffre d'affaires de l'établissement.
Ensuite, les récentes décisions de l'ACPR condamnant des compagnies d'assurance pour leurs négligences à retrouver les bénéficiaires des contrats d'assurance vie en déshérence ont illustré la faiblesse du plafond actuel en comparaison des profits réalisés et de la surface financière des acteurs. Des sanctions de 40 millions d'euros et de 50 millions d'euros ont été prononcées, l'autorité de poursuite ayant préconisé à chaque fois la sanction maximale de 100 millions d'euros. À cet égard, je suis heureuse que nous puissions avoir l'éclairage de Rémi Bouchez sur les raisons qui ont conduit à fixer les sanctions à ce niveau.
Quant à moi, j'estime qu'un relèvement du plafond, soit sous la forme d'un relèvement du montant absolu soit sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires, peut sembler nécessaire pour rendre plus clair et plus juste le panel des sanctions.
En outre, si le choix est fait d'une sanction en fonction du chiffre d'affaires, il sera nécessaire de clarifier l'établissement pris en compte : doit-il s'agir seulement de la filiale en question, ou du groupe tout entier auquel elle appartient ? La première solution ouvrirait la porte à de possibles contournements dans le but de réduire le montant de la sanction.
On voit que sur l'ensemble de ces points, et sans doute sur d'autres, il y a matière à ce que le législateur travaille et prenne des initiatives. Je me réjouis que la commission des finances ait choisi de prolonger le travail entamé en confiant cette mission d'information à Albéric de Montgolfier et Claude Raynal.
Nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Le système juridique français risque d'être pulvérisé tant par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui met en avant le principe de non bis in idem, que par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui interdit de punir une même personne deux fois pour un même fait.
Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir aux choses simples.
Premièrement, le droit de la répression est spécifique par rapport à toutes les autres branches du droit en ce qu'il est le seul qui se développe à travers un procès. Pour cette raison, la procédure et le droit des incriminations sont absolument indissociables. Une difficulté récurrente en matière de procédure révèle nécessairement un problème de fond concernant l'ensemble du système de la répression.
Deuxièmement, le droit financier doit être appréhendé comme le droit utile pour les marchés financiers. Il s'agit d'un droit instrumental au service de son propre objet : il vise à assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.
Troisièmement, la répression financière n'est qu'un outil parmi d'autres pour satisfaire les exigences du bon fonctionnement des marchés financiers. De nombreux outils complémentaires peuvent être mobilisés : les normes, la répression, la soft law, les rapports avec l'Europe, la composition administrative, etc. Conceptuellement, ces outils n'appartiennent pas au même monde. Ainsi, la composition administrative est un contrat, alors que la sanction est une peine.
Deux domaines doivent donc être distingués. Dans le cas d'une punition, il s'agit de faire en sorte que les marchés financiers fonctionnement objectivement bien. Dans le cas d'une peine, qui relève du droit pénal classique, il s'agit de punir une intention dolosive socialement réprouvée, même si le dommage est minime.
La répression financière n'a donc rien à voir conceptuellement avec le droit pénal. Le juge pénal est légitime pour punir les intentions dolosives de certaines personnes qui portent atteinte aux valeurs fondamentales du corps social. A l'inverse, c'est le régulateur qui constitue l'entité légitime pour la sanction de comportements visant à perturber le bon fonctionnement objectif des marchés.
En conséquence, il est absolument inconcevable que le régulateur ne soit pas titulaire d'un pouvoir de sanction. Par l'exercice de ce pouvoir, il affirme son autorité sur les opérateurs, prévient les risques de capture et injecte de l'information dans le marché. Dans cette perspective, il existe une continuité entre la prévention et la sanction.
Pour réguler les marchés, le régulateur utilise son pouvoir de sanctions avec des charges de preuve légères. Les présomptions sont fortement mobilisées car les fautes reprochées sont objectives. Pour le régulateur, en matière probatoire, il est légitime que la fin justifie les moyens. Il est donc parfaitement normal que le régulateur soit beaucoup moins exigeant que le juge pénal.
Ces finalités très différentes doivent se retrouver dans les incriminations. Or, pour des raisons historiques, la construction du droit administratif répressif financier s'est faite par transposition du droit pénal financier. Il s'agit du principal vice du système français. Par exemple, pour ce qui est du manquement d'initié et du délit d'initié, la même incrimination est tout simplement dédoublée.
Ce choix du législateur constitue une grave faute que nous payons aujourd'hui. Petit à petit, les juges européens se réveillent et mettent en cause notre procédure. Or, les procédures ne vivent qu'à travers le procès. Avoir un problème de procédure, c'est donc avoir un problème de droit des incriminations. En conséquence, des ajustements relevant du « bricolage » ne suffiront pas pour donner satisfaction aux juges européens. Une réforme d'ensemble visant à différencier les incriminations est nécessaire. Il faut construire pour le juge pénal et pour le régulateur des infractions spécifiques correspondant conceptuellement aux fins distinctes du droit pénal classique et de la répression financière. C'est uniquement cette différenciation qui pourra permettre de justifier des procédures pouvant se cumuler.

Nous allons maintenant entendre Gérard Rameix, qui préside le collège de l'AMF, l'organe de poursuite de cette autorité. Il pourra donc utilement nous parler de la question du non bis in idem, de son expérience de la composition administrative et, s'il le juge utile, des difficultés qu'il rencontre dans la lutte contre la fraude financière.
Je vous remercie de me donner la parole sur un sujet qui concerne l'une des principales activités de l'AMF.
Nous assistons, sur la scène internationale, à un durcissement de la répression des infractions financières. L'exigence sociale, exprimée par l'opinion publique, est forte. Ce durcissement se manifeste de façon très spectaculaire aux États-Unis et un petit peu en Grande Bretagne ; en France également, mais pour des montants moindres.
Les moyens mis en oeuvre pour réprimer les infractions financières sont très significatifs. Bien évidemment, je souhaiterais qu'ils soient plus importants pour pouvoir suivre la complexité croissante du sujet. Environ un tiers des moyens de l'AMF, soit environ 30 millions d'euros chaque année, sont consacrés à la répression : il s'agit des équipes de surveillance, d'enquête et de contrôle et les personnes qui travaillent auprès de la commission des sanctions ou dans les services juridiques ; ce sont des personnes de très haut niveau et qui continuent de se spécialiser. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le système, même s'il est perfectible, a réalisé de considérables progrès depuis dix ou quinze ans.
L'AMF est un des régulateurs d'Europe continentale les plus répressifs : c'est nous qui, sur le droit boursier, le droit des marchés financiers, imposons les sanctions pécuniaires les plus importantes. Sur des sujets nouveaux et très importants comme par exemple le trading à haute fréquence, très peu d'équipes dans le monde sont capables d'analyser les données techniques des carnets d'ordre permettant d'initier des procédures contre les manipulations de cours. À l'AMF, quelques personnes en sont capables - il y a d'ailleurs plusieurs procédures en cours et certaines ont abouti. Aussi, nous devons avoir recours à des personnes extrêmement qualifiées, capables de reconstituer des stratégies de transactions ou d'annulations d'ordre sur quelques microsecondes.
En 2014, environ 80 personnes ont été sanctionnées, pour un montant total de 38 millions d'euros, sans compter les compositions administratives, au nombre d'une dizaine, qui concernent des infractions plus techniques et représentent quelques centaines de milliers d'euros.
Voilà les éléments de contexte que je souhaitais vous présenter, avant d'aborder les sujets que la présidente a évoqués.
En ce qui concerne le principe du non bis in idem, beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles je suis globalement en accord. J'ajouterais seulement que la coopération entre la filière pénale - renouvelée dans son organisation par la création du procureur national financier - et les équipes spécialisées de l'AMF n'a jamais été aussi étroite. Cette coopération, assez ancienne et plutôt efficace, s'est incontestablement intensifiée.
Plusieurs groupes de travail spécialisés essayent de trouver des solutions, et j'adhère personnellement au raisonnement de Marie-Anne Frison-Roche, mais en tant que technicien, je dois reconnaître que je ne parviens pas à faire des propositions dans ce sens.
Il est en effet très difficile de séparer les domaines, pour une raison historique : les trois infractions pénales qui existent en droit français sont issues des travaux de la commission des opérations de bourse (COB). Les magistrats, le Conseil d'État et la Banque de France, qui ont été les pionniers de la COB dans les années 1970, ont proposé des infractions. À une époque où la COB avait des pouvoirs d'enquête très importants mais aucun pouvoir de sanction. Après l'affaire Péchinet, à l'initiative de Pierre Bérégovoy, alors ministre des finances, des pouvoirs de sanction ont été confiés au régulateur sur deux champs : celui des infractions les plus importantes qui avaient été définies quelques années auparavant et, surtout, le champ de tous les autres manquements, notamment professionnels.
Il faudrait, pour aller au bout du raisonnement de Marie-Anne Frison-Roche, considérer qu'une infraction d'initié portant sur un montant moyen constitue un manquement ; tandis qu'il faudrait non seulement des conditions d'intentionnalité mais aussi de montants pour définir une infraction pénale. C'est extrêmement difficile à construire en pratique, mais je pense que c'est un dialogue que nous sommes amenés à poursuivre.
Pour conclure, nous avons encore des progrès à faire en matière d'articulation des enquêtes, de rassemblement des preuves, de constitution des dossiers - il y a souvent, dans les dossiers d'infraction qui aboutissent, duplication des diligences déjà effectuées, à un stade antérieur, par l'AMF.
En revanche, si on finit par considérer que l'arrêt Grande Stevens de la Cour européenne des droits de l'homme implique de choisir entre les deux procédures, et qu'il en résulte la primauté du droit pénal, alors le régulateur ne disposera plus de pouvoirs de répression dans certaines situations. Ce serait prendre un risque considérable car cela revient à créer une justice répressive en matière financière à deux vitesses. En effet, en pratique, les infractions d'importance moyenne (relativement graves mais pas majeures) seraient réprimées par des amendes assez lourdes prononcées par la commission des sanctions de l'AMF, alors que pour des cas médiatiques ou d'une importance particulière, la voie pénale serait privilégiée. Or aujourd'hui, l'expérience prouve - je ne mets personne en cause - que la procédure est particulièrement longue à cause des niveaux de preuves, des changements de juges d'instruction, des obstacles de procédures de toutes natures. Aussi, nous devrions faire un choix cornélien entre poursuivre quelqu'un pour lui infliger une amende au bout d'un an ou d'un an et demi, ou viser une sanction qui pourrait être plus lourde, pouvant même consister en une peine de prison, mais au bout de cinq, dix voire quinze ans - et je pense qu'il faut absolument éviter cela. Beaucoup de travail doit encore être réalisé et de nombreuses réflexions sont menées actuellement sur ce sujet.
Depuis la création de la procédure des compositions administratives, 27 accords de composition ont été publiés, les homologations des accords par la commission des sanctions sont rapides et quasi-systématiques. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de décote par rapport au quantum qui aurait été fixé en cas de sanction. En cette période où les moyens publics doivent être utilisés le plus efficacement possible, quand on peut gagner six mois ou un an de procédure et économiser des moyens, je pense, à titre personnel, qu'on pourrait prévoir une petite décote sur la sanction. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui.
La publicité des compositions administratives est systématique. Formellement, en droit, il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité mais les faits poursuivis par l'AMF sont expliqués en détail, donc c'est parfaitement transparent.
La composition administrative fonctionne bien, et je pense qu'on pourrait l'étendre très largement. Mais une telle évolution ne pourrait être que progressive dans la mesure où, historiquement, la culture française est intrinsèquement allergique aux procédures de transaction.
Nous pensons notamment que la composition administrative peut être étendue à tous les professionnels car certains en ont été exclus à sa création et aux infractions de marché qui n'entrent pas dans le cas des abus de marché - ce serait une petite extension de quelques affaires par an qui permettrait à la commission des sanctions de gagner du temps.
Je considère, à titre personnel et sans que cela ne constitue une position officielle de l'AMF, que la composition administrative pourrait parfaitement être utilisée dans les cas d'abus de marché et cela fonctionne bien dans les autres pays. L'idée selon laquelle ce serait une procédure plus indulgente, plus favorable aux personnes poursuivies, me paraît tout à fait inexacte - à mon avis, c'est plutôt l'inverse et d'ailleurs c'est aussi ce que pensent beaucoup d'entreprises dans le domaine financier. En mettant le marché entre les mains des entreprises, elles sont incitées à accepter des transactions dans des cas où leurs avocats les auraient peut-être sauvées devant la commission des sanctions.
Je pense qu'il faut également poursuivre notre pratique assez sage : nous avons recours à cette procédure sur des affaires qui paraissent juridiquement très claires, avec des précédents jugés en droit par la commission des sanctions. Il faut ensuite que les personnes acceptent, nous n'avons eu qu'un seul cas de refus sur une trentaine de compositions administratives.
La poursuite des infractions très graves constitue un souci très important pour nous ; il s'agit d'une question de capacité de poursuite plus que d'une question juridique. Nous savons que quelques groupes de personnes sont des professionnels de la fraude financière et dans ces cas, les preuves sont extrêmement difficiles à rassembler. Nous coopérons de manière très étroite avec le parquet national financier, car les moyens dont nous disposons peuvent être utilement complétés par des filatures, des écoutes téléphoniques, des perquisitions organisées à l'étranger.
Quant à l'effectivité de la répression, certaines améliorations pourraient être apportées, notamment concernant les lanceurs d'alerte qui pourraient être mieux protégés en France, la conservation des messageries électroniques professionnelles - nous souhaiterions un texte plus précis obligeant les professionnels à conserver certaines conversations, comme c'est déjà prévu pour les conversations téléphoniques liées à la préparation de transactions. Comme l'a dit Corinne Bouchoux, le plafond global des sanctions pécuniaires peut être relevé, mais c'est une décision politique et je n'y reviens pas ; toutefois, s'agissant des plafonds applicables aux professionnels, il existe des anomalies : pour certaines infractions professionnelles, les plafonds sont inférieurs aux plafonds généraux. Enfin, la durée de prescription a été créée avec l'AMF, elle est de trois ans, ce qui s'avère un peu court. On pourrait, si le législateur l'acceptait, la porter à cinq ans. La durée de trois ans a été calquée sur celle du délit correspondant - on retrouve le défaut de raisonnement critiqué par Marie-Anne Frison-Roche.
Il s'agit d'adaptations marginales et l'essentiel, si l'on veut un véritable pouvoir de sanction, c'est la question de l'organisation des poursuites et d'articulation des moyens juridiques et de police. Il faut à la fois une spécialisation technique de certains de nos agents et l'ensemble des moyens publics pour essayer de recueillir des preuves, notamment pour des poursuites pénales.

Je donne maintenant la parole à Rémi Bouchez, président de la commission des sanctions de l'ACPR, qui a eu une actualité chargée dans la période récente : elle a prononcé les pénalités financières les plus élevées de son histoire dans des affaires tenant aux contrats d'assurance vie en déshérence, sujet qui nous a bien occupés l'année dernière.
L'ACPR a été créée par une ordonnance de janvier 2010, elle-même ratifiée par la loi de régulation bancaire et financière d'octobre 2010, qui l'a ajustée sur certains points.
Cette nouvelle organisation repose, comme à l'AMF, sur une séparation, organique et fonctionnelle, avec, d'un côté, le contrôle et la poursuite qui relèvent du Collège et, de l'autre, l'instruction et le « jugement » qui relèvent de la commission des sanctions. Elle est composée de six membres, trois magistrats et trois personnalités qualifiées. Depuis la loi d'octobre 2010, un membre est désigné rapporteur, c'est-à-dire qu'il instruit le dossier mais ne délibère pas.
De mon point de vue, mais cela ne vous étonnera pas venant de la part du président de la commission des sanctions, cette nouvelle organisation a bien fonctionné et continue de fonctionner efficacement. Si l'on transpose les critères habituellement appliqués aux juridictions, on constate que les délais sont relativement brefs puisque, de l'ouverture de la poursuite à la décision, ils sont compris entre huit et dix mois, en tout cas sensiblement inférieur à un an. Jusqu'à présent, les décisions du Conseil d'État rendues sur nos jugements les ont toujours confirmés, notamment pour deux affaires un peu sensibles et médiatisées, à savoir une affaire concernant UBS et l'autre la Banque populaire Côte d'Azur.
Par ailleurs, le Conseil d'État a rejeté des questions prioritaires de constitutionnalité qui mettaient en cause notre fonctionnement, ce qui a permis de conforter le dispositif mis en place par le législateur en 2010.
La commission des sanctions a rendu trente décisions depuis 2010 et nous tournons à un rythme d'environ dix par an, ce qui est un ordre de grandeur sensiblement inférieur à ce que fait la commission des sanctions de l'AMF.
Notre dispositif fonctionne de manière quasi-juridictionnelle. La commission des sanctions n'est pas une juridiction en droit interne mais elle est un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Au regard de la procédure que nous suivons et du contradictoire qui se développe devant nous, le système ressemble beaucoup à un système juridictionnel même s'il ne l'est pas en termes de droit interne.
Dernier commentaire général sur notre organisation, il y a eu dans la période récente un changement majeur, à savoir la création du mécanisme de surveillance unique (MSU). Il en résulte que certaines procédures disciplinaires sont désormais exercées par la Banque centrale européenne (BCE). Le partage est complexe. Relèvent de la BCE, les établissements les plus importants, les questions prudentielles et le respect du droit de l'Union européenne. Voilà, grosso modo, les trois critères qui dessinent la compétence propre du système européen. Il existe toutefois une possibilité de procédures disciplinaires engagées devant l'ACPR à la demande de la BCE, en particulier pour toutes les procédures visant des personnes physiques.
Ce changement est tout récent et il est difficile d'en apprécier les conséquences. En pratique, le pronostic que l'on peut faire, au regard des dossiers que nous traitons, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'effets majeurs. Fort heureusement, les sujets prudentiels concernant les grands établissements sont rares en procédure disciplinaire. En principe, ces questions sont plutôt réglées par des interventions préventives.
Je voudrais maintenant en venir à un second point, qui vous intéresse particulièrement, à savoir le niveau pécuniaire des sanctions. Je ne parlerais pas des autres types de sanctions dont nous disposons dans notre palette : avertissement, blâme, etc.
La législation de 2010 a eu une grande vertu simplificatrice puisqu'elle a unifié la régulation de la banque et celle de l'assurance, qui relevaient de champs distincts, y compris en matière de sanctions. Dans un premier temps, l'ordonnance avait fixé un plafond de sanctions à 50 millions d'euros qui a été relevé par la loi, quelques mois plus tard, à 100 millions d'euros. Ceci a constitué une augmentation rapide puisque, jusqu'à la loi de modernisation de l'économie de 2008, le plafond était de 5 millions d'euros.
Ce système unique est simple mais devrait se complexifier compte tenu de la législation européenne et, en particulier, la transposition par une ordonnance de février 2014 du « paquet CRD IV », c'est-à-dire la transcription des accords de Bâle III. Désormais, en matière répressive, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement, pour les manquements prudentiels seulement, le plafond est passé à 10 % du chiffre d'affaires ou deux fois l'avantage retiré, s'il est estimable, et, pour les dirigeants responsables - les personnes physiques - le plafond est de cinq millions d'euros. La situation n'est pas tout à fait satisfaisante puisque nous avons à nouveau une divergence entre banque et assurance pour les mêmes types de manquements. La complexité pourrait s'aggraver car la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme comporte des plafonds spécifiques à ces infractions. Pour autant, cela n'a pas beaucoup affecté, compte tenu des dossiers que nous traitons, le prononcé des sanctions.
Nous avons rendu vingt-huit décisions au fond depuis notre création, dont vingt-quatre sanctions pécuniaires, qui s'étagent de 5 000 euros - il s'agissait d'un petit courtier en assurances - à 50 millions d'euros dans une affaire récente relative aux contrats d'assurance vie non réclamés.
Le législateur impose seulement de proportionner la sanction pécuniaire par rapport à la gravité du manquement. Il faut, en outre, pour respecter la jurisprudence, en particulier celle du Conseil d'État, tenir compte de l'assise financière de la personne sanctionnée pour s'assurer que la sanction envisagée n'est pas excessive.
La commission des sanctions s'est efforcée de construire une grille d'analyse qu'elle exprime dans les conclusions de ses décisions. Il s'agit donc de placer le curseur dans l'échelle de 0 à 100 impartie par le législateur.
Nous regardons pour ce faire la nature, le nombre et la durée des manquements. Toutes les obligations professionnelles ne sont pas équivalentes. Le deuxième élément d'appréciation, ce sont les torts éventuels causés à des clients, à des tiers, voire au secteur ou à l'économie en général. Enfin, le troisième élément, ce sont les avantages retirés par l'opérateur du fait de ces manquements : moindres dépenses, gains indus, etc. Nous prenons également en compte l'ampleur et la rapidité des mesures de correction. Le Conseil d'État a validé cette approche même si nous ne sommes pas tenus de le faire.
C'est l'application de cette grille d'analyse qui explique le montant, à mon sens élevé, des sanctions appliquées sur les affaires de contrats d'assurance vie non réclamés, soit 10 millions d'euros, 40 millions d'euros et 50 millions d'euros. Il s'agissait de la mise en oeuvre de la loi de 2007 par laquelle le législateur a imposé aux assureurs, d'une part, de rechercher les informations sur les assurés décédés et, d'autre part, de rechercher le bénéficiaire du contrat si le décès est confirmé.
Dans ces affaires, la commission des sanctions a considéré qu'il y avait un manquement à une obligation légale très importante compte tenu de la volonté claire du législateur de changer les choses en la matière. Il y avait en outre un préjudice pour la clientèle et pour les bénéficiaires des contrats. Enfin, il y a eu des moindres dépenses puisque les assureurs ne se sont pas donné les moyens pour se conformer à leurs nouvelles obligations.
Corinne Bouchoux s'est faite l'écho de points de vue qui estiment que des sanctions encore plus importantes auraient pu être prononcées. Chacun peut avoir son appréciation. Pour ma part, j'ai lu beaucoup d'articles insistant sur le caractère exceptionnel et important de ces décisions.
Il faut d'abord tenir compte du fait que les décisions ne retiennent pas tous les griefs présentés par le collège : certains ont été écartés ou relativisés. La commission des sanctions a en outre estimé que, si le législateur fixe une grille qui va de 0 à 100, il nous revient de placer le curseur à l'intérieur de cette échelle selon une appréciation de proportionnalité par rapport à la gravité. Nous n'avons pas voulu entrer dans un raisonnement qui consisterait à dire : pour les manquements qui concernent des gros opérateurs, la juste sanction, vraiment dissuasive, serait de 200, 300 millions d'euros, voire un milliard d'euros mais, comme le législateur a fixé le plafond à 100 millions d'euros, nous sanctionnons à hauteur de ce plafond. Ce raisonnement, nous a-t-il semblé, serait entaché d'une erreur de droit par rapport à la volonté du législateur. En effet, cela conduirait à nous mettre systématiquement au plafond dès lors que l'opérateur est important. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une bonne méthode pour appliquer la loi.

Pour conclure ces propos liminaires, je donne la parole à Jean-Luc Sauron, conseiller d'État, délégué au droit européen au Conseil d'État, mais dont il est intéressant de noter qu'il fût au début de sa carrière juge d'instruction. Son regard sur la question du non bis in idem sera donc particulièrement utile.
Sur ce point, je ne partage pas du tout l'analyse dominante sur la couleur du ciel... Je pense qu'il est un peu moins gris que beaucoup veulent bien le dire.
C'est un principe ancien, né du droit pénal. Au niveau national, c'est simple puisque les trois cours suprêmes ont des avis identiques sur la question. Au niveau européen, en revanche, c'est plus compliqué puisque, d'un côté, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), avec l'arrêt Åkerberg Fransson du 26 février 2013 rendu en chambre plénière, reconnaît la possibilité de cumuler des sanctions administratives et pénales. La législation européenne prévoit aussi le cumul des deux types de sanctions. Un rapport de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a enfin montré que notre système n'est pas unique dans l'Union européenne. Les situations sont très hétérogènes. Certains pays ne font que du pénal, d'autres que de l'administratif, et nous sommes très loin d'être seuls sur le cumul.
La position de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) mérite d'être analysée plus en détail. D'abord, les deux grandes cours européennes divergent sur ce principe. Ce n'est pas banal d'autant que l'avis 2/13, rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, déclare non conforme au droit primaire de l'Union européenne l'accord d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. Vu les termes de l'avis, nous avons encore devant nous quelques belles années de discussion doctrinale.
L'arrêt Grande Stevens a été beaucoup commenté et a beaucoup inquiété car la réserve d'interprétation mise en avant par l'Italie puis par l'Autriche - et qui a été invalidée par la Cour - était rédigée dans des termes identiques à celle de la France.
Les trois cours suprêmes françaises ont la même position. Le 17 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur ce point - dans le cadre de l'affaire EADS. Elle cite l'arrêt Grande Stevens. Nous verrons si les Sages de l'aile Montpensier du Palais Royal changeront de position. Pour ma part, je les inviterais - même si mon invite n'a pas grande importance - à ne pas changer de position puisqu'elle me paraît très saine sur le principe de la proportionnalité de la peine. Il n'y a pas d'interdiction du cumul mais celui-ci ne doit pas dépasser la sanction la plus forte qui peut être prononcée.
Entre la CEDH et la CJUE, il existe une grande différence sur la portée de leurs décisions. Quand la CJUE prend une décision, celle-ci s'applique à l'ensemble des législations nationales qui seraient identiques ou proches de celle qui a été condamnée. En revanche, pour les arrêts de la CEDH, seul l'État condamné est tenu par la décision. Les autres États peuvent courir le risque d'être condamné ou bien de ne pas l'être puisqu'il y a toujours un contexte factuel spécifique à la procédure.
Par exemple, voilà quelques années, nos voisins belges ont été condamnés parce que les arrêts de cours d'assise belges n'étaient pas motivés. Le barreau français s'est immédiatement mobilisé pour faire évoluer la législation française, ce qui advint finalement. Seulement, entretemps, la CEDH avait rendu deux arrêts concernant la non-motivation des jugements de cours d'assise en France. Dans une affaire, avec un contexte factuel précis, la France a été condamnée tandis que, dans l'autre affaire, avec un contexte factuel différent, la non-motivation a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.
On voit que les jugements de la CEDH sont toujours circonstanciels et dépendent d'un contexte juridique particulier.
Ainsi, on peut penser qu'avec une argumentation mieux construite et mieux débattue que ce que l'Italie a présenté dans l'affaire Grande Stevens, la France pourrait gagner devant la CEDH sur le même sujet. Il faut, je crois, que nous défendions un système auquel nous croyons.
Par ailleurs, je crois que nous sommes désormais dans un système circulaire entre les jurisprudences de cours suprêmes européennes. L'arrêt de la CEDH ne clôt pas le débat. À cet égard, je crois qu'il y a en Europe une forme de « marché de la sanction », ce qui pose la question des réseaux entre autorités de sanction, y compris l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Nous sommes dans un jeu ouvert entre autorités.

Je voudrais tout d'abord vous interroger sur le champ d'intervention des régulateurs financiers. On constate qu'il y a souvent un défaut d'information des épargnants et des scandales, par exemple dans le domaine de l'investissement immobilier, du trading sur devises mais aussi, plus étonnant, des manuscrits ! La législation actuelle couvre-t-elle tous ces cas pour assurer une régulation financière et une protection des épargnants complètes ?
Par ailleurs, s'agissant du plafond des sanctions pécuniaires, l'AMF a-t-elle déjà utilisé le plafond dont elle dispose, à savoir le décuple du profit réalisé ? Je crois qu'en la matière, l'enjeu est l'exemplarité : ne faut-il pas aller plus loin que les sanctions existantes et se saisir de l'échelle des plafonds existants pour rendre les sanctions véritablement dissuasives ?

Je voudrais revenir sur la question des valeurs fondamentales du groupe social. S'il y a mise en cause pénale, c'est qu'il y a une responsabilité. Or, le problème politique et éthique auquel nous sommes confrontés est la question de l'irresponsabilité. L'opinion publique a le sentiment que le système permettrait de couvrir ou de tolérer certains manquements et certains abus en matière boursière. Le citoyen a du mal à supporter la disproportion qu'il ressent entre les peines prononcées dans le droit commun et celles prononcées dans le milieu financier.
Par ailleurs, je voudrais également revenir sur la question des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié dévoile une information, il risque le licenciement de son entreprise. Que fait l'État pour les protéger ? Sans aller jusqu'au système américain de rémunération proportionnelle des lanceurs d'alerte, ne faut-il pas encourager la dénonciation de certains systèmes abusifs ?

Comme le rapporteur général, je m'interroge sur les angles morts de nos textes actuels. Je pense aux investissements immobiliers mais aussi, par exemple, aux matières premières. Je pense, enfin, au conseil en vente de produits financiers aux collectivités territoriales ; cette activité ne repose sur aucun agrément et il n'y a aucun contrôle !
Par ailleurs, parvient-on à sanctionner les défaillances en matière de contrôle interne ? Les sanctions sont-elles suffisantes ?
L'action de groupe a été récemment créée. Y a-t-il de saisines vous concernant ? Cela représente-t-il pour vous un accroissement potentiel d'activité ?
Enfin, la régulation financière est traversée par la différence d'appréciation entre le droit continental et le droit anglo-saxon. Sur le débat qui nous agite, en particulier le non bis in idem, quelle est l'attitude du Royaume-Uni ?

Quelle est la procédure de nomination à la commission des sanctions de l'AMF ? J'ai le souvenir d'une nomination très controversée d'une ancienne banquière d'UBS, ce qui posait question au regard de certaines pratiques de cette banque. Il en va de la crédibilité de notre système de régulation et de sanction.
Par ailleurs, s'agissant des lanceurs d'alerte, je voudrais savoir si l'AMF utilise des informations qui lui sont fournies par ce type d'informateurs.
Sur le trading à haute fréquence, un ancien banquier m'a confié qu'il fallait six mois de travail à l'AMF pour contrôler cinq à dix minutes de transactions. Je m'adresse à Gérard Rameix : pouvez-vous confirmer ce chiffre et, si oui, comment contrôler ? Votre prédécesseur à l'AMF, Jean-Pierre Jouyet, avait déclaré à propos du trading à haute fréquence le 23 novembre 2011 dans le journal Les Échos que « L'intégrité du marché ne pourra être assurée qu'en le supprimant ou en le limitant ».

La régulation et les sanctions sont une question d'éthique, de morale, de confiance et de transparence. Le système est complexe, à tel point que nous pouvons nous demander quel est le rôle du législateur : le politique ne maîtrise pas ce qui se passe sur les marchés financiers. Par ailleurs, je partage l'interrogation de Claude Raynal sur la disproportion entre les peines de prison pour des faits mineurs et les sanctions prononcées en matière financière, qui sont relativement faibles.

Je crois qu'il faut que les régulateurs aient les moyens de réguler en disposant d'un arsenal répressif. Nous avons été partisans de pousser au maximum les pouvoirs de répression administrative, mais nous nous heurtons à un certain moment à l'article 40 du code de procédure pénale. Comment assurer l'articulation dans ces conditions ?
Par ailleurs, s'agissant des affaires relatives aux contrats d'assurance vie en déshérence, quel est le montant total des avoirs concernés ? Et avez-vous pu identifier les profits réalisés par les assureurs dans ce cadre sur l'ensemble de la période ?

Certains citoyens s'étonnent de ce qu'ils perçoivent comme un manque de coopération des autorités dans l'affaire Helvet Immo, qui concernent des contestations de particulier sur des prêts libellés en francs suisses.
On a assisté récemment à des sanctions très importantes de banques françaises aux États-Unis. On a le sentiment que les banques étrangères sont beaucoup moins sanctionnées en France ; un article de presse récent indiquait que Dexia avait été mal conseillé dans certaines transactions par des banques américaines, et invitait l'État français à engager des poursuites contre les banques américaines. Y a-t-il un déséquilibre ? L'AMF est-elle prête et armée pour répondre à ce type d'affaires ?
La question posée par le sénateur Marc Laménie est essentielle : quel est le rôle du législateur ? Les normes européennes et celles prises par des réseaux de régulateurs mondiaux semblent réduire considérablement le rôle du législateur national. Du point de vue technique, on peut en effet avoir l'impression que le législateur n'a plus qu'à recopier ce qui a été décidé ailleurs, notamment aux États-Unis. En fait, c'est faux : le législateur a pour mission de mettre des valeurs dans le système, ce qui est fondamental. Ce n'est pas au régulateur de le faire, mais bien au législateur. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège du discours de la complexité et de la technicité.
S'agissant des plafonds de sanction, je voudrais rappeler que l'amende payée par BNP Paribas aux États-Unis n'est pas une sanction mais une transaction. C'est un contrat, un « deal », ce qui change tout ! Un article paru dans The Economist au mois d'octobre critiquait les récents développements des procédures américaines qui s'apparenteraient à un « racket », puisque dans les procédures de transaction, il n'y a pas de procédure organisée, pas de droits de la défense. La transaction, elle se fait le pistolet sur la tempe !
Dans le même temps, les agences de notation, qui sont en partie responsables du déclenchement de la crise financière, ont été poursuivies en responsabilité aux États-Unis. On a récemment appris que la plus importante d'entre elles avait passé une transaction lui permettant d'acheter son irresponsabilité totale pour un milliard de dollars. Ce n'est pas cher payé pour 1 000 milliards d'euros de coût de la crise financière en Europe !
Dans un cas, le prix à payer semble élevé, dans l'autre il semble faible : mais dans les deux cas, on constate que le prix de la transaction est fixé de façon opaque. C'est pourquoi c'est au législateur de donner des fourchettes et des critères d'appréciation. L'opinion publique a le sentiment d'une irresponsabilité des acteurs financiers dans le cadre de ces accords, alors qu'elle voit des peines de prison pour d'autres faits qu'elle estime plus mineurs. Or, la peine de prison, elle, ne s'achète pas.
Sur le champ de compétence des régulateurs financiers, il y a quelques problèmes de frontière mais ils sont finalement assez pointus. Dans l'immobilier, cela dépend vraiment du cadre. Nous sommes compétents si c'est un produit de placement collectif. Si c'est une vente immobilière, même en time sharing, cela ne relève pas de nous.
Le principal sujet pour moi est que l'AMF soit à la hauteur des défis techniques qui lui sont posés, notamment pour ce qui concerne le trading à haute fréquence. Sur le fond, je partage l'opinion de Jean-Pierre Jouyet sur ce sujet. Le problème est que ni l'AMF, ni même le Gouvernement français, n'ont les moyens de cette politique. C'est un sujet qui doit se traiter au niveau européen et mondial. Nous menons la bataille pour que limiter les conséquences de ces pratiques et mieux les réguler, mais si la France est seule à prononcer une interdiction, nous ne ferons que porter atteinte à la place financière de Paris.
Il nous faut également être à la hauteur dans le champ des matières premières. C'est une compétence nouvelle que nous a confiée le législateur, il faut monter les équipes et développer les compétences nécessaires. Nous nous y attachons.
S'agissant de savoir si nous avons déjà atteint dans les sanctions prononcées le plafond de dix fois les gains réalisés, qui existe depuis 1989, la réponse est non. Le multiple employé par la commission des sanctions est plutôt de trois ou quatre fois les profits. Quant au plafond de 100 millions d'euros, il ne nous a pas gênés pour l'instant, car nous n'avons pas eu d'affaire d'une ampleur suffisante.

On constate pourtant qu'il y a encore en France des affaires de pyramide de Ponzi, des « petits Madoff ». S'agit-il d'un défaut d'information du public ou d'un problème de champ de compétence du régulateur ? Il y a également des affaires mettant en cause des placements collectifs portant sur des oeuvres d'art ou même des manuscrits. Enfin, je suis très étonné par la persistance des publicités proposant au grand public de spéculer sur le marché des devises.
Il existe effectivement des limites au champ de compétence de l'AMF : si quelqu'un vient se plaindre auprès de nous d'avoir été lésé du fait d'un investissement immobilier en time sharing, nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir une enquête car ce n'est pas de notre domaine. Il y a d'autres situations plus problématiques. Certaines activités ne peuvent être exercées que sur agrément préalable de l'AMF. Si une personne exerce avec agrément, l'AMF peut sanctionner d'éventuels manquements, alors que si elle exerce sans agrément, l'AMF est obligée de transmettre l'affaire au juge pénal, qui a parfois d'autres priorités. Je trouve cela très choquant. Le législateur pourrait régler ce problème.
Au-delà des questions de champ, il y également des problèmes d'effectivité. Certaines personnes font des choses interdites, que nous pourrions sanctionner, mais que nous ne trouvons que quand le mal est fait. Pour les escroqueries du type Madoff, nous disposons de tous les textes pour réprimer cela, que cela soit devant le juge pénal ou la commission des sanctions. Le problème est de les détecter avant qu'elles n'aient causé des dommages majeurs.
En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les infractions financières sont insuffisamment réprimées. Je crois que l'on confond trop souvent faute de gestion et infraction. Vous avez des gens qui provoquent des dommages importants en raison de fautes de gestion qui ne sont pas qualifiables d'infractions, que cela soit par nous ou par le juge pénal. Le fait de très mal gérer n'est pas en soi une faute susceptible d'être punie.
Il faut par ailleurs noter que lorsqu'il y effectivement un manquement, nous avons une politique assez sévère qui consiste à poursuivre à la fois la personne morale et le dirigeant lorsque celui-ci à une implication personnelle dans la faute commise. Les décisions récentes de la Commission des sanctions en ont donné des exemples. Nous pensons qu'il faut responsabiliser au maximum les dirigeants. On souligne souvent l'importance du pénal à cet égard, mais il faut rappeler que les amendes pénales sont ridicules. Les amendes qu'un juge pénal peut prononcer même dans des affaires très sérieuses sur les trois principales infractions d'atteinte au marché sont bien plus faibles que celles que nous pratiquons. Éliane Houlette, le procureur national financier, le dit elle-même. Quel que soit le devenir des compétences respectives de l'AMF et du juge pénal, il faut réviser le champ pénal. Les peines de prisons sont très rares.
S'agissant des lanceurs d'alertes, c'est effectivement un sujet important et des textes européens vont nous obliger à mettre en place un statut protecteur. Nous utilisons les alertes qui nous sont adressées, qu'elles soient individuelles ou qu'elles viennent d'intermédiaires financiers qui doivent nous signaler les anomalies qu'ils détectent sur un compte. La présidente de la Securities and Exchange Commission se vante de l'efficacité de son système de lanceurs d'alerte, mais il faut dire qu'elle les rémunère avec un pourcentage des pénalités prononcées, ce qui n'est pas encore dans la culture de notre pays. Il reste en tout cas des choses à faire pour améliore la protection du lanceur d'alerte.
Pour ce qui concerne l'action de groupe, c'est une procédure récente qui va se développer dans le champ de la commercialisation des produits financiers. Nous avons proposé au législateur, qui nous a suivis, de nous autoriser à transmettre au juge civil des éléments de nos enquêtes, ce qui n'était pas possible. Cela fournit des éléments de preuve difficile à réunir autrement dans une action civile.
S'agissant de la question du non bis in idem dans le système britannique, il faut reconnaître que l'articulation entre l'administratif et le pénal est bien meilleur. Leur système pénal est très différent. Il n'y a pas de juge d'instruction et c'est la Financial Conduct Authority qui joue le rôle d'autorité de poursuite au pénal à l'aide des preuves qu'elle a recueillies au cours de son enquête. Le système pénal est très répressif et rapide, malgré un niveau de preuve élevé, et peut être précédé d'une transaction. En pratique, il n'y a pas de cumul. Les Britanniques ne sont donc pas confrontés aux mêmes difficultés que nous, même si je dois dire je suis assez d'accord avec l'analyse de Jean-Luc Sauron. En répondant tout à l'heure sur le sujet du non bis in idem, je me plaçais simplement dans la perspective suggérée par Marie-Anne Frison-Roche d'une application stricte d'un principe de non-cumul.
Sur les nominations à la Commission des sanctions, celle-ci est composée pour un tiers de membres de la Cour de cassation et du Conseil d'État, désignés par le président de chacune de ces juridictions, et pour deux tiers de professionnels, désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Pour revenir sur le trading à haute fréquence, il est vrai que c'est très lourd et très technique, mais nous avons la capacité à mener des enquêtes. Une grande société américaine a été obligée, lors de sa tentative d'introduction en bourse, de publier le fait qu'elle était poursuivie par nous pour manipulation de cours dans le cadre de son activité de trading à haute fréquence. Nous y arrivons même si cela nous coûte beaucoup en temps et en ressources.
S'agissant de l'article 40 du code de procédure pénale, nous l'appliquons depuis toujours, mais les textes qui régissent la coopération entre le parquet et nous vont plus loin. Depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, dès lors que le collège décide d'engager des poursuites pour des infractions susceptibles de recevoir une qualification pénale, j'adresse systématiquement au parquet une copie du courrier de saisine de la commission des sanctions. En général, le parquet attend l'issue de notre procédure et classe l'affaire s'il juge que la sanction prononcée est suffisante. Dans quelques cas, les deux procédures se déroulent parallèlement. La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet désormais au parquet de nous transmettre des informations, y compris pendant une enquête et non plus seulement à partir de l'engagement d'une procédure de sanction. Cela autorise une meilleure coopération entre les deux « polices » : la police financière spécialisée que mes équipes représentent d'une certaine façon et le parquet qui conduit une enquête de police préliminaire peuvent s'échanger des informations sans difficulté juridique.
Vous m'avez également posé une question très difficile : pourquoi aucun régulateur en Europe n'a mis en cause les distributeurs de produits subprime qui ont infesté certains établissements et sociétés de gestion en Allemagne et en France ? Cela a pris des années aux États-Unis : ils viennent seulement de le faire. Nous, nous ne l'avons pas fait. C'est peut-être une erreur, mais nous aurions eu du mal à collecter des éléments pour être efficaces dans la répression de fautes qui avaient été commises en dehors de notre territoire.
Sur les matières premières, nous sommes compétents depuis la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. Le Parlement a porté, à juste titre, une attention particulière sur ce domaine. Nous pouvons maintenant sanctionner directement les manipulations d'indice et nous travaillons sur les missions qui nous ont été confiées. En revanche, sur le marché des devises, nous ne sommes pas directement compétents. Je me suis posé la question de l'autorité compétente pour ce marché très internationalisé. Nous devons travailler avec l'ACPR sur ce sujet. Nous n'intervenons pour l'instant qu'en cas de distribution d'instruments financiers permettant de spéculer sur le marché des devises, ce qui est d'ailleurs extrêmement dangereux.
En tant que président de l'autorité de sanction, je rappelle tout d'abord que je ne peux pas répondre s'agissant des poursuites engagées par l'ACPR.
L'ACPR est une autorité de discipline professionnelle. Dès lors, elle ne peut sanctionner que les professions qui sont réglementées. Certes, son champ de compétence s'est élargi à la faveur de l'accroissement des règlementations ; par exemple, les établissements de paiement sont désormais dans le champ de l'ACPR.
Je crois qu'il ne faut pas focaliser le débat sur la comparaison avec les États-Unis où la philosophie est différente. Si on regarde les pays continentaux qui nous entourent et dont la philosophie répressive est proche de la nôtre, nous sommes un pays très répressifs, par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie par exemple.
Nous sanctionnons des manquements à des obligations professionnelles qui le plus souvent ne correspondent à aucune infraction pénale. Nous sanctionnons le plus souvent des personnes morales, des structures : par exemple une non-conformité du contrôle interne est imputable à toute une structure et non à une ou plusieurs personnes en particulier. Mais il nous arrive de prononcer une sanction contre une personne physique, un dirigeant notamment ou un courtier en assurance, lorsque nous pouvons personnaliser l'infraction.
Nous avons des procédures récentes ou en cours pour insuffisance du contrôle interne ; en effet, la réglementation est très intrusive en la matière et elle prévoit un contrôle de premier degré, un contrôle de second degré, un contrôle permanent, un contrôle périodique, etc.
Par ailleurs, nous sanctionnons également des banques étrangères et leurs filiales ; nos feux ne sont pas concentrés sur les banques françaises. Vous devriez le constater dans certaines décisions à venir.
Pour répondre à Maurice Vincent, je n'ai pas connaissance du dossier Helvet Immo.
S'agissant des décisions portant sur l'assurance vie, la commission des sanctions ne s'est pas engagée sur la voie de la détermination des profits réalisés par les compagnies. En effet, les entreprises d'assurance ont soutenu qu'elles n'avaient pas réalisé de profits.
Elles ont indiqué qu'il y avait des frais de gestion liés au maintien de ces sommes et que des intérêts importants ont été comptés pour des sommes reversées avec retard. Elles ont également souligné que les produits étaient affectés à une provision de participation aux excédents et n'étaient donc pas intégrés au résultat bénéficiaire. En tout état de cause, ce débat était technique et l'autorité de poursuite, qui n'a d'ailleurs pas vraiment cherché à le faire, n'a pas été en mesure de prouver qu'il y avait eu des profits indus. Nous ne nous sommes donc pas placés sur ce terrain pour fixer le niveau de la sanction.
S'agissant des lanceurs d'alerte, il existe déjà une disposition du code monétaire et financier, dans le champ du prudentiel, qui prévoit que les salariés des établissements et du régulateur ont la possibilité de lancer des alertes dans des conditions qui assurent leur protection. Cette disposition pourrait être la base d'un élargissement. Je rappelle que dans l'affaire UBS, il y avait en parallèle une affaire pénale et une affaire disciplinaire dont le point de départ était une alerte des salariés de l'établissement en question.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ce matin, c'est le mélange entre le moral et le pénal. Le système pénal, c'est la sanction, c'est le fait social. Il ne faudrait pas faire de rétro-pédalage par rapport à des lois adoptées voilà quelques années, comme la loi Badinter sur les règlements judiciaires qui a mis fin à la connotation morale extrêmement forte sur le failli. Cette espèce de vapeur morale n'est pas utile.
Le système britannique permet aussi le cumul. Dans le rapport de l'AEMF, il est désigné comme un système de cumul.
Mais pas en pratique.
Oui, leur pratique conduit à éviter le cumul. Dans certains domaines, le cumul est total. Pour répondre à la question du sénateur Bouvard, en fonction des délits, le système n'est pas totalement le même. C'est très britannique, donc extrêmement fin.
Une de mes anciennes collègues dirige l'administration qui saisit les biens des délinquants et criminels. C'est une méthode très efficace : taper sur ce qui a été accumulé depuis des années les dérange beaucoup plus que d'aller passer quelques années en prison.
Le président Rameix a raison : les amendes pénales ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Les sanctions administratives permettent d'être condamné pécuniairement et ce n'est pas anodin, car les actionnaires viennent ensuite demander des explications.
Le dernier point, qui affaiblit les sanctions administratives, tient aux victimes : le système administratif ne gère pas les victimes. J'ai été juge d'instruction spécialisé dans les matières financières. Certaines affaires étaient, techniquement, des batailles d'experts. Je rendais parfois des non-lieux car, dans le respect total des textes, selon que je choisissais tel ou tel ratio, la personne était du bon ou du mauvais côté de la loi.
Ce sont des matières fort complexes - nous le voyons au Conseil d'État - et les collègues qui ont longtemps travaillé dans ces domaines apportent toujours un éclairage précieux.
Le système français n'est pas si mal que cela avec la petite faiblesse que j'évoquais sur les victimes et de l'insuffisante publicité. Au 20 heures, on évoque des peines avec sursis qui font trembler tout le monde mais on ne parle pas des peines pécuniaires considérables en matière financière, alors que la publicité peut être ressentie comme une peine en soi.
Peut-être ne parle-t-on pas assez de nos peines, néanmoins je crois que, dans l'appréciation du caractère dissuasif et proportionné de notre système, il faut bien considérer que, pour les établissements que nous avons devant nous, le problème principal, c'est la publicité de la procédure. Tous nous demandent d'anonymiser nos décisions, ce que nous refusons la plupart du temps. Depuis deux ou trois ans, toutes nos décisions sont publiques avec le nom de l'établissement sanctionné.
L'effet répressif et pédagogique des sanctions est fort parce qu'elles portent sur des professionnels, qui sont sous l'oeil d'autres professionnels. L'action répressive se veut aussi préventive. Des décisions publiques, scrutées par les professionnels, commentées dans les revues spécialisées, ont un effet certain.
J'ai toujours milité pour la publicité, même si cela a pu freiner la composition administrative.

Je vous remercie d'avoir organisé cette audition. Je suis heureuse que Marie-Anne Frison-Roche ait pu intervenir, avec sa radicalité qui n'est pas forcément la mienne. On peut le déplorer, mais on constate sur certaines affaires que la justice judiciaire n'est pas toujours la mieux à même de se prononcer sur ces dossier ; c'est pourquoi, à titre personnel, je pense qu'il faut améliorer le système tel qu'il est, en donnant également les moyens aux régulateurs de remplir leurs missions, qui sont de plus en plus importantes. C'est une question de cohérence.
C'est un sujet complexe techniquement et économiquement, avec des injonctions contraires. Il faut à la fois montrer de la sévérité vis-à-vis de l'opinion publique, de la pédagogie vis-à-vis des acteurs, et de l'attractivité pour les investisseurs de la place - il ne s'agit pas de devenir l'Albanie des années 1960, il nous faut des entreprises industrielles. Nous avons besoin de créer la confiance.
Il nous faut trouver un compromis acceptable par tous sur ce qui est considéré comme grave. La notion de gravité n'a pas le même écho pour tous : pour une entreprise, avoir son nom associé à une sanction publiée est grave, alors que ça ne l'est pas forcément pour des citoyens. Les citoyens s'adressent à ces autorités même pour des sujets sur lesquels elles ne sont pas compétentes, ce qui est le symptôme de l'attente qu'elles suscitent.
Je crois que nous sommes dans une guerre entre le modèle anglo-saxon et le modèle continental. Même si l'articulation entre le pénal et l'administratif est encore à parfaire, j'ai une préférence pour notre modèle où tout ne s'achète pas.
En France, nous avons fait un travail important sur les fonds en déshérence, qui sont un sujet sensible. Je regrette, à titre personnel, que les assureurs n'aient pas tiré les leçons du passé, en particulier de la mission Mattéoli.
Au total, je plaide pour la formation et l'information en amont : j'ai été frappé de la vigilance des étudiants de Marie-Anne Frison-Roche, que j'ai rencontrés, qui sont à la fois passionnés par la banque et la finance et conscients des enjeux. Nous voulons des entreprises sur notre territoire, donc des banques ; il faut travailler de façon rationnelle. J'ai constaté, en tout cas, que nous avions un système répressif qui fonctionne et qu'il n'y a pas cette impunité généralisée parfois imaginée par certains.
S'agissant de l'élargissement des nominations au sein des organes de sanction, je crois qu'il serait possible et souhaitable d'élargir la composition car il existe des gens compétents qui ne sont pas forcément « du sérail ».

Je vous remercie, en souhaitant bonne chance et bon courage à nos nouveaux rapporteurs pour le travail qui les attend.
La réunion est levée à 12 h 40.