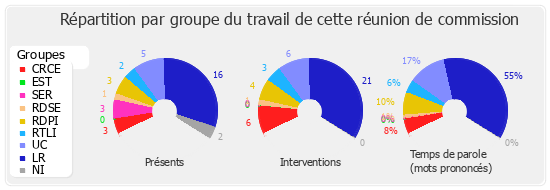Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 20 janvier 2016 à 9h00
Sommaire
- Suivi de l'état d'urgence
- Audition de m. jean-marc sauvé vice-président du conseil d'état et m. bernard stirn président de la section contentieux du conseil d'état (voir le dossier)
- Nomination d'un rapporteur (voir le dossier)
- Suivi de l'état d'urgence
- Prévention et lutte contre les incivilités contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
- Communication de m. françois pillet sur l'issue des commissions paritaires relatives à la proposition de loi relative à la protection de l'enfant et à la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (voir le dossier)
La réunion
La commission entend M. Jean Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Je remercie MM. Sauvé et Stirn d'être venus pour cette audition suggérée par M. Mercier, rapporteur spécial du comité de suivi de l'état d'urgence. Nous avons souhaité vous entendre sur les instruments de contrôle des décisions administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence, qu'il s'agisse de perquisitions, d'assignations à résidence ou de décisions limitant la liberté d'aller et venir et la liberté de réunion et de manifestation. Il est désormais temps de faire le bilan des deux premiers mois d'application de l'état d'urgence car il est possible que le Gouvernement souhaite le prolonger, dans l'attente de l'examen d'éventuelles dispositions législatives tendant à rendre permanents un certain nombre de pouvoirs que l'autorité administrative tire de la mise en oeuvre de l'état d'urgence. Nous nous inscrivons également dans un contexte dans lequel la ligne de partage en matière de protection des libertés, entre ce qui relève du juge administratif et ce qui relève du juge judiciaire, fait débat, ce qui donne l'occasion de faire oeuvre de pédagogie à ce sujet.
Je voudrais tout d'abord évoquer le cadre constitutionnel de l'état d'urgence, tel qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 25 janvier 1985 sur la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a écarté le moyen tiré de l'abrogation implicite de la loi du 3 avril 1955 avec l'entrée en vigueur de la Constitution le 4 octobre 1958, mais ne s'est pas prononcé à l'époque sur le fond de la constitutionnalité de cette loi. Il s'est borné à dire qu'elle était toujours en vigueur.
Dans la décision Cédric D. du 22 décembre 2015, rendue à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État, lui-même saisi de la contestation d'une assignation à résidence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 6 de la loi de 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, était conforme à la Constitution. Il a rappelé que le juge judiciaire était le gardien de la liberté individuelle mais que les mesures d'assignation à résidence, telles qu'elles étaient contestées devant lui, ne constituaient pas une mesure privative de liberté, dès lors que l'astreinte à domicile ne dépassait pas 12 heures par jour et qu'il n'y a pas plus de trois pointages par jour. L'assignation à résidence constitue donc une mesure restrictive de liberté qui ne contrevient pas à l'article 66 de la Constitution. Sur la conformité aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacrent la liberté d'aller et venir, et à l'article 34 de la Constitution, les mesures d'assignation à résidence ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence a été déclaré et édictées qu'à l'encontre de personnes dont on a des raisons de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Elles doivent être édictées et appliquées dans le respect du principe de proportionnalité ; leur durée ne peut excéder celle de l'état d'urgence, et en cas de prorogation de celui-ci, elles doivent faire l'objet d'un réexamen. Le Conseil constitutionnel a enfin jugé que le juge administratif devait contrôler le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures d'assignation à résidence à la fois sur le principe et sur les modalités de ces mesures. Le commentaire dans les cahiers du Conseil constitutionnel a bien noté l'évolution de la jurisprudence administrative, c'est-à-dire le basculement de ce qui était de la haute police dans les années 1950, devenu le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du Conseil d'État du 25 juillet 1985 Dame Dagostini, à un entier contrôle de proportionnalité. Le commentaire aux cahiers fait l'historique de l'évolution et de l'intensification du contrôle opéré par le Conseil d'État et souligne également l'appropriation par le juge administratif des standards internationaux en matière de contrôle de proportionnalité. En réalité, quand il se prononce le 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a en toile de fond la décision rendue par la section du contentieux du Conseil d'État le 11 décembre 2015 Cédric D., et cette décision procède précisément à l'extension du contrôle du juge et opère pour la première fois ce contrôle de proportionnalité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel, onze jours plus tard, fait une déclaration de conformité à la Constitution de l'article 6 de la loi de 1955 sous condition, une condition dont il sait qu'elle est respectée.
Le Conseil constitutionnel s'est aussi prononcé le 22 décembre 2015, de manière positive, sur la conformité de la loi de 1955 modifiée, au regard des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il a constaté que les mesures d'assignation à résidence pouvaient être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
Je voudrais aborder maintenant l'avis du Conseil d'État du 11 décembre 2015 sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, en tant qu'il constitutionnalise l'état d'urgence ; je laisse de côté la question de la déchéance de nationalité. Le Conseil d'État a souligné l'effet utile des dispositions de ce projet de loi en ce qui concerne l'état d'urgence. Il constate que le projet de loi constitutionnelle donne un fondement incontestable aux mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles pendant l'état d'urgence, et permettra leur extension par le législateur ordinaire avec des mesures comme le contrôle d'identité ou la visite des véhicules. Ce texte permet également d'encadrer la déclaration et le déroulement de l'état d'urgence, en apportant des précisions de fond et de procédure, qui ne relevaient jusqu'ici que de la loi ordinaire, que le législateur pouvait donc modifier de manière discrétionnaire, notamment les motifs de la déclaration de l'état d'urgence, la saisine du Parlement pour prorogation et la durée de celle-ci.
Le Conseil d'État a souligné que l'état d'urgence ne saurait, par l'effet de prorogations successives, devenir permanent. Si la menace à l'origine de l'état d'urgence devient permanente, il faut recourir à des instruments de lutte permanents, en leur donnant si besoin un fondement constitutionnel durable.
Dans cet avis, le Conseil d'État a également admis la conformité à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions relatives à l'état d'urgence. Cela a confirmé l'arrêt de l'assemblée du contentieux du 24 mars 2005 Rolin et Boisvert. Il a enfin écarté les dispositions prévoyant un dispositif transitoire d'extinction de l'état d'urgence. Ce dispositif prévoyait la possibilité de maintenir, au-delà de la période pendant laquelle l'état d'urgence s'applique, les effets de mesures individuelles et de mesures générales. Le Conseil d'État a considéré que si les conditions étaient réunies, il devait y avoir prorogation. Si ces conditions ne sont plus réunies, il faut alors en sortir.
Concernant la compétence juridictionnelle pour connaître des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, depuis les origines de la République, le juge administratif est compétent pour les mesures prises à titre préventif pour la protection de l'ordre public ou la prévention des infractions. Le régime des fermetures de débits de boissons, d'interdiction de réunion ont toujours relevé de la compétence du juge administratif, de même que les régimes de police spéciale, comme la police des étrangers. Ces pouvoirs ont toujours été étendus, par voie législative ou jurisprudentielle en temps de circonstances exceptionnelles. Ces derniers mois, le Conseil d'État, bien avant le début de l'année 2016, s'est montré très attentif au respect des prérogatives que l'autorité judiciaire tire de l'article 66 de la Constitution, qui affirme que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés. J'en donnerai quatre exemples.
Le 11 décembre 2015, il a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 sur l'assignation à résidence, notamment au regard de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil d'État a donc posé la question du contrôle du juge administratif sur les mesures d'assignation à résidence.
Le 15 janvier 2016, le Conseil d'État a renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des articles 8, concernant la fermeture des salles de spectacles et des débits de boissons, et 11, relatif aux perquisitions administratives de la loi du 3 avril 1955. Le Conseil constitutionnel aura à se prononcer sur la conformité de ces dispositions au regard de l'article 66 de la Constitution.
Dans son avis du 11 décembre 2015, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la protection de la Nation, il a donné un avis négatif sur la partie du projet de loi plaçant sous l'exclusif contrôle du juge administratif l'ensemble des mesures prises par l'autorité administrative pendant l'état d'urgence. Même si l'avis du Conseil d'État est elliptique sur ce point, il considère par exemple qu'une mesure de privation de liberté prise dans le cadre de l'état d'urgence n'a pas à relever de la compétence du juge administratif. Il y aurait sinon eu une dérogation expresse à l'article 66 de la Constitution, que le Conseil d'État a estimé non souhaitable.
Dans son avis du 17 décembre 2015 sur différentes questions posées par le Gouvernement sur les mesures restrictives de liberté pouvant être prises en dehors de l'état d'urgence, le Conseil d'État mentionne les articles 7 et 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 66 de la Constitution, et affirme de manière très ferme « qu'au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, en vertu desquels l'autorité judiciaire est chargée d'assurer le respect de la liberté individuelle, toute détention doit être décidée par l'autorité judiciaire ou exercée sous son contrôle. Il appartient aux autorités de police administrative (...) de prendre des mesures à caractère préventif qui peuvent comporter des mesures affectant ou restreignant des libertés, mais elles ne peuvent prendre à ce titre des mesures privatives de liberté ». Il rappelle donc que l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge administratif, prendre des mesures restrictives de liberté mais dans des cas ponctuels, par exemple le placement en hospitalisation d'office pendant quelques heures avant l'intervention du juge judiciaire ou la rétention des étrangers dans les premiers jours de leur interpellation. Ces exceptions sont minimes et ponctuelles.
Je voulais souligner en quelques points la nature du contrôle opéré par le juge administratif. C'est tout d'abord un contrôle exercé a posteriori, dans un délai de quelques heures à quelques jours. C'est un contrôle qui s'opère selon les procédures d'urgence, référé-liberté ou référé-suspension. Le Conseil d'État a garanti dans tous ces cas un droit à l'audience. En cas d'assignation à résidence, il a jugé qu'il y avait présomption d'urgence et que par conséquent, la requête ne pouvait être rejetée sans audience. Il y a un entier et strict contrôle sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures prises au regard de la menace représentée par le personne assignée à résidence. Ce triple contrôle s'applique tant au principe qu'aux modalités de la mesure, par exemple la durée de l'astreinte à domicile ou les obligations de pointage. Enfin, le juge mène une instruction approfondie, qui se poursuit à l'audience. L'ensemble des faits et des informations allégués par l'administration est soumis à un débat contradictoire, et le juge se détermine évidemment en fonction du résultat des échanges entre les parties. Des suppléments d'instruction peuvent être décidés, et il y a eu pluralité d'audiences dans certains cas. L'information selon laquelle le juge se déterminerait sur la base de notes émanant des autorités publiques du Gouvernement sans aucune discussion est profondément erronée.
Quant aux résultats, au niveau des tribunaux administratifs, où environ 75 décisions ont été prises, il y a à ce stade une douzaine de suspensions ou d'injonctions à modifier l'arrêté d'assignation qui ont été prononcées, et dans au moins deux cas, le ministre de l'intérieur a annulé la décision d'assignation à résidence. Pour le Conseil d'État, il y a eu 19 décisions, sur lesquelles il y a eu 4 annulations par le ministre de l'intérieur, avant ou après l'audience, 2 injonctions et le reste sont des décisions de rejet.
Je voudrais enfin signaler que le contrôle juridictionnel des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence est tout à fait effectif. En réalité, l'état d'urgence n'introduit, par rapport au droit commun, qu'une rupture : la possibilité pour l'administration de prendre des mesures restrictives de liberté sans mandat judiciaire préalable. Le contrôle juridictionnel s'opère alors non plus en amont mais a posteriori, dans des délais très brefs.
Le contentieux relatif à l'état d'urgence devant le juge administratif est significatif sans être massif. À ce jour, pour les tribunaux administratifs, 75 décisions ont été rendues, dont 64 relatives à des assignations à résidence, avec une douzaine de suspensions prononcées par le juge des référés. Devant le Conseil d'État, dix-neuf décisions ont été rendues, y compris les sept décisions de section du 11 décembre, au tout début de l'état d'urgence, qui ont tracé le cadre général du contrôle de l'assignation à résidence. Elles ont conduit à une évolution de la jurisprudence par un renforcement du contrôle du juge administratif et, avec la présomption de l'urgence, à l'obligation de tenir une audience.
Il reste douze affaires, dont quatre cas pour lesquels le ministère de l'intérieur a mis fin de lui-même à l'assignation à résidence, ce qui a conduit le juge à constater un non-lieu, deux recours pour excès de pouvoir déposés par la Ligue des droits de l'Homme, contre un des décrets d'application et une circulaire d'application de la loi du 20 novembre 2015 qui ont donné lieu aux deux QPC actuellement pendantes devant le Conseil constitutionnel sur les interdictions de réunions et les perquisitions administratives. Il y a par ailleurs deux mesures d'injonction ordonnées par le juge des référés du Conseil d'État, l'une concernant une fermeture de restaurant à Cannes, jugée disproportionnée même si la mesure d'assignation à résidence du propriétaire du restaurant a été confirmée, et l'autre portant sur les modalités d'assignation à résidence d'une mère de famille tchétchène à qui l'on demandait de pointer trois fois par jour à dix kilomètres de chez elle, bien qu'elle ait trois enfants et qu'elle ne dispose d'aucun véhicule. Nous avons en outre, parmi ces douze affaires, eu à connaître d'une affaire particulièrement délicate, parmi les premières affaires jugées, concernant la fermeture d'un restaurant à Bobigny qui a donné lieu à deux audiences successives, ce qui est assez exceptionnel en référé et a abouti au rejet de la requête.
J'informe également votre commission que depuis hier après-midi, le juge des référés est saisi d'une nouvelle affaire, comparable, pour laquelle il a ordonné un complément d'instruction. Un nouveau recours de la Ligue des droits de l'homme a également été déposé hier après-midi demandant au juge du référé-liberté du Conseil d'État d'enjoindre au Président de la République de mettre un terme à l'état d'urgence, rien de moins...
Soulignons l'existence de deux affaires périphériques, l'une concernant des articles pyrotechniques à Strasbourg lors des fêtes du réveillon, en application du code de la défense, et l'autre concernant des interdictions de déplacement de supporters de football, en application du code du sport. En l'espèce, les mesures contestées n'ont pas été prises en application de l'état d'urgence, mais le contexte a joué.
Vous pouvez constater que le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel les trois questions prioritaires de constitutionnalité dont il a été saisi : une première fois le 11 décembre 2015 concernant l'assignation à résidence, puis le 15 janvier 2016 concernant les réunions et les perquisitions.
Je souhaiterais faire quelques remarques sur l'expérience du juge des référés du Conseil d'État, qui est le principal concerné. Il statue au vu d'un dossier et d'un débat. Le dossier comprend les pièces produites par les parties, dont les notes blanches du ministère de l'intérieur, qui font partie des pièces du dossier contradictoire soumises à débat. Ces débats sont systématiques. Ils permettent un échange contradictoire approfondi, pour apprécier la matérialité des faits. Au vu du dossier et du débat, le juge peut demander des compléments d'information et se faire une opinion sur la réalité des faits.
Sur l'efficacité d'ensemble du dispositif, soulignons que le ministre de l'intérieur a accepté les suspensions décidées par les tribunaux administratifs, il n'a pas contesté l'ensemble, et de loin, des jugements prononcés. Il a de lui-même, à plusieurs reprises, pris l'initiative de suspendre l'assignation à résidence. Les compétences très larges du juge des référés en la matière sont indispensables : il peut suspendre et enjoindre. Son pouvoir général d'injonction lui a permis, par exemple, s'agissant de l'assignation à résidence d'une mère tchétchène, d'enjoindre des pointages dans la commune du domicile de l'intéressée.

Quelle est la proportion de ces affaires dans lesquelles les mesures prises étaient justifiées par des soupçons d'appartenance à des mouvances d'islamisme radical ou liées au terrorisme ?
Si l'on fait abstraction des sept affaires de principe jugées en décembre dernier, douze dossiers demeurent en instance devant le Conseil d'État, dont quatre ont fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur de mettre fin à l'assignation à résidence, deux concernent une injonction rendue par le juge des référés, deux concernent des QPC en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Dans les autres affaires, des décisions de rejet ont été rendues, mais l'échantillon est petit. Sur les douze affaires, il y a quatre abrogations et deux injonctions. Dans la moitié des cas, la décision du Conseil d'État a donné lieu à une modification totale ou partielle de la situation.

C'est exact, mais il faut aussi prendre en compte les jugements des tribunaux administratifs. Ma question était surtout de savoir si ces affaires sont liées au terrorisme ?
En dehors des sept affaires liées à la COP 21, la pyrotechnie et les supporters de football, nous avons été saisis de neuf affaires sans lien avec le terrorisme. Cela fait donc dix affaires liées au terrorisme.

Vous avez montré l'évolution du rôle du juge administratif, depuis 1919 jusqu'au contrôle entier de proportionnalité que nous connaissons aujourd'hui. Cette évolution est positive mais vous avez souligné aussi que ce contrôle intervient a posteriori. Vous avez esquissé une solution partielle, allant dans le sens du rééquilibrage des droits, avec le droit à l'audience, mais pourriez-vous préciser ce que recouvre exactement cette notion ? Confirmez-vous que cela implique le droit à un avocat ?
Je souhaiterais par ailleurs intervenir sur deux autres aspects. Premièrement, les citoyens disposent-ils de la faculté d'engager une action en responsabilité de l'État pour réparer les conséquences des habitudes, parfois un peu directes, des forces de l'ordre à l'occasion des perquisitions ? Sur quelle base juridique les citoyens qui ont vu leur appartement chamboulé peuvent-ils agir ? En second lieu, je me réjouis de la légère inflexion de la position du Conseil d'État, davantage prompt aujourd'hui à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel confirmerait la conformité à la Constitution des dispositions législatives contestées par le biais des deux QPC en cours d'examen, il aurait finalement lui-même déjà réalisé la révision constitutionnelle que nous nous apprêtons à examiner...

J'avais demandé, avec plusieurs collègues, au Premier ministre de saisir lui-même le Conseil constitutionnel au moment de la modification de la loi de 1955 sur l'état d'urgence, mais il a préféré ne pas le faire pour éviter une éventuelle censure. La position du Conseil d'État, par le biais des QPC transmises, permet d'examiner la constitutionnalité des mesures contestées. Cela prouve au passage que le régime de la QPC permet d'obtenir des décisions rapides, ce qui est très intéressant quand les libertés sont en cause.

A-t-on une idée du temps moyen entre la saisine du Conseil d'État et la décision ? Par ailleurs, l'état d'urgence, instauré dans une situation très précise, sert aussi à traiter des problèmes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Certes, le Conseil d'État veille à ce que la mesure soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Mais il faudrait un lien entre les mesures prises et les objectifs de l'instauration de l'état d'urgence. Ce qui perturbe, ce n'est pas tant l'instauration de l'état d'urgence, voire son renouvellement, que son détournement à d'autres fins. Cette question devrait être abordée.

Nous n'avons parlé que du contentieux en référé, avec des procédures d'urgence et un seul degré de contestation, puisqu'on va directement du tribunal administratif au Conseil d'État statuant en cassation. Nous allons avoir à connaître des contentieux au fond. Je m'interroge sur l'étendue du contrôle juridictionnel sur les perquisitions, qui sont de loin les mesures administratives les plus nombreuses. Elles sont un acte opposable à l'intéressé, faisant grief, et donnent lieu à un contrôle du juge administratif. Une proportion assez faible de perquisitions réalisées dans le cadre de l'état d'urgence a été contestée, moins de 10 %, ce qui peut s'interpréter de deux manières : une partie des intéressés reconnait le bienfondé des perquisitions menées, mais il y aussi, sans doute, une forme de découragement. Pouvez-vous détailler ce que serait le parcours contentieux d'une décision de perquisition, et si celle-ci était déclarée infondée, quelles en seraient les conséquences ?

Je souhaite formuler deux observations. D'abord, il y a une différence considérable entre une autorisation en amont et un contrôle a posteriori. C'est une évolution qui correspond presque à une révolution par rapport aux droits et libertés. Deuxièmement, le débat contradictoire, indispensable, se fait, du côté du ministère de l'intérieur, sur la base de notes blanches. Quelle est la position du Conseil d'État par rapport à l'existence et à l'utilisation de ces notes blanches ?

Un texte fixe-t-il les modalités précises de l'assignation à résidence ? Peut-on par exemple, avec les moyens de géolocalisation dont nous disposons aujourd'hui, contrôler le respect de l'assignation à résidence ? Dans mon département, un dispositif d'assignation à résidence a rendu nécessaire la mise à disposition de deux gendarmes en permanence pour garder une personne. Ce sont des moyens énormes. Ne faudrait-il pas un autre dispositif ? Lorsqu'une personne assignée à résidence peut librement recevoir la presse et s'exprimer, comme c'est le cas dans l'exemple que je citais à l'instant, cela pose problème.

Vous avez tracé de façon subtile et mesurée la ligne de partage entre les ordres judiciaire et administratif pour ce qui concerne la défense des libertés individuelles. Or, le débat public à ce sujet est assez vigoureux, l'autorité judiciaire considérant qu'elle a été marginalisée en la matière. Comment voyez-vous l'évolution de cette ligne de partage, même si vous avez défini celle-ci comme étant limitée dans le temps ?

Nous sommes tous attentifs aux propos des magistrats judiciaires et responsables de l'autorité judiciaire. Je ne crois pas qu'il y ait dans ces propos une remise en cause de deux ordres juridictionnels qui constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il y a plutôt une préoccupation quant aux textes en préparation qui tendraient, hors période d'état d'urgence, à transférer de l'autorité judiciaire à l'exécutif un certain nombre de pouvoirs. À mon sens, il n'y a pas eu de franchissement de cette « frontière » dans la loi relative à l'état d'urgence. Par contre, le transfert, au sein même de l'autorité judiciaire, des pouvoirs du juge d'instruction vers le parquet, ainsi que l'extension des pouvoirs du préfet et de l'autorité de police pourraient modifier cette ligne de partage.
Pour répondre aux questions relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité et à la compétence des ordres juridictionnels, je rappelle que le Conseil d'État a une compétence résultant de la Constitution. En cas de doute, il saisit le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il a fait en lui renvoyant les trois questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant lui. Le Conseil d'État peut également saisir le Tribunal des conflits, ce qu'il ne manque pas de faire régulièrement. Nous sommes confrontés à des questions émergentes que nous ne tranchons pas unilatéralement. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en 1999 sur l'article 66 de la constitution et a confirmé cette jurisprudence le 22 décembre 2015 concernant l'assignation à résidence.
La loi du 30 juin 2000 sur les procédures d'urgence offre la possibilité de rejeter une requête manifestement sans substance. Le Conseil d'État, dans sa décision Cédric D. du 11 décembre 2015, a estimé qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'assignation à résidence. Les procédures d'urgence ne s'appliquent pas en matière de perquisitions car celles-ci sont terminées et ont produit tous leurs effets lorsque le juge est saisi.
Les premières décisions en matière de perquisitions ont été rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le contentieux se situe au fond avec des demandes d'annulation et d'indemnisation. Le juge peut contrôler la légalité et la responsabilité de la puissance publique.
S'agissant des questions qui ne sont pas en relation avec les motifs ayant provoqué l'état d'urgence, l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, fait application de la loi. Pour déclencher l'état d'urgence, il faut qu'existe un péril imminent. S'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne représente une menace pour l'ordre ou la sécurité publics, il peut y avoir assignation à résidence. Si la loi du 3 avril 1955, notamment l'article 6, avait été autrement rédigée, on aurait pu limiter les mesures administratives aux agissements qui ont déclenché l'état d'urgence. Ce n'est pas le cas. Le juge a noté que dans un contexte de menaces extrêmement lourdes pesant sur l'ordre public, si les forces de police sont absorbées par la gestion de flux de supporters ou par les mesures prises dans le cadre d'une conférence internationale, elles sont distraites de leur mission de prévention et de lutte contre le terrorisme.
Les modalités de l'assignation à résidence ont été fixées par le législateur dans la loi du 20 novembre 2015. Auparavant, ces modalités étaient floues. La loi précise désormais que l'astreinte à domicile ne peut excéder 12 heures par jour et les pointages sont limités à trois par jour. Le Conseil constitutionnel a considéré que, dans cette limite, l'assignation est restrictive de liberté et donc sous contrôle du juge administratif. Au-delà, cette assignation à domicile serait privative de liberté et dès lors soumise au contrôle du juge judiciaire.
La surveillance électronique mobile est prévue par la loi de 1955 mais elle est limitée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour des actes de terrorisme, libérées depuis moins de huit ans. La Ligue des droits de l'homme, à l'occasion des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a déposées, a expressément indiqué ne pas contester ces dispositions qui n'ont donc pas été soumises au Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne les procédures administratives, les délais d'examen sont de deux à cinq jours, même pour les affaires de principe soumises à la formation solennelle. Devant le juge des référés du Conseil d'État, l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation organise une permanence gratuite. Toute personne peut, si elle le demande, être assistée gratuitement d'un avocat dans le cadre de la procédure de référé.
Sur le lien avec les mesures ayant déclenché l'état d'urgence, la position adoptée par le Conseil d'État dans sa décision du 11 décembre 2015 a été confirmée par le Conseil constitutionnel le 22 décembre 2015. Les mesures prises ne sont pas limitées aux personnes visées par les objectifs ayant justifié l'état d'urgence.
Les notes blanches constituent un élément d'information pour le juge qui vérifie si elles résistent au débat contradictoire. Le juge peut demander que ces notes blanches soient complétées, comme dans l'affaire dite du restaurant de Bobigny.
Je partage, monsieur le Président, votre analyse sur le partage de compétences entre les ordres juridictionnels. Nous avons été saisis dans un cadre juridique historique, confirmé. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l'efficacité et les garanties de la procédure pénale dont le Conseil d'État est saisi redéfinit les compétences de l'autorité judiciaire, magistrats du siège et magistrats du parquet, et de l'autorité administrative. Ce texte est de nature à modifier les lignes de partage entre les deux ordres de juridictions. À mon sens, il faut faire une distinction profonde entre l'état d'urgence que nous avons connu à plusieurs reprises et le projet de loi qui pose questions : qui décide, sous quel contrôle, sur l'étendue.

Je vous remercie de m'avoir confirmé ce que je craignais. L'état d'urgence peut permettre une extension des mesures dérogatoires au droit commun à tout ce que le gouvernement voudra. C'est quand même un problème et c'est franchement inquiétant.
L'autorité publique peut prendre des mesures pour des motifs qui sont étrangers à ceux ayant déclenché l'état d'urgence mais en toute hypothèse il doit exister une menace pour l'ordre public, ce que contrôle le juge.
Puis la commission entend M. Jacques Toubon, Défenseur des droits.

Nous sommes heureux, monsieur le Défenseur des droits, que vous ayez accepté cette audition proposée par notre collègue Michel Mercier, rapporteur de notre mission de suivi sur l'état d'urgence.
Merci, monsieur le président. Je suis heureux que la loi du 20 novembre 2015 ait institué un contrôle parlementaire que l'Assemblée nationale et le Sénat exercent de façon attentive et qu'au Sénat, vous l'exerciez à travers une série d'auditions. Vous allez d'ailleurs être saisis d'une proposition de loi relative à la sécurité dans les transports, sur laquelle je me suis déjà exprimé et qui s'inscrit dans le contexte actuel du renforcement des mesures de sécurité.
Je n'ai pas la prétention de répéter les propos du vice-président du Conseil d'État et du président de la section du contentieux qui sont en charge du contrôle juridictionnel de l'état d'urgence. Les informations qu'ils vous ont données sont naturellement pertinentes pour savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé mais, surtout, elles vous permettront d'apprécier des nouvelles mesures à prendre pour combattre ce péril imminent. Il convient en effet de concilier à la fois les exigences légitimes de sécurité et la garantie du respect de l'exercice des libertés fondamentales.
Mon institution est jeune, nous n'avons aucune expérience en matière d'état d'urgence. Mais nous souhaitons être utiles. C'est pourquoi, lors de l'institution du contrôle parlementaire sur l'application de l'état d'urgence, nous avons estimé qu'il relevait de notre responsabilité de recevoir toutes les plaintes relatives aux problèmes liées à la mise en oeuvre de l'état d'urgence et de mettre à profit, pour cela, nos 400 délégués territoriaux. Nous examinons les réclamations portées devant nous en toute indépendance et impartialité. La loi organique du 29 mars 2011 nous impose d'apprécier le respect, par les personnes qui exercent des activités de sécurité, des règles légales en matière de nécessité et de proportionnalité, de non-discrimination ou encore de protection des droits de l'enfant. Nous réalisons un compte rendu hebdomadaire de nos activités avec un tableau recensant l'ensemble des informations recueillies sur l'application de l'état d'urgence que nous adressons aux parlementaires. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
D'une manière générale, les comptes rendus relèvent des interrogations sur l'efficacité de l'état d'urgence. Celui-ci apporte-t-il plus que l'application des lois déjà existantes, par exemple, la loi relative au renseignement ou encore la loi antiterrorisme de novembre 2014 ? La question mérite d'être posée.
Sur le plan quantitatif, entre le 26 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, nous avons reçu quarante-deux réclamations portant sur des mesures prises sur la base de l'état d'urgence dont onze pour assignation à résidence et dix-huit portant sur des perquisitions administratives. En dehors de ces réclamations portant sur des mesures prises expressément sur le fondement de l'état d'urgence, nous avons également reçu onze réclamations liées à des situations indirectement liées à l'état d'urgence : quatre refus d'accès à des lieux publics (exclusion d'une salle de cinéma, refus d'accès à un collège d'une mère voilée, refus d'accès à un commissariat pour port de voile), deux interpellations dont une suivie d'une garde à vue, deux licenciements pour port de barbe, une mise à pied disciplinaire avec signalement d'un employeur en raison du surnom inscrit sur le casier de l'employé, une suppression de carte professionnelle, un refus de délivrance de passeport, un contrôle excessif à l'aéroport, une fouille de véhicule en violation du droit à la vie privée des passagers et une interdiction de sortie du territoire.
S'agissant de la répartition géographique des réclamations, on en a relevé quinze en Île-de-France (en particulier dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), six en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, cinq en Auvergne-Rhône-Alpes, quatre en Nord-Pas-de-Calais, trois en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux en Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, une en Picardie, en Centre- Val de Loire, en Bretagne et en Guyane. La plupart de ces réclamations sont en cours d'instruction, sauf celles qui ont fait l'objet d'une issue favorable via une médiation qui a pris la forme soit d'une indemnisation, soit d'un aménagement des conditions d'assignation à résidence.
Sur le plan qualitatif, quelles leçons tirons-nous de l'instruction de ces réclamations et de leur nature ? En ce qui concerne les perquisitions, qui font actuellement l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, les saisines font état d'interventions de nuit, d'un dispositif policier massif, de dégradations matérielles du domicile, de l'utilisation de menottes, de violences physiques et verbales - avec notamment des propos discriminatoires liées à la pratique de la religion musulmane - et de la présence d'enfants lors du déroulement de l'opération. Le plus souvent, ces réclamations relèvent plus d'un témoignage et ne font pas l'objet d'une demande précise, par exemple en matière d'indemnisation. Ces témoignages montrent la mise en cause de la légitimité de la mesure et la manière dont elle a été appliquée.
Sur la question des procès-verbaux et de leurs motifs, dans le cadre de l'instruction de ces réclamations, le Défenseur des droits demande aux réclamants de produire les arrêtés de perquisition avec lesquels les forces de sécurité sont arrivés. La lecture des motifs permet de relever deux types d'arguments. Soit la personne perquisitionnée est connue comme un activiste appartenant à des mouvances djihadistes, c'est-à-dire avec des soupçons fondés de terrorisme. Soit la personne qui fait l'objet d'une mesure de perquisition s'est trouvée, directement ou indirectement, à un degré non précisé en relation avec un activiste de la mouvance djihadiste. Le conditionnel est alors employé lorsqu'il est indiqué que le logement et les véhicules des personnes visées par la perquisition seraient susceptibles d'être utilisés par des activistes djihadistes. Dans ce cas, nous avons affaire à des soupçons supposés de terrorisme.
Les réclamants nous indiquent qu'à la fin d'une opération de perquisition, il leur est lu un procès-verbal mais ils n'en obtiennent pas de copie. Or ils en ont besoin pour solliciter le remboursement des frais occasionnés par la perquisition. Ainsi, la première recommandation que je vous soumets est qu'un procès-verbal indiquant les bris éventuels doit être délivré aux personnes ayant fait l'objet d'une perquisition. La personne indûment perquisitionnée à cause d'une erreur d'adresse devrait également en être bénéficiaire.
Ensuite, s'agissant des saisies informatiques effectuées au cours d'une perquisition, la loi du 20 novembre 2015, qui modifie l'article 11 de la loi de 1995, a prévu un certain nombre de dispositions qui permettent aux autorités publiques d'accéder aux données des systèmes informatiques. Les données stockées ou accessibles peuvent être copiées mais les disques ne peuvent être saisis. La circulaire du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2015 relative aux conditions inhérentes des perquisitions administratives prévoit que « la perquisition administrative ne permet aucune saisie mais autorise que les ordinateurs ou téléphones soient consultés et permet également de procéder aux copies sur tout support. Une saisie des objets ne peut procéder que de l'ouverture d'une procédure judiciaire et être réalisée exclusivement par l'officier de police judiciaire présent. » Sur ce sujet, j'ai une nouvelle recommandation à vous faire : le recueil des données personnelles lors des saisies informatiques dématérialisées réalisées pendant les perquisitions devrait être entouré de garanties quant à la non-utilisation desdites données à d'autres fins que la lutte contre les atteintes à la sureté de l'État. Le but de la loi doit être atteint mais il ne doit pas favoriser d'autres contrôles ou investigations que celles directement demandées et permises par la loi du 20 novembre dernier.
Le Défenseur des droits, qui est également le Défenseur des enfants, est très attentif à la présence des enfants au cours des perquisitions. Quatre des réclamations dont nous avons été saisies font état de perquisitions effectuées en pleine nuit en présence d'enfants en bas âge sans qu'aucune précaution n'ait, semble-t-il, été prise à leur égard. Les réclamants dénoncent le fait que leurs enfants aient été réveillés dans leur lit, braqués avec des armes et qu'ils sont, depuis, traumatisés. Or le ministère de l'intérieur avait anticipé cette difficulté puisque la circulaire du 25 novembre 2015 rappelle fermement aux policiers et aux gendarmes qui procèdent aux perquisitions leur devoir d'exemplarité et qu'ils se doivent d'être attentifs au respect de la dignité et de la sécurité des personnes qui sont placées sous leur responsabilité. Il est essentiel d'éviter que ces interventions ne soient traumatisantes pour les enfants afin qu'eux-mêmes ne soient pas durablement perturbés et que la représentation qu'ils auront des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ne soient pas durablement négative et contribue plus tard à des attitudes agressives à l'égard de ces derniers.
C'est une question que nous avons déjà traitée en dehors de l'état d'urgence. Nous avons fait des recommandations dans une décision du 26 mars 2012 : nous avions préconisé qu'avant toute intervention, des informations sur la présence d'enfants, leur nombre et leur âge dans le lieu perquisitionné soient recueillies et prévoir, si possible, dans l'équipage des forces de l'ordre, un intervenant social, un psychologue ou un fonctionnaire de police ou un militaire de gendarmerie de la brigade de protection des familles. A tout le moins, une personne membre de l'équipage doit se charger plus spécifiquement de la protection du ou des mineurs. Nous avions aussi demandé que, pendant l'intervention, policiers et gendarmes ne mettent pas les menottes aux parents devant leurs enfants et que ces derniers soient pris à part sur le palier afin qu'ils n'assistent pas à l'intervention. Lorsque des membres de sécurité arborent des cagoules, il était recommandé de les enlever pour parler à un enfant. Ces recommandations sont toujours d'actualité.
Par un arrêt du 15 novembre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Bulgarie pour violation de l'article 3 de la convention européenne : il s'agissait d'une perquisition en présence de jeunes enfants, avec un recours excessif à la force. La Bulgarie a été en particulier sanctionnée en ce que la présence d'enfants mineurs et de l'épouse du requérant n'avait jamais été prise en compte, comme de l'état psychologiquement fragile de ses filles qui étaient âgées de cinq et sept ans. Cet arrêt a également posé la question de la motivation du choix de l'heure d'intervention, en pleine nuit. Les conditions de l'intervention ont amplifié le sentiment de peur et l'angoisse éprouvés par ces personnes et le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l'application de l'article 3 de la convention.
En ce qui concerne les assignations à résidence, les réclamations concernent majoritairement les modalités d'application, la nécessité d'un allégement des mesures en raison d'une maladie, d'un handicap et d'enfants à charge : ainsi le recours devant le juge administratif de l'avocat d'un requérant qui soutenait que son assignation n'était due qu'à la dénonciation calomnieuse d'un ancien collègue de travail, a abouti au retrait de la mesure. Par ailleurs, le Défenseur des droits a été saisi du cas d'un demandeur d'emploi assigné au domicile de ses parents situé loin du lieu de pointage. Le ministère de l'intérieur a été saisi.
En ce qui concerne, et c'est important, les dommages collatéraux, les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence peuvent avoir des conséquences professionnelles pour les personnes concernées. Le Défenseur des droits a été saisi de cas de licenciement pour faute lourde (port de barbe), de mise à pied disciplinaire (l'intéressé a même été prévenu par son employeur que celui-ci le signalerait au commissariat car son surnom inscrit sur son casier était le même que celui d'un terroriste).
C'est également le cas particulier des agents de sécurité. Le Défenseur a été saisi par un coordonnateur en matière de sécurité aéroportuaire du retrait par le préfet de son habilitation d'accès à la zone de sûreté d'un aéroport pour détention d'une arme de catégorie C non déclarée. Il a abouti à la convocation de l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, assortie d'un placement sous contrôle judiciaire. Les faits étant incompatibles avec l'accès à la zone de sûreté, le préfet a fait usage de ses pouvoirs. Second cas, celui d'un salarié d'une grande entreprise en matière de sécurité et d'incendie : retrait de sa carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en raison de l'établissement par l'enquête administrative, et en particulier du fichier des personnes recherchées, d'indices sérieux et concordants d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité publique, de la sûreté de l'État et contraires au devoir de probité. Son employeur l'a informé du retrait de sa carte professionnelle. Il n'a pas été fait référence à sa compétence en matière d'incendie qui n'est pas subordonnée à la détention de la carte professionnelle.
Ceci met en évidence des phénomènes de porosité, non prévus par les dispositions textuelles, entre les services de police et le CNAPS, alors que celui-ci ne peut avoir accès qu'aux faits ayant donné lieu à condamnation.
L'état d'urgence peut également avoir des conséquences sur l'accès aux lieux publics. Nous avons été saisis de différents cas : le refus d'accès à un établissement scolaire de parents d'élèves en raison de l'interdiction par le règlement intérieur de l'établissement du port de signes religieux. Mais je rappelle que cette règle ne s'applique pas aux parents d'élèves. Le Défenseur a également été saisi par des parents mécontents des modalités d'accès aux garderies. Au vu des dispositions combinées du plan Vigipirate et des dispositions du code général des collectivités territoriales, il a été considéré que le maire pouvait légalement réglementer les modalités d'accès à l'établissement dans le cadre des activités périscolaires.
S'agissant de l'indemnisation des dommages causés par ces mesures, la circulaire du 25 novembre 2015 du ministre de l'intérieur dispose que l'engagement de la responsabilité de l'État suppose une faute lourde, sous réserve de l'interprétation des juges du fond. Les dégâts matériels occasionnés par les forces de l'ordre ne devraient pas, à eux-seuls, être constitutifs d'une faute lourde dès lors que les nécessités liées au terrorisme dans le cadre de l'état d'urgence justifient leur intervention. Or ces mesures sont de plus en plus contestées. Au-delà des dégâts matériels, on ne peut non plus oublier l'humiliation ressentie par les personnes concernées et les traumatismes. Le Défenseur recommande donc de mettre en place une procédure d'indemnisation sans justification des dommages causés avec un formulaire-type.
Voilà ce que je pouvais dire des remontées auprès de nos délégués territoriaux ou de notre bureau central.
En conclusion, je considère qu'il faut mieux encadrer l'état d'urgence en posant des limites temporelles et matérielles, en exigeant un lien de causalité stricte entre les motifs des mesures de police administrative et les motifs de déclaration de l'état d'urgence. Il faut respecter le principe de nécessité et de proportionnalité. Il faut que les recours juridictionnels soient renforcés afin que le juge puisse pleinement exercer son rôle de garant de l'état de droit et des libertés fondamentales.

Je remercie le Défenseur des droits pour les informations qu'il tient en permanence à notre disposition. On voit à la lumière de ses propos plusieurs problèmes.
Sur la nécessité d'un lien de causalité entre les mesures de police et les raisons de déclaration de l'état d'urgence, la loi ne le prévoit pas, et le Conseil d'État n'a pu que le constater.
Sur l'indemnisation des personnes concernées, beaucoup de dégâts ont été occasionnés dans des appartements qui, souvent, ne sont pas très solides. J'ai bien compris la proposition du Défenseur d'instituer une indemnisation fondée sur la responsabilité sans faute à prouver ...

La question des enfants est aussi importante.
Ma question est toute simple : le Défenseur nous a dit que ce qui compte était de mesurer l'efficacité de l'état d'urgence par rapport à celle des procédures de droit commun. Mais il n'a pas répondu à cette question. J'aimerais qu'il y réponde.

Je peux faire état de mon accord complet avec trois ou quatre recommandations du Défenseur. J'ai plus d'embarras à l'écoute de l'accumulation de faits : à plusieurs moments, le Défenseur dit que ce sont les propos des réclamants ; dans un seul cas sur les quinze à vingt faits mentionnés, il dit que cela a été vérifié ; dans un cas, il prend ses distances. Dans quels cas, donc, les faits ont-ils été attestés ? Car ce sont des propos publics, ils laissent un petit malaise. Où en sont les vérifications sur ces différentes allégations ?
Sur le sujet de la mesure de contrainte, avec la capacité de la personne à présenter une menace terroriste. Dans la majorité des cas, l'enquête révèle qu'elle n'a aucun antécédent terroriste. Mais dans 95 % des cas, elle présente un antécédent de braqueur ou de dealer. Peut-on donc formuler une distinction entre ces différents cas ?

Vous êtes dans votre rôle par votre approche de ces questions mais ne va-t-on pas trop loin ? Nous sommes en situation d'état d'urgence et il faudrait, à vous écouter, prendre plus de précautions qu'en temps ordinaire. Est-ce que ce n'est pas nuire à l'efficacité des forces de police et de gendarmerie ?

Merci M. le Défenseur des droits d'avoir illustré votre propos par des exemples concrets. J'aimerais savoir quelles sont vos méthodes de travail, si vous avez eu un contact avec les forces de l'ordre mises en cause. Quels sont vos moyens de vérifier les assertions des réclamants ? Le procès-verbal que vous proposez permettrait d'éclairer sur les conditions d'intervention mais ce n'est pas une pratique établie.

Je m'étonne des propos tenus par certains de nos collègues car il est avéré, grâce aux associations que nous rencontrons et aux éléments qui se recoupent, que des dérives ont eu lieu à l'occasion des perquisitions et des assignations à résidence. Il y a eu des conséquences très graves : il nous a été relaté qu'une femme a fait une fausse couche lors d'une perquisition. Ces conséquences sont minoritaires fort heureusement. Je remercie M. le Défenseur des droits d'avoir rappelé les informations recueillies par les associations. Pensez-vous que les moyens législatifs sont aujourd'hui suffisants pour faire face à la lutte contre le terrorisme ?
Sur la question de l'efficacité, je ne suis pas légitime pour en traiter. J'ai simplement observé que les comptes rendus faits par le ministère de l'intérieur et par les parlementaires montrent que cette question peut être posée. Pour ma part, je me suis demandé si les textes adoptés récemment pour lutter contre le terrorisme n'auraient pas eu la même efficacité que la loi sur l'état d'urgence. Un travail d'évaluation est indispensable.
Vous êtes d'accord, je pense, pour considérer que des mesures d'exception intrusives sont légitimes pour prévenir des actes de terrorisme. Comme je l'avais suggéré, le Gouvernement a informé le Conseil de l'Europe qu'il dérogeait, pendant l'état d'urgence, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de son article 15.
Si nous voulons préserver nos droits fondamentaux il faut, face aux mesures de sécurité exceptionnelles, apporter des garanties elles-mêmes exceptionnelles. C'est le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais si l'exception devenait habituelle par la prolongation de l'état d'urgence ou par l'adoption du projet de loi relatif à la procédure pénale, le curseur entre sécurité et liberté serait déplacé. Ma mission est alors de trouver les moyens de garantir les libertés lorsqu'on accroit le niveau d'exigence de sécurité. Nous pourrions aussi accepter une altération durable de notre niveau de droit mais c'est une décision politique qui relève de la représentation nationale.
Sur la question de la trace laissée lors des opérations des services de police ou de gendarmerie, par le biais du procès-verbal, vous savez que le Défenseur des droits milite depuis longtemps pour la traçabilité du contrôle d'identité. Dans le cadre de la proposition de loi du député Gilles Savary relative à la sécurité dans les transports publics, j'ai ainsi suggéré que l'extension des pouvoirs des agents de la SNCF et de la RATP soit accompagnée de la traçabilité des contrôles.
Comme vous le voyez, je ne parle pas de grandes questions politiques ou philosophiques mais de droits « courants » comme les droits de l'enfant, le droit à la vie privée, à l'emploi, au logement. Dans la maison de la sagesse qu'est le Sénat, je vous demande de prendre la mesure de ce travail d'ébénisterie législative nécessaire pour maintenir l'état de droit au niveau que je défends.
J'ai précisé dans mon propos liminaire avoir recueilli des témoignages pour la plupart desquels je suis en phase d'instruction, comme nous le faisons habituellement en matière de déontologie de la sécurité. Nous avons adressé des demandes aux autorités concernées par les réclamations. Dans la plupart des cas, je ne peux attester de la véracité des témoignages. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'établir un procès-verbal et de créer un formulaire de demande d'indemnisation des dommages.
La Procureure générale près la Cour d'appel de Paris, Catherine Champrenault, a cité à l'occasion de la rentrée solennelle Antoine de Saint-Exupéry: « on ne peut pas être à la fois responsable et désespéré ». Je ne suis pas désespéré car nous avons la possibilité de préserver l'état de droit par un équilibre entre exigence de sécurité et garantie des libertés.

Notre commission est sensible à la vigueur de vos convictions et la clarté de vos propos. Notre travail de législateur doit prendre en compte ces préoccupations de recherche d'équilibre. Le contrôle parlementaire a toute son importance. La prorogation de l'état d'urgence ne pourra être votée que si le bilan est positif. Il existe en effet une tradition de défense des libertés au Sénat.
André Reichardt est nommé rapporteur sur la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de M. Thani Mohamed Soilihi, de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce.

Notre collègue Michel Mercier, rapporteur spécial du comité de suivi de l'état d'urgence va nous faire part d'une communication à ce sujet.

Cette communication sera rapide car nous avons d'ores et déjà abordé de nombreux points lors des deux auditions qui viennent de se dérouler. Le comité de suivi a procédé à de nombreuses auditions. Nous avons entendu deux catégories d'acteurs concernés. D'une part, nous avons reçu les acteurs de la sécurité : le Préfet de Police de Paris, le Procureur de Paris, le préfet de Seine-Saint-Denis, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur. Nous avons d'autre part reçu des associations ou des personnes dont le rôle est de défendre les libertés publiques. C'est le cas des avocats, bâtonnier de Paris, représentants du Conseil national des barreaux et avocats ayant défendu des personnes concernées par les mesures de l'état d'urgence. Nous avons aussi reçu la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, Mme Christine Lazerges, ainsi que des représentants d'Amnesty International. Enfin, nous avons reçu une association, la Quadrature du Net, qui intervient en matière de protection des libertés à l'heure du numérique. J'insiste sur ce point, car pour le reste c'est plus classique. L'importance des données informatiques, et la façon dont on les utilise, ressort particulièrement de l'audition de la Quadrature du Net. Il y aura certainement en la matière un certain nombre de modifications législatives à apporter. En effet, au cours d'une perquisition administrative, on ne peut pas saisir les données informatiques, mais on peut les copier. La différence entre les deux est parfois ténue, mais elle existe. Le statut juridique de ces copies n'est pas réellement fixé : peut-on les garder longtemps ? Doit-on obligatoirement les détruire ? Alors que dans le cadre juridique fixé par la loi relative au renseignement, il existe un statut des données informatiques recueillies, avec des durées de conservation et un contrôle, dans le cadre de l'état d'urgence, il n'y a aucune règle.
Je ne vais pas revenir sur des éléments statistiques, le ministère nous faisant passer régulièrement des données sur le nombre de perquisitions ou d'assignations à résidence. Le vice-président du Conseil d'État est d'ailleurs revenu longuement sur ce point ce matin.
Je voudrais donc insister d'une part, comme je viens de le faire, sur le statut de ces données informatiques et d'autre part sur les conditions de réalisation des perquisitions. Jacques Toubon, le Défenseur des droits, vient de décrire les conditions du déroulement de certaines perquisitions que l'on pourrait qualifier d'artisanales : les personnes concernées ne reçoivent ni procès-verbal ni arrêté de perquisition et ne peuvent donc faire valoir aucun droit à l'égard de leur compagnie d'assurance en l'absence de tels documents, sans compter le fait que les polices d'assurance ne couvrent généralement pas les dégâts matériels causés par les forces de l'ordre.
Le paysage global de cette affaire commence donc à se dessiner. Nous avons clairement indiqué à toutes les personnes auditionnées que notre comité de suivi n'était pas là pour se substituer au juge, c'est le rôle du juge administratif, mais pour éclairer notre commission et à travers elle, le Sénat dans l'hypothèse où le Gouvernement demanderait au Parlement la prorogation de l'état d'urgence. Les médias ont annoncé ce matin que le Président de la République allait solliciter une telle prorogation. Nous verrons bien. Notre comité de suivi commence en tout cas à avoir un aperçu des mesures nécessaires pour qu'un équilibre demeure entre la sécurité et la nécessaire protection des libertés publiques.
Nous allons achever la semaine prochaine les auditions. Je pourrai effectuer à ce moment-là une présentation plus complète de nos travaux. Peut-être disposerons-nous alors des décisions que le Conseil constitutionnel, saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, doit rendre, qui auront nécessairement une incidence sur l'examen du projet de loi constitutionnelle.

Vous ouvrez un autre débat en conclusion. Nous disons depuis le début que cette révision constitutionnelle a été engagée pour des motifs qui ne sont pas juridiques. Ce n'est pas un bouleversement que de dire cela. C'est un sentiment assez largement partagé. Dès lors qu'il aura été démontré que, ni sur la déchéance de nationalité, ni sur l'état d'urgence, il n'existe d'impératif constitutionnel nécessitant de réviser la Constitution, nous n'aurons pas pour autant achevé d'examiner tous les motifs qui expliquent cette révision constitutionnelle, y compris les motifs esthétiques.
La commission examine ensuite le rapport de M. François Bonhomme et le texte qu'elle propose sur la proposition de loi n° 281 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

Je salue la présence de M. Alain Fouché, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La collaboration entre nos deux commissions a été fructueuse.

La proposition de loi que nous examinons a pour objet de lutter contre la fraude dans les transports terrestres, notamment ferroviaires. Elle a également pour objet de renforcer la sécurité des voyageurs. Nous souhaitons y intégrer les recommandations de la mission d'information commune à nos deux commissions, dont les conclusions vous ont été présentées il y a une semaine. Malgré les modifications opérées à l'Assemblée nationale, le texte comporte encore de nombreuses dispositions dont la portée juridique et normative reste incertaine.
Selon le rapport de la Cour des comptes de février 2015, la fraude dans les transports collectifs de voyageurs représente une perte d'au moins 500 millions d'euros par an pour l'ensemble des exploitants, montant qu'il faudrait multiplier par quatre ou cinq pour tenir compte des fraudeurs qui n'ont pas fait l'objet de contrôle. Pour la SNCF, le coût s'élève à 340 millions d'euros par an, en taux de fraude mesuré, soit l'équivalent du budget annuel que l'entreprise consacre à la sécurité (400 millions d'euros).
L'article 529-3 du code de procédure pénale autorise la SNCF à conclure une transaction avec le fraudeur, éteignant ainsi toute action publique. Les déclarations de fausse adresse et de fausse identité par les contrevenants, qui constituent un délit quand elles sont intentionnelles, rendent inexploitables la moitié de ces procédures. En pratique, la répression est quasi-inexistante : en 2014, dix personnes seulement ont été condamnées pour ce délit. Pour renforcer la répression des fraudeurs récidivistes, le législateur a institué un délit de fraude d'habitude dans les transports en commun. Cette mesure est également peu mise en oeuvre : 710 condamnations ont été prononcées en 2014. Pourtant, des pratiques nouvelles se développent, à la faveur d'Internet, comme les mutuelles de fraudeurs qui prennent en charge l'amende transactionnelle en échange d'une cotisation modique de chaque sociétaire.
Pour renforcer la sécurité dans les transports collectifs, les agents pourront procéder à une inspection visuelle et à une fouille des bagages, ou bien encore à des palpations de sécurité, avec le consentement des voyageurs concernés. Le texte prévoit l'élargissement des dispenses du port de tenue professionnelle pour les agents des services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP, en l'occurrence la Sûreté générale (SUGE) et le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR). D'autre part, les forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, procéderont à des contrôles supplémentaires. Le régime de contrôle d'identité préventif sera assoupli grâce à la création de règles de compétence spécifique pour les procureurs en cas d'intervention dans un train : le procureur de la gare de départ serait compétent pour l'ensemble du trajet. Enfin, sur le modèle du contrôle préventif des véhicules, on pourra procéder à un contrôle des bagages dans les transports en commun et dans les emprises immobilières concernées, ainsi qu'au contrôle administratif des agents, préalablement à leur recrutement ou à leur affectation.
Plusieurs dispositions améliorent la lutte contre la fraude. L'encadrement juridique du délit sera assoupli : il suffira de cinq contraventions au lieu de dix, en douze mois, pour constituer un délit de fraude d'habitude. Un dispositif d'échange d'informations spécifique entre les agents chargés de la lutte contre la fraude et les différentes administrations, par le biais d'une personne morale unique, sera développé. En opérant à partir des nom, prénom, date de naissance et adresse des fraudeurs, ce dispositif contrecarrera d'éventuelles falsifications d'identité en cas de contrôle. Un délit sanctionnera le refus de se tenir à disposition de l'agent contrôleur dans l'attente de l'intervention de l'officier de police judiciaire. Enfin, pour lutter contre le développement des mutuelles de fraudeurs, le texte modifie la loi du 29 juillet 1881.
Nos propositions visent d'abord à simplifier le texte en supprimant les dispositions de nature réglementaire ou sans caractère normatif. D'autres articles doivent être précisés. Je propose de modifier le mécanisme d'enquête administrative préventive prévu dans le cas d'agents susceptibles de poser un problème de sécurité après leur affectation ou leur recrutement. Je propose également d'aligner le régime de fouille des bagages sur celui des véhicules, pour remédier à la différence de régime qui prévaut dans le texte, en référence à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale. Je propose de préciser pendant combien de temps un contrevenant doit se maintenir à la disposition de l'agent de sécurité en attendant la décision de l'officier de police judiciaire. Même s'il faut lutter contre la constitution de mutuelles de fraudeurs, le mécanisme proposé par le texte risque de porter atteinte à la logique de la loi de 1881, qui considère comme complices les personnes ayant appelé à commettre un délit ou un crime, si ceux-ci se sont réalisés. La seule exception à ce principe est constituée par l'apologie du terrorisme qui est en soi un délit. Enfin, l'article 12 qui autorise les polices municipales à relever des infractions dans les transports est contradictoire avec le principe selon lequel les missions de police judiciaire s'effectuent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Notre deuxième proposition renforce les contrôles externes des agents de sécurité internes de la SNCF et de la RATP, au regard de leurs nouvelles prérogatives, pour parvenir à l'équilibre que le Défenseur des droits nous encourage à trouver. Le code de la sécurité intérieure autorise les entreprises qui le souhaitent à se doter d'un service interne de sécurité propre, soumis au contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Si la sécurisation du secteur ferroviaire a ses caractéristiques propres, la protection d'autres secteurs, non moins spécifiques, comme les navires, est confiée à des services qui dépendent du CNAPS. Il serait pertinent d'un point de vue juridique d'en faire autant pour la SUGE et le GPSR, à l'image de ce que nous avions proposé, en 2014, sous l'impulsion d'Alain Richard, dans le projet de loi sur la protection des navires. Pour les agents de la SUGE et du GPSR, ce contrôle du CNAPS serait assoupli, pour ne pas l'étouffer sous la charge de travail, en se concentrant sur la formation des agents de sécurité interne, sur le respect de l'application du code de déontologie, et sur la transmission du bilan des contrôles réalisés.
Je vous proposerai enfin d'autoriser la transmission en temps réel aux forces de l'ordre des images de vidéo-surveillance recueillies au sein des véhicules ou des emprises immobilières liées au transport des voyageurs, en prenant modèle sur les mesures qui figurent dans le code de la construction. Il faudra également renforcer le rôle des polices municipales, en facilitant la constitution de polices intercommunales, comme l'ont recommandé nos collègues François Pillet et René Vandierendonck dans le cadre de la mission d'information qu'ils ont menée sur les polices municipales, en prévoyant le transfert de la réglementation des transports urbains, lorsque l'intercommunalité a la compétence transports.
Je vous propose d'approuver cette proposition de loi sous réserve de l'adoption des amendements.

Je vous remercie pour ce rapport d'autant plus remarquable qu'il s'agit de votre premier rapport législatif.

Pour élaborer ce rapport, nous avons auditionné des représentants de la police, des responsables de la SNCF et de la RATP, dirigeants et syndicalistes. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a déposé des amendements identiques à ceux de la commission des lois. Elle a validé l'ensemble de ces amendements, en souhaitant toutefois que le transfert du pouvoir de police des transports ne soit pas de plein droit. Elle se prononce également en faveur de l'utilisation à titre expérimental de « caméras-piéton » par les agents de la SUGE et du GPSR en intervention. Ces caméras sécuriseraient leur action en dissuadant les comportements violents. Quant à la fraude, nous proposerons à l'article 9 quelques modifications rédactionnelles du mécanisme d'échange d'informations entre administrations et personnels des transporteurs chargés de la lutte contre la fraude.

Dans la mesure où les services de sécurité de la SNCF et de la RATP fonctionnent à l'identique de ceux des autres modes de transport, il serait logique qu'ils soient encadrés par les règles transversales qui figurent dans le code de sécurité intérieure. Depuis que l'on dispose de codes organisés par secteurs, chaque ministère croit avoir la mainmise absolue sur celui qui lui correspond. C'est pourquoi il n'a pas été facile d'obtenir du Gouvernement qu'il inscrive dans le code de sécurité intérieure la règlementation sur la protection des navires et le président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale y était opposé. La formule transactionnelle que propose le rapporteur est la bonne. Seule petite réserve, le préfet qui dirige le CNAPS est en garde à vue depuis hier matin...
Je partage le point de vue d'Alain Fouché quant à l'effet dissuasif des « caméras-piéton ». Reste à savoir si cela relève du législatif ou du réglementaire. Le côté intrusif est certain. Il faudrait calquer le support légal sur celui qui s'applique dans la police et la gendarmerie.
Enfin, dans la mesure où le pouvoir de police consiste à fixer une règlementation, il doit revenir au président de l'agglomération. En revanche, le pouvoir d'intervention ou d'interpellation reste municipal. Il faudrait donc soit placer les agents de police municipale sous l'autorité intercommunale, soit accepter que le policier municipal puisse opérer dans la commune voisine. Cette seconde option me semble préférable.
- Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente -

Je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail. Cette proposition de loi est inquiétante. On surfe sur une émotion légitime pour faire passer des mesures répressives plutôt que préventives. Les objectifs initiaux de lutte contre les incivilités et contre les atteintes à la sécurité publique s'effacent devant celui de la lutte contre le terrorisme, ce qui justifie que l'on privatise les pouvoirs de police. Les syndicats et les associations de policiers que j'ai auditionnés sont vent debout contre ce texte. Les agents des entreprises de transport ont pour mission d'assurer la sûreté des voyageurs, mais ne disposent pas du pouvoir de maintien de l'ordre qui revient à l'État.
Rien n'est dit dans le texte des moyens financiers nécessaires. Attribuer des missions de sécurité publique à des agents sans leur garantir l'arsenal juridique adéquat pour les légitimer s'ils ont recours à la force pose problème en termes de respect des libertés. Enfin, l'absence de récépissé attestant une palpation ou une fouille pose problème en matière de lutte contre les discriminations.
La fraude est un vrai sujet. Elle appelle d'autres réponses que celles qui sont préconisées. Tel sera le sens des amendements que nous déposerons lors de l'examen de ce texte en séance publique.

Pour un premier rapport, c'est un succès. Peut-on envisager de rendre la fouille des bagages obligatoires plutôt que de la soumettre à l'assentiment des voyageurs contrôlés ? Quant à la vidéosurveillance, il faudrait interroger le Gouvernement sur l'installation d'équipements rendant possible un visionnage en direct plutôt qu'a posteriori. Enfin, en matière de déontologie, veillons à l'harmonie de ce texte avec les décisions législatives récentes.
- Présidence de M. Philippe Bas, président -

Je salue le travail du rapporteur et la manière objective dont il a abordé cette proposition de loi qui nous arrive de l'Assemblée nationale, en procédure accélérée. Vous avez su rappeler que le texte n'était pas seulement dicté par la lutte contre le terrorisme. Notre travail sur la sécurité dans les transports et la lutte contre la fraude a commencé bien en amont de l'attentat avorté du Thalys. La sécurité dans les lieux publics n'est pas l'apanage exclusif de la police nationale. La SNCF a l'obligation d'assurer la sécurité des passagers. Veillons à trouver un équilibre entre les moyens dont disposent les agents et les règles auxquelles ils doivent se soumettre. Ce texte ne pourra pas régler toutes les questions.

À mon tour de féliciter le rapporteur. Je n'opère pas une distinction aussi forte entre l'action de la police publique et les forces de sécurité privées qui interviennent dans les transports. Lorsque la SNCF était une entreprise publique, la surveillance générale y était assurée par des agents publics, en mission de service public. Le statut de l'entreprise a évolué, mais elle continue d'assurer une mission de service public. Parfois qualifiés de « police ferroviaire », les agents de sécurité de la SNCF s'apparentent plus à des policiers municipaux qu'à des vigiles privés. Confortons-les dans leur rôle de coproducteurs de la sécurité et dans leur appartenance à un service public.
Qu'arrive-t-il lorsqu'un voyageur refuse de se soumettre à la fouille ? Lui interdit-on l'accès au train, comme cela se fait dans les aéroports ? Mieux vaudrait repérer les voyageurs qu'il est intéressant de fouiller plutôt que de se focaliser sur ceux qui refusent de l'être.
De mon point de vue, la disposition qui concerne les « caméras-piéton » n'est pas de nature législative. Cela mérite d'être vérifié. Voilà des années que dans mon territoire, la police municipale est équipée de caméras. C'est une sécurité pour les citoyens qui sont ainsi à l'abri d'abus de pouvoir ou de ripostes disproportionnées de la part des policiers. C'est une garantie pour les agents de police contre les mises en cause abusives. Bref, c'est une sécurité pour l'autorité en général. Il n'est pas nécessaire de légiférer, sauf à vouloir systématiser l'enregistrement vidéo dans les transports. Le coût est minime et l'investissement serait rapidement amorti.
Dans la mesure où les transports relèvent de la compétence intercommunale, rien n'interdit que des agents municipaux accompagnent les contrôleurs sur le territoire de la commune. Les policiers municipaux les grandes villes centres peuvent être détachés dans des communes plus petites à des heures spécifiques, toujours sous les ordres et la responsabilité du maire de la commune où se trouvent les agents au moment de l'injonction. Rien n'oblige à en passer par la communautarisation de la police municipale.

Monsieur Richard, nous proposerons un amendement à l'article 12 pour transférer au président de l'intercommunalité le pouvoir de réglementation en matière de transport, si la compétence transports est exercée au niveau intercommunal. Madame Assassi, la SUGE a été créée en 1938 et le GPSR, après-guerre. Ce sont des services de « sûreté » plutôt que de « sécurité ». Les syndicats de la RATP et de la SNCF que nous avons auditionnés ont accueilli favorablement l'extension des prérogatives attribuées aux agents de sécurité. D'autant que nous proposons en contrepartie des garanties supplémentaires. Nous souhaitons la délivrance d'un agrément et d'une habilitation spécifique lorsqu'un agent doit procéder à une palpation de sécurité. Monsieur Vasselle, juridiquement, une fouille de bagages s'apparente à une perquisition. En cas de défaut de consentement, les agents doivent faire appel à un officier de police judiciaire. Les agents du GPSR et de la SUGE sont assimilés à des personnes privées, même s'ils sont en mission de service public. Ces services restent néanmoins coordonnés par l'Unité de coordination de la sécurité dans les transports en commun (UCSTC) et le Service national de police ferroviaire (SNPF). Nous avons prévu de rattacher les agents des services de sécurité interne au code de déontologie du CNAPS. Monsieur Bigot, effectivement, ce texte n'a pas la prétention de tout régler. Enfin, en cas de refus de consentement à être fouillé, nous pourrions nous prévaloir du Code des transports pour refuser l'accès au train, en considérant que le voyageur doit se conformer au règlement intérieur. Quant à la disposition sur les caméras portatives, le Gouvernement laisse entendre qu'elle est de nature législative et qu'elle sera intégrée dans un texte à venir sur la réforme de la procédure pénale pour pérenniser une expérimentation du même ordre est menée actuellement au bénéfice des policiers.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
L'amendement de clarification COM-10 est adopté.

L'amendement COM-11 renforce les garanties sur les palpations de sécurité, qui sont intrusives. Il convient de maintenir une habilitation et un agrément supplémentaires.
L'amendement COM-11 est adopté.
Article additionnel après l'article 1er

Les « caméras-piéton » sont un élément de preuve en cas de comportement violent contre un agent de sécurité. L'amendement COM-57 prévoit une expérimentation de trois ans de leur utilisation par les agents des services de la SUGE et du GPSR, avec plusieurs garanties : le renvoi aux dispositions du code de la sécurité intérieure sur la vidéo-protection, la limitation de l'enregistrement à la seule durée de l'intervention et, dans des conditions permettant aux personnes filmées d'en être informées, son interdiction hors des lieux dans lesquels interviennent les agents de la SUGE et du GPSR. Ces données ne seront pas accessibles aux agents qui les enregistrent. L'opportunité du maintien de cette mesure serait examinée au bout de deux ans grâce à une clause de revoyure. Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2017, afin de laisser à la SNCF et à la RATP le temps de s'y préparer.

Les personnes devraient être systématiquement informées qu'elles sont filmées. Cela modère les ardeurs !

Tout a déjà été prévu par notre rapporteur.
L'amendement COM-57 est adopté.
Article 2
Les amendements identiques COM-13 et COM-62 visant à ce que le CNAPS contrôle la formation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont adoptés.

L'amendement COM-14 prévoit que le bilan annuel des contrôles des forces de l'ordre sur les agents de la Suge et du GPSR est transmis au Conseil national des activités privées de sécurité.
Les amendements identiques COM-14 et COM-63 visant à ce que le CNAPS soit destinataire, en plus du Défenseur des droits, du bilan annuel des contrôles réalisés par les forces de l'ordre sur les agents des services internes de sécurité sont adoptés.
Les amendements COM-16 et COM-12 sont adoptés, de même que les amendements identiques COM-15 et COM-64 visant à ce que le code de déontologie édicté par le CNAPS s'applique aux agents de la SUGE et du GPSR.
Article 3

L'amendement COM-17 récrit l'article 3 qui élargit les possibilités pour les agents des services internes de sécurité d'intervenir en tenue civile.

Pour éviter tout risque de confusion entre la police et les agents de sécurité interne, il serait bon que les agents de la SUGE et du GPSR portent un brassard lors de leurs interventions en civil.

Le Sénat est dans son rôle de renforcement des droits, même lorsqu'il renforce les contrôles.
Les amendements identiques COM-17 et COM-65 sont adoptés.
Article 3 bis

L'amendement COM-7 est satisfait par l'amendement COM-18, qui réécrit le dispositif d'enquête administrative préalable à un recrutement ou à une affectation afin de permettre de contrôler aussi les agents déjà en poste.

L'amendement COM-18 réécrit le dispositif de vérification administrative prévu par le texte.
Les amendements identiques COM-18 et COM-66 sont adoptés.
Article additionnel après l'article 3 bis

L'amendement COM-5 prévoit la transmission aux employeurs des fiches « S » établies, le cas échéant, pour leurs salariés ; ce serait inopportun car ces informations sont confidentielles. Avis défavorable.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
Article 4 ter

L'amendement COM-19 supprime l'article 4 ter qui ajoute une liste non exhaustive de lieux pour lesquels une interdiction de séjourner pourrait être prononcée. L'article 131-31 du code pénal permet déjà de prononcer des interdictions pour de tels lieux.
L'amendement COM-19 n'est pas adopté.
Article 5
L'amendement rédactionnel COM-20 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-21.
Article 6
L'amendement rédactionnel COM-22 est adopté.
Articles additionnels après l'article 6

Les amendements identiques COM-23 et COM-67 transcrivent une recommandation du rapport de la mission d'information commune des commissions du développement durable et des lois consistant à permettre aux opérateurs de transports publics de transmettre en temps réel les images prises dans les véhicules ou emprises immobilières des opérateurs de transport public aux forces de l'ordre.

Cet article change totalement le droit de la vidéo-protection ! Actuellement, les images ne sont pas transmises.

L'amendement prévoit que le dispositif sera soumis aux dispositions générales de la loi de 1995.

L'article précise que la convention est transmise à la commission départementale de vidéo-protection mentionnée à l'article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 qui apprécie la pertinence des garanties.

La convention prévoit que les images sont renvoyées si nécessaire à la police nationale. Là où des systèmes de transmission existent - deux fois sur cinq ! - la convention entre police nationale et exploitant autorisera à renvoyer les images.

Plusieurs d'entre vous ont constaté que les cloisonnements entre services ont pu empêcher l'arrestation de délinquants. Ce dispositif y remédiera.
Les amendements identiques COM-23 et COM-67 sont adoptés.
L'amendement COM-4 prévoit une fouille des bagages systématique pour le voyageur pris en flagrant délit de fraude et qui refuserait de justifier de son identité par tous moyens.
Article 6 bis A

L'amendement COM-24 supprime le rapport prévu par l'article 6 bis A : le Parlement peut s'autosaisir, c'est une position de principe.
L'amendement de suppression COM-24 est adopté.
Article 6 bis

L'amendement COM-25 supprime l'article 6 bis créant une contravention - qui ne serait probablement pas très opérante - ce qui relève du pouvoir réglementaire. En outre, les opérateurs de transports peuvent déjà imposer des billets nominatifs.
L'amendement de suppression COM-25 est adopté.
Les amendements COM-8 et COM-9 tombent.
Article 6 ter

Selon l'article 6 ter, sans portée normative, les autorités organisatrices de transport et les exploitants peuvent se doter de services internes de sécurité, régis par le code de la sécurité intérieure. Les conventions sectorielles prévues à l'alinéa 2 seraient redondantes avec les CISPD et les CLSPD existants qui traitent déjà des questions de sécurité, notamment dans les transports collectifs. Ayons plutôt une vision d'ensemble de la lutte contre la délinquance.
L'amendement de suppression COM-26 est adopté.
Article 6 quinquies

Encore un rapport du Gouvernement.
Les amendements de suppression COM-27 et COM-61 sont adoptés.
Article 7
L'amendement COM-28 est adopté.
Article 8

L'amendement abaisse à trois contraventions sur douze mois le délit de fraude d'habitude. Avis défavorable.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
L'amendement COM-29 exclut du champ du délit de fraude d'habitude les cas de transaction avec l'opérateur. La transaction, prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale, éteint l'action publique et ne peut être comptabilisée pour constituer le délit de fraude d'habitude dans les transports collectifs.

Je comprends la position juridique du rapporteur, mais l'acceptation d'une transaction peut résulter d'une stratégie, dans la mesure où les amendes sont difficilement recouvrées ; or celui qui paie une transaction cinq fois de suite est un fraudeur. Le Gouvernement pourrait s'expliquer sur ce sujet, afin que, comme pour les infractions routières, la transaction soit une amende forfaitaire, ce qui permettrait de la comptabiliser. L'objectif est de réduire la fraude, qui coûte très cher aux organisateurs de transport.

Je vous rappelle que la transaction a pour effet d'effacer l'infraction...

Certains fraudeurs développent de véritables stratégies de fraude mais on ne peut surmonter cet obstacle juridique. Un autre amendement, qui améliore le recouvrement des amendes résultant d'une transaction réduira l'intérêt d'une telle stratégie.
L'amendement COM-29 est adopté.
Article additionnel après l'article 8

L'amendement COM-3 interdit l'accès aux transports publics à ceux qui ont commis plus de trois délits dans l'enceinte des transports publics.
L'amendement COM-3, satisfait, n'est pas adopté.
Article 8 bis

L'amendement COM-30 limite à trente minutes la durée pendant laquelle peut être retenu un fraudeur qui refuse de décliner son identité aux agents contrôleurs assermentés, en attendant la décision de l'officier de police judiciaire.

L'objectif est de laisser le temps suffisant pour joindre l'officier de police judiciaire.

Si l'officier doit être présent, ce délai est insuffisant ! Imaginez, en pleine nuit dans la Meuse...

Il suffit que l'officier de police judiciaire donne son accord par téléphone.
Nous nous y opposons.
L'amendement COM-30 est adopté.
Article 8 ter
L'amendement rédactionnel COM-31 est adopté.
Article 9
L'amendement rédactionnel COM-58 est adopté, de même que l'amendement de coordination COM-59 et les amendements rédactionnels COM-32, COM-33, COM-34.

L'amendement COM-60 précise que l'administration fiscale transmet les données relatives aux contrevenants à la personne morale mentionnée à l'alinéa 4, laquelle les transmet aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction, et non aux agents ayant constaté l'infraction. C'est une mesure de bon sens et de bonne organisation, on s'étonne cependant qu'elle soit de niveau législatif.
L'amendement COM-60 est adopté.
Articles additionnels après l'article 9

L'amendement COM-1 qualifie l'incitation à la fraude dans les transports de délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Et pourquoi pas la réclusion criminelle à perpétuité ?
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'amendement COM-2 a pour effet de fusionner les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF. Cette fusion serait délicate et ces services se coordonnent déjà sans problème. Avis défavorable.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Article 9 bis

L'article 9 bis allonge la durée pendant laquelle le contrevenant peut acquitter les sommes résultat de la transaction, ce qui serait contradictoire avec l'objectif de lutte contre la fraude.
L'amendement de suppression COM-35 est adopté.
Article 11

L'article 11 est un « cavalier », sans lien avec le présent texte.
L'amendement de suppression COM-36 est adopté.
Article 12

L'amendement COM-37 ouvre la possibilité de transférer les attributions de police des transports de la police municipale, comme il est déjà possible pour les aires de gens du voyage, l'assainissement, les déchets ménagers, la voirie, le stationnement.

Cette disposition est issue du rapport Pillet-Vandierendonck relatif aux polices municipales.

Par rapport à notre rapport, il n'y a rien de nouveau sous le soleil : il s'agit du transfert des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de transport sur une base volontaire au président de l'établissement public de coopération intercommunale qui a la compétence de transports urbains. C'est un sujet important : Martine Aubry et Gérald Darmanin se satisfont désormais de pouvoir envisager un service de vidéo-protection à l'échelle intercommunale. C'est pragmatique, pas hémiplégique ! Ne rouvrons pas le débat.

Je partage l'exposé des motifs mais ne vois pas la possibilité pour le maire de s'opposer à ce transfert.

Cela figure dans le corps de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Il faut choisir entre les amendements COM-37 ou COM-68, dont l'objet est identique : celui notre rapporteur impose le transfert sauf opposition du maire, celui du rapporteur pour avis le rend possible.

Je reste sur le parallélisme des formes, en m'inspirant de la rédaction de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le principe assorti de réserves.

Ne rouvrons pas de vieilles querelles ! La nécessité l'emportera si besoin !
L'amendement COM-37 n'est pas adopté.
L'amendement COM-68 est adopté.
Article 13
L'amendement rédactionnel COM-38 est adopté.

L'amendement COM-39 supprime les alinéas 10 à 14 de l'article 13, relatifs notamment à la répression du signalement d'agents effectuant un contrôle ou d'incitation à commettre des infractions à la police des transports, qui semblent disproportionnées.
L'amendement COM-39 est adopté.
Article 14
L'amendement de suppression COM-40 est adopté.
Article additionnel après l'article 14

L'amendement COM-41 assure l'application outre-mer de la proposition de loi.

Notre collègue Mme Lana Tetuani s'interrogeait sur le III de l'article 1er : pourquoi applique-t-on automatiquement ces dispositions à l'outre-mer ?

Cela a été abrogé. Les dispositions rassurant notre collègue figurent dans l'amendement.
L'amendement COM-41 est adopté.
L'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Communication de m. françois pillet sur l'issue des commissions paritaires relatives à la proposition de loi relative à la protection de l'enfant et à la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Communication de m. françois pillet sur l'issue des commissions paritaires relatives à la proposition de loi relative à la protection de l'enfant et à la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Je viens de participer, coup sur coup, à deux commissions mixtes paritaires (CMP) consacrées à des textes dont vous m'aviez confié le rapport pour avis. Je souhaitais vous informer de leur issue.
La CMP sur la protection de l'enfance a échoué, ce qui conduira le Sénat à se prononcer en nouvelle lecture. Il me semble très regrettable qu'un texte élaboré à l'origine par le Sénat échappe ainsi à la décision finale de notre assemblée, mais les députés ont refusé d'entendre les réserves que nous avons exprimés sur plusieurs points.
Hier s'est tenue la CMP sur la proposition de la loi relative à la fin de vie. Nous sommes parvenus à un texte commun.
Quatre points principaux étaient en discussion.
Le premier tenait à l'assimilation de l'hydratation et de la nutrition artificielles à des traitements ou des soins qui pourraient être maintenus, à la demande du patient, jusqu'au décès.
Les députés ont obtenu qu'on les qualifie de traitements et qu'on supprime la mention selon laquelle ils peuvent être arrêtés, sauf opposition du patient. La raison de cette suppression est que cette mention serait surabondante avec le fait que la suspension des traitements ne peut intervenir qu'à la demande du patient. J'ai veillé à bien faire préciser ce point dans nos débats afin qu'il fixe définitivement l'interprétation qui pourra être faite de ce texte : un patient pourra toujours demander, et un médecin pourra toujours décider, lorsqu'il arrête les traitements vitaux d'un patient que soit malgré tout maintenus l'alimentation ou l'hydratation artificielle.
Le deuxième point en discussion était la réintroduction, à la demande des deux rapporteurs de l'Assemblée nationale, du recours à la sédation profonde et continue dans le cas où un patient atteint d'une affection grave et incurable décide d'arrêter un traitement vital et que cette décision engage son pronostic vital à court terme. Cette sédation ne lui aurait accordée que si cet arrêt était, je cite, « susceptible d'entraîner une souffrance insupportable ou un inconfort majeur ».
Le rapporteur de la CMP, notre collègue Gérard Dériot a obtenu que l'expression d'« inconfort majeur » soit supprimée. C'est heureux : une telle notion est totalement indéterminée. En revanche, il n'a pu obtenir que soit précisé que la souffrance causée doit être réfractaire à tout traitement. Comme l'ont proposé les deux rapporteurs de l'Assemblée nationale, il suffira que la décision d'arrêter le traitement soit susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. La différence entre les deux expressions me paraît toutefois minime.
Le troisième point concerne les directives anticipées. Nous avons obtenu des députés qu'ils acceptent le principe de leur révocabilité et de leur révision à tout moment et, surtout, par tout moyen.
En revanche, alors que le Sénat défendait l'idée que la procédure collégiale devait être la règle, les députés ont obtenu qu'elle n'intervienne qu'à la demande du médecin, lorsqu'il estimera qu'elles sont sans doute inappropriées ou inadaptées à la situation du malade. Nous avions pour notre part défendu, lors des premières lectures du texte, que le médecin devait passer par la procédure collégiale en cas de contestation sérieuse, notamment par l'un des proches du patient. Il s'agissait, non pas de donner le dernier mot à la famille, mais de lui permettre d'exiger le recours à la procédure collégiale lorsqu'elle fournit une objection sérieuse à l'application stricte des directives anticipées.
En pratique, et en dépit de la rédaction finalement retenue par la CMP, je n'imagine pas qu'un médecin se dispenserait de la procédure collégiale alors qu'il fait face à une contestation sérieuse de la part de la famille.
Enfin, le dernier point était relatif à la compétence des personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle pour rédiger seules des directives anticipées et désigner leur personne de confiance. À l'initiative du Gouvernement, nos collègues députés les avaient traitées comme des personnes sous tutelle ! C'était un retour en arrière manifeste par rapport à la loi de 2007 sur les majeurs protégés. Nous avons obtenu qu'elles soient traités comme tout un chacun : ces décisions sont hautement personnelles et elles doivent pouvoir les prendre seules, sans avoir à solliciter l'autorisation du juge.
En conclusion, je dirais que les échanges que nous avons eus avec les députés manifestent une certaine convergence de vues sur les préoccupations que nous avions formulées, notamment sur l'ultime recours à la sédation profonde et continue ou sur la possibilité de maintenir certains traitements à la demande du patient. Il me semble que le texte écarte tout risque de dérive vers le suicide assisté. Les praticiens qui s'engageraient malgré tout dans cette voie se placeraient résolument en dehors de la loi.

Je profite de l'occasion de cette communication pour saluer la qualité du travail accompli par le rapporteur et sa défense des positions de notre commission sur ce sujet délicat.

Précisons qu'il s'agit de la position de la majorité de notre commission. Pour ma part, j'estime que le texte ne va pas suffisamment loin.
La réunion est levée à 13 h 05