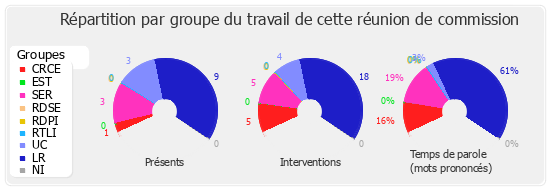Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 8 juillet 2020 à 9h35
Sommaire
La réunion

J'ai souhaité ce matin évoquer devant vous le contrôle de la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi.
Permettez-moi tout d'abord de rappeler en quelques mots le cadre constitutionnel et organique dans lequel il s'inscrit. L'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».
Cette rédaction a de lourdes conséquences pour l'initiative parlementaire, puisqu'elle implique un traitement radicalement différent en recettes et en dépenses. Si l'usage du singulier pour le mot « charge » conduit à ce que toute augmentation des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des administrations de sécurité sociale soit strictement prohibée et ne puisse faire l'objet d'aucune forme de compensation, il est en revanche possible pour les parlementaires de diminuer les recettes de ces personnes publiques, à la condition que cette baisse soit compensée à due concurrence par l'augmentation d'une autre recette. Cela se traduit en pratique par le fameux « gage » tabac.
Le contrôle de la recevabilité financière implique également de veiller à la bonne application de l'ensemble des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Il s'agit principalement d'assurer le respect du domaine des lois de finances et de leur structure bipartite.
Comme vous le savez, les commissions des finances des deux chambres jouent un rôle prépondérant - même s'il n'est pas exclusif - dans le contrôle de la recevabilité financière, et il revient en particulier à leurs présidents respectifs de se prononcer sur ce contrôle de recevabilité.
À cet égard, tout en soulignant que les grandes lignes de la jurisprudence sont communes aux deux commissions des finances, j'avais rappelé devant vous il y a un peu plus d'un an la persistance de quelques divergences de jurisprudence.
Ces dernières sont le corollaire de l'autonomie et de la grande liberté dont dispose chaque chambre dans l'exercice de son contrôle. En effet, le Conseil constitutionnel n'examine la conformité d'une initiative parlementaire à l'article 40 de la Constitution que si ce dernier a été invoqué par le Gouvernement ou un parlementaire devant la première assemblée saisie, en vertu de la règle dite du « préalable parlementaire ». C'est extrêmement rare, si bien que le juge constitutionnel n'est en pratique jamais amené à se prononcer sur ces divergences de jurisprudence.
Si ces divergences sont peu nombreuses et tendent à s'atténuer, je me suis rapproché l'an dernier de mon homologue Éric Woerth afin de rechercher des points de convergence. En effet, l'autonomie de décision ne saurait aller jusqu'à exclure une forme de « dialogue des juges » de la recevabilité financière.
À la suite de ce travail, j'ai essayé de « faire le tri » entre les divergences qui me semblent pouvoir être surmontées et celles pour lesquelles le pas à franchir me paraît trop important.
En la matière, trois principes ont guidé ma réflexion.
Premièrement, préserver les interprétations de l'article 40 plus favorables aux Sénateurs. J'en avais dénombré cinq et celles-ci sont bien évidemment maintenues.
Deuxièmement, accepter de s'écarter d'une approche trop juridique lorsque cela conduit à des solutions paradoxales sur le plan économique au regard de l'esprit de l'article 40, qui vise au départ à favoriser la bonne gestion des finances publiques.
Troisièmement, refuser les interprétations qui me paraissent ouvrir des contournements majeurs de l'article 40, en contradiction manifeste avec la lettre de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est la condition pour que le juge constitutionnel accepte de demeurer un juge d'appel, contrairement par exemple à ce qui se fait pour le contrôle des cavaliers législatifs.
Permettez-moi à cet égard de commencer par vous présenter la principale divergence qui me semble insurmontable.
La commission des finances de l'Assemblée nationale tolère depuis quelques années les amendements portant création d'une expérimentation coûteuse, sous réserve qu'elle soit optionnelle, limitée dans le temps et réversible.
À l'inverse, de tels amendements sont déclarés irrecevables au Sénat, dès lors que rien ne laisse entendre que le caractère temporaire, facultatif ou réversible de la charge constitue un motif suffisant pour que le Conseil constitutionnel écarte l'application de l'article 40. Au contraire, celui-ci a par le passé expressément validé la censure d'amendements portant création de charges temporaires.
Sur le fond, une telle évolution serait à mon sens contraire à l'esprit de l'article 40 et ouvrirait la voie à des contournements majeurs - puisqu'un « gage expérimentation » précisant à la fin du dispositif que les dispositions « présentent un caractère expérimental » suffirait pour rendre recevable toute proposition créant une charge publique.
Je souhaite donc maintenir notre jurisprudence sur ce point.
Au regard de cette grille de lecture, il me semble en revanche possible de transposer au Sénat deux évolutions récentes de la jurisprudence de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui iraient dans le sens d'un assouplissement des règles de recevabilité financière.
La première concerne les fusions de structures à des fins d'économies d'échelle.
Alors que les commissions des finances des deux chambres avaient toujours considéré que la fusion de deux personnes publiques distinctes devait s'analyser comme une création de charge, dès lors que juridiquement on supprime deux personnes publiques pour en créer une nouvelle, la commission des finances de l'Assemblée nationale regarde désormais avec bienveillance les initiatives visant à fusionner plusieurs structures existantes à des fins de rationalisation fonctionnelle ou budgétaire, estimant qu'il s'agit alors d'une « simple réorganisation de charges existantes ».
Il me semble acceptable de nous aligner sur la position de l'Assemblée nationale sur ce point, dès lors que ces initiatives visent clairement à réaliser des économies. Cela paraît d'autant plus légitime qu'il est déjà possible de fusionner deux personnes publiques n'ayant pas la personnalité morale dans le cadre de notre jurisprudence actuelle.
La seconde innovation que je vous propose de transposer concerne les charges de trésorerie.
Jusqu'à peu, il avait toujours été considéré dans les deux chambres qu'un amendement ayant pour effet de repousser dans le temps la perception d'une ressource publique ou d'anticiper le versement d'une dépense publique constituait une charge de trésorerie.
Sur le fond, cette position se justifie notamment par le fait que ce décalage est susceptible de créer un besoin de financement pour l'organisme considéré, généralement comblé par un recours à un emprunt coûteux en termes d'intérêts.
Il faut d'ailleurs rappeler que ce cas avait expressément été envisagé par les rédacteurs de la Constitution, Gilbert Devaux ayant inscrit « les dépenses [...] de trésorerie » dans le champ des charges publiques lors de la réunion de la commission constitutionnelle du Conseil d'État des 25 et 26 août 1958. Par la suite, le Conseil constitutionnel a intégré de fait cette notion dans sa jurisprudence en validant la censure, par la commission des finances de l'Assemblée nationale, d'un amendement diminuant la durée d'amortissement des obligations données en échange des actions des sociétés nationalisées en vertu de la loi du 11 février 1982.
Toutefois, la commission des finances de l'Assemblée nationale a récemment décidé de retenir une interprétation plus souple en vertu de laquelle seraient désormais recevables les initiatives ayant « un effet infra-annuel et non massif sur la trésorerie ». Cela explique pourquoi les amendements visant à anticiper le versement de la « prime de naissance » ont par exemple pu être examinés à l'Assemblée nationale mais pas au Sénat.
Si la position de nos collègues députés comporte indéniablement une part de risque au regard de la jurisprudence constitutionnelle, il me paraît envisageable de nous aligner sur celle-ci pour deux raisons.
Tout d'abord, l'aménagement est mesuré, dès lors qu'il ne porterait que sur les initiatives ayant un effet infra-annuel et non massif sur la trésorerie. Cela peut en quelque sorte s'analyser comme une extension de la jurisprudence sur les « charges de gestion absorbables » à un nouveau domaine - interprétation qui avait d'ailleurs été expressément validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur le « Pacs ».
Ensuite, le contexte économique a radicalement évolué. En particulier, les taux des emprunts français à un an sont négatifs depuis 2015, si bien qu'il me paraît de plus en plus difficile de défendre une vision très « juridique » de la charge de trésorerie à cet horizon, déconnectée de la réalité budgétaire.
Pour terminer, je souhaite soumettre à votre consultation une dernière convergence possible, sur laquelle je suis plus partagé.
Elle porte sur la délicate question des affectations de recettes, qui est à l'origine de nombreuses incompréhensions de la part de nos collègues.
Je tiens tout d'abord à rappeler que les commissions des finances des deux chambres prévoient que l'attribution d'une ressource supplémentaire est susceptible, dans certains cas, d'être analysée non pas comme une simple augmentation de recettes, mais comme l'aggravation d'une charge publique.
Sur le fond, cette jurisprudence s'inspire de la décision du 29 décembre 1982 du Conseil constitutionnel, qui avait jugé que les prélèvements sur recettes doivent être considérés comme des recettes, et non comme des dépenses, dès lors qu'ils n'établissent aucune « corrélation entre une recette de l'État et une dépense incombant à celui-ci ».
A contrario, lorsqu'un lien direct peut être établi entre l'augmentation de recettes envisagée et l'augmentation d'une dépense déterminée, il est d'usage d'analyser l'initiative parlementaire comme constitutive d'une aggravation de charge publique, qui est prohibée par l'article 40 de la Constitution.
Les deux chambres divergent toutefois sur les critères à réunir pour caractériser une aggravation de charge.
La divergence tient pour l'essentiel aux affectations de recettes fiscales supplémentaires au profit d'un opérateur ayant la personnalité morale et qui ne sont pas expressément fléchées vers une dépense. Celles-ci sont admises à l'Assemblée nationale mais pas au Sénat.
Sur le fond, notre raisonnement s'articule autour du principe d'universalité budgétaire. Le budget de l'État et des collectivités territoriales répond au principe d'universalité budgétaire. Dès lors, pour ces derniers, on ne saurait établir de lien entre l'augmentation de recettes envisagée et l'augmentation d'une charge déterminée. Mais ce raisonnement ne vaut pas lorsque les dépenses de l'organisme bénéficiaire sont circonscrites au champ des compétences qui lui sont attribuées. Un lien direct peut alors être établi entre la ressource affectée et les dépenses de cet organisme. En effet, à l'inverse des impositions ordinaires qui alimentent le budget général et peuvent ainsi améliorer les comptes publics, ces augmentations ont généralement pour but de renforcer la capacité de dépense de l'organisme bénéficiaire. Il me paraît ainsi manifeste - je pense que le rapporteur général ne pourra pas me contredire sur ce point - que lorsqu'un amendement veut relever le plafond d'une taxe affectée à un opérateur, c'est bien pour lui donner des moyens budgétaires de dépenser. C'est une subvention déguisée !
Trois éléments m'amènent toutefois à soumettre au débat la question d'un alignement sur la position de l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, il s'agit d'une divergence majeure, qui est à la source de nombreuses incompréhensions au regard des possibilités offertes aux députés et qui grève considérablement l'initiative sénatoriale. De nombreux collègues ne comprennent pas pourquoi il n'est pas possible de relever le montant d'une taxe pour l'affecter au Centre national du Cinéma, à l'AFIFT, ou à tout autre opérateur de l'État.
Ensuite, les deux positions me paraissent pouvoir juridiquement se défendre, contrairement par exemple à la souplesse sur les expérimentations, sur laquelle j'ai des réserves de fond beaucoup plus fortes.
Enfin, l'Assemblée nationale a fait un pas vers nous ces dernières années, en admettant désormais expressément qu'une affectation de recettes publiques à des structures dépourvues de la personnalité morale est contraire à l'article 40, même en l'absence de fléchage explicite vers une dépense. En effet, certains fonds ont la particularité de ne pas disposer de la personnalité juridique et d'être strictement définis comme l'identification d'enveloppes de dépenses au sein d'opérateurs, ce qui ouvrait la voie à des contournements trop importants de l'interdiction d'affecter une recette à une dépense.
Il nous faut toutefois bien mesurer les conséquences concrètes qu'un changement de jurisprudence impliquerait, et ce alors même que cette jurisprudence est très ancienne.
En effet, de très nombreux amendements ayant pour objet d'affecter une ressource nouvelle à un organisme public ou de relever les plafonds de taxes affectées à des opérateurs sont chaque année examinés à l'Assemblée nationale.
Pour ne donner qu'un chiffre, 288 amendements ont été examinés à l'Assemblée nationale sur l'article 27 du PLF 2020 concernant les taxes affectées, contre seulement 25 au Sénat. Il résulterait donc d'un assouplissement de notre jurisprudence un accroissement considérable du nombre d'amendements examinés lors du débat budgétaire - sans doute dès le troisième projet de loi de finances rectificative que nous commencerons à examiner la semaine prochaine.
En conclusion, je vous propose donc ce matin, en toute transparence, deux évolutions jurisprudentielles permettant de retenir des dispositions plus favorables à l'initiative des sénateurs et je souhaiterais que sur le troisième point, vous puissiez me faire part de vos observations, compte tenu des conséquences importantes que l'assouplissement de la jurisprudence relative aux taxes affectées est susceptible d'emporter sur les conditions d'examen des textes financiers.

L'article 40 suscite régulièrement des incompréhensions de la part de nos collègues. Cet encadrement a été imaginé pour rationaliser l'initiative parlementaire et protéger les finances publiques. Pour autant, il est permis de s'interroger sur les raisons qui rendent irrecevables un amendement dont la conséquence ultime est de rationaliser des structures. Il faut donc se prémunir de tout formalisme en la matière. Lorsque nous avons travaillé sur le projet de réforme constitutionnelle, certaines voix se sont exprimées pour une suppression de l'article 40, lequel n'a d'ailleurs pas empêché la dérive de nos comptes publics.
Nous n'en sommes toutefois pas à envisager sa suppression. Je souscris naturellement aux deux évolutions proposées par le Président. Une réflexion devra sans doute intervenir sur l'expérimentation. Concernant le relèvement des plafonds de taxes affectées, ce changement se traduira certes par une augmentation du nombre d'amendements, mais j'y suis favorable. La situation actuelle le montre : certains organismes vont être en difficulté, il faut que leurs ressources soient adaptées.

Je souhaiterais m'inscrire dans le sillage du rapporteur général, en ayant à l'esprit la situation des chambres consulaires, mises à mal par la crise actuelle. Il faut que les parlementaires puissent ajuster les ressources de ces organismes, en faisant valoir leur connaissance de terrain.

Le pouvoir législatif est fortement corseté. Aussi, toute interprétation susceptible de desserrer l'étau doit être soutenue. Il ne faut rien exclure : je soutiens donc l'assouplissement concernant les taxes affectées.

C'est un sujet sensible. Il est bien de pouvoir échanger sur la doctrine, ce qui nous permet d'éviter le couperet de l'irrecevabilité financière. Je partage l'évolution suggérée, qui va dans le bon sens.

Je vous remercie de vos réactions et commentaires et je ferai connaître à l'ensemble de nos collègues l'évolution de la jurisprudence en matière de recevabilité financière.

Dans le prolongement des travaux et des échanges que nous avons collectivement eus au Sénat à l'occasion de la réforme de la taxe d'habitation, il nous est apparu, avec Charles Guené, qu'un travail devait être conduit sur la question de la péréquation.
Le bureau de notre commission nous a chargés de conduire un tel travail et nous souhaitons aujourd'hui vous en restituer les premières observations et perspectives.
Aux termes de l'article 72-2 de notre Constitution, la péréquation a pour objet de favoriser « l'égalité entre les collectivités territoriales ». Cette intention est rendue d'autant plus nécessaire que nous savons combien la répartition des ressources et des charges entre les territoires est inégale et procède, souvent, de dynamiques bien indépendantes de la volonté et de l'action des exécutifs locaux.
En pratique, la péréquation prend la forme de plusieurs flux financiers qui vont de l'État aux collectivités territoriales ou s'opèrent entre les collectivités elles même. Les montants concernés sont notables puisqu'en 2019 ce sont près de 12 milliards d'euros qui avaient été mobilisés, dont les deux tiers au titre de la péréquation verticale.
Les transferts financiers mis en oeuvre au titre de la péréquation se traduisent par un nombre de plus en plus important d'instruments qui visent des catégories spécifiques de collectivités locales - je pense à la dotation d'intercommunalité perçue par les groupements de communes ou au fonds de péréquation récemment réformé et institué au profit des départements - et poursuivent des objectifs particuliers tel que le soutien aux territoires ruraux ou aux territoires urbains.
La mise en oeuvre de la péréquation implique, au-delà des seuls montants mis en jeu, de prévoir des moyens de mesurer objectivement les inégalités entre les territoires aux fins de savoir qui doit contribuer au dispositif et qui a le droit d'en bénéficier.
Comme vous le savez, ces mesures d'inégalité s'appuient sur des indicateurs de ressources et de charges souvent critiqués et, en tout cas, probablement perfectibles. Or, dans le contexte de la réforme de la taxe d'habitation ce sont précisément ces indicateurs qui pourraient, sans intervention, varier au point de faire basculer l'édifice de la péréquation.
L'identification des risques que fait peser la réforme de la taxe d'habitation sur la bonne marche de la péréquation territoriale a, dès lors, constitué un premier axe de nos travaux.
Force est de constater - et c'est heureux - que nous n'avons pas été seuls à nous intéresser à ce sujet. Ainsi, le comité des finances locales a constitué en son sein un groupe de travail nous permettant, en lien avec l'administration et les associations d'élus, de bénéficier de simulations éclairantes quant à l'impact de la réforme « toutes choses égales par ailleurs ».
Les observations et les conclusions de ce groupe de travail rejoignent pour l'essentiel celles que nous avons formées à ce jour dans le cadre de notre mission de contrôle.
Pour rappel la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales impliquera qu'à compter de 2021 les communes et les EPCI ne percevront plus les recettes de cette imposition. En contrepartie, les communes percevront le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement perçu par les départements et les EPCI bénéficieront de l'affectation d'une fraction de TVA. Dans le même temps, les départements seront compensés, également, par l'affectation d'une fraction de TVA.
Il est toutefois utile de prendre la mesure de l'importance que revêtent à ce jour les recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales du point de vue des mécanismes de péréquation.
En effet, l'un des indicateurs les plus fréquemment employés pour comparer les ressources des collectivités locales est le potentiel fiscal ou financier. Il s'agit de la somme du produit des bases brutes d'imposition de divers impôts locaux acquittés par les ménages et les entreprises et des taux moyens constatés au niveau national pour chacun d'entre eux.
Nos travaux ont mis à jour qu'en 2019 la taxe d'habitation sur les résidences principales représentait, en moyenne, 44,8 % du potentiel fiscal des communes et 39,7 % du potentiel fiscal des EPCI. Dans ces conditions, les différences - même marginales - qui pourraient exister entre la taxe d'habitation et les ressources appelées à la remplacer sont susceptibles d'entrainer des effets importants sur l'ensemble du potentiel fiscal des collectivités locales.
Il n'est donc pas surprenant que des effets de grande ampleur ressortent des simulations que l'administration ou nous-même avons réalisées. Ainsi, le potentiel financier des communes pourrait diminuer en moyenne de 5 % tandis que le potentiel financier des EPCI se contracterait, en moyenne, de 1,5 %.

La situation que vient de décrire Claude Raynal est d'autant plus inquiétante que l'ampleur de ces variations des potentiels fiscal et financier n'est pas homogène entre les collectivités territoriales.
Ainsi, les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants pourraient voir leur potentiel financier diminuer de 10 % à 14 %.
Dans le même temps, alors que le potentiel fiscal des métropoles et des communautés urbaines augmenterait de 9 % à 12 %, il diminuerait de 2,7 % pour les communautés d'agglomération.
Enfin, l'ampleur de la variation du potentiel fiscal des départements - résultant là du remplacement des recettes de taxe foncière par une fraction de TVA - pourrait être comprise entre - 43 % et + 39 %.
Comme l'ont montré les plus récents travaux présentés au comité des finances locales le 30 juin et le 7 juillet derniers, ces variations induites par la réforme de la taxe d'habitation sur le potentiel fiscal et financier des collectivités auront des conséquences sur leur éligibilité à certains dispositifs et sur les montants prélevés ou perçus au titre de la péréquation.
À titre d'exemple, en appliquant les paramètres de la réforme « toutes choses égales par ailleurs », 1 900 communes auraient perdu en 2019 leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale tandis que 1 900 autres se seraient trouvées éligibles alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant.
De telles entrées ou sorties d'un dispositif d'année en année sont habituelles, mais ce qui doit ici retenir l'attention c'est l'ampleur de ces mouvements. En effet, en 2019, ce n'étaient en réalité que 800 communes - et non 1 900 - qui avaient perdu ou gagné leur éligibilité à la DSR.
En d'autres termes, la réforme de la taxe d'habitation de traduira, si aucune correction n'est faite et malgré les intentions régulièrement rappelées par le Président de la République ou le Gouvernement, par des transferts de ressources entre collectivités.
Tout autant pour permettre à cette promesse de neutralité financière d'être respectée que pour éviter des mouvements dont l'ampleur pourrait mettre en difficulté les collectivités territoriales, nous estimons qu'il est nécessaire de travailler à des dispositifs de neutralisation.
Plusieurs options pourront être envisagées et expertisées : faudra-t-il garantir un montant de dotation ? Ou, alors, devrait-on plutôt prévoir un couloir d'évolution des valeurs des indicateurs de péréquation comme le potentiel fiscal ou l'effort fiscal ? Peut-être un coefficient de correction des bases d'imposition pourrait-il être institué ?
À ce stade, nous demeurons ouverts à l'ensemble des pistes susceptibles de protéger les collectivités locales des effets de la réforme sur la péréquation et nous ne manquerons pas de vous associer et de vous tenir informés de l'avancement de nos réflexions, sachant que le Gouvernement doit aussi produire un rapport.
Le second axe de nos travaux concerne, lui, une réflexion plus prospective quant à l'avenir des dispositifs de péréquation. Celle-ci nous a, en particulier, conduit à nous interroger sur la pertinence des indicateurs et sur la manière dont ils pourraient être améliorés et mieux mobilisés.
Nous pensons, notamment, qu'une plus grande attention doit être accordée aux charges auxquelles les collectivités territoriales sont exposées. Les indicateurs de charges tiennent, d'ailleurs, une place croissante dans la mise en oeuvre des dispositifs de péréquation puisque, comme l'a montré l'observatoire des finances et de la gestion locale, ils représentent actuellement 60 % de l'ensemble des indicateurs. Cette tendance est notamment vérifiée pour les départements puisque 35 indicateurs de charges sont retenus contre 15 indicateurs de ressources.
S'il faut saluer cette prise en compte plus attentive des charges des collectivités locales, les indicateurs pourraient être améliorés. Ainsi, dans la continuité des réflexions que nous avons conduites sur le sujet en étudiant, en particulier, l'exemple italien, il paraitrait utile de définir des coûts standards pour les équipements et les services locaux.
Une première expérimentation pourrait être conduite dans le cadre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en intégrant, par exemple, le coût moyen pour les collectivités locales des locaux dédiés à l'enseignement et au périscolaire dans le calcul des montants prélevés et versés au titre du FPIC, puisque l'observatoire des finances et de la gestion locales (OFGL) en a fait l'étude exhaustive.
Un meilleur ciblage des dotations nous semble également devoir être étudié afin, par exemple, que les dotations de solidarité rurale et urbaine parviennent davantage à soutenir les territoires au profit desquels elles ont été instituées.
Enfin, il faudra parvenir à mieux articuler entre eux les différents dispositifs de péréquation horizontale et verticale dont les effets se cumulent et parfois se contredisent.
Comme vous le constatez, nos travaux ont vocation à se poursuivre et à s'amplifier notamment dans la perspective du projet de loi de finances pour 2021 qui sera l'occasion de proposer des dispositifs de neutralisation des effets de la réforme de la taxe d'habitation et, sans doute, des premières pistes d'amélioration pour l'avenir du fonctionnement des dispositifs de péréquation, sachant que nous avons encore un an pour mener ces opérations.

Merci à nos rapporteurs de s'être penchés sur ce sujet important aux conséquences redoutables. J'aurais pour ma part deux remarques.
Premièrement, vous avez souligné l'importance du nombre de communes concernées par des transferts à venir. Les communes qui perdront le plus sont celles dont les bases de taxe d'habitation sont les plus faibles, dont la population est plus défavorisée, et qui subissent par conséquent des charges plus importantes. Il y a donc un sujet d'égalité, avec la mise en difficulté de communes ayant déjà fait des efforts importants.
Ma seconde remarque concerne les indicateurs. Vous avez noté qu'il y a plus d'indicateurs de charges que de ressources, et qu'une meilleure définition de ces indicateurs est nécessaire, ce que je partage. Se pose cependant la question du poids relatif des différents indicateurs : selon le résultat recherché, on peut, à partir des mêmes indicateurs, obtenir ainsi des résultats très différents. Les résultats du premier fonds de solidarité entre départements m'avaient particulièrement interpellé en Île-de-France : un indicateur avait été élevé au carré, au détriment des autres.

Je trouve nos rapporteurs plus alarmistes à l'oral que dans leurs écrits. Je partage pour ma part cette inquiétude. Le document des rapporteurs précise qu'un territoire riche d'un point de vue foncier est « le plus souvent » peuplé d'habitants disposant d'un revenu important. Tout est dans ce « plus souvent »... Il y a toujours des communes qui à la marge risquent d'être durement affectées.
Par ailleurs, que signifie concrètement le fait d'appliquer des coefficients correcteurs ? Les effets cliquets sont à craindre en matière de péréquation, car la situation des communes évolue.
Je lis également que vous proposez à nouveau de réduire le nombre de communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU). Cela a déjà été fait : la DSU avait été cristallisée sur le bas de tableau, avec une concentration des augmentations sur la DSU-cible. Une sortie abrupte de la liste des éligibles aurait des conséquences importantes sur les communes concernées. Nous essayons de trouver à mettre des emplâtres sur une jambe de bois, mais cela ne règle pas le problème.
J'ai cependant bien conscience que le sujet est très compliqué. J'en entends parler depuis de nombreuses années, sans que nous parvenions à obtenir des résultats. Nous avons maintenant un an devant nous pour trouver une solution satisfaisante. Je crains que, ne sachant comment faire pour résoudre le problème, nous collions des rustines, avec des conséquences qui peuvent pénaliser des communes déjà fragiles.

Je partage ce qui a été dit par Philippe Dallier. J'ai déjà entendu Charles Guené soumettre l'idée d'une dotation générale de fonctionnement (DGF) de base, qui ne pourrait être inférieure à un certain montant. J'y serais favorable : il est indécent de notifier à des communes une DGF négative comme c'est parfois le cas. L'attribution actuelle de la DGF est préjudiciable à la bonne gestion communale, qui nécessite une stabilité des ressources.

Merci aux rapporteurs d'avoir abordé ce sujet important : il s'agit de l'avenir des ressources de nos collectivités suite à la réforme de la fiscalité locale, pour lesquelles nous pouvons être inquiets. Je me souviens que la fusion des intercommunalités avait par exemple eu des effets pervers sur les dotations de certains territoires. Nous devons aujourd'hui être attentifs à l'évolution des bases de taxes foncières, qui pourraient accroître les disparités entre collectivités.
Je relève également que les collectivités touristiques disposeront d'un avantage dans la mesure où elles conserveront des recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Les collectivités ne peuvent vivre indéfiniment des dotations de l'État. Nous devons trouver des leviers fiscaux pour les intercommunalités, les départements et les régions, afin de responsabiliser les élus, qui ne doivent pas devenir les répartiteurs des dotations de l'État.
Enfin, les rapporteurs peuvent-ils nous confirmer que les EPCI disposant d'une part de taxe foncière pourront bien continuer d'activer ce levier fiscal ?

Merci à nos rapporteurs. Les chiffres qui figurent dans votre document relatif à l'impact de la réforme de la fiscalité locale sur la péréquation avaient-ils été anticipés, ou les avez-vous découverts avec effarement lors de vos travaux ? On constate en effet d'importants transferts en faveur des métropoles et des écarts significatifs dans l'évolution des potentiels fiscaux des départements, allant de - 43 % à + 39 %. Connaissez-vous le département le plus pénalisé et le département le moins pénalisé ? Disposez-vous d'une typologie des départements affectés par la réforme ? Cela semble être une bombe à retardement...

Je m'associe aux remarques qui ont été faites et aux félicitations données aux rapporteurs. Nous avons vu petit à petit disparaitre les ressources traditionnelles des collectivités territoriales. On entend que le Gouvernement, dans sa volonté de suppression des impôts de production, envisagerait désormais une réforme de la CVAE...
Je remarque par ailleurs que le système de péréquation se fait aujourd'hui à enveloppe fermée. Cela a des effets amplificateurs, puisque la croissance de la péréquation s'est accompagnée de réduction des dotations forfaitaires, ce qui peut avoir in fine pour effet d'empirer la situation de certaines collectivités. On constate aujourd'hui que les départements les plus pauvres (Gers, Aude, Tarn, Guyane...) vont subir une hausse de leur potentiel fiscal, ce qui paraît aberrant. Le problème de la désuétude de valeurs locatives déterminées dans les années 1970 continue de se poser car celles-ci demeurent la base de la taxe foncière. Il y a donc des raisons d'être inquiet.
Comme l'a relevé Arnaud Bazin, le poids et la composition des indicateurs peuvent être très différents selon les dispositifs, conduisant à des situations ingérables.
Le recours à la TVA affectée aux collectivités territoriales a en outre montré ses limites. Contrairement à ce qui était annoncé, la crise a démontré que le produit de cet impôt pouvait baisser fortement. En outre, l'affectation de la TVA aux régions, aux départements mais également à la sécurité sociale nous conduit mécaniquement à nous demander quelles pourront être les ressources de l'État, dans un contexte où les recettes de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu vont également baisser.

Merci à nos deux rapporteurs d'avoir abordé ce sujet complexe et d'actualité. Les nouveaux élus issus des élections vont être amenés à découvrir l'élaboration des budgets locaux. Est-on en mesure d'évaluer les masses financières que représentent respectivement la péréquation horizontale et la péréquation verticale, ainsi que leur évolution ?

Je m'associe aux félicitations qui ont été décernées à nos rapporteurs spéciaux pour leur connaissance du sujet. Un premier constat, que j'aborde avec beaucoup de précautions : la dernière répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) - et je ne veux pas mettre en concurrence les territoires - montre que ces attributions vont du simple au double. Deuxième élément, en matière de péréquation horizontale cette fois-ci, et notamment de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : je constate la faiblesse de cette péréquation. Les territoires les moins riches sont parfois proches du prélèvement quand ils disposent de quelques mutations supplémentaires sur une année mais que les bases initiales étaient faibles. Cette augmentation des mutations se traduit en effet dès lors par une forte hausse en pourcentage, alors qu'elles représentent peu en valeur absolue. Cela témoigne du fait que les critères de péréquation ne sont pas adaptés à la réalité du terrain et de la richesse des territoires. Dernier point : les plafonnements de dotations sont assez incompréhensibles. Une intercommunalité pauvre peut prétendre à des augmentations de dotations liées aux critères qui s'appliquent mais ces augmentations sont plafonnées. S'agissant des critères de répartition, j'ai toujours été étonné par ces notions de potentiel financier et fiscal, dans la mesure où la capacité fiscale d'un territoire c'est la capacité contributive de ses habitants. Il y a, à mon avis, deux critères qui l'illustrent : le revenu et le patrimoine. On en est aujourd'hui arrivés à une situation illisible. Il va falloir revoir les critères de péréquation, dans une logique d'acceptabilité de ceux-ci par les élus et par la population. On peut donc être très inquiets des conséquences de la réforme de la taxe d'habitation sur la péréquation. Elle soulève aussi la question de l'autonomie fiscale.

je m'interroge sur l'avenir des territoires. Comment sera-t-il possible de faire des budgets avec des fonds de péréquation qui sont variables d'une année sur l'autre, avec des coefficients incompréhensibles et assez opaques ?

Je salue à mon tour le travail de nos collègues qui réintroduisent un débat que je crois avoir suivi ici-même à plusieurs occasions dans le passé. Dans le cadre de l'évolution de l'intercommunalité, certains départements ont fait le choix de grandes intercommunalités sans mesurer toujours les conséquences que cela allait avoir. J'ai en tête un exemple précis : il a fallu recalculer le potentiel fiscal de ces intercommunalités ; or cela s'est traduit pour les unes par une hausse, pour les autres par une baisse. On a même assisté à ce résultat paradoxal que facialement, ce potentiel fiscal ayant augmenté pour certaines, les dotations ont diminué. Ce mécanisme a joué sur la DGF, et sur la DSR en particulier. On voit bien que l'on est dans une mécanique extrêmement complexe : en jouant sur un seul critère, alors qu'ils sont innombrables, on atteint des résultats très différents, pour ne pas dire divergents. Cela m'amène à dire que sans simulations, il est toujours difficile de se prononcer sur des sujets tels que ceux que l'on évoque aujourd'hui. Nous nous inscrivons aussi dans un sujet beaucoup plus global : comment garantir aux collectivités des ressources tout en prenant en compte l'évolution générale du budget de l'État. Enfin, deux autres choses : nous avons abordé ici-même la question de la taxe d'habitation l'année dernière ; de même, nous avons réfléchi à l'augmentation de l'enveloppe du FPIC. À chaque fois, il y a eu des oppositions : il y a en effet toujours des gagnants et des perdants. Il est en tout cas nécessaire pour les collectivités d'avoir quelques garanties sur la pérennité de leurs ressources.

pour compléter la question de Marc Laménie, qui a évoqué les grands mouvements de péréquation, j'aimerais savoir si des études ont été faites au sein du comité des finances locales ou de notre commission pour mesurer l'impact de la réforme de la taxe d'habitation sur le fonds de soutien à la région Ile-de-France (FSRIF), car il a une incidence directe sur les critères de répartition du FPIC.

On pourrait rester la journée sur cette question. Je voudrais d'abord avoir un propos préalable. Il ne faut pas avoir d'inquiétude particulière sur l'application des indicateurs de péréquation tels qu'ils ressortent de la réforme de la taxe d'habitation, parce qu'ils ne seront pas appliqués tels quels mais feront l'objet d'une neutralisation. La question est en revanche celle des modalités de la neutralisation et du calendrier de celle-ci : doit-elle être pérenne ? C'est donc la problématique d'une réforme globale derrière. Or celle-ci est un sujet en soi, parce que lorsque que l'on se penche sur la fiscalité locale, on compare toujours les résultats de la réforme aux ressources historiques, considérées comme le Graal. Or, tant que l'on fera ça, on ne pourra jamais faire de réforme. La référence à la ressource historique est absurde, or tous les critères et indicateurs mis en oeuvre visent à s'en rapprocher le plus possible.
L'une des problématiques que soulève la réforme de la fiscalité locale c'est que dans le cas des EPCI et des départements elle conduit à remplacer une ressource potentielle par une ressource réelle. La notion de potentiel ne peut plus vraiment s'appliquer.
Pour répondre à notre collègue Arnaud Bazin, je précise que, s'agissant des communes, les variations les plus importantes du potentiel fiscal s'observent en raison de l'écart entre le montant des bases brutes et des bases nettes de taxe d'habitation. En effet, le potentiel fiscal est aujourd'hui calculé en référence aux bases brutes tandis que la compensation prévue dans le cadre de la réforme sera déterminée en fonction du produit de taxe d'habitation, c'est-à-dire en fonction des bases nettes.
Thierry Carcenac a évoqué la réforme des valeurs locatives cadastrales. La difficulté c'est que cette réforme n'interviendra pas avant 2026. Dès lors, il me semble important de neutraliser les effets de la réforme de la taxe d'habitation avant d'envisager une réforme plus vaste de la péréquation. Toutefois, nous pensons possible de travailler sur certains dispositifs spécifiques comme le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales par exemple. Le FPIC nous semble aujourd'hui, d'ailleurs, être le dispositif le moins affecté par la réforme de la taxe d'habitation.
La problématique du poids des indicateurs est réelle comme nous avons pu le constater dans le cas du dispositif des zones de revitalisation rurale. Certains indicateurs peuvent varier de façon extrêmement importante d'un territoire à l'autre alors que, pour d'autres, les écarts sont epsilonesques. En outre, comme je l'ai indiqué, on a sans doute tendance à jouer sur le poids de ces indicateurs pour parvenir à contrarier les effets des dispositifs de péréquation afin de garantir des ressources historiques aux collectivités territoriales.
Notre collègue Sylvie Vermeillet s'est déclarée favorable à garantir un montant minimal de dotation globale de fonctionnement (DGF). À mon sens, il faut faire attention. Je crois qu'il faut éviter de s'intéresser aux ressources des collectivités territoriales de façon isolée mais privilégier, plutôt, une approche globale.

Je suis d'accord avec Charles Guené lorsqu'il indique que la notion de potentiel fiscal ou financier est remise en cause par la prise en compte croissante de recettes réelles sur lesquelles les collectivités territoriales ne sont pas en mesure d'intervenir.
J'ai longtemps considéré qu'il fallait envisager une réforme globale de la péréquation. Toutefois, j'estime que c'est un exercice qui n'est pas véritablement réalisable. Aujourd'hui, l'architecture des dispositifs, comme la DGF, intègre de nombreux cliquets ou garanties. Lorsqu'on envisage de réformer globalement ces mécanismes on suscite une grande inquiétude de la part des collectivités territoriales qui peuvent s'attendre à perdre le bénéfice de ces garanties. Je plaide donc davantage pour des approches ciblées.
À mon sens, la première question qui se pose à nous est celle de la neutralisation des effets de la réforme de la taxe d'habitation. Il s'agit de protéger les collectivités territoriales dans cette période particulière.
Je suis d'accord avec Arnaud Bazin lorsqu'il nous rappelle que le coût de cette réforme sera surtout supporté par les territoires les plus pauvres.
S'agissant des sorties que connaissent certaines collectivités territoriales de dispositifs de péréquation dont elles bénéficiaient jusqu'alors, je crois qu'il faut s'efforcer de prévoir des mécanismes de lissage.
Je ne suis pas d'accord avec notre collègue Sylvie Vermeillet à propos de la DGF négative. Il faut se souvenir que ce dispositif vient du fait que des communes qui ne percevaient pas de DGF ne pouvaient pas contribuer au rétablissement des comptes publics par ce biais alors que, par ailleurs, elles bénéficiaient de ressources appréciables. Dans ce contexte, la DGF négative était un prélèvement qui permettait d'organiser cette participation à l'effort collectif. C'est pour cette raison, comme l'indiquait Charles Guené, qu'il faut prendre en compte l'ensemble des ressources et non des ressources ciblées.
Pour répondre à notre collègue Michel Canévet, je confirme que la tendance est une répartition croissante de produits d'impôts nationaux au profit des collectivités territoriales. Le phénomène ira même en s'aggravant si l'on tient compte des propos du ministre de l'économie concernant une éventuelle réforme des impôts de production dont la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions, les départements et les EPCI fait partie.
À mon sens on se dirige vers un système « à l'allemande » par lequel l'État verserait une dotation aux collectivités territoriales sans qu'il n'existe, véritablement, de ressources fiscales au plan local. Avec la suppression de la taxe d'habitation et celle, peut-être à venir, de la CVAE, il ne reste, finalement que le foncier bâti ce qui est bien peu et laisse peu de marges.
Je souhaite d'ailleurs dire ici que l'intervention du ministre de l'économie Bruno Le Maire à propos de la réforme des impôts de production m'a semblé violente. Il indique qu'il ne souhaite pas réformer la C3S mais la CVAE alors qu'il s'agit d'une ressource des collectivités territoriales. Il faudra réagir.
Pour répondre à notre collègue Marc Laménie s'agissant des masses financières, la péréquation représente 12 milliards d'euros dont 66 % au titre de son volet vertical. J'appelle, toutefois, à une certaine prudence dans l'appréhension de cette distinction entre péréquation horizontale et verticale. Dès lors que l'on raisonne au sein d'une enveloppe normée, certaines variations des montants mobilisés au titre de la péréquation verticale sont, en réalité, financées par la diminution des montants prévus au titre d'autres dispositifs. Dans une certaine mesure on pourrait parler de péréquation diagonale.
S'agissant de l'impact de la réforme de la taxe d'habitation sur les potentiels fiscaux des départements, sans correction on constaterait que les départements qui avaient un taux de taxe foncière plus faible que la moyenne verraient leur potentiel fiscal diminuer. En d'autres termes, les départements « aisés » pourraient bénéficier d'une augmentation des versements de péréquation effectués à leur profit ce qui est contre-intuitif.

Effectivement c'est une inversion contre-intuitive. Cela plaide pour une neutralisation ou pour une évolution du mode de calcul du potentiel fiscal des départements, ce qui est d'ailleurs une piste actuellement à l'étude.
Michel Canévet nous a demandé s'il sera toujours possible de verser des contributions fiscalisées aux syndicats de communes. Cela sera toujours possible mais reposera sur une assiette plus resserrée.

Je souhaite répondre à l'interrogation soulevée par notre collègue Philippe Dallier concernant le potentiel fiscal. Ce que nous avons indiqué c'est que les impacts de la réforme sur le potentiel fiscal doivent être corrigés mais ne sont pas dramatiques au point d'imposer de revoir entièrement cet indicateur.
En effet, nous faisons le constat que cet indicateur parvient en moyenne à capter une certaine réalité de la richesse d'un territoire. Nous observons, ainsi, une corrélation entre la richesse foncière d'un territoire - mesurée par le potentiel fiscal par habitant - et la richesse de ses habitants - mesurée par le revenu fiscal de référence par habitant.
Bien sûr il s'agit d'une moyenne et c'est la limite de cette observation. Il existe évidemment des territoires qui ne vérifient pas ce constat.

Je souhaite ajouter que je crois que toute réforme à venir devra nous amener à apprécier la richesse et les charges au niveau intercommunal.

Merci à nos rapporteurs spéciaux pour leur communication, la synthèse de leurs travaux qui vous a été distribuée fera l'objet d'une publication.

Nous entendons maintenant une communication des rapporteurs spéciaux de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances ».

Avant d'évoquer devant vous les conclusions de notre contrôle, nous souhaitions remercier nos collègues de la délégation aux droits des femmes et leurs équipes pour leur expertise et nous féliciter de nos échanges fructueux. Par ailleurs, nous souhaitions remercier toutes les personnes auditionnées, notamment les associations et le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE), qui ont contribué à ce contrôle, y compris pendant la période difficile et chargée pour eux de confinement.
Dans le cadre du large périmètre de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances », nous avons donc décidé de conduire des travaux de contrôle sur le sujet du financement de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons fait ce choix après avoir, lors du dernier projet de loi de finances, pointé le tour de « passe-passe » du Gouvernement s'agissant du financement de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes.
Pour mémoire, alors que la ministre Marlène Schiappa annonçait l'ouverture d'un milliard d'euros pour cette politique publique, une lecture attentive du document de politique transversale nous avait conduits à relever qu'on était loin du compte. Ce montant de 1,116 milliard d'euros correspondait, en réalité, non pas à des crédits de paiement, mais à des autorisations d'engagement et était constitué aux trois quarts de fonds destinés aux programmes d'aide publique au développement.
Nous avons donc souhaité aller plus loin sur ce sujet, en nous intéressant plus particulièrement aux crédits prévus pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment contre les violences conjugales.
Un Grenelle de lutte contre les violences conjugales s'est en effet tenu en fin d'année 2019 regroupant toutes les parties prenantes, au niveau national et local. Il a conduit à la présentation, par le Gouvernement, de quarante mesures visant à prévenir les violences, mieux accompagner les victimes et les enfants ainsi qu'à développer le suivi des auteurs. Par ailleurs, des dispositifs législatifs sont venus s'ajouter récemment, visant notamment à traduire ce Grenelle dans la loi.
Dans le document de clôture du Grenelle, le Gouvernement affirmait mettre en oeuvre « des moyens à la hauteur des enjeux » mentionnant une enveloppe de 360 millions d'euros pour 2020. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif du présent contrôle était de comprendre la réalité des chiffres derrière des annonces gouvernementales. Plus largement, nous avons tenté, dans ce rapport, d'identifier les crédits mobilisés pour cette politique publique et d'examiner son pilotage institutionnel.

Érigée comme grande cause du quinquennat, cette politique publique n'est pourtant pas nouvelle, mais elle a fait l'objet d'une prise de conscience progressive, sur le plan politique et de l'opinion publique.
Le constat est glaçant : 121 femmes tuées et 213 000 victimes de violences physiques et sexuelles en 2018, selon la lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes. Les conséquences sont dramatiques sur l'entourage familial, et notamment les enfants, avec toutefois moins d'une victime sur 5 déclarant avoir déposé plainte et plus de la moitié des victimes n'ayant fait aucune démarche auprès de professionnels ou d'associations.
Nous avons découvert, lors de ce contrôle, le phénomène d'emprise, dont souffrent les femmes victimes, qui est au coeur d'un « cycle » identifié de violence correspondant à un processus de dégradation des relations dans un couple.
Cette question des violences a fait l'objet d'une prise de conscience progressive, dont une étape a été franchie avec le mouvement « me too », l'activité des associations l'attestant, comme nous l'évoquerons plus tard. Érigée en grande cause du quinquennat, le Gouvernement a souvent la tentation de s'approprier des mesures pourtant déjà existantes. Bien que nous reconnaissions ses efforts en la matière, il convient de souligner que cette politique publique n'est pas nouvelle. Pour preuve, les commissions départementales contre les violences faites aux femmes datent de 1989 ...mises en place par une ministre bien connue de notre commission, Mme Michèle André, alors secrétaire d'État aux droits des femmes.
La politique d'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment celle de lutte contre les violences faites aux femmes, est budgétairement inscrite sur le programme 137 de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances ». On observe ainsi, depuis 2010, une relative augmentation de ces crédits qui masque néanmoins des sous-exécutions importantes jusqu'en 2018, et des opérations discrètes de redéploiements internes, permettant de dégager des crédits, dont la communication gouvernementale laisse souvent à penser, à tort, qu'il s'agit de crédits nouveaux.
Par ailleurs, depuis le projet de loi de finances pour 2019, ce programme 137 dispose d'une nouvelle maquette budgétaire, ne permettant plus d'identifier clairement les crédits spécifiques à la lutte contre les violences et la prostitution. Une opération de simplification pour le Gouvernement qui a conduit à obscurcir l'information du Parlement. Nous le regrettons.
Toutefois, ce programme ne représente qu'une partie du financement de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, qui se caractérise, en effet, par un fort morcellement des crédits, puisqu'à la croisée de plusieurs politiques publiques.
Malheureusement, le document de politique transversale de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes ne permet pas d'identifier de façon satisfaisante ces différentes sources de financement. Il se révèle être un outil insuffisamment fiable et développé. Nous avons été surpris par les auditions réalisées qui ont révélé le caractère assez « artisanal » de son élaboration. L'absence de méthodologie claire de la part de la direction du budget, le peu de volonté des ministères d'y contribuer conduisent à un document au périmètre instable et très loin d'être exhaustif. L'augmentation des crédits d'une année sur l'autre n'est pas forcément liée à des crédits supplémentaires, mais à des choix méthodologiques de rattachement.

Dans ce morcellement des crédits difficilement lisibles, nous avons tenté d'identifier les 360 millions d'euros annoncés par le Gouvernement pour financer le Grenelle. À l'analyse et sous toutes réserves méthodologiques, liées à l'indisponibilité de certaines données, il semblerait que la majeure partie de ce montant constitue des crédits déjà existants en 2019.
Cette comparaison, dont vous pouvez voir le tableau récapitulatif dans le document distribué, nous conduit à formuler plusieurs séries d'observations.
D'abord, nous constatons la quasi-absence de mesures nouvelles : les intervenants sociaux en commissariat et gendarmeries, les psychologues, ou encore les correspondants locaux de lutte contre les violences intrafamiliales existaient déjà.
Ensuite, il faut relever le peu d'augmentation des crédits entre 2019 et 2020 pour les mesures déjà existantes, voire une diminution des crédits s'agissant des moyens humains de l'administration centrale et déconcentrée.
Enfin, concernant la contribution des programmes « gendarmerie » et « police », la valorisation financière des personnels est quelque peu sujette à caution, d'autant qu'il s'agit de dispositifs comptabilisés dans la politique de lutte contre les violences de façon un peu extensive.
Toutefois, il convient de signaler qu'au-delà de ces 360 millions d'euros identifiés, 4 millions d'euros supplémentaires ont été ouverts dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 et d'autres devraient l'être en 2021 avec des mesures nouvelles, ce que nous saluons.
Afin d'y voir plus clair, nous avons ainsi tenté de dresser un état des lieux des financements. Nous sommes cependant loin du milliard demandé par les associations, même si des efforts financiers ont été réalisés par l'État, comme vous pouvez le voir sur le tableau synthétisant les financements mobilisés dans le cadre d'un parcours type de prise en charge des victimes et des auteurs.
Ce tableau ne tient, cependant, pas compte des financements des collectivités locales, souvent en première ligne, et qui apportent un soutien financier très important à cette politique publique, mêmes si des disparités peuvent exister selon les territoires. Nous avons eu des données de l'Association des départements de France (ADF), de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCASS) et de l'Association des maires de France (AMF) extrêmement intéressantes qui figureront dans le rapport. Les collectivités constituent, par ailleurs, souvent des laboratoires d'expérimentation, comme vous le savez : l'observatoire des violences de Seine-Saint-Denis, présidé par une figure militante, Ernestine Ronai, fut, par exemple, préfigurateur de nombreux dispositifs, comme le Téléphone Grave Danger. Il en est de même pour la communauté urbaine d'Arras, avec la mise en place du premier centre de prise en charge des auteurs de violence, que le Gouvernement veut généraliser, dans le cadre du Grenelle.
Autre source de financement, cette fois-ci, très peu exploitée : celle en provenance de l'Union européenne. Lors des auditions que nous avons réalisées, les associations n'ont fait que très peu de référence à ces financements, qui restent sous-utilisés.
Enfin, nous souhaitions mentionner les aidées privées (dons des particuliers et mécénat) qui restent également une source peu développée, même si cela commence à changer à la faveur de la communication engendrée par le mouvement « me too », et en raison de la période de confinement. Une des rares études sur le sujet datant de 2016 indiquait que les actions des fondations en faveur des droits des femmes représentaient un budget de 3 millions d'euros.
Ce faible recours aux dons et au mécénat s'explique par le manque de visibilité de la cause et un personnel non formé à cette recherche de financement dans les associations. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le dispositif voté dans le dernier PLF, concernant la hausse du plafond de défiscalisation des dons à hauteur de 75 % n'est que très peu connu par les structures qui sollicitent des dons, et par les particuliers.

Cette question de la générosité publique nous conduit à faire un point sur la période de confinement, qui a marqué un tournant en la matière. Ainsi la Fondation des femmes, à la faveur d'une communication et d'une visibilité du sujet pendant cette période, a réalisé une collecte record : 2,7 millions d'euros dont environ 500 000 euros de dons de particuliers, avec une moyenne d'environ 100 euros par personne.
Ce faible recours aux dons et au mécénat s'explique par le manque de visibilité de la cause et un personnel non formé à cette recherche de financement dans les associations. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le dispositif voté dans le dernier PLF, concernant la hausse du plafond de défiscalisation des dons à hauteur de 75 % n'est que très peu connu par les structures qui sollicitent des dons, et par les particuliers.
Parmi ces acteurs, il faut citer le Service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE) tout d'abord, rattaché à la direction générale de la cohésion sociale, composé de 25 ETP dont les moyens humains n'ont pas cessé de diminuer depuis sa création. Malheureusement il ne bénéficie pas d'un poids suffisant pour assurer une forte mobilisation des autres directions ministérielles concernées par la question des violences, et n'est surtout pas outillé pour répondre à toutes les missions croissantes demandées par le ministère. Il en est de même pour le réseau déconcentré qu'il anime.
Ce réseau repose, au niveau régional, sur une directrice régionale, avec une équipe restreinte de deux personnes, rattachée au SGAR et au niveau départemental sur une déléguée, placée au sein des délégations départementales à la cohésion sociale. Seules trois déléguées sont directement rattachées au préfet. Ces effectifs très minces - qui connaissent des vacances régulières - sont indéniablement un facteur de fragilisation de cette politique. Ces déléguées se trouvent souvent au coeur d'« injonctions contradictoires », les demandes du ministère sur ces sujets d'égalité et des violences sont croissantes et leurs moyens désuets.
C'est le cas pour le SDFE déjà cité, mais également pour la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), créée en 2012. Pour remplir ces missions, elle dispose d'un effectif réduit : cinq agents mis à disposition et un budget de fonctionnement de 20 000 euros par an. Nous avons été étonnés d'entendre comment étaient réalisés les outils de formation, sans équipements ou logiciels informatiques adéquats. Là encore, cette politique repose sur l'engagement de personnalités, comme sa secrétaire générale.

À côté de ces acteurs étatiques, se trouvent les associations, qui sont les véritables « bras armés » de cette politique. Souvent des petites structures, elles jouent un rôle essentiel dans la prévention et la parcours de sortie des femmes victimes de violences, en offrant un service de conseil, d'accès à l'information, de mise à l'abri notamment.
Elles ont néanmoins été fragilisées, par l'afflux de demandes, à la suite du mouvement « me too », qui n'a pas été entièrement compensé par des ressources budgétaires correspondantes. L'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AFVT) a ainsi dû fermer sa permanence téléphonique, l'année dernière, alors qu'elle était la seule association oeuvrant sur le champ des violences au travail.
Les associations ont également souffert de la perte de la réserve parlementaire, et surtout d'un manque de visibilité budgétaire. Leur financement repose, pour beaucoup d'entre elles, sur des subventions annuelles, versées parfois tardivement dans l'année.
Cette fragilisation des acteurs et du pilotage conduit à une inégalité d'application des dispositifs sur le territoire, préjudiciable à la pris en charge des femmes victimes de violence.
Comme nous avons pu le voir au fur et à mesure de nos auditions, la bonne mise en oeuvre de cette politique dépend des initiatives et de la bonne volonté et coordination des différents acteurs sur les territoires : directrices régionales, déléguées départementales, préfecture, parquet/procureur gendarmerie/police, associations. La réussite de cette politique repose ainsi souvent sur l'engagement de personnalités (procureur, préfet...), qui, quand elles partent peuvent mettre en péril l'exécution de cette politique publique sur les territoires.
Par ailleurs, cette politique publique est souvent « fondue » dans des dispositifs de droit commun. L'exemple du 39.19 est éclairant, cette ligne téléphonique « qui a explosé » durant le confinement repose sur la fédération nationale Solidarité Femmes et des écoutantes formées. Avec le lancement d'un marché public pour sa généralisation 7j-7 et 24h-24, prévue dans le cadre du Grenelle, le risque est grand, selon les associations, que les prestataires ne soient pas spécialisés et formés à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Ces constats dressés pour la politique de lutte contre les violences conjugales, se retrouvent pour celle de lutte contre la prostitution, mise en oeuvre dans la loi de 2016, qui a institué un parcours de sortie de la prostitution et une allocation financière. La mise en place des comités départementaux et des parcours prévus a été freinée par un pilotage national défaillant, et une mise en oeuvre hétérogène sur le territoire reposant sur des volontés individuelles.

Au vu des observations que nous avons pu faire, nos recommandations s'articulent autour de deux axes, afin de traduire concrètement cette priorité politique qu'est la lutte contre les violences conjugales, sur le plan budgétaire et institutionnel.
Premier axe, rendre les financements plus lisibles et à la hauteur des enjeux.
Cela passe d'abord par une meilleure transparence budgétaire, gage d'une meilleure visibilité de la politique publique et d'une bonne information du Parlement. Cela pourrait passer a minima, par la refonte du programme 137, voire l'ajout d'actions ou indicateurs sur d'autres programmes pour suivre la mise en oeuvre de ces crédits. A maxima, la lutte contre les violences étant à la croisée de plusieurs politiques publiques et pour lutter contre ce morcellement des crédits, la création d'un fonds interministériel et pluriannuel sur le modèle du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pourrait être envisagée.
En tout état de cause, le document de politique transversale doit être revu, en lien avec la direction du budget afin de remédier aux dysfonctionnements identifiés. Il s'agit d'un préalable avant toute généralisation d'un budget intégrant l'égalité, qui semblerait précoce au vu des conclusions de l'expérimentation menée l'année dernière.
Outre une meilleure transparence, les financements doivent être à la hauteur des enjeux et des mesures annoncées.
Un préalable est sans doute d'appréhender la dépense comme un coût évité pour l'avenir. Un chiffre est éclairant : 40 à 60 % d'enfants délinquants sont des enfants qui ont vécu des violences conjugales, selon le juge Édouard Durand.
Il nous semble ainsi nécessaire d'octroyer aux associations un niveau de financement public leur permettant de répondre à leurs missions tout en encourageant les co-financements multi-acteurs publics et privés. Simplifier les réponses aux appels à projet et la généralisation des conventions pluriannuelles font partie de nos recommandations, dont le détail sera explicité dans le rapport.
Le développement des financements privés doit également être une piste à explorer. L'enjeu est de rendre attractive la donation en faveur de cette politique de lutte contre les violences, comme cela a déjà été amorcé. Les associations doivent rendre visibles leurs actions et les pouvoirs publics doivent les accompagner dans leur modernisation, pour encourager les partenariats avec des fondations.

Notre deuxième axe de recommandation concerne l'architecture institutionnelle de cette politique. Il y a nécessité de sortir des formes actuelles d'organisation conjoncturelle, qui reposent sur des coordinations d'acteurs de bonne volonté pour ancrer cette politique publique dans le dur. Le pilotage institutionnel est un impensé du Grenelle, en raison probablement des groupes de travail thématiques pilotés par les ministères, qui ont empêché cette vision transversale, pourtant nécessaire.
Cette refonte de l'architecture institutionnelle, doit d'abord passer, au niveau central, par un renforcement du pilotage interministériel et du suivi de cette politique.
Les moyens et le positionnement du SDFE et de la MIPROF doivent être revus en dotant cette politique publique d'une vraie administration centrale et interministérielle. Un de ces deux services pourrait prendre le titre de délégation interministérielle à la lutte contre les violences faites aux femmes, rattachée directement au Premier ministre.
Par ailleurs, le suivi de cette politique et du Grenelle, en particulier, doit être renforcé. Le suivi du Grenelle nécessiterait la mise en place d'un comité interministériel réunissant tous les ministres concernés, doublé d'un comité réunissant toutes les parties prenantes (y compris les associations et élus locaux), en pérennisant et institutionnalisant, par exemple, les groupes de travail du Grenelle.
Le Parlement et notamment le Sénat a un rôle clé à jouer dans le suivi et l'évaluation de cette politique publique. À cet égard, à l'image de ce travail de contrôle, il nous semble que les synergies entre les commissions et délégation du Sénat doivent être encouragées.
Au niveau local, la refonte de l'architecture institutionnelle doit passer par un renforcement de la coordination des acteurs et du pilotage départemental.
Il faut que les bonnes pratiques d'un territoire dues aux initiatives d'un réseau d'acteurs deviennent pérennes et puissent se retrouver sur tout le territoire. Le guide des bonnes pratiques géré par la MIPROF doit être enrichi.
Le pilotage départemental doit ainsi être renforcé et homogénéisé sur le territoire, en veillant à la mise en oeuvre de la déclinaison locale de cette politique publique et notamment du Grenelle sur tout le territoire. Cette exécution locale peut passer par des outils déjà existants ou par la ré-instauration d'une commission départementale de lutte contre les violences et de la prostitution. Le but est d'avoir, sur chaque territoire, une structure dédiée aux violences faites aux femmes et identifiée par les acteurs, qui institutionnalise ce travail partenarial entre forces de sécurité, de justice, de santé, associations... et qui se réunisse régulièrement.
L'important est de « laisser faire ce qui se fait sur les territoires, des choses formidables s'y passent », comme a pu nous dire la secrétaire générale de la MIPROF, mais nous y ajouterions, tout en veillant à ce que l'État ne se désengage pas de cette politique publique essentielle.

Je souhaitais revenir sur deux points. J'ai été un peu surpris dans le tableau de répartition des crédits du document de synthèse, de voir qu'il n'y avait pas de montant chiffré pour la contribution de l'Éducation nationale, qui est à mon sens essentielle dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et les violences familiales en général. Je reste convaincu, peut-être en raison de ma profession, que le rôle de l'éducation est indispensable dans la prévention de ces violences. Vous avez d'ailleurs souligné qu'une forte proportion des jeunes délinquants sont des enfants ayant vécu des violences conjugales. Il serait donc essentiel de savoir, quelle part est donnée, dans la politique du Gouvernement, à l'Éducation nationale pour l'information et la prévention sur ces questions de violences faites aux femmes.
Le deuxième point, que je souhaitais évoquer, concerne les difficultés liées à la disparition de la réserve parlementaire, notamment pour le secteur associatif. À l'époque de sa suppression, avait été annoncée une augmentation des crédits d'investissement dans les départements mais aussi la création du fonds départemental d'aide à la vie associative (FDVA). J'aimerais savoir si la suppression des crédits issus de la réserve parlementaire, qui contribuaient au financement des différentes associations sur tout le territoire, sont aujourd'hui compensées par le FDVA.

Merci aux deux rapporteurs pour ce travail de fond qui révèle aussi un volet humain important et un sujet malheureusement d'actualité. Le confinement a accru les risques de violences, comme je peux en témoigner en tant que membre de la délégation au droit des femmes.
J'ai également remarqué qu'il existe des décalages entre les mesures annoncées et la réalité du terrain. Pendant la période de confinement, des réunions étaient animées par les préfets, auxquelles nous étions conviés, mais nous n'avions malheureusement que peu d'informations. Sur le volet financier, cette politique de lutte contre les violences faites aux femmes est certes financée par le programme 137, qui dispose d'assez peu de moyens financiers, mais également par plusieurs autres ministères. Comme l'a rappelé Jean-François Rapin le premier budget sur ce sujet est celui de l'Éducation nationale. Il faut également noter le rôle essentiel des associations, comme nos deux rapporteurs l'ont indiqué. Mais j'aimerais aussi aborder la question de l'implication de nos collectivités territoriales, les communes et intercommunalités en particulier mais aussi les départements qui assument une mission sociale et déploient ainsi des moyens humains sur le terrain. Une meilleure organisation sur les territoires de cette politique est-elle possible ? En discutant avec les forces de l'ordre et les pompiers qui interviennent, mais aussi la justice, on est largement dans le flou... Comment renforcer le rôle des délégués aux droits des femmes sur le terrain ?

Concernant l'observation de Jean-François Rapin sur le chiffrage des crédits de l'Éducation nationale, nous regrettons de ne pas avoir eu communication de montants plus précis. Cependant, le Gouvernement n'hésite pas à faire figurer, dans le document de politique transversale, des montants très importants au titre des heures d'enseignement des professeurs d'histoire-géographie qui interviennent sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes à différents moments du cursus des élèves. Nous avions ainsi démontré, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2020, qu'en retranchant ces montants et ceux versés au titre de l'aide aux pays en développement au milliard d'euros annoncé par le Gouvernement, il restait moins du quart de la somme annoncée. Et parmi ce faible montant restant, l'essentiel des crédits concernait l'hébergement, alors que le programme 137 ne représentait qu'environ 30 millions d'euros.
Concernant la réserve parlementaire, nous ne disposons pas de l'ensemble des données permettant de vérifier si le FDVA a compensé les crédits versés au titre de cette réserve. Toutefois, nous mettons en évidence dans le rapport que, d'une manière globale, les montants anciennement consacrés par les parlementaires aux associations ne sont pas intégralement compensés par ce nouveau fonds. De plus, les mécanismes d'appels à projet, sur lesquels repose le FDVA, rendent plus complexe le recours à ce type de financement pour les associations.
S'agissant de la question de l'implication des collectivités territoriales dans cette politique de lutte contre les violences faites aux femmes, évoquée par Marc Laménie, les informations précises dont nous disposons figureront dans le rapport.
Enfin, concernant la question de l'architecture institutionnelle de cette politique, qui constitue un axe important de nos propositions, il est évident qu'un pilotage plus affirmé et une déclinaison efficace dans chaque département sont essentiels pour que ces politiques ne soient plus dépendantes de la volonté d'un procureur, d'un Président de tribunal de grande instance, d'un préfet ou d'un autre acteur. Le pilotage de cette politique publique doit être solidifié et conforté.

J'aimerais évoquer quelques éléments pour compléter les propos de mon collègue Arnaud Bazin : concernant le financement issu de la réserve parlementaire, je remarque qu'il était essentiel aux associations, et que ce sujet revient chaque fois qu'on s'intéresse au fonctionnement des associations, comme cela fut le cas, lors notre travail de contrôle sur l'aide alimentaire aux plus démunis, dont la distribution reposait essentiellement sur des associations. Cette réserve, critiquée, servait pourtant à irriguer le tissu associatif, dont on connaît l'importance sur de nombreuses thématiques, et permettait de donner quelques moyens, essentiels à de nombreuses petites structures. S'agissant de la question des violences faites aux femmes, le confinement n'a pas été un révélateur mais un amplificateur. Un chiffre doit être cité, qui figure dans le rapport : il y a eu autant d'appels au 39.19 en deux mois, en avril et mai 2020, que sur toute l'année 2019.
Concernant le point évoqué, par Marc Laménie, il y a effectivement un nombre d'acteurs multiples qui réalisent un travail avec beaucoup d'engagement, mais le pilotage national tout comme les moyens financiers doivent être renforcés. J'ai, en effet, eu l'occasion de rencontrer la déléguée départementale aux droits des femmes du Nord, qui ne dispose que d'un employé à mi-temps et d'une stagiaire pour mener à bien ses missions, dans un département de 2,5 millions d'habitants.
La commission autorise la publication de la communication des rapporteurs spéciaux sous la forme d'un rapport d'information.

Mon rapport porte cette année sur un opérateur peu connu du grand public : l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), établissement public de recherche fondamentale dans le domaine aérospatial. Bien qu'il soit placé sous la tutelle du ministère des armées depuis sa création en 1946, l'ONERA a une vocation duale. L'ensemble des grands programmes aéronautiques civils et militaires français comprennent de nombreux apports de l'ONERA. Son rôle est également majeur dans le domaine des missiles tactiques et stratégiques, de la dissuasion nucléaire, des drones, des lanceurs ou encore des satellites.
J'ai souhaité vous soumettre ce rapport pour trois raisons. En premier lieu, en 2015, la Cour des comptes avait pointé un ensemble de dysfonctionnements majeurs de l'Office. Ensuite, l'ONERA est régulièrement évoqué par nos collègues lors de l'examen du projet de loi de finances pour demander le rassemblement de ses sites franciliens ou s'inquiéter des difficultés de fidélisation des personnels. Enfin, nos capacités nationales d'innovation dans le domaine aérospatial ont une importance stratégique, surtout dans le contexte actuel de conception du système de combat aérien du futur (SCAF) et je souhaitais approfondir ce point.
Sur le premier point je vous renvoie à mon rapport pour noter que les nombreux dysfonctionnements liés au fonctionnement du conseil d'administration, aux instances dirigeantes, aux procédures ou à la tutelle sont très largement réglés.
Sur le plan immobilier, si l'on peut regretter que les choses n'aillent pas aussi vite que souhaitées nous sommes rentrés dans une logique de rationalisation avec un regroupement des trois sites franciliens d'ici à 2024 sur le site de Palaiseau permettant de libérer ceux de Meudon et de Châtillon.
L'ONERA dispose également du plus grand parc de souffleries d'Europe, dont la valeur théorique à la reconstruction est d'1,5 milliard d'euros, et qui constituent un atout industriel majeur. On a connu des difficultés à Modane, et aujourd'hui les investissements ont été faits. À cet égard, un prêt de 47 millions d'euros sur 6 ans a été octroyé par la banque européenne d'investissement (BEI) en 2019 afin d'assurer leur pérennité et leur remise à niveau. Cet effort s'est traduit par une hausse de la part de marché de ces souffleries, ce qui constitue incontestablement une évolution positive.
Malgré ces évolutions récentes et son potentiel important, l'ONERA reste gêné dans son développement par la rigidité de certaines règles de gestion, et surtout par le manque de visibilité offerte par les pouvoirs publics sur sa participation à des projets stratégiques.
Avec 1 916 employés au 31 décembre 2019 l'activité de l'ONERA repose pour moitié sur des contrats réalisés à titre onéreux pour des clients privés ou publics financés par la DGA au titre d'une subvention pour charge de service public afin de réaliser des recherches amont. L'augmentation des ressources contractuelles constitue un des principaux objectifs que l'État a fixé à l'ONERA (par le biais du contrat d'objectifs et de performance 2017-2021). Celles-ci ont augmenté ces dernières années, mais restent toujours inférieures aux objectifs.
Sans doute parce que les règles de gestion des effectifs ne sont pas adaptées. Bercy ne peut pas à la fois demander à l'ONERA d'accroitre ses recettes propres et en même temps lui interdire d'augmenter ses effectifs afin de faire appel à des chercheurs correspondant aux profils susceptibles de pouvoir répondre à une demande des entreprises.
L'ONERA est en outre confronté à des difficultés de fidélisation de ses personnels. La comparaison des rémunérations entre l'ONERA et les employeurs du même domaine, tant publics que privés, met en évidence un écart réel en défaveur de l'ONERA, de l'ordre de 300 euros par mois. Afin de permettre à l'ONERA de lancer la négociation salariale nécessaire, une hausse de la subvention pour charges de service public (SCSP) par rapport au contrat d'objectifs et de performance (COP) a été décidée pour la porter de 105 à 110 millions d'euros dès 2020. Les effets de la crise économique actuelle sur le vivier d'emploi de l'ONERA et l'évolution de la concurrence avec les autres employeurs du secteur apparaissent aujourd'hui difficiles à anticiper. Il convient toutefois de maintenir les efforts de fidélisation prévus, afin de parvenir à une consolidation des effectifs.
Après avoir évoqué les menaces « internes », il est important de revenir sur les menaces d'ordre « externe » auxquelles est confronté l'office.
La plus importante est celle de la concurrence de l'homologue allemand de l'ONERA, dans le contexte particulier du développement par la France et l'Allemagne, rejoints par l'Espagne, du système de combat aérien du futur - le SCAF, à horizon 2040. Si l'ONERA coopère très largement avec son homologue allemand, le DLR (Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt), sa montée en puissance est susceptible de constituer une menace pour l'indépendance et la pérennité des savoir-faire français. Le DLR allemand met en oeuvre depuis cinq ans une stratégie de développement particulièrement offensive, le budget qu'il dédie à l'aéronautique ayant augmenté de près de 30 % depuis 2015, alors que celui de l'ONERA est resté stable.
Contrairement à l'ONERA, et malgré les efforts budgétaires faits par les pouvoirs publics allemands, le DLR ne maîtrise pas aujourd'hui l'ensemble du spectre de compétences nécessaire à la conception du futur avion de chasse européen, le SCAF. La logique du « juste retour », couplée à la puissance financière du DLR pourrait toutefois nuire à la place que l'ONERA aura dans ce projet et au maintien des compétences françaises dans ce domaine stratégique. Le DLR semble déjà être assuré d'un budget national pour sa contribution au SCAF, via le BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, équivalent allemand du GIFAS), ce qui n'est pas encore le cas pour l'ONERA. Le risque est réel de voir l'ONERA sacrifié au profit de l'industrie aéronautique française, la part du retour industriel entre la France et l'Allemagne devant être le reflet de la part des financements des deux pays.
Il est clair que la coopération en matière d'industrie de défense avec l'Allemagne constitue une nécessité, pour garantir une puissance financière suffisante permettant la conception de technologies abouties, comme le SCAF. Elle constitue également une nécessité géostratégique, dans un contexte d'affaiblissement de l'OTAN. Le succès du SCAF marquerait, à cet égard, une avancée majeure non seulement pour l'industrie, mais aussi pour la coopération européenne en matière de défense.
Cette coopération ne doit toutefois pas consister à transférer les technologies industrielles stratégiques à l'Allemagne tout en laissant à la France « le soin de faire la guerre ».
L'ONERA constitue le « gardien » d'un ensemble de moyens et de compétences stratégiques nationaux. Si sa participation au SCAF n'était pas suffisante, la perte définitive de savoir-faire pour l'ONERA constituerait un affaiblissement majeur. La durée d'aboutissement de ce projet, de plus 20 ans, conjugué à sa rareté, rendrait irréversible cette perte d'autonomie de la France dans de nombreux domaines (aérodynamique, propulsion, furtivité, etc.).
Il est donc indispensable que le gouvernement français donne à l'ONERA des garanties quant à sa participation au SCAF.
De manière plus générale, la place de l'ONERA dans le cadre du plan de relance est incertaine aujourd'hui, tant dans le domaine militaire que civil. Les commandes de la direction générale de l'armement (DGA) à l'ONERA ont augmenté de 30 % depuis 2018, ce qui constitue une dynamique positive.
En matière d'aviation civile, l'ONERA a traversé une crise structurelle au début des années 2010, mais a su engager une transformation profonde à partir de 2015 pour se repositionner sur ces enjeux. Les efforts qu'il consacre aux recherches relatives à la réduction de l'empreinte environnementale du trafic aérien représentent 5 % du montant des travaux effectués sur SCSP en 2019 et apparaissent trop faibles par rapport aux enjeux économiques et industriels en cause. L'ONERA, qui maîtrise certaines technologies comme la propulsion à l'hydrogène au coeur de la stratégie de soutien au secteur aéronautique présentée par le gouvernement, doit occuper une place croissante dans ce domaine dans les années à venir. Je ne puis que déplorer que l'ONERA ait été absent de la troisième vague du programme des investissements d'avenir (PIA 3). Il conviendra donc qu'une partie des financements destinés au volet recherche et développement du plan de soutien à l'aéronautique présenté en juin par le gouvernement, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, soient effectivement orientés vers l'ONERA.

Merci pour cette communication qui nous apporte un éclairage utile sur un domaine à la fois technique et stratégique.
La commission autorise la publication de la communication de M. Dominique de Legge, rapporteur spécial, sous la forme d'un rapport d'information.
La commission soumet au Sénat la nomination de MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Roger Karoutchi, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac et Didier Rambaud comme membres titulaires ; et de MM. Jérôme Bascher, Sébastien Meurant, Jean-François Rapin, Vincent Delahaye, Rémi Féraud, Jean-Claude Requier et Éric Bocquet comme membres suppléants de l'éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019.
La réunion est close à 12 heures.