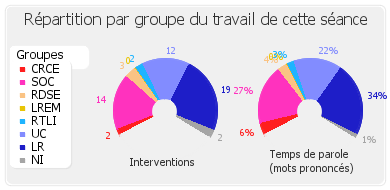Séance en hémicycle du 24 octobre 2017 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à une commission et à une délégation sénatoriale
- Questions orales (voir le dossier)
- Délivrance des cartes nationales d'identité dans les communes nouvelles et les zones de montagne (voir le dossier)
- Logement des pasteurs et des rabbins et travaux sur les lieux de culte en alsace-moselle (voir le dossier)
- Difficulté d'harmonisation de la compétence scolaire dans le cadre de la fusion d'epci (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 18 octobre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes et qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la question n° 059, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les arboriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence ont subi, en avril dernier, deux épisodes de gelée noire particulièrement dévastateurs. La capacité de production pour la période 2017-2018 est ainsi gravement affectée.
Pour ces agriculteurs, l’enjeu est de préserver une trésorerie suffisante pour pouvoir maintenir leur activité et donner une visibilité aux employés et aux clients, mais aussi aux banques et aux structures de financement de ces exploitations agricoles.
Or les procédures d’indemnisation des agriculteurs concernés qui doivent permettre de passer ce cap très difficile ne prennent en compte qu’une petite partie des préjudices subis.
En effet, l’arrêté du 17 septembre 2010, qui pose le cadre général des conditions d’indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents, prévoit des taux d’indemnisation par type et volume de pertes qui ne correspondent pas à la réalité des dommages supportés lors de ces deux épisodes de gelée noire.
Je me permets de rappeler, monsieur le ministre, que des dispositions exceptionnelles ont déjà été mobilisées lors d’épisodes similaires pour d’autres départements. L’arrêté du 1er juin 2013 portant modification du taux d’indemnisation applicable aux pertes supérieures à 80 %, à la suite du gel des 16 et 17 mai 2012, a ainsi prévu que, pour une tranche de perte supérieure à 80 %, le taux d’indemnisation de base soit porté à 50 % au lieu de 35 %.
Compte tenu de la gravité de ces épisodes et de l’importance de la filière arboricole pour l’ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, je demande que, de manière similaire, ce taux d’intervention soit augmenté à hauteur de 50 % pour garantir la pérennité de l’activité.
Monsieur le ministre, ces agriculteurs, plus particulièrement ceux qui exercent en montagne, sont les premières victimes du réchauffement climatique : aux gelées noires d’avril a succédé une période de sécheresse, situation dans laquelle, mes chers collègues, ils se trouvent toujours. Ils n’ont pas de répit.
Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : entendez-vous relever le taux d’indemnisation de ces agriculteurs ; comment comptez-vous accélérer les procédures d’indemnisation ?
Monsieur le sénateur, durant le mois d’avril 2017, la France a connu deux épisodes de gel qui ont affecté un grand nombre de régions françaises et différents types de production, dont les arbres fruitiers. Comme vous l’avez rappelé, c’est notamment le cas dans votre département.
Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour établir, en lien avec les professionnels, un état des lieux précis des dommages et pour mettre en place les mesures d’accompagnement nécessaires.
Afin d’accompagner les exploitants qui connaissent des difficultés économiques en cette période, plusieurs dispositifs peuvent d’ores et déjà être utilisés : le recours à l’activité partielle pour leurs salariés ; un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par le gel ; un report du paiement des cotisations sociales auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
Pour la filière arboricole, les pertes de récolte et de fonds sont éligibles au régime des calamités agricoles.
Le travail de reconnaissance au titre des calamités agricoles est en cours au niveau départemental et la majorité des dossiers devrait être examinée au prochain comité national de gestion des risques en agriculture, le CNGRA.
En ce qui concerne le taux d’indemnisation en arboriculture, l’arrêté du 17 septembre 2010 prévoit déjà un taux évolutif, compris entre 20 % et 35 %. À ce stade, le Gouvernement n’envisage pas de majorer ce taux.
Pour autant, monsieur le sénateur, face à la multiplication des intempéries, il est possible de développer d’autres solutions, à propos desquelles nous pouvons discuter.
Il est indispensable que les exploitants agricoles, notamment les arboriculteurs, puissent assurer plus largement leurs productions, à travers le dispositif d’assurance récolte contre les risques climatiques. L’État accompagne ces dispositifs assurantiels par une prise en charge partielle des primes ou cotisations d’assurance payées par les exploitants agricoles qui peut aller jusqu’à 65 %.
Mais nous savons bien que le coût de l’assurance n’est pas le seul frein. Il est important de mieux communiquer sur l’outil et d’expliquer les possibilités ouvertes pour adapter les contrats à chaque situation individuelle, par exemple pour abaisser la franchise. Des travaux ont été engagés avec les organisations professionnelles agricoles, en particulier les professions viticoles et arboricoles, ainsi qu’avec les assureurs, pour mieux communiquer sur le dispositif et étudier des pistes d’amélioration.
Telle est la réponse que je peux apporter, monsieur le sénateur, à votre question sur la situation des arboriculteurs.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. L’essentiel de ma question portait sur la possibilité de majoration de l’indemnisation en cas de perte supérieure à 80 %. Vous me dites que cette majoration ne sera pas mise en place. C’est bien dommage et je vous demande de bien y réfléchir, car une gelée noire est un phénomène exceptionnel pour nos agriculteurs, en particulier en termes d’impact sur leurs revenus.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, auteur de la question n° 060, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur l’homologation de deux agents actifs : le fongicide polyvalent dénommé « bouillie sulfocalcique » et l’insecticide biologique appelé « Neemazal ».
En effet, ces produits, qui sont indispensables au traitement des vergers labellisés biologiques, sont homologués par l’Union européenne conformément au cahier des charges qui limite notamment l’emploi des intrants. C’est ainsi que la bouillie sulfocalcique et le Neemazal sont largement utilisés par les arboriculteurs allemands, suisses ou italiens et que nous consommons en France, sous le label bio, des pommes issues de ces vergers.
Or, en France, ces agents de base font l’objet d’une dérogation annuelle délivrée par votre administration, sous couvert de la direction générale de l’alimentation.
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, cette dérogation, limitée dans le temps et renouvelable sous certaines conditions, s’appuie entre autres sur le principe de précaution en raison de données toxicologiques.
Il n’existe pas de produit de substitution pour lutter efficacement contre les pucerons des arbres fruitiers, si bien que, sans ces produits de base, la pérennité de l’arboriculture bio n’est pas assurée en France.
Dans ce contexte, alors que les principes actifs sont connus et que toutes les garanties sont prises, je vous sollicite, monsieur le ministre, pour que de nouvelles dispositions soient mises en œuvre pour aligner la réglementation française sur celle des autres États membres de l’Union européenne. Je souhaite ainsi que la bouillie sulfocalcique et le Neemazal soient enfin homologués de manière permanente au titre des produits conformes à l’agriculture biologique.
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur l’homologation de plusieurs préparations fongicides, utilisables notamment en agriculture biologique.
Le Neemazal est un produit phytopharmaceutique à base d’azadirachtine, qui est une substance extraite du margousier. Il s’agit d’une substance active, approuvée en 2011 par l’Union européenne.
L’azadirachtine a des propriétés insecticides, qui présentent un intérêt en arboriculture fruitière, en particulier pour lutter contre le puceron cendré, et en culture légumière ou ornementale. Du fait de son origine naturelle, cette substance est utilisable en agriculture biologique.
Six demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de cette matière active ont été déposées à l’ANSES. Leur évaluation est en cours et s’approche de son terme. Des décisions relatives à ces demandes d’autorisation de mise sur le marché sont donc attendues en 2018.
Afin de répondre à certaines situations d’urgence phytosanitaire dans les vergers de fruits à pépins ou à noyaux et d’agrumes, situations qui ont été signalées depuis 2014, le ministère de l’agriculture a délivré des autorisations dérogatoires d’une durée de 120 jours pour le Neemazal. Les producteurs ne se sont donc pas retrouvés en situation d’absence de solution, et je veillerai à ce que les choses continuent ainsi.
Concernant la bouillie sulfocalcique, communément appelée bouillie nantaise – second point que vous abordez, madame la sénatrice –, c’est une préparation à base de soufre, efficace contre de nombreuses maladies des fruits, en particulier les maladies fongiques. Le soufre constitue une alternative intéressante au cuivre – celui-ci compose la bouillie communément appelée bordelaise –, qui présente un caractère de persistance marqué dans l’environnement. La plupart des préparations soufrées sont autorisées en agriculture biologique.
À ce jour, une seule firme a montré de l’intérêt pour distribuer en France une préparation sulfocalcique. Cependant, elle a décidé de soumettre, dans un premier temps, une demande d’autorisation de mise sur le marché en Espagne et de solliciter, ultérieurement, une autorisation en France par la voie de la reconnaissance mutuelle. Selon les dernières informations disponibles, l’examen du dossier en Espagne n’est pas encore achevé.
Aussi, aucune demande d’autorisation de mise sur le marché n’a actuellement été sollicitée en France. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible, à ce stade, d’accorder une autorisation définitive pour ces préparations.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette réponse, qui n’est que moyennement satisfaisante. Comme vous le savez, l’arboriculture est déjà durement frappée par des crises structurelles et conjoncturelles et de nombreux professionnels, dont ceux des Hautes-Alpes ou des Alpes-de-Haute-Provence, s’engagent dans une démarche qualitative, afin de convertir leurs vergers en agriculture biologique. C’est pourquoi l’État ne peut entretenir plus longtemps les conditions d’une distorsion de concurrence qui est très préjudiciable à la production française, à la filière pomme-poire en particulier.

La parole est à M. Bernard Delcros, auteur de la question n° 040, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la ministre, le nouveau dispositif de délivrance des cartes d’identité, issu de la réforme Préfectures nouvelle génération, a été généralisé au mois de mars 2017. Actuellement, seules 2 088 communes sont dotées du dispositif de recueil – le DR – et donc habilitées à délivrer les cartes d’identité.
Après plusieurs mois de mise en œuvre et d’observations faites sur le terrain, je pense que cette situation ne peut pas rester figée indéfiniment et qu’il convient d’envisager des évolutions pour tenir compte, d’une part, de la spécificité des territoires et, d’autre part, de l’évolution de l’organisation territoriale.
En ce qui concerne la spécificité des territoires, je pense que, dans les zones de montagne, où les déplacements sont parfois rendus difficiles et les temps de trajet plus longs en raison du relief, de l’altitude ou de l’enneigement, l’implantation des points de délivrance des cartes d’identité mériterait d’être révisée.
Dans le département du Cantal, par exemple, 9 communes sur 247 sont actuellement équipées du DR, alors que quelques autres, non équipées, jouent un vrai rôle de bourg-centre, certes sur un territoire à faible densité démographique, mais très vaste.
Une approche objective, prenant en compte les temps de trajet et les difficultés d’accès, justifierait que ces communes soient autorisées à délivrer les cartes d’identité.
Sur la question de l’évolution de l’organisation territoriale, des communes rurales ont fait le choix, parfois difficile, de se regrouper au sein d’une commune nouvelle pour optimiser leurs compétences et mutualiser leurs moyens. Cette courageuse évolution territoriale modifie le contexte local et confère désormais à ces communes nouvelles une vocation d’offre de services, qui justifierait qu’elles délivrent les cartes d’identité.
Madame la ministre, dans un contexte où la ruralité a besoin de messages positifs de l’État, j’espère que vous pourrez répondre favorablement à ma demande, qui est simplement fondée sur le bon sens venu du terrain.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Monsieur Delcros, sénateur du Cantal, l’évolution des modalités d’instruction des demandes de cartes nationales d’identité dans le cadre du plan Préfectures nouvelle génération vise à sécuriser la procédure de délivrance et à renforcer la lutte contre la fraude. Ainsi, les données personnelles sensibles recueillies lors de la constitution des dossiers doivent transiter par des réseaux informatiques dédiés et sécurisés, comme pour les demandes de passeport.
Dans un rapport publié en juin 2016, l’Inspection générale de l’administration avait calculé le nombre de dispositifs de recueil supplémentaires qu’il convenait d’installer pour assurer une capacité annuelle de production satisfaisante, dans le respect de l’égalité des territoires. À la fin de l’année 2016, 278 stations supplémentaires ont ainsi été déployées avant que le ministère de l’intérieur n’annonce, en mars 2017, le déploiement de 250 nouveaux dispositifs.
Les préfets ont été informés, en juillet, de la répartition par département de ces stations biométriques qui a été décidée en considération du taux d’utilisation des stations existantes et de la fréquence des délais de rendez-vous supérieurs à 30 jours. Dans les départements répondant à ces critères, il appartient aux préfets, en concertation avec les associations départementales des maires, de répartir ces nouveaux dispositifs.
Dans le Cantal, le taux d’utilisation peu élevé des dispositifs installés ainsi que l’existence de délais de rendez-vous dans les mairies satisfaisants ont amené le ministère à reconduire le dispositif existant.
J’entends parfaitement, monsieur le sénateur, les questions que vous avez soulevées de proximité et d’accessibilité du service public, notamment en zone de montagne ou dans les communes nouvelles qui sont amenées à fournir de nouveaux services. Cela dit, à l’heure actuelle, comme je vous l’ai indiqué, le système a été reconduit dans le Cantal.
Toutefois, les mairies qui le souhaitent peuvent permettre aux usagers, à l’aide d’un simple ordinateur équipé d’un scanner et relié à internet, d’effectuer, dans leurs locaux, une prédemande en ligne, ce qui ne retire pas, toutefois, la nécessité d’une prise des empreintes digitales.
En outre, un dispositif de recueil mobile a été mis à la disposition des mairies dans chaque département, afin notamment de recueillir, de manière itinérante, les demandes d’usagers ayant des difficultés à se déplacer, singulièrement les personnes âgées ou hospitalisées. Dans le cadre d’une convention passée avec le préfet, ce dispositif de recueil mobile peut être mobilisé au profit des communes non équipées, ce qui peut naturellement concerner les communes nouvelles.
L’ensemble de ces mesures traduit les efforts du Gouvernement pour faire face aux questions liées au souci de proximité, mais j’ai bien conscience, monsieur le sénateur, de ne pas répondre complètement à votre désir de voir certaines communes équipées. Je pense tout de même que le plan Préfectures nouvelle génération répond à ce souci de proximité.

Ce point précis de la délivrance des cartes d’identité touche un sujet de fond plus général, celui des critères de décision en matière de politique publique. On constate malheureusement, depuis de nombreuses années, que ces critères, en l’espèce le taux d’utilisation ou le délai de rendez-vous, sont purement urbains. Ils ne tiennent pas compte des situations en zone rurale. Certes, dans ces zones, il n’est pas besoin d’attendre trois semaines afin d’obtenir un rendez-vous pour demander une carte d’identité, mais sur des territoires à faible démographie, les vastes espaces entraînent des temps de transport très longs et des difficultés d’accès.
Je suis de ceux qui pensent que la seule politique efficace et juste d’aménagement du territoire est celle qui prend en compte la diversité et apporte des réponses différenciées. L’équité territoriale ne consiste pas à apporter la même réponse à tous, mais plutôt à prévoir des adaptations à la réalité du terrain. Toutes les décisions que nous prenons doivent croiser plusieurs critères, fondés à la fois sur la démographie et l’aménagement du territoire. C’est ainsi que nous réussirons à réduire la fracture territoriale et à adresser des messages positifs à la ruralité.

La parole est à Mme Christine Herzog, auteur de la question n° 073, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame le ministre, pour le culte catholique, dans les trois départements d’Alsace-Moselle, les frais de logement du prêtre desservant et de réparation du presbytère sont répartis entre les conseils de fabrique dont le desservant a la charge et donc, indirectement, entre les communes concernées. Dans la même logique, quelles sont les règles applicables pour les frais de logement, de fonctionnement et de réparation du logement d’un rabbin ou d’un pasteur protestant ? Le cas échéant, je souhaite savoir quels sont les critères administratifs précis de délimitation du ressort territorial à prendre en compte pour définir les communes concernées par la répartition.
Par ailleurs, des interrogations du même type se posent au sujet de la répartition des dépenses de grosse réparation des temples protestants et des synagogues. Cette problématique a été évoquée en détail dans la question écrite n° 440 du 13 juillet 2017, posée par mon collègue Jean Louis Masson. Malheureusement, cette question n’a toujours pas obtenu de réponse de votre part.
Or il y a un vide juridique, car les fabriques catholiques n’ont pas d’équivalent pour les cultes protestant et israélite. Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un temple ou une synagogue, je souhaite savoir si seule la commune d’implantation doit assurer le financement ou si celui-ci incombe à l’ensemble des communes concernées. Le cas échéant, je souhaite connaître le critère administratif précis qui délimite les communes concernées.

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la sénatrice, s’agissant des frais de logement des ministres du culte d’Alsace-Moselle, il convient tout d’abord de rappeler que les communes ont la charge exclusive du versement d’une indemnité de logement, en l’absence de presbytère ou de logement mis à disposition par ces communes.
Ces modalités sont précisées par l’ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, qui prévoit l’intervention du préfet de département pour déterminer le montant de l’indemnité due, ainsi que la répartition de cette charge entre les communes bénéficiant de la desserte cultuelle.
En revanche, les frais d’entretien de ces bâtiments, lorsqu’ils sont mis à disposition des ministres du culte par les communes, ainsi que des édifices du culte, en général, incombent à titre principal aux établissements publics du culte, à savoir, selon chaque culte, la fabrique d’église, le conseil presbytéral ou le consistoire israélite départemental.
Ce n’est qu’en cas d’insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription religieuse correspondante sont appelées, à titre subsidiaire, à participer à cette charge, en application de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l’article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au marc le franc », c’est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial.
Cependant, aucune disposition équivalente ne s’appliquant aux autres confessions, en particulier au culte protestant pour lequel les communes comprises dans le ressort paroissial n’ont pas été précisément désignées, il est communément admis que pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de 1810 précitée. La fixation des ressorts rabbiniques a, en revanche, fait l’objet de mesures réglementaires permettant d’identifier le cas échéant les communes appelées à participer à ces frais.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, en vous indiquant que je suis intervenue aujourd’hui, car nous n’avons pas reçu de réponse à la question écrite de juillet dernier.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteur de la question n° 045, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la ministre, ma question porte sur les difficultés d’harmonisation de la compétence scolaire dans le cadre de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI. La loi NOTRe prévoit des délais d’harmonisation qui ne sont pas homogènes : un an pour les compétences optionnelles et deux ans pour celles qui sont facultatives.
Par nature, la compétence scolaire est singulière et a un impact très important sur les charges transférées, selon le périmètre de l’intérêt communautaire retenu.
Les trois étapes du transfert – choix de la reprise, définition de l’intérêt communautaire, réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées, la CLECT – ne peuvent pas être dissociées dans le débat qui doit avoir lieu avant le 31 décembre 2017. Chaque choix est étroitement lié l’un à l’autre et est d’autant plus complexe que, dans certains cas, l’une des communautés exerce pleinement la compétence scolaire depuis de nombreuses années.
On ne peut donc délibérer sur le choix de la reprise, sans être d’accord au préalable sur l’intérêt communautaire, qui lui-même peut supposer une restitution partielle de la compétence. En outre, un accord unanime de la CLECT est requis.
J’ajoute que ces débats se tiennent dans un contexte où les élus doivent aussi mener des discussions importantes sur les reprises de compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations – GEMAPI –, des zones d’activité, ou encore de l’eau.
Madame la ministre, il me semble, dans ce contexte, que le calendrier proposé ne permet pas d’envisager réellement un débat serein et argumenté, d’autant que les ressources humaines ne sont pas toujours disponibles pour éclairer les élus et permettre un véritable travail prospectif.
Serait-il alors envisageable de mettre en place un assouplissement du dispositif, afin, notamment, de donner un délai supplémentaire aux communautés de communes concernées, qui sont confrontées à des arbitrages complexes en termes d’harmonisation de leurs compétences ?

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la sénatrice Loisier, les délais pour harmoniser la compétence scolaire à la suite de la fusion de deux communautés de communes au sein d’une nouvelle intercommunalité sont distincts selon que la compétence est facultative ou optionnelle.
Dans le cas de compétences facultatives, comme le sont les services en matière scolaire, une nouvelle communauté de communes dispose d’un délai de deux ans pour conserver ou restituer la compétence.
En revanche, pour les compétences optionnelles – dans le domaine scolaire, il s’agit des bâtiments –, ce délai est seulement d’un an. Si elle décide de conserver la compétence optionnelle, la communauté de communes doit ensuite décider de l’intérêt communautaire de la compétence dans les deux ans qui suivent la date de son arrêté de fusion.
Jusqu’à la prise de la délibération actant l’intérêt communautaire, et dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la fusion, un exercice territorialisé temporaire de la compétence « bâtiments scolaires » peut être admis. Au-delà de ce délai, la définition de l’intérêt communautaire permet à la nouvelle communauté de communes de déterminer les composantes de cette compétence qui seront exercées à son niveau.
En outre, jusqu’à la définition de cet intérêt communautaire, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, l’intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des anciens établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, ayant fusionné est maintenu.
Si la nouvelle communauté de communes restitue la compétence en matière de bâtiments scolaires à ses communes membres, mais que tout ou partie de celles-ci ne souhaitent pas l’exercer en propre, les communes peuvent la confier à un service commun créé par voie de convention avec l’EPCI dont elles sont membres.
Dans ce cas, il est évidemment souhaitable que la restitution de compétence et la création du service commun soient menées dans les plus brefs délais. À cet effet, il est conseillé au conseil communautaire de prendre une décision de restitution de compétence avec une date d’entrée en vigueur différée.
Cette formule, qui s’applique également en cas de restitution de la compétence en matière de service des écoles, paraît répondre à la préoccupation que vous avez exprimée, madame la sénatrice. En effet, elle permet de conserver la compétence scolaire dans son ensemble à l’échelle du périmètre antérieur, sans avoir recours à la création d’un syndicat.
D’ailleurs, rien n’interdit que les communes décident ultérieurement de transférer de nouveau la compétence à la nouvelle communauté de communes.

Madame la ministre, je vais réfléchir à cet enchevêtrement de calendriers ! Reconnaissez tout de même que les délais sont courts pour mener toutes ces réflexions, notamment quand on doit prendre en compte aussi le calendrier scolaire pour éviter de déménager des enfants et des équipes pédagogiques en cours d’année.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, auteur de la question n° 029, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les dysfonctionnements dans le système d’admission post-bac, dit APB.
Ce portail centralisait jusqu’à présent l’ensemble des démarches d’inscription dans l’enseignement supérieur. Depuis la mise en place du système d’orientation des bacheliers vers différentes formations proposées au niveau supérieur, la complexité et l’opacité du système sont régulièrement critiquées.
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur a présenté au mois de juin dernier un rapport dans lequel il souligne la nécessité d’améliorer l’information des familles sur la procédure et rappelle que « l’algorithme utilisé doit être transparent pour tous ».
En juillet dernier, après les résultats du bac, plus de 86 000 candidats n’avaient pas de place dans l’enseignement supérieur, et plusieurs milliers d’entre eux étaient encore dans cette situation à la fin du mois de septembre. Nombre d’entre eux ont le sentiment de jouer leur avenir à la loterie.
Le Gouvernement a déjà annoncé la fin du tirage au sort pour l’an prochain. La procédure d’admission changera de nom et continuera à utiliser un algorithme. Enfin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, demande au Gouvernement que les décisions ne soient pas prises seulement sur la base d’un traitement algorithmique ; elle lui demande aussi de faire preuve de plus de transparence.
Je souhaite donc savoir, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour rendre la procédure d’admission post-bac transparente et conforme à la loi Informatique et libertés, qui dispose : « Aucune […] décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ».

La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Madame la sénatrice Deseyne, dans une décision rendue publique le 25 septembre dernier, la CNIL a fermement critiqué, devant les difficultés rencontrées pendant la campagne 2017 d’APB, l’absence d’un traitement personnalisé et humain des étudiants, ainsi que le manque d’information des lycéens sur le respect des droits qui leur sont reconnus par la loi Informatique et libertés de 1978.
La CNIL confirme donc le constat fait par le Gouvernement dès le mois de juillet dernier : le système APB, tel qu’il est conçu actuellement, est un immense gâchis et ne peut plus répondre de manière satisfaisante à l’enjeu que représente l’accès à l’enseignement supérieur pour les futurs étudiants et leur famille.
Plus récemment, dans son rapport du 19 octobre dernier, la Cour des comptes a appuyé notre position en rappelant l’opacité du fonctionnement algorithmique d’APB et l’absence de fondement juridique à la procédure du tirage au sort.
Le consensus est donc total : il n’y aura plus de tirage au sort, et le Gouvernement veillera à garantir la transparence du nouveau système d’accès à l’enseignement supérieur en y réintroduisant une part d’humain.
Plus largement, la problématique du premier cycle ne saurait se limiter à la question d’APB. Je rappelle que deux tiers des étudiants échouent à obtenir leur licence en trois ans. Nous devons à nos étudiants d’édifier un premier cycle qui leur permette de construire leur réussite plutôt que d’intérioriser dès le plus jeune âge l’échec comme horizon indépassable de leurs efforts.
À cette fin, j’ai lancé le 17 juillet dernier une concertation sociale avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur, afin de déterminer le contenu d’une réforme systémique du premier cycle. Tous les acteurs ont été entendus : établissements et représentants des étudiants, des élèves et de leurs parents.
Nous prendrons prochainement une initiative législative globale sur le fondement du rapport final du recteur Daniel Filâtre qui m’a été remis le 19 octobre dernier, à l’issue de la concertation et des consultations que je conduis actuellement auprès des différents représentants de la communauté de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante.
Cette réforme, qui sera globale, permettra d’améliorer la réussite des étudiants. Je puis d’ores et déjà vous annoncer que nous garantirons la transparence du nouveau système en confiant sa gestion à un service à compétence nationale adossé à un comité d’éthique constitué de scientifiques et de juristes. En outre, les mentions légales permettant d’informer les étudiants de leurs droits seront bien entendu mises en évidence sur le nouveau portail.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse. Nous avons un certain nombre de convergences.
Vous avez engagé une réflexion, mais je pense qu’il est maintenant temps de changer de système. Je souhaite vivement la mise en place d’une orientation bien en amont, qui tienne compte des aptitudes et des souhaits des futurs étudiants, mais aussi et surtout l’instauration de prérequis obligatoires à l’entrée de chaque filière. Ces prérequis rendront l’entrée à l’université plus juste et plus transparente et éviteront à nos étudiants nombre des déceptions et des échecs qu’ils subissent, comme vous l’avez dit, dès la première année.

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, auteur de la question n° 068, adressée à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les biens « sans maître » auxquels sont confrontées nombre d’équipes municipales.
L’impossibilité de retrouver les héritiers ou le refus des légataires d’accepter certaines successions immobilières au regard du mauvais état des bâtiments font que de plus en plus de communes sont affectées par des biens non entretenus, souvent au cœur même de leur centre-bourg. Ces biens se détériorant inexorablement jusqu’à devenir dangereux pour la population, les maires sont conduits à prendre des arrêtés de péril avant de devoir les faire démolir aux frais de leur commune.
En effet, les domaines, qui, in fine, deviennent propriétaires de ces biens « sans maître », répondent, lorsqu’ils sont sollicités par les élus, qu’ils ne disposent pas de ligne budgétaire à affecter à ces démolitions ! Ainsi les communes se retrouvent-elles seules à assumer indûment des travaux qui viennent grever des finances locales déjà fortement pénalisées par les baisses de dotation.
À titre d’exemple, je citerai une commune de mon département, la Haute-Vienne – un département que vous connaissez bien, monsieur le ministre, et où nous sommes toujours heureux de vous accueillir –, qui doit faire face à une telle situation : Magnac-Laval, qui, avec 2 000 habitants et un budget communal de l’ordre de 2 millions d’euros, va devoir financer dans les semaines qui viennent la démolition d’un bâtiment en centre-bourg pour un coût de 100 000 euros au minimum, d’autres cas similaires se profilant à brève échéance.
Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si, et comment, l’État peut accompagner les élus qui ont à faire face, en Haute-Vienne et ailleurs, à de telles situations ?
Madame la sénatrice Perol-Dumont, je connais cette problématique pour y avoir été directement confronté dans mes fonctions d’élu local. Il s’agit d’une problématique récurrente, pour laquelle il existe deux procédures.
La première est la procédure de bien en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales : après une procédure de constat d’un bien non entretenu et un échange avec le propriétaire, elle aboutit à une expropriation simplifiée pour cause d’utilité publique avec versement d’une indemnité. Certaines collectivités s’en sont d’ailleurs fait une spécialité, comme Joinville, en Haute-Marne.
La seconde est la procédure de bien « sans maître », qui permet une incorporation sans indemnité dans le domaine privé ou public de la commune. Elle est déclenchée pour l’un des deux motifs suivants : soit le propriétaire est connu mais disparu ou décédé depuis plus de trente ans sans qu’aucun héritier se soit présenté, soit le propriétaire est inconnu et les taxes foncières sur l’immeuble ne sont pas acquittées ou le sont par des tiers depuis plus de trois ans.
Ces deux procédures sont peu utilisées, ce qui pose la question de leur opérationnalité. Dans le cadre du plan Villes moyennes, sur lequel nous sommes en train de travailler, j’ai demandé qu’une réflexion soit engagée pour trouver les moyens de les améliorer.
Par ailleurs, je vous rappelle que, s’agissant de biens en état d’abandon manifeste ou faisant l’objet d’un arrêté de péril avec interdiction définitive d’habiter, le dispositif de résorption de l’habitat insalubre de l’Agence nationale de l’habitat peut permettre le financement de la démolition des deux maisons de Magnac-Laval dont vous avez parlé, dans le cadre d’un projet de retraitement de l’îlot. Peut-être cette piste pourrait-elle être utilement explorée. Si je me rends de nouveau en Haute-Vienne, je me tiendrai volontiers à votre disposition pour examiner cette question.

Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir rappelé les diverses situations et procédures existantes. Reste que les élus locaux, comme vous le comprendrez aisément pour l’avoir été vous-même, rechignent de plus en plus, alors qu’on leur demande constamment de maîtriser leurs dépenses, à faire face à des dépenses totalement improductives !

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, auteur de la question n° 039, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires.

Monsieur le ministre, depuis le dépôt du texte de cette question, au mois de juillet dernier, le contexte en matière de technologie satellitaire a bien évolué ; vous comprendrez donc que j’actualise ma question.
En effet, à la suite de votre communiqué de presse du 27 septembre dernier, dans lequel vous avez fixé les orientations de la stratégie d’aménagement numérique des territoires, vous vous engagez à mobiliser l’ensemble des technologies disponibles, dont les solutions satellitaires nouvelles déployées, pour garantir à l’ensemble des foyers dès 2020 un accès au bon débit, c’est-à-dire entre 8 et 30 mégabits par seconde.
Ce mixtechnologique est une bonne nouvelle. Comme nous le savons, des progrès industriels considérables ont pu être accomplis dans le domaine des télécommunications par satellite ces dernières années. En la matière, la France dispose de grands champions ; je pense notamment à Eutelsat, qui lance un nouveau satellite avec son partenaire ViaSat. Les discussions sont encore en cours, afin d’être opérationnel à bien plus large échelle.
Toutefois, la technologie satellitaire disponible à l’heure actuelle se heurte à un problème de saturation prégnant. Or les collectivités territoriales engagées dans l’aménagement numérique de leur territoire ont besoin de visibilité sur la part des foyers que cette technologie pourrait effectivement permettre d’atteindre, au côté des technologies autres que la fibre.
Aussi, monsieur le ministre, compte tenu à la fois des échéances de votre feuille de route pour un bon débit en 2020 et des contraintes technologiques afférentes au satellite, pouvez-vous nous indiquer précisément dans quelle mesure le Gouvernement souhaite recourir à cette technologie, mais aussi comment les mesures de politiques publiques pourront faciliter la pénétration de cette solution en zone rurale au bénéfice des citoyens et des entreprises ?
Monsieur le sénateur de Nicolaÿ, votre question initiale était tout à fait pertinente. Vous avez bien voulu dire qu’une réponse importante lui avait déjà été apportée, puisque nous avons indiqué de façon très claire qu’il était opportun de recourir à la technologie satellitaire dans le cadre du mixtechnologique envisagé pour apporter le bon débit à tous les habitants sur tout le territoire en 2020, la question du très haut débit devant, quant à elle, être résolue en 2022. Sur le fond, donc, nous sommes parfaitement d’accord.
Nous avons demandé aux services de l’Agence du numérique de procéder à une analyse fine, département par département, des bâtiments qui ne disposeront pas d’un accès au haut débit en 2020. Ce travail, réalisé en coordination avec les collectivités territoriales porteuses de projets de réseaux d’initiative publique, sera généralisé d’ici à la fin de l’année à l’ensemble des territoires.
Nous nous inscrivons dans une approche pragmatique pour ce qui est du mix technologique, afin d’essayer de proposer à chaque foyer une solution de connectivité efficace dès 2020. Comme je l’ai indiqué très clairement aux opérateurs, la solution satellitaire aura toute sa place pour garantir une couverture des bâtiments les plus isolés, au même titre que la THD radio ou la 4G fixe des opérateurs mobiles.
En ce qui concerne le satellite, une fois terminé le travail d’identification en cours, nous pourrons déterminer le volume de bâtiments, qu’ils soient d’habitation ou d’entreprise, qui pourront bénéficier d’une connexion satellitaire en 2020. À ce stade, le potentiel est estimé entre 500 000 et 800 000 foyers ; une fois le travail achevé, je pourrai répondre de manière beaucoup plus précise à votre question.
Les modalités de soutien à ces technologies déjà prévues dans le cadre du plan France très haut débit seront revues et améliorées pour permettre la bonne utilisation de cette technique, pour laquelle des progrès majeurs sont réalisés par les industriels de notre pays.
Nous sommes donc tout à fait d’accord, monsieur le sénateur, pour encourager le développement de ces solutions !

La parole est à M. Cédric Perrin, auteur de la question n° 071, adressée à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Rabotage des aides personnalisées au logement, APL, baisse des loyers, exclusion des territoires ruraux du prêt à taux zéro et des bénéfices de la loi Pinel, et j’en passe… Monsieur le ministre, toutes ces mesures inscrites dans le projet de loi de finances pour 2018 mettent à mal les territoires ruraux !
Ce sont tout d’abord les mesures fiscales qui vont les déstabiliser. Ainsi de la loi Pinel, pour ne prendre que cet exemple – le recentrage du prêt à taux zéro répond à la même philosophie.
En quoi l’exclusion de la loi Pinel des zones B2 et C constitue-t-elle un nouveau coup dur pour ces zones moins tendues ? Tout simplement parce que, une nouvelle fois, on concentre l’avantage fiscal, et donc les investissements immobiliers locatifs, dans les territoires déjà urbanisés. Vous réservez les avantages fiscaux aux grandes villes et vous laissez mourir les milliers de zones qui ne sont pas des métropoles !
En effet, vous n’incitez pas les investisseurs à implanter leurs projets dans ces territoires plus reculés et plus fragiles économiquement. Ce sont pourtant ces zones qu’il faut soutenir pour favoriser leur développement ! En les excluant des avantages fiscaux, on les fait perdre en attractivité et on les fragilise encore davantage.
Quant à la réduction des aides personnalisées au logement et aux mesures en matière de logement social, elles reviennent à baisser le budget d’investissement des bailleurs sociaux de 20 à 5 ou 6 millions d’euros pour le Territoire de Belfort.
Quelles en seront les conséquences ? Les opérations neuves et de réhabilitation non lancées ne verront pas le jour et les actions sur le patrimoine, notamment en faveur de la qualité énergétique, seront dégradées. Il faudra alors expliquer aux locataires que, en contrepartie de la mesure populaire de baisse des APL, c’est la dégradation programmée de l’ensemble du parc social que vous allez mettre en marche ! Bref, c’est le retour vers le logement bas de gamme dans les secteurs détendus tels que le mien…
Je note enfin la brutalité de vos annonces, qui mettent à mal tout un écosystème, du bailleur social aux entreprises du BTP en passant par les architectes, les bureaux d’études, les promoteurs, les lotisseurs et les constructeurs.
Monsieur le ministre, il y a sans doute des offices riches, mais tous les bailleurs sociaux de notre pays ne le sont pas, vous le savez bien…
Aussi, face à ce que je qualifierai de désertification rurale organisée, pouvez-vous m’indiquer le montant des économies réalisées par le biais de ces mesures, mais aussi, et surtout, celui des pertes qui résulteront de l’abandon de ces dispositifs ? Le bilan ne risque pas d’être à l’avantage de nos finances publiques…
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que vous nous aviez habitués, sur ces travées, à un pragmatisme et un bon sens à toute épreuve ; j’ai l’impression, et avec moi un certain nombre d’élus des territoires non métropolitains, que ce bon sens a été abandonné par le Gouvernement dans le domaine du logement !
Monsieur le sénateur Perrin, le bon sens consiste d’abord à ne pas entrer dans la polémique, surtout lorsqu’elle est injustifiée. Par ailleurs, je n’ai pas tellement de leçons à recevoir en matière de désertification rurale, surtout compte tenu de ce qui s’est passé lors des deux précédents quinquennats, quels qu’aient été les gouvernements.
Ensuite, il faut être précis. S’agissant du dispositif Pinel, qui était l’objet de votre question, la loi de finances pour 2017 prévoyait son ouverture à certaines communes de la zone C, sous réserve d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat. Or le décret prévu à l’article 68 de cette loi, celui dont vous déplorez l’absence, a été publié au Journal officiel du 5 mai 2017…
Au demeurant, d’après le dernier bilan établi, moins de vingt communes ont bénéficié de ce dispositif. Telle est la réalité ! C’est la preuve du caractère peu incitatif du dispositif Pinel en zone C…
S’agissant du prêt à taux zéro, conformément à l’annonce du Président de la République, il sera mis en place pour toutes les communes des zones B2 et C pour les deux ans qui viennent, alors qu’il avait été prévu en 2016 que ce dispositif prendrait fin au 31 décembre 2017.
Soyons donc précis, concrets, et reconnaissons les mesures prises. Là est le bon sens !
Je ne parlerai pas de l’absence de baisse de dotation ni de la conservation au plus haut niveau des dispositifs de dotation et de subvention pour les communes. Toujours est-il que le bon sens, monsieur le sénateur, c’est d’avoir une approche équilibrée et juste de ce qui est fait. Je comprends parfaitement que vous ne soyez pas d’accord avec tout, mais, en ce qui concerne le logement, sachez que j’entretiens un dialogue constant avec l’Union sociale pour l’habitat et les bailleurs sociaux…
… et que je fais le maximum pour trouver des solutions constructives dans l’intérêt général.

Monsieur le ministre, j’entends bien votre réponse, mais vous ne pouvez pas affirmer que vous menez une politique juste quand vous privilégiez très clairement les métropoles au détriment des zones moins urbaines, comme le Territoire de Belfort, que je représente. Dans une commune comme Belfort, qui compte plus de 42 % de logements sociaux, les conséquences des décisions prises aujourd’hui seront absolument catastrophiques !
Imaginez la restructuration d’un site hospitalier en 380 logements. Ce ne sont pas les retraités d’Alstom qui pourront faire en sorte qu’un tel programme immobilier aboutisse : il s’agira évidemment de vente en l’état futur d’achèvement, avec possibilité de bénéficier du dispositif Pinel en zone B2.
Remarquez, monsieur le ministre, que je n’ai jamais évoqué la problématique du dispositif Pinel en zone C ; je parle de la zone B2. Si je vous ai interrogé, c’est parce qu’il a été annoncé que seules les communes situées en zone B1 pourraient bénéficier de la loi Pinel, ce qui serait tout à fait désastreux, puisque l’intégralité de l’investissement immobilier serait attirée dans les zones métropolitaines.
Dans des territoires difficiles comme le mien – le ministre de l’économie viendra à Belfort après-demain pour le comité de suivi du plan Alstom –, le bon sens, monsieur le ministre, est de ne pas en rajouter une couche supplémentaire.
Nous sommes dans l’obligation de réhabiliter des friches industrielles ou laissées vacantes par le départ de certaines administrations. Le dispositif Pinel est fondamental pour nous permettre de le faire et de construire de nouveaux logements !

La parole est à Mme Josiane Costes, auteur de la question n° 050, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, ma question concerne des problématiques de politique éducative en milieu rural.
Dans les départements qui connaissent une déprise démographique, les établissements du second degré perdent chaque année des élèves, et leurs internats se vident.
Ainsi, dans les collèges du Cantal, il y avait, à la rentrée 2016, 128 internes ; il n’y en avait plus que 101 à la rentrée 2017, pour environ 600 places disponibles, dont près de 300 rénovées récemment.
La possibilité de mettre en place des « internats liberté » a été évoquée. Comment cette mise en place est-elle envisagée ? Ces internats seront-ils proches des internats de la réussite pour tous, c’est-à-dire des internats que les jeunes choisissent pour les activités spécifiques qui y sont proposées ? Quel appui les collectivités territoriales peuvent-elles apporter à cette mise en place ? Les départements qui font face à des baisses d’effectifs préoccupantes dans leurs établissements du second degré pourraient-ils être prioritaires pour cette expérimentation ?
La seconde partie de ma question concerne les regroupements pédagogiques intercommunaux, ou réseaux d’écoles de territoire.
Lorsque la densité des effectifs est trop faible, les élèves, parfois de très jeunes enfants, sont confrontés à des temps de parcours très longs, particulièrement en zone de montagne. Est-il envisageable que ces territoires puissent bénéficier de mesures dérogatoires afin d’éviter des fermetures d’écoles qui imposeraient des temps de trajet excessifs ?
Madame la sénatrice Costes, je vous prie d’excuser l’absence du ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui m’a chargé de répondre à votre question.
Lors de l’ouverture de la Conférence nationale des territoires, le 17 juillet dernier, au Sénat, le Président de la République a clairement marqué l’attachement du Gouvernement au service public de l’éducation dans les territoires ruraux. Dans cet esprit, des instructions précises ont été données pour ne pas fermer d’écoles.
Le ministre de l’éducation nationale a également indiqué clairement qu’il souhaitait la poursuite de la démarche de contractualisation entre l’État et les acteurs locaux à travers les conventions ruralité, pour que la totalité des territoires éligibles soient couverts d’ici à la fin de 2018. Vous ne l’ignorez pas, puisque le département que vous représentez est concerné.
L’objet de ces conventions est non pas de transposer le modèle d’une école urbaine en milieu rural, mais de proposer des solutions adaptées aux enjeux démographiques et géographiques de chaque territoire, à partir d’un diagnostic partagé.
En ce qui concerne le collège et le lycée, le ministre de l’éducation nationale souhaite relancer le plan Internat en milieu rural, ce qui correspond à votre question. Actuellement, 200 000 lits sont disponibles en France, mais 20 % sont inoccupés, notamment en milieu rural. Revitaliser les internats ruraux à partir de projets d’excellence au sein des collèges et lycées rendus attractifs est de nature à donner une image positive de ces établissements, qui pourront devenir des lieux de réussite pour les élèves.
Par ailleurs, le ministre de l’éducation nationale souhaite lancer une réflexion sur le rapprochement de l’école et du collège dans la ruralité, sur le plan tant du bâti que pédagogique.
Ces deux ambitions pourraient s’articuler, lorsque les collectivités territoriales et les communautés éducatives sont volontaires, avec la signature de conventions ruralité ou d’avenants à celles-ci.
Je sais, madame Costes, que M. Bruno Faure, le président du conseil départemental de votre département, a proposé par écrit, au ministre de l’éducation nationale, que ce territoire figure parmi les premiers départements à se lancer dans cette opération d’internats d’excellence en milieu rural. Je sais aussi que le ministre a répondu positivement à cette proposition et que nous allons pouvoir nous engager dans la réalisation du projet. J’y prêterai une attention toute particulière.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces paroles encourageantes et rassurantes.

La parole est à M. Philippe Mouiller, auteur de la question n° 038, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Madame la secrétaire d’État, selon les chiffres établis par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, environ 8 000 enfants naissent chaque année avec un trouble du spectre autistique.
Pour ces 8 000 enfants repérés, l’établissement d’un diagnostic précoce et adapté a permis de connaître le handicap suffisamment tôt pour apporter une réponse avant que ses effets ne deviennent irréversibles. Mais nous ignorons tout des autres enfants nés porteurs du handicap, sans que ce dernier ait pu être dépisté. Beaucoup de familles, en effet, peinent à accéder au dépistage.
Les structures chargées du dépistage précoce de l’autisme, les centres de ressources autisme, ou CRA, ont fait l’objet de virulentes critiques dans un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS.
Insuffisamment déployés sur le territoire national, parfois composés de personnes insuffisamment formées, surchargés au point de rendre leurs conclusions après des délais d’attente de près d’un an et demi, ces centres peinent à remplir leur mission.
Le troisième plan Autisme avait fait de la réorganisation du réseau des CRA et de l’homogénéisation de leurs pratiques une priorité. Un décret du 5 mai 2017 a posé quelques « conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement » de ces centres.
Mais est-ce bien suffisant ? Peut-on se contenter d’un seul CRA par région ? Peut-on se satisfaire qu’un CRA doive parfois s’associer à un centre hospitalier spécialisé, autrement dit un hôpital psychiatrique, pour exister ? Comment peut-on tolérer que les recommandations de bonne pratique dont les CRA doivent se faire le relais ne soient nulle part mentionnées ?
Les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique se trouvent davantage exposées aux ruptures de parcours, aux carences de l’offre médico-sociale, à l’inadaptation des solutions actuellement proposées.
Comme vous le savez, l’autisme est un handicap évolutif dont les impacts peuvent être limités lorsqu’un diagnostic suffisamment précoce est posé et communiqué aux familles. Je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer, madame la secrétaire d’État, les mesures que le Gouvernement compte prendre pour favoriser la diffusion de ces diagnostics.

La parole est à Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Votre question, monsieur le sénateur, me donne l’occasion de revenir sur l’une des priorités du quinquennat : le handicap et, plus particulièrement, l’autisme.
Les centres de ressources autisme ont été généralisés depuis plus de dix ans. Ils sont effectivement des acteurs majeurs dans le dispositif de prise en charge et d’accompagnement des personnes avec autisme.
Vous indiquez que le récent décret régissant leur fonctionnement a été établi en 2017, sans concertation avec les usagers. Je veux vous rassurer : la publication tardive de ce décret, qui est travaillé depuis 2014, tient précisément à la durée des concertations et à la difficulté à trouver un point d’accord entre les nombreuses parties prenantes, comme trop souvent dans ce domaine, traversé par des débats et des conflits « plus délétères que féconds », selon l’expression du rapport d’évaluation du troisième plan Autisme.
En l’espèce, il aura donc fallu trois ans pour confirmer, dans le décret de 2017, la place et le rôle central des CRA dans la chaîne repérage, diagnostic et intervention. Non pas toute la place, mais une juste place en tant que centre expert, pour les diagnostics les plus complexes, et centre ressources, pour la formation des équipes de proximité.
C’est une place essentielle pour garantir la fluidité d’un triptyque indispensable à la qualité des prises en charge, conformément aux bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé, la HAS, et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’ANESM, et pour favoriser l’accès précoce à des interventions adaptées afin d’éviter, comme vous l’avez signalé, l’installation d’incapacités et rendre enfin possible une trajectoire d’inclusion.
Malheureusement, les textes sont aussi longs à être publiés que les pratiques à évoluer !
Je veux le dire clairement, la concentration des diagnostics sur les centres régionaux de ressources autisme est un vrai problème. Elle témoigne de l’insuffisance de la structuration des parcours et, surtout, de celle des outils donnés aux professionnels de santé et aux familles pour assurer une orientation adéquate.
Notre ambition est bien que le nouveau plan, dont la remise est annoncée au début de 2018, permette de remédier au problème.
Je serai, pour ma part, particulièrement attentive à toutes les propositions qui seront faites pour accroître la formation initiale et continue des professionnels de santé. Je sais compter sur l’engagement en ce sens de la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, qui est pleinement mobilisée sur le sujet, dans le cadre d’une feuille de route totalement croisée.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de ces propos, qui, en tout cas de par les intentions évoquées et, surtout, de par les problématiques prises en compte, sont rassurants.
Nous attendrons avec impatience les propositions visant à faire évoluer favorablement le fonctionnement de ces centres. Les membres de la commission des affaires sociales du Sénat seront également très ouverts à une participation aux réflexions sur l’évolution du plan Autisme. Il y a là une invitation à venir nous rencontrer !

La parole est à Mme Brigitte Micouleau, auteur de la question n° 042, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, la protonthérapie est une technique de radiothérapie utilisant des faisceaux de protons.
Elle est aujourd’hui reconnue comme la méthode permettant de cibler le mieux une tumeur, tout en épargnant les tissus sains voisins.
Moins toxique que la radiothérapie classique, elle permet notamment de s’attaquer à des cancers développés par l’enfant, tels que des tumeurs neurologiques ou de la colonne vertébrale. Chez l’adulte, ses bénéfices sont indiscutables dans le traitement des cancers de la prostate et des sinus.
Le troisième plan Cancer, qui court sur la période 2014-2019, a prévu la création de nouvelles autorisations pour l’ouverture de centres de protonthérapie.
Il est un fait : le grand quart sud-ouest de la France et, plus largement, le quart sud-ouest de l’Europe sont dépourvus de ce type de centres.
Première métropole de France en termes de développement démographique et économique, Toulouse compte déjà plus de 760 000 habitants et jouit d’une situation géographique qui lui permettrait de répondre de la meilleure des façons aux enjeux d’égalité territoriale d’accès à ce traitement innovant, et ce, sur le plan aussi bien national que continental, du fait notamment de sa proximité avec la péninsule ibérique.
De plus, forte de l’Oncopole, pôle de recherche sur le cancer et l’innovation en santé de dimension européenne, la métropole toulousaine peut déjà compter sur une dynamique médicale et scientifique de très haut niveau.
Mobilisés depuis plus de trois ans sur ce dossier, médecins, chercheurs, ingénieurs, industriels et collectivités territoriales, solidairement rassemblés au sein du projet « protonthérapie et recherche innovante en cancérologie et systèmes », dit PERICLES 2, ont réalisé un travail extraordinaire. Ils n’attendent plus aujourd’hui qu’un signe du Gouvernement pour engager les investissements qu’ils ont provisionnés.
Aussi, madame la secrétaire d’État, pouvez-vous dès à présent nous préciser le calendrier, ainsi que les modalités pratiques de l’appel à projets de création de ces nouveaux centres de protonthérapie ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Je vous prie, madame la sénatrice, de bien vouloir excuser l’absence de la ministre des solidarités et de la santé, qui n’a pas pu être présente et m’a chargée de vous répondre.
Vous appelez son attention sur le projet PERICLES 2, projet de création d’un centre de protonthérapie, conjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à l’institut Claudius Regaud, centre de lutte contre le cancer.
L’accompagnement des évolutions technologiques et thérapeutiques, ainsi que le déploiement équitable de l’innovation en cancérologie figurent parmi les priorités de la politique menée par le Gouvernement.
J’attire votre attention sur le fait qu’aucun appel à projets pour l’implantation de centre de protonthérapie n’est prévu par le plan Cancer 2014-2019.
Dans le cadre de ce plan Cancer, l’Institut national du cancer, l’INCa, a remis au ministère de la santé son premier rapport sur le développement de la protonthérapie en juillet 2015. Il a mené des travaux complémentaires, en 2016, pour affiner les indications « projetées ».
Se pose dorénavant la question de l’évaluation médico-économique de la protonthérapie, pour laquelle la Haute Autorité de santé doit être saisie. Cette évaluation permettra d’élaborer d’éventuelles recommandations de bonnes pratiques.
Dans cette attente, les agences régionales de santé, les ARS, ont sursis à toute décision d’autorisation en la matière.
Nous ne pouvons que souligner le mérite du positionnement volontariste du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l’institut Claudius Regaud.
Dans l’attente des orientations nationales, nous invitons ce projet à s’inscrire à moyen terme dans le cadre du processus d’autorisation qui suivra l’élaboration du futur projet régional de santé, ou PRS – celui-ci sera justement révisé à l’aune de ces orientations nationales.
Le projet toulousain pourra également s’inscrire dans des orientations qui découleront du programme national de recherche en santé publique, figurant dans la stratégie nationale de santé, lequel sera mené en étroite collaboration et coordination avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Je reste néanmoins inquiète s’agissant de la création de nouveaux centres de protonthérapie. Je regrette ce qui ressemble à un renoncement, bien qu’un engagement de l’État ait pourtant été acté sur ce sujet particulier de santé publique et de lutte contre le cancer. Nous pouvions espérer une autre réponse et une réelle volonté politique.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 049, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Près d’un mois après la Journée mondiale du cœur et à quelques jours de la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux – dits AVC –, je souhaite vous interroger, madame la secrétaire d’État, sur la prise en charge de ces attaques dans notre pays.
L’AVC, il faut le savoir, fait une victime toutes les quatre minutes ! Il représente un enjeu de santé publique majeur, affectant chaque année près de 130 000 personnes et causant 62 000 décès. C’est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième chez l’homme, et encore un exemple, d’ailleurs, de l’androcentrisme de la recherche médicale, sujet sur lequel il faudra agir.
Lorsqu’il ne conduit pas au décès, l’AVC constitue la première cause de handicap physique acquis chez l’adulte. Son coût pour l’assurance maladie est par ailleurs estimé à 4, 5 milliards d’euros par an.
Je précise que ma région, la Bretagne, est malheureusement très touchée. Elle est l’une des deux régions métropolitaines – l’autre étant les Hauts-de-France – enregistrant le taux de patients hospitalisés pour un AVC ischémique et le taux de mortalité par AVC les plus élevés.
Face à ce phénomène, de nouvelles modalités de prise en charge ont été développées. Outre les traitements médicamenteux, la thrombectomie mécanique représente une avancée médicale capitale, permettant d’augmenter sensiblement les chances de survie des patients et de limiter les risques de séquelles. Encore faut-il que cette technique puisse être disponible sur tout notre territoire !
Si aujourd’hui ces traitements de pointe se développent au sein des unités neuro-vasculaires, unités spécifiquement dédiées à la prise en charge des personnes victimes ou suspectées d’AVC, de nombreuses zones géographiques, en particulier rurales, restent encore trop éloignées de ces structures, avec des temps de transport et d’acheminement bien trop longs. Or le délai de prise en charge d’un AVC est fondamental. On estime qu’une minute perdue représente en moyenne deux millions de neurones en moins !
Il est donc urgent d’assurer à nos concitoyens une réelle égalité d’accès à ces soins.
Je veux ajouter un autre facteur à prendre en compte : la reconnaissance des symptômes de l’AVC.
Ces signaux sont encore trop méconnus, alors qu’ils sont simples à reconnaître, ne serait-ce que la difficulté à sourire, la paralysie temporaire ou le fourmillement. Face à de tels symptômes, il ne faut pas hésiter et appeler le 15 !
Voilà autant d’enjeux liés à la prise en charge de l’AVC, sur lesquels, madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interpeller. Quelles sont les intentions du Gouvernement en matière de développement de la prévention, de sensibilisation à la détection des signes de l’AVC et, enfin, d’un accès aux soins rapide et suffisant sur l’ensemble de notre territoire ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
De nouveau, madame la sénatrice, je vous prie d’excuser l’absence de la ministre des solidarités et de la santé.
Les maladies cardio-neuro-vasculaires représentent la deuxième cause de mortalité en France, avec près de 180 000 décès annuels. Elles sont caractérisées par une incidence stable de 150 000 cas par an, avec un taux d’incidence multiplié par deux après 55 ans.
La mise en œuvre du plan AVC 2010-2014 a assuré non seulement une restructuration de la prise en charge de la population au sein de filières AVC, mais aussi le développement d’outils d’aide à la décision pour réduire les délais de prise en charge. Je pense notamment à la télémédecine, avec la téléconsultation, la téléexpertise et la télésurveillance des AVC.
L’innovation thérapeutique que représente la pratique de la thrombectomie mécanique par voie endovasculaire, couplée ou non à la thrombolyse, a montré une récupération quasi totale à trois mois, chez les personnes victimes d’infarctus cérébral, réduisant considérablement les risques de décès et de séquelles.
Les premiers éléments de consensus ont fait émerger l’estimation annuelle d’environ 60 000 à 80 000 AVC susceptibles d’être traités par thrombolyse, dont la moitié avec une association potentielle à une thrombectomie, pour 37 centres de neuroradiologie interventionnelle et 135 unités neuro-vasculaires, ou UNV, dont celle du centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Des évolutions organisationnelles au niveau de la prise en charge sont nécessaires, avec le soutien, notamment, de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, et de la Haute Autorité de santé, la HAS.
Elles sont proposées par le comité Thrombectomie créé à cet effet en février 2016, et qui réunit l’ensemble des acteurs impliqués, en lien avec les associations de malades France AVC et la Fédération nationale des aphasiques de France, la FNAF.
En novembre 2016, la HAS a annoncé la reconnaissance du service attendu de l’acte de thrombectomie. Cette reconnaissance a été suivie de la création dans la classification commune des actes médicaux, la CCAM, d’un acte Thrombectomie par la CNAMTS en juillet 2017.
Le déploiement de cette activité s’inscrit également dans le calendrier de la réforme du régime des autorisations d’activités de soins, et de celui du troisième cycle des études médicales.
Il repose aussi sur la télémédecine concernant les AVC, ou téléAVC, qui est l’un des éléments clés du parcours de soins. Plus de 30 projets de téléAVC sont inscrits dans les projets régionaux de santé, les PRS.
À ce jour, une montée en charge progressive de l’activité est observée, notamment par un rattrapage dans les territoires sous-dotés en UNV et le travail se poursuit, avec l’ensemble des acteurs et avec un objectif fixé d’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Je vous remercie de ces précisions, madame la secrétaire d’État.
Je voudrais ajouter qu’un dispositif expérimental de l’Union européenne – dénommé Spices – sera justement développé dans le pays évoqué tout à l’heure, le Centre-Ouest-Bretagne.
Il s’agit d’un outil de prévention des maladies cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires qui permet d’impliquer tous les acteurs de la communauté médicale, mais aussi tous les acteurs du territoire, autour de la question d’un enseignement le plus précoce possible – par exemple auprès des jeunes à l’école – des symptômes de l’AVC.
Autre remarque, il faut travailler à une recherche médicale centrée sur la femme. Alors qu’il existe une spécificité féminine très forte, les recherches portent sur l’être humain et, en général, sur l’homme. Or les femmes, du fait notamment des traitements hormonaux ou des grossesses, présentent une fragilité particulièrement grande des vaisseaux. La recherche doit le prendre en compte.

La parole est à Mme Catherine Troendlé, auteur de la question n° 052, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Je souhaite attirer votre attention, madame la secrétaire d’État, sur la problématique des déserts médicaux.
Le Gouvernement, qui a présenté le vendredi 13 octobre 2017 son plan de lutte contre les inégalités d’accès aux soins, n’envisage pas de mesures coercitives afin d’inciter fortement les médecins à s’installer dans les zones déficitaires. Il ne prévoit ni d’augmenter le numerus clausus des étudiants en médecine ni même de le supprimer.
Or les pouvoirs publics vont être confrontés aux défis liés à la couverture médicale de l’ensemble du territoire, plus particulièrement dans les zones rurales et urbaines précarisées.
Ce phénomène de désertification médicale est sans nul doute le résultat d’une conjonction de divers facteurs : un vieillissement des praticiens en activité, un recul des vocations de médecin généraliste, mais également un moindre attrait de l’exercice libéral.
Ces réalités aboutissent à des situations extrêmement difficiles à gérer, telles des fermetures définitives de cabinets médicaux ou encore de maisons de santé « coquilles vides », entravant l’accès aux soins de nombreuses populations.
Je voudrais citer pour exemple la ville de Huningue, dans le Haut-Rhin, comptant 7 000 habitants. Elle se voit privée de médecin généraliste depuis le 1er avril dernier, alors que, dès 2011, l’équipe municipale avait entrepris la création d’un pôle médical au cœur même de la commune, afin de pérenniser la présence des médecins généralistes.
La municipalité s’est toujours montrée très attentive à l’ensemble des requêtes de ces professionnels de santé, tant en matière d’aménagement des locaux – des locaux fabuleux – que sur le calcul équitable des loyers et charges. Mais rien n’y a fait !
La situation est aujourd'hui inacceptable pour les élus locaux !
En réaction, les deux pharmaciens de Huningue ont lancé une pétition afin d’alerter les pouvoirs publics sur la pénurie de médecins. Cette démarche, qui a recueilli en peu de temps 1 150 signatures, s’articule autour de deux idées fortes : une régionalisation des diplômes et une réflexion en vue d’une modification législative qui porterait sur la libre installation des médecins – des propositions qui pourraient figurer dans une réelle et ambitieuse réforme !
Partageant pleinement les légitimes inquiétudes exprimées tant par les patients que par les élus locaux sur ce sujet, partant du constat que toutes les mesures incitatives mises en place jusqu’à présent n’ont jamais atteint leurs objectifs, je souhaite connaître, madame la secrétaire d’État, les mesures que vous souhaitez prendre afin de répondre à cette problématique de désertification médicale, qui affecte désormais tous les territoires.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de la ministre des solidarités et de la santé, madame la sénatrice Troendlé.
Comme vous l’avez souligné, l’accès aux soins est un enjeu majeur pour nos concitoyens. Mais pour y faire face, on ne peut se contenter d’une réponse unique qui serait « la » solution partout, dans tous les territoires.
La réponse ne passe pas uniquement par la présence d’un médecin dans chaque village.
Tout l’objectif du plan qui a été présenté par le Premier ministre et par Mme Agnès Buzyn est précisément d’ouvrir le champ des possibles en matière d’organisation, afin que les acteurs de terrain puissent mettre en œuvre les solutions les plus adaptées à leur situation.
Mme la ministre des solidarités et de la santé ne croit effectivement pas en la coercition ou au conventionnement sélectif. Cette méthode n’a pas démontré sa pertinence dans tous les pays qui l’ont essayée, car il y a toujours des moyens de contourner l’obligation.
En outre, il semble essentiel de construire les réponses avec les professionnels, et non contre eux. Ces derniers sont prêts à prendre leur part de responsabilité, dès lors que nous leur facilitons la tâche en levant les verrous réglementaires.
Aussi, ce plan est pragmatique et présente un panel de mesures destinées aux professionnels de santé et aux acteurs de terrain.
Il s’inscrit autour de quatre objectifs importants : redonner du temps médical au soignant, en facilitant les remplacements, le cumul entre emploi et retraite ou les exercices partagés entre ville et hôpital ; mettre en place la révolution numérique, en généralisant la télémédecine dès 2018 et en équipant toutes les zones sous-denses et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, d’ici à 2020 ; coordonner les professionnels de santé entre eux, en doublant les maisons et centres de santé d’ici à cinq ans, notamment grâce au 400 millions d'euros d’aide à l’investissement issus du Grand Plan d’investissement ; enfin, mettre en place une nouvelle méthode, fondée sur la confiance et le dialogue au niveau de chaque territoire.
Je souhaite donner à l’ensemble des acteurs tous les moyens leur permettant d’organiser ou de réorganiser les soins sur l’ensemble de nos territoires.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 viendra compléter l’annonce de plan, en particulier sur les aspects financiers et réglementaires.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, des précisions que vous m’apportez. Je voudrais moi-même en formuler quelques-unes…
À propos des maisons de santé, j’ai parlé tout à l’heure de coquilles vides.
Les élus locaux sont prêts à mettre en œuvre de tels dispositifs, mais la principale difficulté – je constate sur ce point un infléchissement du Gouvernement, qui semble avoir compris le problème, mais doit réellement en tenir compte –, c’est que ces projets de maison de santé sont impossibles à mettre en œuvre sans une véritable volonté des professionnels de santé.
S’agissant de la solution de la télémédecine, que vous avez évoquée, je vous mets tout de même en garde : cette solution ne peut être l’alpha et l’oméga des réponses apportées à la problématique.
Je pense tout d’abord que nous allons vers une déshumanisation des soins, mais il s’agit là d’un jugement tout à fait personnel.
Par ailleurs, ces consultations de télémédecine nécessitent la réalisation de plateaux techniques très onéreux et, c’est une évidence, la présence de médecins pour vérifier tous les éléments transitant par ces plateaux.
Enfin, et c’est la problématique principale, évoquée voilà quelques instants, il faut des engagements budgétaires importants ! En particulier, ces plateformes de télémédecine exigent un maillage très fin en matière de réseau à haut débit. Je souhaite que le Gouvernement agisse en ce sens, car, même dans une région bien dotée comme la mienne, des zones grises ou blanches demeurent. Ce maillage est un préalable nécessaire à la mise en place d’une télémédecine efficace !

La parole est à M. Daniel Chasseing, auteur de la question n° 053, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Ma question porte sur l’amélioration de la procréation médicalement assistée, la PMA.
Pour toutes sortes de raisons sociologiques, un nombre croissant de femmes, aujourd’hui, retardent l’âge de la maternité. Or, après 35 ans, il est scientifiquement démontré que la fertilité baisse. Le nombre d’ovocytes que peut produire une femme diminue progressivement, ce qui réduit ses chances lors de démarches de PMA, singulièrement pour ce qui concerne la congélation d’ovocytes.
En France, celle-ci ne peut se faire qu’à trois conditions : en cas de traitement médical – notamment une chimiothérapie – ; en cas de don d’ovocytes ; en cas de traitement de fécondation in vitro. Elle n’est pas autorisée dans le cadre d’une démarche d’autoconservation.
En 2016, face à l’intransigeance de la législation française sur la PMA, des praticiens ont pris position publiquement. Le professeur René Frydman, notamment, a cosigné un manifeste avec plus de 130 de ses confrères. Ils y affirment avoir aidé et accompagné des couples et des femmes célibataires dans leur projet d’enfant, dont la réalisation n’était pas possible en France. Ces mêmes professionnels se sont récemment émus de l’absence de positionnement favorable à l’autoconservation ovocytaire.
Ainsi, de nombreuses Françaises vont bénéficier d’un diagnostic génétique embryonnaire ou d’une autoconservation ovocytaire à l’étranger, notamment en Espagne : en 2016, plus de 200 Françaises ont consulté dans une clinique de Barcelone. Mais elles se rendent aussi en Belgique, en Italie, en République tchèque, au Danemark ou en Grèce, voire aux États-Unis ou au Canada – 6 000 d’entre elles, semble-t-il.
Certaines techniques de PMA sont effectivement autorisées dans plusieurs pays, et non en France. De ce fait, elles ne sont pas accessibles aux patientes les moins fortunées, même si la caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, participe au financement à l’étranger.
En conséquence, il paraîtrait logique de permettre à toutes les femmes d’accéder aux évolutions de la PMA, en particulier pour la conservation de leurs ovocytes, ainsi que pour les diagnostics génétiques embryonnaires.
Parallèlement, il faudrait prévoir un encadrement du dispositif et en confier la gestion, sous certaines conditions à déterminer par les organismes représentatifs, à des établissements de santé privés ou publics, contrôlés par les pouvoirs publics.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir me donner votre avis, et par là même celui du Gouvernement, sur cette suggestion.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
L’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes relève de la loi. Elle mérite un débat apaisé.
À l’heure actuelle, la PMA répond aux problèmes d’infertilité des couples hétérosexuels. Or les demandes d’accès à la PMA ont désormais vocation à répondre à d’autres problèmes.
L’homoparentalité et la monoparentalité issues de cette technique sont, dans notre pays, une réalité. Chaque année – des chiffres ont déjà été cités –, 2 000 à 3 000 femmes ont légalement recours à la PMA dans des pays limitrophes.
L’opinion publique évolue, puisque 61 % des Français sont favorables au recours à cette technique par les couples de femmes, alors qu’ils n’étaient que 55 % en 2014.
Le Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, a rendu un avis favorable à cette extension, le 15 juin dernier, en demandant de définir des « conditions d’accès et de faisabilité ». Il s’agissait précisément de l’accès à l’insémination artificielle avec donneur aux femmes seules et aux couples de femmes.
L’avis va vers plus d’autonomie pour les femmes, conforté par l’absence de violence engendrée par cette technique et par la relation à l’enfant, satisfaisante, dans ces nouvelles structures familiales.
Le CCNE s’inquiète d’un maintien du statu quo, qui stigmatiserait ces formes familiales.
Cependant, il recommande des conditions d’accès et de faisabilité pour les femmes seules, plus vulnérables, ainsi qu’une gratuité garantie du don de gamètes.
Vous le savez, l’actuelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011 sera révisée l’an prochain. Conformément aux dispositions prévues, cette révision sera précédée de la tenue d’états généraux, sur l’initiative du CCNE.
Le sujet de l’extension de la PMA pourra être débattu, au premier semestre 2018, lors de ces états généraux. Ce n’est qu’ensuite que sera élaboré le projet de loi de bioéthique. Il est donc trop tôt pour connaître les dispositions qui seront contenues dans ce projet de loi.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État. Tout cela doit être scrupuleusement encadré, mais l’autoconservation des ovules et le diagnostic embryonnaire – les deux points que j’ai soulevés dans ma question – nous paraissent une bonne pratique médicale. En effet, dans le cas du diagnostic embryonnaire préimplantatoire, une analyse chromosomique est autorisée en France pour les femmes enceintes qui le souhaitent, pour un dépistage anténatal, mais cela reste interdit pour le prélèvement d’une cellule sur l’embryon, avant le transfert in utero, ce qui nous paraît incohérent.

La parole est à Mme Françoise Gatel, auteur de la question n° 044, transmise à Mme la ministre du travail.

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur une incongruité administrative ou sanitaire – vous m’aiderez à la qualifier – relative aux conditions d’autorisation du travail le dimanche pour les laboratoires d’analyse de lait.
Chaînons essentiels de notre industrie laitière, mais également protecteurs indispensables de la santé de nos concitoyens, les laboratoires d’analyse de lait ne bénéficient pourtant pas du même régime que les laiteries concernant le travail dominical.
Contrairement à ces dernières, qui profitent en permanence d’une dérogation au titre des denrées périssables, les laboratoires d’analyse de lait, acteurs essentiels de la santé publique, ont besoin d’une dérogation renouvelable annuellement pour pouvoir travailler le dimanche.
Le laboratoire d’analyse MyLab, reconnu par les pouvoirs publics, situé sur ma commune de Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine, s’occupe de l’analyse laitière à destination de 65 laiteries et de près de 20 000 fermes dans la zone Grand Ouest. Il a ainsi attiré mon attention sur cette situation préoccupante.
La dérogation demandée est essentielle pour trois des activités de ces laboratoires : la collecte des échantillons ; l’astreinte pour assurer la conformité à la réglementation sur le critère de résidus d’antibiotiques dans le lait ; l’astreinte pour assurer la surveillance vis-à-vis des critères bactériologiques.
La demande annuelle d’une telle dérogation est donc un frein administratif au bon déroulement de l’activité à caractère sanitaire de ces structures.
Les lourdeurs administratives peu pertinentes – voilà l’incongruité dont je parlais – telles que la nécessaire délibération du conseil municipal de la commune où se situe le laboratoire constituent un véritable problème pour ces laboratoires. C’est une difficulté importante et assez incompréhensible qui peut mettre en danger l’activité de ces acteurs de la santé publique.
Aussi, madame la secrétaire d’État, je souhaite savoir quelles dispositions vous comptez prendre pour résoudre cette anomalie juridique et – me semble-t-il – sanitaire.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Madame la sénatrice Gatel, je vous prie de bien vouloir excuser ma collègue Muriel Pénicaud, qui est retenue par les concertations avec les partenaires sociaux sur le deuxième volet de la transformation de notre modèle social.
Vous interrogez le Gouvernement au sujet des conditions d’autorisation du travail dominical des laboratoires d’analyse de lait, plus précisément du laboratoire MyLab, situé à Châteaugiron.
Comme vous l’indiquez, ces laboratoires d’analyse de lait ne bénéficient pas, contrairement aux laiteries qu’ils contrôlent, d’une dérogation permanente au repos dominical au titre du code du travail.
Néanmoins, cette activité d’analyse peut bénéficier d’une dérogation au repos dominical au titre du code rural et de la pêche maritime.
En effet, les articles L. 714-1 et R. 714-1 de ce code le permettent, sous réserve toutefois que les organismes de contrôle laitier relèvent du régime agricole, aux termes du 6° de l’article L. 722-20 du même code.
Or le laboratoire MyLab, bien qu’agréé par le ministère de l’agriculture, relève non pas du régime agricole, mais du régime général. Dans ces conditions, en l’état actuel du droit et à moins d’une modification de son régime d’affiliation, le laboratoire MyLab doit continuer à solliciter auprès du préfet une dérogation temporaire au repos dominical, sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail.

J’ai bien compris votre argumentation juridique très pertinente, madame la secrétaire d'État. Toutefois, vous conviendrez qu’il s’agit là d’une activité sanitaire, liée à des obligations de contrôle du lait. J’entends bien votre réponse, mais permettez-moi de souligner une nouvelle fois cette incongruité. Il me semble nécessaire, compte tenu de l’enjeu sanitaire s’agissant d’une denrée périssable, que les laboratoires qui sont obligés de faire ces contrôles bénéficient d’une législation plus ad hoc. Je sais que les communes sont compétentes sur tous les sujets, mais vous avouerez que solliciter l’avis d’un conseil municipal sur celui-ci en particulier, c’est quand même une curiosité française dont on pourrait se passer pour plus d’efficacité et de sécurité.

La parole est à M. Martial Bourquin, auteur de la question n° 065, adressée à Mme la ministre du travail.

Madame la secrétaire d'État, je veux attirer votre attention sur les conséquences inquiétantes de la diminution drastique et immédiate du nombre de contrats aidés dans nos communes et nos territoires.
Je prends un exemple simple, celui de la commune d’Audincourt, ville de 15 000 habitants, qui, à travers ses associations, se voit profondément impactée par cette décision.
Ainsi, la maison des jeunes et de la culture Saint Exupéry, centre social, situé dans un quartier classé prioritaire, a perdu trois postes – référent famille, secrétariat et comptabilité – en septembre 2017, auxquels s’ajouteront trois autres contrats aidés au cours de la période 2017-2018.
L’association Réussir Ensemble, située également aux Champs-Montants, s’est vu refuser le renouvellement de deux contrats aidés.
L’association Soli-cités, une association d’aide et de soins à domicile, doit normalement renouveler douze contrats aidés d’ici à la fin de l’année, des emplois qui représentent un souffle indispensable pour cette structure.
Les Francas du Doubs nous alertent également, tout comme l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes nous fait part de ses plus vives inquiétudes puisque la perte et le remplacement par des agents des services hospitaliers des quinze contrats aidés que compte cette structure représentent un coût supplémentaire de 65 600 euros, soit une augmentation du prix de journée de 4, 35 euros.
Voilà, madame la secrétaire d'État, à l’échelle d’une ville moyenne, un tableau rapide et non exhaustif des conséquences concrètes d’une telle décision. Diminuer drastiquement et sans aucune concertation le nombre d’emplois aidés a non seulement comme conséquence directe le retour à la précarité pour les personnes concernées, mais c’est également un coup porté à la cohésion sociale et aux services rendus aux plus fragiles qui sont directement remis en cause.
Madame la secrétaire d'État, pouvons-nous avoir un débat sur ces questions, afin d’assurer le vivre ensemble dans les quartiers, éviter des drames et, certainement, une remise en cause durable de la cohésion sociale ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Monsieur le sénateur Bourquin, je vous prie de bien vouloir excuser ma collègue Muriel Pénicaud, qui est retenue par les concertations avec les partenaires sociaux.
Vous demandez au Gouvernement de maintenir l’ensemble des contrats aidés, alors que vous aviez non seulement sous-budgétisé ce dispositif – 280 000 contrats aidés en loi de finances initiale pour 2017 contre 459 000 en 2016 –, mais aussi consommé plus des deux tiers des crédits de l’enveloppe au premier semestre.
Face à cette situation, et dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, le Gouvernement a pris ses responsabilités en accordant 40 000 contrats aidés de plus.
Ceux-ci sont recentrés sur les publics les plus éloignés du marché du travail et là où ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale, notamment en direction des communes rurales en difficulté financière extrême.
Au-delà, nous considérons qu’une politique de l’emploi efficace, capable de répondre aux défis à venir, doit s’appuyer sur le renforcement des politiques de formation et d’accompagnement ciblé qui donnent plus d’atouts, de capacités aux personnes qui en bénéficient pour s’insérer durablement dans l’emploi.
C’est le sens du Grand Plan d’investissement compétences, d’un montant de 15 milliards d’euros, de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, mais aussi de la mission que Muriel Pénicaud a confiée à Jean-Marc Borello, président du Groupe SOS, pour apporter des solutions d’insertion innovantes et accompagner également les associations pour une nouvelle gouvernance, ce qui leur permettrait de faire face à ces difficultés financières.

Madame la secrétaire d'État, je regrette que vous ne répondiez pas précisément à mes questions. Que vont faire ces associations si elles n’ont pas ces contrats aidés ? Vous nous parlez de maîtrise des dépenses publiques ; il y a d’autres choix à faire. Vous avez supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF, vous avez fait des choix. Dans un sondage rendu public aujourd’hui, pour plus de 80 % des Français, le Président de la République est le président des riches. Je suis désolé d’entendre cela. Je pensais que vous auriez des réponses, une volonté de négocier pour essayer de régler le problème des contrats aidés.
Alors que le congrès des maires ruraux du Doubs vient de se tenir, vous nous indiquez que la ruralité serait peu impactée grâce aux mesures prises. Les Francas du Doubs ont fait dire au cours de ce congrès, par le biais d’un rapport, qu’une grande partie des actions périscolaires risquait de disparaître dans ce département.
Je pense que cette politique a été menée à la hâte. S’il y avait une possibilité de renouer le dialogue avec le Gouvernement et de revoir cette politique des contrats aidés, nous pourrions certainement entamer une vraie discussion et, surtout, essayer de sortir de cette situation.
Ces étudiants bénéficiant de contrats aidés pour s’occuper d’enfants en échec scolaire et essayer de les remettre dans le système scolaire, ils mènent des actions sociales indispensables : c’est la lutte contre l’échec scolaire. Tout cela va s’arrêter au mois d’octobre, au mois de novembre, si nous ne trouvons pas une solution.
Parfois, il faut entendre le bon sens. Ce n’est pas une intervention politique partisane que je fais aujourd’hui ; j’essaie d’attirer l’attention du Gouvernement sur un risque grave pour la cohésion sociale dans les quartiers.

La parole est à M. Cyril Pellevat, auteur de la question n° 035, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la France est la première destination touristique mondiale, avec plus de 80 millions de visiteurs en France métropolitaine en 2015.
Représentant 8 % du PIB et deux millions d’emplois directs et indirects, le tourisme est un secteur clé de l’économie française.
Il ne serait pas bon de se reposer sur nos lauriers. Car, nous le savons, l’année 2016 a été très mauvaise en raison des attentats. Nous devons renforcer notre offre touristique et l’attractivité de la France.
Les défis ne manquent pas, au premier rang desquels la sécurité, mais aussi le numérique avec l’e-commerce et le travail à domicile, le tourisme des seniors, le boom du tourisme chinois, une meilleure valorisation du patrimoine, le problème des coûts élevés, la piètre qualité de l’accueil des étrangers, etc.
Nous devons aussi adopter des ajustements en matière de fiscalité pour promouvoir l’investissement, adopter des simplifications administratives.
Je soulignerai deux autres points qui mériteraient l’attention et la vigilance du Gouvernement : d’une part, la question du renouvellement des clientèles, notamment l’adaptation de l’offre touristique aux besoins des jeunes générations ; d’autre part, la question centrale des transports, individuels et en commun. Ce point détermine la capacité de développement des stations.
Concernant la destination Savoie-Mont-Blanc, territoire dynamique dont nous souhaitons développer les atouts « quatre saisons », nous avons de nombreux enjeux, dont la hausse de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui pénalise les finances, de même que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, anormalement élevé dans les communes de montagne.
Les exemples sont nombreux. Je citerai la communauté de communes de la Vallée de Chamonix, dont le FPIC est passé de 2, 7 millions d’euros à 3 millions d’euros en 2016.
Il faudrait revenir également sur la législation concernant les unités touristiques nouvelles qui, trop complexe, pénalise les nouveaux projets en pays de Savoie.
De plus, les normes françaises concernant l’hôtellerie familiale pénalisent lourdement la transmission et impliquent des fermetures nombreuses. Inspirons-nous de la Suisse et de l’Autriche.
Concernant les modifications du calendrier scolaire pour une saison de ski plus longue, des efforts ont été faits, mais ils doivent être poursuivis.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles actions le Gouvernement compte-t-il entreprendre en faveur de ce secteur ? Pourriez-vous nous détailler la politique du tourisme qu’il souhaite mettre en œuvre pour atteindre les 100 millions de touristes internationaux en 2020 ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le sénateur, quelle politique du Gouvernement en matière de tourisme ?
Même si la conjoncture du tourisme se redresse en 2017, vous l’avez souligné dans votre propos, il ne faut pas oublier la contre-performance de 2016 – baisse du nombre d’arrivées de touristes internationaux de 2, 2 % –, consécutive aux attentats terribles qui ont frappé l’Hexagone. Cela montre que la compétitivité du site France n’est jamais acquise et qu’il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, qu’il faut poursuivre les efforts qui ont été engagés, parfois depuis longtemps, au-delà des appartenances partisanes.
La politique du Gouvernement a été définie lors du comité interministériel du tourisme qui s’est tenu à Matignon le 26 juillet dernier et dont les grandes orientations ont été rappelées il y a quelques jours au ministère des affaires étrangères. Elle comprend six axes prioritaires.
Premier axe : la qualité de l’accueil et la sécurisation des sites, facteurs à la fois de satisfaction et de fidélisation des touristes étrangers, en particulier de certaines clientèles plus sensibles que d’autres aux questions de sécurité – je pense à la clientèle chinoise. Cela passe par la rapidité dans la délivrance des visas – des efforts ont été engagés en ce sens – et par la promotion de la marque d’État Qualité Tourisme.
Deuxième axe : la structuration d’une offre touristique pour mettre en valeur l’ensemble des territoires. Le Gouvernement a par exemple mis en œuvre des instruments, comme les contrats de destination – je suis certain que vous en connaissez l’intérêt –, qui permettent de fédérer les acteurs d’un territoire autour d’une stratégie touristique commune de structuration et de promotion de l’offre touristique, afin de rendre l’offre de la destination France plus lisible.
La politique des contrats de destination sera poursuivie en 2018 avec la continuation des premiers contrats qui arrivent à échéance.
Troisième axe : le soutien étatique en matière d’investissements, qui suppose une meilleure mobilisation du fonds France Développement Tourisme, doté de 1 milliard d’euros sur cinq ans. Mis en place en 2015, il a permis de mobiliser des crédits de la Banque publique d’investissement et de la Caisse des dépôts sur les entreprises et projets touristiques porteurs.
Le Gouvernement vient en outre de lancer une mission pour identifier les propositions qui permettront de faciliter la rénovation du parc privé d’hébergements touristiques, notamment dans les stations littorales et de montagne – ces dernières vous sont chères, monsieur le sénateur, et je connais bien, moi aussi, cette région de la Savoie dont vous êtes l’élu.
Quatrième axe : la formation et l’emploi. Le Gouvernement a fait des formations dans le secteur du tourisme l’un des enjeux majeurs du développement du secteur. Il s’agira de poursuivre notamment la montée en puissance de la Conférence des grandes écoles françaises du tourisme, créée en 2016 sur l’initiative du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’éducation nationale. À ce jour, vingt formations d’excellence, dispensées par une douzaine d’établissements, ont été sélectionnées et l’appel à candidatures reste ouvert.
Le Gouvernement souhaite également augmenter le nombre de contrats d’apprentissage dans le secteur, en concertation avec les professionnels, pour développer l’offre des entreprises en direction des moins de 25 ans et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Le secteur touristique est sans doute l’un de ceux qui peuvent nous permettre de juguler le chômage qu’on observe depuis bien longtemps parmi le million de jeunes de moins de 25 ans sans emploi et constitue une ressource importante dans ce combat commun.
Cinquième axe : le soutien à la numérisation et au partage d’informations. Cette action comprend le développement de DATAtourisme, évoqué dès le comité interministériel du 26 juillet dernier, qui agrégera des données touristiques pour les livrer en open data, afin d’en permettre un meilleur usage.
Sixième et dernier axe : l’accès aux vacances pour le plus grand nombre, notamment pour les personnes en situation de handicap – Sophie Cluzel aurait pu vous en parler bien mieux que moi –, au moyen de la valorisation des marques « Tourisme et Handicap » et « Destination pour tous ».
Vous avez évoqué par ailleurs la question de la simplification, politique transversale aux six axes, qui, vous le savez, tient à cœur à ce gouvernement. Un projet de loi lui est consacré et, au-delà, c’est le fil rouge de l’action que le Gouvernement mènera.
En tout cas, nous nous assurerons de la mise en œuvre de ces axes dans le cadre des comités interministériels du tourisme et de leurs comités de pilotage, qui se réunissent tous les trois mois, et dont vous aurez bien évidemment connaissance.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, qui nous indique les éléments détaillés de la feuille de route tracée par le Gouvernement.
Je rejoins votre propos selon lequel il faudra que nous soyons unis, de façon transpartisane, pour faire évoluer le tourisme, répondre aux enjeux et ne pas nous laisser dépasser par les autres pays.
Quelques points d’alerte s’agissant de nos stations de montagne, que vous connaissez également – j’en profite pour vous renouveler mon invitation, à vous ainsi qu’à votre collègue Sébastien Lecornu, que nous aurons plaisir à recevoir en Haute-Savoie. Nous sommes passés de la première à la troisième place en ce qui concerne les ventes de forfaits journaliers aux skieurs entre 2016 et 2017, loin derrière les États-Unis et l’Autriche. S’agissant de la neige de culture, le taux de couverture en France est de 35 %, contre 48 % en Suisse, 60 % en Autriche et 70 % en Italie.
Vous le voyez, monsieur le secrétaire d'État, il faudra un travail conjoint entre les professionnels du secteur, les environnementalistes et les services de l’État pour que nous puissions conserver cette dynamique.
Encore une fois, je vous remercie de votre réponse, qui, je l’espère, satisfera l’ensemble des acteurs.

La parole est à Mme Gisèle Jourda, auteur de la question n° 037, adressée à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur l’état d’avancement des discussions entre les services du ministère chargé du tourisme et les opérateurs présents en ligne référençant les activités touristiques.
Depuis novembre 2016, à la suite de l’évolution des procédures utilisées par ces groupes puissants en situation de quasi-monopole, l’ensemble des offres touristiques présentes sur le territoire de plusieurs collectivités ne sont plus du tout référencées.
De fait, un cloisonnement géographique a été mis en place. Par exemple, avant cette date, une recherche effectuée sur des sites comme TripAdvisor et Booking permettait d’associer au nom « Carcassonne » l’ensemble de l’offre touristique présente sur les communes avoisinantes. Depuis près d’un an, ce n’est plus le cas. À cause du cloisonnement géographique mis en place par ces référenceurs, même un établissement présent à moins d’un kilomètre de la cité médiévale, mais domicilié sur une autre commune que Carcassonne, ne se voit plus identifié dans les possibilités offertes aux clients. Même la communauté d’agglomération se trouve impactée puisqu’elle ne peut plus référencer ses offices du tourisme communautaires en les rattachant à la ville-centre.
Vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, c’est fortement dommageable.
À la suite de cette évolution, certaines activités touristiques ont subi une large baisse de fréquentation, allant jusqu’à près de 30 % dans le département de l’Aude. C’est d’autant plus pénalisant que des acteurs touristiques continuent de payer pour être référencés, certains ayant même choisi de s’appuyer principalement sur ces groupes pour assurer leur communication.
Pourquoi une telle situation ? Il apparaît dans les échanges avec ces grands groupes qu’ils ont souhaité standardiser leurs procédures, mais qu’ils ont pris néanmoins conscience des limites de ces dernières, notamment au vu des multiples réclamations dont elles ont fait l’objet.
Monsieur le secrétaire d'État, en raison des enjeux pour les professionnels du tourisme et pour nos collectivités, j’aimerais connaître l’état d’avancement des discussions entre vos services et les grands opérateurs. Je souhaite sincèrement qu’une solution rapide et pérenne puisse être apportée.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l’économie et des finances.
M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur le tourisme dans nos territoires et la place prépondérante prise par certaines grandes plateformes numériques, que nos concitoyens connaissent bien pour en faire un usage régulier dans la préparation de leurs vacances – encore récemment, j’y ai eu recours pour organiser celles de mes enfants.
Sourires.
Votre question intervient quelques jours après le conseil de pilotage du tourisme, réuni le 10 octobre dernier par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et d’une trentaine de professionnels représentatifs des différentes activités touristiques.
À l’occasion de cette réunion a été annoncé le lancement d’une mission sur le financement de la promotion de la destination France qui devra rendre ses conclusions avant la fin de l’année. L’objectif de cette mission est d’élargir l’assiette des contributeurs à l’opérateur public Atout France et d’y associer plus étroitement les grands acteurs numériques qui bénéficient de ses actions de promotion sans pour autant les financer – en tout cas pas toujours.
L’Union nationale pour la promotion de la location de vacances, qui regroupe notamment les grands acteurs numériques tels que Airbnb, Abritel Homeway, Expedia et TripAdvisor, représentée par son président, a participé à ces travaux et redit sa volonté de contribuer à l’effort collectif selon des modalités qu’il appartiendra aux trois rapporteurs de la mission de définir.
Sur la question plus spécifique du référencement des professionnels que vous soulevez, les services du ministère ont été saisis d’une situation préoccupante à Carcassonne, sur votre territoire. La plateforme TripAdvisor a en effet décidé de changer son découpage territorial et de ne plus faire remonter dans les listes de résultats des internautes que les acteurs géographiquement situés dans la ville, brimant de facto les acteurs situés à la périphérie de Carcassonne, nombreux compte tenu de l’importance de ce pôle touristique dans la région.
Cette situation est évidemment très pénalisante pour ceux qui ont besoin d’être connectés à la marque « Carcassonne » – je n’aime pas assimiler le nom d’une ville à une marque – pour remonter dans les référencements de ce type de plateforme.
Cela ne correspond pas en outre à la logique des contrats de destination – je les ai évoqués dans ma réponse précédente – mis en place dans toute la France pour dépasser les frontières administratives, pas toujours des plus opérationnelles et efficaces, et fédérer les acteurs territoriaux du tourisme autour d’une marque commune.
Le contrat de destination « Pays cathare » est d’ailleurs le reflet de cette ambition et il bénéficie à plein de ce dispositif.
Après plusieurs échanges, TripAdvisor a indiqué avoir pris conscience des problèmes générés par son nouveau découpage territorial et travaille à des fonctionnalités moins restrictives pour les professionnels. La plateforme nous a indiqué traiter le cas de Carcassonne en priorité et doit faire des propositions dans le courant du mois de novembre. Elle est en relation constante avec l’office du tourisme du Grand Carcassonne et les services du Quai d’Orsay pour apporter au plus vite une solution satisfaisante à cette situation pour le moins ubuesque.
Ce cas particulier de Carcassonne n’est pas isolé en France ; d’autres professionnels sont confrontés à cette situation dans nos territoires. Là où existe une difficulté, nous nous employons à faire du sur-mesure, territoire par territoire. Cela soulève la question de la place hégémonique, voire oligopolistique – tel est le terme utilisé voilà quelque temps lors des cours d’économie que je suivais – prise en quelques années par les plateformes numériques dans le secteur du tourisme. Ce sont aujourd’hui des acteurs incontournables avec lesquels il faut collectivement pouvoir travailler, interagir et coopérer, dans un dialogue exigeant, afin que nous atteignions les objectifs ambitieux fixés par le Premier ministre le 26 juillet dernier à l’occasion du conseil interministériel du tourisme, à savoir l’accueil de 100 millions de touristes étrangers à l’horizon 2020 et 50 milliards d’euros de retombées économiques pour la France et l’ensemble de ses territoires.

Mme Gisèle Jourda. Monsieur le secrétaire, vous prononcez bien mieux que moi les anglicismes !
Sourires.

Cela étant, votre réponse va totalement dans le sens de mon questionnement. Je m’en ferai l’écho dans mon territoire auprès des opérateurs du tourisme et des représentants des communautés de communes et d’agglomération. Il est évident qu’en ayant placé ces frontières, TripAdvisor a dressé des remparts, alors que, pour Carcassonne, cité médiévale – vous avez mis en avant, et je vous en félicite, la marque « Pays cathare » –, le département de l’Aude a été l’un des premiers à déposer une marque voilà déjà quelques années, grâce au député européen Éric Andrieu.
Alors que nous avions mis en place au fil des années une politique touristique qui se voulait à l’avant-garde et précurseur, nous nous retrouvons avec des personnes qui n’ont plus l’« effet marguerite » voulu autour de Carcassonne pour promouvoir nos châteaux cathares, mais surtout le tourisme des abbayes et des sites remarquables situés dans le département de l’Aude. Or ce département comprend deux villes de moyenne importance, Carcassonne et Narbonne, autour desquelles rayonne le tourisme.
Il faut s’ouvrir au net, mais il ne faut pas, au moment où l’on veut que les frontières tombent pour s’ouvrir à un tourisme international et mondial, se trouver face à ce type de difficultés qui ont vraiment nui aux chambres d’hôtes et aux tables de l’arrière-pays qui bénéficiaient de l’intérêt pour Carcassonne.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, auteur de la question n° 055, adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sur la scène internationale, nous sommes reconnus pour notre engagement en faveur des droits de l’homme, pour la protection que la sécurité sociale offre à nos compatriotes et, même si cela est peut-être moins connu, pour la densité et le dynamisme de notre réseau diplomatique et consulaire.
La France permet ainsi à ses ressortissants installés ou de passage à l’étranger de bénéficier d’un réseau en constante évolution et dont nous avons toujours préservé l’universalité.
Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur la façon dont votre ministère gère les personnels qui animent ce réseau.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est un employeur atypique : il fait travailler près de 14 000 agents aux statuts très différents, dont un tiers d’agents de droit local. Cette catégorie de personnel regroupe des agents aux profils et aux fonctions très variés, recrutés localement par nos postes et soumis à la législation locale. À l’instar de leurs collègues titulaires, ils doivent en permanence s’adapter à des méthodes de travail qui se modernisent. Dans le même temps, ils sont aussi tenus de respecter le référentiel Marianne qui garantit un accueil efficace et courtois aux usagers dans nos consulats.
Le contexte budgétaire a conduit le ministère, afin de faire des économies, à remplacer, sur certains postes, des agents titulaires par des recrutés locaux dont le traitement salarial est tout à fait différent. Au vu de la forte activité des postes, la contribution de ces agents à notre réseau diplomatique, consulaire et culturel est devenue à la fois incontournable et fondamentale.
Or je suis inquiète de constater, au fil de mes déplacements, la dégradation des conditions de vie de ces agents. Les revalorisations salariales consenties par le ministère sont très insuffisantes au regard du coût de la vie dans les grandes villes comme Toronto, New York, San Francisco, ou encore Istanbul, dont je reviens, où leurs salaires ne sont plus en phase avec l’augmentation des loyers et des transports. Les recrutés locaux célibataires ou ayant une famille à charge ont de grandes difficultés à se loger décemment. Certaines situations individuelles sont tout à fait critiques.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne peux me résoudre à ce que des agents qui travaillent au service de la France depuis de nombreuses années ne puissent vivre dignement.
Aussi, je voudrais connaître les mesures que vous comptez prendre pour répondre aux préoccupations de ces personnels et, en premier lieu, leur assurer à toutes et à tous des conditions de travail et de vie décentes.

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.
Je vous rappelle que le temps imparti pour chaque réponse est de deux minutes, sachant que vos deux interventions précédentes, monsieur le secrétaire d’État, ont duré quatre minutes chacune…
Je vais essayer d’être concis.
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question. Vous avez parfaitement raison de souligner la contribution essentielle des agents recrutés localement au bon fonctionnement de notre réseau diplomatique, consulaire et culturel dans le monde. J’ai moi-même eu l’occasion de bénéficier de la qualité de leur travail lors de mes déplacements récents en Chine, en Corée du Sud ou en Tunisie plus récemment avec le Premier ministre. Ces agents représentent 46 % des effectifs du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à l’étranger.
Ce ministère est évidemment très attentif à la situation de ces personnels dans l’ensemble du réseau, en particulier aux États-Unis, compte tenu du coût élevé de la vie en Amérique du Nord. Dans un contexte budgétaire contraint, il s’assure tous les ans que les conditions de rémunération de ces personnels sont adaptées à l’évolution du coût de la vie et à la politique salariale pratiquée chez nos principaux partenaires dans les pays considérés.
Ainsi, 92 pays ont bénéficié au 1er janvier 2017 d’une revalorisation salariale destinée à compenser l’inflation constatée en 2016, pour un montant d’environ 1, 7 million d’euros. Contrairement à la pratique des années précédentes, les niveaux d’inflation observés par le Fonds monétaire international ont été compensés intégralement, sans déduction de l’inflation française. Ce point précis répondait à une préoccupation souvent exprimée par les personnels locaux.
Par ailleurs, 22 pays verront leurs cadres salariaux révisés à compter du 1er janvier 2017, afin de les adapter aux conditions locales de rémunération, pour un coût annuel total de plus de 1, 6 million d’euros.
Ces montants illustrent l’effort budgétaire significatif consenti par le ministère en faveur des agents de droit local dont l’importance a été soulignée.
Les agents de droit local aux États-Unis ont pu bénéficier, au cours des dernières années, d’augmentations régulières et significatives. Ces revalorisations ont été mises en place sur plusieurs années consécutives.
Sur la base d’une étude des niveaux de salaire offerts aux agents de droit local dans l’ensemble de nos postes aux États-Unis, une revalorisation vient d’être décidée, pour les villes où un décrochage est patent par rapport à nos partenaires européens. Une revalorisation uniforme de 2 % a été accordée aux agents à New York et à San Francisco. Le cas du Canada pourra être étudié de la même manière en 2018.
Les agents de droit local aux États-Unis ont régulièrement bénéficié des augmentations annuelles au titre du mécanisme du coût-vie, sans préjudice des revalorisations structurelles que je viens de rappeler.
En ce qui concerne l’accès aux concours internes de la fonction publique, le ministère étudie plusieurs pistes, à la fois juridiques et statutaires, qui permettraient aux agents de nationalité française d’accéder à des modes de recrutement ouvrant la voie à une intégration dans un corps du ministère. L’action de ces agents au quotidien est déterminante pour le bon fonctionnement de notre réseau diplomatique et consulaire.
Enfin, s’agissant de l’éligibilité à l’indemnisation chômage des recrutés locaux qui rentrent en France, il est exact que le cadre juridique de ce mécanisme de protection ne permet pas d’en faire bénéficier les employés ayant exercé dans notre réseau sous contrat de travail de droit étranger et décidant de rentrer en France. Il s’agit d’un sujet sur lequel nous devrons nous pencher rapidement.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir, de fait, répondu à trois questions que j’avais posées. Ces réponses vont dans le bon sens et seront en effet de nature à rassurer ces personnels.
Je veux attirer votre attention sur le fait qu’un certain nombre de postes ont organisé des études comparatives entre les salaires que nous octroyons à nos recrutés locaux et les salaires versés par d’autres ambassades dans leur pays de résidence. Dans trop de pays, la France, et ce n’est pas très glorieux, arrive en queue de peloton. Les revalorisations que vous avez annoncées vont donc vraiment dans le bon sens.
Ainsi, nous observons aujourd’hui, cela a été le cas à Istanbul, qu’un grand nombre de recrutés locaux quittent leur poste, tout simplement parce qu’ils perçoivent des salaires plus intéressants ailleurs, alors que nous avons vraiment besoin de ces personnels bilingues, voire trilingues, dont les compétences techniques sont reconnues. Il est très important de les fidéliser, en les rémunérant à hauteur de ces compétences. Globalement, nos recrutés locaux méritent mieux.

La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 031, adressée à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question porte sur l’amélioration de la prise en charge de l’indemnisation des dégâts causés par les effondrements de marnières, sujet qui ne peut avoir que de la résonance aux oreilles d’un Normand.
Historiquement, l’exploitation de la craie, aussi appelée marne, était utilisée pour enrichir la terre agricole. Les exploitations souterraines accessibles par un puits sont aujourd’hui de loin les plus nombreuses en Normandie. En effet, les extractions de marne devaient se situer à proximité des surfaces agricoles situées sur les plateaux où la craie est en moyenne à 25 mètres de profondeur. Ces cavités étaient accessibles par un puits, qui permettait de descendre dans des galeries, créant une véritable toile d’araignée souterraine.
En Seine-Maritime, le volume de chaque marnière vide était environ de 250 mètres cubes. Quand la marnière n’était plus exploitée, le puits était refermé et signalé par un arbre. Malheureusement, au fil du temps et des remembrements, ces arbres, généralement isolés au milieu des champs, ont disparu et la mémoire des sites avec eux. Dans le département de la Seine-Maritime, le nombre de marnières est estimé entre 60 000 et 80 000.
Les effondrements de marnières sont aujourd’hui récurrents et présentent un risque réel, tant pour les habitants que pour les constructions. Ils peuvent être dramatiques – les témoignages de victimes sont nombreux –, et leurs conséquences financières très lourdes.
La prévention des effondrements est rendue difficile en raison des difficultés de recensement des cavités et du coût des explorations. Cependant, depuis plusieurs années, sous l’impulsion notamment de mon collègue le sénateur Charles Revet, la législation a évolué pour mieux prendre en compte le dommage résultant de l’effondrement des marnières. Dorénavant, l’état de catastrophe naturelle peut être reconnu sous certaines conditions et le Fonds Barnier permet de financer la prise en charge partielle des opérations de sondage et de comblement.
Face à ces situations récurrentes, les maires jouent un rôle central, au titre tant de leur pouvoir de police, notamment par l’adoption d’un arrêté de péril ou la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, que du relogement des sinistrés. Cependant, l’aide accordée aux victimes demeure trop peu importante et difficile à mettre en place.
Le Gouvernement compte-t-il améliorer le régime applicable aux victimes propriétaires ? Des aides fiscales et financières nouvelles souvent mises en avant sont-elles à l’ordre du jour ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice, je vous remercie d’avoir évoqué ce sujet difficile que nous connaissons bien entre Normands, aussi bien en Seine-Maritime que dans mon département, l’Eure.
L’exploitation passée des marnières, pour extraire de la craie dans le sous-sol, a duré des siècles dans notre région et provoque des effondrements, parfois terribles, vous l’avez rappelé.
Sachez, madame la sénatrice, que l’inventaire national des cavités est toujours en cours en Normandie et qu’il est annuellement enrichi de nouvelles données. Le chiffre que vous indiquiez dans votre question est un minima. On recense aujourd’hui jusqu’à 120 000 marnières, de taille inégale, potentiellement présentes en Seine-Maritime, ce qui illustre l’ampleur du phénomène.
Je vous remercie donc de relayer, dans cet hémicycle, l’inquiétude, et souvent même la détresse, des habitants confrontés à des situations qui peuvent parfois les mettre en danger de façon importante.
Comment aider les victimes ? Aujourd’hui, les communes peuvent prétendre à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans le cas d’un effondrement d’une intensité soutenue ou anormale. Cette reconnaissance permet ensuite aux assurés de bénéficier du remboursement des frais de remise en état du bien endommagé.
Néanmoins, sur ce sujet, et nous en sommes parfois les témoins en tant qu’élus locaux, il me semble que l’un des enjeux principaux est la prévention. Cela figurait d’ailleurs au cœur du plan national Cavités, mené entre 2013 et 2015.
Vous l’avez évoqué dans votre question, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, est aujourd’hui le dispositif le plus adapté techniquement et financièrement pour prévenir les risques d’effondrement. Comment s’applique-t-il ? Les travaux de prévention engendrent des coûts importants, qu’il n’est pas toujours évident de prendre en charge.
Aussi, le Fonds Barnier s’applique pour les opérations de reconnaissance et les travaux de comblement ou de traitement des cavités souterraines, avec une subvention à hauteur de 30%, et pour les études et travaux de réduction de la vulnérabilité, prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques, ou PPR, avec une subvention à hauteur de 40 % pour les habitations et de 20 % pour les biens à usage professionnel des petites entreprises.
Au fond, la vraie question est le taux de recours à ce dispositif. Pour répondre à votre interrogation, le Gouvernement doit améliorer la médiation, l’accompagnement des élus locaux sur ce sujet, puisque le Fonds Barnier est peut-être encore trop complexe. Le Parlement et le Gouvernement doivent engager une réflexion commune sur ce point.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de ces éléments de clarification.
Dans ces situations, nous nous trouvons face à des propriétaires victimes qui connaissent une vraie détresse et à des élus locaux qui n’ont pas tous les outils pour accompagner celles-ci comme ils le souhaiteraient. Certes, des mécanismes existent, mais ils restent aujourd’hui complexes à mettre en œuvre. Il faut travailler à une simplification pour faciliter la vie de ces propriétaires et leur éviter de telles difficultés.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 036, adressée à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la stratégie que le Gouvernement compte mettre en œuvre concernant la présence du loup dans nos territoires et tout particulièrement le plan Loup 2018-2023.
Pour que les troupeaux et les loups cohabitent, l’État a instauré un arsenal d’interventions telles que la dissuasion par effarouchement, le tir de défense ou le tir de prélèvement avec un quota annuel de loups qu’il est possible d’abattre.
Une des caractéristiques du pastoralisme dans les Alpes-Maritimes est que les troupeaux restent en extérieur quasiment toute l’année, ce qui explique la raison pour laquelle, en 2016, mon département a enregistré le plus d’attaques de troupeaux – près de 3 000 bêtes – et le plus de tirs de prélèvement – 14 –, selon un décompte de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DREAL.
Compte tenu de cette particularité, le quota de loups abattables est de 42 jusqu’au 1 er janvier 2018, mais déjà, à l’heure actuelle, 29 loups ont dû être abattus contre 30 à Noël dernier. Ce plafond sera donc vraisemblablement dépassé.
Le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a déclaré qu’il souhaitait rencontrer toutes les parties prenantes après l’été 2017, afin de pouvoir définir une stratégie claire pour les prochaines années.
Mais la situation est urgente, les éleveurs sont inquiets face aux premières propositions du plan Loup 2018-2023, qui ne prend pas en compte leur première préoccupation : mieux protéger leurs troupeaux.
La problématique n’est pas spécifique aux Alpes-Maritimes, d’autres départements sont régulièrement frappés par des attaques, comme la Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Hautes-Alpes, l’Isère et la Drôme.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous poserai trois questions.
Pouvez-vous présenter la méthode que le Gouvernement compte employer pour remettre les éleveurs au cœur du dispositif, pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales ?
Alors même que la première réunion nationale sur le loup organisée le 22 juin 2017 à Lyon n’a pas été très concluante et qu’une première manifestation d’éleveurs s’est déroulée récemment contre les premières mesures proposées dans le plan Loup, le Gouvernement compte-t-il amender son plan d’action et écouter les éleveurs ?
Enfin, les collectivités locales auront-elles un rôle spécifique dans les territoires concernés par ce plan quinquennal ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice, votre question est délicate. Depuis 1992, date du retour naturel du loup en France, la population de loups connaît une augmentation, ce qui pose la question de la cohabitation avec l’élevage et du respect de la biodiversité que représente le loup.
Cette vision d’une cohabitation possible est bien évidemment défendue par Nicolas Hulot, qui suit personnellement ce dossier. Je vous prie d’ailleurs de bien vouloir excuser son absence ce matin. N’ayant pu être présent, il m’a chargé de le représenter.
Quelles actions ont déjà été menées ? Sur ce dossier, nous ne partons pas de zéro. Les différents plans nationaux Loup ont permis la mise en place de mesures indispensables pour financer les moyens de protection des troupeaux, vous l’avez rappelé, indemniser les éleveurs, mais aussi assurer un dialogue entre les différents acteurs.
Dès 2016, et face à l’augmentation de la prédation, vous l’avez également rappelé dans votre question, une démarche prospective a également été lancée pour trouver de nouvelles pistes d’action, à la suite du constat, que nous partageons, de l’insuffisance des dispositifs en place.
Depuis le début du quinquennat, c’est-à-dire depuis seulement quelques mois, des mesures de dérogation à la protection du loup ont été prises pour assurer la défense des troupeaux tout au long de l’année 2017, notamment dans votre département, madame la sénatrice.
Quel est l’objectif visé par le Gouvernement ? Nous voulons aboutir à l’élaboration du prochain plan Loup dès 2018, dont le principal enjeu sera de garantir la viabilité de l’espèce sur le territoire – c’est une nécessité –, tout en contribuant à réduire considérablement la prédation des troupeaux. Cet objectif est bien évidemment partagé par le ministre de l’agriculture et le ministre de la transition écologique.
Quelle est la méthode du Gouvernement ? Nicolas Hulot a décidé de remettre à plat notre politique dans un cadre interministériel, avec des réflexions en cours qui suivent un cap clair.
Premièrement, il faut mener le dialogue – il est indispensable sur un sujet devenu passionnel – avec l’ensemble des parties prenantes, les représentants des éleveurs qu’il faut écouter encore davantage, mais aussi les ONG et les élus locaux. Cela permettra d’entendre le point de vue de chacun, de connaître les difficultés et de trouver des solutions.
Deuxièmement, il convient de garder la vision d’une coexistence entre la présence du loup et le pastoralisme durable que nous devons construire ensemble en opposant moins les uns et les autres.
Enfin, troisièmement, nous avons la conviction, comme vous, que tout n’a pas encore été tenté pour arriver à trouver des solutions.
Quels grands chantiers avons-nous engagés ? Nous travaillons sur plusieurs sujets comme les nouveaux moyens de détection et d’effarouchement des loups. La marge de progression technique est importante sur ce point. Nous œuvrons également sur la résilience du pastoralisme confronté aux prédations. Là aussi, des perspectives d’amélioration sont à noter. Je citerai encore les foyers d’attaque ou l’impact des tirs sur la régulation de la prédation et sur la démographie de l’espèce.
Sachez que, dans le cadre de ce prochain plan, les collectivités territoriales seront appelées à apporter leurs compétences et leurs moyens pour mettre en œuvre plusieurs actions. Je pense notamment à l’accompagnement des éleveurs et à l’amélioration des conditions de vie pastorale. C’est ainsi que l’ont formulé les acteurs locaux lors de déplacements ministériels. Ils souhaitent intervenir dans un esprit de coconstruction à propos du plan Loup 2018. Dans le même état d’esprit que sur d’autres sujets, le Gouvernement les fera participer à la réflexion. C’est le moindre des respects que nous devons aux maires ainsi qu’aux élus consulaires des chambres d’agriculture qui sont confrontés à ces sujets.

Monsieur le secrétaire d’État, j’apprécie votre volonté d’élargir le dialogue et d’associer autour de la table non seulement les éleveurs, les premiers concernés, mais aussi les agriculteurs, les élus locaux et les associations, et ce pour assurer la survie du pastoralisme. Les éleveurs n’en peuvent plus de la pression qu’ils subissent ; ils n’arrivent plus à exercer leur métier en toute sécurité. La pression doit viser aujourd’hui d’abord le prédateur, le loup.
Des mesures que vous avez annoncées ne font pas encore l’unanimité. Je pense en particulier au tir par effarouchement, que les éleveurs ne considèrent pas comme un bon moyen de dissuasion. Ceux-ci souhaiteraient une réflexion autour de la suppression durant une année du quota concernant le nombre de loups à abattre, en fonction de la spécificité des territoires et sous réserve du maintien d’un nombre minimal de loups. À l’issue du délai d’un an pourrait s’appliquer une clause de revoyure.
L’inquiétude grandit dans les Alpes-Maritimes. L’an dernier, le quota de 30 loups a été atteint. Il est aujourd’hui de 42, sachant que 29 loups ont déjà été abattus. On sait donc qu’il sera dépassé. Il serait peut-être intéressant de conduire une expérimentation dans des départements fortement touchés comme celui des Alpes-Maritimes fondée sur l’idée qu’un quota ne s’impose pas, et de faire appel à la sagesse, au dialogue, à la cohabitation nécessaire entre les éleveurs et les défenseurs du loup, tout en ayant le souci d’assurer la survie du pastoralisme dans nos territoires et de l’élevage en plein air comme c’est le cas dans mon département.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, auteur de la question n° 048, adressée à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Quelle est la stratégie du Gouvernement en matière de traitement des déchets ménagers ? Quelles sont les clés de lecture qui permettraient aux collectivités locales de prendre des décisions pertinentes sur le long terme ? Nous nous inscrivons dans le cadre de l’application de la loi dite de transition énergétique. Nous savons que la valorisation matière des déchets doit atteindre 65 % à l’horizon de 2025 et que l’enfouissement des déchets doit être réduit de 50 % à la même échéance.
Les collectivités intègrent la nécessité d’agir à la source en accordant la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets pour parvenir à l’objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets en 2020 par rapport à 2010.
Partout en France, monsieur le secrétaire d’État, des réflexions sont conduites pour adapter les unités de traitement de nos territoires et répondre à nos enjeux. Les investissements à prévoir engagent l’avenir de nos concitoyens qui assument le coût du service de collecte et de traitement des déchets au travers de la taxe ou de la redevance dédiée. Il importe, pour faire les choix technologiques les plus performants, que le Gouvernement donne ses intentions, sa position.
Dans un avis de mars 2017 intitulé Quel avenir pour le traitement des ordures ménagères résiduelles ?, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, semble faire la part belle aux usines d’incinération. Je ne comprends pas, monsieur le secrétaire d’État, que les réticences soient aussi fortes envers les unités de prétraitement des ordures ménagères, alors qu’il s’agit d’installations capables de valoriser de 50 % à 90 % des ordures ménagères entrantes.
Plusieurs opérateurs sont en mesure aujourd’hui de proposer des unités s’appuyant sur les technologies existantes et en prenant partie de produire du combustible solide de récupération, CSR, ou d’utiliser la méthanisation.
Il me semble que l’esprit de la loi de transition énergétique est d’encourager les initiatives innovantes plutôt que de les limiter.

Je vous demande également de nous éclairer sur la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Prévoyez-vous de l’augmenter dans les années à venir ? À quel rythme ? Pouvez-vous nous donner des objectifs chiffrés qui permettront ainsi aux collectivités d’apprécier la conduite à tenir ?
Technologie, innovation, trajectoire financière : quelle est la visibilité pour nous permettre de prendre des décisions pertinentes ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur, deux minutes trente pour la stratégie sur les déchets, c’est court ! Je vais tenter d’être concis et efficace.
Quels sont nos objectifs ? C’est la continuité de la loi que le Parlement a votée sur la transition énergétique, comme la continuité dans la volonté de diminuer nos gaz à effet de serre. Vous savez à quel point la question du recyclage permet d’y parvenir. C’est l’un des axes forts du plan Climat qui a été dévoilé par Nicolas Hulot, vous le savez, au mois de juillet dernier.
Au moment même où nous nous parlons dans cet hémicycle, monsieur le sénateur, Brune Poirson est en train de présenter la méthode qui permettra l’élaboration de la feuille de route sur l’économie circulaire, afin de lancer une grande période de concertation avec l’ensemble des acteurs, y compris les élus locaux très fortement engagés dans les syndicats de traitement des ordures ménagères pour lesquels nous devons avoir le plus grand respect et la plus grande écoute.
Comment allons-nous atteindre les objectifs ? C’est la vraie question, monsieur le sénateur.
Tout d’abord, nous devons beaucoup progresser dans notre pays, vous l’avez dit, en termes de déploiement du tri des déchets. C’est un enjeu majeur. Sur ce sujet, les intentions du Gouvernement sont claires, notamment sur la trajectoire prévue de la TGAP. Conformément à l’engagement du Président de la République pendant sa campagne, nous augmenterons cette taxe collectée sur la mise en décharge et l’incinération d’ici à la fin du quinquennat. C’est là une condition indispensable ! Pour rendre le recyclage plus compétitif que la mise en décharge, il faut créer l’effet de levier.
Nous le savons, il est néanmoins nécessaire que cette évolution soit soutenable pour les entreprises et les collectivités territoriales. Cela signifie deux choses : d’une part, monsieur le sénateur, les augmentations ne doivent pas avoir lieu trop tôt, pour laisser le temps aux investissements, conformément à un devoir de prévisibilité, pour ne prendre personne en otage ; d’autre part, nous devons réfléchir en parallèle aux mesures d’incitation et d’accompagnement aux financements de projets pour les parties prenantes. Brune Poirson souhaite d’ailleurs que le Parlement soit associé à cette réflexion.
Vous m’interpellez également sur les installations de tri mécano-biologique, qui permettent d’extraire la fraction fermentescible des ordures ménagères collectées en mélange.
L’expérience française a montré les limites de ces installations. En effet, les procédés utilisés ne permettent généralement pas la production d’un compost de qualité pure : les composts produits contiennent encore, notamment, des morceaux de plastique. C’est pourquoi la loi privilégie explicitement la mise en place du tri à la source des biodéchets et indique, dans ce cadre, que la création d’installations de tri mécano-biologique est désormais non pertinente et doit être évitée.
Je tiens néanmoins à vous rassurer. L’ADEME, dans son avis technique de mars 2017, que vous citez, ne se montre absolument pas opposée au développement d’installations innovantes, à la seule condition qu’elles soient compatibles avec le déploiement du tri à la source, qui est nécessaire pour assurer un recyclage ou un compostage de qualité.
Ces questions très techniques sont parfois difficiles à expliquer à nos concitoyens et même aux élus locaux. Le Gouvernement est donc preneur de vos conseils, monsieur le sénateur, et note votre souhait d’enrichir la trajectoire de traitement des déchets dans notre pays.

La question posée n’est pas aussi technique que vous voulez bien le dire, monsieur le secrétaire d’État. Les mesures à prendre sur l’ensemble des territoires pour tenir les objectifs nécessitent de mettre en œuvre des investissements à l’échelle d’une génération. On ne peut donc se tromper ni sur les choix financiers ni sur les choix techniques. Nous comprenons bien que le Gouvernement veuille assurer la continuité de l’application de la loi – il n’y a pas de débat sur ce point –, mais pour cela il faut une feuille de route.
Sur la TGAP, vous m’avez indiqué que vous prévoyez son augmentation d’ici à la fin du quinquennat, mais nous avons besoin de savoir quel sera le niveau d’arrivée, à quel rythme se fera l’augmentation… Sans ces éléments, nous ne pouvons pas faire de projections financières.
Vous m’avez également précisé que vous laissez une place à l’innovation. Je me permets d’insister pour qu’elle soit la plus large possible. Cela va au-delà du tri mécano-biologique ; se pose, par exemple, la question de la constitution d’une filière pour le combustible solide recyclable. Le CSR est-il, à vos yeux, une filière d’avenir ? Nous encouragez-vous en ce sens, en complément de l’utilisation de techniques telles que la méthanisation ? Quelle est la part d’innovation que vous nous laissez ?
Vous venez aussi de m’indiquer que le Gouvernement réfléchissait à un accompagnement au projet. Cela signifie des perspectives de subventions. Cela se fera-t-il par la voie de l’ADEME, ou d’une autre manière ? Dans le cadre de ces subventionnements, aurons-nous la liberté des choix technologiques, qui peuvent bien sûr être examinés avec les conseils utiles ? Peut-on combiner financement, subventions et innovation ?
Il vous appartiendra de nous donner ces réponses d’une manière un peu plus précise dans les semaines et les mois qui viennent, faute de quoi nous ne pourrons pas prendre de décisions cohérentes d’investissement.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 062, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Je souhaite appeler l’attention de Mme la ministre chargée des transports sur les nuisances occasionnées pour les riverains par la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Tours-Bordeaux.
Depuis le 2 juillet 2017, date de mise en service de cette ligne, les riverains immédiats mais aussi, parfois, les résidents de villages distants de la ligne ressentent les nuisances sonores ou vibratoires occasionnées par le passage des TGV. De l’avis général, ces bruits et vibrations ne sont nullement comparables à ceux qui ont été ressentis lors des essais en amont.
Le concessionnaire de la ligne, LISEA, s’est engagé à réaliser un suivi acoustique tant à l’échelle de l’ensemble de la ligne que sur les sites les plus sensibles, conformément aux normes en vigueur pour une telle situation, en particulier l’arrêté du 8 novembre 1999. La réglementation prévoit que les mesures réalisées prennent en considération le niveau sonore moyen sur deux périodes de référence. Les pics de bruit, qui sont en réalité ce qui affecte le plus les riverains, ne comptent pas aujourd’hui parmi les mesures retenues.
LISEA a également indiqué privilégier, dans sa sélection des sites de suivi, ceux qui sont situés à moins de 100 mètres de la ligne à grande vitesse. Les élus et les habitants des communes impactées demandent en revanche que des mesures soient effectuées dans des lieux situés au-delà de cette limite, notamment les hôpitaux, les écoles et les sites qui accueillent un public sensible, afin d’y prendre en considération les pics de bruit répétés au cours de la journée.
Ces deux points révèlent que le respect de la réglementation en vigueur, sur laquelle LISEA entend se fonder pour réaliser les infrastructures de protection acoustique des riverains, risque de ne pas suffire pour protéger pleinement ceux-ci des nuisances. J’entends dès lors interroger par votre intermédiaire, monsieur le secrétaire d'État, Mme la ministre chargée des transports quant aux possibilités, d’une part, de prendre des mesures de protection complémentaires à celles existant aujourd’hui et, d’autre part, de faire évoluer la réglementation applicable afin d’apporter une meilleure réponse aux préoccupations des riverains de la LGV Tours-Bordeaux.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice, tout d’abord, je tiens à excuser l’absence de Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports. Je m’efforcerai de porter devant vous la voix du Gouvernement et de vous rassurer.
Il me faut tout de même acter dès à présent que cette ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux a permis, depuis le 2 juillet dernier, une nette amélioration de la desserte ferroviaire du grand Sud-Ouest et qu’elle était attendue par bon nombre de nos concitoyens depuis très longtemps. Dans le même temps, comme vous l’avez rappelé, c’est aussi un sujet de préoccupation majeur pour les riverains de la nouvelle infrastructure, qui s’inquiètent des nuisances sonores occasionnées.
Le Gouvernement a pleinement conscience de ce problème. Nous avons été saisis directement par des associations d’élus et des parlementaires ; vous le faites encore ce matin, madame la sénatrice.
Quel est le cadre prévu pour ces nuisances sonores ? Les impacts sonores des nouvelles infrastructures de transport sont strictement encadrés par la réglementation. Je veux ici vous confirmer que le concessionnaire, LISEA, devra scrupuleusement respecter les niveaux maximums autorisés. Dans ce domaine, le gestionnaire d’infrastructure a en effet une obligation de résultat, et non pas seulement une obligation de moyen.
Quelles actions sont et seront menées ? Une vaste campagne de mesures acoustiques, sur site, pilotée par le CEREMA, est en cours pour s’assurer du bon respect de ces normes. Il faut savoir de quoi on parle et avoir un instrument de mesure.
Les résultats sont attendus au début de l’année 2018 et seront accessibles aux parlementaires qui s’intéressent à la question. Si des manquements, graves ou relatifs, devaient être relevés, nous imposerons au concessionnaire de mettre en place, à ses frais, les mesures correctrices qui s’imposeront, et ce dans les plus brefs délais.
Mme la ministre chargée des transports a demandé aux services de l’État tant centraux que déconcentrés d’être très attentifs au bon respect de ces dispositions. Je vous invite d’ailleurs, madame la sénatrice, à joindre vos efforts aux nôtres pour vous assurer de ce suivi.
La réglementation doit-elle évoluer ? Tel est aussi, bien évidemment, en creux, votre question. Il existe un débat récurrent – je le connais bien en tant qu’élu local normand – sur la manière dont sont pris en compte les pics sonores en fonction du lieu où les mesures sont faites et de la circulation des trains.
L’objectif du Gouvernement n’est pas de se lancer, en début de quinquennat, dans un débat d’experts ; il s’agit plutôt de répondre rapidement au ressenti des populations et des élus locaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a demandé aux préfets concernés d’organiser des comités de suivi, qui associent la population, pour veiller au respect de la réglementation par LISEA, mais surtout pour recenser les difficultés apparues et les faire remonter au ministère, ce qui nous permettra d’avoir un dialogue opérationnel et concret avec le concessionnaire.
Quels outils peuvent être mobilisés ? Il faudra examiner avec toutes les parties prenantes les réponses qui peuvent être apportées. Sachez en tout cas que le Gouvernement est déjà favorable à ce que le Fonds de solidarité territoriale de la LGV Sud-Europe-Atlantique soit mobilisé pour toute action visant à améliorer l’insertion environnementale de la nouvelle infrastructure en dehors de l’emprise ferroviaire et au-delà des obligations réglementaires qui s’imposent.
Nous sommes précisément dans ce cas. L’utilisation de ce fonds pourrait donc être activée si des situations particulières étaient détectées et étaient portées par les préfets ou par vous-même à notre connaissance. Dans ce cas, et sous la présidence du préfet coordinateur, un financement pourrait être mis en place. Mme Élisabeth Borne aura en tout cas à cœur de réunir les collectivités territoriales concernées dès le début de l’année 2018, partant du résultat des mesures pour prescrire, éventuellement, un certain nombre de travaux indispensables. Nous sommes mobilisés sur ce sujet.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Je sais que Mme Borne est soucieuse de cette question et que le Gouvernement essaie d’apporter des réponses. Pour ma part, tout comme pour les riverains, il n’y a pas cinquante solutions, il n’y en a que deux.
La première serait de changer le matériel roulant, pour que ne circulent sur cette ligne que des TGV neufs. Ce sont d’ailleurs ces rames neuves qui roulent entre Paris et Bordeaux et qui ont été utilisées par LISEA dans le cadre des prémesures acoustiques avant l’ouverture de la ligne. Or c’est du matériel ancien qui roule sur la ligne entre Tours et Angoulême, par exemple, et ce sont ces rames, poussées à 300 kilomètres à l’heure, qui occasionnent un bruit effroyable. Ce matériel sera probablement changé, mais dans cinq ans peut-être ; en attendant, c’est lui qui fait du bruit.
La deuxième solution serait de modifier le seuil retenu par la réglementation en la matière. Vous m’expliquez que c’est compliqué, qu’il s’agit d’un débat d’experts. Il n’en reste pas moins que, dans les mesures acoustiques, les pics de bruit ne sont pas retenus ; comme vous le savez, on ne mesure que la moyenne entre les pics et les silences. Or ce ne sont évidemment pas les silences qui posent problème aux riverains ; ce sont les pics ! Il est nécessaire de faire entrer ces derniers dans la réglementation.
Vous avez par ailleurs évoqué l’utilisation du FST, le Fonds de solidarité territoriale, pour les travaux qu’il faudrait imposer au concessionnaire. J’imagine que les élus qui nous écoutent en ce moment vont bondir. En effet, le Fonds de solidarité territoriale vise à offrir aux communes et autres collectivités traversées par la LGV un dédommagement de tous les préjudices qu’ils ont subis pour la construction de la ligne. Si ce fonds est utilisé pour ces travaux, les communes ne pourront donc pas bénéficier des crédits qui leur ont été octroyés.
Je veux bien, à l’évidence, travailler avec le Gouvernement sur ces sujets prégnants. J’ai pu, dans mon département, me rendre chez des riverains de la LGV et constater que le passage de ces TGV engendre un degré de nuisances sonores qui dépasse l’entendement. Je compte donc sur le Gouvernement pour améliorer la situation et faire en sorte que les riverains puissent être satisfaits dans les meilleurs délais.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 072, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Lors de l’examen par notre assemblée, voilà quelques années, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord franco-espagnol pour la réalisation de la ligne à grande vitesse transpyrénéenne Perpignan-Figueras, j’avais beaucoup insisté, en ma qualité de rapporteur, sur l’urgence qui s’attachait à réaliser concomitamment le tronçon Montpellier-Perpignan. Les années ont passé, la section internationale Perpignan-Figueras a bien été réalisée, mais la LGV Montpellier-Perpignan est restée au point mort de longues années durant, alors même que la mission Querrien, en 1990, avait annoncé sa réalisation dans les dix années suivantes.
Plus récemment, et fort heureusement, les ministres des transports des précédents gouvernements avaient rassuré élus, populations et acteurs économiques quant à la volonté de l’État de réaliser cette ligne à grande vitesse. L’un des prédécesseurs de Mme Borne avait posé les perspectives suivantes : approbation du tracé à la fin de l’année 2015, réalisation d’une enquête publique à la fin de 2016, puis, en 2018, la déclaration d’utilité publique et, enfin, un chantier d’une durée de quatre à cinq ans. Tout cela avait été précisé à Mme Marie-Hélène Fabre, alors députée de Narbonne.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Ce projet fait-il encore partie des priorités de ce gouvernement ? Par ailleurs, quelles suites le Gouvernement entend-il réserver au projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne ?
Je rappelle que le projet de LGV Montpellier-Perpignan représente non seulement un atout économique majeur pour l’essor et le développement de nos territoires, mais également un enjeu en matière de mobilité et de développement durable.
La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan et l’axe Bordeaux-Toulouse-Narbonne doivent offrir des liaisons structurantes entre les trois métropoles régionales que sont Montpellier, Barcelone et Toulouse. L’enjeu est non seulement local, régional et national, mais aussi européen. La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan constitue un véritable maillon stratégique sur le plus grand des axes de lignes à grande vitesse européennes. Le statut international de la ligne a été reconnu et il a été admis que son utilité et ses enjeux dépassaient largement ceux du seul tronçon considéré. Cette liaison rapide avec Barcelone et toute la Catalogne constitue un véritable levier économique pour l’eurorégion.
La LGV Montpellier-Perpignan permettrait de garantir tant la continuité des réseaux à grande vitesse entre la France et l’Espagne que les énormes investissements déjà réalisés. Enfin, dois-je rappeler l’union sacrée des collectivités autour non seulement de ces deux projets de ligne à grande vitesse, mais aussi des modalités de desserte des agglomérations, dont la gare de Narbonne-Montredon. Allez-vous me rassurer, monsieur le secrétaire d'État ? Allez-vous dissiper mes craintes ? Quelles sont les véritables intentions du Gouvernement sur ces deux dossiers majeurs ?

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur, la grande question, on le sait bien, est la suivante : comment financer ces grands projets au vu de l’état des finances publiques, que vous connaissez et que je découvre en tant que jeune membre du Gouvernement ?
La LGV Montpellier-Perpignan requiert un investissement d’un montant de 5, 5 milliards d’euros, dont 1, 9 milliard d’euros pour une première phase Montpellier-Béziers, qui devait faire l’objet d’une mise à l’enquête publique en 2018, ce que je vous confirme. La liaison Bordeaux-Toulouse-Narbonne, qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2016, représente quant à elle un investissement de 5, 9 milliards d’euros.
Ces deux projets nécessiteraient donc un investissement total d’au moins 10 milliards d’euros, qui devra être supporté exclusivement par la puissance publique. En effet, je le rappelle, la « règle d’or » empêche désormais SNCF Réseau de financer les nouveaux projets par sa dette, qui s’élèvera en 2018 à la modique somme de 50 milliards d’euros.
Quelle est la position du Gouvernement sur ces projets ? Le Gouvernement est absolument conscient des fortes attentes des élus et des territoires d’Occitanie sur ces deux projets ferroviaires. Qu’il n’y ait pas de doute sur ce point ! Néanmoins, face à l’impasse de financement à laquelle nous sommes confrontés, le Gouvernement a annoncé, le 1er juillet dernier, une pause de tous les grands projets d’infrastructures de transport.
Mme la ministre chargée des transports, dont j’excuse à nouveau l’absence devant vous, a toujours eu une position claire sur le futur des mobilités : il faut reconstruire nos modes de pensée mais aussi nos solutions. C’est tout le sens de cette pause de travail. Je tiens à vous rassurer : il ne s’agit pas de confondre pause et remise en cause des projets, comme je peux parfois le lire dans la presse quotidienne régionale.
Comment s’y prendre ? Il faut rechercher, d’abord, toutes les optimisations des réseaux existants qui peuvent redonner de la régularité et de la capacité à nos services de transports. C’est une nécessité que nos concitoyens attendent au quotidien.
L’objectif, dans le même temps, est non pas d’abandonner les grands projets structurants pour les territoires, mais bien de les inscrire dans un calendrier réaliste, après avoir mobilisé toutes les optimisations possibles des lignes classiques. Je le dis pour les deux projets dont vous faites état, monsieur le sénateur, mais vous comprendrez que mon propos concerne l’ensemble des projets d’infrastructures que notre pays peut connaître.
Quelle est la prochaine étape ? Les Assises de la mobilité et les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures ont été lancés avec un objectif simple : permettre la construction d’une trajectoire pluriannuelle de financement des infrastructures de transport afin de créer de la visibilité et de la prévisibilité. Cette trajectoire devra être équilibrée entre recettes et dépenses, elle devra être réaliste et, permettez-moi de le dire, elle devra être sincère. En effet, si ces projets ont pris beaucoup de retard, c’est parce que nous avons parfois manqué, dans le passé, de sincérité budgétaire.
Les conclusions de cette démarche feront l’objet d’un projet de loi d’orientation, qui sera présenté au Parlement au premier trimestre de 2018. C’est dans ce cadre que le Gouvernement souhaite la poursuite des réflexions autour des grands projets d’infrastructure de transport, en Occitanie comme dans le reste de la France. J’espère, monsieur le sénateur, que je vous aurai ainsi rassuré.

Voilà un interminable feuilleton ! Comprenez, monsieur le secrétaire d’État, notre lassitude et notre irritation face aux tergiversations des pouvoirs publics depuis des décennies.
Dois-je rappeler que la volonté de favoriser les échanges entre la France et l’Espagne s’est manifestée, en 1992, lors du sommet franco-espagnol d’Albi ? Elle a été réaffirmée lors du sommet de Tolède en 1993. Les deux gouvernements ont décidé la réalisation d’une ligne à grande vitesse à écartement international de Montpellier à Narbonne et Barcelone. Le sommet franco-espagnol de Foix, en 1994, a défini le tronçon de la liaison Paris-Madrid par Montpellier et Barcelone, qui irait de Barcelone à Narbonne, point d’où les futures lignes se dirigeraient vers Montpellier, Paris et Toulouse. Ce tronçon devait, en principe, être mis en service au cours de la période 2002-2005.
Or, aujourd’hui, vingt-sept ans après la mission Querrien, les pouvoirs publics en sont encore à s’interroger, alors que le tronçon Montpellier-Perpignan constitue, sur l’axe reliant l’Europe du Nord au sud de l’Espagne, le seul maillon manquant. Voilà qui explique, monsieur le secrétaire d’État, notre exaspération.

La parole est à M. Pierre Laurent, auteur de la question n° 064, transmise à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Ma question porte sur la réalisation de la liaison privée « Charles-de-Gaulle Express ».
Au moment même où le Gouvernement fait planer le doute quant à la réalisation pleine et entière du futur réseau Grand Paris Express, dont plusieurs lignes sont remises en cause, il fait preuve d’une obstination qui confine à l’absurde concernant le projet CDG Express. Il me faut d’abord faire remarquer que cette liaison privée aura pour l’usager un coût : le titre de transport est estimé aujourd’hui entre 27 et 29 euros et la tarification du STIF ne s’y appliquera pas.
Les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette ligne privée reposent entièrement sur des deniers publics, car la société de projet est abondée en fonds propres par la SNCF et Aéroports de Paris. De source interne à SNCF Réseau, le coût global de ce projet est estimé aujourd’hui à 2, 12 milliards d’euros. Pour autant, le CDG Express ne desservirait ni les arrondissements parisiens ni les villes de la banlieue parisienne qu’il traverserait. Nul site olympique ne serait non plus desservi. Ce sont les lignes B et D du RER, impactées négativement par ce projet s’il était réalisé, et la future ligne 17 du Grand Paris Express qui desserviront ces sites. En effet, le CDG Express utiliserait en grande partie le réseau ferré existant, alors que celui-ci est déjà saturé, ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences dramatiques pour les usagers des lignes B, E, H, K et P, pour ceux du TER Picardie et pour le fret.
D’un point de vue environnemental – le secrétaire d’État à la transition écologique devrait être sensible à cet argument –, le CDG Express serait également néfaste. Cela est clair au vu des procédures d’expulsion d’extrême urgence qui concernent 29 hectares de terres agricoles sur le territoire de Mitry-Mory, du passage de nouveaux tronçons au cœur d’une zone Natura 2000 ou encore de la dégradation de l’environnement urbain des habitants de la porte de la Chapelle à Paris, dont on connaît déjà l’état actuel et où le train passera 152 fois par jour sous les fenêtres des riverains.
Le STIF estime à 1, 5 milliard d’euros le déficit de recettes lié à la perte de ponctualité sur la ligne B du RER, qui transporte chaque jour 900 000 passagers, alors qu’on en prévoit à peine 20 000 sur le CDG Express. Et l’impact financier sur les autres lignes reste à établir !
On le voit, le CDG Express est en exacte opposition à la priorité aux transports quotidiens affichée par le Président de la République. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le dire. Pas un seul des organismes compétents consultés au sujet du CDG Express – STIF, Autorité environnementale, ARAFER, Cour des comptes et d’autres – n’a manqué de souligner son impact négatif pour les transports du quotidien. Pas un seul n’a manqué de sommer le gestionnaire de fournir des garanties solides sur le sujet. À ce jour, aucune réponse nette et précise n’existe quant à ces questions primordiales.
Monsieur le secrétaire d’État, en un mot comme en cent, ce projet reste inutile et coûteux. Il ne manquera pas d’avoir des conséquences désastreuses sur le transport quotidien des Franciliens. Il faut avoir le courage de l’abandonner. C’est l’engagement que j’attends de votre réponse.

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur, je ne vais pas vous surprendre : le Gouvernement ne partage pas votre point de vue. Je doute de pouvoir vous convaincre, mais je vais tenter d’apaiser vos craintes.
La qualité de cette liaison ferroviaire est vitale pour l’économie et pour l’attractivité de notre pays et de sa capitale, Paris, dont vous êtes sénateur et qui est la première destination touristique d’Europe. La nécessité de cette infrastructure nouvelle est donc établie pour le Gouvernement. Avec une croissance moyenne du trafic de l’aéroport de 3 % par an, soit un doublement en vingt ans, l’accès à l’aéroport par les autoroutes A1 et A3 est déjà saturé et le RER B ne pourra jamais suffire. Plusieurs raisons justifient clairement et de manière rationnelle ce projet.
Sur l’aspect du transfert modal, ce projet permet d’opérer un transfert de la route vers le fer pour l’accès à l’aéroport, ce qui aura un impact direct sur la pollution de l’air et le changement climatique en décongestionnant les voies rapides du nord de la région parisienne, qui en ont bien besoin.
Par ailleurs, quant au confort des voyageurs, dans le RER, les voyageurs avec leurs bagages et les voyageurs du quotidien se gênent mutuellement. Il y a une forme de conflit d’usage, comme disent les techniciens des questions de transport. Cela est vrai, notamment, à chaque arrêt avec les nombreuses montées et descentes. Le CDG Express permettra donc d’apporter un gain de confort pour tout un chacun.
Où en sommes-nous sur ce projet ? Il a été déclaré d’utilité publique, une seconde fois, en mars 2017 après un avis favorable de la commission d’enquête. Sa construction sera réalisée dans le cadre d’un montage juridique associant SNCF Réseau, Aéroports de Paris et la Caisse des dépôts et consignations. Je tiens, monsieur le sénateur, à vous préciser que le projet sera réalisé sans subventions publiques. Il ne pèsera donc pas sur les financements nécessaires à la modernisation du RER B, puisqu’il sera entièrement financé par la vente de billets sur cette liaison, donc par l’usager, et par une taxe affectée dont s’acquitteront, à partir de 2024, les passagers aériens, hors correspondances, de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Il n’y a donc pas lieu d’opposer le projet Charles-de-Gaulle Express à la modernisation de la ligne B du RER, qui se poursuit et qui contribue d’ailleurs au projet lui-même à hauteur de 150 millions d’euros. Je tiens à vous rassurer sur ce point, puisque j’ai entendu le début de votre question : l’État et la région Île-de-France se sont engagés en faveur des transports du quotidien dans le cadre du nouveau contrat de plan 2015-2020. Une enveloppe totale de 7, 5 milliards d’euros est prévue pour les projets de transports collectifs régionaux, dont près de 1, 3 milliard d’euros pour les schémas directeurs des RER ; 230 millions d’euros ont d’ailleurs déjà été engagés, depuis 2015, pour le seul RER B.
Enfin, et toujours au profit des voyageurs du quotidien, il faut bien entendu mentionner la réalisation du Grand Paris Express, dont les travaux sont lancés au sud de Paris et qui viendra soulager les lignes existantes. Je doute de vous avoir convaincu, monsieur le sénateur, mais j’espère au moins vous avoir apaisé.

Je vous ai écouté attentivement, monsieur le secrétaire d’État, mais vous ne m’avez en effet absolument pas convaincu et je n’ai rien entendu qui puisse me rassurer ou convaincre des acteurs attachés à la transition écologique. Ce projet est un non-sens de ce point de vue. Il causera des nuisances extraordinaires, il sera déséquilibré et l’investissement réalisé est démesuré et contraire à l’intérêt général.
J’y insiste, ce projet reste une insulte – je pèse mes mots – à la dignité des habitants de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du nord de Paris, qui verront cette ligne passer sous leurs yeux sans pouvoir y accéder. C’est même le cas des salariés très nombreux – plusieurs dizaines de milliers – de la plateforme aéroportuaire. Il est temps d’arrêter ce type d’aménagement qui ne bénéficie qu’à un très petit nombre d’usagers au détriment de l’immense majorité de ceux qui ont besoin d’une amélioration des transports.
Il faut un autre projet : donner les moyens d’une forte accélération des investissements pour les lignes de RER et, plus particulièrement, pour la ligne B, qui dessert notamment l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ces investissements pourraient être financés via la création d’une recette dédiée, comme une augmentation de la taxe locale sur les bureaux, que nous proposons.
Par ailleurs, l’une des solutions efficaces et à court terme qui permettrait de désengorger le réseau et, notamment, la ligne B serait d’augmenter la fréquence de la ligne K, ce qui requiert des moyens. Dans le même esprit, il faudrait installer un véritable atelier de maintenance du matériel roulant à Mitry-Mory.
À plus long terme, il faudrait doubler le tunnel entre les stations Châtelet et Gare du Nord, ce qui permettrait d’absorber deux fois plus de trafic pour les RER B et D, et réaliser le bouclage du RER B entre Mitry-Claye et l’aéroport. Voilà un investissement beaucoup plus efficace ! Investir dans du matériel roulant neuf, comme cela a été fait sur d’autres lignes, ne serait sans doute pas de trop.
Je vous encourage donc une nouvelle fois à suivre ces pistes plutôt que de vous entêter dans un projet contraire à l’intérêt général du point de vue tant financier qu’écologique. Vous nous avez dit que les deniers publics ne seraient pas utilisés, mais, quand la ligne sera déficitaire – tout le monde sait qu’elle le sera –, à qui demandera-t-on alors d’éponger le déficit ? Aux deniers publics et aux usagers !

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.