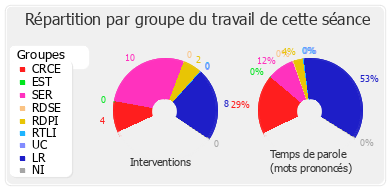Séance en hémicycle du 22 décembre 2005 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

J'ai reçu de M. le Premier ministre, le rapport annuel 2004-2005 de l'Observatoire de l'emploi public, établi en application de l'article premier du décret n° 2000-663 du 13 juillet 2000 portant création de l'Observatoire de l'emploi public.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des lois et à la commission des finances.

L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de l'ensemble des présidents de commission permanente, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission d'information commune est autorisée.
Conformément aux propositions de désignations présentées par les commissions permanentes, les sénateurs membres de cette mission sont : MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, José Balarello, Gilbert Barbier, Mme Marie-France Beaufils, M. Dominique Braye, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cambon, Philippe Dallier, Yves Dauge, Christian Demuynck, Alain Dufaut, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Michel Houel, Serge Lagauche, Mmes Valérie Létard, Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jacques Mahéas, Mme Catherine Morin Desailly, MM. Roland Muzeau, Hugues Portelli, Thierry Repentin, Philippe Richert, Louis Souvet, Alex Türk, André Vallet et Mme Dominique Voynet.

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 141).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports est parvenue à un accord.
Je veux tout d'abord me féliciter du climat dans lequel nous avons travaillé, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je pense en particulier aux excellentes relations que j'ai entretenues avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Dominique Le Mèner. Notre concertation a été étroite et a permis d'aboutir aux ultimes rapprochements qui conditionnaient le succès de cette commission mixte paritaire.
Je me plais également à souligner, monsieur le ministre, les très bons contacts que nous avons eus avec vos collaborateurs.
J'ai le sentiment que cette nouvelle loi permettra des avancées importantes dans les différents secteurs concernés par les dispositions qu'elle prévoit.
Sur le volet aérien, ce texte conforte les pouvoirs de contrôle du ministre sur les aéronefs étrangers et améliore la protection de la confidentialité s'agissant des informations liées aux accidents et incidents aériens. Un règlement communautaire devrait prochainement être adopté, nous le savons, à propos de l'information des passagers.
Sur le volet maritime, nous avons obtenu un renforcement des garanties sociales offertes aux marins tout en améliorant la sécurité maritime en donnant au système français de données ÉQUASIS un statut qui devrait encore accroître son rôle international.
Dans le domaine ferroviaire, la commission mixte paritaire a adopté la disposition traduisant, dans notre droit, la mise en place progressive d'un marché ferroviaire européen intégré.
Elle a approuvé le recours au partenariat public-privé pour relancer les initiatives de développement de nos infrastructures ferroviaires.
Elle a assoupli, dans un souci d'efficacité, la législation relative à la maîtrise d'ouvrage pour accélérer le démarrage de grands projets de transports collectifs, telle la future ligne ferroviaire CDG Express entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Sur le volet routier, trois sujets restaient en discussion. Nous sommes finalement tombés d'accord sur la nécessité de relancer une concertation sur la disposition qui permettait au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, d'attribuer, dans des conditions dérogatoires au droit commun, des fréquences aux radios d'information routière.
Le Sénat a pu faire prévaloir ses vues sur un sujet qui lui tenait à coeur, à savoir l'application des règles de la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, comme l'inscription au registre des transports à l'ensemble des entreprises de transport routier de marchandises ou de personnes, y compris celles qui utilisent exclusivement des véhicules motorisés à deux-roues. Il y avait là une question d'équité, d'égalité devant la loi et de concurrence loyale qui m'a paru fondamentale.
S'agissant de la taxe qui sera prélevée, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur les poids lourds en Alsace, j'estime que le texte finalement retenu par la commission mixte paritaire améliore sensiblement le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
À propos du syndicat des transports parisiens et de la région d'Île-de-France, le STIF, la commission mixte paritaire a retenu la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à poser une règle de majorité qualifiée pour les décisions financières les plus importantes, sauf en cas d'urgence. En revanche, elle a jugé qu'il revenait aux élus du conseil d'administration de cet organisme de prendre toutes leurs responsabilités quant aux modalités de son fonctionnement futur.
Au total, les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire apportent des solutions qui me semblent justes et équilibrées au regard des différents problèmes qui nous ont été posés.
N'oublions pas que le projet de loi permet, en outre, de nous mettre en conformité, sur bien des points, avec les règles du droit communautaire, conformément aux engagements de la France.
Pour toutes ces raisons, je propose au Sénat d'adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, que vous avez adopté en première lecture le 19 octobre dernier, est de nouveau à l'ordre du jour de votre assemblée, après qu'il a été examiné par l'Assemblée nationale les 13 et 14 décembre derniers, puis en commission mixte paritaire le 20 décembre.
Ce projet de loi, qui couvre l'ensemble des domaines du transport, permet la mise en conformité du droit national avec certains engagements communautaires et internationaux souscrits par la France dans ces domaines.
Il comporte, en outre, d'importantes dispositions relatives aux transports et à leur développement. Plusieurs d'entre elles ont une portée particulièrement significative.
Dans le domaine de la sécurité des transports, il s'agit, d'abord, de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire, dont les tâches d'instruction de dossiers et de contrôle de la réglementation seront essentiellement techniques. Il va de soi que l'État conservera la responsabilité de la sécurité des transports ferroviaires, notamment en édictant la réglementation.
Il s'agit également de l'introduction dans notre droit des contrôles SAFA en matière aéronautique et de l'obligation faite aux personnes publiques et privées qui exercent leurs fonctions dans l'aviation civile de rendre compte de tout accident ou incident dont elles auraient connaissance.
Il s'agit aussi de la mise en place de sanctions adaptées pour mettre un terme au phénomène dit du « débridage » des deux-roues et des quadricycles à moteur, qui est à l'origine d'un certain nombre d'accidents graves.
Il s'agit, enfin, de dispositions importantes relatives à la sécurité maritime. Le texte prévoit ainsi la possibilité de créer des groupements d'intérêt public, qui sont des structures juridiques adaptées aux missions internationales de service public. Il institue aussi une réglementation de l'enseignement de la conduite des bateaux de plaisance à moteur, qui était très attendue par les professionnels et par l'ensemble du milieu de la plaisance.
Dans le domaine du développement des transports, il s'agit de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du marché du fret ferroviaire, à travers la transposition des dispositions dites du « deuxième paquet ferroviaire ».
Il s'agit également du recours au partenariat public-privé pour la réalisation d'infrastructures ferroviaires et fluviales. Cette évolution s'inscrit dans l'orientation voulue par le Gouvernement vers une politique dynamique et modernisée des investissements au service de l'emploi et de la croissance.
Cette ouverture se fera dans le respect des principes actuels de gestion du réseau ferré national et des compétences de la SNCF en matière, d'une part, de gestion du trafic et des circulations, d'autre part, du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité. Sont également précisées les modalités de pilotage par l'État de la mise en oeuvre de la liaison d'intérêt national Charles-de-Gaulle Express.
Il s'agit, en outre, de dispositions favorables aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport fluvial, lesquels sont aujourd'hui confrontés à un contexte économique difficile, notamment à la suite de la forte hausse du prix du carburant.
Dans ce chapitre relatif aux transports routiers, un article instituant une taxe, à titre expérimental en Alsace, pour les véhicules utilitaires de plus de douze tonnes utilisant certaines voies, a été introduit malgré les réserves et les interrogations dont j'avais fait part à l'Assemblée nationale.
Ce dispositif sera notifié à la Commission européenne, comme le prévoit la directive du 17 juin 1999.
Je sais l'impatience des Alsaciens confrontés à une circulation très intense de poids lourds et je la comprends parfaitement. Toutefois, je tiens à vous confirmer les difficultés juridiques qui ne manqueront pas de se poser et nous serons confrontés à la complexité de ce dossier au moment de la rédaction du décret en Conseil d'État nécessaire à sa mise en oeuvre. Nous le ferons en pleine concertation avec tous les partenaires concernés par ce sujet, ce qui est très important.
Dans le domaine social, il s'agit de différentes mesures applicables aux transports routier et maritime, notamment pour les gens de mer. Les dispositions prévues sont très positives avec la mise en oeuvre des conventions maritimes de l'Organisation internationale du travail, l'OIT.
Pour conclure, je tiens à remercier tous les sénateurs qui ont pris part de manière constructive aux débats.
Ces remerciements vont tout particulièrement au rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Revet, dont le travail de fond important et intéressant a permis l'amélioration et l'enrichissement du texte dès sa première lecture par votre assemblée. Ils vont également au président de cette commission, M. Emorine, qui a suivi de très près les débats, ainsi qu'à la commission mixte paritaire, qui a travaillé sur ce texte techniquement complexe, dans des délais extrêmement serrés et je me félicite tout particulièrement de la réussite de ses travaux.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le ministre, je vous remercie des aimables compliments que vous avez adressés au Sénat, en particulier à la commission des affaires économiques, à son président et à son rapporteur, qui ont fait un excellent travail.
Jules Ferry, dont nous sommes les disciples aujourd'hui, disait que le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite.
La parole est à M. Michel Billout.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais apporter un avis légèrement différent de ceux qui viennent d'être exprimés, cela ne vous étonnera pas.
Une nouvelle fois, le Gouvernement fait adopter dans l'urgence un texte de loi aux conséquences multiples et importantes.
Les sénateurs avaient déjà eu très peu de temps pour étudier ce projet de loi, puisqu'il avait été adopté le 5 novembre par le Conseil des ministres et qu'il avait été examiné par la Haute Assemblée seulement deux semaines plus tard.
Les députés ont disposé d'un peu plus de temps, mais certains amendements importants n'ont même pas fait l'objet d'un examen par la commission des affaires économiques.
Je pense notamment aux amendements de M. Devedjian. Pourtant, ces amendements risquent d'entraver durablement le bon fonctionnement du Syndicat des transports d'Île-de-France.
Ainsi, un premier amendement implique que toute décision, lorsqu'elle fait progresser les contributions d'autres collectivités que la région à plus de deux points au-dessus du taux moyen d'évolution des tarifs, doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
Tout développement sérieux de l'offre de transport, toute politique tarifaire sociale deviendra donc impossible à mettre en oeuvre sans l'aval du président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui préside également l'UMP, et dont on connaît la volonté de s'attaquer aux services publics, au nom de la modernité
Ainsi, cette disposition revient sur le principe même de solidarité territoriale en permettant que les départements riches et bien dotés puissent refuser de contribuer au développement de l'offre de transport envers les départements les plus défavorisés en matière d'infrastructures et de matériels.
Dans ce même amendement, M. Devedjian demandait également le maintien de l'ancien conseil d'administration du STIF tant qu'un nouveau conseil d'administration ne sera pas en place. Cette partie de l'amendement particulièrement provocatrice n'a heureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire.
Comme si cela ne suffisait pas, un deuxième amendement du même député a été adopté et maintenu par la commission mixte paritaire.
Cet amendement permet à l'État de reprendre la responsabilité du projet Charles-de-Gaulle Express, alors même que ce projet devrait être sous la responsabilité du STIF, comme autorité organisatrice des transports de la région. Comment peut-on proposer et voter un amendement qui détourne à ce point la procédure législative pour satisfaire des considérations particulières, sans aucun rapport avec le projet de loi débattu ?
Ainsi, la discussion de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, loin du travail parlementaire traditionnel qui est d'améliorer les dispositions du projet de loi, a permis un règlement de compte avec la majorité du conseil régional.

De plus, ces amendements reviennent sur les principes même de la décentralisation en privant la région de la responsabilité des transports franciliens. Il s'agit d'un grave déni de démocratie.
En adoptant ces nouvelles mesures, le Parlement ne respecte pas le vote des électeurs de la région d'Île-de-France, qui ont porté une majorité de gauche au sein de l'exécutif régional. La majorité sénatoriale ne s'honore pas en soutenant de telles manoeuvres politiciennes.
Parallèlement, le Gouvernement s'est également servi de cette lecture devant l'Assemblée nationale pour faire ratifier par amendement la simplification de la procédure de déclassement des biens de Réseau ferré de France, RFF.
Cette simplification va, en réalité, permettre à RFF de déclasser, puis de céder plus rapidement, des terrains pour alimenter son budget, afin de faire face au désengagement de l'État dans le secteur des transports.
Déjà devant le Sénat, le Gouvernement, par voie d'amendement, avait permis la ratification d'une ordonnance fondamentale dans le domaine du transport aérien, qui entérinait un transfert de responsabilité de l'État sur les exploitants d'aérodromes pour la mise en oeuvre des missions de sûreté.
Or, la prévention des actes de terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité du territoire représentent des missions éminemment régaliennes dont la responsabilité doit rester à l'État.
Dans le secteur aérien, comme dans d'autres domaines, les objectifs sont les mêmes. Il s'agit pour l'État de se décharger de ses missions régaliennes, en faisant appel soit aux collectivités territoriales, soit à l'initiative privée.
Les conditions dans lesquelles se fait le travail parlementaire sont inacceptables. La déclaration de l'urgence sur les textes, le fait que la commission saisie au fond n'ait pas examiné ces amendements, la ratification des ordonnances par simple amendement du Gouvernement semblent devenir les instruments privilégiés de celui-ci pour diriger le travail parlementaire.
On revient de cette manière sur les fondements du pacte républicain et sur les principes mêmes de souveraineté nationale.
Mais venons-en au contenu de ce projet de loi.
Nous persistons à dire que, loin de permettre le développement des transports et d'assurer une meilleure sécurité, ce texte risque d'accroître l'insécurité des transports en soumettant ce secteur aux impératifs du marché, en déréglementant le droit des salariés, en faisant fi des impératifs de préservation de l'environnement et de développement durable.
La première mesure de ce texte correspond à la transposition en droit interne du deuxième paquet ferroviaire entérinant l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire international le 1er janvier prochain et du fret national le 31 mars prochain.
Je tiens à rappeler que les parlementaires communistes réclament depuis de nombreuses années un moratoire sur les effets économiques et sociaux de la libéralisation des secteurs publics, notamment des secteurs ferroviaire, aérien et maritime, et que cette demande légitime n'a jamais trouvé de réponse.
Au regard des attentes exprimées à plusieurs reprises par le peuple français, il semble pourtant que l'un des premiers mandats du Gouvernement devrait être de solliciter les institutions européennes pour la réalisation de ce moratoire.
De plus, le rejet du traité constitutionnel européen, exprimé le 29 mai dernier, a été l'occasion pour nos concitoyens d'exprimer leur refus des politiques ultralibérales, de la déréglementation à tout va et du démantèlement des services publics.
Le Parlement européen n'a pas entendu ce message, puisque les députés viennent de voter le troisième paquet ferroviaire qui ouvre à la concurrence le transport de passagers.
Le Gouvernement français n'a pas plus tenu compte du résultat du référendum, puisqu'il nous propose aujourd'hui d'adopter ce projet de loi.
En amont, il a déjà préparé l'ouverture à la concurrence par l'adoption du plan fret ferroviaire.
Mais que constate-t-on ? L'offre de transport et la sécurité ont-elles été améliorées ? Loin de là, le rail a encore perdu des parts dans le transport de marchandises. Ce plan s'est soldé par une perte de capacité du réseau, par la fermeture de nombreuses gares, de nombreux sillons, moins 18 %, et par la suppression d'emplois.
Ce plan a également mis 200 000 camions supplémentaires sur les routes depuis sa mise en oeuvre en 2004. Au terme de ce plan, ce sont 1 million de camions supplémentaires qui sont attendus.
Sur ce point, je tiens à vous rappeler que le rapporteur de l'Assemblée nationale pour la mission « Transports » estimait, lui aussi, qu'un bilan d'étape approfondi du plan fret ferroviaire, préparant l'ouverture à la concurrence devait être établi. Cette proposition n'a pas davantage été reprise par le Gouvernement.
Alors que l'État doit s'engager en faveur du rééquilibrage modal afin de respecter ses engagements pris lors du sommet de Kyoto, les parts du transport routier de marchandises n'ont cessé de croître. Cela s'explique par une politique plus que généreuse du Gouvernement d'allégement de charges et d'assouplissement de la réglementation du travail, comme en témoignent les articles 15, 16 et 17 de ce projet de loi.
Le patronat routier va bénéficier également, grâce au plan du Gouvernement du 12 septembre dernier, d'un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle sur les camions de plus de 16 tonnes, plan qui va coûter à l'État 400 millions d'euros. Toutes ces mesures s'ajoutent au dégrèvement de taxe professionnelle pour les camions de 7, 5 tonnes déjà accordé dans la loi de finances pour 2005 et accentué dans la loi de finances pour 2006.
Cette démarche de libéralisation vise à favoriser les nouveaux entrants dans le transport ferroviaire, qui, ne nous leurrons pas, seront plus intéressés par les profits à court terme sur les lignes rentables que par la qualité du service et la satisfaction des besoins.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen estiment, pour leur part, que le développement et la sécurité des transports passent par la maîtrise publique des investissements dans les infrastructures et le matériel de transport.
Sur ce point, l'audit sur les infrastructures de transport estimait à 600 millions d'euros supplémentaires les besoins de financement des infrastructures de transport.
Or, dans le projet de loi de finances pour 2006, seulement 70 millions d'euros supplémentaires sont accordés à ce financement. Ce sous-investissement chronique aboutira, si rien ne change, à la suppression de 60 % des lignes d'ici à 2025.
Le projet de loi de finances a également entériné le désengagement de l'État en faveur du désendettement de la SNCF et de RFF.
Pourtant, il est urgent de définir une conception de la politique des transports pour permettre à l'État de dégager des priorités au regard, non de la rentabilité escomptée, mais des impératifs d'intérêt général de sécurité des réseaux, d'aménagement du territoire et d'égal accès des usagers à la mobilité.
Dans ce sens, la possibilité de partenariat entre les secteurs public et privé, si elle n'est pas contestable par principe, comporte le risque de la création de monopoles privés sur certains segments du réseau.
On peut d'autant plus s'inquiéter de la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre les conditions d'un désengagement de l'État dans le financement des infrastructures que la privatisation engagée des autoroutes prive l'agence de financement des infrastructures de ressources pérennes.
Ainsi, l'on s'en remet, par ce projet de loi, à l'initiative privée pour établir des priorités dans le choix des infrastructures à financer. Cela est extrêmement dangereux au regard des missions de service public qui incombent à l'État.
Malgré quelques dispositions positives de ce texte concernant les transports aériens et maritimes, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, vous n'en serez pas surpris, mes chers collègues, voteront contre ce projet de loi, qui fragilise la sécurité des usagers et des personnels et qui renonce au développement d'une offre de transport digne de notre pays.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
CHAPITRE IER
L'Établissement public de sécurité ferroviaire
I. - L'Établissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'État et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées par le directeur général.
II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.
III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second alinéa de l'article 1er, et de se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au secret professionnel.
En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'État ou de ses établissements publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.
Les ressources de l'Établissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
- un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;
- une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
2° Les subventions de l'État ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.
Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret en Conseil d'État. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'État. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13-1, après les mots : « avant que l'État », sont insérés les mots : « ou l'Établissement public de sécurité ferroviaire », et après les mots : « au représentant de l'État, », sont insérés les mots : « ou au directeur général de l'Établissement public de sécurité ferroviaire » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « ou l'Établissement public de sécurité ferroviaire » ;
2° bis Dans le troisième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'autorité de l'État compétente », sont insérés les mots : « ou le directeur de Établissement public de sécurité ferroviaire » ;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « De l'interopérabilité du système ferroviaire » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, le mot : « transeuropéen » est supprimé ;
5° Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre chargé des transports peut, par arrêté » sont remplacés par les mots : « le directeur général de Établissement public de sécurité ferroviaire peut » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des transports ou le directeur général de Établissement public de sécurité ferroviaire peut » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 26-2, après les mots : « les agents de l'État », sont insérés les mots : «, ceux de Établissement public de sécurité ferroviaire » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article 26-4, les mots : « tout document » sont remplacés par les mots : « tout élément justificatif ».
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la sécurité aérienne
I. - Le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Police de la circulation des aéronefs
« Art. L. 133-1. - Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.
« Art. L. 133-2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
« Art. L. 133-3. - Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
« a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
« b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;
« c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;
« d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.
« Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
« Art. L. 133-4. - Les agents de l'État, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
« Art. L. 133-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 330-6 du même code est complété par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. »
III. - L'article L. 410-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. - L'intitulé du livre VII du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : « Enquête technique relative aux accidents et incidents - Protection de l'information ».
II. - L'article L. 722-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2. - Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre VII du même code est complété par deux articles L. 722-3 et L. 722-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-3. - Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, précitée, dans les conditions prévues à l'article L. 722-2, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
« Art. L. 722-4. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés. »
IV. - Le chapitre unique du titre III du livre VII du même code est complété par deux articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4. - Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'applique ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 731-3, ni aux comptes rendus d'accidents, d'incidents ou d'événements au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, précitée et aux documents s'y rapportant, ni aux rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 133-2, ni aux rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen. Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
« Art. L. 731-5. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations. »
V. - A l'article L. 741-1 du même code, les mots : « de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives » sont remplacés par les mots : « de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 722-2 ».
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Après l'article L. 147-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 147-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7-1. - A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
I. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes.
II. - Le I de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, ou sortant de celles-ci » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la sécurité des tunnels routiers
Après l'article L. 118-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après accord du représentant de l'État, un agent de sécurité qui coordonne les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.
« Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'État, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.
« Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-1.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
I. - 1°. Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit », sont insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième classe ».
2°. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les mots : « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacés par les mots : « L. 325-1 à L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé et il est inséré un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - A l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1°. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code, les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2°. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des États membres de l'Union européenne et aux autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces États, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. »
Les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'État destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière. »
Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'État, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'État.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.
I. - 1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;
- soit à une peine prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce pendant la durée de la peine infligée ;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ;
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées par voie réglementaire.
II. - 1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné au 1 du I peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;
2° Être titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'État.
III. - 1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au 1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
IV. - Les I, II et III sont applicables aux établissements de formation existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. Ce délai ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un agrément dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent devront remplir l'ensemble des conditions du 2 du II pour pouvoir continuer leur activité à l'issue de la période transitoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
CHAPITRE VI
Dispositions communes relatives à la sécuritédes différents modes de transports
Dans la première phrase du I de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « le ministre chargé des transports peut décider » sont remplacés par les mots : « il peut être décidé ».
TITRE II
DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'organisation du transport ferroviaire
I. - L'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié, à compter du 31 mars 2006 :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de transport ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; »
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont remplacés par les mots : « principes du service public ».
II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France sont validées en tant que leur légalité serait contestée aux motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées ne comprenait pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et était, par la suite, irrégulièrement composé.
CHAPITRE Ier bis
Dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France
I. - Avant le dernier alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions des membres autres que la région d'Île-de-France supérieure au taux d'évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de l'année majoré d'un taux de deux points.
« Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque l'augmentation des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du syndicat à la suite d'une baisse imprévue du produit du versement transport, du produit des amendes de police ou des redevances perçues. »
II. - Supprimé.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux investissements sur le réseau ferré national
I. - L'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français. Il détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant de la maîtrise d'oeuvre ou de la réalisation de travaux. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué. »
II. - Après l'article 1er de la même loi, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1 er -1. - Sauf s'il est fait application de l'article 1er-2, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures d'intérêt national ou international destinées à être incorporées au réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité qui demeurent régis par le deuxième alinéa de l'article 1er. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
« Art. 1 er -2. - L'État peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article 1er-1 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'État et Réseau ferré de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 16 de la même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'État définit les modalités d'établissement par l'État d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison.
CHAPITRE III
[Division et intitulé supprimés]
Supprimé
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au transport routier
Supprimé
I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « véhicules automobiles d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : « véhicules motorisés ».
II. - Les dispositions figurant au I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code du travail, les mots : « par automobiles », sont remplacés par les mots : « par véhicules routiers motorisés ».
Après l'article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un article 285 septies ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0, 001 et 0, 015 euro par tonne et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'État lorsque la voie appartient au domaine public de l'État et par l'organe délibérant de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
« Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son locataire.
« La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation. »
CHAPITRE IV bis
Dispositions relatives aux transports scolaires
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est complété par les mots : «, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée ».
CHAPITRE V
Dispositions relatives au transport fluvial et au domaine public fluvial
I. - Au début de l'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est insérée la mention : « I ».
II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport. »
III. - Le même article 189-6 est complété par les II à IV ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
« III. - A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
« IV. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises. »
Après l'article 224 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sont insérés deux articles 224-1 et 224-2 ainsi rédigés :
« Art. 224-1. - Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
« Art. 224-2. - L'État, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'État et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
CHAPITRE VI
Dispositions relatives aux ports maritimes
I. - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.
II. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la collectivité territoriale propriétaire d'un port visé au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peut, à la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.
III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application du présent article.
IV. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.
Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'État ;
« - le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros. »
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux aéroports
Dans le IV de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « conseil municipal, », sont insérés les mots : « les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ».
TITRE III
DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables au transport routier
L'article L. 220-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier » sont remplacés par les mots : « de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « entreprises de transport routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ».
I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
« a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
« b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
« c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
« d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
« e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
« f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
« g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - La date d'entrée en vigueur des dispositions figurant au I est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis M du code général des impôts est supprimée.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au transport maritime
Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« - travail illégal.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. »
Le cinquième alinéa (1°) du I de l'article 2 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est complété par les mots : « ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ».
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la mise en oeuvre de dispositions internationales et communautaires concernant les gens de mer
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail sont supprimés.
II. - Après l'article L. 742-1 du même code, il est inséré un article L. 742-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-1-1. - I. - L'inspection du travail maritime est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère chargé de la mer. Un décret en Conseil d'État fixe la répartition des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code au sein des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.
« II. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle de l'application des conditions sociales de l'État d'accueil dans les cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
« Pour l'exercice de ces missions, les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
« III. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime participent, en outre, au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au régime de travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« IV. - Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »
III. - L'article 123 du code du travail maritime est abrogé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail, après la référence : « L. 231-3-2, », est insérée la référence : « L. 231-4, ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 324-12 du même code, après la référence : « L. 611-10, », sont insérés les mots : « les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, ».
VI. - L'article 122 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 122. - L'inspection du travail maritime est régie par les dispositions de l'article L. 742-1-1 du code du travail. »
VII. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 27 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 précitée, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 742-1 » est remplacée par deux fois par la référence : « I de l'article L. 742-1-1 ».
I A. - Après l'article 25-1 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
« La liste de ces activités est fixée par décret. »
I. - L'article 28 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
« a) Par roulement ;
« b) De manière différée, au retour au port ;
« c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
« Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
« A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret. »
II. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret. »
Le chapitre IV du titre IV du code du travail maritime est ainsi modifié :
1° Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :
« Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
« 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
« 2° A la fin de la période de préavis ;
« 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
« 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
« 5° En cas de naufrage ;
« 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
« 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
« 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
« 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
« L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
« Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
« L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord.
« Art. 88. - Le rapatriement comprend :
« 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le pays de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties.
« 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
« Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
« Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
« Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
« Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
« Art. 90. - La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention de celles-ci.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.
« Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'État. » ;
2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. - Est puni de 7.500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. »
II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article, sont substitués aux mots : « à l'alinéa précédent », les mots : « aux alinéas précédents ».
L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400.000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département à se retirer pendant ce délai. »
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ;
2° L'ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types.
Dans le premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les mots : « et de celles prises en application des articles 60 et 84 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « , de celle prise en application de l'article 60, de celles prises en application des 1° (a à d), 2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois, et de celle prise en application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle le délai est de vingt-quatre mois ».
La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes autorisant les travaux nécessaires à cette opération ne peuvent être contestées au motif que le décret du 8 septembre 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Jarrie, Péré, Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou (Charente-Maritime), Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres) aurait été pris après le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article L. 11- 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite dire quelques mots sur ce projet de loi qui nous occupe depuis octobre dernier.
Touchant à l'ensemble des modes de transport, ferroviaire, routier, aérien et maritime, ce texte apparaissait dès l'origine pour le moins hétérogène. Or, après une première lecture au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, il apparaît plus encore comme un texte fourre-tout.
Je redis notre opposition à ce texte, car sa mesure phare est l'avancement de la date d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire national.
Nous y sommes opposés, d'une part, parce qu'il est le fruit de la négociation avec la Commission européenne sur la participation financière de l'État et de la SNCF à un plan fret qui n'affiche comme objectif que le seul retour à l'équilibre financier. Il n'a pas pour objectif de reprendre des parts de marché à la route. Au contraire, depuis son entrée en application, ce plan a mis des milliers de camions supplémentaires sur les routes de notre pays. Ce n'est pas ainsi que nous envisagions le report modal si nécessaire au respect des engagements que nous avons pris lors du sommet de Kyoto et à l'économie d'une énergie de plus en plus rare et de plus en plus chère.
Nous y sommes opposés, d'autre part, car la concurrence, affichée en dogme permanent, n'a pas fait la preuve de sa capacité à favoriser les modes de transport alternatif au transport routier.
La seule concurrence qui s'exerce est à l'intérieur même du système ferroviaire et elle risque de mettre inutilement l'entreprise historique en difficulté.
J'avais dit lors de l'examen du projet de loi en première lecture, et je le confirme aujourd'hui, que certaines dispositions de ce texte ont notre assentiment.
Il s'agit des dispositions qui concernent la sécurité ferroviaire, l'Agence française de sécurité ferroviaire étant devenu utilement au cours des débats un établissement public d'État.
Il s'agit également des dispositions destinées à améliorer la sécurité aérienne, le contrôle maritime, ce qui suppose des moyens humains conséquents, ce n'est pas toujours le cas.
Il s'agit aussi des mesures relatives au transport routier, notamment de celle qui fait du prix du gasoil une variable désormais facturable au juste prix.
Il s'agit, enfin, des mesures d'encadrement social pour les personnels des entreprises portuaires - le lamanage a opportunément été ajouté au remorquage par nos collègues de l'Assemblée nationale -, ainsi que de l'amendement de nos collègues Alsaciens, qui proposent une solution expérimentale de péage routier, ayant vocation à être généralisée.
Je n'énumérerai pas toutes les dispositions auxquelles nous sommes défavorables, notamment les validations législatives - elles sont trop nombreuses et ce n'est pas une manière de faire - qui sont venues assombrir ce texte.
Ainsi, l'article 10 quater, assez étrange, est un contournement d'une décision du Conseil d'État. C'est une réponse négative et assez sèche apportée aux nouveaux agents contractuels des services d'étude technique des routes et des autoroutes qui souhaitaient légitimement bénéficier, comme d'autres de leurs collègues, de dispositions financières plus favorables.
Je pense ici à la demande de prise en compte de l'indemnité de résidence dans leur traitement. Mais c'est l'habitude, puisqu'un amendement de même nature concernant les personnels des laboratoires des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques a été ajouté dans la loi de finances rectificative.
Enfin, un second amendement, non le moindre, introduit à l'Assemblée nationale en séance, sans étude préalable en commission, modifie les règles de majorité au conseil d'administration du STIF, et ce à la veille du transfert à la nouvelle autorité organisatrice, le conseil régional d'Île-de-France.
Il s'agit là d'une mauvaise manière d'introduire une majorité qualifiée des deux tiers sur la question du financement de ce syndicat, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, cette mesure est en contradiction avec les statuts fixés en concertation par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin dans un décret très récent. Cette nouvelle disposition accorde en fait un droit de veto inadmissible à quelques contributeurs très minoritaires.
Ensuite, cette disposition place de fait le conseil régional, dont la participation est la plus importante, sous la coupe, la tutelle, de quelques départements qui, eux, participent à moins de 20 %.
Un tel dispositif de plafonnement de la hausse des contributions rendra impossible l'amélioration nécessaire du transport en région francilienne et même le strict respect de la loi pour les usagers les moins favorisés.
Cette façon de procéder n'est guère élégante et votre majorité, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, en commission mixte paritaire, y a prêté la main. Ce n'est vraiment pas la meilleure manière d'engager la décentralisation du transport en Île-de-France.
En résumé, mes chers collègues, voilà quelques-unes des raisons qui, plus encore qu'en première lecture, nous conduisent à nous opposer fermement à ce texte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, nous commencions nos débats sur ce projet de loi.
En trois mois, nous sommes arrivés à un texte très complet, qui aborde plusieurs questions relatives à tous les modes de transports, ferroviaire, aérien, routier, maritime, fluvial, sous différents aspects : le financement des infrastructures, la sécurité, le développement économique, les règles sociales, la formation professionnelle.
Un tel résultat n'a pu être obtenu que par un travail très minutieux de notre collègue rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Charles Revet, et une grande coordination avec nos collègues députés.
Toutes les dispositions que nous allons voter aujourd'hui étaient très attendues, et ce pour deux raisons principales.
D'une part, elles correspondent souvent à des mises en conformité de notre droit avec des engagements internationaux et européens. D'autre part, il était aussi important que certaines mesures puissent entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine, notamment celle qui concerne le mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole.
Aussi, je retiendrai quelques mesures primordiales qui montrent toute l'importance de ce texte.
Tout d'abord, nous créons une agence de sécurité ferroviaire. Puis, nous améliorons les conditions et modalités du contrôle technique des avions des pays tiers en attendant la publication prochaine d'une liste noire européenne. Nous fixons aussi les conditions de sécurité dans les tunnels de plus de cinq cents mètres du réseau routier transeuropéen. Ensuite, les sanctions pour débridage des moteurs, à l'origine de nombreux accidents de la circulation, sont aggravées comme l'a expliqué M. le ministre.
Ensuite, nous transposons la directive européenne relative au développement des chemins de fer communautaires. Nous allons également permettre le recours aux partenariats public-privé pour la réalisation d'infrastructures ferroviaires.
Enfin, nous réglementons, après concertation avec les professionnels et les plaisanciers, la formation à la conduite des bateaux de plaisance de plus en plus nombreux.
Comme je l'ai dit, toutes les mesures du présent texte, même si elles peuvent sembler disparates au premier abord, sont utiles et nécessaires.
C'est pourquoi le groupe UMP votera ce projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 73 :
Nombre de votants329Nombre de suffrages exprimés327Majorité absolue des suffrages exprimés164Pour l'adoption201Contre 126Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures trente-cinq.

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 143).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers résulte d'un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Le projet de loi présenté en conseil des ministres comportait quinze articles. Après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, il en comptait vingt-sept. Le Sénat, qui a adopté plus de quarante amendements, a porté ce nombre à trente-trois.
Sur les vingt-sept articles issus des travaux de l'Assemblée nationale, quinze ont été adoptés par la Haute Assemblée dans les mêmes termes.
La commission mixte paritaire était appelée à examiner les dix-neuf articles qui restaient en discussion. La majorité d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune modification, ou n'ont subi que de simples modifications de coordination.
Avec M. Alain Marsaud, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous avons souligné, au cours de la réunion de cette commission mixte, la vision commune des deux assemblées sur ce texte, le Sénat ayant principalement conforté et complété le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Ce texte porte donc incontestablement l'empreinte de notre assemblée, et il reflète la plupart des souhaits et préoccupations exprimés la semaine dernière dans cet hémicycle.
Parmi les apports les plus substantiels du Sénat, j'évoquerai notamment la création d'une cour d'assises spéciale près le tribunal de grande instance de Paris, chargée de juger les actes de terrorisme commis par des mineurs ; la généralisation du délit de non-justification des ressources correspondant au train de vie d'une personne en relation habituelle avec d'autres individus se livrant à des infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et en tirant un profit direct ou indirect ; le renforcement de la procédure d'agrément par le préfet des personnels ou dirigeants des entreprises privées de sécurité qui sont amenés à travailler sur des sites sensibles, qu'il s'agisse d'aéroports ou d'installations industrielles dangereuses ; enfin, la création d'une procédure d'agrément des personnes ayant accès aux lieux de stockage ou de conditionnement du fret lorsque ces lieux se trouvent en dehors des zones réservées des aérodromes.
Par ailleurs, je tiens à réaffirmer ici l'attachement du Sénat à la création d'une commission parlementaire de contrôle des services de renseignement. Je souhaite que le groupe de travail mis en place à cette fin parvienne rapidement à élaborer une proposition de loi, qui pourrait être adoptée au cours de l'année prochaine. Il ne faut pas laisser passer l'occasion historique que nous avons de rompre avec cette exception française !
Quelques modifications de fond ont néanmoins été apportées par la commission mixte paritaire.
À l'article 5, relatif à la procédure de réquisition administrative des données techniques des communications électroniques, la commission a rétabli, parmi les finalités justifiant ces réquisitions administratives, la répression du terrorisme, alors que le texte adopté par le Sénat limitait le champ d'exercice de cette faculté à la seule prévention du terrorisme.
À ce même article, la commission a légèrement modifié la procédure selon laquelle la personnalité qualifiée chargée d'autoriser les demandes de réquisitions administratives de ces données sera nommée. La rédaction proposée ménage une plus grande liberté de choix à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui pourra choisir sur une liste d'au moins trois noms présentée par le ministre de l'intérieur, la CNCIS pouvant toujours, éventuellement, refuser l'ensemble des noms ainsi proposés.
Enfin, toujours à l'article 5, la commission a supprimé, par souci de coordination avec l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la précision selon laquelle les surcoûts éventuels pesant sur les fournisseurs d'hébergement font l'objet d'une compensation financière.
À l'article 6, relatif à l'obligation, pour les transporteurs, de communiquer les données concernant les passagers, la commission a déplacé, dans un souci de clarification, l'alinéa prévoyant l'information des passagers sur la mise en oeuvre de fichiers à partir des données relatives aux passagers ainsi collectées et transmises.
À l'article 7, relatif aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, la commission a rétabli la possibilité d'installer de tels systèmes pour réprimer ou prévenir le terrorisme.
Au même article, elle a supprimé la possibilité de consulter les données enregistrées par ces systèmes et n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés pour les besoins d'une procédure douanière. Cette possibilité subsisterait uniquement pour les besoins d'une procédure pénale. Toutefois, la commission ne s'est pas opposée à ce que soient conservées plus d'un mois les données ayant fait l'objet d'un rapprochement positif lorsque les besoins d'une procédure douanière le nécessitent.
À l'article 9 ter, relatif à l'exclusion de certaines informations communiquées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, dans le cadre des formalités préalables à la création de fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, la commission a adopté une position de compromis, afin de concilier les exigences de la sécurité et les impératifs du contrôle.
Le texte adopté par le Sénat prévoyait que certaines demandes d'avis et certains actes réglementaires portant sur des fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et adressés à la CNIL puissent, aux termes d'un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par la loi du 6 janvier 1978. La commission a approuvé une rédaction restreignant la dérogation aux seules demandes d'avis et précisant que le décret en Conseil d'État fixerait également la liste des informations devant figurer a minima dans ces demandes d'avis.
À l'article 10 bis A, instituant une cour d'assises spéciale pour les mineurs terroristes, la commission a supprimé toute possibilité de dérogation à la présence obligatoire de deux juges des enfants parmi les assesseurs.
À l'article 10 ter, relatif à la garde à vue, la commission est revenue au texte adopté par l'Assemblée nationale, estimant que la modification rédactionnelle introduite par le Sénat n'apportait pas de garantie supplémentaire par rapport aux dispositions initiales, selon lesquelles la personne placée en garde à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat.
Tout ayant été dit au cours d'une sérieuse première lecture, je voudrais enfin, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, exprimer un certain nombre de remerciements.
Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le ministre, de la clarté de vos explications et de la grande ouverture aux propositions du Sénat dont vous avez fait preuve au cours de nos débats.
Je remercie également les très nombreux intervenants qui, dans un esprit constructif ou critique, ont contribué à leur manière à enrichir le débat et, en définitive, à améliorer ce texte.
Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous achevez ce matin l'examen d'un texte particulièrement important pour l'avenir de notre pays.
Au nom de Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, je souhaite exprimer ce matin les remerciements du Gouvernement à l'égard de la représentation nationale.
Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, tel qu'il a été adopté mardi par la commission mixte paritaire et tel qu'il vous est soumis aujourd'hui, fait oeuvre utile au service de nos compatriotes. En votant ce texte, le législateur donne à la France, avec fermeté, de nouveaux instruments juridiques adaptés aux réalités de notre temps afin de dissuader, de combattre l'une des formes les plus barbares et les plus pernicieuses de la violence, celle du terrorisme.
Prévenir le terrorisme et non le subir, parer les coups plutôt que panser les plaies, en un mot agir en amont des attentats potentiels en gardant un temps d'avance et en permettant une meilleure collecte des renseignements, tel est tout l'esprit des principes qui ont inspiré ce projet de loi.
Je ne reviendrai pas, à ce stade du débat, sur l'architecture de ce texte. Je veux seulement souligner que, avec le développement ciblé et qualitatif de la vidéosurveillance et le renforcement des possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste, nous tirons le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Nous modernisons nos instruments de lutte antiterroriste en les adaptant à la réalité : celle de terroristes extrêmement mobiles, organisés en réseaux, maîtres dans l'art d'utiliser les nouvelles technologies. En effet, la menace est trop grave pour que nous nous permettions le luxe d'avoir un temps de retard : ce serait tout simplement irresponsable !
Notre responsabilité, après les attentas de Madrid et de Londres, a précisément consisté à tirer les enseignements opérationnels de ces événements tragiques afin de garder un temps d'avance. Le terrorisme, hélas, n'attend pas !
Une grande majorité d'entre vous, sur différentes travées, a parfaitement compris les objectifs du Gouvernement et a su lui apporter son entier soutien.
Je veux saluer de nouveau l'esprit de responsabilité qui s'est exprimé dans chacune des deux assemblées. Le Gouvernement s'est montré très ouvert aux amendements qui ont été déposés, tant à ceux qui l'ont été par les deux rapporteurs au nom de chacune des deux commissions des lois du Parlement - et je veux saluer le travail qui a été réalisé, ici, par Jean-Patrick Courtois - qu'à ceux qui l'ont été par les membres des différents groupes politiques.
Je ne citerai les effets que de quelques-uns de ces amendements : l'amélioration du régime de contrôle des installations de vidéosurveillance, la prolongation de la garde à vue dans les affaires de terrorisme, la consolidation du dispositif des assurances au bénéfice des victimes du terrorisme, ou encore le nouveau régime de contrôle des chaînes de télévision extra-européennes.
Je veux remercier les groupes UMP et UC-UDF, ainsi que la majorité du groupe du RDSE, de leur entier soutien et des nombreuses améliorations qu'ils ont apportées au texte du Gouvernement.
À l'Assemblée nationale, les parlementaires de l'opposition socialiste ont su prendre la mesure de l'enjeu auquel avec l'ensemble du Gouvernement nous devons faire face, et ils ont approuvé l'essentiel des mesures de ce texte en s'abstenant. Je regrette que tel n'ait pas été le cas au Sénat.
Toutefois, je suis très heureux que les conditions de la prolongation de la durée de garde à vue dans les affaires de terrorisme aient pu être définies à partir d'un amendement parlementaire, et ce dans des conditions très consensuelles, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
Je veux aussi, puisque cela a été l'objet d'amendements émanant de membres des groupes UMP, UDF, RDSE et socialiste du Sénat comme de leurs homologues de l'Assemblée nationale, renouveler solennellement l'engagement pris au nom du Gouvernement par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'agissant du contrôle parlementaire des services de renseignement.
Un groupe de travail sera mis en place aussitôt la loi promulguée et un projet - ou une proposition - de loi sera rédigé avant le 15 février, pour être inscrit dans les meilleurs délais à l'ordre du jour parlementaire : nous n'en sommes plus au débat en première lecture à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous en sommes au vote final des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat, et c'est donc un engagement solennel pris par le ministre d'État que je renouvelle aujourd'hui en son nom et au nom du Gouvernement.
La lutte contre le terrorisme, mesdames, messieurs les sénateurs, n'est ni de droite ni de gauche : elle est l'affaire de tous les Français.
C'est la raison pour laquelle l'opposition d'alors avait voté la loi sur la sécurité quotidienne que le gouvernement de Lionel Jospin avait proposée après les attentats du 11 septembre 2001.
Nous avions su faire preuve, hier, de l'esprit d'unité nationale que nous attendons aujourd'hui des responsables de l'opposition. Il ne s'agit pas de prendre la pose et de se draper dans des positions de principe : il s'agit, avec pragmatisme - mais aussi avec modestie -, de travailler au service des Français.
En proposant ce projet de loi, le Gouvernement ne prétend pas mettre les Français à l'abri de la menace terroriste, il entend seulement - et c'est sa responsabilité première - améliorer les moyens de lutte contre la menace.
L'actualité la plus récente nous démontre que la menace est là. Il faudrait d'ailleurs être aveugle pour ne pas la voir : je ne rappellerai pas, car chacun le sait, que la semaine dernière encore une cache d'armes et de munitions a été découverte en Seine-Saint-Denis, grâce à l'excellent travail des services de renseignement, auxquels je tiens à rendre hommage.
Les Français comprendraient-ils que, sur telle ou telle travée de la gauche, le choix ait été fait de voter contre les nouveaux instruments de la lutte antiterroriste ? Chacun prendra ses responsabilités, et les Français, le moment venu, seront les seuls juges.
Le Gouvernement, pour sa part, aussitôt la loi votée, entend bien la mettre en oeuvre de manière efficace. Le ministre d'État a d'ores et déjà demandé aux services du ministère de l'intérieur de préparer la rédaction des décrets indispensables à l'application effective de ce texte, et ce sans délai, car l'enjeu est d'importance : il en va de la protection de la démocratie contre la barbarie des terroristes. À travers cette loi, la République, fidèle à ses valeurs, leur répond fermement en utilisant les armes du droit.

Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

Je vous donne la parole, monsieur Sueur, mais je vous prie d'être bref.

Mon rappel au règlement est fondé à la fois sur le règlement et sur la Constitution, monsieur le président, et il sera effectivement très bref.
Dans son propos, M. le ministre vient de nous annoncer qu'un projet - ou une proposition - de loi serait déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 15 février. Je pense que vous serez d'accord avec moi, monsieur le président, pour rappeler à M. le ministre que, s'il était tout à fait dans son rôle en annonçant le dépôt d'un projet de loi, il l'était certainement moins en évoquant une proposition de loi, sachant que les propositions de loi ne peuvent être déposées que par des parlementaires ! §
Voilà pourquoi je me suis permis de faire ce rappel au règlement qui, comme vous pouvez le constater, monsieur le président, est fondé sur nos règles constitutionnelles.

M. le président. Je vous comprends, mon cher collègue, mais M. le ministre ayant été longtemps député, il a pu recevoir des confidences de ses amis parlementaires...
Sourires
Monsieur le sénateur, je suis très surpris par ce rappel au règlement et par le manque d'esprit d'ouverture dont, à la différence du Gouvernement, vous faites preuve.
Tout au long de ce débat, nous n'avons cessé, le ministre d'État et moi-même en son nom, d'être totalement ouverts à toutes les propositions émanant de la représentation nationale, et ce d'où qu'elle viennent.
Or, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, tant les rapporteurs que les députés ou les sénateurs nous ont fait valoir - les comptes rendus des débats en témoignent - qu'ils étaient prêts, le cas échéant, à déposer une proposition de loi une fois connues les conclusions des travaux de la commission qui sera mise en place.
Par conséquent, comme ce fut le cas tout au long de ce débat, le Gouvernement se montrera ouvert à la représentation nationale et à ses propositions, et je ne peux que redire qu'au terme des travaux de cette commission seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat soit un projet de loi, soit une proposition de loi...
Je réitère donc ces propositions, qui ont été celles de Nicolas Sarkozy comme elles ont été les miennes tout au long de ce débat !

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Sueur. L'incident est clos !

Il ne s'agit pas d'un incident, monsieur le président, mais d'une clarification !

En tout cas, mon cher collègue, si vous souhaitez déposer une proposition de loi, nous l'enregistrerons !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce ne sera certainement pas une surprise pour vous : le texte issu de la commission mixte paritaire ne nous convient pas plus que le projet de loi initial. En effet, son esprit reste resté inchangé, et il fait peser une lourde menace sur les libertés individuelles.
Que le Gouvernement veuille prévenir tout acte de terrorisme contre notre pays, quoi de plus responsable ? Pour autant, cela doit se faire exclusivement dans le cadre de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ce postulat qui doit donc guider l'action de tout gouvernement et imposer de s'attaquer de manière pertinente à cette négation de l'humanité que constitue le terrorisme.
À cette fin, doit-on privilégier les mesures sécuritaires, nécessitant de multiples modifications de la loi pénale qui fragilisent un peu plus l'édifice de nos libertés fondamentales, ou les mesures permettant de limiter en amont l'action des groupes terroristes ?
Nous penchons, bien évidemment, pour la seconde option. C'est malheureusement la première qu'a choisie le Gouvernement avec ce texte.
Toutes les mesures qu'il préconise présentent deux points faibles. D'une part, elles ne seront pas efficaces pour empêcher un acte terroriste et, d'autre part, en se situant exclusivement dans une logique de police administrative, elles restreignent dangereusement les libertés individuelles.
Tel est le cas de la vidéosurveillance : elle intervient a posteriori et servira, au mieux, à identifier les auteurs d'un attentat, mais elle ne servira pas à démanteler des réseaux et à remonter jusqu'aux commanditaires de ces actes odieux et barbares.
Les organisations terroristes n'ont que faire de la vidéosurveillance, nous le savons bien depuis les attentats de Londres. En revanche, les honnêtes citoyens n'échapperont pas à ce regard indiscret et permanent qui portera atteinte à leur liberté d'aller et venir librement et au respect de leur vie privée.
Ainsi, des dispositions qui étaient encore aujourd'hui un tant soit peu encadrées ne le seront plus du tout. Les agents qui mèneront des actions de police administrative à des fins préventives, et donc sans le contrôle d'un juge, auront les mêmes prérogatives que ceux qui mènent actuellement les actions de police judiciaire, ciblées et ponctuelles.
Cet élargissement des pouvoirs de police administrative a évidemment pour contrepartie d'affaiblir les libertés individuelles de nos concitoyens.
La procédure d'urgence aggrave cette situation en écartant ni plus ni moins la commission départementale, celle-ci ne pouvant se prononcer qu'après la pose de systèmes de vidéosurveillance.
Nous sommes au regret de constater que la France succombe à la tentation de faire prévaloir la logique administrative - et par conséquent politique - sur la logique judiciaire, primauté lourde de danger s'agissant de la présomption d'innocence et du principe de légalité.
Toutes les mesures prévues par le projet de loi et qui, sous couvert de prévention du terrorisme, se situent dans le cadre d'actions de police administrative, seront donc appliquées sans contrôle du juge judiciaire.
C'est évidemment regrettable eu égard au respect des droits fondamentaux de nos concitoyens : je fais ici référence à l'extension des contrôles d'identité dans les trains transnationaux, aux interceptions et à l'accès à des données relatives aux communications électroniques, à la constitution de fichiers concernant les étrangers qui voyagent, aux possibilités de contrôler et de photographier, en tout point du territoire, les occupants de véhicules, ou enfin à la consultation de multiples fichiers par des agents de la police et de la gendarmerie nationales.
Les mesures relatives à l'aggravation des peines, à la déchéance de la nationalité ou encore à la garde à vue, ne parviennent pas à nous convaincre davantage.
Le Gouvernement nous présente la plupart de ces dispositions comme étant exceptionnelles et applicables jusqu'au 31 décembre 2008 seulement. Nous sommes malheureusement habitués à ce que l'exceptionnel devienne pérenne, et cela ne nous encourage guère à donner un blanc-seing au Gouvernement lorsque autant de droits fondamentaux se trouvent ainsi remis en cause.
Toutes les mesures exceptionnelles prévues par les textes passés pour une période donnée - sans exception, si je puis dire - ont été reconduites, voire entérinées. Dès lors, comment vous faire confiance aujourd'hui ? Nous n'avons pas beaucoup d'illusion à ce sujet !
Toutes ces mesures seront d'une efficacité très limitée en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, tout en portant atteinte aux libertés. L'équilibre entre liberté et sécurité est ainsi rompu. C'est le premier motif qui nous conduit à rejeter catégoriquement ce texte.
Même si les dispositions du texte sur le gel des avoirs se situent dans la logique de la lutte contre le terrorisme, elles n'interviennent qu'une fois que l'attentat est commis et que ses auteurs sont éventuellement arrêtés et jugés. Encore faut-il, en effet, que la police ait pu retrouver et appréhender les terroristes, sans parler du fait qu'ils aient pu mourir lors de l'attentat !
C'est pourquoi nous avions fait des propositions en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent sale et en faveur d'une plus grande transparence des transactions financières.
Nous regrettons que la commission et le Gouvernement n'aient pas compris l'intérêt de telles propositions concernant la lutte contre le terrorisme. Il est pourtant évident que les réseaux terroristes prospèrent et perdurent grâce au blanchiment de capitaux, à l'existence de pays reconnus pour leur législation insuffisante ou leurs pratiques faisant obstacle à la lutte contre ce blanchiment, et qui représentent de magnifiques paradis fiscaux pour ces réseaux.
Les propositions du Gouvernement en la matière ne vont malheureusement pas aussi loin, puisqu'elles ne concernent que le gel des avoirs et n'ont donc qu'une incidence minime sur le financement du terrorisme.
En cela, le projet de loi ne répond finalement pas à la lutte contre le financement des réseaux terroristes, qui devrait être prioritaire.
Cette absence de volonté du Gouvernement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux constitue notre second motif de rejet de ce texte, qui se révèle être purement et simplement un texte d'affichage.
Le Gouvernement veut essayer de démontrer aux Français qu'il entend lutter contre le terrorisme, et il utilise à outrance l'effet d'annonce. Il est même prêt à aller très loin pour cela, et c'est sans doute ce qui explique l'amalgame effectué à plusieurs reprises dans ce texte entre terrorisme et immigration.
Le Gouvernement pratique également depuis bientôt quatre ans l'amalgame entre les différentes mesures sécuritaires. Toutes les lois précédentes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale ont ceci en commun : elles présentent toutes un catalogue de dispositions sécuritaires disparates qui n'ont, par définition, pas de lien entre elles.
Nous en avons encore l'exemple avec ce texte, dans lequel ont été introduites des dispositions relatives à l'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive, ou encore avec l'autorisation donnée aux personnels de la police nationale de faire usage de leur arme pour immobiliser un véhicule.

Sur ce dernier point, je tiens à dire que nous émettons des doutes sur l'application qui sera faite de cette mesure. En effet, les policiers pourront faire usage de leur arme non seulement si le conducteur d'un véhicule ne s'arrête pas à leurs sommations, mais également sans sommation, en raison du risque que constituerait le comportement du conducteur ou en cas de crime ou de délit flagrant. Cela ne risque-t-il pas, à l'avenir, de justifier des légitimes défenses qui n'en seraient pas ?
Pour conclure mon propos, permettez-moi de revenir sur la lutte contre le terrorisme. Je le répète, le terrorisme met à l'épreuve l'équilibre fragile entre la liberté et la sécurité. Or l'objectif des terroristes est de pousser l'État de droit dans ses retranchements et de provoquer les gouvernements afin qu'ils réagissent de manière abusive, s'aliénant au passage les opinions publiques et érodant progressivement les fondements de la démocratie.
Ce projet de loi illustre parfaitement mon propos, puisqu'il fait pencher la balance du côté de la sécurité au détriment du respect de la liberté.
Les sénateurs communistes républicains et citoyens rejettent avec force ce texte, parce qu'il est dangereux pour les libertés. De surcroît, il ne répond pas, selon nous, au grave problème du terrorisme.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la vidéosurveillance
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. » ;
3° bis Au VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »
Suppression maintenue
Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :
« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« - les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
« II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.
« III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.
« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.
« IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.
« V. - Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.
« VI. - Supprimé »
CHAPITRE II
Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste
I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
« - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »
II. - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.
I. - Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »
II. - Supprimé.
I. - Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-1-1. - Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.
« Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.
« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »
I bis. - Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.
« Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »
II. - 1 A. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».
1 B. Dans le premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que ».
1. Il est inséré, dans la même loi, un titre V intitulé : « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.
2. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. 27. - La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel
I. - Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
- des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
- des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.
III. - Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.
IV. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.
V. - Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
VI. - Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
« L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
« Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
« Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »
Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national de gestion des permis de conduire ;
- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
- le système de gestion des passeports ;
- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines
Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. »
Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables. »
I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots : « et les officiers de police » ;
2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise et d'application » sont remplacés par les mots : « d'encadrement et d'application », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d'une commission » ;
3° Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° ».
II. - Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ; ».
I. - L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, et de la cent vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article
« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
II et III. -- Supprimés.
CHAPITRE IV BIS
Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française
CHAPITRE V BIS
Dispositions relatives à l'audiovisuel
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes
I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »
III. - Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »
IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.
V. - L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »
VI. - 1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».
3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».
CHAPITRE VI BIS
Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;
2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; »
3° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;
4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé:
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ».
I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »
II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-8. - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »
CHAPITRE VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :
« 1°A Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 1° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de l'article 10-1, les mots : représentant de l'État dans le département sont remplacés par les mots : représentant de l'État ;
« 2° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1, les mots : commission départementale sont remplacés par les mots : commission locale ;
« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
« b) À la fin du VI de l'article 10, les mots : des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article 226-1 du code pénal ;
« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont supprimés ;
« 4° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail sont remplacés par les mots : et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »
I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 12 ter et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, 12 ter, 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence: « à L. 574-3 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».
IV. - Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme nécessite le concours de tous les élus de la République, ...

... qui ne doivent pas ménager leur soutien au gouvernement, quel qu'il soit, car nous devons lutter de toutes nos forces contre ce qui est la négation de la civilisation et de la démocratie.

La question qui nous est posée est de savoir dans quelles conditions il est légitime de prendre les mesures exceptionnelles qu'appelle nécessairement la lutte contre le terrorisme.
Nous pensons que, parce que ces mesures sont nécessairement exceptionnelles, les conditions dans lesquelles elles doivent être prises appellent une attention toute particulière.
D'un côté, et nous l'avons dit à la tribune lors de la discussion générale, il est si important de lutter contre le terrorisme qu'il convient de ne ménager aucun effort.
D'un autre côté, notre collègue Robert Badinter l'a expliqué avec beaucoup de force, la plus grande victoire des terroristes serait de faire abdiquer nos démocraties sur les principes de l'État de droit alors même que cela ne serait pas nécessaire.
La question de savoir jusqu'à quel point et dans quelles conditions on peut prendre des dispositions exceptionnelles est ancienne.
Pour notre part, nous ne pouvons approuver le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre délégué, et ce pour deux raisons.
Premièrement, ce texte dans son ensemble a malheureusement pour objet de dessaisir les juges de leurs prérogatives. Or, qu'il s'agisse de vidéosurveillance, de contrôle des déplacements, des communications et des échanges téléphoniques et électroniques, nous considérons qu'il est nécessaire que certaines décisions soient prises par l'autorité judiciaire.
Nous tenons à cette occasion à rendre hommage aux juges antiterroristes, car ils font un travail très difficile, ...

... comme nous rendons hommage à l'ensemble des magistrats, des policiers et des gendarmes qui oeuvrent dans ces domaines.
Les parquets sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour prendre des décisions. Il existe des procédures très rapides, et nous sommes en droit d'attendre d'eux toute la célérité nécessaire. Nous sommes donc contre votre décision de leur retirer le pouvoir au bénéfice d'instances administratives.
Pour ce qui est des prérogatives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en matière d'échanges téléphoniques et électroniques, je précise que cette instance est présidée par un magistrat désigné par le Président de la République, sur proposition du vice-président du Conseil d'État et du Premier président de la Cour de cassation. Or ses pouvoirs sont supprimés en l'espèce, et on lui substitue une personnalité qualifiée, nommée par le ministre de l'intérieur : cela ne nous paraît pas acceptable.
De la même manière, pour ce qui est de la liberté d'aller et venir et des contrôles y afférant, il ne nous paraît pas acceptable que ce texte donne des pouvoirs exorbitants au pouvoir exécutif, hors du contrôle des juges - j'y insiste -, lorsqu'il s'agit des « grands rassemblements » et des « événements particuliers ». Qu'est-ce qu'un « grand rassemblement » ?

Quant à la notion d'« événements particuliers », elle est tellement floue et imprécise qu'elle peut viser n'importe quel événement.

Par conséquent, mes chers collègues, ce texte donne au pouvoir exécutif et à ses services administratifs un pouvoir quasiment illimité sur tout ce qui concerne la vie personnelle. Cela ne nous semble pas justifié car, dans tous les cas que j'ai cités, il était tout à fait possible de laisser la décision à la justice, quitte à apporter des précisions pour l'application de ces mesures. Et, si tel avait été le cas, nous aurions voté ces dispositions.

M. Jean-Pierre Sueur. J'en viens très rapidement, monsieur le président, à ma conclusion.
Protestations sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, le sujet est important, et je veux seulement ajouter deux phrases.

M. le président. Non ! Je risquerais alors d'être l'objet d'un rappel au règlement, car vous avez déjà dépassé votre temps de parole !
Sourires

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il faut respecter le règlement, monsieur le président !
Nouveaux sourires
Nouvelles protestations sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes résolument opposés à tous les amalgames opérés par ce texte. Je pense, d'une part, à l'amalgame entre la lutte contre la délinquance et la lutte contre le terrorisme, qui permet aux moyens destinés à cette dernière de s'appliquer très largement hors des situations de terrorisme. Je pense, d'autre part, à l'amalgame, inacceptable selon nous, entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration étrangère, car il entraîne toute une série de procès d'intention dont les conséquences peuvent être désastreuses.

C'est pourquoi, monsieur le président, nous voterons contre ce texte, ...

...pour les raisons que j'ai dites et, compte tenu des problèmes qui se posent par rapport à l'État de droit, notre groupe saisira le Conseil constitutionnel.

Monsieur Sueur, permettez-moi ce rappel à notre règlement : vous vous êtes exprimé pendant six minutes et cinquante-quatre secondes, alors que le temps qui vous était imparti était de cinq minutes !

M. Jean-Pierre Sueur. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, monsieur le président !
Sourires

Rassurez-vous, monsieur le président, je ne reviendrai pas sur les raisons de notre opposition à ce texte, elles ont été largement exprimées au cours du débat et, aujourd'hui encore, à la tribune, par Mme Assassi. Permettez-moi toutefois de souligner à quel point le discours de M. le ministre est inquiétant.
J'ai rarement entendu des propos aussi partisans et insultants pour une partie de la représentation nationale, qui a été pratiquement qualifiée publiquement d'irresponsable.
Ces propos, hélas ! ne nous étonnent guère, puisqu'ils prennent place parmi les interventions irresponsables et provocatrices des membres de la majorité, ministres ou élus, ... jusqu'à M. Éric Raoult, s'exprimant dans l'hebdomadaire Minute, pour demander la mise sous tutelle d'un maire voisin, sûrement dans le cadre de l'arrestation de terroristes !
Monsieur le président, monsieur le ministre, il est de la responsabilité de ceux qui ne sont pas dupes de la manipulation politicienne du terrorisme, de la délinquance, de l'immigration, pas plus que des amalgames de toute sorte - à des fins évidemment politiques -, de le dire, de le dénoncer et, surtout, de s'y opposer !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, lorsque nous légiférons en matière de terrorisme, il est de notre devoir de maintenir fidèlement un cap, en gardant à l'esprit le double objectif qui s'impose à nous.
D'une part, il s'agit d'assumer notre responsabilité au service de nos concitoyens en leur garantissant que les services de police et de gendarmerie puissent bénéficier de tout l'arsenal technique et technologique nécessaire pour prévenir les actes terroristes.
D'autre part, il s'agit de s'assurer que toutes les mesures que nous adoptons s'inscrivent dans le cadre de la préservation des libertés publiques.
Le texte que nous apprêtons à adopter répond à cette double exigence et nous pouvons nous enorgueillir d'améliorer notre droit qui, en la matière, fait déjà figure d'exemple parmi les grandes démocraties. Cela tient sans doute à notre procédure inquisitoire, qui est particulièrement adaptée puisqu'elle place les magistrats au coeur du dispositif.
Nos partenaires nous envient la qualité de nos services de lutte contre le terrorisme et l'efficacité de notre procédure. Pourquoi devrions nous en rougir ?
Nous ne comprenons donc pas la position du groupe socialiste du Sénat en la matière.

La législation antiterroriste a toujours, jusqu'à aujourd'hui, fait l'objet d'un consensus entre les grands partis à vocation majoritaire.
Ces errements, cette volonté de politiser un débat sur lequel nos concitoyens attendent un front uni, nous semblent regrettables et les arguments que nous avons entendus nous paraissent particulièrement infondés. À croire que nous ne parlons pas du même texte !
La vidéosurveillance, la densification des sources d'information ne sont rien d'autre que des mesures que les magistrats eux-mêmes nous demandent de mettre en place pour assurer leur mission et s'adapter à l'évolution permanente des cellules terroristes.
Nos concitoyens seront seuls juges de cette attitude polémique !
Pour notre part, nous assumerons nos responsabilités face à eux et le groupe UMP votera ce texte tel qu'il ressort de nos travaux.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette que ce débat ne soit pas serein.
Parce que nous exprimons nos positions, parce que nous développons nos arguments sur l'efficacité de ce texte par rapport aux libertés publiques fondamentales, nous sommes accusés d'« errements » - c'est le dernier mot utilisé - et nous sommes suspectés de « politiser le débat » - quelle vilaine chose ! - et de manquer d'esprit d'ouverture.
Pour ma part, j'ai le sentiment que, au travers des amendements que nous avons déposés - et qui ont tous été rejetés -, ...

... nous avons apporté notre contribution à ce débat. Où est donc l'esprit d'ouverture ? Je le cherche !
Quoi qu'il en soit, comme mon collègue Jean-Pierre Sueur, je considère que l'on nous a présenté un projet fourre-tout et qu'un nombre considérable des articles qui le composent sont étrangers à son objet même, qu'il s'agisse de la carrière des policiers, de l'accès pour les douaniers au fichier des véhicules, de la généralisation du délit de non-justification des ressources par rapport au train de vie, de la lutte contre le hooliganisme dans les stades - certes, c'est un vrai problème qui mérite effectivement que l'on prenne des mesures, mais il n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme ! -, ou encore de la lutte contre l'immigration clandestine.
Il s'agit donc d'un texte inefficace, d'un texte fourre-tout, rempli de cavaliers.
Nous l'avons dit, nous ne pensons pas que le doublement des peines soit de nature à décourager les terroristes : les cas les plus récents montrent que ces derniers ne sont pas dissuadés par les peines, de quelque nature qu'elles soient. J'ajoute d'ailleurs, après M. Badinter, que le doublement des peines alourdira les procédures de jugement.
L'allongement de la période durant laquelle le condamné pour fait de terrorisme pourra être déchu de la nationalité française n'est pas, lui non plus, de nature à dissuader les terroristes de passer à l'action.
Voilà donc un texte qui procède par amalgames successifs : amalgame avec la délinquance ordinaire, amalgame avec l'immigration clandestine, amalgame aussi avec certains de nos concitoyens d'origine étrangère !
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte et nous saisirons le Conseil constitutionnel.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, MM. Jean-Pierre Sueur et Richard Yung ont fort bien exposé les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire.
Sans reprendre ce qu'ils ont très bien dit sur la nécessité de combattre fortement le terrorisme, j'insisterai sur le fait nous serons d'autant plus forts dans cette lutte que nos libertés seront préservées. Les deux extrémités de cette problématique se tiennent ! Un parlementaire de qualité, issu des rangs centristes, n'a-t-il pas écrit naguère - mais cela demeure d'actualité ! - un petit livre intitulé : L'Immigration, une chance pour la France ? Nous en sommes loin !
L'article 6 du présent projet de loi - un de ceux qui n'ont pas été modifiés - contribuera justement, hélas ! à mettre en condition la population, puisqu'il y est question de lutte contre l'immigration clandestine à l'occasion d'un texte destiné, nous dit-on, à combattre le danger terroriste. C'est assez grave !
Nous aimerions que, dans notre pays, au sein de toutes les familles politiques, naisse enfin la volonté de poser la problématique d'une véritable politique de l'immigration. En effet, chaque fois que l'on s'en sert pour des raisons sécuritaires ou pour mettre en condition la population, on commet, selon moi, une mauvaise action à l'encontre de la France et de son renom international.
J'ai d'ailleurs lu récemment une déclaration de Mme Christine Boutin - dont j'ai apprécié l'action lorsqu'elle était membre de la commission d'enquête sur les prisons, que je présidais à l'Assemblée nationale - dans laquelle elle met en garde certaines personnalités de la majorité actuelle contre le « tout sécuritaire ». Effectivement, l'envahissement du « tout sécuritaire » est extrêmement grave.
Parce que nous ne sommes pas persuadés de l'efficacité des mesures qui sont proposées dans ce projet de loi, parce que nous craignons qu'il puisse de nouveau restreindre les libertés et parce que nous constatons que, une nouvelle fois, le problème de l'immigration est posé de façon provocatrice et absurde, nous voterons contre ce texte. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai, bien entendu, en faveur de ce projet de loi, comme l'ensemble du groupe UMP.
Au risque de me répéter, j'indique que, comme chacun sur ces travées, j'ai le souci du respect des droits de l'homme.

Pour autant, je pense que nous ne devons pas tomber dans l'excès inverse en voulant à tout prix « freiner » sur les mesures prises pour lutter contre le terrorisme.
Je vous le rappelle, j'ai été pris en otage, et je sais ce que cela représente et comment les choses se passent. Alors, je veux bien que l'on prenne soin de protéger les citoyens, mais il ne faut pas que les mesures que l'on prend aillent trop loin dans la protection et ne servent pas la lutte contre le terrorisme. Nous devons trouver la juste mesure.
Peut-être ce projet de loi est-il un texte fourre-tout, mais il a le mérite d'exister, et il nous servira à lutter contre le terrorisme. Il n'est peut-être pas parfait - rien n'est parfait en ce monde ! -, mais il existe !
Vous vous inquiétez des mesures qui sont prises, mes chers collègues ? Pour ma part, je m'inquiète davantage du terrorisme !

M. Robert Del Picchia. Nous allons donc adopter ce texte avec confiance car, s'il n'est pas parfait, il a au moins l'avantage d'exister !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je veux remercier une fois de plus M. le rapporteur de son intervention et du travail qu'il a accompli, et saluer la présence au banc de la commission de M. le président Hyest.
Madame Assassi, j'ai relevé un élément très intéressant dans votre intervention : vous avez parlé d'« efficacité limitée ». Dans ces conditions, à partir du moment où vous reconnaissez un tant soit peu d'efficacité à ce texte, pourquoi ne votez-vous pas en sa faveur ?
Monsieur Sueur, vous avez fait, une fois de plus - vous n'avez d'ailleurs pas cessé de le faire tout au long de l'examen de ce texte -, l'amalgame entre terrorisme et immigration clandestine.
Non ! C'est vous, et vous seul, qui faites cet amalgame !
Je rappelle que les auteurs de ce texte se sont contentés de procéder à la transposition d'une directive européenne prise au lendemain des attentats de Madrid et faisant référence aux moyens dont doit se doter l'Union européenne en matière à la fois de lutte contre l'immigration clandestine et de lutte contre le terrorisme. C'est l'Union des vingt-cinq qui a fait ce choix ! Nous nous sommes contentés de respecter cette volonté, en transposant cette décision. Pour le reste, c'est votre amalgame et votre amalgame seul !
Madame Borvo Cohen-Seat, vous avez parlé de propos insultants là où le Gouvernement n'a cessé de se montrer ouvert et d'appeler au rassemblement de tous les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Et je le fais en cet instant une fois de plus !
À MM. Yung et Mermaz, je rappelle simplement que, contrairement à ce qu'ils affirment aujourd'hui, le Gouvernement s'est montré très ouvert, puisque deux amendements du groupe socialiste ont été retenus au Sénat, et cinq à l'Assemblée nationale Nous nous sommes contentés de rejeter - ce qui est bien naturel ! - les amendements de suppression que vous aviez déposés.
Pour le reste, il me semble que la Haute Assemblée a été suffisamment éclairée pour que je n'entre pas dans le détail de tous les points qui ont été soulevés par les différents orateurs.
En conclusion, si je remercie les intervenants du groupe UMP, MM. Béteille et Del Picchia, de leur soutien, je constate que, ce matin, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé par la voix de Christophe Caresche, s'est dit prêt à voter ce texte malgré quelques points de divergence, et a regretté que l'état d'esprit d'unité prédominant au Palais-Bourbon ne prévale pas au Palais du Luxembourg. Cette attitude montre vos grandes contradictions !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
M. Caresche a ainsi rappelé que, en 1986, l'opposition s'était abstenue lors du vote du premier texte de lutte contre le terrorisme, qui était alors présenté par M. Charles Pasqua.
En 2001, l'opposition s'était également abstenue sur le texte de loi qui avait été présenté par M. Daniel Vaillant au nom du gouvernement de M. Jospin au lendemain des attentats de New York.
Jusqu'à aujourd'hui, la tradition a toujours été que, quel que soit leur appartenance, les partis de gouvernement manifestent une vraie volonté d'unité dans la lutte contre le terrorisme.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Caresche a lui-même fait part de son incompréhension face à votre attitude. Et pourtant, vous vous retrouvez autour de la même table rue de Solferino ! Cela montre bien la grande contradiction qui existe, au sein même de votre formation politique, entre ceux qui adoptent une attitude responsable et les autres.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. À l'instar de M. Béteille, je conclurai en disant que, face à cette menace importante qui pèse sur notre pays et sur les démocraties en général, les citoyens français seront les seuls juges.
Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Quand M. Estrosi fait à ce point l'éloge d'un socialiste, je me méfie !

Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une de la commission des lois, l'autre du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 74 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche étant retenu à l'Assemblée nationale, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole (n° 122).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui au terme du processus qui devrait déboucher, dans quelques minutes, sur l'adoption définitive de ce très important projet de loi d'orientation agricole.
Ainsi que vous le savez, les attentes sont très fortes à ce sujet, la dernière loi d'orientation agricole ayant été adoptée en 1999.
Le présent texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dont M. le président de la commission des affaires économiques fut le rapporteur. Il fixe des orientations claires pour notre agriculture, à l'heure où l'actualité internationale et communautaire est particulièrement dense sur le sujet, qu'il s'agisse de la fin de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à Hong Kong, ou de l'accord européen sur les perspectives budgétaires pour la période 2007-2013.
Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, le présent projet de loi fixe des perspectives de moyen et de long terme ambitieuses pour nos agriculteurs, qui ont aujourd'hui besoin de repères stables et d'un engagement politique fort pour continuer à exercer leur métier.
À cet égard, je me réjouis tout d'abord que le présent texte soit finalement adopté et promulgué avant la fin de l'année, soit environ un an après le début du grand débat national qui l'aura précédé !
Il s'agissait d'une demande insistante du président de notre commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Émorine. Je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez donné suite rapidement à ce projet.
Le 1er janvier 2006 sera marqué par l'entrée en vigueur dans notre droit de l'intégralité de la PAC réformée. Il importait, pour des raisons tant techniques que politiques, que la loi d'orientation agricole puisse entrer en application au même moment.
Je souhaiterais par ailleurs me féliciter du travail très important fourni par le Parlement sur le présent projet de loi. Notre assemblée, en ce qui la concerne plus spécifiquement, l'a examiné durant six jours - et permettez-moi d'ajouter, monsieur le ministre, pendant six nuits - et 763 amendements ont été déposés. Le débat démocratique a bien eu lieu et a été d'un très bon niveau, ainsi que cela a été reconnu sur toutes les travées de cet hémicycle. La chaleur qui a pu animer les échanges sur certains thèmes particulièrement sensibles témoigne d'ailleurs de l'important investissement personnel qui l'a accompagné.
Je souligne également la qualité du dialogue avec l'Assemblée nationale. C'est dans un esprit de concertation et de respect mutuel - ce qui n'empêche en rien les débats, bien au contraire - que nos deux assemblées se sont efforcées d'enrichir le texte qui leur était initialement soumis, afin de parvenir à un accord.
De ce point de vue, je salue tout particulièrement mon homologue de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Antoine Herth, qui a fourni un excellent travail.
Je rappelle que le projet de loi comptait 35 articles lors de son dépôt par le Gouvernement, puis 85 à l'issue de la discussion à l'Assemblée nationale et, enfin, 115 après son examen par le Sénat.
Je salue également le remarquable travail effectué par le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Joël Bourdin, sur les volets du texte dont il était saisi.
Je souhaite aussi rendre hommage à notre président de commission, M. Jean-Paul Emorine, qui a éclairé nos travaux tout au long des dernières semaines et qui aura été à l'origine de l'important article étendant progressivement le mécanisme de l'assurance récolte. Sa contribution sur le sujet a été décisive.
Enfin, je tenais à vous remercier personnellement, monsieur le ministre, de l'écoute et de la connaissance du monde agricole dont vous avez fait preuve tout au long de la discussion du projet de loi d'orientation, ainsi que des échanges utiles et constructifs que j'ai eus avec l'ensemble de vos collaborateurs et de vos services.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 8 décembre pour examiner les 105 articles qui restaient en discussion. Elle a adopté plus d'une centaine d'amendements. Si certains étaient rédactionnels ou portaient sur des mesures de coordination et de précision, trente-cinq d'entre eux concernaient le fond du texte.
A l'article 2, la commission mixte paritaire est revenue à la rédaction de l'Assemblée nationale concernant la définition de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur.
A l'article 5 bis, elle a rétabli un dispositif précisant les conditions de recours contre certaines installations d'élevage classées.
A l'article 6, elle a ramené à 2010 la date limite d'application du dispositif de « crédit transmission » pour l'installation.
A l'article 6 quater, la commission mixte paritaire a rétabli la possibilité de déroger à la règle de la réciprocité en matière de distance d'éloignement entre les installations agricoles et les bâtiments d'habitation. C'est un sujet que nous connaissons bien : le Sénat avait rejeté cette proposition faite par les députés. Nous avions en effet estimé que cette disposition était de nature à créer et à alimenter de nombreux contentieux et risquait, en définitive, de se retourner contre l'agriculture et les agriculteurs. J'ajoute qu'elle aurait également pu être source de problèmes avec nos futurs voisins ! Vous l'aurez compris, je n'ai pas changé de point de vue sur cette question.
A l'article 9 ter, la commission mixte paritaire a décidé d'étendre aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, les ETARF, les réductions de charges sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels, revenant ainsi sur l'amendement que le Sénat avait adopté sur proposition du Gouvernement.
Elle a supprimé les articles 10 nonies et 10 decies, qui modifiaient la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, en matière d'aide à l'installation.
S'agissant de l'article 11 bis et du problème très polémique des sacs en plastique, la commission mixte paritaire a confirmé sur le fond la position du Sénat et interdit les seuls sacs de caisse à usage unique à compter du 1er janvier 2010. En outre, elle a souhaité ouvrir des possibilités pour l'avenir en adoptant, sur l'initiative du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Patrick Ollier, un amendement renvoyant à un décret le soin de déterminer les usages du plastique pour lesquels l'incorporation progressive dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire.
La commission mixte paritaire a élargi le champ de l'article 12 sur l'autoconsommation des huiles végétales pures et étendu son bénéfice à l'avitaillement des navires de pêche, ce dont on ne peut que se féliciter.
En ce qui concerne les organisations de producteurs visées à l'article 14, elle a également souhaité maintenir la possibilité pour les comités économiques agricoles de créer des fonds de mutualisation.
Avec notre accord, elle a supprimé l'article 20 bis, introduit par le Sénat, qui ouvrait la possibilité pour les exploitants agricoles de provisionner les cotisations sociales.
Pour ce qui est de l'évaluation et de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévues par l'article 21, elle a encadré le dispositif de façon à ce qu'il respecte les réglementations nationale et communautaire.
Sur le point très débattu de l'apposition de la dénomination « montagne » sur un produit AOC, autorisée par l'article 22 bis, la commission mixte paritaire a retenu une version de compromis maintenant l'interdiction de la superposition, excepté dans le cas où la zone d'AOC serait entièrement située en zone de montagne. Cette solution devrait permettre d'éviter la segmentation des produits, contre laquelle nous nous étions prononcés de façon presque unanime.
Toujours en ce qui concerne les signes de qualité, la commission mixte paritaire a retiré les certifications de conformité produit, les CCP, de la catégorie des signes d'identification de la qualité et de l'origine et en a fait une catégorie à part entière.
Enfin, sur l'initiative des deux rapporteurs, elle a inséré un nouvel article 25 septies A visant à mettre en place un régime de sanctions pénales à l'appui des règles encadrant la pêche maritime.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai la conviction que ce projet de loi est un texte équilibré, qui devrait satisfaire les attentes du monde agricole en lui fixant des perspectives claires et prometteuses pour l'avenir.
Je vous propose donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, de retour d'une nuit bruxelloise consacrée au poisson, je suis heureux d'être devant le Sénat ce matin pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation agricole.
Je vous remercie de votre investissement tout au long de l'élaboration de ce texte. Je salue tout particulièrement l'implication personnelle très forte de M. le rapporteur, Gérard César, dont l'engagement et la compétence ont contribué à la tenue du débat.
Ce compliment s'adresse également à son complice, M. le président de la commission des affaires économiques et du Plan, Jean-Paul Emorine, dont l'autorité et la sagesse ont été plusieurs fois sollicitées et dont la contribution en matière d'assurance récolte a été importante.
Enfin, ces compliments s'adressent naturellement aux porte-parole de tous les groupes, ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs, nombreux, qui se sont impliqués dans l'examen de ce projet de loi.
Si vous l'acceptez, nous nous retrouverons d'ailleurs de manière informelle et amicale au mois de janvier, lors de la rentrée parlementaire, pour évoquer ce texte dans des conditions agréables, autour de quelques produits charentais.

M. Jean-Paul Émorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Et bourguignons !
Sourires
Naturellement ! Mais les produits charentais couvrent assez bien le terroir...
Ce texte vous est soumis, vous l'aurez noté, à un moment important : les négociations à Hong Kong de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, où la Haute Assemblée était représentée par plusieurs sénateurs connaissant bien ces sujets, viennent de s'achever. Celles-ci n'ont pas été faciles, car l'Europe était assez isolée entre les Brésiliens, le groupe de Cairns, les Américains, les pays du G20 et les pays du G90, mais elle s'en est finalement bien tiré.
À cet égard, l'accord de Bruxelles, sur l'initiative du Président de la République, a permis aux Européens de se ressouder in fine, à un moment où il était important pour eux de savoir ce qu'ils étaient prêts à accepter ou non. Et, comme je l'ai dit hier, les engagements que nous avons pris sont réciproques. Le cadre de la PAC a été respecté et les concessions partagées. Nous y demeurerons très attentifs.
Comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues de l'Assemblée nationale, le commissaire Mandelson, que j'avais parfois un peu malmené, a bien défendu les intérêts européens, avec beaucoup de fermeté, alors que la situation n'était pas facile.
Parallèlement à la réunion de l'OMC, la réforme de la politique agricole commune, à laquelle 293 milliards d'euros seront consacrés, a été confortée par le Conseil européen.
Les objectifs du premier pilier et du deuxième pilier seront respectés. Les chiffres étant connus, nous savons désormais comment programmer notre développement rural. Ces chiffres sont naturellement un peu moins bons que ceux du compromis luxembourgeois, mais ils nous permettront de financer nos politiques.
Sur le terrain, la réforme de la PAC se met en place. Ainsi, les droits à paiement unique entreront en vigueur à partir du 1er janvier prochain.
Par ailleurs, comment ne pas évoquer, puisque nous parlons de l'actualité agricole, le débat sur la grippe aviaire, qui a préoccupé nos concitoyens ?
Je note avec plaisir que, en cette période de Noël, les chiffres de la consommation, en ce qui concerne tant les prix que les commandes, sont bons. Même si nous constatons un petit tassement, nous ne connaissons pas les pertes que nous avions redoutées à certains moments.
Dans ce cadre, le projet de loi d'orientation agricole offre des perspectives. Je ne reviendrai pas sur le contenu de ce texte, dont nous avons déjà longuement débattu. Je ne rappellerai que ses orientations majeures.
Ce texte permet d'adapter le statut de l'exploitation agricole pour encourager la démarche entrepreneuriale et d'améliorer la qualité de la vie et le revenu des agriculteurs. Ce dernier - on l'a vu cette semaine - est malheureusement en baisse, du fait de la crise viticole, que beaucoup d'entre vous connaissent bien.
Ce texte permet par ailleurs de développer de nouveaux débouchés - la Haute Assemblée y a été très attentive - dans les domaines de la chimie verte et des biocarburants. Enfin, il permet de renforcer l'organisation économique et de mieux maîtriser les risques. Il répond aux attentes de la société en matière de sécurité sanitaire, de qualité des produits et de respect de l'environnement.
Je voudrais maintenant revenir sur le débat lui-même. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, celui-ci a été riche et constructif. En effet, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, 2 000 amendements ont été déposés. C'est beaucoup ! Ce débat s'est d'ailleurs nourri des travaux de parlementaires en mission, entre autres de ceux de M. Jean-Marie Le Guen.
L'Assemblée nationale a enrichi le texte sur les biocarburants. Elle est ainsi à l'origine de l'interdiction, à compter de 2010, de l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables, ainsi que de l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole.
Le Sénat, quant à lui, est à l'initiative de mesures très fortes améliorant la protection sociale, notamment les retraites des polypensionnés. Cette initiative est très saluée sur le terrain, nous le savons tous. Par ailleurs, il a pris des mesures concernant le 1 % logement. Enfin, il a engagé la généralisation de l'assurance récolte, mécanisme que j'ai déjà évoqué tout à l'heure en rendant hommage à M. Emorine.
Conjointement, les deux assemblées ont participé à la définition de trois chapitres sur la protection de l'espace agricole, la forêt et la montagne, donnant ainsi une dimension « territoires » à ce projet de loi et illustrant sa complémentarité avec la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.
Enfin, grâce à votre implication et à l'intérêt dont vous avez fait preuve - je pense en particulier à M. le président et à M. le rapporteur de la commission des affaires économiques -, le nombre d'ordonnances a été significativement restreint. Celles-ci seront limitées à des aspects techniques, l'orientation générale du texte étant affirmée dans le coeur de la loi.
Après le vote, voilà moins d'une demi-heure, de l'Assemblée nationale et, nous l'espérons, celui du Sénat dans quelques instants, il conviendra d'assurer le service après-vote. Je tiens à vous dire, à cet égard, comment les choses vont se passer et de quelle manière je souhaite, si vous l'acceptez, vous y associer.
Le projet de loi qui vous est soumis comporte aujourd'hui cent quatre articles, dont cinquante-huit, soit plus de la moitié, sont d'application directe. Nous devons donc maintenant travailler sur les ordonnances, sur cinquante-six décrets - dont dix-neuf en Conseil d'État, un en conseil des ministres et trente-six décrets simples -, ainsi que sur quatre arrêtés.
Mon objectif est que les ordonnances et les décrets importants concernant les points essentiels de ce texte - la déclaration du fonds agricole, l'organisation économique, les signes de qualité ou l'élevage - soient transmis au Conseil d'État le plus rapidement possible, en tout état de cause avant la fin du premier semestre de 2006. Ils feront naturellement l'objet d'une concertation, à laquelle seront associés les professionnels, mais également les parlementaires, comme je vous l'avais indiqué au cours du débat.
Monsieur le président de la commission des affaires économiques, je me propose de venir devant votre commission au mois de juin prochain pour vous informer de l'état d'avancement des textes réglementaires et de leur contenu. Nous pourrons ainsi, tout au long de l'élaboration de ces textes, travailler en concertation - M. César, je le sais, y est prêt, comme son collègue M. Herth, à l'Assemblée nationale - de manière que le Parlement exerce son droit de suivi sur les textes d'application qui seront pris dans l'esprit du projet de loi que vous allez, je le souhaite, adopter.
Pour tous les autres textes d'application, je veillerai également à associer les parties concernées.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est important, la richesse des débats et le temps qui y a été consacré l'ont montré.
Nous avons, ensemble, mis à la disposition des agriculteurs, des entrepreneurs, des consommateurs, des outils nouveaux et nous avons été très attentifs au respect des équilibres territoriaux, environnementaux et sanitaires, dimension à laquelle le Sénat est toujours très sensible.
Ce texte encourage, selon le précepte du Président de la République que j'ai déjà cité, « une agriculture économiquement efficace et écologiquement responsable ». Il permet, dans le cadre d'une PAC financée jusqu'en 2013 et dans celui de l'OMC, qui est aujourd'hui mieux défini, de donner à nos exploitants les moyens de travailler en confiance, avec une vision de l'avenir, et à tous les Français des raisons supplémentaires d'être fiers de leur agriculture.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir contribué à cette oeuvre commune avec autant de pugnacité et de talent.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons une dernière fois le projet de loi d'orientation agricole, sur lequel l'urgence a été déclarée ; la commission mixte paritaire réunie le jeudi 8 décembre 2005 a trouvé un accord sur un texte qui nous laisse une forte impression d'insatisfaction et de frustration.
Nous réitérons le constat fait lors des débats : ce projet de loi apparaît comme un rendez-vous raté entre l'État et les agriculteurs, qui plaçaient pourtant beaucoup d'espoir dans ce texte, dans un contexte européen et international très préoccupant pour leur avenir.
À la fin des débats, une seule question mérite encore d'être posée : cette loi d'orientation agricole permettra-t-elle aux agriculteurs de faire face aux nouveaux défis lancés tant au niveau européen qu'au niveau international ?
En effet, les hasards du calendrier ont fait que, la semaine dernière, à la fois le Conseil européen et les États membres de l'OMC se sont trouvés réunis. Ils ont pris des décisions importantes touchant directement les agriculteurs pour les décennies à venir.
Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dispositions restées en discussion et qui ont trouvé, vaille que vaille, au cours de la CMP, une nouvelle rédaction de compromis.
Je reviendrai brièvement sur certains points aussi importants et porteurs de sens pour l'avenir que la multifonctionnalité ou la diversité des activités agricoles, à peine évoqués dans ce texte.
Ainsi, je déplore le refus de réintroduire l'article 1er bis qui prévoyait que, si le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, présentait une taille économique suffisante, un jeune agriculteur pouvait en devenir membre par simple apport en numéraire.
Autre exemple significatif : un amendement portant article additionnel avait été adopté au Sénat visant « à promouvoir et aider à l'installation des nouveaux agriculteurs, dès lors que la surface de l'exploitation disponible correspond sensiblement ou plus à la surface de référence définie par la commission départementale des structures agricoles et ceci en priorité sur tout projet d'agrandissement éventuel ». Pourquoi cet article 10 decies a-t-il été supprimé en CMP, alors que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ne cessent de dire qu'ils veulent aider les jeunes agriculteurs à s'installer et éviter l'hémorragie des exploitations agricoles sur notre territoire ?
Pourquoi refuser la prise en compte pour la retraite d'exploitant des périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial agricole à partir de l'âge de quatorze ans ? Quand on sait combien il est difficile de se constituer une véritable et « si faible » retraite, cette prise de position nous paraît très choquante.

Ces exemples, concernant à la fois les jeunes agriculteurs et les futurs retraités, illustrent bien le peu de prise en compte par le Gouvernement des réalités vécues par les agriculteurs aujourd'hui.
Les jeunes agriculteurs n'ont pas trouvé dans ce texte les propositions concrètes qui les auraient rendus moins amers et plus optimistes pour l'avenir, un avenir qui s'annonce très difficile face à la concurrence des nouveaux pays partenaires de l'Union européenne et, surtout, face aux nouvelles règles commerciales entérinées par l'OMC à Hong Kong.
Avec plus de conviction encore que lors de notre vote négatif du 9 novembres 2005 sur ce projet de loi d'orientation agricole, nous affirmons aujourd'hui que, au lieu de renforcer la situation de l'ensemble des agriculteurs sur le territoire français par des mesures financières et environnementales concrètes, porteuses d'avenir, ce texte semble malheureusement s'inscrire dans les logiques du « tout libéral » exprimées dans les conclusions de l'Union européenne et de l'OMC.
Ne pouvant cautionner ces choix, le groupe socialiste réitère son vote négatif, tout en reconnaissant quelques avancées positives, ...

... qui devraient aider le monde agricole à surmonter, vaille que vaille, les crises annoncées !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation agricole ne présentent, on le sait, qu'un caractère formel.
Nous regrettons que l'urgence ait été déclarée sur ce texte. Le Gouvernement a ainsi écourté le débat parlementaire, alors même que les enjeux en présence sont fondamentaux pour les agriculteurs et, plus généralement, pour l'avenir du monde rural, pour le développement harmonieux du territoire ou encore pour notre souveraineté alimentaire.
Cette précipitation n'a pas permis de retranscrire dans le texte ce qui s'entend dans le pays venant de nombreux syndicats, y compris parfois du syndicat majoritaire.
Nous avons appris la semaine dernière que le revenu des paysans avait baissé de 10 % en 2005, après une baisse de plus de 7 % en 2004. Effectivement, il y a urgence !
Urgence à fixer des prix rémunérateurs pour les produits agricoles, urgence à assurer un niveau de vie décent pour nos agriculteurs, en activité ou à la retraite, urgence à stopper la financiarisation écrasante du secteur agricole, urgence à adapter les prix agricoles au niveau de vie de chaque pays sans pénaliser les consommateurs.
Ainsi, en créant le fonds agricole et le bail cessible, vous encouragez la valorisation artificielle des exploitations agricoles, sans mesurer, semble-t-il, les effets néfastes de telles dispositions pour la transmission de ces exploitations, le renouvellement des générations en agriculture.
Dans le même sens, le projet de loi tend à précariser le statut des fermiers : les pas-de-porte seront légalisés, le renchérissement des prix des loyers des fermes pourrait bientôt se généraliser ; si le bail cessible attire les foules, les charges nouvelles qui en découleront pour les fermiers ne pourront que les fragiliser davantage.
En ce qui concerne le métayage, la commission mixte paritaire a confirmé, heureusement, la suppression de l'article 2 quinquies. Nous tenons, à ce sujet, à souligner que la viticulture a été largement oubliée dans ce projet de loi d'orientation agricole alors même que ce secteur connaît une crise importante.
Rappelons, à titre d'exemple, que les vignerons du Gard sont aux prises avec une crise de leur marché sans précédent, dans un contexte de baisse constante des cours payés aux producteurs, et cela alors même qu'ils avaient entrepris des efforts pour diminuer leur production et en améliorer la qualité.
Par ailleurs, le démantèlement progressif du contrôle des structures prévu par la loi entraînera très certainement une pression accrue sur le prix des terres; l'accès au foncier sera bientôt réservé aux plus riches. Les jeunes n'auront plus les moyens de s'installer. Nous regrettons d'ailleurs que les quelques mesures qui allaient dans le bon sens pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER - aux articles 10 nonies et 10 decies - aient été supprimées.
Avec les modifications apportées au statut des organisations professionnelles, le texte intensifie l'intégration des agriculteurs aux filières de transformation de l'industrie agroalimentaire. Au moment où la filière avicole traverse une grave crise, conséquence directe de sa forte intégration, vous cherchez à généraliser à toute l'agriculture un modèle qui démontre chaque jour sa totale inefficacité, et sa fragilité, aussi.
Ainsi, toutes les conditions seront désormais réunies pour faciliter la concentration foncière et transformer les derniers paysans de France en « agromanagers ». Tout rachat d'exploitation, toute installation de jeune agriculteur deviendront progressivement impossibles sans apport massif de capitaux externes, ce qui, par conséquent, augmentera la dépendance financière des uns et des autres.
L'orientation que vous souhaitez donner à notre agriculture est, en outre, au regard du contexte européen et international, absolument suicidaire pour la France.
Il ressort des négociations menées au sein de l'OMC que les riches pays du Nord subventionneraient leur agriculture pour accroître leurs marchés et donc pousser à la faillite les petits paysans du Sud. La suppression des aides à l'export en 2013 pénalisera les agriculteurs des pays du Nord sans mettre fin à l'exploitation honteuse des agriculteurs des pays du Sud.
En réalité, au niveau national comme au niveau international, les seuls vainqueurs du système seront les grands propriétaires, les grands groupes agroalimentaires et la grande distribution.
En décidant, comme vous le faites, d'encourager la constitution de grandes exploitations et de soumettre notre agriculture à des logiques de fonctionnement simplement capitalistes, vous confortez ce mouvement. D'ailleurs, la politique retenue par la France dans la répartition des aides communautaires en offre, s'il le fallait, un nouvel exemple.
Au lieu de renforcer la situation de l'ensemble des agriculteurs français, ce texte est une fuite en avant, voire un encouragement à s'inscrire dans les logiques de l'OMC.
Parce qu'ils refusent que les agriculteurs soient instrumentalisés au profit de la rentabilité des capitaux investis, comme le confirment les orientations libérales retenues dans ce texte, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE Ier
PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS
CHAPITRE Ier
Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;
1° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : « fonds » est remplacé à trois reprises par le mot : « terrains » et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien », sont remplacés par les mots : « Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».
Supprimé
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».
II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.
« À défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.
« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.
« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.
« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.
« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.
« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.
« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.
« Art. L. 418-3. Àdéfaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.
« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.
« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.
« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.
« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;
2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;
3° L'article 793 est ainsi modifié :
a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;
- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;
b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;
4° L'article 885 H est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme », sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;
5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants. » ;
6° L'article 885 Q est ainsi modifié :
- après les mots : « des droits immobiliers à destination agricole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P » ;
- dans le deuxième alinéa, les mots : « à long terme » sont supprimés ;
7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».
Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 411-2, les mots : « ou à son conjoint » sont remplacés par les mots : «, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 411-34 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, après le mot « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;
- dans la deuxième phrase, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, au partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
4° L'article L. 411-35 est ainsi modifié :
- dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
- dans le deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
- la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;
6° L'article L. 411-48 est ainsi modifié :
- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
8° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 411-60, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « partenaires d'un pacte civil de solidarité, » ;
9° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
10 ° L'article L. 412-5 est ainsi modifié :
- dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », est inséré le mot : «, partenaire » ;
- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
- dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
- dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L. 461-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
12 ° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-10, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;
13° Dans le 2° de l'article L. 462-5, après le mot : «conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société » et les mots : « ou à l'article L. 323-14 » sont insérés après les mots : « à l'article L. 411-37 ».
Supprimé
I. - L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 417-10. - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :
« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »
Supprimé
Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-51 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».
Supprimés
Supprimé
I. - La troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est ainsi rédigée : « Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »
III. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental », sont insérés les mots : « ou régional ».
Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».
I - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;
2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.
II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
I A. - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ».
I. - Le même alinéa est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».
I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».
II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;
3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;
4° Le 4° est abrogé ;
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »
6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
« c) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.
« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »
III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »
3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »
IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :
« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »
V. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Dans le second alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « d'installations classées », sont insérés les mots : « d'élevage, liées à l'élevage ou ».
Supprimés
I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 vicies A. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.
« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.
« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »
II. - 1. Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.
2. Supprimé
Supprimé
L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : «, de fonds agricoles » ;
2° Dans le deuxième alinéa
a
3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés, deux fois, les mots : «, le fonds agricole ».
L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
CHAPITRE II
Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes
Supprimé
I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ».
II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».
2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;
b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, pour l'une des qualités suivantes :
« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Supprimé
Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »
L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-16 - I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
« II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I ci-dessus au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
« IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II ci-dessus ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
« V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »
Supprimés
I.- Après l'article L. 716-1 du code rural, il est inséré un article L. 716-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-2. - Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.
« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
« Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi rédigé : « Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ».
III. - Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »
II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »
Supprimés
Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'État, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;
2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :
« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsque intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; »
3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »
TITRE Ier BIS
PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».
II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».
III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».
Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »
Supprimés
Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »
À la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».
I. - Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa (2°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;
2° Le quatrième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application. » ;
3° Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; »
4° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : « en vigueur à la date de cette décision » et, dans le huitième alinéa, les mots « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date ».
II. - Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance. ».
Supprimé
TITRE II
CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'ACTIVITÉ
CHAPITRE IER
Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers
I. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».
II. - Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »
III. - L'article L. 1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; »
3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :
« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :
« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »
Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation dans des zones naturelles sensibles de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
I. - Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :
« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »
II. - Supprimé
Au cinquième alinéa (b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ».
Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.
Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.
Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.
Supprimé
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 de l'article 265 bis A est remplacée par les trois phrases suivantes :
«Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits.» ;
1° bis Le second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est supprimé ;
2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :
« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.
« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
« Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
3° Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :
« Art. 265quater. - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »
II. - Dans le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.
IV et V. Supprimés
La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée :
« Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »
Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rédigé :
« 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »
CHAPITRE II
Organiser l'offre
I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;
2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;
3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1°A Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :
« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »
1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
a) Supprimé ;
a bis) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;
b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;
c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« - à participer aux actions internationales de développement. » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;
b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;
3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »
b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« 10° La participation aux actions internationales de développement ; »
3° bis L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;
3° ter Supprimé ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : «, aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 632-6 » ;
6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;
7° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;
8° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».
II bis. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, aux calendriers de livraison, aux durées du contrat ».
III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.
IV. - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
V. - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux », sont remplacés par le mot : « présidents ».
Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
« Section 1
« Règles susceptibles d'être étendues
« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.
« Section 2
« Procédure d'extension
« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
« Section 3
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 554-3. - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.
Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS
« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.
« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.
« Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.
« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.
« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »
Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. »
I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;
3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;
4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.
« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
« h) La dotation des réserves facultatives.
« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »
« Art. L. 524-2-2. - Supprimé ;
5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.
« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. À cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.
« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.
« Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.
« Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;
- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'État.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;
d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. » ;
e) L'article L. 531-2 est abrogé ;
6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.
« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.
« Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. »
II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.
« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »
2. Supprimé ;
III. - À l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »
V. Supprimé
I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».
III.- Supprimé
CHAPITRE III
Maîtriser les aléas
Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;
2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'État. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 362-16 sont supprimés ;
5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »
Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 » ;
3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;
4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.
« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.
« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;
« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;
« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.
« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ;
5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.
« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »
I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;
« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. » ;
B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;
« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;
« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;
« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;
« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.
« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.
« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.
« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :
« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »
Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :
« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.
« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;
c) Supprimé ;
2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
III.- Supprimé
Supprimé
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
TITRE III
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENSET DES CONSOMMATEURS
CHAPITRE IER
Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »
II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - À l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »
III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;
2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;
3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »
5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;
6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».
IV. - Supprimé
V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
V bis. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
VI. - Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;
2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;
2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;
3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;
4° Supprimé ;
5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;
6° Supprimé
Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par la phrase : « Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination montagne lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne. »
Supprimés
I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
« b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
« c) La mention agriculture biologique, attestant la qualité environnementale ;
« d) Supprimé ;
« 2° Les mentions valorisantes :
« a) La dénomination « montagne » ;
« b) Le qualificatif « fermier » ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » ;
« c) Les termes « produits pays » dans les départements d'outre-mer ;
« d) La dénomination « vins de pays », suivie d'une zone de production ou d'un département.
« 3° La démarche de certification des produits. »
II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination INAO, est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;
2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
« 5° Un conseil agréments et contrôles. »
II bis. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.
II ter. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et II bis du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;
2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.
IV. - Les dispositions des I, II, II bis et II ter entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III et au plus tard le 1er janvier 2007.
V.- Dans le premier alinéa de l'article L. 641-21 du code rural, le mot : « vins » est remplacé par les mots : « produits d'origine vitivinicole ».
CHAPITRE II
Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement
Supprimé
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.
« II. - A. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique ;
« B. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu ne puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :
« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;
5° Supprimé
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;
3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »
Supprimé
Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude...
le reste sans changement
Supprimés
Les articles 13 et 13-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont remplacés par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :
« a) une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros.
« Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction.
« En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles.
« b) la suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix.
« La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE III
Garantir les conditions d'une agriculturede montagne durable
Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé :
« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ».
L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne notamment par la voie contractuelle. »
L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. »
Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination montagne des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination montagne. »
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ».
Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée qualité et spécificité des produits de montagne composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination montagne intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »
Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :
« - la mobilisation de la ressource forestière ;
« - la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;
« - la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »
L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'État ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'État dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »
TITRE IV
SIMPLIFIER ET MODERNISERL'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE
CHAPITRE IER
Moderniser le dispositif de développement agricole
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :
1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;
2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;
3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en oeuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
« À titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.
« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'État participe à l'abondement de ce fonds.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »
II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7-1. - À compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »
III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :
« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;
« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;
« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »
IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».
2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.
3. Supprimé
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;
2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;
3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.
VI. - Les dispositions des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Supprimé
CHAPITRE II
Améliorer l'organisation des services de l'Étatet de ses établissements publics
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'État, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'État et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.
« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :
« Les offices ont pour mission : » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;
4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.
« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.
« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;
5° Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».
I bis. - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »
II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :
1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :
- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;
- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;
- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;
2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'État pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »
II bis. - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ».
III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
IV. - À compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :
- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'État, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'État pour ces objets leur sont transférés ;
- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.
V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agence unique de paiement
« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'État et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.
« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.
« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »
VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. À ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'État.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.
Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.
TITRE V
ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'État sont ainsi rédigés :
« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'État en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »
I bis. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'État aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
[Pour coordination]
Les ordonnances prévues aux articles 3, 17, 22 et 27 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Les dispositions des aa et a du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du V de l'article 31 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.
I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.
II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet loi, je donne la parole à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. le rapporteur, qui s'est beaucoup investi aux côtés de M. le président de la commission, a rappelé l'important travail qui a été réalisé ces dernières semaines dans cette enceinte, en concertation avec l'Assemblée nationale. Il a conclu son propos en déclarant qu'un excellent compromis a résulté de ces travaux.
Parallèlement, monsieur le ministre, deux conférences importantes se sont tenues tout récemment, à savoir le sommet de Bruxelles et la conférence ministérielle de l'OMC, à Hong Kong.
Je veux souligner que M. le Président de la République s'est beaucoup investi sur le plan européen. Pour ce qui vous concerne, monsieur le ministre, vous avez fait en sorte qu'au niveau tant de l'Europe que de l'OMC soient maintenues les dispositions qui avaient été décidées antérieurement, alors qu'elles étaient remises en cause par un certain nombre de partenaires. Il faut saluer le travail personnel que vous avez accompli et vous en remercier.
Enfin, la PAC est pérennisée jusqu'en 2013, ce qui est essentiel. Une telle décision était attendue par les agriculteurs. Mais, 2013, c'est demain ! Il faut profiter du laps de temps dont nous disposons jusqu'à cette date pour bien prendre en considération les orientations nouvelles auxquelles nous serons confrontés. Nous ne pouvons pas faire autrement ! Étant donné, en effet, le processus d'élargissement en cours et les nouvelles demandes d'adhésion, nombreuses, nous pouvons nous interroger sur la pérennité de la PAC au-delà de 2013.
Quoi qu'il en soit, la France a des atouts. Les biocarburants, notamment, peuvent offrir d'extraordinaires perspectives. Monsieur le ministre, je sais que vous y êtes attaché. Il faudra probablement prendre des dispositions nouvelles en matière de fiscalité pour que la France soit véritablement un pays moteur dans ce domaine : c'est elle qui a le plus d'atouts ; c'est elle aussi qui a le plus de besoins. Mais je sais que vous en êtes convaincu, monsieur le ministre. Vous nous avez proposé de nous retrouver dans quelques mois, peut-être même au début de l'année prochaine. Nous serons à vos côtés pour faire en sorte que l'agriculture demeure le secteur économique essentiel qu'il est aujourd'hui pour notre pays et que les agriculteurs prennent toute leur part dans l'aménagement du territoire.
Après vous avoir encore remercié, monsieur le ministre, ainsi que notre rapporteur, je vous indique, mais cela n'étonnera personne, que les membres du groupe UMP voteront ce projet de loi.

Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 75 :
Nombre de votants326Nombre de suffrages exprimés325Majorité absolue des suffrages exprimés163Pour l'adoption200Contre 125Le Sénat a adopté définitivement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.