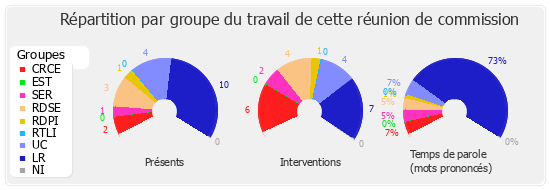Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 4 novembre 2009 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Au cours d'une première séance tenue le matin, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Bernard Saugey sur le projet de loi de finances pour 2010 (mission « Relations avec les collectivités territoriales » et compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »).
a précisé que les collectivités territoriales seraient, en 2010, pleinement associées à la réalisation de l'objectif d'assainissement et de redressement des finances publiques, que, en conséquence, les concours de l'Etat aux collectivités territoriales seraient contenus dans une « enveloppe normée » et que leur progression globale serait indexée sur le taux prévisionnel d'inflation hors tabac -soit 1,2 % en 2010. Il a précisé que cette norme d'indexation avait été inaugurée par la loi de finances pour 1996, puis abandonnée entre 2001 et 2007 et remise en oeuvre à partir de 2008.
Il a ensuite noté que, dans ce cadre contraint, le projet de loi de finances pour 2010 visait à inciter les collectivités à maîtriser leurs dépenses, mais aussi à favoriser l'investissement local : le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ne sera soumis à aucun plafonnement et les dotations d'investissement, qui auraient dû diminuer entre 2009 et 2010 si les dispositions du code général des collectivités territoriales avaient été strictement appliquées, augmenteront de 1,2 %. Il a néanmoins rappelé que, ces concours étant inclus dans le périmètre de l'enveloppe normée, leur croissance entraînait mécaniquement une contraction des autres crédits « sous enveloppe » ; à cet égard, il a relevé que la DGF, auparavant indexée sur l'inflation prévisionnelle, n'augmenterait que de 0,6 % et servirait, pour la première fois, de « variable d'ajustement ». S'il a souscrit pleinement à l'objectif de réduction des déficits et estimé légitime que les collectivités territoriales participent à sa réalisation, il s'est déclaré particulièrement sensible aux inquiétudes des élus locaux, qui craignent que, à terme, l'enveloppe normée ne conduise les collectivités à réduire leurs investissements.
En outre, M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a observé que les intérêts et les propositions des collectivités étaient désormais mieux pris en compte, et que la création de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) à la fin de l'année 2008 avait permis de les associer étroitement au processus normatif. Rappelant que la CCEN, chargée de se prononcer sur les projets de normes nationales ou communautaires ayant vocation à s'appliquer aux collectivités territoriales, était saisie d'environ 300 textes nouveaux chaque année, il a indiqué que son président, M. Alain Lambert, avait émis le souhait qu'elle soit saisie aussi des textes anciens qui forment le stock des normes opposables aux collectivités.
s'est également félicité du bilan extrêmement satisfaisant de la CCEN : grâce au volontarisme de ses membres, la Commission avait diffusé une nouvelle culture de l'évaluation financière au niveau central et incité les administrations à mieux tenir compte des conséquences de leurs décisions sur les finances des collectivités.
a souligné que le présent projet de loi de finances s'inscrivait dans un contexte difficile. Sous l'effet de la crise, les collectivités sont confrontées à une dégradation sensible de leurs finances. Ainsi, le déficit des collectivités territoriales, s'il reste limité dans l'absolu -puisqu'il ne représente que 0,4 % du PIB et 11% du déficit public total- avait augmenté de 12 % entre 2007 et 2008.
Le rapporteur a signalé que ces départements étaient tout particulièrement fragilisés par la crise économique : ils subissent à la fois une nette décrue de leurs recettes fiscales, due notamment à la baisse des droits de mutation, et une forte hausse de leurs dépenses, en raison de leurs larges compétences sociales. Il a donc appelé le Parlement à tenir compte de ce problème dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2010.
Puis, M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a évoqué la suppression de la taxe professionnelle, prévue par l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010.
Il a rappelé que la taxe professionnelle était une source fondamentale de ressources pour les collectivités territoriales et un élément essentiel de leur autonomie fiscale. Il a toutefois souligné qu'elle était nuisible à l'investissement et avait des effets néfastes sur la compétitivité des industries françaises, justifiant la volonté du Gouvernement de remplacer la taxe professionnelle par un impôt plus équitable et plus efficace.
À ce titre, il a indiqué que le dispositif de remplacement initialement proposé par le Gouvernement, la « contribution économique territoriale » (CET), composée d'une taxe assise sur le foncier (la « cotisation locale d'activité » ou CLA) et d'une fraction assise sur la valeur ajoutée (la « cotisation complémentaire » ou CC), avait suscité l'inquiétude des élus locaux pour trois raisons :
- premièrement, le taux de la CC aurait été fixé à l'échelle nationale, et non plus à l'échelle locale, réduisant l'autonomie fiscale des collectivités ;
- deuxièmement, les communes et leurs groupements n'auraient perçu que la CLA, si bien que leurs ressources fiscales auraient été déconnectées de l'activité économique ;
- troisièmement, les recettes attendues de la CET étant inférieures à celles de la taxe professionnelle, l'Etat aurait été amené à augmenter le montant des dotations budgétaires allouées aux collectivités territoriales et, en conséquence, à diminuer leur degré d'autonomie financière.
Ayant précisé que les craintes des associations d'élus avaient été entendues par l'Assemblée nationale, M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a estimé qu'une réflexion sur le concept d'autonomie fiscale devait être menée. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne reconnaît pas cette notion et ne protège que l'autonomie financière des collectivités territoriales, il a néanmoins considéré que les collectivités s'administraient d'autant plus librement qu'elles maîtrisaient une large partie de leurs ressources et que la notion d'autonomie fiscale devait, de ce fait, faire l'objet d'une attention toute particulière. À cet égard, il a déploré que le Parlement ne dispose d'aucune donnée statistique et ne puisse donc pas contrôler l'action du Gouvernement en la matière ; il a donc suggéré que l'autonomie fiscale soit identifiée dans les documents budgétaires transmis chaque année aux Assemblées, par exemple par le biais d'un indicateur dédié.
Enfin, M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a estimé que les enjeux inhérents aux finances locales ne pouvaient pas être séparés de la réforme des structures territoriales qui sera prochainement examinée par la commission des lois, puis discutée par le Sénat ; il a affirmé que le Parlement devait s'attacher à faire respecter ce principe sous peine de mettre à mal la cohérence de l'organisation locale.

Convenant qu'il n'appartenait pas à la commission des lois d'anticiper sur les débats en séance publique concernant la suppression de la taxe professionnelle, M. François Zocchetto s'est toutefois étonné de voir la « cotisation complémentaire » appuyée sur la valeur ajoutée, donc sur les salaires ; il a souligné que, après la suppression progressive de la part « salaires » de la taxe professionnelle entre 1999 et 2003, la réintégration des salaires dans les bases d'imposition des entreprises pourrait être vue comme une régression. Il a en outre noté que, si la territorialisation des impôts attribués aux collectivités permettait d'assurer leur autonomie, elle posait problème dans le cas de la valeur ajoutée, celle-ci se déplaçant plus facilement et plus rapidement encore que les investissements. Il a donc estimé que le Parlement avait besoin de temps supplémentaire pour élaborer la réforme.

a souligné qu'il incomberait à la commission des finances, puis au Sénat, de se prononcer sur cette question.

Faisant valoir que le rapporteur pour avis avait cosigné une tribune plaidant pour un report de la transformation de la taxe professionnelle, M. Jean-Pierre Sueur a marqué son accord avec cette position et engagé la commission des lois, forte de sa compétence en matière de collectivités territoriales, à s'associer à cette proposition. Par ailleurs, il a regretté que les collectivités soient accusées d'être dépensières et mal gérées, alors même que leur dette est très nettement inférieure à celle de l'Etat.
En ce qui concerne la compensation des transferts de compétences, M. Jean-Pierre Sueur a déploré que le poids des dotations budgétaires soit en constante augmentation au sein des concours de l'Etat aux collectivités territoriales. Il a estimé que ce choix était peu cohérent avec le principe d'autonomie financière inscrit à l'article 72-2 de la Constitution et peu légitime, dans la mesure où ces dotations avaient un pouvoir péréquateur très limité.

Ayant déclaré qu'aucune corrélation ne pouvait être dégagée entre les réformes de la taxe professionnelle et l'évolution des exportations des industries françaises et ayant, en conséquence, mis en doute les effets néfastes de la taxe professionnelle sur la compétitivité française, M. Pierre-Yves Collombat a interrogé le rapporteur afin de savoir, en premier lieu, comment évolueraient la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine (DSU) entre 2009 et 2010 et, en second lieu, pour connaître les mesures prises par le gouvernement pour inciter les collectivités à augmenter leurs investissements.

ayant marqué son accord avec les propos de Jean-Pierre Sueur et considéré que les modalités de compensation des transferts de compétences étaient perfectibles, M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que, selon un rapport récent de la Cour des comptes sur « La conduite par l'Etat de la décentralisation », ce problème se posait surtout pour les compétences sociales transférées aux départements.
En réponse à M. Pierre-Yves Collombat, M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a ensuite indiqué que la DSR et la DSU augmenteraient de 3,4% entre 2009 et 2010, soit une hausse respective de 26 millions et de 40 millions d'euros, et que l'investissement local était favorisé par l'absence de plafonnement du FCTVA.

a alors fait valoir que le FCTVA n'était pas une contribution de l'Etat, mais une réversion aux collectivités territoriales et que, en tant que tel, il ne saurait en tout état de cause être plafonné.

Soulignant que la France était l'un des rares pays d'Europe à tenir compte de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, M. Patrice Gélard a considéré que la libre administration n'impliquait pas nécessairement l'existence d'une telle autonomie fiscale et cité l'exemple de l'Allemagne, où certaines catégories de collectivités, bien qu'indépendantes de l'Etat central et dotées de très larges compétences, ne disposent d'aucun pouvoir de lever l'impôt. En outre, il a estimé que l'autonomie fiscale contribuait fortement à maintenir les inégalités de ressources entre les collectivités, et que le processus de remplacement des recettes fiscales par des dotations, engagé pour toutes les catégories de collectivités territoriales, était inéluctable.

Appuyant les propos de M. Patrice Gélard, M. Jean-Jacques Hyest, président, a illustré son propos en évoquant le cas de la région Île-de-France, et estimé que le poids des recettes fiscales dans les finances départementales pérennisait les inégalités préexistantes entre ces mêmes départements. Il a donc déclaré que l'autonomie fiscale pouvait être une source d'injustice.

a précisé qu'un système efficace d'écrêtement permettrait de garantir l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, tout en assurant une répartition équitable des ressources.

En réponse à M. Jacques Mézard, qui souhaitait savoir quelles seraient les conséquences de l'achèvement de la carte intercommunale, prévue par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis, a précisé que le Gouvernement ne disposait pas encore de simulations sur ce point, mais que le mécanisme de complément de garantie de la DGF ne serait pas remis en cause par la réforme des structures locales.

a rappelé que cette donnée ne pouvait pas être connue à l'avance, puisque le montant de la DGF attribuée aux intercommunalités dépend notamment du coefficient d'intégration fiscale, et donc des compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à la place des communes ; or, de tels transferts de compétences sont, par nature, imprévisibles.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
La commission a décidé de saisir pour avis la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale et du projet de loi organique n° 62 (2009-2010) relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale tirant les conséquences en matière électorale des articles premier et 2 du projet de loi n° 60 (2009-2010) de réforme des collectivités territoriales.

Puis, sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a décidé de se saisir, sur le fondement de l'article 73 quinquies, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863), présentée par la Commission européenne le 16 octobre 2009 et transmise au Sénat le 26 octobre 2009.
Précisant que la proposition de règlement portait sur les successions transfrontalières et qu'elle visait à unifier au niveau communautaire les règles permettant de déterminer la loi applicable à la succession et le juge compétent pour se prononcer en la matière, M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué qu'il apparaissait que certains des principes retenus par le texte pouvaient entraîner la mise en échec de règles importantes du droit français des successions, notamment celles relatives à la réserve héréditaire, ce qui justifiait que la commission des lois s'en saisisse.
La commission a désigné M. Pierre Fauchon comme rapporteur.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Pierre Vial et a établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 8 (2009-2010), présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire ou à réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeant d'une entreprise du secteur public et d'une entreprise du secteur privé.

a souligné que la proposition de loi s'inscrivait dans le contexte lié à la désignation envisagée de M. Henri Proglio aux fonctions de président-directeur général d'EDF, alors que celui-ci conserverait dans le même temps un mandat de président du conseil d'administration de la société Veolia Environnement. Il a expliqué que l'objet de ce texte était de réagir à cette situation par un dispositif d'encadrement du cumul de fonctions de direction dans des entreprises relevant du secteur public et du secteur privé, ainsi que du cumul des rémunérations en découlant.
Il a rappelé que, à l'heure actuelle, il n'était pas rare qu'une même personne exerce plusieurs mandats sociaux relevant d'entreprises appartenant au secteur privé et au secteur public. En revanche, il a indiqué qu'il ne semblait pas exister à ce jour de cumul de fonctions de direction, comme l'illustrait la situation de M. Henri Proglio. Il a précisé qu'il n'existait par ailleurs aucune réglementation relative au cumul des rémunérations publiques et privées.
a indiqué que certains dispositifs pouvaient d'ores et déjà s'appliquer à certaines hypothèses de cumul de fonctions de direction des entreprises relevant du secteur public et du secteur privé.
Il a évoqué en premier lieu l'intervention de la commission de déontologie de la fonction publique, chargée de prévenir les situations de conflits d'intérêts constitutives du délit de prise illégale d'intérêts ainsi que de situations pouvant donner lieu à de tels conflits sans pour autant être appréhendées pénalement. Il a néanmoins précisé que cette commission ne connaissait actuellement que de la situation de personnes limitativement énumérées liées à l'administration en raison soit de leur statut public, soit de leur participation à l'activité d'un organe chargé de la définition ou du contrôle des politiques publiques.
Il a souligné que, désormais, le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution instituait une procédure permettant de soumettre aux commissions permanentes du Parlement la nomination par le Président de la République des dirigeants d'un certain nombre d'entreprises publiques. Il a précisé que le projet de loi organique, en cours d'examen au Parlement, prévoyait notamment de soumettre à l'avis des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat la nomination du président-directeur général d'EDF. Il a indiqué que les commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient entendu M. Henri Proglio avant même l'entrée en vigueur de ce texte, ce qui avait permis d'apporter certaines explications sur la façon dont ce dernier entendait exercer simultanément ses fonctions chez Veolia et EDF, ainsi que sur sa rémunération globale.
Il a rappelé que dès lors que la plupart des entreprises publiques sont constituées sous la forme de sociétés anonymes, les dispositions du code de commerce applicables à ces sociétés doivent également être suivies, ce qui implique en particulier un plafonnement du nombre de mandats sociaux pouvant être exercés simultanément par une même personne physique. La loi fixe actuellement le nombre maximum de mandats sociaux pouvant être détenus par un même administrateur à cinq et impose l'exercice exclusif d'une fonction de directeur général ou de président du directoire, sous réserve de certains aménagements à l'égard des sociétés filiales.
Il a ajouté que les entreprises avaient par ailleurs édicté des codes de conduite en la matière qui n'avaient néanmoins pas de valeur juridiquement contraignante.
Abordant la question de l'encadrement du cumul de rémunérations, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a précisé que la législation sur les sociétés commerciales prévoyait des règles de procédure spéciales ainsi que des interdictions de fond, notamment s'agissant de la détermination des éléments de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux.
Il a expliqué qu'une réglementation particulière s'appliquait en outre aux rémunérations des dirigeants des entreprises publiques, puisque s'exerce en la matière un contrôle ministériel et que le ministre chargé de l'économie veille désormais à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et principes de gouvernance d'un haut niveau d'exigence éthique.
Il a rappelé que, pour leur part, les entreprises s'étaient imposé certaines règles en la matière dans le cadre de leur code de gouvernement d'entreprise.
S'agissant de la pertinence d'une intervention législative spécifique en cas de cumul de fonctions de direction dans des entreprises relevant du secteur public et du secteur privé, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a estimé que le cas présenté par M. Henri Proglio invitait à avoir une réflexion sur la nécessité de disposer de règles prudentielles en la matière.
Il a expliqué qu'un encadrement de cette pratique n'était pas illégitime mais que le choix, fait par les auteurs de la proposition de loi, de la commission de déontologie pour procéder à l'examen de la pertinence d'un cumul n'était pas satisfaisant, dès lors que sa fonction était réservée aux situations mettant en cause des agents de l'administration. Or, la faire intervenir dans un cadre plus large, et notamment à l'égard de personnes issues du secteur privé, reviendrait à la dénaturer.
Il a en revanche avancé que l'intervention de l'agence des participations de l'Etat, service actuellement rattaché au ministre de l'économie, serait mieux adaptée pour vérifier la compatibilité d'une situation de cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'Etat et examiner la rémunération globale applicable. Il a proposé, en outre, que l'avis de l'agence des participations de l'Etat soit porté à la connaissance des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat lorsqu'elles statuent dans le cadre de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Revenant spécifiquement sur le cas de M. Henri Proglio, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a précisé que celui-ci était déjà administrateur d'EDF depuis cinq ans et membre de son conseil stratégique et que, entendu par la commission de l'économie du Sénat, M. Proglio avait affirmé ne pas avoir connu de situation de conflits d'intérêts durant cette période, le seul conflit susceptible d'intervenir concernant, selon lui, la filiale commune d'EDF et Veolia, Dalkia, qui serait alors examiné par M. Louis Schweitzer, vice-président du conseil d'administration de Veolia.

a rappelé que, dans le cadre d'un accord avec les groupes politiques du Sénat, le texte d'une proposition de loi d'un groupe d'opposition ou minoritaire ne pouvait donner lieu à un texte établi par la commission qu'avec l'assentiment des auteurs de cette proposition. Il a souligné que le rapporteur s'était rapproché du président du groupe RDSE, par ailleurs premier signataire de la proposition de loi, afin d'aboutir à un accord de principe sur les modifications à apporter au texte originel. M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que le recours à la commission de déontologie n'était absolument pas adapté au cas d'espèce et que la solution proposée par le rapporteur semblait plus opérante.

rejointe par M. Jacques Mézard, a remercié le rapporteur de ses efforts en vue de parvenir à une rédaction consensuelle mais a estimé que le texte qu'il soumettait à la commission n'était pas de nature à répondre véritablement aux problèmes soulevés, l'agence des participations de l'Etat ne lui paraissant pas l'organe le plus pertinent pour connaître des situations de cumul.

a jugé que l'intervention de la commission de déontologie était justifiée mais que se posait la question plus large de savoir s'il ne convenait pas d'interdire purement et simplement le cumul de fonctions de direction dans une entreprise publique et dans une entreprise privée. Il a estimé que l'agence des participations de l'Etat n'aurait pas la marge d'appréciation suffisante pour se prononcer sur la pertinence d'un tel cumul.

a souligné que la proposition de loi avait pour principal intérêt de mettre en lumière une situation préoccupante qui n'était pas suffisamment prise en compte par les règles actuelles du droit des sociétés en matière de cumul des mandats sociaux. Estimant trop large le plafond de cinq mandats, il a jugé impossible en pratique de cumuler des fonctions de direction dans le secteur public et dans le secteur privé en raison d'un risque évident de conflit d'intérêts. Il a indiqué que la question de la stratégie industrielle devait être posée mais qu'il convenait alors de s'engager dans la voie d'une fusion d'EDF et de Veolia. Il a fait part de sa crainte que le cumul de fonctions envisagé pour M. Henri Proglio donne lieu à d'autres hypothèses de cumul et, de ce fait, à la multiplication des situations hybrides.

s'est dit mal à l'aise face à un texte de circonstances qui ne lui semblait pas pouvoir conduire à une intervention législative adaptée, l'intervention de la commission de déontologie ne lui semblant pas particulièrement appropriée. Il a souligné que le président d'un conseil d'administration exerçait un réel pouvoir au sein d'une société, quand bien même il ne cumulait pas ces fonctions avec celles de directeur général. Il lui a semblé que la seule solution en la matière serait une interdiction pure et simple du cumul des fonctions de direction.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut rappelé que l'objet de la proposition de loi n'était pas de poser une incompatibilité de principe, M. Charles Gautier a indiqué qu'il convenait de distinguer la question de la stratégie industrielle, qui pouvait conduire à un rapprochement effectif d'EDF et Veolia, de celle des titulaires de mandats de direction dans ces deux entités. Soulignant que les fonctionnaires ne pouvaient pas cumuler de fonctions rémunérées dans le privé, il a estimé qu'un cumul chez les dirigeants de ces entreprises ne pouvait être accepté.

a jugé que l'interdiction pure et simple du cumul aurait pu être proposée mais n'aurait sans doute pas abouti. Jugeant que l'intervention de la commission de déontologie soulevait plusieurs difficultés tout comme celle de l'agence des participations de l'Etat, il a néanmoins estimé souhaitable de soutenir la proposition faite par le rapporteur.

a souligné que, face au questionnement légitime que faisait naître la question du cumul, le Parlement était confronté à un choix : soit ne pas intervenir, au risque de voir des situations délicates exister en pratique, soit adopter un dispositif destiné à apporter un encadrement raisonnable. L'accord auquel il était parvenu avec le président du groupe RDSE sur ce texte lui paraissant satisfaisant, il a estimé que celui-ci pouvait en conséquence être adopté.
Répondant à M. Charles Gautier sur la question du cumul d'activités des agents publics, il a rappelé que, depuis 2007, ces cumuls d'activités étaient autorisés dans des cas strictement limités.

a indiqué que la commission pouvait choisir, soit de rejeter la proposition de loi, soit d'adopter la version du rapporteur qui lui semblait plus opportune. M. Jacques Mézard a expliqué que le dépôt de la proposition de loi par le groupe RDSE était mû par la volonté de débattre d'une situation particulière qui soulevait des questions essentielles.
Il a déclaré accepter que la proposition de loi soit modifiée dans le sens proposé par le rapporteur.

a indiqué se rallier à la solution de compromis présentée par le rapporteur, soulignant qu'elle ne devait pas lier la réflexion sur le réaménagement des règles de cumul actuellement prévues par le code de commerce, M. Richard Yung expliquant, quant à lui, que le groupe socialiste s'abstiendrait sur les amendements du rapporteur au profit d'une discussion en séance publique.
La commission a ensuite adopté :
l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le rapporteur, tendant à réécrire l'article premier de la proposition de loi pour prévoir l'avis de l'agence des participations de l'Etat préalablement au cumul de fonctions de direction, tant sur la compatibilité de ce cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'Etat que sur la rémunération qui en résulterait, cet avis étant transmis aux commissions permanentes lorsqu'elles sont compétentes dans le cadre de la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
l'amendement n° 2, présenté par le rapporteur, tendant à supprimer l'article 2 de la proposition de loi.
Puis la commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

Ensuite, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. François Pillet et a établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 506 rectifié (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
a fait valoir que la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public avait pour but d'apporter aux forces de l'ordre et aux magistrats un certain nombre de solutions adaptées à la spécificité des violences commises en bandes. Tout en souscrivant à cet objectif, il a souhaité que ce texte puisse être modifié dans le respect des principes fondamentaux du droit pénal français et de la cohérence de l'échelle des peines.
a remarqué que, depuis plusieurs décennies, les grandes agglomérations françaises étaient périodiquement traversées par des flambées de violences émanant le plus souvent de jeunes gens issus de quartiers défavorisés. Il a observé que, pourtant, pendant de longues années, les pouvoirs publics n'avaient pas semblé prendre la mesure du caractère spécifique du phénomène des bandes violentes. D'après les personnalités qu'il a auditionnées, la notion de « bande » ne fait réellement l'objet d'une attention particulière que depuis cinq à six ans. De ce fait, il a regretté que peu de données objectives soient disponibles pour tenter de cerner précisément ce phénomène.
a indiqué qu'une étude réalisée par la direction centrale de la sécurité publique en mars 2009 avait néanmoins établi qu'il existait 222 bandes violentes en France, regroupant environ 2 500 membres réguliers et autant de membres occasionnels. D'après cette étude, les quatre cinquièmes de ces bandes sont localisées en région parisienne et un peu moins de la moitié de leurs membres sont âgés de moins de dix-huit ans. A la différence des gangs américains, qui comptent parfois plusieurs milliers de membres, d'après cette étude, les bandes françaises les plus structurées ne comporteraient guère plus de cinquante personnes. Il lui a semblé essentiel de distinguer les « bandes » des groupes politiques extrémistes, tels que ceux qui se sont manifestés lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, en avril 2009, ou à Poitiers récemment. A la différence de ces groupes d'extrémistes, qui agrègent au gré des manifestations des individus ne partageant pas de vie en commun, il a souligné que les bandes constituaient de véritables formes de sociabilité alternative, que la notion de territoire revêtait pour elles une valeur quasi-sacrée et qu'elles ne fonctionnaient que collectivement, les actes de violences étant toujours accomplis en commun, le plus souvent dans des territoires « neutres » tels que les espaces scolaires ou les transports en commun.
a fait valoir que l'action engagée par les pouvoirs publics pour lutter contre la délinquance urbaine avait permis à cette dernière de diminuer de 33 % entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. Néanmoins, ces données globales masquent une certaine radicalisation des phénomènes de violences, concentrés sur un nombre restreint de quartiers en difficulté et d'individus au passé judiciaire lourd, comme l'a notamment indiqué le Conseil national des villes dans un avis rendu en janvier 2008. En outre, il a fait valoir que ce phénomène de radicalisation s'accompagnait, d'une part, d'un accroissement des agressions perpétrées contre les forces de l'ordre, et, d'autre part, d'une banalisation du recours aux armes.
a indiqué que le droit pénal n'était pas totalement démuni face aux violences commises en groupes. En premier lieu, il a rappelé que le complice de l'infraction est puni des mêmes peines que l'auteur des faits. En second lieu, il a souligné que, dans un grand nombre d'hypothèses, le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs individus agissant en groupe est considéré par le code pénal comme une circonstance aggravante, à travers la notion de commission en réunion ou de celle, plus grave, de commission en bande organisée. En troisième lieu, il a relevé que, depuis l'adoption du code Napoléon de 1810, le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs permet d'incriminer les groupements formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits, le champ de cette infraction ayant été étendu en 2001 aux crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au surplus, il a indiqué que les groupements spontanés peuvent être poursuivis sur le fondement du délit d'attroupement.
Par ailleurs, le rapporteur a observé que les tribunaux n'hésitent pas à retenir la responsabilité de tous les membres d'un groupement informel qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, dès lors qu'une faute peut être imputée à chacun d'entre eux. Enfin, il a noté que ce dispositif pénal a été renforcé au cours des dernières années par l'adoption de mesures plus spécifiques visant les violences de groupes. Il a notamment cité les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ainsi que dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Néanmoins, M. François Pillet, rapporteur, a fait valoir que l'ensemble de ces mesures n'apparaissait pas suffisant pour lutter efficacement, de façon préventive, contre les violences commises en groupes. En effet, il a relevé que, si les dispositions relatives aux attroupements permettaient de réprimer les violences commises par des groupes politiques extrémistes et si celles relatives à la criminalité organisée et à l'association de malfaiteurs concernaient les bandes criminelles présentant un certain degré d'organisation et une activité inscrite dans la durée, en revanche, le droit ne parvenait pas à prévenir de façon suffisamment efficace les violences commises par des bandes informelles, peu structurées, constituées sur une base territoriale et se livrant de façon régulière à des formes de délinquance allant de simples actes d'incivilités à des délits graves. Il a souligné que la proposition de loi visait précisément ce type de groupes informels.
a remarqué que, au cours des derniers mois, un certain nombre de dispositions avaient été adoptées ou renforcées afin de mieux lutter contre les phénomènes de bandes violentes. Ainsi, en ce qui concerne l'adaptation de l'organisation des forces de l'ordre à cette forme particulière de délinquance, il a mentionné la création de vingt-trois unités territoriales de quartiers (UTEQ), composées d'effectifs spécialement affectés à un territoire délimité ayant pour mission d'améliorer la connaissance des quartiers et de leur population et d'assurer une présence quotidienne, dissuasive et visible afin de mieux identifier les auteurs de délinquance et de mieux procéder à leur interpellation. Il a indiqué que ces UTEQ étaient désormais appuyées au niveau départemental par des compagnies de sécurisation d'une centaine d'hommes chacune, formés aux violences urbaines et aux investigations dans des environnements difficiles. Il a rappelé que, lors de son discours de Gagny du 18 mars 2009, le chef de l'Etat avait annoncé que cent UTEQ et vingt-trois compagnies de sécurisation seraient constituées avant la fin de l'année 2010. Par ailleurs, il a fait valoir que l'organisation des forces de l'ordre en réponse à la délinquance de bandes, qui se caractérise par une forte mobilité, passait également par la création de polices d'agglomération, et a annoncé qu'il proposerait un amendement tendant à faciliter leur création. Enfin, il a indiqué que des efforts avaient été engagés au cours des derniers mois pour renforcer le recours à la vidéosurveillance, pour restructurer le dispositif de renseignement intérieur et pour mieux protéger les établissements scolaires et leurs abords, citant notamment la circulaire signée conjointement par les ministres de l'intérieur et de l'éducation nationale le 23 septembre 2009.
a constaté que la proposition de loi s'inscrivait dans le contexte de ces mesures. Il a indiqué que, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, ce texte comportait seize articles et visait trois objectifs principaux :
1°) agir préventivement contre les phénomènes de violences de groupes, au moyen d'infractions-obstacles permettant d'incriminer, avant le passage à l'acte, les comportements dangereux susceptibles de déboucher sur des violences ou des dégradations ;
2°) punir plus sévèrement les auteurs de violences qui profitent de l' « effet masse » créé par le groupe pour commettre des infractions, à travers la création d'un certain nombre de circonstances aggravantes nouvelles ;
3°) enfin, sanctuariser les établissements scolaires, en élevant notamment au rang de délit l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement d'enseignement.
a indiqué que, après avoir entendu un certain nombre de personnes, notamment le préfet de police de Paris, le directeur central de la sécurité publique ainsi que des membres du Parquet, il estimait nécessaire de donner aux pouvoirs publics des outils juridiques nécessaires pour prévenir et lutter efficacement contre les violences commises par les bandes. Néanmoins, il a indiqué que son attention avait été appelée sur un certain nombre de difficultés que pourrait susciter l'application de ce texte par les forces de l'ordre ou les juridictions. Pour cette raison, il a souhaité proposer quinze amendements tendant à modifier la proposition de loi en fonction de trois orientations :
- tout d'abord, il a souhaité que soient modifiées ou supprimées les dispositions susceptibles d'ouvrir la voie à une forme de responsabilité collective, qui serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit pénal ;
- en outre, il lui a semblé indispensable de restaurer une certaine cohérence dans l'échelle des peines retenue par le texte ;
- enfin, il a proposé de supprimer un certain nombre de dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur.
En conclusion, M. François Pillet, rapporteur, a fait valoir que la question des violences commises par les bandes requérait toute l'attention des pouvoirs publics et que la prévention devait demeurer au coeur des préoccupations. Il a indiqué que le droit comparé offrait un certain nombre de solutions qu'il a estimé intéressant d'étudier et a souhaité que les travaux à venir de la commission permettent de poursuivre cette réflexion.

a souligné que, si elle était adoptée en l'état, cette proposition de loi constituerait le quinzième texte pénal adopté par le Parlement en sept ans. Il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer systématiquement après la survenue d'événements tragiques, estimant qu'un grand nombre de dispositions du code pénal permettaient d'ores et déjà de réprimer les violences commises par les bandes. Il s'est interrogé sur les effets des suppressions de postes dans les établissements scolaires, soulignant que la prévention des violences passait avant tout par l'intervention des enseignants et des éducateurs auprès des enfants et des adolescents. Enfin, il a dénoncé le phénomène d'inflation législative, considérant que l'adoption de lois nombreuses et souvent difficilement applicables ne pouvait que discréditer le travail du Parlement. En outre, il s'est inquiété des dispositions figurant à l'article premier du texte, estimant que celles-ci placeraient les juges dans l'obligation de se prononcer sur des intentions, et non sur des faits matériels.

a estimé qu'il était du devoir du Parlement de veiller, en matière pénale, à adopter des textes qui puissent s'appliquer de façon générale. Il a émis des doutes sur l'effet dissuasif du texte, considérant par ailleurs que de nombreuses dispositions du code pénal permettent déjà de réprimer les violences commises en groupes.

a estimé que cette proposition de loi, présentée à la suite d'un fait divers, se caractérisait par sa démesure et qu'elle serait probablement difficile à appliquer, à l'image de la disposition, adoptée dans le cadre de la loi du 18 mars 2003, incriminant l'occupation abusive des halls d'immeubles. Il a observé que le phénomène des bandes n'était pas nouveau. Il a estimé dangereuse la disposition tendant à sanctionner un individu sur le fondement de ses intentions, et non de ses actes. Il a observé que, quelle que soit la configuration des bandes de jeunes, ces dernières comportaient des individus ne partageant pas nécessairement les mêmes motivations. Il a souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontés les magistrats chargés d'appliquer cette proposition de loi. Enfin, il s'est interrogé sur la place qui serait laissée aux pouvoirs de police du maire dans le cadre de la constitution de polices d'agglomération.

a dénoncé la méthode consistant à annoncer l'adoption d'un texte pénal après un fait divers. Tout en considérant que les violences commises par les bandes étaient inadmissibles, elle a relevé que les lois adoptées au cours des années récentes n'avaient pas permis de mettre un terme à ces violences et que, en outre, elles avaient rendu plus difficile l'application du droit pénal par les magistrats. Par ailleurs, elle a relevé qu'un certain nombre de dispositions de la proposition de loi n'avaient pas de lien immédiat avec l'objet du texte. Enfin, elle a regretté l'instrumentalisation à des fins politiques, quelques mois avant des élections, de la question des violences commises par les bandes.

s'est interrogée sur l'articulation de cette proposition de loi, et notamment de son article premier A, avec le projet de code pénal des mineurs annoncé par le Gouvernement. Elle s'est également interrogée sur la conformité à la Constitution d'incriminations tendant à réprimer des intentions, rappelant que les infractions pénales devaient être caractérisées par des faits matériels.

a estimé, à l'issue des auditions auxquelles elle avait participé, que la répression des violences commises par des bandes passait avant tout par l'amélioration de la qualité des enquêtes policières et par le renforcement, au sein des établissements scolaires, de l'autorité des chefs d'établissement.

a souhaité connaître les attentes des policiers et des magistrats à l'égard de cette proposition de loi, estimant que le code pénal comportait, d'ores et déjà, un grand nombre de dispositions permettant de réprimer les violences de groupes. Il a craint que les dispositions contenues dans la proposition de loi ne compliquent le travail des magistrats et qu'elles soient instrumentalisées par des avocats de la défense pour allonger inutilement les procédures.

a observé que la délinquance en Seine-Saint-Denis ne diminuait pas. Il a déploré les mauvaises relations entre bandes de jeunes et forces de l'ordre, les violences commises par les premières trouvant parfois leur source dans les provocations des secondes. Il a estimé que, face à cette question d'une particulière gravité, la solution adoptée par les pouvoirs publics ne pouvait être uniquement répressive. Il a attiré l'attention sur la nécessité de permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi, grâce, notamment, aux entreprises d'insertion dont il a souligné le travail de qualité.

s'est interrogé sur l'apport de cette proposition de loi au droit existant, estimant que la répression des violences commises par les bandes relevait avant tout de l'organisation des forces de l'ordre. Il a considéré qu'un certain nombre de dispositions de la proposition de loi étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur et que le délit d'appartenance à une bande, se situant en amont de la commission d'infractions, poserait probablement un certain nombre de difficultés aux forces de l'ordre et magistrats chargés de le mettre en oeuvre.

a indiqué que la plupart des amendements qu'il proposait tendaient à répondre aux craintes et objections formulées. Par ailleurs, il a considéré que, à la différence du droit civil, le droit pénal, qui est d'interprétation stricte, était nécessairement amené à être régulièrement modifié afin de s'adapter aux évolutions de la délinquance. Il a enfin observé que le phénomène des bandes, s'il n'est pas totalement nouveau, relève néanmoins aujourd'hui de logiques nouvelles et résiste à la baisse générale de la délinquance.
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements.
A l'article premier A (délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, afin de déplacer ces dispositions, en les modifiant, au sein d'un article additionnel inséré à la fin du chapitre Ier du texte.
A l'article premier (délit de participation à un groupement violent), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à modifier la définition de ce délit afin que celui-ci n'ouvre pas la voie à une forme de responsabilité collective, et, d'autre part, à abaisser les peines encourues à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende afin que la préparation de l'infraction ne soit pas punie plus sévèrement que la commission de cette même infraction.
A l'article premier bis (aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, considérant que ces dispositions étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur.
A l'article 2 (extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, qui a fait valoir que cet article 2 n'apparaissait pas pleinement compatible avec le principe de responsabilité personnelle, qu'il risquait de poser de réelles difficultés probatoires aux juridictions et que, enfin, il risquait de rendre inutile le mécanisme des sommations, ce qui pourrait apparaître incompatible avec le principe de la liberté de circuler ou de manifester.
A l'article 2 bis (habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter une précision rédactionnelle et à subordonner l'embauche d'un agent de surveillance ou de gardiennage à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux interdictions d'exercice de telles fonctions.
La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à créer un article additionnel après l'article 3, afin d'élargir aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la compétence du préfet de police de Paris. La commission a considéré que la création de polices d'agglomération, notamment en région parisienne, constituait un moyen particulièrement adapté pour lutter contre les bandes violentes, qui se caractérisent par leur extrême mobilité.
A l'article 4 (enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie), la commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, tendant notamment à préciser que le versement au dossier de l'enregistrement est de droit lorsqu'il est demandé par une personne à qui est reprochée une infraction commise au cours de l'intervention.
A l'article 4 bis (raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à préciser que la transmission des images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation, qu'elle s'effectue en temps réel et qu'elle est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre et, d'autre part, à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL la détermination des conditions d'application de cet article.
A l'article 4 ter (délit d'occupation abusive des halls d'immeubles), la commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
A l'article 4 quater (instauration d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général pour occupation abusive de halls d'immeubles), la commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
A l'article 4 quinquies (délit de vente forcée dans les lieux publics), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, au motif que les dispositions de cet article n'ont pas de lien évident avec l'objet de la proposition de loi.
La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies, afin de reprendre, dans une rédaction modifiée, les dispositions qui figuraient précédemment à l'article premier A.
La commission a adopté un amendement de M. Laurent Béteille tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies, afin d'étendre le champ du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et à l'usage de ces artifices dans ces mêmes lieux.
La commission a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies, afin de renforcer le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade et à la répression des violences commises à l'occasion de manifestations sportives.
A l'article 6 (instauration d'une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements scolaires ou à leur proximité immédiate), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à conserver un dispositif de peines aggravées lorsque les violences sont commises dans les locaux de l'administration ou aux abords de ces derniers.
A l'article 7 (correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement scolaire), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'abord, à préciser que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire n'est constitué que lorsque l'intrusion a pour but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, ensuite, à adapter l'échelle des peines retenue par ces dispositions, en outre, à supprimer les dispositions ouvrant la voie à une forme de responsabilité collective, et, enfin, à supprimer les dispositions relatives au port d'armes dans les établissements scolaires, qui sont déjà satisfaites par les dispositions générales posées à l'article L. 2339-9 du code de la défense.
A l'article 8 (application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à permettre l'application de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.
Les votes émis par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, président, a dressé le bilan annuel de l'application des lois au 30 septembre 2009.
Il a d'abord souligné l'importance du contrôle parlementaire, tant au niveau de l'application de la loi que de l'évaluation de ses effets dans le temps. Avant de présenter le bilan annuel de l'application des lois votées au cours des sessions précédentes comme de celle qui vient de s'achever, il a rappelé que les statistiques effectuées prenaient uniquement en compte les mesures réglementaires prévues par une disposition législative.
a dressé un bilan très positif de l'application des lois cette année, en précisant que moins de lois avaient été votées, mais qu'elles avaient été mieux appliquées. Il a annoncé que 15 lois, examinées au fond par la commission des Lois, avaient été promulguées en 2008-2009, contre 22 l'année dernière.
Il a toutefois précisé que cette baisse du nombre de lois promulguées n'était pas pour autant significative d'un rythme législatif moins soutenu. Au contraire, la commission a examiné un nombre particulièrement important de propositions de loi (15 contre 9 l'an passé), propositions de résolution (4 cette année, aucune l'année dernière) mais aussi de projets de loi importants, dont les examens n'étaient pas achevés au 1er octobre 2009. En outre, la commission a rendu cette année 5 avis (aucun l'an passé).
Concernant les 15 lois promulguées, il a souligné la très nette amélioration de leur applicabilité, car 9 sont d'application directe (soit près des deux tiers), 2 sont devenues applicables au cours de la session, une seule n'est que partiellement applicable (contre 8 l'année précédente) et 3 n'ont encore fait l'objet au 1er octobre d'aucune des mesures d'application prévues. L'année 2008-2009 est donc marquée par une nette amélioration du taux d'application des lois, puisque contrairement aux deux années précédentes, les lois entièrement applicables - c'est-à-dire d'application directe ou appliquées à 100 % - représentent 11 lois sur 15, soit 73,3 % (45,45 % en 2007-2008).
Il a néanmoins indiqué que 29 mesures d'application, dont 10 expressément prévues par la loi, avaient été prises concernant les lois votées au cours de l'année parlementaire écoulée, soit un taux d'application de seulement 15 % par rapport aux 68 mesures attendues, ce qui représente une baisse importante puisque ce taux était de 30 % l'année précédente.
a toutefois nuancé ce constat en rappelant que deux des quatre lois nécessitant des mesures d'application avaient été promulguées tardivement, et que de nombreuses lois étaient devenues applicables au cours de l'année.
Il a précisé que 140 mesures d'application prises entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (contre 98 l'année précédente, soit une hausse de 42,8 %) ont eu des effets notables sur l'applicabilité de nombreuses lois adoptées antérieurement à la présente session.
Ainsi, 13 anciennes lois dont la commission des lois avait été saisie au fond, sont devenues entièrement applicables, contre seulement 2 l'année précédente, parmi lesquelles les lois sur les contrats de partenariat, les archives, les mini-motos, la maîtrise de l'immigration, l'assurance de protection juridique, la récidive ou encore la rétention de sûreté.
Quant aux délais de parution, alors qu'on constatait un léger ralentissement l'année précédente où plus des deux tiers des mesures d'application étaient prises entre 6 à 12 mois après la promulgation de leurs lois respectives, lors de la session 2008-2009, plus des trois quarts de ces mesures d'application ont été prises moins de 6 mois après promulgation de la loi.
a regretté que les lois votées au cours des deux précédentes législatures ne soient pas encore toutes applicables. Il a indiqué qu'une poignée de lois votées sous la XIe législature n'était pas encore totalement applicables, bien que certaines aient fait l'objet de mesures d'application en 2008-2009. Ainsi, 9 lois dont certaines très anciennes, attendent encore des mesures d'application, dans des proportions variables. C'est le cas notamment des lois n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. M. Laurent Béteille, qui en avait été rapporteur, a toutefois noté que le texte manquant sur l'autorité parentale n'en entravait pas l'application.
s'est félicité que 2 lois requérant un nombre important de mesures réglementaires aient vu leur taux d'application s'améliorer cette année : la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Il a ensuite indiqué que les taux d'application restaient honorables pour les lois votées sous les XIIe et XIIIe législatures. En effet, seules 17 lois votées sous la XIIe législature ne sont aujourd'hui que partiellement applicables, et le taux moyen d'application est relativement satisfaisant : 78,1 %.
s'est également réjoui de l'usage très modéré de la procédure accélérée, et de l'application plus rigoureuse des lois votées selon cette procédure. En effet, seules 3 lois (sur 15) relevant de la compétence de la commission ont fait l'objet d'une procédure accélérée en 2008-2009. Ce chiffre représente un taux de 20 %, qui s'inscrit dans une tendance à la baisse depuis plusieurs années de l'utilisation de la procédure accélérée : 22,7 %, l'année dernière et 38,9 % en 2006-2007. Il a rappelé que le taux constaté en 2006-2007 s'inscrivait dans un contexte de changement de législature. Deux de ces lois sont déjà applicables car d'application directe : la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, et la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. En revanche, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique n'a encore fait l'objet d'aucune mesure d'application pour l'instant.
s'est déclaré très satisfait de ce que les lois d'origine parlementaire soient cette année plus nombreuses et mieux appliquées.
Il a précisé que 6 lois d'origine parlementaire examinées au fond par la commission des lois avaient été promulguées, soit un taux de 40 %, marquant là encore une forte progression par rapport à l'année précédente (31,8 %) et à 2006-2007 (16,6 %). Il a expliqué que cette importante augmentation du nombre de textes votés d'origine parlementaire constituait l'un des effets de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui réserve une semaine par mois aux textes d'initiative parlementaire.
Revenant sur la mise en application des 6 propositions de loi adoptées, il a apporté les précisions suivantes : 3 sont d'application directe, une n'est encore que partiellement applicable (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures), une a fait l'objet des mesures d'application prévues (loi n° 2009 689 du 15/06/2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative), et enfin, une n'est pas encore applicable (loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire).
Par ailleurs, il s'est réjoui que la moitié des lois d'origine parlementaire soit issue de propositions de loi sénatoriales, contrairement à l'année précédente où six de ces sept lois étaient originaires de l'Assemblée nationale. Il a ajouté que sept propositions de loi étaient actuellement en navette à l'Assemblée nationale après une première lecture au Sénat, et que la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques avait été examinée en séance publique après le 1er octobre 2009.
Après ce bilan statistique, M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité souligner quelques exemples intéressants d'application apparus à l'occasion de ce suivi annuel.
Il a indiqué que la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile devrait être totalement applicable d'ici la fin de l'année, plus de cinq ans après sa promulgation. En effet, la dernière disposition pour laquelle la loi avait prévu un décret d'application, l'article 82, instaurait des contrats à durée déterminée de sapeurs-pompiers pour permettre aux SDIS de recruter temporairement des sapeurs-pompiers volontaires afin de remplacer momentanément des sapeurs-pompiers professionnels ou de faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels : le projet de décret avait longtemps été bloqué faute d'accord entre les représentants des présidents de conseil d'administration des SDIS et ceux des sapeurs-pompiers, notamment sur la liste des emplois dans les SDIS qui ne peuvent donner lieu à des recrutements temporaires de sapeurs-pompiers volontaires.
a indiqué que la dernière mouture avait été adoptée à l'unanimité par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours lors de sa réunion du 3 mars 2009, et transmise au Conseil d'Etat le 18 juillet dernier. Le projet est actuellement au contreseing, et devrait être publié avant la fin de l'année.
Sur le volet « droit pénal », il a souligné que la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales était totalement applicable depuis la parution du dernier décret le 23 juin 2009, qui définit les modalités du traitement automatisé de données SALVAC (système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes). Ce nouveau système devrait faciliter les enquêtes des services de police et de gendarmerie sur les crimes et délits présentant un caractère sériel.
Il a également précisé que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité faisait elle aussi l'objet d'une application très satisfaisante, précisant que seul le décret concernant les dispositions relatives à la commission nationale des repentis (art. 12) n'avait pas été pris, les négociations entre la Chancellerie et le ministère de l'intérieur se poursuivant sur ce sujet, en particulier sur la question du financement de la commission.
S'agissant du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires, il a indiqué que le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé « Cassiopée » concernant l'élaboration technique de la nouvelle chaîne pénale informatique avait été adopté.
Sur le volet « justice », M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que la loi n° 2001-539 relative au statut des magistrats était désormais totalement applicable. Il a expliqué que la commission des lois avait multiplié les démarches depuis la session 2006-2007 pour obtenir la publication du décret d'application permettant le rachat des droits à pension par les magistrats issus des concours complémentaires. Il a indiqué que la Chancellerie n'avait finalement pas estimé nécessaire de prendre un nouveau décret, suivant en cela l'analyse du Conseil d'Etat dans deux arrêts du 7 août 2008. Les dispositions du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature seront donc appliquées aux magistrats recrutés par concours exceptionnel et à ceux recrutés par voies de concours complémentaire. Il a regretté qu'il n'ait pas été possible d'arriver plus tôt à une telle conclusion.
Il s'est ensuite félicité de l'application totale de la loi n° 2007-210 portant réforme de l'assurance juridique, indiquant que la loi avait retenu le principe de la subsidiarité de l'aide juridictionnelle en présence d'un contrat de protection juridique ou de tout autre système équivalent. Il a exposé les principales dispositions du décret du 15 décembre 2008, qui en précise les modalités notamment en présence d'un contrat de protection juridique : le demandeur d'aide juridictionnelle devra préalablement effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin que ce dernier lui indique le montant qu'il prend en charge. En fonction de ces éléments, le bureau d'aide juridictionnelle se prononcera sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle.
Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, président a vivement regretté que la loi relative à la législation funéraire n'ait fait l'objet d'aucune mesure réglementaire jusqu'à présent. Il a noté que certaines dispositions ont été indûment supprimées par une ordonnance, ce qui a contraint le législateur à les rétablir dans la loi de simplification du droit. Par ailleurs, les deux ministères concernés n'ont engagé que tardivement, quand ils l'ont fait, les travaux préparatoires aux décrets d'application, ce qu'il a déploré, appelant à une accélération de la mise en application d'une loi d'origine parlementaire basée sur un travail bipartisan et adoptée à la quasi-unanimité par les deux chambres.

a insisté sur l'importance de la mise en application de cette loi, s'inquiétant de ce que de nombreux maires se trouvaient dans une confusion juridique et ne savaient plus quelles dispositions appliquer.

En guise de conclusion, M. Jean-Jacques Hyest, président, a remarqué que la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 faisait l'objet d'un taux d'application insatisfaisant (4 %), et s'est étonné de la lenteur de sa mise en application s'agissant de dispositions dont la nature même devrait exclure la complexité de mise en oeuvre.