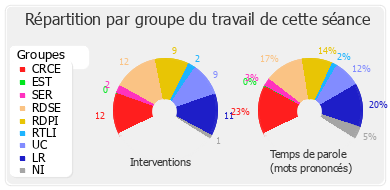Séance en hémicycle du 31 janvier 2013 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur le commerce extérieur.
Je rappelle que l’auteur de la question et la ministre, pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.
Ce débat étant retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat, ainsi que sur France 3, il importe que chacun respecte son temps de parole.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, l’augmentation, totalement antiéconomique, des impôts et des charges, en entraînant mécaniquement une augmentation des coûts, pèse lourdement sur la compétitivité des entreprises et aggrave la situation dont le Gouvernement a hérité.
De plus, en diminuant les marges des entreprises, elle conduit souvent celles-ci à renoncer à prendre le risque d’investir dans une recherche de clients extérieurs.
Dans ces conditions, je crains que notre déficit commercial ne s’aggrave encore.
Quels appuis financiers et fiscaux le Gouvernement met-il en œuvre pour inciter et aider les entreprises à exporter ? Quelles sont les aides pratiquées par nos concurrents européens ? Je vous pose cette seconde question, madame le ministre, parce que les difficultés d’accès à l’information ne nous permettent pas d’évaluer le contexte concurrentiel dans l’Union européenne.
Vous avez raison de cibler un nombre limité de pays, car tous les produits français ne sont pas exportables sur tous les terrains. Votre méthode s’apparente au laser beaming du Japon, mais quelle est votre ligne directrice ?
Par exemple, j’ai constaté que le Kazakhstan ne figurait pas parmi les pays cibles du secteur prioritaire « mieux vivre en ville », alors que ce thème a précisément été choisi pour l’exposition universelle d’Astana en 2017.
Les soldats de l’An II qui se battaient contre l’Europe entière avaient au moins pour eux leur enthousiasme ; dans la guerre économique mondiale, la France envoie des soldats démoralisés se battre contre le monde entier !
Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Quelle politique fiscale incitative comptez-vous mettre en œuvre pour doper nos exportations ?

Monsieur de Montesquiou, vous avez raison de vous préoccuper des politiques menées à l’étranger : vous faites ainsi du benchmarking, comme l’on dit en bon français ! Le fait que nous soyons dans une compétition mondiale rend d’autant plus nécessaire que nous connaissions la manière dont agissent nos concurrents.
C’est la raison pour laquelle j’ai confié à Mme Claude Revel une mission sur notre stratégie en matière de normes européennes et internationales. Mme Revel m’a remis son rapport ce matin et j’en tiens des exemplaires à votre disposition, réservant ainsi au Sénat la primeur de sa communication.
Nous nous faisons trop souvent imposer des normes parce que nous ne sommes pas suffisamment présents dans les lieux où elles sont définies : il nous faut occuper les sièges qui nous y sont réservés dès le début du processus, pour peser sur l’élaboration des normes en Europe et dans le monde.
Vous m’avez interrogé sur ma stratégie, en vous appuyant sur l’exemple du Kazakhstan, un pays que vous connaissez bien.
Le Kazakhstan fait partie des quarante-sept pays que j’ai identifiés comme porteurs de 80 % de la demande mondiale dans les dix prochaines années. Mon travail consiste à organiser pour chacun de ces pays une offre commerciale performante afin d’atteindre les objectifs précis que le Premier ministre m’a fixés, notamment celui de rétablir l’équilibre de notre balance commerciale hors énergie d’ici à la fin du quinquennat.
S’agissant du Kazakhstan, une commission mixte pour la coopération économique se réunira le 7 mars prochain : nous aurons ainsi un échange complet avec les représentants de ce pays au sujet des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Je pense aux produits de la famille « mieux vivre en ville », qui sont particulièrement performants : notre offre de qualité autour de la ville durable est en phase avec la demande mondiale, y compris celle du Kazakhstan. Agir ainsi, c’est faire preuve d’anticipation par rapport à nos concurrents !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE. – M. Aymeri de Montesquiou applaudit également.

M. Aymeri de Montesquiou. Madame le ministre, je vous félicite d’avoir commandé ce rapport qui sera très précieux.
Mme la ministre du commerce extérieur fait passer un exemplaire du rapport à l’orateur.

Je suis très heureux que le Kazakhstan n’ait pas échappé à votre sagacité. Toujours est-il que, dans les listes que j’ai consultées, ce pays ne figure pas parmi les pays cibles au titre de « mieux vivre en ville ». Or, je le répète, la ville d’Astana a été choisie pour accueillir en 2017 une exposition internationale sur ce thème. Le Kazakhstan doit donc être ajouté à cette liste, d’autant que c’est un pays plein d’avenir. Je suis certain que les produits français, de très haute qualité, y trouveront leur place, ainsi que beaucoup d’entreprises françaises.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, que notre balance commerciale soit indéfiniment déficitaire n’est pas une fatalité.
Pour revenir à l’équilibre hors énergie d’ici à cinq ans, alors que notre déficit s’est élevé à 70 milliards d’euros l’an dernier, nous avons besoin d’une politique volontariste. C’est cette politique que vous conduisez, madame la ministre, grâce à une stratégie de reconquête qui s’appuie sur les forces de notre tissu industriel et sur nos entreprises les plus innovantes.
Dans cette perspective, vous avez récemment conclu un partenariat avec les régions, qui se sont engagées à mettre en place, dès le premier trimestre de l’année 2013, des plans régionaux pour l’internationalisation des entreprises, les PRIE, dont elles seront les chefs de file. Il s’agit de mettre en place des guichets uniques et des actions unifiées au service des entreprises, afin notamment de faire progresser de 10 000 en trois ans le nombre des PME et des ETI exportatrices.
Reste que ces plans ne seront efficaces que si nous parvenons à nous doter d’une organisation institutionnelle préservant le lien de proximité si nécessaire dans ce domaine. Des initiatives existent déjà en matière de détection, d’information, de diagnostic et d’aide logistique à l’export. Comment s’inscriront-elles dans les futurs PRIE ?
Pour ne prendre qu’un exemple, je signale qu’une convention régionale de l’export a été conclue en 2011 en Aquitaine, où la chambre de commerce et d’industrie régionale – CCIR – a institué un guichet unique de l’export régional et finance déjà certaines actions. Les premiers résultats de ce dispositif sont encourageants. Nous devons donc éviter la redondance institutionnelle et préserver le savoir-faire et l’expérience déjà acquis.
Madame la ministre, je soutiens sans réserve vos mesures et je suis d’accord avec vous sur le rôle moteur que doivent jouer les régions. Je souhaiterais seulement savoir de quelle manière vous entendez articuler les futurs PRIE avec les initiatives qui existent déjà.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur Bérit-Débat, j’ai indiqué, très peu de temps après mon entrée en fonction, que j’entendais faire des régions les pilotes de l’exportation, puisque la loi leur attribue les compétences du développement économique et de l’innovation. Du reste, je crois savoir que le projet de loi sur l’acte III de la décentralisation que présentera ma collègue Marylise Lebranchu, et que les sénatrices et les sénateurs attendent avec impatience, confortera les régions dans ce rôle.
Je ne suis pas un caporal et je fais confiance aux territoires parce qu’ils sont proches des entreprises, comme je le constate tous les jours. J’ai déjà visité onze régions – j’étais lundi dernier en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Monsieur Bérit-Débat, lorsque je me suis rendue dans votre belle région d’Aquitaine, le 15 novembre dernier, j’ai dit au président du conseil régional ainsi qu’aux responsables de la CCIR que c’était à eux de s’organiser, sachant que, dans mon esprit, la région doit être le chef de file.
J’ai donné rendez-vous aux régions à partir du mois de mars prochain, pour qu’elles me remettent leurs plans régionaux d’internationalisation des entreprises. Mon intention est que chaque région s’organise suivant ses particularités territoriales, car l’Île-de-France n’est pas la Bretagne, la Bretagne, ce n’est pas le Nord–Pas-de-Calais, et le Nord–Pas-de-Calais, ce n’est pas Provence-Alpes-Côte d’azur.
Aujourd’hui, de premières informations me parviennent et je constate que les régions s’organisent. Dans certains cas, c’est la CCIR qui pilote ; dans d’autres cas, il y a fusion ; dans d’autres encore, une complémentarité intelligente est mise en place.
C’est un fait que notre système territorial est souvent illisible et trop compliqué : pour une PME ou une ETI, il est très difficile de se repérer parmi tous les acteurs impliqués. De plus, la multiplicité des acteurs n’est pas une garantie de succès, puisque notre déficit commercial a atteint l’an dernier le niveau historique de 73 milliards d’euros. Nous devons donc trouver des complémentarités sur nos territoires pour être performants à l’international !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.

Je vous remercie, madame la ministre, de vos explications particulièrement claires. Elles montrent votre détermination et celle du Gouvernement à tout faire pour réduire le déficit de notre balance commercial, conformément aux engagements que vous avez pris.
Je pense que nous devons jouer la carte du partenariat le plus large et celle de la proximité. Autour des régions, dont il est très bon qu’elles soient chefs de file, il faut que la démarche se diffuse sur le terrain, au sein des compagnies consulaires, des communautés d’agglomération et des départements, qui ont une bonne connaissance du tissu industriel et artisanal, et par conséquent des entreprises capables d’exporter.
J’espère aussi que l’action de la Banque publique d’investissement permettra de doper l’activité de nos entreprises, non seulement sur le plan intérieur mais aussi à l’exportation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le commerce extérieur de notre pays est déficitaire ; il est réalisé pour plus de 60 % avec les pays de l’Union européenne. Cette réalité essentielle, si elle pose la question de la construction européenne, doit sans cesse être rappelée pour que nous ne fassions aucune erreur dans le diagnostic de nos difficultés.
D’ailleurs, si nous allions plus loin dans l’analyse, nous nous rendrions compte que notre déficit résulte assez largement de l’inégalité de nos échanges avec l’Allemagne. En 2011, par exemple, nous avons totalisé 17 milliards d’euros de déficit commercial avec notre premier partenaire économique.
Cependant, ma question porte sur un autre sujet. La France n’a sans doute pas attendu l’instauration, par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour mettre en œuvre une politique favorisant l’implantation de ses entreprises à l’étranger et leur coopération avec des entreprises extérieures, ces deux objectifs étant autant de points d’appui de notre commerce extérieur.
La pratique des investissements extérieurs a d’ailleurs été si peu mise en œuvre qu’en 2013 Sanofi, première capitalisation boursière de la place de Paris, fait fabriquer à l’étranger 50 % de ses médicaments génériques vendus en France. De même, Peugeot réimporte la majorité des modèles vendus dans l’Hexagone, tandis que Renault construit à l’étranger plus de 70 % de ses équipements et les deux tiers de ses voitures vendues en France.
Ces choix, plus souvent guidés par un objectif de rentabilité financière que par une volonté de coopération, pourtant nécessaire, avec l’étranger ou par un souci de qualité de nos échanges extérieurs, sont mortifères pour l’emploi industriel et coûteux pour notre commerce extérieur.
Au moment où ces entreprises mettent en place des plans sociaux et suppriment des emplois, que compte faire le Gouvernement pour peser sur leur stratégie afin de maintenir et de développer l’emploi industriel en France, tout en réduisant notre déficit commercial ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – MM. Jean-Pierre Sueur et Claude Bérit-Débat applaudissent également.

Force est de constater que, dans la première phase de la nouvelle mondialisation commencée au début des années 1990, la France n’a pas trouvé sa place. Je reste néanmoins convaincue qu’elle peut la trouver en défendant en Europe et ailleurs le principe très important de la réciprocité des échanges : nous considérons que notre ouverture doit trouver sa contrepartie dans l’ouverture des pays partenaires.
Madame Gonthier-Maurin, votre question soulève le problème de la stratégie à l’international. Aujourd’hui, pour exporter, nos entreprises, qu’il s’agisse des grands groupes, des ETI ou des PME, ne peuvent plus se contenter d’offrir un produit, fût-il le meilleur possible.
En effet, même si je pense que la croissance peut repartir en Europe, notamment grâce aux initiatives prises par le Président de la République, à court terme, la dynamique de la demande se situe essentiellement hors d'Europe, en particulier dans les grands pays émergents. Or ceux-ci ne veulent pas importer simplement nos produits : ils souhaitent aussi des implantations industrielles ou la conclusion de partenariats industriels, de manière à favoriser leur développement. La capacité d’essor de nos entreprises à l’international suppose donc qu’elles trouvent des partenaires locaux, distributeurs ou producteurs.
Du reste, je constate que, quand une entreprise s'installe durablement dans un pays étranger, qu'elle y produit des biens et des services, cela profite à ses établissements situés en France.
Madame la sénatrice, vous avez cité Sanofi. Il ne faut surtout pas rendre l'implantation internationale de Sanofi responsable des difficultés que le groupe rencontre sur le territoire national. C’est même tout le contraire et je pourrais vous le démontrer, chiffres à l'appui.
En revanche, dans la mesure où les grands groupes se sont souvent internationalisés grâce à l’aide de la puissance publique, ils doivent une sorte de contrepartie aux territoires. Il nous faut donc veiller avec soin à ce que les ETI et PMI, notamment sous-traitantes, puissent elles aussi se projeter à l'export. §

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Vous avez évoqué la question de la réciprocité et la nécessité de l'exigence publique. Cependant, la puissance publique doit être plus clairement exigeante encore. Dans l'entreprise Renault, par exemple, l’État est certes actionnaire minoritaire, mais sa voix peut encore porter pour que soit donnée une traduction concrète à de telles exigences.
Les cas de PSA ou de Sanofi sont sans doute emblématiques, mais il y a malheureusement bien d’autres exemples. Lorsqu’une grande entreprise engage un processus de réduction d’effectifs ou de fermeture de sites, la puissance publique est habilitée à exiger des contreparties bien plus substantielles.
Voilà qui plaide assurément pour que nous travaillions à accorder beaucoup plus de droits nouveaux d’intervention dans la gestion aux organisations syndicales et au personnel, notamment dans les secteurs industriels stratégiques.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le constat est sévère : la part de la France dans les exportations mondiales ne cesse de se dégrader et notre pays se situe désormais au cinquième rang ; en quinze ans, notre balance commerciale est passée d’une situation d’excédents réguliers à une situation de déficits récurrents. En 2010, le déficit commercial a atteint 52 milliards d’euros et la part de la France sur le marché mondial est maintenant de 4 %, après avoir atteint 6 % au début des années quatre-vingt.
Dans ce contexte, madame la ministre, je salue le plan ambitieux que vous avez lancé le 17 septembre dernier et qui vise à remettre la balance commerciale de notre pays, hors énergie, à l’équilibre d’ici à 2017.
Dès lors, ma question concernant la stratégie de notre pays en matière de commerce extérieur est double.
Je m’interroge, tout d’abord, sur la fragmentation institutionnelle encore trop grande des organismes d’aide à l’exportation : UBIFRANCE, l’Agence française de développement, l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger, etc. Il est vrai qu’OSEO fait désormais partie de la Banque publique d’investissement, à côté du Fond stratégique d’investissement. Malgré tout, madame la ministre, ne pensez-vous pas que le millefeuille actuel des outils institutionnels est encore trop important ? Ne nous faudrait-il pas penser des structures ad hoc réactives et adopter une démarche partant des besoins du terrain ?
Je m’interroge, ensuite, sur l’exportation des technologies écologiques, domaine dans lequel notre pays pourrait exceller s’il s’en donnait les moyens.
Le gouvernement précédent avait lancé le label France Greentech et le plan stratégique Ecotech 2012, dans le sillage du Grenelle de l’environnement. Quelles sont les initiatives du gouvernement actuel pour promouvoir nos écoentreprises à l’exportation dans le domaine du développement durable, en particulier nos entreprises de taille intermédiaire ? §

Madame la sénatrice, vous avez évoqué la fragmentation de notre offre commerciale. C'est vrai pour le territoire national, mais aussi pour notre présence à l'étranger.
Vous êtes très attachée au développement de nos entreprises sur le territoire ; c'est bien tout le sens de ma mission. Je pense que la création de la Banque publique d'investissement va obliger tous les acteurs territoriaux à se positionner dans l'unité.
En effet, quel est notre problème, à nous, Français ? Individuellement, nous sommes relativement bons ; nous ne sommes pas toujours les meilleurs, mais nous avons des pôles d'excellence. En revanche, nous ne savons pas travailler ensemble. C’est à la lumière de ce constat que, hier, mon collègue Arnaud Montebourg et moi-même avons lancé la mission de réflexion « marque France », que je qualifie de « marque ombrelle ».
Il s’agit de promouvoir cette appellation au profit de la diversité de notre production, qui est souvent notre force dans nos régions et dans nos territoires. Il faut que l’ensemble des entreprises développent ensemble leur implantation à l’étranger, quelles que soient leur filière, leur famille de produits ou leur organisation institutionnelle.
Il faut que tout le monde trouve sa place, mais il faut agir ensemble, ce que nos concurrents font, à l’heure actuelle, bien mieux que nous.
Vous avez évoqué à juste titre les écotechnologies. Elles font partie des secteurs de produits d'excellence que j’encourage. Je pense notamment au secteur « mieux vivre en ville », qui recouvre la notion de ville durable, pour laquelle nous avons une offre très intéressante à promouvoir en ce qui concerne le transport de proximité ou l'efficacité énergétique. En Turquie, en Chine et ailleurs, ces besoins doivent être couverts et ces pays nous demandent notre contribution en la matière. La ville durable constitue d’ailleurs l’objet de mon déplacement prochain en Inde, où je vais me rendre avec le Président de la République. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le fameux rapport Gallois énonce dans l’un de ses chapitres : « Devant le déficit de notre commerce extérieur, la progression de l’exportation est une priorité nationale. Notre indépendance et le niveau de vie des Français en dépendent. » Face à cette affirmation, le niveau de notre déficit en 2012, qui devrait baisser par rapport à 2011, apparaît néanmoins toujours comme une menace.
Nous le savons, cette réalité économique pèse très lourdement sur l’activité industrielle, donc sur le niveau de l’emploi dans notre pays. C’est pourquoi il n’y aura pas d’inversion de la courbe du chômage sans une action vigoureuse sur l’exportation.
À cet égard, je me félicite des premières orientations de votre politique, madame la ministre, que ce soient celles qui touchent au dispositif de financement à l’export ou encore à la simplification des procédures douanières.
Vous avez aussi décidé de définir quatre secteurs prioritaires relevant davantage du commerce courant et de sortir du seul prisme des grands contrats. J’espère toutefois que ces derniers bénéficieront de votre vigilance. Je pense en particulier à l’aéronautique.
Ce secteur représente une part non négligeable de nos exportations : les livraisons d’Airbus devraient notamment contribuer à l’amélioration de notre solde commercial de 2012. Or, selon une étude récente d’analyse prospective conduite par la direction du Trésor, le potentiel d’exportation du secteur aéronautique à l’horizon 2022 est relativement faible par rapport à celui d’autres secteurs.
Certes, les entreprises aéronautiques n’ont pas besoin du soutien direct de l’État, compte tenu de leur taille et de leur notoriété. Mais je m’inquiète des attaques spécifiques auxquelles elles peuvent être confrontées.
Au cours de l’été dernier, des responsables chinois ont indiqué à notre ministre des affaires étrangères, en visite en Chine, que leur pays comptait, à partir de sa chaîne d’assemblage d’Airbus de Tianjin, exporter des avions vers des pays tiers, exportations qui entreraient ainsi directement en concurrence avec nos propres exportations. Sur ce point, madame la ministre, avez-vous quelques éléments rassurants à nous communiquer ? §

Monsieur le sénateur, vous connaissez bien le sujet et vous savez que les grands contrats concernent essentiellement l'aéronautique, le nucléaire et le luxe.
Je disposerai des chiffres du commerce extérieur pour l'année 2012 le 7 février prochain, mais les informations dont je dispose concernant les onze premiers moins de l'année me font mesurer la part qu’occupe l'aéronautique, laquelle a effectivement permis à la France d’enregistrer des résultats moins mauvais qu’en 2011. La courbe du déficit ne s’inverse pas encore, mais le mouvement est amorcé. Ce n’est pas d'ailleurs forcément pour de bonnes raisons, car il faut aussi tenir compte du fait que nous importons moins. Nous devons donc faire en sorte que nos exportations augmentent à un rythme supérieur à celui de la baisse de nos importations.
C'est mon challenge !
Nous avons besoin des grands contrats, derrière lesquels se trouve un tissu de PME très important. Je travaille avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le GIFAS, pour aider ces PME équipementières de premier et deuxième rangs à être autonomes sur des marchés qu'elles peuvent prospecter grâce à la couverture que leur apporte le grand groupe.
Il en est de même dans le nucléaire. Lorsque je me rends en Chine pour visiter notre chantier de l'EPR, je rencontre les quatre-vingt-cinq PME et ETI qui travaillent dans la filière nucléaire et qui, parce qu'elles disposent du label des grands du secteur – EDF, AREVA, Alsthom –, sont à même de conquérir leur propre autonomie. Quand on sait faire de la robinetterie dans le nucléaire, on doit savoir en faire dans d’autres secteurs là où l'on est implanté !
Les grands groupes concourent donc à l'activité des PME de leur filière.
Cela étant, il ne faut pas faire de la Chine le bouc émissaire de nos difficultés. Dans le cadre d’une commission mixte avec nos partenaires chinois, nous avons abordé tous ces sujets dans un dialogue franc et direct. J'ai bien évidemment évoqué l'aéronautique et le problème que vous avez soulevé, monsieur le sénateur. Mais il faut savoir que, dans un avion, la valeur ajoutée chinoise représente seulement 7 % : le reste incombe aux Européens et notamment, bien sûr, aux Français. §

Madame la ministre, je vous remercie de votre excellente réponse et je tiens ici à saluer votre détermination, votre volontarisme pour infléchir la courbe du solde de notre commerce extérieur, qui pose un véritable problème.
Je vous suis également reconnaissant de soutenir l'aéronautique. Nous savons que vous mesurez parfaitement l’importance de ce dossier, notamment dans le Sud-Ouest, la région de Toulouse, le Tarn-et-Garonne, département dont je suis l'élu et qui compte de nombreuses entreprises sous-traitantes, lesquelles forment des gisements d'emplois tout à fait essentiels.
J'ai parlé de la Chine, mais j'aurais très bien pu citer les États-Unis, qui, pendant longtemps, nous ont « taillé des croupières » avec des subventions déguisées, tout en critiquant les avances remboursables dont bénéficiait l'aéronautique européenne. Je sais, madame le ministre, que l’Union européenne discute actuellement d’un projet d’accord de libre-échange avec les États-Unis. J’espère qu’un tel accord mettra fin au dumping très bien caché auquel se livrent parfois les États-Unis. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la part de marché de la France en matière d’exportations de produits manufacturés s’est effondrée entre 2000 et 2011, passant de 8, 1 % à 4, 7 %. Celle de l’Allemagne n’est passée que de 13, 6 % à 11, 5 % et notre voisin exporte deux fois plus que nous.
Tout aussi alarmante est la détérioration de notre solde extérieur courant, jadis en équilibre et aujourd’hui en déficit, contrairement à celui de l’Allemagne.
Nos exportations, qui représentent 27 % du PIB, seront notre seul vecteur de croissance en 2013, car les autres moteurs – consommation, dépenses publiques, investissement – sont en panne.
Afin de les renforcer, nous devons remédier à trois maux majeurs.
D’abord, notre présence est trop timide sur les marchés émergents. Ces pays ne sont destinataires que de 20 % de nos exportations. Notre présence en Chine ne représente que 3 %, alors que celle de l’Espagne est de 7 %, celle de l’Italie, 8 %.
Ensuite, notre tissu de PME exportatrices n’est pas assez étoffé. Leur nombre est passé de 120 000 à 95 000 en dix ans, alors qu'en Allemagne elles sont quatre fois plus nombreuses. En outre, 70 % de nos exportations sont réalisées par seulement 1 % des acteurs : Airbus, le secteur énergétique, l'agroalimentaire, le luxe, ainsi que vous venez de le rappeler, madame la ministre. Il faut donc absolument renforcer l'idée de travailler à l'export « en escadrille ». Par exemple, une grosse entreprise allemande qui s'installe à l'étranger est nécessairement entourée de tout un tissu de PME d'origine allemande.
Se pose enfin le problème de notre positionnement sur le marché. Notre modèle fiscal et social, qu’il n’est pas ici question de critiquer, pénalise notre compétitivité sur le bas de gamme.
Si l’aéronautique reste un domaine fort en matière d’exportations, le secteur de l’automobile a vu les siennes diminuer de 26 % en dix ans. En dehors du haut de gamme et du luxe, nous sommes donc très faibles à l’export.
Face à ce constat, madame la ministre, quelles mesures votre gouvernement entend-il prendre afin que la France puisse retrouver son rang au regard de la productivité internationale ?

Monsieur Fouché, même si cela ne nous exempte pas d’agir – et c’est bien ce que je fais, avec le Gouvernement –, je veux d’abord relativiser votre propos en rappelant quelques faits.
S’il est vrai que la part de marché de la France a considérablement diminué en dix ans, il ne faut pas oublier que le marché mondial s’est considérablement étendu dans l’intervalle, notamment avec la montée en puissance des émergents, grands ou intermédiaires.
Vous avez raison, nous ne sommes pas assez présents dans les pays émergents, et c’est pourquoi je concentre mon action de court terme dans cette direction.
Nous savons que l’Europe est en difficulté et nous avons besoin de relais de croissance. Nous devons donc nous porter vers ces marchés plus lointains, qui sont certes difficiles, mais qui vont concentrer 80 % de la demande mondiale dans les dix années qui viennent.
Dans cette optique, j’ai structuré l’offre commerciale autour de quatre grandes familles : « mieux vivre en ville », « mieux se soigner » – l’économie du bien-être –, « mieux se nourrir » – c’est tout le domaine de l’agroalimentaire, du champ à l’assiette – et « mieux communiquer », cette dernière famille recouvrant des segments à très forte valeur ajoutée, telles les nouvelles technologies portant sur la sécurité numérique. Cette offre sera focalisée sur quarante-sept pays dans lesquels nous réorganisons en priorité notre présence, notamment celle de notre opérateur commercial.
Vous avez parlé des contraintes fiscales, monsieur le sénateur. Je voudrais quand même rappeler l’action du Gouvernement à cet égard. Le pacte de compétitivité contient des objectifs très précis dans mon champ de compétences. Outre que nous avons créé le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui représente 20 milliards d’euros pour les entreprises, nous avons stabilisé cinq dispositifs fiscaux, notamment le crédit d’impôt recherche, très profitable au tissu industriel français et très attractif pour les entreprises étrangères qui s’implantent en France et exportent à partir de la France.
Il nous faut aussi garder notre première place en attractivité pour les centres industriels et attirer les investissements étrangers en France, pour pouvoir ensuite produire et créer de l’emploi. Je vous rappelle que 1 milliard d’euros à l’export, c’est 10 000 emplois supplémentaires créés en France.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

J’ai bien noté votre réponse, madame la ministre.
Je souhaite effectivement que des mesures soient prises, car je suis très inquiet, comme beaucoup de Français, sur l’avenir de l’industrie et, par conséquent, sur l’avenir d’un certain nombre de travailleurs.
Nous sommes vraiment confrontés à de grandes difficultés.
Quoi qu’il en soit, nos objectifs se rejoignent et je souhaite, madame la ministre, que vous engagiez les moyens nécessaires pour les atteindre.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fixe l’objectif d’un équilibre de la balance commerciale hors énergie pour 2017. C’est un objectif très ambitieux, qui représente 25 milliards d’euros supplémentaires à l’export et qui nécessite de revenir sur le démantèlement du service public de soutien à l’exportation mis en œuvre lors du précédent quinquennat, démantèlement dont nous voyons aujourd’hui les conséquences sur notre balance commerciale.
Dans cette optique, depuis votre arrivée au ministère du commerce extérieur, de nouveaux outils et de nouvelles orientations se mettent en place. Ainsi, un partenariat État-régions a été établi, reconnaissant les régions comme « pilotes de l’export ». On a également confié à la Banque publique d’investissement la mission d’assurer le financement de l’internationalisation de nos entreprises. En outre, la politique du chiffre d’UBIFRANCE a été abandonnée au profit d’un suivi plus qualitatif de l’accompagnement de nos entreprises. Enfin, un ciblage pays-secteurs a été élaboré, vous l’avez rappelé, madame la ministre.
Dans mon intervention de novembre 2011 sur le budget d’UBIFRANCE, je rappelais une grande part des critiques formulées tant par les acteurs de terrain que par la Cour des comptes sur l’orientation donnée à cet organisme par le gouvernement Fillon.
Je soulignais en particulier deux points.
Premièrement, il y a urgence à assurer une complémentarité totale entre les acteurs de terrain – les chambres de commerce françaises à l’étranger au premier chef, mais aussi nos communautés d’affaires – et l’ensemble des institutions françaises ayant l’ambition d’intervenir sur cette question – particulièrement UBIFRANCE et les missions économiques et commerciales –, qui doit jouer tant dans la définition des priorités que dans l’action de soutien aux entreprises.
Deuxièmement, en raison du déficit record de notre balance commerciale, tous les services de l’État doivent se mobiliser.
Dans beaucoup de pays, l’absence de mission économique et commerciale ou de mission UBIFRANCE fait que notre ambassade se retrouve seule pour l’accompagnement de nos entreprises. Dès lors, ne faudrait-il pas densifier géographiquement notre réseau UBIFRANCE pour mieux coller aux besoins et spécificités d’un grand nombre de pays, plutôt que de constituer de grands bureaux compétents sur de nombreux pays et dont les moyens peuvent faire double emploi avec ceux des chambres de commerce ?
Parfois, la structure de l’économie du pays cible, ses projets d’infrastructures ou l’absence d’expertise privée française locale, qu’il convient pourtant de favoriser, rendraient indispensable l’existence d’un service de soutien à l’export sur place.
Cette même préoccupation me conduit à vous interroger sur la complémentarité des rôles de vos services, des ambassadeurs et des plénipotentiaires du Gouvernement qui ont été nommés pour la Chine, l’Algérie ou la Russie, ou encore sur la complémentarité des rôles des conseillers du commerce extérieur et des conseils économiques annoncés par Laurent Fabius en août 2012.
Comment permettre au service public de l’export d’avoir une connaissance aussi fine que possible des opportunités qui s’offrent à nos entreprises et des moyens de les saisir ?
Comment mieux mobiliser les opérateurs français vivant à l’étranger au service de nos ambitions, sans que cela fasse doublon avec UBIFRANCE ?

Comme moi, vous parcourez le monde, monsieur Leconte ; nous nous croisons d’ailleurs quelquefois.
UBIFRANCE, notre opérateur commercial, a pour mission d’aider nos PME et PMI à se projeter à l’étranger.
Avec Jean-Marc Ayrault, nous avons souhaité réorganiser la manière de travailler de cet organisme, en nous gardant de toute réforme de structure qui nous aurait emmenés trop loin et aurait pris trop de temps.
En revanche, nous avons décidé qu’UBIFRANCE, plutôt que de faire du quantitatif, ferait du qualitatif, en accompagnant dans la durée, sur trois ans, 1 000 PME innovantes et ETI indépendantes chaque année. Croyez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un vrai challenge !
La semaine dernière, UBIFRANCE m’a présenté son plan de montée en charge : 250 entreprises en 2013, 600 en 2014 et 1 000 en 2015. Je ne doute pas que ces objectifs seront atteints.
De la même manière, nous avons décidé d’augmenter le nombre de volontaires internationaux en entreprise, ces jeunes qui partent à l’étranger au service d’une PME ou d’un grand groupe, et qui sont parfois aidés, pour partie, par les régions. J’en profite pour rendre hommage à l’action de ces collectivités : quand elles s’impliquent, elles le font très bien ; il faut simplement qu’elles le fassent encore davantage !
Ces jeunes sont actuellement 7 400 et nous souhaitons, en trois ans, porter leur nombre à 9 000. Là encore, c’est un vrai challenge, qui doit mobiliser tout le monde, grands groupes comme petites entreprises. Et les grands groupes doivent aider les plus petites entreprises à bénéficier elles aussi de l’apport que représentent ces volontaires.
Vous avez également évoqué la présence des services de l’État à l’étranger. Quand on dit aux représentants d’UBIFRANCE : vous devez aller au Kenya, parce que c’est un pays porteur, qui fait partie de la liste des quarante-sept, ils s’implantent dans ce pays. Quand on leur dit : vous devez très vite prendre place en Birmanie, car la concurrence y est déjà implantée, ils le font. Cela impose des redéploiements, car je vous rappelle que nous sommes soumis, comme les autres, aux contraintes des finances publiques, qui imposent de faire des économies. Cela nous oblige à être meilleurs.
Quant aux chargés de mission nommés par mon collègue ministre des affaires étrangères, ils font partie de la panoplie de la diplomatie économique. J’y vois, en priorité, une aide au commerce extérieur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je salue la mobilisation et les réorientations qui sont annoncées, de même que le renforcement du rôle de l’État à l’export.
Je salue aussi la réflexion sur les normes, un outil très important pour arriver à exporter.
Il me semble qu’une réflexion sur les marchés publics à l’exportation mériterait aussi d’être menée.
En vérité, c’est une véritable révolution culturelle que nous devons opérer pour remettre l’industrie au cœur de notre économie. C’est un véritable projet de société, qui dépasse la simple relance de nos exportations.
Parce qu’il n’y aura pas d’exportation sans production, et parce que, à terme, il n’y aura pas non plus d’emplois ni de civilisation sans production, il faut remettre la production au centre de l’économie.
Madame la ministre, vous êtes au premier rang pour accomplir cette révolution culturelle.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord me réjouir de l’organisation, aujourd’hui au Sénat, d’une séance tout entière consacrée au commerce extérieur.
Notre pays n’a en effet que trop rarement pris conscience de la très grande importance du sujet !
Je voudrais ensuite vous adresser, personnellement, chère ancienne collègue et rapporteur générale du budget, mes compliments et encouragements. Nous apprécions votre saine estimation de la gravité de la situation, votre volontarisme affiché – et au demeurant bien réel, je le crois –, ainsi que votre volonté de mobiliser tous les acteurs des secteurs public et privé, en France comme à l’étranger, pour les faire agir collectivement. J’ai lu avec une attention particulière la feuille de route que vous avez adressée aux conseillers du commerce extérieur de la France.
Cependant, madame la ministre, permettez-moi aussi de regretter que tous les membres du Gouvernement n’aient pas la même conscience de la gravité de la situation.
Si c’était le cas, les priorités seraient différentes et vous ne seriez pas privée, dans votre action, de l’apport si précieux de beaucoup d’entrepreneurs que nous voyons avec grande tristesse partir à l’étranger, où ils créent ces richesses et ces emplois dont nous avons tant besoin.
Quand la maison brûle, n’y a-t-il pas mieux à faire pour notre pays que d’occuper la scène médiatique et parlementaire avec des sujets dont l’urgence est pour le moins discutable ?
Mais je reviens à votre mission. On ne peut qu’approuver et soutenir les priorités que vous avez affichées dans votre plan d’action. Il reste à les mettre en œuvre. D’où mes trois questions.
Comment, concrètement, obtenir enfin un jeu collectif qui impliquerait tous les acteurs ? Je n’ose pas parler d’équipe de France, car je crois avoir compris que vous préfériez d’autres expressions… §
J’espère vivement que l’expérience du « comité Asie », que vous avez installé avec votre collègue Guillaume Garot, ministre délégué chargé de l’agroalimentaire, sera un tel succès que ce comité pourra servir de modèle.
Ma deuxième question a trait à l’articulation entre l’aval du processus, c’est-à-dire notre dispositif à l’étranger, et l’amont, c’est-à-dire, en France, les secteurs ou filières professionnelles et les régions.
À supposer que, en aval, un dispositif très performant permette d’identifier des marchés prometteurs, comment s’assurer que les acteurs français de la filière sont bien informés et réagissent efficacement. Ensuite, s’il faut effectivement mobiliser les régions, comment articuler la connexion entre filières et régions ?
Avec votre autorisation, madame la présidente, je poserai très rapidement ma troisième et dernière question, car je m’aperçois que j’ai dépassé mon temps de parole.

Il me semble que chacun s’accorde sur le fait que, à l’étranger, l’ambassadeur doit avoir la responsabilité de coordonner l’action et d’assurer la nécessaire synergie entre tous les acteurs.
Que pensez-vous, dès lors, de l’idée d’une cosignature par vous-même et le ministre des affaires étrangères de la partie économique des lettres de mission de nos ambassadeurs ?

M. André Ferrand. Quoi qu’il en soit, madame la ministre, je vous souhaite de réussir, car il y va de l’intérêt supérieur de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l’UMP, du RDSE et du groupe socialiste.

Pour ce qui est de cette dernière, je vous fais confiance ! §Je pense l’avoir expliqué tout à l'heure, en matière de diplomatie économique, sur le plan opérationnel et de manière très concrète, c’est moi qui suis l’animatrice sur le terrain.
Vous avez évoqué les chiffres du commerce extérieur. J’ai pour habitude de dire qu’il s’agit là du véritable juge de paix de nos faiblesses. Or il est clair que, de ce point de vue, la situation actuelle n’est pas du tout satisfaisante.
Mais le tocsin de l’année 2011 a tout de même permis de mobiliser les énergies. J’ai déjà assisté à onze réunions dans onze régions différentes, je me rends partout à l’étranger et, à chaque déplacement, je vois des entrepreneurs et des personnels extrêmement mobilisés. Je constate aussi qu’il y a tout de même des secteurs qui marchent : nous devons nous appuyer sur eux comme sur des leviers afin d’être plus efficaces à court terme.
Je l’ai dit, il nous faut jouer collectif. Vous savez que je me méfie des grandes formules, et notamment de celles qui font référence à l’équipe de France de football, qui n’a pas toujours donné le meilleur exemple par le passé. Le match France-Allemagne aura lieu très bientôt : attendons le résultat !
Nouveaux sourires.

Au-delà des formules, je souhaite que l’on soit plus opérationnel, que l’on avance groupé. Voilà qui est clair ! Chaque filière, quelle que soit sa taille – grande, moyenne, petite –, doit avancer de manière groupée, notamment en matière d’offre commerciale.
C’est pour cette raison que j’ai défini quatre familles correspondant à quarante-sept pays qui vont assurer 80 % de la demande mondiale. Cela ne signifie pas qu’il faille laisser tomber l’Europe, c’est évident. En Europe, les parts de marché valent très cher. C’est aussi ce qui explique que nos principaux partenaires européens soient souvent nos principaux concurrents à l’étranger. Nous devons donc, pour être plus efficaces, déployer notre intelligence économique de manière plus collective.
Je finirai par là où j’ai commencé : il me semble que le commerce extérieur est devenu une priorité pour ce gouvernement. Dès le mois d’août, le Premier ministre a repris à son compte la stratégie que je lui ai proposée. Ce qui a été fait au travers du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi en témoigne. En effet, ce pacte ne se limite pas au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : il comporte aussi tout un volet sur la modernisation de l’action publique. Soyez attentifs, mesdames, messieurs les sénateurs, à ce volet.
Je pense que nous arriverons – le Premier ministre y tient – à ce que la modernisation de l’action publique constitue enfin la véritable réforme de l’État. §

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur le commerce extérieur.
Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures cinq.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe socialiste, la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale, présentée par M. Jacky Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés (proposition n° 243, texte de la commission n° 278, rapport n° 277).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacky Le Menn, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi déposée par les membres du groupe socialiste est, en quatre ans, le cinquième texte dont l’examen amène le Sénat à se pencher sur l’avenir de la biologie médicale. Elle fait suite à la proposition de loi de Valérie Boyer et Jean-Luc Préel, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale voilà un an, le 26 janvier 2012. Comme cette dernière, le présent est exclusivement consacré à cette question.
Le souhait de voir ratifier l’ordonnance du 13 janvier 2010, qui s’applique depuis trois ans, est partagé de façon quasi unanime dans la profession et largement transpartisan.
Le texte qui nous est soumis reprend plusieurs dispositions de la proposition de loi Boyer-Préel tout en se rapprochant des positions du Sénat, notamment pour ce qui concerne l’interdiction des « ristournes ». Il a été élaboré en étroite concertation avec des collègues députés particulièrement impliqués en la matière. Un large processus de concertation avec les professionnels publics et privés et d’auditions a été mené pendant plusieurs mois.
L’objet de la présente proposition de loi est à la fois restreint et ambitieux. Il s’agit de garantir la sécurité des examens par l’accréditation et de limiter la financiarisation du secteur libéral, dont les bénéfices attirent des investisseurs extérieurs aux professions de santé.
Quelle que soit la qualité des professionnels qui exercent dans les laboratoires de biologie médicale, leur infaillibilité n’est pas plus démontrée que celle des autres professionnels de santé. Or le nombre d’actes de biologie médicale augmente de façon constante depuis 1998. Il faut donc garantir aux patients que les examens qu’ils subissent seront pratiqués d’une manière telle que les diagnostics et traitements prescrits sur leur fondement soient adaptés à leur pathologie.
Le système de contrôle antérieur à l’ordonnance précitée comportait des limites importantes. En moyenne, et selon les départements, un laboratoire ne faisait l’objet d’une visite d’inspection que tous les vingt ou quarante ans, ce qui ne permettait pas de garantir aux patients la qualité des examens. Or, malgré ce très petit nombre d’inspections, en France, sur un total d’environ 4 000 laboratoires de biologie médicale privés, dix à quinze sont fermés chaque année par les autorités sanitaires. On peut donc craindre que des laboratoires n’offrant pas toutes les garanties de qualité ne soient encore en exercice.
Par ailleurs, le renouvellement constant des technologies impose un effort continu de formation et d’adaptation de la part des laboratoires et des investissements lourds en capital.
À ces éléments s’ajoute le fait que la biologie médicale est particulièrement présente sur notre territoire : près de 10 500 biologistes, soit 16, 5 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne communautaire est de 5, 8.
À la suite d’un rapport particulièrement sévère de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de 2006, les pouvoirs publics ont confié à Michel Ballereau, conseiller général des établissements de santé, l’élaboration d’une réforme du secteur. Celle-ci, conduite en 2010, s’est appuyée sur plusieurs constats dressés dans le rapport qu’il a remis à la ministre de la santé de l’époque.
Il a tout d’abord été relevé que certains laboratoires de biologie médicale avaient une activité trop faible pour pouvoir s’adapter aux techniques d’analyse les plus modernes et qu’ils présentaient le plus grand nombre de défauts au contrôle national de qualité.
Il a toutefois été observé qu’il était nécessaire de lutter contre les situations monopolistiques, notamment en raison des risques qu’elles font peser sur l’organisation de l’offre de soins.
Le rapport constatait enfin qu’il fallait opérer un choix entre une biologie analytique, plus coûteuse et de moindre efficacité pour les patients, et une biologie médicale, davantage attachée à la fiabilité des examens et à l’efficience des pratiques. C’est cette dernière voie qui a été retenue dans la présente proposition de loi, dans la ligne de l’ordonnance de 2010.
Ce que l’on appelle généralement la « médicalisation » de la biologie médicale découle d’une double volonté : d’une part, garantir le plus haut niveau de qualité pour les examens, quelle que soit la structure publique ou privée qui les pratique ; d’autre part, limiter la possibilité pour des investisseurs, légitimement motivés d’abord par le taux de retour sur leur capital, de contrôler cette activité de plus en plus importante en volume.
La médicalisation doit néanmoins être appréciée dans le cadre du droit européen. En effet, les limites posées par le législateur à l’ouverture des cabinets de biologie médicale posent un problème au regard des principes de liberté d’installation et de prestation qui sont aux fondements du droit de l’Union européenne. Ainsi, la Commission européenne n’est pas habilitée à se prononcer sur l’opportunité du choix par un État membre de réserver l’exercice de certaines activités aux professions de santé. En revanche, elle peut exiger que cette restriction ne soit pas une entrave déguisée au droit de la concurrence.
Si la France ne se conformait pas aux exigences du droit de l’Union européenne et ne parvenait pas à justifier les restrictions qu’elle apporte à l’installation de laboratoires par des motifs de santé publique, elle pourrait se voir contrainte par la Cour de justice de l’Union européenne d’ouvrir la biologie médicale à la concurrence.
J’en viens au contenu de la proposition de loi tel qu’il a été modifié par la commission des affaires sociales.
L’ordonnance du 13 janvier 2010 s’applique depuis sa publication. Toutefois, tant qu’elle n’a pas été ratifiée, ses dispositions législatives sont susceptibles d’un recours devant le Conseil d’État. De fait, l’ordre des médecins, qui s’opposait à l’accréditation obligatoire, a déféré l’ordonnance devant le juge administratif qui n’a annulé qu’une seule de ses dispositions, jugée inintelligible. Dès lors, la stabilité juridique du dispositif peut être considérée comme largement acquise.
Il convient cependant de noter que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, une mesure réglementaire prise sur le fondement de cette ordonnance mais contraire au droit européen reste susceptible d’annulation par le juge administratif.
Néanmoins, la ratification explicite de l’ordonnance est considérée par la profession comme une garantie de l’engagement des pouvoirs publics dans la réforme. C’est l’objet de l’article 1er de la présente proposition de loi.
La qualité des soins est la finalité fondamentale de la proposition de loi. Elle dépend de l’accréditation. La commission des affaires sociales a choisi de rétablir l’objectif d’une accréditation à 100 % en 2020.
Je considère que la mise en place de paliers imposant progressivement un taux d’accréditation de plus en plus élevé est nécessaire à la création d’un mouvement qui changera les mentalités en même temps que les pratiques dans les laboratoires. Cette évolution passera successivement par un palier d’accréditation à 50 % en 2016 et à 80 % en 2018, pour aboutir à un taux d’accréditation à 100 % en 2020. Ainsi que nous l’ont affirmé les chercheurs, ce mouvement n’entravera nullement l’innovation puisque celle-ci est prise en compte dans les procédures d’accréditation.
Je n’en suis pas moins conscient des problèmes spécifiques qui se posent pour la biologie spécialisée, par exemple dans le cadre de la recherche en génétique. Compte tenu de l’évolution très rapide des techniques dans ces domaines de pointe, les équipes de recherche n’ont parfois pas matériellement le temps de s’engager dans l’accréditation de procédures en constante évolution. J’attire donc l’attention de vos services, madame la ministre, ainsi que ceux de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur ces enjeux très particuliers.
Toute accréditation est conduite sous l’égide du Comité français d’accréditation, le COFRAC, qui est chargé d’une mission de service public et dispose d’un monopole national pour son action. En pratique, ce sont les pairs qui conduisent les accréditations et contrôlent la conformité des équipements et des pratiques à la norme définie par l’Association française des normes. On ne peut donc affirmer que le niveau de contrainte serait sans lien avec la pratique quotidienne et la réalité des procédures, car ce sont des praticiens de terrain qui exercent à temps partiel la fonction d’accréditeur.
J’insiste sur le fait que l’accréditation ne se substitue pas au contrôle que doivent exercer les agences régionales de santé, les ARS, sur les laboratoires. Madame la ministre, peut-être pourrez-vous nous apporter des précisions sur les moyens, notamment informatiques, qui seront mis à leur disposition pour exercer cette mission.
Par ailleurs, je ne pense pas que le choix du mode de garantie de la qualité des examens de biologie médicale recouvre une volonté de regroupement du secteur. Le regroupement des entités qui détiennent les laboratoires et la fermeture des sites des laboratoires de biologie médicale sont en effet deux choses différentes. L’obligation de concentration imposée par les appareils et leurs coûts est contrebalancée par deux éléments. D’abord, la pratique ancienne des industriels du secteur est de prêter les appareils aux laboratoires afin de vendre les consommables. Surtout, rien n’empêche des biologistes d’ouvrir, dans le respect des règles d’implantation, de nouveaux laboratoires accrédités utilisant des technologies plus compactes.
Des questions se posent néanmoins relativement au coût de l’accréditation. D’après la direction générale de la santé, celui-ci représenterait 1 % à 2 % du chiffre d’affaires ; l’ordre des médecins, dont nous avons auditionné des représentants, l’évalue plutôt au double. Ce débat et celui qui porte sur la nature juridique du COFRAC – ce comité est une simple association – m’ont conduit à demander à la commission des affaires sociales d’inscrire l’accréditation en santé humaine parmi les sujets dont elle confie l’examen à la Cour des comptes. Plusieurs amendements ont par ailleurs été déposés, et nous attendons des précisions du Gouvernement sur ce point.
Le refus de la financiarisation de la profession constitue la seconde priorité de la proposition de loi. Sans porter de jugement sur l’éthique des entreprises d’actionnaires détenant plusieurs laboratoires, l’indépendance des biologistes de laboratoire est mieux garantie par la possibilité pour eux d’acquérir une fraction, voire la totalité du laboratoire dans lequel ils travaillent. C’est le cas pour 85 % des laboratoires, et cette proportion devrait rester stable ou augmenter du fait de l’application des dispositions des articles 8 et 9 de la proposition de loi, qui limitent les formes juridiques que sont susceptibles de prendre les laboratoires de biologie médicale.
Plusieurs professionnels libéraux s’inquiètent des possibilités de contournement des restrictions qui seraient imposées par le législateur. Je considère cependant qu’il convient de ne pas rendre trop complexes les normes applicables à l’exercice libéral de la profession, sous peine d’augmenter le nombre de contentieux et, surtout, de risquer une condamnation sur le fondement du droit européen de la concurrence. Une telle condamnation priverait en effet les biologistes de toute protection.
De plus, conformément à la position constante du Sénat, l’article 5 de la proposition de loi interdit, en dehors du cadre des contrats de coopération passés entre laboratoires, de déroger au prix réglementé des actes, et donc de pratiquer des tarifs inférieurs, communément appelés « ristournes ». Il convient de noter que l’interdiction porte également sur la pratique des dépassements d’honoraires.
La proposition de loi traite également, à son article 6, de la question du recrutement de personnels enseignants et hospitaliers universitaires non titulaires du DES – diplôme d’études spécialisées – de biologie médicale. La position adoptée par la commission des affaires sociales est une position de compromis, qui permet de concilier les préoccupations des biologistes hospitaliers et des doyens de faculté, et qui ne saurait être remise en cause sans compromettre cet équilibre.
Il m’est apparu qu’un accès dérogatoire à ces postes était rendu nécessaire par les impératifs des activités spécifiques de soins, de recherche et d’enseignement des CHU. Le DES de biologie médicale permet en effet de former des biologistes généralistes compétents, mais ne forme pas spécifiquement aux surspécialités sur lesquelles repose la biologie médicale hospitalo-universitaire, telles que la biochimie-biologie moléculaire, la parasitologie ou encore l’immunologie. Il est donc crucial d’ouvrir les équipes hospitalo-universitaires à des personnels ayant une double compétence dans les spécialités cliniques et dans les surspécialités considérées, tant pour assurer la dimension médicale de l’enseignement en DES de biologie médicale que pour préserver la qualité des soins en CHU.
Il ne s’agit pas pour autant d’ouvrir ces postes à l’ensemble des scientifiques ; car cette demande nous a été faite. Seuls des médecins ou pharmaciens pourront y accéder, conformément à l’objectif de médicalisation qui guide cette proposition de loi, et ils ne pourront exercer que dans leur surspécialité.
Un dernier point me semble important. La réforme de 2010 impose les mêmes obligations aux secteurs public et privé. L’accréditation s’impose à tous et à tous les actes de biologie, ce qui signifie que les laboratoires hospitaliers ne disposent pas d’une présomption de conformité. Je note d’ailleurs que les laboratoires des hôpitaux publics sont en cours de restructuration rapide et qu’ils se sont pleinement engagés dans le processus d’accréditation. On peut néanmoins regretter que le dialogue entre secteurs public et privé reste difficile et marqué par le soupçon réciproque d’une volonté d’expansion.
Dans l’ensemble, l’ordonnance de 2010 est, malgré ses défauts, porteuse d’un renouveau de la biologie médicale, auquel nous pouvons tous adhérer et qui doit maintenant être consacré par la loi. J’estime que, après trois ans de débats, la procédure accélérée prend tout son sens, et je suis convaincu que nous parviendrons, au plus tard en commission mixte paritaire, à trouver une rédaction qui pourra être largement adoptée. §
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales – je ne suis pas habituée à voir tant de présidentes !
Sourires.
Nous sommes aujourd'hui dans une situation nouvelle, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. C’est donc un nouveau texte qui vous est présenté par Jacky Le Menn, au nom de son groupe. Je tiens à saluer le travail effectué en lien avec l’Assemblée nationale pour que nous puissions avancer rapidement sur un sujet qui appelle des décisions.
Si le Gouvernement fait le choix de soutenir très clairement et très fortement cette proposition de loi, c’est parce qu’il nous revient aujourd’hui de tout mettre en œuvre pour permettre à la biologie médicale française de relever le double défi de la qualité et de l’efficience. Je souhaite que ces défis importants donnent lieu à des débats constructifs dans cet hémicycle, afin que nous avancions de manière collective et aussi consensuelle que possible.
La première de nos priorités est d’assurer la qualité des examens en biologie médicale. Nous savons évidemment qu’un résultat fiable est indispensable pour garantir un bon diagnostic et un traitement adapté.
Le développement des connaissances scientifiques a donné à la biologie médicale une place centrale dans le parcours de soins du patient. Le texte que nous examinons aujourd'hui prend la mesure de la diversité de la biologie médicale française. Il faut rappeler que, en ville et à l’hôpital, elle détermine plus de trois diagnostics sur cinq. Les biologistes médicaux jouent un rôle pivot : ils sont quotidiennement au contact de millions de Français et assurent la qualité de leur prise en charge. Ils sont également en relation étroite avec l’ensemble des professionnels de santé.
Or ce secteur connaît une profonde mutation, du fait notamment – mais pas exclusivement – des progrès techniques qui ont, ces dernières années, transformé la pratique de cette profession. La médecine s’est technicisée et la biologie s’est automatisée. Ces évolutions imposent à la fois une formation permanente des professionnels et de lourds investissements financiers, qui ne sont pas sans poser un certain nombre de difficultés.
Dans le même temps, le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, la complexité des diagnostics médicaux et, il faut bien le dire, le niveau d’exigence croissant des patients – on peut le comprendre –, ont considérablement modifié l’exercice de ce métier.
Pourtant, comme cela a été rappelé, depuis 1975, le secteur n’a connu aucune réforme ambitieuse, lui permettant de faire face à ces nouveaux enjeux. Cela signifie que, pendant presque quarante ans, la profession a été confrontée à des changements importants des techniques et des pratiques médicales – l’évolution s’est même accélérée ces dernières années – sans pour autant être réorganisée. Nous devons donc poursuivre la réorganisation du secteur de la biologie médicale si nous voulons garantir la qualité des soins.
Ces dernières années, plusieurs rapports ont mis en évidence de graves défauts de qualité et insisté sur la nécessité d’une nouvelle structuration du secteur. Un rapport de l’IGAS sur la biologie médicale publié en 2006 indiquait ainsi que la moitié des laboratoires de biologie médicale de notre pays n’étaient pas en mesure de « remplir les conditions de qualité » dues à chaque patient. Certains d’entre eux présenteraient même un fonctionnement à risque.
Nous devons aujourd'hui garantir la qualité des analyses et des examens. C’est un enjeu de sécurité sanitaire, car la qualité, c’est la juste prescription. On voit bien, à suivre les débats qui traversent notre pays, que nos concitoyens sont, à juste titre, particulièrement sensibles à tout ce qui touche à leur sécurité sanitaire.
Il nous faut donc mettre en place un dispositif qui garantisse la sécurité de nos concitoyens : c’est tout le sens de l’accréditation, qui permettra de s’assurer de la fiabilité des résultats, quel que soit l’examen pratiqué et quel que soit le laboratoire qui le pratique.
Vous avez également rappelé, monsieur le rapporteur, que l’accréditation ne devait pas se substituer aux contrôles effectués par les ARS. Je peux vous assurer que je veillerai à la mise en œuvre de cette double démarche.
Le renforcement de la médicalisation de la biologie médicale vise, lui aussi, à garantir le plus haut niveau de qualité des examens. L’ordonnance du 13 janvier 2010 a fait le choix de réserver la pratique de la biologie médicale aux seuls médecins et pharmaciens ayant suivi une formation spécifique au cours de leurs études. Le biologiste médical, médecin ou pharmacien spécialisé en biologie médicale, acquiert ainsi une responsabilité à part entière : il devient le garant de la qualité des résultats.
Garantir cette qualité, c’est aussi s’assurer que chaque patient a accès à ses résultats dans des délais raisonnables, et le plus rapidement possible en cas d’urgence. C’est pourquoi la loi prévoit déjà que les résultats doivent être rendus au prescripteur et au patient « dans un délai compatible avec l’état de l’art ». Ils doivent être fiables et interprétés biologiquement en des termes compréhensibles et clairs.
Le second défi que nous devons relever est celui de l’efficience du secteur de la biologie médicale. Ses modèles économique et juridique constituent aujourd’hui un frein au progrès.
Il nous revient donc de préparer l’avenir en offrant aux laboratoires les moyens de se réorganiser, de diminuer leurs coûts et d’investir. Nous devons tout mettre en œuvre pour ne prendre aucun retard technologique et pour assurer la qualité des examens.
La modernisation de notre système de soins commence par sa réorganisation, laquelle permettra aux laboratoires d’investir dans des outils de haut niveau, donc de gagner en efficience, de dégager des économies et, aussi, de maîtriser, il faut le dire, les dépenses de santé.
Je le répète, ce n’est pas parce que nous dépenserons plus que la qualité des soins s’en trouvera améliorée. Quels que soient le niveau et l’évolution des dépenses en matière de santé, nous devons évidemment faire en sorte que celles-ci soient justes et appropriées, et que leur correspondent des soins de qualité pour nos concitoyens.
Ce texte a pour objet d’accompagner un mouvement qui a déjà été engagé. En effet, si cette proposition de loi est adoptée, les laboratoires de biologie médicale gagneront en souplesse d’organisation. Ainsi, ils pourront être « multisites » et se réorganiser sans heurt. La nouvelle réglementation a déjà largement contribué à soulager les budgets hospitaliers.
Les objectifs visés par la réorganisation de la biologie médicale sont donc l’amélioration de l’efficience du système et celle de la qualité du service rendu aux cliniciens, donc aux patients.
Enfin, nous devons garantir le maintien d’une offre en biologie médicale dans tous nos territoires. Telle est bien l’ambition de ce texte, qui vise notamment à préserver la biologie médicale des abus de la financiarisation et à empêcher la constitution de monopoles.
Le maillage de notre territoire est aujourd’hui bien assuré par l’existence de nombreux établissements de proximité. Il s’agit d’un atout, auquel les citoyens français sont attachés, comme ils le sont à une offre de soins de proximité. Nous devons donc préserver ce maillage, car c’est le seul moyen de garantir l’accès aux examens biologiques à l’ensemble de la population, quel que soit son lieu d’habitation.
À travers les schémas régionaux d’organisation des soins, les SROS, les agences régionales de santé, les ARS, s’attachent à répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Elles auront pour mission de maintenir une offre adaptée en biologie médicale dans chaque territoire. Il s’agit d’un point important, qui doit être explicitement intégré dans les SROS, car c’est précisément à l’échelle des territoires que nous pouvons lutter efficacement contre les inégalités sociales et territoriales de santé, lesquelles, nous le savons bien, sont intimement liées.
Ce qui est vrai pour l’offre de soins en termes médicaux doit l’être aussi pour la biologie médicale. En effet, on ne peut pas concevoir une offre de soins complète dans un territoire sans accès à une biologie de qualité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la volonté de ratifier l’ordonnance de 2010 est aujourd’hui quasi unanime et dépasse largement les clivages politiques et partisans. Nous devons envoyer un message fort pour mettre un terme à toute forme d’insécurité juridique et garantir la qualité et l’efficience de la biologie médicale française.
C’est pourquoi je vous appelle tous à un débat constructif, dans l’intérêt des patients. Je souhaite que, par-delà les clivages partisans, nous aboutissions, comme cela avait été le cas à l’Assemblée nationale sous la précédente législature, à un texte commun. Il y va de la sécurité sanitaire de nos concitoyens et de leur égalité face à l’offre de soins dans toute sa diversité.
Je remercie M. le rapporteur et les membres de la commission des affaires sociales, mais aussi tous ceux d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui se sont fortement impliqués. J’espère que nous pourrons, collectivement, faire œuvre utile. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, d’emblée, je dois saluer Jacky Le Menn : il a le mérite d’avoir déposé cette proposition de loi qui vise à mettre un terme à une situation confuse et à un fiasco législatif suscitant l’amertume de toute la profession.
En proposant la ratification de l’ordonnance du 13 janvier 2010, il a aussi apporté des modifications substantielles, qui, je l’espère, subsisteront, pour « remédicaliser » une frange importante du parcours de soins laissée à la merci de puissants groupes financiers ayant trouvé là matière à profit.
Cependant, je regrette une certaine retenue sur des points essentiels, retenue qui risque d’empêcher le texte d’atteindre complètement son objectif, lequel est, à mon sens, de rendre à la profession de biologiste médical la maîtrise de sa pratique dans l’intérêt du patient, et de lui seul.
Depuis le rapport Ballereau de 2008, qui préconisait une réforme de la biologie médicale, cette question est revenue pas moins de cinq fois dans les débats législatifs. Elle a en effet été abordée lors de l’examen de la loi HPST ; de la loi relative à la bioéthique, à l’occasion de laquelle certains ont tenté d’abroger l’ordonnance prise par le gouvernement d’alors ; de la loi relative aux activités immobilières des établissements d’enseignement supérieur, lorsqu’il a été question de permettre aux personnels enseignants et hospitaliers des CHU non titulaires de la formation qualifiante d’exercer dans ces centres comme biologistes médicaux et d’assumer la responsabilité des pôles de laboratoires ; de la loi Fourcade, partiellement annulée par le Conseil constitutionnel ; enfin, de la loi Boyer, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier 2012.
Il n’est pas superflu de mettre un terme à ces tribulations, car il y a urgence ! Trente-huit ans après la réforme de la loi du 11 juillet 1975 et près de vingt ans après l’instauration des sociétés d’exercice libéral, la biologie médicale a, en effet, considérablement évolué, en ce qui concerne tant son rôle dans le parcours de soins que sa pratique, transformée par l’automatisation et l’informatisation.
Malheureusement, ces changements ayant nécessité de gros investissements de la part des laboratoires, elle a aussi vu l’arrivée de groupes financiers, plus intéressés par la rentabilité d’une nomenclature des actes peu évolutive.
L’enjeu de ce texte devrait être la réaffirmation de l’indépendance des professionnels par rapport aux pratiques, la préservation d’un maillage territorial qui s’est considérablement restreint depuis quelques années, du fait de regroupements sous la mainmise de groupes financiers opérant à coup d’offres de rachat à des biologistes en fin de carrière désirant, très légitimement, rentabiliser leurs investissements.
Sur ce point, je dois dire que les craintes que l’on peut avoir pour l’avenir ne concernent pas les seuls laboratoires de biologie, mais l’ensemble du secteur de la santé. Il n’est qu’à voir ce qui se passe pour les cliniques, les maisons de retraite, les maisons de santé, les cabinets dentaires, les officines, détenus par des puissances financières, qu’elles soient privées, spéculatives ou non, ou mutualistes.
Pour les uns et les autres, les soucis de rentabilité ou, simplement, d’équilibre budgétaire conduisent à des mesures qui ne prennent pas toujours en considération l’intérêt du patient. Dans le domaine de la biologie médicale, cela se traduit par des fermetures le week-end, des résultats d’examens différés, le regroupement des prélèvements, etc.
Les professionnels de santé ayant fait le choix consenti de l’exercice libéral – avec ses obligations, ses contraintes, ses emplois du temps surchargés, mais aussi ses satisfactions résultant du contrat singulier entre le malade et le soignant, qui fait la grandeur et la qualité de la médecine française – se voient dépouillés de ce que certains ont appelé leur toute-puissance et se trouvent aujourd’hui soumis à des contraintes qui ne riment pas forcément avec qualité et écoute du malade. C’est en particulier le cas pour les jeunes biologistes sous contrat précaire et licenciables à merci.
Je crains que notre texte ne puisse empêcher cette évolution, qui, si l’on n’y prend garde, conduira à la disparition des laboratoires indépendants et de proximité – là où ils existent encore… –, au profit d’une concentration de l’activité sur des plateaux techniques éloignés des territoires ruraux.
La proposition de loi vise à remédier au problème des biologistes médicaux en situation ultra-minoritaire dans les sociétés d’exercice libéral, mais je doute, au vu du dernier amendement déposé par Mme la ministre, voilà quelques heures, qu’elle y parvienne…
Il s’agirait pourtant d’une importante avancée, même si le texte présentait quelques failles, notamment pour assurer la transmission intergénérationnelle, très aléatoire en l’état.
S’agissant de l’accréditation, à laquelle je suis bien évidemment favorable, il faut, à mon sens, éviter une marche forcée, coûteuse, qui risque de placer les laboratoires indépendants dans l’obligation de renoncer. Nombreux sont les cas qui nous sont signalés de biologistes qui, à l’évidence, vont baisser les bras !
De même, vouloir à tout prix une accréditation à 100 % est bien irréaliste face à l’évolution perpétuelle des techniques. Comment cet organisme qu’est le COFRAC, le Comité français d’accréditation, pourra-t-il, à une date donnée, délivrer une telle accréditation à l’ensemble des laboratoires français ?
Cette proposition de loi a pourtant le mérite, même si elle est encore perfectible, d’avoir pour objet de redonner à la profession de biologiste médical ses prérogatives et la maîtrise de ses actes, de donner aussi un peu d’espoir aux jeunes générations, ce qui pourrait nous éviter de connaître les déboires liés au manque cruel de professionnels que nous connaissons dans d’autres secteurs de la santé. Le domaine de la santé doit absolument rester une prérogative nationale par le jeu de la subsidiarité.
Le groupe RDSE souhaite donc que la discussion qui va s’engager aboutisse à des améliorations. Sous cette réserve, il soutiendra la proposition de loi. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte sur la biologie médicale est, M. Barbier vient de le rappeler, le cinquième sur ce thème à avoir été inscrit à l’ordre du jour du Sénat en quatre ans.
Le moins que l’on puisse dire est que le sujet suscite un débat assez animé et que la réforme de la biologie médicale suit un parcours législatif plutôt tortueux, avec de multiples rebondissements.
C’est notamment pour cette raison que je souhaite tout d’abord remercier Jacky le Menn, qui n’a pas ménagé sa peine pour susciter la concertation sur cette question quelque peu épineuse.
Son travail, déterminé et minutieux, a permis l’émergence d’un juste compromis entre qualité, accessibilité, proximité et indépendance de la biologie médicale française, en lien avec les deux problématiques fondamentales que sont l’accréditation et la lutte contre la financiarisation.
Sur l’accréditation, la proposition qui nous est faite nous paraît équilibrée. Un quasi-consensus semble d’ailleurs avoir émergé.
Il faut bien l’avouer, l’accréditation est difficile à critiquer sur le fond. Elle permet en effet, si toutefois les conditions de travail sont convenables, d’assurer la permanence des procédures, d’améliorer l’information et la communication interne, donc, globalement, la qualité, la traçabilité et la transparence, évolutions que nous, écologistes, réclamons dans d’autres contextes.
Nous ne sommes pas pour autant naïfs : il ne fait aucun doute que les gros laboratoires ont valorisé au maximum l’accréditation aux yeux des pouvoirs publics, non pas seulement pour des raisons vertueuses, mais parce qu’ils savaient pouvoir l’assumer plus facilement que d’autres.
Quoi qu’il en soit, il est vrai que l’accréditation des laboratoires a, dans un premier temps, soulevé le mécontentement et l’inquiétude de certains biologistes, car elle est onéreuse, chronophage et qu’elle les éloigne de leur cœur de métier quand ils ne sont pas en situation de déléguer cette tâche à un nouveau salarié, mais force est de constater que le processus est aujourd’hui enclenché. Elle a, en effet, déjà été obtenue ou est en cours d’obtention par un grand nombre d’établissements.
Je rejoins le constat fait par M. le rapporteur : le problème est, non pas l’accréditation en elle-même, mais le rythme et les modalités de sa mise en œuvre.
Concernant le rythme de l’accréditation, d’une part, je soutiens la proposition faite à l’article 7 de la proposition de loi de mettre en place des paliers, en l’occurrence un minimum de 50 % exigé en 2016, puis de 80 % en 2018.
S’agissant des modalités de l’accréditation, d’autre part, je partage les doutes et inquiétudes dont ont fait part plusieurs de mes collègues, lors de l’examen du texte en commission, à l’égard du COFRAC, organisme chargé d’une mission de service public et disposant d’un monopole national pour son action.
Cet organisme pose en effet un problème, tant en raison de son manque d’indépendance, car les experts biologiques censés délivrer l’accréditation sont souvent issus des grands laboratoires, qu’en raison des tarifs élevés qu’il applique. Sur cette question, je soutiendrai les amendements déposés par plusieurs de nos collègues.
La financiarisation est le second enjeu important de la réforme de la biologie médicale que nous engageons aujourd’hui au Sénat avec l’examen de cette proposition de loi.
L’objectif est clairement établi par l’auteur dès les premières pages de son rapport : « limiter la possibilité pour des investisseurs légitimement motivés au premier titre par le taux de retour sur leur capital de contrôler cette activité ».
Le fait que des fonds de pension ou d’autres investisseurs spéculent ainsi sur des établissements à vocation sanitaire est en effet choquant – dans le domaine de la biologie médicale comme dans d’autres spécialités, soit dit en passant.
L’exposé des motifs de l’article 8, qui précise qu’il « vise à freiner la financiarisation du secteur, en rétablissant le principe d’une détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par les biologistes exerçants au sein de cette société », marque donc, selon nous, une avancée substantielle.
Cependant, nous estimons qu’en l’état le dispositif prévu pourrait malheureusement ne pas suffire et être assez facilement contourné par certaines structures, notamment au moyen de clauses extrastatutaires, lesquelles ne sont actuellement visées par aucun texte.
Nous ne sommes pas les seuls à éprouver cette inquiétude : plusieurs organisations représentatives du secteur nous ont alertés à ce sujet et les débats de la commission des affaires sociales ont montré que plusieurs d’entre vous, mes chers collègues, y étaient également sensibles. Aussi, je compte sur votre soutien aux deux amendements déposés sur ce point par le groupe écologiste.
Partant du constat que l’indépendance des biologistes de laboratoire est mieux garantie par la possibilité pour eux d’acquérir une fraction, voire la totalité, du laboratoire dans lequel ils travaillent, notre premier amendement vise à faire passer de « plus de la moitié » à « plus de 60 % » la part du capital et des droits de vote d’un laboratoire de biologie médicale devant obligatoirement être détenue par des biologistes en exercice au sein de la société.
Quant au second amendement, il tend à permettre que soient rendus publics, à la demande de l’un des détenteurs de capital, l’ensemble des contrats et des conventions signées dans le cadre des sociétés d’exercice libéral.
Justifiés par des motifs de santé publique, ces deux amendements ne nous semblent pas susceptibles d’être considérés par le juge communautaire comme des entraves déguisées au droit commercial.
En conclusion, le groupe écologiste votera cette proposition de loi, parce qu’il partage l’espoir formulé par Jacky Le Menn, dans l’introduction de son rapport, de voir ce texte « apporter une solution sinon définitive, du moins durable » aux problèmes de la biologie médicale, mais aussi parce que cette spécialité est devenue un élément central du parcours de soins des patients, déterminant pour l’élaboration d’environ 60 % des diagnostics. La biologie médicale ne doit donc plus souffrir de la crispation et des turpitudes dans lesquels elle est plongée depuis maintenant plusieurs années. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, presqu’un an, jour pour jour, après l’adoption par l’Assemblée nationale, le 26 janvier 2012, de la proposition de loi de Valérie Boyer et Jean-Luc Préel portant réforme de la biologie médicale, nous sommes réunis pour examiner celle de notre collègue Jacky Le Menn, qui reprend partiellement la précédente.
La biologie médicale représente un enjeu majeur des politiques publiques en termes de santé et de maintien d’une profession de qualité sur notre territoire. Comme il est rappelé dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, « la biologie médicale est un élément central du parcours de soins des patients, déterminant l’élaboration d’environ 60 % des diagnostics, en ville et à l’hôpital ».
Aussi est-ce pour réaffirmer le caractère médical de la profession de biologiste et permettre des évolutions de structure en cohérence avec l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques que le précédent gouvernement avait souhaité entreprendre une nouvelle réforme, la première depuis la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.
Il s’agissait, d’une part, de garantir la qualité des actes et la confiance des professionnels et des patients, et, d’autre part, d’assurer l’efficience des dépenses, nécessité économique et éthique, ainsi qu’une bonne adéquation entre nos exigences nationales et celles de l’Union européenne.
La réflexion sur la nécessité de réformer la biologie médicale a débuté en 2006, trente ans donc après l’entrée en vigueur de la loi de 1975, avec le rapport de l’inspection générale des affaires sociales et celui de Michel Ballereau. Ces deux rapports concluaient à l’urgence de modifier la législation.
Or cette réforme a connu un parcours parlementaire pour le moins chaotique. L’article 69 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour mettre en œuvre la réforme de la biologie médicale. Dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, l’Assemblée nationale avait inopinément proposé l’abrogation de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. Quelques mois plus tard, une dizaine d’articles consacrés à cette réforme étaient insérés dans la loi Fourcade, mais censurés par le Conseil constitutionnel, qui les considérait comme des cavaliers législatifs. Enfin, comme je le rappelais au début de mon intervention, la proposition de loi « Boyer-Préel », adoptée par l’Assemblée nationale, n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat.
Nous voici donc enfin réunis pour débattre de cette nouvelle proposition de loi, après que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Une fois n’est pas coutume, madame la ministre, nous considérons que le recours à cette procédure est légitime puisque, comme je viens de le rappeler, nous avons déjà débattu à maintes reprises de ce sujet. Il est en effet urgent d’en finir !
J’en viens au fond. La proposition de loi s’articule autour de quatre axes : la ratification de l’ordonnance de 2010, le renforcement de la médicalisation de la profession de biologiste médical, l’amélioration de la qualité des examens biomédicaux et, enfin, l’organisation de la biologie médicale.
Sur ces objectifs, monsieur le rapporteur, nous ne pouvons évidemment que nous entendre.
Je rappelle que l’absence de ratification de l’ordonnance crée une insécurité juridique préjudiciable, tant pour les professionnels de santé que pour les pouvoirs publics.
Avant d’évoquer les mesures contenues dans le texte de la commission, je tiens à souligner l’importance de la sauvegarde de la biologie médicale et de son maillage territorial. Quant au caractère de l’acte de biologie, il s’agit bien d’un acte médical ; il est essentiel qu’il soit de qualité et rapide.
La commission, sur proposition de son rapporteur, dont je tiens à saluer le travail, a modifié le texte initial de la proposition de loi. Certaines de ces modifications vont dans le bon sens.
Je pense notamment à la nouvelle rédaction du 2° de l’article 4 qui précise les lieux de prélèvements hors laboratoire. En effet, seuls 5 % des prélèvements sanguins seraient réalisés en dehors des laboratoires ou des établissements de santé, pour répondre à des situations spécifiques, particulièrement en zone rurale, où le patient est parfois éloigné des laboratoires.
Il est cependant important que le reste de la phase pré-analytique soit sous le contrôle du biologiste médical. C’est pourquoi notre groupe souhaite revenir sur cet article avec un amendement qui réintroduit le terme de « prélèvement » en remplacement de celui de « phase pré-analytique ».
À l’article 7, la suppression de la possibilité donnée à l’Ordre des pharmaciens de prononcer une interdiction définitive de pratiquer la biologie médicale permet d’éviter une inégalité entre les professionnels inscrits à cet ordre et ceux qui le sont à l’Ordre des médecins.
L’accréditation à 100 % au 1er novembre 2020 avait été insérée par la commission. En tant que rapporteur de la loi Fourcade, j’avais considéré que limiter à 80 % les accréditations ne satisfaisait pas les objectifs majeurs de la loi HPST et de la réforme de la biologie médicale, à savoir « la qualité prouvée par l’accréditation ». Rendre obligatoire l’accréditation des laboratoires est la seule modalité envisageable pour prouver la qualité des examens de biologie médicale. Cette discipline médicale sera ainsi la seule soumise à une accréditation.
En revanche, certaines dispositions du texte de la commission ne nous satisfont pas. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la défense de nos amendements, mais je souhaite d’ores et déjà évoquer certains points.
Nous parlons souvent de l’importance du maillage territorial, mais certains départements ne disposent pas de laboratoire public de biologie médicale et leurs hôpitaux sont trop éloignés d’autres établissements équipés d’un laboratoire. Or il pourrait être envisagé de mettre en place une dérogation permettant aux hôpitaux de continuer à bénéficier de « ristournes », comme le propose notre collègue Jean-François Mayet.
Cela étant, sur le fond, nous soutenons l’objectif de l’article 5, à savoir la suppression de ces « ristournes » qui dévalorisent le travail des biologistes médicaux.
L’article 6 tend à permettre le recrutement, par les centres hospitaliers universitaires et les établissements qui leur sont liés par convention, soit de professeurs des universités-praticiens hospitalier, soit de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, diplôme créé en 1984.
Il ne s’agit pas là de trouver une solution pour quelques cas exceptionnels pendant une période transitoire. En réalité, cet article tend à organiser une filière parallèle et pérenne de recrutement de responsables hospitaliers auxquels il serait seulement demandé de justifier d’un service de trois ans dans un laboratoire de biologie.
En même temps qu’elle décourage les étudiants en biologie médicale d’envisager une carrière hospitalière, cette perspective crée un sentiment d’injustice et de dévalorisation de leur formation. Le Sénat a déjà rejeté, en 2011, une disposition analogue, à laquelle s’opposaient l’ensemble de la profession et les ordres concernés ; ils s’y opposent toujours et il n’y a pas plus de raisons d’accepter cette dérogation aujourd’hui qu’il n’y en avait en 2011.
L’article 7 ter, qui prévoit la suppression de l’article L. 6211-9 du code de la santé publique, ne nous paraît pas justifié. En effet, un des objets de la réforme de la biologie médicale est de permettre au biologiste médical de participer à la prescription des examens, de proposer les plus utiles pour éclairer le médecin et de rendre la prescription la plus efficace et la plus pertinente possible. Il sera ainsi possible d’éviter des examens inutiles ou redondants, mais l’objectif principal est d’obtenir la réponse la plus claire aux questions que l’on se pose et qui justifient le recours à l’examen de biologie médicale. Il s’agit donc de tirer le meilleur parti des compétences du biologiste médical.
Enfin, l’organisation de la biologie médicale, visée aux articles 8 et 9, est au cœur de l’inquiétude des jeunes biologistes, mais aussi de ceux qui veulent préserver une biologie médicale de proximité et non financiarisée.
Avec la législation actuelle, cet objectif est hors de portée : les jeunes sont de fait interdits d’accès à la profession. Il est donc nécessaire de les associer au capital des sociétés et de prévoir des dispositions qui empêchent la financiarisation de cette filière.
Le renforcement du rôle des agences régionales de santé, à l’article 9, leur permettra de réguler l’offre de biologie médicale sur les territoires. Il s’agit de garantir le maintien d’une biologie médicale de proximité, puisque le directeur d’une ARS peut s’opposer à une fusion ou acquisition de laboratoire si la part d’activité réalisée par l’entité issue de l’opération dépasse le seuil de 25 % du total des examens sur le territoire.
Cet article 9 va donc dans le sens du rapport Ballereau, puisque ce dernier préconisait de conserver le principe de liberté d’installation, tout en mettant en place une régulation. Celle-ci doit permettre à la fois de protéger la proximité territoriale et de favoriser les restructurations nécessaires aux laboratoires pour qu’ils atteignent une taille critique et puissent ainsi faire face aux enjeux économiques et techniques de l’avenir.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, comme les autres groupes, celui de l’UMP est particulièrement attaché à la préservation et au renforcement d’une médecine de qualité sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, tout en soutenant ce texte dans ses finalités, nous présenterons différents amendements afin de l’améliorer en espérant aboutir à l’adoption rapide d’une loi satisfaisante.
Mes chers collègues, je souhaite que nous arrivions à trouver un compromis. Nous sommes, en effet, convaincus que l’absence de loi produirait des effets pervers, notamment sur l’étendue de la financiarisation de la biologie médicale. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par notre collègue Jacky Le Menn est d’une grande importance puisqu’elle a l’ambition de freiner la financiarisation du secteur libéral de la biologie médicale et de renforcer la sécurité des examens pratiqués.
Il s’agit d’un sujet techniquement complexe dont les enjeux sont essentiels non seulement en termes de santé publique, d’accès aux soins au sens large, de vie et de dynamisme de nos territoires, mais aussi pour tout ce qui touche au cadre même de l’exercice de la profession.
Cette pluralité d’enjeux explique sans doute le cheminement particulier, commencé par la voie d’une ordonnance et déjà passé par quatre textes, de la réforme de la biologie médicale. C’est ainsi que la présente proposition de loi est la cinquième occasion récente pour notre assemblée de se pencher sur ce sujet.
J’y vois, mes chers collègues, la validation du bien-fondé de notre opposition à l’utilisation de l’article 38 de la Constitution, qui, au lieu de permettre une application rapide de l’ordonnance du 13 janvier 2010, aura surtout permis de créer une instabilité juridique dont personne ne peut se réjouir.
Pour notre part, cette ordonnance n’est pas sans nous inquiéter ou, pour le moins, nous interroger. Notre groupe l’avait d’ailleurs explicitement dit en 2009, par la voix de notre ancien collègue François Autain, lors de la présentation du projet de loi de ratification par la ministre de l’époque, Mme Roselyne Bachelot-Narquin.
Nous avions accueilli avec satisfaction la disposition portant création d’un article 6213-2 au sein du code de la santé publique, article qui prévoyait que seul un titulaire du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale pourrait exercer la responsabilité de biologiste médical.
Nous avons pris acte des modifications proposées à cet égard dans la présente proposition de loi. Notre groupe défendra un amendement identique à celui qui a été déposé par nos collègues du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi présentée par Mme Valérie Boyer.
En revanche, nous avions été et nous demeurerons particulièrement vigilants sur le fait qu’en application de l’ordonnance, que l’article 1er de la proposition de loi vise donc à ratifier, un laboratoire médical pourra demain être considéré comme une structure constituée d’un ou plusieurs sites où pourront être effectués les examens de biologie médicale.
Nous y voyons deux risques, qui inquiètent également de nombreux professionnels et patients.
Le premier de ces risques est la transformation de certains laboratoires médicaux existants en de simples structures de prélèvements dont les analyses seraient effectuées au sein d’une structure mère regroupant des machines particulièrement performantes, hautement techniques et coûteuses.
Cet éloignement entre le lieu de prélèvement et celui dans lequel est réalisé l’examen biologique à proprement parler peut engendrer certaines difficultés inhérentes à un traitement à grande échelle. Le transfert des prélèvements vers le centre d’analyse n’est pas sans supposer également quelques risques. Notre rapporteur partage en partie nos craintes puisqu’il a pris soin, en commission des affaires sociales, de présenter un amendement précisant que « les examens de biologie médicale sont pratiqués dans des conditions permettant le traitement des situations d’urgence ».
Chacun mesure, en effet, combien les analyses biologiques peuvent jouer un rôle majeur, voire vital, dans la détermination de la pathologie. Cette précision, utile face aux éventuels dangers, nous semble, certes, protectrice, mais assez faiblement, raison pour laquelle nous avons déposé de nouveaux amendements.
Le second risque est la financiarisation du secteur de la biologie médicale. Personne ne l’ignore, certains groupes financiers sont aux aguets et tentent, depuis plusieurs années, de conquérir la biologie médicale, comme ils l’ont déjà fait dans d’autres pays ou dans d’autres secteurs économiques. Pour eux, la santé n’est qu’un marché dont les différents acteurs ne sont que des opérateurs.
Disant cela, je pense particulièrement à l’action en justice introduite par la Commission européenne contre la France à la suite de la plainte de l’un de ces grands groupes financiers nous reprochant, ni plus ni moins, d’avoir une législation nationale incompatible avec la directive dite « services », qui exige la libre concurrence.
L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue, depuis, la Cour de justice de l’Union européenne, a conforté notre droit interne. L’alinéa 89 de cet arrêt, qui ne souffre aucune interprétation, autorise en effet clairement la France à prendre les mesures qu’elle estime nécessaires, y compris en réduisant l’applicabilité des principes de libre concurrence et de liberté d’installation, dès lors que ces restrictions sont justifiées par un objectif de santé publique.
C’est la pleine reconnaissance par la Cour européenne de l’application du principe de subsidiarité en matière de santé. C’est dire que nous n’avons pas à craindre qu’une éventuelle législation nationale limitant l’accès des groupes financiers au capital des laboratoires de biologie médicale ne soit sanctionnée.
Nous proposerons donc une série d’amendements à l’article 8 dont l’esprit est de réduire clairement, dans les laboratoires existants comme dans ceux qui se créeraient demain, soit ex nihilo, soit du fait d’une fusion ou d’un regroupement, la part totale de capital social et de droit de vote détenu par les groupes financiers.
Nous ne pouvons pas accepter que, par le biais de holdings et de sociétés en cascade, la quasi-totalité des parts de certains laboratoires de biologie médicale soit détenue par des personnes morales exerçant la biologie médicale, c’est-à-dire par des groupes financiers qui n’ont qu’un objectif, accroître leurs dividendes en « cannibalisant » le monde de la santé.
Enfin, je dois vous dire que les dispositions relatives à l’accréditation suscitent notre inquiétude. Bien entendu, comme notre rapporteur et comme le Gouvernement, comme d’ailleurs l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens, nous sommes vigilants en matière de sécurité sanitaire. Il n’y a pas, d’un côté, celles et ceux qui voudraient garantir la sécurité des patients et, de l’autre, ceux qui pourraient l’ignorer.
Pour autant, nous ne sommes pas dupes et savons pertinemment que, malgré les amendements présentés par notre rapporteur et adoptés par la commission des affaires sociales, un grand nombre d’établissements de proximité ne pourront pas entreprendre les travaux et mises aux normes exigées pour pouvoir être accrédités. Ces derniers n’auront alors plus que deux choix : fermer, en agrandissant encore un peu plus ces déserts sanitaires que nous combattons, ou bien vendre aux groupes financiers, au risque de voir l’activité des centres se réduire aux seuls prélèvements.
Fondé sur un principe de sécurité sanitaire, sans accompagnement particulier, notamment financier, le passage des normes existantes à l’accréditation pourrait ainsi participer, au final, à ce mouvement de financiarisation que la présente proposition de loi entend pourtant freiner. Je pense en particulier aux centres de santé.
Vous le voyez, mes chers collègues, nos inquiétudes sont grandes et les réponses apportées par cette proposition de loi n’y répondent pas totalement. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé plusieurs amendements, et c’est au regard du traitement qui leur sera réservé ainsi que de la nature de nos échanges que notre groupe se déterminera quant à son vote sur l’ensemble de la proposition de loi. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis sa constitution après-guerre, la biologie médicale est devenue une spécialité de santé stratégique. Un peu comme l’industrie pharmaceutique, elle se situe en effet au carrefour de la santé publique et du marché de la santé, entre risque maladie et enjeu économique.
On le voit, la matière n’est pas facile. Elle soulève des questions proprement médicales, bien sûr, mais aussi de gouvernance du système de santé, de droit de la concurrence, communautaire en particulier, de droit des sociétés et de financement de la recherche.
Face à ces difficultés, l’ordonnance Ballereau de 2010 a globalement relevé le défi.
Ce n’est pas sans malice, monsieur le rapporteur, que nous vous voyons contraint de l’admettre, alors que le groupe socialiste s’y était, à l’époque, opposé ! Je vous cite, avec plaisir d’ailleurs : « Dans l’ensemble, l’ordonnance de 2010, malgré ses défauts, est porteuse d’un renouveau de la biologie médicale auquel nous pouvons tous adhérer et qui doit maintenant être consacré par la loi. »
Ce propos, nous y souscrivons totalement, y compris, d’ailleurs, pour ce qui touche aux réserves qu’il exprime. L’ordonnance Ballereau n’est en effet pas parfaite, ce qui nécessite de procéder à des ajustements.
Ces ajustements, nous avons été les premiers à les formaliser au Parlement, avec Jean-Luc Préel, coauteur, avec Valérie Boyer, de la proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2012. Bien sûr, avec le présent texte, nous ne pouvions partir que d’une base favorable puisqu’il reprend les principaux axes de cette proposition de loi.
Puisqu’il faut procéder à des ajustements, quels sont-ils ? Schématiquement, je dirai qu’il faut concilier qualité et proximité, qui ne sont pas toujours compatibles !
Il y a, à nos yeux, un troisième impératif dont on parle peu, malgré son importance, c’est l’impératif budgétaire. L’on consomme, en effet, de plus en plus d’actes de biologie médicale, ce qui pèse évidemment sur les comptes sociaux.
Dans l’immédiat, je dirai que cette problématique peut être décomposée en cinq questions.
La première est la question du rythme et de l’ampleur de l’accréditation. Sur cette question clé, monsieur le rapporteur, nous vous apporterons notre plein et entier soutien.
Le calendrier fixé par la présente proposition de loi nous semble un bon entre les desiderata des grands laboratoires, dits financiers, et ceux des indépendants.
De plus, et c’est à nos yeux essentiel, le texte issu des travaux de notre commission rétablit l’objectif d’une accréditation à 100 %. Pour des raisons techniques, les actes de biologie médicale étant en constante évolution, une accréditation ne pourra jamais être, comme nous l’avons appris, de 100 %, mais seulement de 96 ou de 97 %. Du moins doit-elle tendre vers l’objectif des 100 % parce que c’est la meilleure garantie de qualité que nous ayons.
La deuxième question est celle de la financiarisation. Nous souscrivons à l’objectif consistant à maintenir des limites en matière de détention du capital et de liberté d’installation pour les non-biologistes. Il s’agit d’aider les biologistes à conserver le contrôle capitalistique de leurs laboratoires. Les articles 8 et 9 sont supposés permettre d’atteindre cet objectif.
Cependant, monsieur le rapporteur, vous le relevez vous-même, nombre de professionnels libéraux s’inquiètent des possibilités de contournement des restrictions qu’imposerait le législateur.
Cette crainte, on ne peut pas la balayer d’un revers de main, madame la ministre, sous prétexte de ne pas excessivement complexifier le droit positif, objet de l’amendement que vous avez déposé à l’article 8. En effet, c’est l’efficacité même du dispositif proposé qui est en jeu.
C'est précisément pour éviter tout risque de contournement que nous présenterons un amendement visant à encadrer le régime des sociétés d’exercice libéral et à imposer une transparence sur les conventions extrastatutaires pour écarter tout risque de contournement.
La troisième question est celle des fameuses « ristournes ». Nous ne voyons absolument rien de choquant à ce que le public puisse favoriser le public ! En revanche, l’impératif économique peut se heurter à l’impératif de proximité, dont dépend la qualité du service rendu au patient.
Nous défendrons donc un amendement en vertu duquel les établissements publics seront tenus de lancer un appel d’offres au cas où il n’y aurait pas de laboratoires publics à proximité.
La quatrième question est celle de la médicalisation de la spécialité, laquelle pose, à nos yeux, deux problèmes : celui de la phase pré-analytique et celui de l’exercice de la biologie médicale en CHU.
Le traitement de la phase pré-analytique est l’un des seuls points sur lesquels, monsieur le rapporteur, nous semblons avoir un désaccord. Pourquoi faire échapper au contrôle du biologiste médical la totalité de la phase pré-analytique ? Nous ne nous l’expliquons pas et nous défendrons donc un amendement destiné à revenir sur ce point. C’est une question de responsabilité. Je ne pense pas que celle-ci puisse être partagée.
Nous retrouvons d’ailleurs le même type d’interrogation en ce qui concerne l’exercice de la profession en CHU. La proposition de loi ouvre de nouvelles dérogations à l’exercice de la biologie médicale par des non-biologistes. Or ces dérogations ne nous semblent en rien se justifier.
La cinquième et dernière question est celle de la facturation. Pour être moins fondamentale que les précédentes, elle a toutefois son importance. Nous avions déposé un amendement, mais nous le retirerons, car le texte que vous proposez, monsieur le rapporteur, nous paraît bien tendre à harmoniser et à clarifier ces règles de facturation des actes de biologie. Je vois dans la facture unique un facteur de responsabilité, qui vaut pour tous les établissements, qu’ils soient publics ou privés, et même en cas de sous-traitance.
En conclusion, vous l’aurez compris, madame la ministre, hormis les quelques réserves que je viens d’émettre, nous sommes globalement favorables à ce texte qui précise, encadre et procède à de bons ajustements.
Je tiens à saluer le travail de la commission, en particulier, celui de notre rapporteur, Jackie Le Menn.
Spécialiste du sujet, puisqu’ancien directeur d’hôpital, vous avez su mener ce dossier avec intelligence et esprit d’ouverture, monsieur le rapporteur, et je vous en remercie. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je veux tout d’abord remercier Jacky Le Menn de l’énergie qu’il a consacrée à la réécriture, ô combien délicate ! de ce texte qui a connu tant de péripéties ; il nous a permis, grâce à sa remarquable capacité d’écoute, de parvenir à la meilleure solution possible sur ce sujet aussi politique que technique.
Les biologistes médicaux, on l’a rappelé, participent pour beaucoup au parcours de soins de nos concitoyens, puisqu’ils contribuent à établir 60 % du diagnostic des pathologies.
Reconnaissance de la dimension médicale exercée par les médecins et les pharmaciens, qualité des soins, proximité, égalité d’accès aux soins, efficience : tels sont les défis qu’il nous faut relever. Nous devons par ailleurs stabiliser la situation juridique des biologises médicaux en prévoyant une égalité de traitement entre laboratoires privés et publics.
Nous devons légiférer dans le cadre du droit européen, qui nous laisse deux voies alternatives en matière d’organisation de la biologie : il nous faut soit considérer la biologie comme une prestation susceptible de relever d’une définition très large de la communauté scientifique, soit réserver la possibilité de pratiquer les examens de biologie relatifs à la santé humaine aux seuls médecins et pharmaciens ayant suivi une spécialisation en biologie.
Nous avons choisi la seconde voie, celle la médicalisation de la biologie médicale. Il faut nous en féliciter, alors même que nous devons répondre à un double enjeu : garantir le haut niveau de qualité des examens pratiqués et limiter la possibilité pour des investisseurs soucieux du taux de retour de leur capital de contrôler l’activité de biologie médicale. Nous avons en effet la volonté de lutter contre la financiarisation de cette activité.
Notre marge de manœuvre est étroite. La Communauté européenne n’est certes pas habilitée à se prononcer sur l’opportunité du choix, par un État membre, de réserver l’exercice de certaines activités aux professions de santé, mais elle peut, en revanche, exiger que cette restriction ne constitue pas une entrave déguisée au droit de la concurrence.
Si notre marge de manœuvre est étroite, elle ne doit pas, pour autant, entraver notre détermination à lutter contre la financiarisation de la biologie médicale.
Défendre la qualité des examens biologiques, c’est mettre en place une méthodologie d’évaluation qualitative qui permette d’en déduire une preuve objective : l’accréditation de l’ensemble des laboratoires.
Cette procédure inquiète une grande partie des biologistes. Nous devons les entendre et mettre en place des garde-fous afin que l’accréditation soit au service de la biologie médicale, et non une entrave à son développement, en particulier pour les jeunes biologistes qui souhaitent s’installer.
L’accréditation doit être généralisée afin de contrecarrer la tentation de qualifier différemment des laboratoires de tailles diverses, mais elle ne doit pas être uniforme. Elle doit tenir compte, entre autres choses, des familles d’examens biologiques médicaux.
Nous devons par ailleurs veiller à ce que ne soit pas validée l’idée selon laquelle l’accréditation impose une forme particulière d’exercice de la biologie médicale, impliquant une forte concentration de l’exercice autour d’appareils volumineux et très coûteux.
Pour être acceptée et réalisable dans de bonnes conditions, l’accréditation doit pouvoir être pratiquée de façon progressive, par paliers ; nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la discussion des articles.
Au-delà des principes, nous avons à répondre de façon précise aux questions relatives à la pratique de l’accréditation.
Toute accréditation est conduite sous l’égide du Comité français d’accréditation, le COFRAC, chargé d’une mission de service public, qui dispose pour mener son action d’un monopole national.
Le coût de ses prestations est dénoncé par nombre de biologistes ; certains d’entre eux considèrent même qu’il peut mettre en cause la viabilité de leur laboratoire. Alors qu’il est censé représenter, en théorie, de 1 % à 2 % du chiffre d’affaires d’un laboratoire, il atteint en réalité, selon l’Ordre des médecins, plus du double de ce taux.
Si le coût de l’accréditation est un enjeu central, ses modalités pratiques, notamment la sélection des experts et l’établissement des normes, ne manquent pas non plus de nous interpeller.
La sélection des experts doit permettre de représenter l’ensemble de la profession. Il faut aussi des normes visant à prendre en compte les conditions de sécurité du prélèvement, de la réalisation de l’examen, mais aussi la qualité et la permanence de l’investissement humain. Doivent ainsi être appréciées la présence effective du biologiste dans son laboratoire, ainsi que la rapidité avec laquelle il transmet les examens.
Sans chercher de boucs émissaires, je salue donc votre volonté, monsieur le rapporteur, de demander à la commission des affaires sociales de solliciter auprès de la Cour des comptes un rapport d’évaluation relatif au COFRAC.
L’accréditation, dont la réussite dépendra de son efficacité, est la première priorité de cette proposition de loi ; le refus de la financiarisation est la seconde.
L’indépendance des biologistes de laboratoire est mieux garantie, grâce à la possibilité qui leur est réservée d’acquérir une fraction, voire la totalité, du laboratoire dans lequel ils travaillent. Cela semble une évidence ; d’ailleurs, 85 % des laboratoires sont d’ores et déjà détenus par des professionnels.
L’engagement que nous manifesterons au cours de nos débats sera déterminant pour faire obstacle à cette financiarisation, délétère pour la pérennisation de nos laboratoires, de proximité en particulier.
Je souhaite à présent évoquer certaines questions qui, je le crois, sont propres à susciter le débat.
Tel est le cas, tout d’abord, de la détermination de la responsabilité des différents intervenants lors de la phase dite « pré-analytique » de l’examen biologique, qui court du moment où l’on pratique le prélèvement jusqu’au transport de celui-ci, et qui précède la pratique de l’examen lui-même. Il me semble en effet important de déterminer à partir de quel moment la responsabilité du biologiste peut être engagée.
Nous devrons par ailleurs nous pencher et, partant, sans doute prendre position – négativement, en ce qui me concerne ! – sur la décision de ne pas confier à l’Établissement français du sang les examens biologiques du receveur. On constate en effet l’existence de doublons, sources de dépenses supplémentaires.

Je tiens d’ailleurs à dire, même si tel n’est pas l’objet de cette proposition de loi, que l’Établissement français du sang est en grand danger. En effet, le don éthique, gratuit et anonyme dont nous sommes si fiers se heurte actuellement aux dispositions prises aux niveaux européen et mondial. La France est ainsi complètement isolée sur la question du rappel des lots de médicaments dérivant du sang, en particulier du plasma.
Il est urgent de se pencher sur ce problème. Pour autant, ce n’est pas une raison pour confier aux centres de transfusion des examens qui sont excellemment pratiqués par les laboratoires d’hématologie publics et privés.
Il nous faudra également réfléchir à la nécessité de rétablir une consultation médicale dans le cadre des examens biologiques relatifs à la création médicale assistée. Nous avions proposé un amendement en ce sens, mais celui-ci n’a pas été retenu, l’article 40 de la conséquence l’ayant « sabré ».
Nous devrons également mettre en place des procédures visant à lutter contre les inégalités territoriales. Vous l’avez rappelé, madame la ministre, certains de nos collègues estiment que le maintien des ristournes serait une solution pour y parvenir ; tel n’est pas mon avis. Vous avez indiqué une voie, en suggérant que les agences régionales de santé parviendraient à trouver une solution.
Il nous revient aussi de trouver un équilibre entre la légitime revendication des étudiants en DESS de biologie, qui doivent pouvoir accéder à cette spécialisation sans difficulté, et la possibilité offerte aux étudiants des centres hospitaliers universitaires, non diplômés en biologie, de travailler sur des objectifs de recherche. Je pense que nous aurons de beaux débats à l’article 6...
Bien que peu d’entre nous l’aient abordé, peut-être évoquerons-nous aussi le sujet de la facturation unique. Je considère néanmoins que cette discussion serait plus à sa place dans le cadre d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En conclusion, nous pouvons nous féliciter, et remercier derechef notre rapporteur, de l’occasion qui nous est donnée de débattre de cette proposition de loi, car elle doit nous permettre d’assurer le statut juridique de nos biologistes médicaux et d’optimiser la qualité des soins de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire. §
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux tout d’abord vous remercier de la grande qualité de ce débat. Celui-ci montre qu’il existe une volonté partagée d’avancer sur ce sujet qui, vous l’avez souligné, fut trop longtemps laissé en jachère, pour des raisons diverses.
Je salue votre engagement à tous et je souhaite que nous puissions, lors du débat sur les articles, avancer ensemble.
Vos interventions, vos préoccupations, voire vos motifs d’interrogation et d’inquiétude, se concentrent autour de certains sujets : la financiarisation du modèle d’exercice de la biologie médicale, l’accréditation des laboratoires, la formation des professionnels. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ces points lors de l’examen des amendements que vous avez déposés.
Gilbert Barbier a été le premier à poser clairement la question de la financiarisation.
Je tiens à lui dire que le Gouvernement partage les inquiétudes qui se sont exprimées, en des termes différents, sur l’ensemble de ces travées, et qui se rejoignent en ce qu’elles traduisent votre volonté de garantir la présence de laboratoires de biologie médicale sur l’ensemble du territoire national.
Allons-nous laisser libre cours, dans le domaine de la santé, à la logique de financiarisation ? Au reste, comme l’a souligné M. Barbier, celle-ci ne concerne d’ailleurs pas uniquement les laboratoires de biologie médicale.
Cette logique de pure rentabilité financière des capitaux investis, sans lien avec l’activité elle-même, est à l’œuvre dans d’autres secteurs d’activité, mais elle est inacceptable dans le secteur de la santé, qui touche au bien-être, aux soins, à l’avenir et à la vie même de nos concitoyens.
La logique capitalistique, je le réaffirme, est sans lien avec nos engagements et nos objectifs en matière de santé. C’est l’une des raisons majeures pour lesquelles le Gouvernement soutient cette proposition de loi : la volonté qui s’est exprimée sur toutes les travées du Sénat, il la fait sienne !
La question de l’accréditation a également été évoquée par tous les intervenants.
Madame Archimbaud, le Gouvernement partage votre point de vue : l’accréditation est en effet une condition de la qualité et de la transparence, et donc un élément socle d’une sécurité sanitaire renforcée et améliorée.
Je n’insisterai pas outre mesure sur les débats actuels sur l’usage de certains médicaments, mais l’enjeu est bien là : la sécurité sanitaire est directement liée à la capacité de garantir une information et des procédures transparentes, qui sont gages de confiance.
J’ai bien entendu, par ailleurs, que vous souteniez la démarche de l’accréditation par paliers.
Celle-ci permettra de répondre à la préoccupation que vous avez exprimée avec force, madame Cohen. J’en suis parfaitement d’accord avec vous, il ne faudrait pas que l’on assiste à un effet boomerang de l’accréditation et que les objectifs poursuivis ne soient pas atteints du fait même des instruments mis en place à cette fin.
Si tel devait être le cas, nous mettrions en effet en danger les petits laboratoires, mais il me semble que la mise en place de la démarche de l’accréditation par paliers, saluée comme un point positif par Mme Archimbaud, devrait éviter une telle évolution.
Si j’ai bien noté votre soutien en la matière, madame Archimbaud, j’ai également relevé vos inquiétudes, que vous partagez d’ailleurs avec plusieurs de vos collègues, concernant l’indépendance et les tarifs du Comité français d’accréditation.
M. le rapporteur a indiqué comment il entendait assurer la transparence du fonctionnement de ce comité. Je n’y vois pour ma part que des avantages. Nous avons besoin d’avoir confiance dans les instruments que nous mettons en place pour encadrer nos politiques et garantir la qualité de nos procédures et de nos institutions. Sinon, le doute subsistera. Je ne peux donc que me rallier aux propos tenus par M. Le Menn.
Monsieur Milon, j’ai été particulièrement sensible à votre intervention, dans laquelle vous avez affirmé votre soutien à la démarche d’ensemble. Vous avez très justement fait remarquer que la situation dans laquelle nous nous trouvions ne pouvait pas perdurer : elle est source d’insécurité tant juridique que sanitaire.
Vous avez par ailleurs souligné que les actes de biologie médicale étaient des actes médicaux. Nous ne pouvons pas, comme on l’a trop souvent fait par le passé, présenter la biologie médicale comme un secteur à part du système de santé. Elle est indissociable d’une chaîne de soins, qui va de la phase pré-analytique au soin et à son accompagnement.
Je souhaite que nous parvenions à trouver des solutions satisfaisantes pour l’ensemble de nos concitoyens, car c’est bien là notre préoccupation commune, afin d’effacer vos inquiétudes.
Madame Cohen, au-delà du point que je viens d’évoquer, je suis sensible, je le répète, à la démarche que vous avez prônée. Tout l’enjeu est de réussir à apporter des réponses sur les deux tableaux : d’une part, celui de la maîtrise d’un processus, qui, aujourd’hui livré à lui-même, nous conduit droit dans le mur d’une financiarisation excessive, dont l’objectif est non pas la santé de nos concitoyens, mais plutôt l’intérêt des actionnaires de différents groupes ; d’autre part, celui de la garantie de la qualité des actes, qui nous impose de ne pas laisser les procédures sans contrôle ni maîtrise.
Il nous faut trouver un équilibre satisfaisant entre ces deux impératifs. Tel est l’objet de ce texte. Sans doute pouvons-nous encore l’améliorer : ce sera tout l’enjeu de la discussion des articles, conformément à la volonté de M. le rapporteur.
Monsieur Vanlerenberghe, je ne reviendrai ni sur la financiarisation ni sur l’accréditation, dont je viens de parler.
Je vous remercie d’avoir apporté votre soutien à l’accréditation par paliers pour atteindre notre objectif de qualité. Il serait évidemment irréaliste et insensé de fixer un objectif à atteindre immédiatement !
Vous avez particulièrement insisté sur la formation des professionnels et l’accès à l’exercice de la biologie médicale dans les hôpitaux, sujets qui doivent, en effet, être liés à l’exigence d’une permanence des soins sur tout notre territoire.
Il s’agit non pas d’ouvrir sans contrôle la pratique d’une profession, mais de faire en sorte que celle-ci s’exerce dans des conditions et un cadre déterminés, comportant des exigences en matière de permanence des soins, par des professionnels aux compétences médicales identifiées possédant l’expérience nécessaire. On ne peut pas dire, d’un côté, que la biologie médicale fait partie de la chaîne des soins et, de l’autre, l’en détacher lorsque l’on parle d’assurer la permanence des soins de proximité.
Madame Génisson, j’ai bien entendu vos propos sur les contraintes juridiques extérieures, européennes notamment. Tout l’enjeu, pour nous, est de nous frayer un chemin entre nos propres exigences en matière de sécurité sanitaire et ces contraintes juridiques dont nous ne pouvons nous abstraire.
Comme vous l’avez dit, cet objectif nous oblige à faire preuve d’une ténacité et d’une volonté absolues : nous ne pouvons pas renoncer. Telle est bien, d’ailleurs, la volonté du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle nous soutenons cette proposition de loi. Elle nous paraît en effet porter l’expression d’une volonté forte, notamment s’agissant de l’accréditation, que vous avez vous-même présentée comme une démarche positive.
Nous espérons mettre ainsi en place un cadre pour l’exercice de la biologie médiale, à la fois satisfaisant pour les professionnels et rassurant pour les patients.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

Cet article a pour objet de ratifier l’ordonnance du 13 janvier 2010, afin de permettre aux dispositions qu’elle contient et qui ont aujourd’hui force réglementaire d’avoir demain, après promulgation de la loi, force législative.
Il est naturellement souhaitable que des règles qui encadrent l’exercice d’une profession aussi déterminante que celle de la biologie médicale dans le parcours de santé des patients puissent figurer dans la loi.
Toutefois, nous considérons que le processus utilisé ici, qui consiste à faire ratifier une ordonnance par l’adoption du premier article d’une proposition de loi pour ensuite, à l’occasion de l’examen des dix articles suivants, modifier le texte qui vient d’être ratifié, est un exercice particulier, même s’il est conforme aux pratiques habituelles et au droit.
Au-delà du recours à l’ordonnance, contre lequel chacun des groupes de gauche, je me permets de le rappeler, s’était à l’époque élevé, le contexte même de l’élaboration de cette ordonnance paraît problématique. De très nombreux interlocuteurs dénoncent l’absence de concertation réelle entre les autorités en charge de sa rédaction et les professionnels de terrain.
Elle a fait suite au rapport remis par M. Ballereau, missionné par la ministre de la santé de l’époque, Roselyne Bachelot-Narquin, rapport qui a servi de base à la rédaction de la réforme adoptée au début de l’année 2010.
Si, à l’image des professionnels concernés, nous souscrivons à la volonté de renforcer la médicalisation de la profession, nous regrettons que celle-ci s’inscrive dans la même logique que celle qui a conduit, peu après, à l’adoption de la loi HPST.
Il n’est pas indifférent de constater que c’est dans ce premier support juridique que cette ordonnance a commencé à prendre vie, puisque, comme pour la loi HPST, il y est question, au nom de la réduction des dépenses publiques, de diminuer le nombre de centres existants, en favorisant les fusions et les regroupements.
Comme pour les hôpitaux et maternités de proximité, on prend prétexte du besoin légitime de sécurité sanitaire pour fermer les plus petits sites, avec la conviction que la réduction de l’offre entraînera mécaniquement une réduction des dépenses. Les groupes financiers, ceux qui rêvent depuis des années de faire main basse sur le secteur, n’ont d’ailleurs pas manqué de rappeler que, par la fusion des structures et la concentration en un lieu des machines les plus performantes et les plus coûteuses, ils permettraient de réaliser des économies d’échelle profitables à la sécurité sociale.
Voilà le contexte dans lequel cette ordonnance a pris forme. Pour autant, certaines des dispositions qu’elle contenait initialement allaient dans le bon sens. Je pense par exemple à l’interdiction de recruter un candidat ne possédant pas un DES de biologie médicale à un poste à responsabilité au sein d’un CHU. Cette interdiction était cependant toute relative, dans la mesure où les dérogations existantes étaient maintenues…
Approuver aujourd’hui la ratification de cette ordonnance, même rectifiée par la proposition de loi – je salue à cet égard le travail mené par M. le rapporteur –, revient donc à entériner la logique comptable qui a présidé à sa rédaction.
Vous le savez, ce n’est pas un scoop, nous sommes pour l’abrogation de la loi HPST et contre sa logique comptable. C’est la raison pour laquelle le groupe CRC s’abstiendra sur cet article.

La ratification de l’ordonnance de 2010 vise à instaurer une stabilité juridique et, comme vous l’avez fort bien dit, madame la ministre, financière.
À cet égard, nous sommes nombreux à nous inquiéter du sort des laboratoires de proximité dans les territoires ruraux. Maintenant que vous avez déclaré votre flamme à ces laboratoires, madame la ministre, il va falloir leur donner un certain nombre de gages !
On voit bien que la logique de médicalisation va à l’encontre des logiques de proximité, de lutte contre la financiarisation et d’implantation de jeunes diplômés. Je pense notamment à l’un des amendements que nous avons étudié en commission, quelques minutes avant ce débat, à propos des actionnaires ultra-minoritaires et dont l’adoption aurait pour effet de freiner l’implantation des jeunes.
Si nous voulons maintenir les laboratoires de proximité, il faut impérativement donner des perspectives aux jeunes qui s’engagent dans une formation visant à obtenir un DES de médecin-biologiste.
Demeurent donc un certain nombre d’orientations contradictoires, raison pour laquelle il serait important, madame la ministre, que vous nous donniez des gages de votre volonté de trouver un consensus transpartisan dans cette proposition de loi fort importante pour la biologie médicale.
En tout état de cause, nous allons voter l’article 1er.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6222-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Art. L. 6222 -6. – Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

L’adoption de l’article 1er de cette proposition de loi aura pour effet la ratification de l’ordonnance du 13 janvier 2010. Dès lors, un laboratoire de biologie médicale pourra être constitué de plusieurs sites.
Afin de répondre au besoin légitime de sécurité sanitaire de nos concitoyens – la sécurité sanitaire est présentée comme le principe fondamental ayant conduit à l’adoption de ladite ordonnance –, il nous semble important de modifier l’article L. 6222-6 du code de la santé publique, afin que celui-ci prévoie que chaque laboratoire comporte un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites créés.
Il revient en effet aux biologistes et non aux techniciens d’assurer le respect des règles de sécurité, notamment en contrôlant personnellement le strict respect des obligations prudentielles et de sécurité.
Les biologistes, parce qu’ils sont formés spécifiquement à cette mission, sont les professionnels les plus sensibilisés au respect impératif des règles d’hygiène et de sécurité. Il paraît donc logique qu’au moins un biologiste soit présent sur chacun des sites.
Un même amendement, déposé fort opportunément par nos collègues socialistes, avait déjà fait l’objet d’une discussion lors de l’examen en seconde lecture par le Sénat de la proposition de loi Fourcade. M. Milon, rapporteur de ce texte, avait émis un avis défavorable ou de retrait, au motif que l’article que cet amendement visait à modifier ne prévoyait que « des règles minimales », qui revenaient d’ailleurs, comme celles qui étaient proposées, « à exiger qu’il y ait au moins un biologiste médical par site »…
L’objectif que nous visons est bien de garantir à chacun de nos concitoyens le droit d’être suivi dans un laboratoire où au moins un biologiste exerce. La médicalisation de cette profession et l’importance des nouvelles missions qui lui sont confiées, notamment dans l’aide à la prescription, ainsi que les éventuelles situations d’urgence rendent cette présence minimale sur chacun des sites indispensable.

Comme je l’ai souligné en commission, je souscris bien évidemment à l’objectif des auteurs de cet amendement, à savoir lutter contre la financiarisation des laboratoires de biologie et assurer la sécurité de leurs patients.
La rédaction proposée est néanmoins en retrait des obligations déjà prévues par l’actuel article L. 6222–6 du code de la santé publique, lequel impose déjà la présence d’au moins un biologiste aux heures d’ouverture sur chacun des sites d’un laboratoire de biologie médicale. Surtout, il prévoit que ce biologiste doit être en mesure d’intervenir à tout moment en dehors des heures d’ouverture. Cette obligation est bien plus contraignante que celle qui lui impose d’être simplement identifiable à tout moment.
Cet amendement est donc déjà satisfait par les dispositions existantes, et même au-delà. Aussi, j’en demande le retrait ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
J'avais émis un avis a priori favorable sur cet amendement, à l’objet duquel nous souscrivons tous, mais j’ai été sensible aux arguments avancés par M. le rapporteur.
De fait, madame la sénatrice, la rédaction que vous proposez pour l'article L. 6222–6 du code de la santé publique me paraît, sinon en retrait par rapport à sa rédaction actuelle, tout au moins redondante, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat pour en juger.

En réalité, nous visons le même objectif, mais nous faisons une lecture différente de l’article L. 6222–6.
Aux termes de cet article, la présence d’au moins un biologiste médical est obligatoire sur chacun des sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d’ouverture, mais pas au-delà. Compte tenu de la spécificité de la profession, nous demandons, nous, qu’un biologiste soit en mesure de répondre aux besoins sur chaque site, par exemple pour étudier les résultats des examens.
Notre lecture n’est peut-être pas la bonne, mais elle reste différente. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 26.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin applaudit.
(Non modifié)
Après le mot : « Pharmaciens », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l’un de ses domaines dans un établissement de santé ; ».

Notre groupe fait preuve depuis toujours d’une certaine défiance à l’égard des ordres professionnels, particulièrement lorsque ces derniers interviennent dans le champ de la santé.
Si l’heure n’est plus, comme en 1981, à la suppression de ces ordres, nous continuons à regretter qu’ils se voient confier des missions importantes qui pourraient et, théoriquement, devraient relever des pouvoirs publics.
En effet, sans reprendre à notre compte nos motifs d’hostilité aux ordres professionnels, liés aux origines de leur création, sous le régime de Vichy et pour se substituer aux syndicats existants, comment ne pas regretter que des pouvoirs quasi judiciaires leur soient confiés ?
Les membres des ordres sont en effet appelés à sanctionner leurs pairs en cas de conflit avec les patients ou de manquements aux règles déontologiques. Bien que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ait quelque peu réformé cette justice interne, force est de constater qu’elle demeure essentiellement corporatiste. Rappelons que rares, pour ne pas dire inexistantes, furent les sanctions dans les cas de pratiques, par les professionnels de santé, de tarifs exorbitants, dépassant de très loin le tact et la mesure.
Qui plus est, en dehors même des compétences « judiciaires » des ordres professionnels, il faut admettre que ces derniers, dans le domaine de la santé, ont toujours fait preuve d’une grande réticence face aux évolutions médico-économiques.
Sans aller jusqu’à rappeler leur opposition à la création de la sécurité sociale en 1945, comment ne pas nous souvenir qu’à l’occasion de la loi HPST l’ordre des médecins s’était opposé à ce que figure dans les cabinets copie des sanctions prononcées à l’encontre des professionnels ayant été sanctionnés, notamment pour discrimination financière à l’égard des publics relevant de la couverture maladie universelle ou de l’aide médicale de l’État ?
Enfin, nous considérons que les ordres professionnels ne sont pas les structures les plus adéquates pour représenter les intérêts des personnels et des professionnels de santé, dès lors que ces derniers n’exercent pas à titre libéral.
C’est évidemment le cas pour les personnels salariés, mais cela demeure pertinent pour ceux qui ne sont ni réellement libéraux ni réellement salariés, comme les travailleurs non salariés, qui sont de plus en plus nombreux au sein des laboratoires de biologie médicale. Ils risquent d’ailleurs de l’être encore plus si, malgré l’adoption de cette proposition de loi, nous ne parvenons pas, ce que nous redoutons, à mettre un frein à la financiarisation de la biologie médicale.
Pour eux, comme pour les salariés, nous considérons que les représentants légitimes ne sont non pas les ordres, mais les syndicats. C’est d’ailleurs ce même constat qui nous a conduits à déposer une proposition de loi tendant à rendre facultative l’adhésion aux ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC s’abstiendra sur cet article.
L'article 2 est adopté.
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6211-1 est complété par les mots : «, hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6211-23, après les mots : « et des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques », sont insérés les mots : « effectués dans un laboratoire de biologie médicale » ;
3° Après la première occurrence des mots : « cytologie pathologiques » du dernier alinéa de l’article L. 6212-2, sont insérés les mots : « effectué dans un laboratoire de biologie médicale » ;
4° Au 2° de l’article L. 6221-1, les mots : « effectués à l’aide de techniques relevant de la biologie médicale » sont remplacés par les mots : « figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels » ;
5° L’article L. 6221-12 est abrogé ;
6° L’article L. 6241-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou la structure qui réalise les examens d’anatomie et de cytologie pathologiques » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou de la structure qui réalise des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques » et les mots : « ou cette structure » sont supprimés.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Milon.

Cet amendement vise à maintenir l’article L. 6221–12 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, qui est issue de l’ordonnance du 13 janvier 2010, et donc à supprimer son abrogation, prévue à l’alinéa 6 de l’article 3 de la présente proposition de loi.
Il faut rappeler que l’article L. 6221–12 dispose que « les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens », à l’obligation d’accréditation.
Ces examens d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale peuvent être réalisés soit dans un laboratoire de biologie médicale ayant un secteur d'anatomie et de cytologie pathologiques, soit dans un laboratoire ou un cabinet d'anatomie et de cytologie pathologiques non adossé à un laboratoire de biologie médicale.
Afin qu'il y ait égalité des soins pour tous les patients, il est nécessaire, quelle que soit la structure dans laquelle sont réalisés les examens, que des garanties de qualité soient identiques et prouvées par l'accréditation.
En conséquence, il est nécessaire, dans tous les cas, que l'accréditation soit obligatoire pour tous les types de structures.

Cet amendement tend à revenir sur la distinction opérée entre les examens de biologie médicale et les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par les spécialistes de cette discipline. Il vise ainsi à inclure les actes relevant de cette spécialité dans le champ de l’accréditation.
La rédaction retenue dans la proposition de loi ne fait cependant que reprendre la position constante du Sénat sur cette question. Elle permet de prendre en compte le fait que la biologie médicale, d’une part, l’anatomie et la cytologie pathologiques, d’autre part, sont des spécialités médicales différentes.
En outre, cette solution d’équilibre ne ferme aucune porte : les structures spécialisées dans l’anatomie et la cytologie pathologiques peuvent entreprendre une démarche d’accréditation de manière volontaire.
Il reviendrait sans doute à un texte spécial de trancher définitivement la question de la place de cette discipline spécifique dans le champ médical et dans celui de la recherche. Or aucun projet de texte n’existe à ce jour.
La commission émet un avis défavorable.
Comme l'a dit M. le rapporteur, les actes accomplis dans le cadre d'examen d'anatomie et de cytologie pathologiques ont une spécificité propre. La biologie et ce qu'on appelle l’« anapath » sont deux spécialités différentes et, par conséquent, il n’est pas possible de lier l’une et l’autre en les soumettant à des règles d’organisation identiques.
Je rappelle d'ailleurs que, à la demande du Conseil national des pathologistes, le CNPath, qui regroupe l'ensemble des professionnels et des associations œuvrant dans le secteur de l’anatomie et de la cytologie pathologiques, un rapport a été rendu en avril 2012, dans lequel il est indiqué que cette discipline spécifique ne peut pas être considérée comme une partie de l'activité de biologie médicale et qu'il importe de la dissocier clairement de la biologie afin de lui donner une organisation et des règles propres, notamment lorsqu'elle est pratiquée hors d'un laboratoire de biologie médicale.
Il paraît donc nécessaire que les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques relèvent de règles et de techniques spécifiques. Tel est le sens de l'abrogation de l'article L. 6221–12 du code de la santé publique.
À mon regret, monsieur Milon, j’émets donc un avis défavorable.

J'ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre, auxquels je ne peux que souscrire. D’ailleurs, personne ne conteste que l'anatomopathologie et la biologie médicale sont deux activités différentes, mais, comme vous l'avez fait, madame la ministre, il est important de souligner que cette différence de nature entre l’une et l’autre n’implique aucunement que seule l’une d’entre elles, en l’occurrence la biologie médicale, soit expressément soumise à une obligation d'accréditation. Pour quelle raison l’anatomopathologie ne serait-elle pas soumise à cette même obligation ?
Si nous avions l’assurance que les structures qui réalisent des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques à l’aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, à l’obligation d’accréditation, nous nous rangerions à l’avis de la commission et du Gouvernement.
Madame la ministre, il serait souhaitable que vous puissiez nous le confirmer.

Bien évidemment, je soutiens l'amendement présenté par Alain Milon.
Là encore, je relève une contradiction, madame la ministre. Si les laboratoires qui réalisent des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques ne sont pas accrédités, comment envisager que des laboratoires de proximité qui ne sont pas spécialisées spécifiquement dans l’anapath puissent passer des conventions avec des laboratoires spécialisés dans l'anatomopathologie et non accrédités ?
Il y a vraiment là une ambiguïté, que l'amendement d'Alain Milon permettait justement de lever, étant entendu, je ne le conteste pas, que l’anapath et la biologie médicale sont deux spécialités différentes. La logique voudrait que les actes médicaux accomplis dans le cadre de ces deux disciplines fassent l’objet d’une reconnaissance identique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’entends bien le sens de vos observations.
Je ne dis pas que les actes d’anatomopathologie ne doivent pas relever d’un contrôle et d’une démarche d’accréditation, mais je considère que l’on ne peut pas, lors de la discussion d’un texte portant sur la seule biologie médicale, décider l’extension de règles propres à cette dernière à des actes qui relèvent d’une spécialité différente.
Vous me demandez, madame Génisson, si l’anapath sera soumise à accréditation obligatoire. Cette considération me paraît répondre à votre question. Cela étant dit, soyez assurée qu’une démarche est d’ores et déjà engagée pour déterminer des règles de contrôle spécifiques à l’anatomopathologie.

Madame la ministre, je vous remercie des précisions que vous m’avez apportées. Dès lors que vous nous indiquez que la démarche d’accréditation vaut pour cette autre spécialité qu’est l’anatomopathologie, nous suivrons votre avis et celui du rapporteur.
Je tiens à lever toute ambiguïté. Je n’ai pas dit que la démarche d’accréditation engagée valait pour les actes d’anatomopathologie. J’ai dit que, parallèlement à la démarche que nous avons engagée pour la biologie médicale et qui aboutit aujourd'hui à cette proposition de loi, nous avons engagé au sein des services administratifs une démarche afin de déterminer de quelle manière encadrer également les actes d’anatomopathologie.
Je n’affirme pas que la même démarche, le même label d’accréditation sera ensuite étendu. Je veux, je le répète, lever toute ambiguïté afin que l’on ne puisse pas ensuite reprocher au Gouvernement d’avoir entretenu le flou sur ses objectifs.

Il ne faut pas, en effet, jouer sur l’ambiguïté. Les laboratoires d’anatomopathologie ne sont pas soumis à accréditation ; seule une autorisation, délivrée sous certaines conditions, est obligatoire pour leur ouverture.
Envisager de les soumettre à accréditation serait, certes, parfaitement logique, mais, à l’heure actuelle, je ne crois pas qu’une telle démarche soit envisagée. Je ne soutiendrai pas l’amendement de mon ami Alain Milon, car il s’agit de deux démarches différentes.

J’ai bien entendu les divers arguments comme les explications de Mme la ministre, et je suis plutôt de l’avis de Gilbert Barbier s’agissant de l’accréditation des laboratoires d’anatomopathologie. Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
L'article 3 est adopté.
Le même code est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire de qualification biologique du don comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;
2° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-13. – Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle peut l’être dans un établissement de santé, au domicile du patient ou dans des lieux en permettant la réalisation, par un professionnel de santé autorisé, sous sa responsabilité et conformément aux procédures déterminées avec le biologiste-responsable du laboratoire mentionné à l’article L. 6211-11.
« Les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser cette phase et les lieux permettant sa réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° À l’article L. 6211-17, les mots : « au domicile du patient » sont supprimés ;
4° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital social d’une société de professionnels de santé autorisés à faire des prélèvements dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René-Paul Savary.

Une réglementation spécifique aux établissements de transfusion sanguine est prévue aux articles L. 1223-1 et suivants du code de la santé publique pour leur activité principale, la qualification du don et pour leurs activités d’immunohématologie.
Aussi, il ne paraît pas utile d’introduire dans cette réglementation des éléments dérogatoires à l’exercice de la biologie médicale.
Par ailleurs, l’article L. 1223-1 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que les établissements de transfusion sanguine sont admis à exploiter, dans le cadre d’un laboratoire, une activité de biologie médicale, sous réserve que celle-ci conserve un caractère accessoire.
L’exécution d’examens de biologie médicale dans le cadre du laboratoire de l’établissement de transfusion sanguine respecte pleinement les dispositions légales qui s’imposent, pour une telle activité, aux laboratoires de biologie médicale.
En particulier, aucune considération de santé publique non plus qu’aucune « spécificité particulière » d’une telle activité de biologie médicale, fût-elle exercée à titre accessoire, ne justifie qu’un laboratoire de biologie médicale, même s’il est exploité par un établissement de transfusion de sanguine, ne soit pas soumis aux dispositions de l’article L. 6222-5 applicable à tous les laboratoires de biologie médicale.
Une telle dérogation serait, au contraire, de nature à contrarier l’un des objectifs majeurs recherchés par la proposition de loi qui est de « garantir une biologie médicale de proximité et de qualité ».
Par ailleurs, toute dérogation aux règles fixées par l’article L. 6222-5 du code de la santé publique accordée aux établissements de transfusion sanguine serait de nature, en ce qui concerne les activités de biologie médicale réalisées sur le territoire national, à porter une atteinte au principe de libre concurrence tel qu’il est prévu par le droit communautaire.

L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
qualification biologique du don
par les mots :
biologie médicale
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement est évidemment très différent du précédent.
Une des difficultés que rencontre l’Établissement français du sang du fait de la réforme de la biologie médicale réside dans le respect de la règle de territorialité.
Nous estimons que la règle qui vise à éviter ou à empêcher que des établissements se retrouvent sur plus de trois territoires de santé limitrophes ne doit pas s’appliquer à l’Établissement français du sang. En effet, de par les missions qu’il mène et de par son statut, cet établissement ne peut pas être considéré comme un laboratoire de biologie de droit commun.
Je précise d’emblée, même si j’aurai sans doute l’occasion d’y revenir après l’avis de la commission, que, si nous adoptions cette interdiction, nous mettrions en danger l’activité de plusieurs sites de collecte de dons de sang dans les régions les plus densément peuplées. Vingt-sept sites fonctionnent actuellement en Île-de-France et, à l’évidence, ils sont répartis sur plus de trois territoires de santé limitrophes.
En conséquence, si nous voulons préciser les conditions dans lesquelles la collecte de sang est réalisée, nous ne voulons pas remettre en question l’exception de territorialité pour l’Établissement français du sang.

Les amendements déposés sur les alinéas 2 et 3 de l’article 4 illustrent l’alternative dans laquelle nous sommes placés s’agissant de la situation de l’Établissement français du sang.
L’amendement n° 57 vise à étendre les dérogations accordées à l’EFS à des activités qu’il pratique actuellement, mais qui ne relèvent pas de son monopole législatif. C’est le cas de l’immunohématologie du receveur, voire de la biologie médicale.
L’amendement n° 11 tend, au contraire, à limiter les dérogations accordées à l’EFS à ses seules activités de qualification biologique du don, pour lesquelles le droit existant lui accorde un monopole et auquel les règles de territorialité des sites de laboratoires ne s’appliquent pas.
Je comprends, bien sûr, les préoccupations qui ont inspiré la proposition du Gouvernement. Ne pas légitimer une pratique qui existe déjà, et qui semble-t-il fonctionne bien, pourrait entraîner une forte désorganisation de l’Établissement français du sang. Or, celui-ci rend des services indispensables puisqu’il effectue 85 % des actes de délivrance des dons.
J’attire cependant votre attention, mes chers collègues, sur les risques que présenterait une telle légitimation. L’Établissement français du sang n’intervient aujourd’hui que pour 28 % des examens d’immunohématologie des receveurs, qui ne relèvent pas de son monopole, tandis que les laboratoires de biologie médicale privés en effectuent 55 % et les centres hospitaliers 15 %. Lui accorder une dérogation pour ces actes et, plus encore, pour les examens courants de biologie médicale pourrait porter atteinte aux principes de libre concurrence.
Placée devant ce choix, la commission des affaires sociales, après en avoir longuement délibéré, a décidé de donner un avis de sagesse sur ces amendements. Il appartient donc à chacun de vous de se déterminer, mes chers collègues !
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement lui préfère, bien évidemment, son propre amendement !
Sourires.
J’apporterai simplement quelques précisions.
L’activité de l’Établissement français du sang ne se limite pas à la qualification biologique des dons sanguins. Les laboratoires de l’EFS réalisent des analyses qui vont très au-delà des simples analyses biologiques d’immunologie cellulaire et humorale, de cytologie hématologique, d’hémostase ou encore de biologie moléculaire, et se livrent donc à des activités qui relèvent de différentes spécialités.
Cependant, l’EFS est l’opérateur unique de la transfusion sanguine sur notre territoire. Il ne peut donc pas être placé sur le même pied que les autres opérateurs de la biologie. Il ne s’agit pas d’une question de concurrence ou de distorsion de concurrence, mais bien de garantir la pérennité de l’ensemble des activités de l’EFS, qui, on l’a dit, est en proie à des difficultés, ce qui justifie qu’une mission de réflexion ait été engagée en vue de l’accompagner et de le consolider.
M. le rapporteur l’a dit et je tiens à le souligner, certaines analyses de biologie médicale concernant le sang sont réalisées aujourd’hui dans des établissements de santé, de sorte que l’EFS n’a pas le monopole de fait de l’ensemble des analyses réalisées. En maintenant la dérogation territoriale, nous n’empêchons pas la réalisation des actes dans d’autres structures, notamment dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé ; nous apportons simplement des garanties pour des activités qui, aujourd’hui, sont réalisées sur des sites qui peuvent être considérés comme proches territorialement mais qui sont avant tout proche de l’Établissement français du sang.
C’est en ce sens que je disais tout à l’heure qu’il ne s’agissait pas d’une question de distorsion de concurrence. L’objectif n’est pas de dénier à d’autres établissements le droit de réaliser certains actes de biologie médicale, mais simplement de ne pas empêcher l’Établissement français du sang de mener à bien ses propres activités, dans le cadre du statut particulier dont il jouit dans notre paysage sanitaire, compte tenu de l’importance de tout ce qui a trait au don du sang et à la transfusion sanguine.
J’insiste sur ce point : nous sommes face à des enjeux de sécurité sanitaire majeurs. Je le répète donc, il ne s’agit pas d’empêcher les établissements de santé de réaliser les actes qu’ils pratiquent déjà, mais il ne faut pas renverser la situation en adoptant des dispositions qui fragiliseraient l’Établissement français du sang, sans que personne n’y trouve avantage par ailleurs, et désorganiseraient tout le système.

Ce qui compte avant tout, c’est la sécurité de nos concitoyens et donc la fiabilité des examens hématologiques pratiqués tant sur les donneurs que sur les receveurs.
Il existe peu d’établissements de santé, qu’ils soient publics où privés, qui ne disposent pas d’un laboratoire d’hématologie à même de pratiquer les examens qu’effectue l’Établissement français du sang. Il est tout à fait légitime que ce dernier procède aux examens concernant le donneur, mais les examens de compatibilité, eux, sont couramment faits dans les laboratoires des établissements de santé.
Je pense donc que, dans la mesure où ces laboratoires existent, les prérogatives qui seront accordées à l’Établissement français du sang ne pourront que créer une situation de concurrence. Je ne crois pas, par ailleurs, qu’elles puissent être la solution aux difficultés réelles qu’il rencontre.
Nous mélangeons deux sujets, majeurs l’un et l’autre, mais ce n’est pas parce que l’EFS est confronté à une situation délicate qu’il faut, pour lui donner une bouffée d’oxygène, l’autoriser à pratiquer des examens qui sont réalisés par ailleurs.
Je peux vous garantir que dans mon exercice professionnel j’ai vu beaucoup d’examens redondants parce que fournis et par le centre de transfusion sanguine et par le laboratoire d’hématologie du centre hospitalier concerné.
J’avoue, madame la ministre, que votre démonstration me laisse assez perplexe et je ne vois pas très bien quel intérêt supérieur du patient nous défendrions en votant votre amendement !

Je tiens à préciser une nouvelle fois que l’amendement que j’ai défendu ne résulte pas de la volonté de déstabiliser l’Établissement français du sang. Je crois, madame la ministre, que nous avons des objectifs communs mais que nous empruntons des voies différentes pour les atteindre.
Ce qui nous préoccupe aussi, comme Catherine Génisson l’a fort bien dit, c’est la redondance des examens. Tous les praticiens le constatent, les examens sont régulièrement pratiqués deux fois, et c’est donc toute l’économie de la santé qui est en jeu.
Il ne s’agit pas de déstabiliser l’un ou de favoriser les autres, mais de trouver une solution, et je crois que vous n’échapperez pas, madame la ministre, à la nécessité de trouver un équilibre un peu mieux construit entre les prérogatives des centres de transfusion et celles des autres partenaires.
Voilà quelques instants, on a vu que les laboratoires d'anapath n’entraient pas dans le champ de la proposition de loi, et l’on constate maintenant que les centres de transfusion peuvent eux faire l’objet d’amendements susceptibles d’être retenus : il me semble qu’il y a deux poids, deux mesures !
En tout état de cause, j’estime que la question méritait d’être posée. Ce n’est pas forcément aujourd’hui, je le concède bien volontiers, que nous pourrons y répondre, mais il faudra bien trouver une solution. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
Il n’y a pas deux poids, deux mesures, monsieur Barbier.
L’Établissement français du sang et ses sites pratiquent bien une activité de biologie, et c’est au regard de celle-ci que l’ensemble de leurs actes doivent être considérés.
Par ailleurs, madame Génisson, certains sites de l’Établissement français du sang réalisent l’ensemble des actes concernant le sang du donneur, y compris la vérification de compatibilité, qui n’est donc pas systématiquement réalisée par un établissement de santé, contrairement à ce que vous dites.
À Pontoise, par exemple, c’est le site de l’EFS qui réalise l’ensemble des examens d’hématologie sur les donneurs…
L’établissement de santé a, en quelque sorte, délégué à ce site de l’Établissement français du sang l’ensemble de l’activité. Or Pontoise est située dans un secteur où la question de l’enjeu territorial se pose très concrètement : s’il n’y a pas demain de dérogation à la règle de la territorialité, le site de l’EFS ne pourra pas être maintenu, ce qui ne manquera pas d’entraîner une désorganisation de la pratique des actes d’hématologie.
Au-delà de cet exemple, il est évident que la région Île-de-France, qui recouvre huit territoires, de surcroît limitrophes, serait la plus directement impactée.
Pour conclure, je tiens à signaler que nous avons engagé une mission sur l’ensemble de la filière du sang, car les enjeux qui s’attachent à la sécurité de toute la chaîne sont essentiels, et pas seulement pour les donneurs et les receveurs. Dans le cadre de cette mission, nous serons amenés à nous interroger, monsieur Savary, sur l’articulation entre l’Établissement français du sang et les différentes structures qui procèdent, à un titre ou à un autre, à des examens sanguins.

Il faut voir la réalité des choses. Ce n’est pas avec les centres de biologie privés qu’il y a concurrence. C’est entre les sites de l’Établissement français du sang et les laboratoires d’hématologie et d’immunologie des CHU et des grands hôpitaux qu’une véritable rivalité existe, et c’est bien là le problème !
Cette « guéguerre » ne date pas d’aujourd’hui et, comme l’a souligné Mme Génisson, même si des examens ont été pratiqués par l’Établissement français du sang, lorsque le patient arrive au CHU, on les refait, et cette redondance a évidemment un coût qu’il faut bien que quelqu’un supporte…
Je ne connais pas la situation en Île-de-France, mais je peux vous dire que dans ma région, la Franche-Comté, l’activité de biologie médicale ne peut représenter plus de 15 % des actes qu’effectue l’Établissement français du sang et qu’elle est donc limitée comparée à celle du CHU. Du fait de cette limitation, même s’il capte une certaine clientèle, l’EFS ne peut pas toujours effectuer l’ensemble des examens biologiques à pratiquer sur l’un de ses clients, ce qui d’ailleurs ne doit pas être sans conséquence sur le plan financier.
Je soutiendrai cependant l’amendement de M. Milon parce qu’il répond peut-être, en l’état actuel des choses, à un problème qui se pose de façon plus générale sur l’ensemble du territoire français.

La parole est à Mme Catherine Génisson, que je prie de bien vouloir être concise.

Je le serai, madame la présidente, d’autant que ce n’est certainement pas aujourd'hui que nous parviendrons à traiter totalement le sujet !
Forte des explications que vient de donner Mme la ministre, je pense que ce qu’il y a de gênant dans cet alinéa 3 de l’article 4, c’est qu’il prévoit que chaque établissement de transfusion sanguine pourra disposer d’un laboratoire de qualification biologique du don.
Autant je peux entendre que, lorsque des inégalités territoriales sont constatées, l’ARS intervienne pour favoriser localement des conventions entre l’établissement de transfusion sanguine et établissements de santé, autant j’ai du mal à admettre que ce droit soit accordé à tous les établissements de transfusion sanguine sur l’ensemble du territoire national.
Pour autant, je veux bien adhérer à l’argumentation de Mme la ministre, sachant que le texte doit et va encore évoluer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Pinton et Lorrain et Mmes Procaccia et Bouchart, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée
par les mots :
le prélèvement d’un échantillon biologique ne peut être réalisé
2° Remplacer le mot :
elle
par le mot :
il
II. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
cette phase
par les mots :
ce prélèvement
La parole est à M. Alain Milon.

La rédaction actuelle de l’alinéa 1 de l’article L. 6211-13 du code de la santé publique autorise la réalisation, en dehors du laboratoire, de l’ensemble de la phase pré-analytique d’un examen – comprenant le prélèvement d'un échantillon biologique, le recueil des éléments cliniques pertinents, son transport ainsi que sa préparation en vue des analyses –, ce qui, du point de vue de la santé publique et de la sécurité sanitaire, n’est évidemment pas souhaitable.
En effet, cette rédaction est contraire aux exigences de la santé publique, dont le seul objet est de contribuer à la qualité de l’examen de biologie médicale.
En l’état, la répartition des laboratoires et de leurs sites sur le territoire national leur permet de réaliser cette phase de l’examen de biologie dans des conditions de sécurité et de qualité.
Seuls 5 % des prélèvements sanguins environ seraient réalisés en dehors des laboratoires ou des établissements de santé. Cette pratique correspond à des situations particulières, notamment en zone rurale du fait de l’éloignement du patient.
Le présent amendement prévoit donc de restreindre le champ de l’examen de biologie médicale réalisable en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques.
J’ajoute que cette nouvelle rédaction de l’article L. 6211-13 du code de la santé publique est en totale adéquation avec les avancées qualitatives de la « médicalisation » de la biologie médicale.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Barbier, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
la totalité ou une partie de la phase préanalytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée
par les mots :
le prélèvement d’un échantillon biologique, sa conservation, son transport ne peuvent être réalisés
2° Remplacer les mots :
elle peut
par les mots :
ils peuvent
3° Après les mots :
un établissement de santé
insérer les mots :
dans une pharmacie d’officine,
La parole est à M. Gilbert Barbier.

Cet amendement diffère un peu du précédent…
L’ordonnance de 2010 prévoit la suppression de l’article L. 6211-5 du code de la santé publique, selon lequel « la transmission des prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée qu’au pharmacien d’officine installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif ».
Mme Bachelot-Narquin, alors ministre, avait été alertée des conséquences de cette suppression qui prive les officines de pharmacie de la possibilité de recueillir des prélèvements biologiques, utile notamment en milieu rural. Elle avait promis que ce point serait revu, mais, hélas, le problème est toujours pendant.
Les pharmaciens d’officine assuraient un service efficace et de qualité. Le recueil et la transmission des prélèvements en milieu rural risquent donc de se trouver ralentis en raison des distances à parcourir entre le laboratoire, d’une part, et les cabinets d’infirmières ou le domicile du patient, d’autre part. Pourtant, l’ordonnance avait été conçue pour améliorer, entre autres objectifs, l’accessibilité aux examens de biologie médicale !
Le nouvel article L. 6211-13 du code de la santé publique prévoit que, « lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé […] », la liste de ces lieux et leurs caractéristiques étant déterminées par décret en Conseil d’État. Le même article prévoit par ailleurs que les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pourquoi avoir exclu les pharmacies d’officine ?
À ce jour, ce problème, qui se pose maintenant depuis trois ans, n’est pas tranché.
Si, au regard des dispositions de l’ordonnance, les pharmaciens ne sont plus autorisés à transmettre les prélèvements remis par leurs patients, nombre d’entre eux, notamment en milieu rural, continuent à recueillir, conserver et transmettre ou à recevoir en dépôt des prélèvements dans le plus grand flou juridique, ce qui les place dans une situation très incertaine et dangereuse en cas de problème. Est-il envisagé de corriger cette omission dans le décret qui pourrait intervenir, pour l’application de ces soins ?
Le second point concerne le problème de la phase pré-analytique. En la matière, l’amendement que je présente varie quelque peu par rapport à celui de mes collègues. En effet, limiter la partie hors laboratoire aux prélèvements est beaucoup trop restrictif. Partant, cette définition est inadaptée aux réalités. Il convient de prévoir la conservation et l’éventuel transport des prélèvements, en définissant les modalités de ces trois actes par décret ou par arrêté.
En effet, il est très courant que les professionnels de santé, notamment les infirmières, soient conduits à transporter directement au laboratoire les prélèvements qu’ils effectuent.
Par ailleurs, il faut souligner le changement fondamental – là réside l’aspect capital du texte qui nous est proposé – par rapport aux dispositions en vigueur. Actuellement, la phase pré-analytique est placée sous la responsabilité du biologiste médical ; le présent texte tend à la transférer à la responsabilité du professionnel de santé, qui assume tout ou partie de cette phase. Cela revient à ôter au biologiste une partie fondamentale de l’examen qui comprend également, ne l’oublions pas, le recueil des éléments cliniques pertinents et la préparation de l’échantillon.
Qu’adviendra-t-il des responsabilités respectives du professionnel de santé qui effectue le prélèvement et le transporte, et du biologiste médical, lequel assure les phases suivantes ? Quel est le rôle de chacun des intervenants en cas de problème ?

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par MM. Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L'amendement n° 27 est présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée
par les mots :
le prélèvement d’un échantillon biologique ne peut être réalisé
2° Remplacer le mot :
elle
par le mot :
il
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 3.

Madame la présidente, je serai bref. En effet, mon amendement étant quasiment identique à celui qu’a présenté M. Milon et proche de celui que vient de proposer M. Barbier, les arguments que je pourrais développer sont peu ou prou les mêmes que ceux qui viennent d’être invoqués.
Je relève toutefois une exception, concernant un enjeu que M. Barbier a souligné : la responsabilité du laboratoire d’analyses médicales.
Monsieur le rapporteur, si j’ai bien lu l’article 4, c’est sous la responsabilité de l’opérateur que s’effectue le prélèvement ou la phase pré-analytique. Mais qu’advient-il, dès lors, du laboratoire d’analyses, qui reste, en définitive, le seul et unique responsable vis-à-vis du patient ?
Je ne suis certes pas médecin mais, en tant que scientifique, je m’interroge sur cette question : si la phase pré-analytique n’est pas bien réalisée, qui sera responsable du mauvais jugement, de la mauvaise analyse ? Le laboratoire ! Il s’agit là d’un véritable problème, que je me permets de soulever et qui, je l’espère, sera résolu par notre assemblée via une nouvelle rédaction de cet article.

Nos arguments rejoignent ceux qui viennent d’être avancés.
Naturellement, nous ne sommes pas opposés à ce que, dans certaines circonstances particulières et limitées, d’autres professionnels de santé que les biologistes médicaux puissent être autorisés à effectuer des prélèvements, notamment sanguins. Je songe par exemple à la faculté dont disposent les infirmiers de prélever des échantillons biologiques en cabinet, voire au domicile des patients.
Pour autant, la phase pré-analytique ne saurait être limitée au seul prélèvement. À nos yeux, il convient de réserver les autres étapes aux biologistes médicaux, ne serait-ce que pour garantir l’intégrité du prélèvement, composante indispensable à la qualité de l’examen et à l’exactitude des conclusions qu’en tireront les biologistes.
Qui plus est, il y a, selon nous, un paradoxe certain à vouloir tout à la fois encadrer la chaîne d’examen afin d’en renforcer la sécurité – c’est, au regard des arguments avancés, tout le sens de la procédure d’accréditation – et extraire de cette obligation de sécurité une phase qui est essentielle à l’analyse et, par voie de conséquence, à l’établissement du diagnostic.
Est-ce à dire que la phase pré-analytique est moins importante que les autres étapes ?
En outre, cette disposition est de nature à engendrer une distorsion de droits et d’obligations avec les laboratoires de biologie médicale qui mènent eux-mêmes cette phase, à moins que l’accréditation qui s’imposera demain aux laboratoires de biologie médicale ne concerne pas cette étape.
Mes chers collègues, cette question a déjà fait l’objet d’un débat similaire à l’Assemblée nationale. Alors que nos collègues députés examinaient la proposition de loi présentée par Valérie Boyer, Mme Catherine Lemorton, en défendant un amendement identique à celui que nous sommes en train d’examiner, avait pris un exemple particulièrement éclairant, que je souhaite vous livrer : « Lorsqu’un échantillon urinaire devra être transporté sur soixante ou soixante-dix kilomètres – car, à force, c’est ce qui va arriver, avec la disparition des laboratoires de proximité – dans quelles conditions ce transport s’effectuera-t-il, et à qui incombera la responsabilité si les choses ne se passent pas bien ? »
Les infirmières et infirmiers ruraux, qui se plaignent déjà de la baisse des tarifs kilométriques, seront sans doute peu nombreux à vouloir assurer ce transport, surtout si celui-ci s’accompagne de contraintes – légitimes – en matière de mise aux normes. C’est la raison pour laquelle nous considérons que cette mission doit continuer à relever de la responsabilité matérielle et juridique des biologistes médicaux.

Mes chers collègues, je vous remercie de cet excellent exercice d’analyse.
Ces quatre amendements tendent à limiter les étapes de l’examen biologique qui peuvent se dérouler en dehors des laboratoires de biologie médicale et des établissements de santé, afin que la phase pré-analytique ne soit pas concernée dans son ensemble par cette possibilité.
Les amendements n° 12, 27 et 3 limitent ces étapes au seul prélèvement d’un échantillon biologique, tandis que l’amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Barbier, concerne le prélèvement, la conservation et le transport.
En premier lieu, je tiens à préciser que la rédaction de l’article 4 n’impose en rien que l’intégralité de la phase pré-analytique se déroule hors des laboratoires de biologie médicale. Elle en ouvre simplement la possibilité, pour une partie de la phase pré-analytique, voire pour sa totalité, et ce par souci de pragmatisme, lorsqu’il est impossible que cette phase ait lieu dans un tel laboratoire.
L’article 4 n’empêche pas non plus le biologiste médical de se déplacer pour accomplir lui-même ces actes. Il permet uniquement, si le biologiste ne souhaite pas ou ne peut pas se déplacer – par exemple en raison des obligations de présence que lui impose le code de la santé publique –, que cette phase soit réalisée par des professionnels de santé. Celle-ci est alors accomplie sous leur responsabilité et dans le cadre d’une convention conclue avec le biologiste.
Il me paraît difficile de dissocier clairement les différentes composantes de la phase pré-analytique, telles qu’elles sont définies à l’article L. 6211–2 du code de la santé publique, auquel je vous renvoie.
D’un point de vue pratique, on ne peut imaginer qu’un biologiste qui ne se déplace pas pour effectuer un prélèvement sur un patient se déplace en revanche pour assurer le recueil des éléments cliniques pertinents pour ce même patient. Le même raisonnement s’applique pour les autres étapes de la phase pré-analytique mentionnées dans le code : la préparation, la conservation et le transport de l’échantillon biologique. Une telle dissociation conduit donc à vider l’article 4 de son objet, qui est d’assurer l’accès aux soins de biologie médicale sur l’ensemble du territoire.
De plus, en dissociant ces différentes étapes, l’on dissocie également les responsabilités applicables, ce qui me paraît dangereux.
Je suis bien conscient des enjeux de santé et de sécurité ainsi que des enjeux de responsabilité qui s’attachent à la phase pré-analytique, notamment aux stades du prélèvement et de la préparation. Néanmoins, il me semble que ceux-ci sont pris en compte dans la rédaction actuelle.
S’agissant des enjeux de sécurité sanitaire, la présente proposition de loi prévoit la définition de procédures directement avec le biologiste-responsable. En pratique, ces procédures sont fixées par une convention conclue entre les professionnels de santé – notamment les cabinets infirmiers – et les laboratoires de biologie médicale.
Est également résolue la question de la responsabilité applicable. Celle-ci est attribuée dans sa globalité au professionnel de santé qui effectue tout ou partie de la phase pré-analytique. Il s’agit d’une évolution importante par rapport aux textes précédents, qui conservaient au biologiste sa responsabilité sur l’ensemble des phases de l’examen.
Le principe retenu par le présent texte est le suivant : celui qui effectue un acte est également celui qui en assume la responsabilité. Il ne nous semble pas opportun de faire peser aujourd’hui sur les biologistes la responsabilité d’actes qu’ils n’accomplissent pas eux-mêmes.
Cette évolution permet par ailleurs de répondre aux attentes des professionnels de santé, qui ne souhaitent pas être placés sous la tutelle des biologistes. Ce n’est pas incompatible avec le contrôle par les biologistes de la phase pré-analytique, par le biais des conventions passées notamment avec les cabinets infirmiers.
L’amendement n° 37 rectifié prévoit en outre, à l’article 4, que les pharmacies d’officine soient mentionnées parmi les lieux dans lesquels peut se dérouler la phase pré-analytique. Cette rédaction ne me semble pas opportune.
De fait, la rédaction proposée tendrait à autoriser toutes les pharmacies, dans leur ensemble, à accomplir des actes dans le cadre de la phase pré-analytique. Or celles-ci ne sont pas toutes adéquatement équipées pour sa réalisation, ce qui pose un problème de sécurité sanitaire.
Le texte de la présente proposition de loi, tel qu’il a été modifié par la commission, n’exclut en rien une ouverture aux pharmacies, puisqu’il permet au pouvoir réglementaire d’accorder à certains lieux la possibilité de réaliser cette première phase de l’examen de biologie médicale. Pourront alors être définis des critères spécifiques qui permettront d’accorder cette possibilité aux pharmacies disposant de l’équipement nécessaire, ce que je vous ai rappelé en commission des affaires sociales.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces quatre amendements, pour les raisons qu’a excellemment présentées M. le rapporteur.
Concernant les amendements n° 12, 3 et 27, présentés par M. Milon et un certain nombre de collègues de son groupe, et, au nom de leurs groupes respectifs, par M. Vanlerenberghe et par Mme Cohen, je souscris totalement aux propos de Jacky Le Menn : il s’agit de ne pas dissocier les différentes étapes de la phase pré-analytique. En réalité, que signifierait, pour un patient, le fait de disposer d’une sécurité pour l’acte de prélèvement si on ne peut lui garantir que l’ensemble de la chaîne présente les mêmes garanties de sécurité ? Il va de soi que la qualité de l’acte est en jeu dès la phase de prélèvement, et jusqu’au terme de la phase analytique.
Tout à fait, monsieur le sénateur ! Cela ne fait que renforcer ce constat : les garanties doivent être les mêmes du début jusqu’à la fin du processus. On ne peut pas tronçonner l’ensemble de cette chaîne et affirmer : « Nous allons garantir une sécurité pour un acte de prélèvement, sans nous préoccuper, notamment, de la phase de transport. »
Aux yeux des auteurs de ces trois amendements, il n’est pas souhaitable que la responsabilité ne pèse que sur un des acteurs et il faut donc que chacun d’eux soit responsabilisé. Toutefois, une identification est nécessaire : à cet égard, des conventions existent déjà entre celui qui prélève, éventuellement celui qui transporte, et le laboratoire qui réalise l’analyse du prélèvement. Ces conventions pourront être dénoncées si toutes les conditions de la garantie ne sont pas assurées. Aussi, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 12, 3 et 27.
Monsieur Barbier, l’amendement n° 37 rectifié, que vous avez présenté, tend également à permettre le prélèvement en pharmacie d’officine. Or ce souhait est de facto satisfait par le présent article : les pharmaciens pourront figurer au nombre des professionnels autorisés. Il faudra naturellement que les conditions de sécurité et de garantie soient satisfaites, vous ne le contestez pas.
Dès lors qu’un pharmacien sera habilité, il faudra que les procédures soient déterminées via une convention préétablie entre celui-ci et le laboratoire qui traitera, dans un second temps, l’échantillon prélevé dans ces conditions. Rien ne s’oppose à ce qu’une convention soit conclue entre le pharmacien d’officine et le laboratoire.
Ainsi, étant donné que la rédaction actuelle du présent texte permet déjà l’aménagement que vous suggérez, j’émets également un avis défavorable sur votre amendement.

Madame le ministre, j’avoue ne pas saisir très bien votre raisonnement.
En effet, vous affirmez que les amendements déposés par mes collègues et moi-même reviendraient à extraire la totalité ou une partie de la phase pré-analytique de la responsabilité du biologiste médical. Mais c’est bien le texte actuel qui l’autorise ! Or cela pose un véritable problème, ne serait-ce que pour ce qui concerne la rémunération de ces actes : on le sait fort bien, c’est le biologiste médical qui encaissera le prix de l’acte et rétribuera ainsi le professionnel de santé qui aura concouru à cette phase pré-analytique.
Bref, le texte que vous nous proposez sort beaucoup plus que nous le souhaitons cette phase pré-analytique de la responsabilité du biologiste. Pour notre part, nous entendons restreindre l’étape extraite de la phase pré-analytique au prélèvement et – pour ce qui me concerne – au transport et à la conservation. Sur ce point, une ambiguïté demeure, et vous ne l’avez pas levée.
À mon sens, cette situation risque de se révéler très complexe sur le plan juridique. Elle placera sans nul doute le biologiste responsable dans une position très délicate.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Je partage tout à fait les propos de M. Gilbert Barbier. Vous l’avez dit, madame la ministre, c’est un ensemble, on ne peut séparer la phase pré-analytique de la phase analytique. Pourtant le texte les dissocie.
Je vous mets en garde, parce que c’est sous sa responsabilité que l’opérateur va effectuer le prélèvement §et mener la phase pré-analytique, dans le cadre d’une convention, c’est vrai. Mais on sait ce que vaut une convention en la matière !
Certes, la responsabilité de l’opérateur est engagée, mais c’est quand même le laboratoire de biologie médicale qui sera responsable en fin de compte de la qualité de l’analyse, du diagnostic, et en quelque sorte de la fiabilité de l’examen.
C’est sérieux, vous savez ! Cette phase pré-analytique peut conduire à des erreurs très graves. Je pense que nous devons établir une autre rédaction, conforme à ce que vous dites, d’ailleurs, quand vous affirmez qu’on ne peut pas dissocier les phases de l’examen. Écrivons donc, « sous la responsabilité du laboratoire de biologie médicale, et conformément à la convention » et ce problème sera réglé. Cette rédaction n’enlèverait rien à la responsabilité de l’opérateur. Exerçant une profession médicale, il est de toute façon responsable au regard du code de déontologie.
Comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, le prélèvement est un acte qui peut emporter des conséquences très importantes.
Comment peut-on admettre, dites-vous, qu’un biologiste, au fond, soit garant d’un ensemble d’actes dont le défaut pourrait être porteur de nombreuses conséquences négatives ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe s’exclame.
Je voudrais vous retourner l’argument ! Comment peut-on imaginer qu’un biologiste maintienne des liens conventionnels avec des organismes qui n’effectueraient pas les actes dont la qualité de son diagnostic dépendrait ?
De facto, donc, dans la réalité professionnelle, il est inenvisageable qu’un laboratoire ou un biologiste puisse se désintéresser de l’ensemble de la chaîne. En outre, on ne voit pas comment il pourrait ne pas rompre une convention s’il disposait d’éléments l’amenant à conclure que la sécurité de son diagnostic et des actes qu’il réalise lui-même est mise en cause.
C’est bien de cela qu’il s’agit dans cet article et c’est cela que vous voulez remettre en cause en fractionnant la phase pré-analytique !
L’enjeu n’est pas mince ! C’est la sécurisation de l’opérateur qui intervient dans différents établissements. Il s’agit de garantir que la responsabilité sera clairement identifiée pour des actes qui seront réalisés dans des maisons de retraite, dans des services d’aide à domicile, etc.
On ne peut imaginer que des actes soient simplement exécutés comme cela, indépendamment de leur insertion dans la chaîne. Il paraît important que la qualité des actes soit l’objet d’une responsabilité globale. À cette fin, une convention reliera les différentes phases de l’analyse les unes aux autres et un acteur sera en charge de déterminer la nature des relations qu’il entretient avec l’ensemble des autres membres de la chaîne.

Dans le texte actuellement en vigueur, l’article L. 6211–13 précise : « … elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d’un biologiste médical et conformément aux procédures qu’il détermine. ». On a modifié ce texte, et une ambiguïté a été introduite : « … elle peut l’être […] par un professionnel de santé, sous sa responsabilité et conformément… ».
Pourquoi ne pas être plus clair et dire que l’ensemble du processus est placé sous la responsabilité d’un biologiste médical, comme c’est le cas dans le texte en vigueur ?

Je voulais dire exactement cela, en reprenant les propos de Mme la ministre évoquant la responsabilité globale ! Je crois donc qu’il y a véritablement une ambiguïté dans le texte. Si vous la maintenez, c’est à vos risques et périls !

Étant déjà intervenu longuement, je vais résumer au plus court : c’est celui qui fait l’acte qui est responsable.

Mais non ! C’est la responsabilité sous la responsabilité du biologiste médical ! L’examen, c’est un tout !

Monsieur le rapporteur, vous devez comprendre que la responsabilité ne se partage pas, surtout dans le cas d’une analyse médicale, …

… dont la conclusion peut entraîner de très graves erreurs de diagnostic !

Il est clair que, sur toutes les travées, une ambiguïté a été identifiée. Si cet article était bien écrit, il ne provoquerait pas ces réactions unanimes ! Je pense que nous pouvons le rédiger différemment en tenant compte de ces avis.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures.

La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale.
Nous en sommes parvenus à la mise aux voix de l’amendement n° 12. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que l’adoption de ce dernier rendrait sans objet l’amendement n° 37 rectifié, ainsi que les amendements identiques n° 3 et 27.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
dans des lieux en permettant la réalisation
par les mots :
dans les lieux figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, selon des caractéristiques déterminées par lui
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Avec cet amendement, nous poursuivons notre démarche visant à l’encadrement et à la sécurisation de la phase pré-analytique.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 de la proposition de loi prévoit que la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale peut se dérouler « dans des lieux en permettant la réalisation ». Cette formulation ne nous semble pas satisfaisante, dans la mesure où elle donne l’impression que l’on vise une possibilité matérielle, en quelque sorte pratique.
La proposition de loi visant à apporter toutes les garanties de sécurité à l’examen pour que son interprétation soit la plus juste possible, on ne peut pas se satisfaire d’une expression qui suggère que la phase pré-analytique pourrait se dérouler dans un lieu où sa réalisation serait certes possible techniquement, mais en dehors de toute contrainte de sécurité ou de confidentialité.
C’est pourquoi nous proposons de confier au ministre chargé de la santé le soin d’établir une liste de lieux où la réalisation de cette phase serait possible, sur la base de critères et de caractéristiques arrêtés par décret.

Cet amendement vise à préciser la procédure selon laquelle les lieux permettant la réalisation de la phase pré-analytique de l’examen biologique peuvent être fixés par le pouvoir réglementaire. Il prévoit que la liste de ces lieux sera arrêtée par décret en Conseil d’État.

Il me semble qu’une telle procédure n’offre pas de garantie supplémentaire en matière de sécurité, dans la mesure où le Conseil d’État se prononcera sur la base des propositions du ministère de la santé.

En outre, elle pose un problème de cohérence avec la rédaction de l’alinéa suivant de l’article 4, l’alinéa 6, qui prévoit sur cette question un arrêté du ministre chargé de la santé.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y serait défavorable.

L’amendement n° 28 a été rectifié : il n’est plus question d’un décret en Conseil d’État !
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement, même rectifié.
L’enjeu principal est de s’assurer que le professionnel est autorisé à effectuer l’acte. Or il ne semble pas que les conditions supplémentaires prévues par l’amendement soient de nature à renforcer la sécurité telle qu’elle est définie à cet article 4.

Oui, madame la présidente. Je tiens simplement à préciser que, pour tenir compte des travaux en commission, nous avons abandonné l’intervention du Conseil d’État afin de rendre la procédure moins lourde.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions pour lesquelles la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé sont définies par décret. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le signaler, l’ordonnance du 13 janvier 2010, en permettant la création de laboratoires multisites et en freinant la financiarisation du secteur de la biologie médicale sans la stopper, risque de conduire à une baisse du nombre de laboratoires sur le territoire national. Cette réduction résulterait de la concentration de toutes les phases d’examen au sein d’antennes régionales, dans le seul but de réduire les coûts et d’accroître les dividendes versés aux actionnaires.
Les groupes financiers ont également compris que la diminution des coûts de fonctionnement et, donc, l’augmentation de leurs marges bénéficiaires et de leurs dividendes pouvaient passer par une forme d’externalisation de la phase pré-analytique vers d’autres professionnels de santé. À quoi bon investir dans cette phase quand d’autres peuvent la réaliser pour vous ? Cette politique va conduire à la fermeture de centaines de laboratoires médicaux de proximité.
Je souligne qu’un amendement analogue avait été déposé par nos collègues du groupe socialiste lors de l’examen de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « proposition de loi Fourcade ».
La pratique de proximité doit demeurer, notamment en milieu rural, mais elle doit être encadrée. Nous proposons aussi d’empêcher la séparation de la phase pré-analytique et de la phase analytique. Cette séparation est espérée par certains grands groupes, parce que la phase analytique est la seule qui rapporte réellement.
Dès lors qu’à l’évidence toutes les circonstances de la vie ne se prêtent pas à la réalisation de la phase pré-analytique d’une analyse biologique au sein d’un laboratoire ou d’un établissement public de santé, il apparaît nécessaire que l’autorité réglementaire établisse une liste des cas dans lesquels cette opération pourrait être réalisée en d’autres lieux.
J’insiste sur le fait que notre intention est toujours la même depuis le début de la discussion de la proposition de loi.

Cet amendement tend à confier au pouvoir réglementaire le soin de définir les cas dans lesquels la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale pourrait, par exception, être réalisée en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement de santé.
Je pense que, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 de la proposition de loi assure un encadrement satisfaisant de la phase pré-analytique. Il prévoit que les procédures applicables à cette phase sont déterminées avec le biologiste-responsable du laboratoire et que « les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser cette phase et les lieux permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 29 rectifié.
Il ne me semble pas que la proposition défendue par Mme Cohen présente un intérêt pratique du point de vue de la sécurité des procédures de prélèvement, qui est l’enjeu de fond de l’article 4.
En effet, je ne vois pas en quoi le fait d’établir par décret les conditions auxquelles la phase pré-analytique peut ne pas être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale apporterait une sécurité supplémentaire.
Madame Cohen, vous avez tiré argument de la multiplication de petits sites de prélèvement sous l’égide de laboratoires importants. Il me paraît peu probable que la dérive dont vous avez parlé se produise, dans la mesure où les frais d’installation et de fonctionnement d’une telle organisation ne diminueraient pas les charges que les laboratoires supportent en tout état de cause.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
L’article L. 6211–21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211–21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212–6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162–1–7 et L. 162–1–7–1 du code de la sécurité sociale. »

La biologie médicale et ses acteurs de terrain participent pleinement à l’excellence de notre système de santé. Comme celui-ci, la biologie médicale connaît de profondes modifications, parmi lesquelles celle qu’il est convenu d’appeler la médicalisation.
Ce mouvement, que nous appelons de nos vœux, tend à resituer le biologiste dans un contexte de santé publique : il ne doit plus être considéré comme un technicien de la santé – lequel est par ailleurs respectable –, mais comme un véritable conseiller médical capable, en même temps qu’il informe les patients, d’échanger avec les autres professionnels de santé et même, le cas échéant, de conseiller les médecins. Je ne parle pas de conseils portant sur les thérapeutiques les plus adaptées, mais sur la nécessité de réaliser des examens complémentaires ou des investigations plus poussées afin d’aider le prescripteur à élaborer le meilleur diagnostic possible.
Nous souscrivons pleinement à cette médicalisation, qui doit théoriquement profiter aux patients. Toutefois, elle ne doit pas servir de prétexte à la transformation d’une biologie médicale assise sur le colloque singulier entre professionnels et patients en une biologie médicale de type industriel. Je dois dire qu’en la matière nous avons quelques craintes.
Il n’en demeure pas moins qu’en actant la médicalisation de la profession, il était nécessaire de rompre avec certaines pratiques passées. Comme M. le Menn le rappelle à raison dans son rapport, celles-ci sont très mal vécues par la profession, qui les interprète comme « une négation de la médicalisation de la biologie médicale ».
En effet, personne n’accepterait d’une autre profession médicale qu’elle puisse négocier les tarifs qu’elle applique à un établissement de santé, en raison de son intervention dans celui-ci. Encore moins si cette négociation a pour effet de réduire les tarifs appliqués, au point qu’ils puissent se trouver inférieurs aux tarifs figurant dans la nomenclature.
Cette pratique dite des ristournes, qui renvoyait la biologie médicale à un acte technique, ne doit plus avoir cours. C’est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe CRC voteront en faveur de l’article 5 de la proposition de loi.
Les ristournes avaient tendance, de manière incidente, à rouvrir le débat sur la nature de la biologie médicale. En effet, si les professionnels de ce secteur pouvaient pratiquer des tarifs inférieurs à ceux fixés par la nomenclature, c’est qu’ils ne procédaient pas à un acte médical à proprement parler, mais à une simple prestation de service. Dès lors, comment la France pouvait-elle justifier au plan européen son refus d’appliquer à ce secteur les principes de libre concurrence imposés par les directives sur les services ?
Pour autant, la suppression des ristournes ne réglera pas toutes les difficultés que rencontrent les professionnels de santé, dont la médicalisation exigera qu’ils assurent des missions nouvelles : les biologistes médicaux devront interpréter plus et mieux les analyses médicales, au risque de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée, et consacrer davantage de temps à un travail d’interprétation non rémunéré alors même que, depuis des années, leurs tarifs n’ont cessé d’être réduits.
Par ailleurs, personne ne peut ignorer que le renforcement du rôle du biologiste médical dans l’interprétation des résultats rend nécessaire la rencontre entre le professionnel et le patient, afin que le premier puisse réaliser, à l’image des médecins, un véritable interrogatoire du second. Seulement, ces rencontres seront d’autant moins possibles que la nature multisites des laboratoires tendra progressivement à éloigner les biologistes des patients.
Malgré leurs réserves, les sénateurs du groupe CRC voteront en faveur de l’article 5, qui permettra de mettre un terme à la concurrence par les prix pratiquée par certains laboratoires. C’est d’autant plus nécessaire que, lorsqu’elles sont consenties aux établissements de santé privés commerciaux, les baisses de tarifs ne profitent qu’à ces derniers, lesquels baissent leurs coûts de revient sans réduire les tarifs imposés aux patients.
C’est pourquoi, tout en restant vigilants, nous approuvons l’article 5 de la proposition de loi.
L'article 5 est adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié sexies est présenté par MM. Mayet, Pinton, Chauveau, Cointat, Gournac, Leleux, Milon, Revet, du Luart et B. Fournier, Mmes Sittler et Cayeux, MM. Portelli, Magras et Pillet, Mme Giudicelli, M. Beaumont, Mlle Joissains et M. Vial.
L'amendement n° 8 est présenté par MM. Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6211–21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À titre dérogatoire, l’article L. 6211–21 n'est pas applicable aux établissements de santé publics situés dans un département ne disposant pas d’un laboratoire public de biologie médicale.
« Cette dérogation est accordée sur proposition de l’agence régionale de santé. Cette dernière prend en compte des critères d’éloignement de l’établissement par rapport à d’autres établissements de santé publics équipés d’un laboratoire de biologie médicale, ainsi que la convention le liant à un laboratoire privé.
« Les critères d’éloignement visés à l’alinéa précédent combinent des données objectives de distance et de temps de parcours appréciées par l’agence régionale de santé. »
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié sexies.

Les premiers signataires de cet amendement sont MM. Mayet et Pinton.
Certains départements ne possèdent pas de laboratoires publics de biologie médicale et leurs établissements de santé publics sont trop éloignés d’autres établissements équipés d’un laboratoire. Dans ces départements, conformément à la réglementation, les établissements de santé publics traitent avec des laboratoires privés, qui consentent alors des remises.
Cet amendement a pour objet de maintenir cette possibilité, afin de conjuguer efficacité médicale, c'est-à-dire la proximité, et nécessité budgétaire, par le biais de « ristournes ».

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l'amendement n° 8.

Madame la présidente, Alain Milon ayant très bien présenté son amendement, je considère que le mien est défendu. Il s’agit ici de cas limites, qui justifient que soient négociées des remises, terme que je préfère à celui de ristourne. Il faut procéder par appel d'offre, ce qui me paraît légitime dans la mesure où cela concerne un établissement public.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Barbier, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6211–21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À titre dérogatoire, les dispositions de l’article L. 6211–21 ne sont pas applicables à un établissement de santé public ne disposant pas d’un laboratoire public de biologie médicale dans un rayon de 50 km. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.

Nos collègues des départements ruraux ont souligné la difficulté que rencontrent certains établissements publics de santé ne disposant pas d’un laboratoire public de biologie dans un périmètre rapproché, voire dans tout un département. Ils ont insisté sur la nécessité de sous-traiter les examens à un laboratoire privé et d’obtenir de celui-ci un contrat approprié sans obérer les finances de l’établissement.
Le non-recours à la pratique de la ristourne peut se concevoir. Une procédure d’appel d’offre pourrait être décidée, sur le modèle de ce qui se pratique pour la sous-traitance de certaines activités ou prestations de l’établissement public – restauration, lavage du linge, etc. – qui sont confiées à des entreprises privées.
En revanche, la limite départementale ne me paraît pas adaptée. Il faut tenir compte du réseau de laboratoires publics et prendre en compte la distance par rapport à l’établissement. C'est la raison pour laquelle je propose la distance de cinquante kilomètres ; elle me paraît raisonnable et me semble correspondre davantage aux difficultés que peut rencontrer un établissement public pour faire effectuer les examens dans un établissement public de biologie.

L’amendement n° 2 rectifié sexies, que nous avons déjà examiné très longuement lors de l’élaboration du texte de la commission, porte sur les ristournes. Même s’il concerne un cas très précis, nous pensons que les problèmes financiers que rencontrent certains hôpitaux doivent plutôt trouver leur solution dans une intervention des agences régionales de santé ou dans une renégociation des tarifs. Le maintien même restreint des ristournes est contraire à la volonté de médicalisation de la biologie médicale.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement identique n° 8.
Même s’il encadre plus encore le cas de dérogation à l’interdiction des ristournes, l'amendement n° 39 rectifié pose le même problème de principe. Il ne peut y avoir de concurrence par les prix, par quelque mécanisme que ce soit. Seul le tarif réglementé est applicable.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
J’entends parfaitement les préoccupations qui ont été exprimées quant au maintien de la capacité d’analyses médicales dans des territoires isolés. Vous ne voulez pas qu’aux déserts médicaux s’ajoutent des déserts d'analyses biologiques.
La question est de savoir si les ristournes sont la solution adaptée au problème.
Vous vous placez sur le terrain exclusif de la relation financière, alors qu’il s’agit bien plutôt de déterminer des coopérations entre les établissements de santé et des laboratoires. Il faut en effet établir des conventions de bonne qualité avec des laboratoires situés plus loin géographiquement, quand les laboratoires de proximité font défaut, ce qui arrive. En revanche, quand les laboratoires sont « petits » et, par conséquent, fragiles, il est nécessaire de prévoir des conventions renforçant leur rôle en lien avec les établissements de santé.
Les agences régionales de santé ont indiscutablement un rôle à jouer dans la structuration de l'offre de santé sur un territoire.
Cela étant, comment considérer que l'enjeu est exclusivement financier et que l’on puisse contester, de façon générale, la logique du dumping – car c'est bien de cela qu’il s’agit –, mais l'accepter pour certains territoires ? Je doute d’ailleurs que cela permette d’atteindre l’objectif que l’on se fixe, car, si l’on fait du dumping, viendra un moment où les petits laboratoires seront eux-mêmes mis en danger.
Je suis particulièrement sensible aux inquiétudes que vous exprimez. Je doute cependant que la réponse retenue soit appropriée. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis plutôt défavorable sur ces trois amendements.

Les revendications exprimées par les auteurs de ces amendements sont tout à fait légitimes, vous l'avez d'ailleurs souligné, madame la ministre, et votre réponse est tout à fait convaincante.
Il faudrait toutefois que cela figure noir sur blanc dans la loi : oui, il relève de la responsabilité des agences régionales de santé d'assurer l'égalité d'accès aux examens biologiques sur l'ensemble du territoire, en fonction des spécificités de chaque territoire.

J’évoquerai un cas concret. Les groupements hospitaliers interdépartementaux existent ; il faut donc s'affranchir de la barrière départementale. Le groupement hospitalier Aube-Marne que je connais, étant un élu de la Marne, n'a pas encore la taille critique suffisante pour maintenir un laboratoire accrédité et est en train d’établir une convention avec le laboratoire du centre hospitalier de Troyes.
Cette situation entraîne indéniablement des frais de transports pour les analyses quotidiennes, mais également en période d'urgence. La difficulté n’est pas tant d'organiser un transport pour acheminer l'ensemble des analyses d'un groupement hospitalier vers le laboratoire qui est loin que d’intervenir en cas d'urgence ou lorsqu’il convient de réaliser dans la journée des examens à la demande du praticien. Cela engendre des frais supplémentaires. Or ces groupements hospitaliers sont soumis à la tarification à l’activité et ont besoin d'équilibrer leurs budgets, alors que ceux-ci sont déjà déficitaires.
Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, nous avons pu constater les difficultés auxquelles doivent faire face les hôpitaux. Il ne me paraît pas aberrant d’établir une convention qui contienne un chapitre financier, de façon que chaque groupement ou hôpital puisse s’y retrouver financièrement. Il y va de l'équilibre budgétaire, me semble-t-il.
Il s'agit d'une ristourne au sens non pas mercantile du terme, mais fonctionnel, afin que le groupement hospitalier local n’ait pas à assumer la prise en charge totale des frais. Ce serait sinon lui infliger une double peine : plus de laboratoire et une pénalisation financière.

Je vous ai écouté avec attention, madame le ministre. Vous avez évoqué des conventions passées avec les petits laboratoires. Comporteront-elles des clauses financières ? Parler de « ristourne » est inapproprié. Cela étant, un laboratoire qui est situé à une certaine distance et vient effectuer une dizaine ou une vingtaine de prélèvements dans un établissement public est en droit de facturer pour chacun des actes la totalité de ce qui correspond à cet acte.
Dans ces conditions, si aucun accord financier n’est adossé à la convention qui sera conclue avec les laboratoires, l'établissement public en subira bien entendu les conséquences. En revanche, si ce volet financier existe, compte tenu du nombre d'actes qu’il effectue chaque jour dans cet établissement, le laboratoire pourra consentir non pas une ristourne, mais un abattement financier.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Je partage tout à fait les propos de Gilbert Barbier.
Je précise simplement, madame la ministre, qu’il ne faut pas priver les établissements publics d'une ressource, eu égard à la répétition de l’acte. Les établissements publics, en particulier les hôpitaux, se trouvent dans une situation financière telle qu’il faut leur permettre de réaliser des économies.

Je suis sensible aux difficultés qui sont exposées, y compris dans l’exemple concret qui a été évoqué. Il n'en demeure pas moins que je trouve extrêmement dangereux de faire intervenir la notion non pas de ristourne, mais de moins-disant financier pour un acte médical. C’est un précédent qui pourrait avoir des conséquences extrêmement inquiétantes.

Mes chers collègues, hier matin, lors de la réunion de la commission, nous avons adopté l’amendement n° 52 déposé par le rapporteur à l'article 7 bis, dont l’objet peut satisfaire les préoccupations que vous exprimez.
En revanche, je partage les propos de notre collègue concernant les dangers de l'introduction de tarifs différenciés. L'article 5 prévoit justement un même tarif pour tous.

Il ne faut pas introduire une concurrence par les prix. Aussi, il convient d’être vigilant à cet égard, en évitant de parler de rémunération et en tout cas dans la convention qui pourrait être mise en place.
L'amendement n° 52 apporte déjà une première réponse. Il va de soi que, lors de l’examen de ce texte par l'Assemblée nationale, Mme la ministre et les députés pourront faire évoluer le dispositif, en précisant encore le rôle des agences régionales de santé afin de prendre en compte la réalité des territoires dépourvus de laboratoires de biologie médicale.
J’ai tenu dès à présent à évoquer l’article 7 bis. Il ne faut pas introduire de concurrence par les prix, qui pourrait être préjudiciable au secteur de la biologie médicale.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Après l’article L. 6213–2 du même code, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213–2–1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142–5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline biologique ou mixte, sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités, exercent les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213–12, lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la sous-section pharmaceutique du Conseil national des universités dont ils dépendent. »

J’ai souhaité m’exprimer sur l’article afin de rappeler les raisons pour lesquelles, selon moi, il est non seulement équilibré, mais important.
Cet article est équilibré parce qu’il est le fruit d’une longue négociation entre les biologistes hospitaliers et la Fédération hospitalière de France, d’une part, les doyens de facultés et plusieurs professeurs de sur-spécialité de la biologie médicale, d’autre part.
Le Sénat s’est opposé à ce que l’on puisse recruter des scientifiques et des vétérinaires sur des postes de CHU. Cet article rend ces recrutements impossibles. Seuls pourront être recrutés sur ces postes sans avoir le DES de biologie médicale des médecins et des pharmaciens, dans le cadre d’une procédure contraignante et sans possibilité d’exercer autrement que dans leur spécialité d’origine.
Évidemment, pour les postes en CHU, priorité sera donnée aux titulaires du DES. À l’heure actuelle cependant, il semble qu’il n’y ait pas suffisamment de candidats issus de la filière de biologie médicale.
Écarter les scientifiques et les vétérinaires des postes en CHU n’est pas une solution si évidente qu’il y paraît. J’ai reçu un professeur au collège de France, Jean-Louis Mandel, qui est titulaire de la chaire de génétique humaine et médecin hospitalier. Il est venu plaider pour le recrutement de scientifiques et de vétérinaires au nom de l’intérêt de la recherche dans les CHU. Son analyse et son expérience ne sont pas à prendre à la légère et il faudra que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la santé se rapprochent pour trouver une solution.
Nous avons néanmoins écarté tous ceux qui ont une autre formation de base que la médecine ou la pharmacie, afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la volonté de médicalisation de la profession et pour trouver une voie moyenne entre des positions divergentes mais également légitimes.
Cet article vise donc à trouver un équilibre, ce qui n’est jamais facile. Je pense de surcroît que cette disposition est très importante pour la formation des biologistes eux-mêmes. L’enseignement des sur-spécialités comme l’hématologie, la génétique ou la virologie, qui prennent de plus en plus de place dans l’évolution de cette discipline, doit pouvoir être confié à des spécialistes. Sinon, on risque d’appauvrir la formation, non seulement des biologistes, mais de tous les médecins.
Aussi, je souhaite que l’article 6 sorte de nos débats le moins altéré possible.

Au cours de la discussion générale, j’ai eu l’occasion de préciser que notre groupe s’était, dès 2010, réjouit que l’ordonnance du 13 janvier de la même année encadre plus strictement le recours par les établissements publics de santé à des non-titulaires du DES de biologie médicale pour diriger un service de biologie.
Encadrement plus strict et non interdiction, puisque, contrairement à ce qui a pu être dit, notamment lors de l’examen de l’article 52 de la proposition de loi due à l’initiative de Jean-Pierre Fourcade, les CHU pouvaient, malgré l’ordonnance de 2010, continuer à recruter des non-titulaires dès lors que ces derniers remplissaient les conditions posées par les dérogations existantes.
Cet article permet donc aux dirigeants des centres hospitaliers et universitaires de recruter et de nommer des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des université-praticiens hospitaliers non titulaires du DES de biologie médicale à la tête d’un service hospitalier de biologie médicale.
Nous prenons acte de cet article, qui semble aujourd’hui faire l’objet d’un certain consensus, y compris auprès des organisations syndicales, et c’est donc un point important.
Pour autant, nous émettons un doute.
Notre groupe est, pour l’ensemble des professions, particulièrement sensible à la reconnaissance et au respect des diplômes et des qualifications. Le diplôme constitue en effet le premier passeport des jeunes professionnels pour accéder à un emploi et aux responsabilités. Il atteste de l’acquisition de connaissances spécifiques par le jeune professionnel. Or, recruter des non-titulaires, malgré les conditions posées par cet article, revient au final à faire comme si ces années passées à se former, comme si cet enseignement particulier, dédié à la biologie, n’étaient pas si indispensables que cela pour exercer.
Les jeunes peuvent alors légitimement s’interroger sur le bien-fondé de poursuivre une formation spécialisée si cette dernière ne leur garantit en rien d’être prioritairement recruté au sein des services qui leur sont normalement destinés par leur formation.
Cela étant, nous ne sommes pas partisans d’une fermeture totale, mais d’une ouverture encadrée.
Nous avons voulu, davantage encore que lui, garantir l’équilibre dont vient de parler M. le rapporteur à travers un amendement de précision qui concerne la qualité de l’avis donné par la commission. Nous espérons que cet amendement sera retenu par notre assemblée.

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, MM. Marseille, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L'amendement n° 14 est présenté par MM. Milon, Gilles et Savary, Mmes Deroche et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot et Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton et Mmes Procaccia et Bouchart.
L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Barbier, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 6.

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 6 du texte. Bien que M. le rapporteur juge sa rédaction équilibrée, il crée une dérogation nouvelle qui permet à des professionnels médecins ou pharmaciens non qualifiés en biologie médicale d’exercer en CHU les fonctions de biologiste médical. Cette dérogation ne se justifie pas à nos yeux.
En effet, l’ordonnance Ballereau n’a pas réservé l’exercice de la biologie médicale aux seuls détenteurs du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale. Différentes voies dérogatoires sont déjà prévues.
C’est notamment le cas pour les médecins et les pharmaciens non titulaires du DES de biologie médicale, après obtention de la qualification en biologie médicale par les ordres respectifs.
De plus, à condition qu’ils n’exercent pas d’activité de biologie médicale, les personnels enseignants et hospitaliers des CHU n’ayant pas les diplômes requis peuvent continuer à réaliser des activités d’enseignement et de recherche fondamentale et appliquée, après nomination par le Conseil national des universités, le CNU, sans induire une rupture d’égalité de la prise en charge des patients.
Cette ordonnance ouvre également une troisième voie, dont je vous épargnerai les détails, pour l’exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation par des biologistes non-titulaires du DES.
Notre sentiment est donc qu’il n’y a pas de raisons objectives de créer une voie nouvelle pour l’exercice de la biologie médicale.

Tout d’abord, madame la présidente, je vous informe que nous demanderons un scrutin public sur ces trois amendements identiques.
L’ordonnance du 13 janvier 2010 sur la biologie médicale n’a pas réservé l’exercice de la biologie médicale aux seuls détenteurs du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale.
Différentes voies dérogatoires sont donc d’ores et déjà prévues.
Cette ordonnance prévoit en effet une dérogation pour les médecins et pharmaciens non titulaires du DES de biologie médicale, après obtention de la qualification en biologie médicale par les ordres respectifs.
De plus, les personnels enseignants et hospitaliers – médecins, pharmaciens ou scientifiques – des centres hospitaliers et universitaires peuvent continuer à réaliser des activités d’enseignement et de recherche fondamentale et appliquée de haut niveau après nomination par le Conseil national des universités, sans induire une rupture d’égalité de la prise en charge des patients.
L’ordonnance ouvre également une troisième voie pour l’exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation par les biologistes non titulaires du DES de biologie médicale.
Il n’y a donc aucune raison de créer une voie nouvelle pour l’exercice de la biologie médicale.
Nous considérons que cet article, en créant une nouvelle dérogation, dévalorise la formation de biologiste médical et nous rappelons que le Sénat a rejeté à de nombreuses reprises des dispositions similaires.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié.

Le Sénat s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur ce texte et l’a rejeté.
J’ai l’impression que l’on se dirige de plus en plus vers l’abrogation de ce qui faisait le fondement de la pratique hospitalo-universitaire, à savoir le triptyque soins, enseignement, recherche. On se contente désormais d’exiger de certains d’entre eux l’enseignement et la recherche, les soins passant à la trappe.

Cet article est le fruit d’un compromis entre les biologistes hospitaliers et les doyens des facultés de médecine.

Je note que les chercheurs souhaiteraient que nous allions encore plus loin, en ouvrant des postes aux scientifiques et aux vétérinaires. Nous nous limitons aux médecins et aux pharmaciens.
Je suis personnellement convaincu que cette dérogation est nécessaire pour garantir la meilleure formation possible des internes, qui ont besoin d’avoir comme enseignants les meilleurs spécialistes.
Nous avons, en commission, précisé qu’en plus de la recherche et de l’enseignement, les personnes recrutées devront exercer des fonctions hospitalières.
Dès lors, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.
L’avis est également défavorable.
J’entends bien les arguments avancés par plusieurs des sénateurs qui sont intervenus, mais je tiens à préciser que la dérogation prévue à l’article 6 est strictement encadrée.
Il ne s’agit pas d’ouvrir les vannes ou de permettre que tout un chacun puisse, au sein des CHU, pratiquer des actes ou une activité de biologie médicale.
Il s’agit effectivement, en premier lieu, d’établir une différence entre la pratique de ville et celle qui se déroule au sein des CHU.
Monsieur Barbier, vous ne pouvez pas, d’un côté, dire que cet article a été soufflé par les doyens et, de l’autre, regretter que l’intégration entre l’enseignement, la recherche et les soins soit mise en cause. En effet, ce qui fait précisément la spécificité du CHU, et ce à quoi les doyens sont, eux aussi, particulièrement attachés, c’est le fait d’avancer conjointement sur ces trois terrains.
C’est précisément pour respecter cette spécificité du CHU, à savoir que le soin et la pratique sont adossés à l’enseignement et à la recherche, qu’une différence est inscrite dans le texte entre la formation des biologistes médicaux amenés à exercer en ville et celle des biologistes susceptibles d’exercer en milieu hospitalier.
Pour autant, la dérogation, loin d’être largement ouverte, reste strictement encadrée. Le professionnel doit tout d’abord avoir préalablement exercé trois ans au moins dans un laboratoire hospitalier, ce qui représente tout de même l’acquisition de compétences qu’il est difficile de nier. Puis une commission spécialisée intervient et donne un avis, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’automaticité entre l’exercice au CHU et le fait de pouvoir disposer de la dérogation telle qu’elle a été prévue.
Par ailleurs, plusieurs éléments ne figurent pas dans le texte, alors même qu’ils étaient demandés par certains, qui voulaient que l’on aille plus loin dans la dérogation. Ainsi, le texte ne prévoit pas que la dérogation puisse être étendue aux personnels scientifiques qui ne sont ni médecins ni pharmaciens, ce qui aurait pu être envisagé, mais n’a pas été acté. Il arrive que ces personnels scientifiques soient très fortement impliqués dans le fonctionnement d’un CHU ; pourtant, le texte n’a pas retenu cette dérogation.
Je tiens enfin à préciser que les personnels hospitaliers concernés doivent évidemment concourir à l’ensemble des obligations de service public attachées à leur fonction. Il ne s’agit donc pas d’une dérogation accordée sans contrepartie. Ces personnels hospitaliers devront ainsi, au même titre que l’ensemble des autres biologistes, participer à l’organisation de la permanence de soins, c’est-à-dire aux astreintes de laboratoire. Je me permets d’insister sur ce point, car la question de la permanence des soins est clairement posée dans certains de nos territoires. Nous avons donc besoin que l’ensemble de ceux qui participent à ces missions soient également concernés par ces astreintes. C’est aussi un effet favorable de l’article 6 que de garantir cette permanence des soins.

Je souscris à l’argumentaire de M. le rapporteur, à savoir qu’il s’agit d’un texte d’équilibre.
J’entends également l’argumentation forte de Mme la ministre, qui indique que si ces personnels sont assujettis à l’ensemble des responsabilités qu’ils doivent assumer en milieu universitaire, notamment en termes de recherche, ils ont aussi l’obligation d’assurer la permanence des soins, ce qui est en effet fondamental.
En revanche, afin qu’aucun sentiment de concurrence déloyale ne s’installe entre les étudiants qui préparent le DES en quatre ans et les professionnels qui travaillent dans ces services hospitaliers, le plus souvent d’ailleurs dans des centres hospitalo-universitaires, je souhaiterais que soit affirmée la possibilité d’accueillir tous les étudiants qui préparent leur DES, ou qui ont l’intention de le préparer, au sein de ces services. Il me semble en effet qu’il s’agissait de l’une des principales inquiétudes des étudiants en biologie et des biologistes, qui se faisaient l’écho des craintes de leurs jeunes confrères. Ils voulaient avoir la certitude qu’ils conserveraient des places dans ces services au cours de leurs quatre années d’études de DES.

Mes chers collègues, à la demande de la commission nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à dix-neuf heures quarante-huit.

La séance est reprise.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 6, 14 et 40 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 91 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 6 est supprimé et les amendements n° 1 rectifié ter et 30 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Raoul et Kerdraon, Mme Génisson, MM. Daudigny et Teulade, Mmes Emery-Dumas, Printz et Schillinger, MM. Cazeau, Jeannerot et Godefroy, Mme Alquier, M. Labazée, Mmes Demontès, Meunier, Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5
par les mots :
, dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5 et dans les centres de lutte contre le cancer
L'amendement n° 30, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
favorable

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Patriat et Mmes Klès et Bourzai, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un vétérinaire peut suivre une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical.
La parole est à Mme Virginie Klès.

Cet amendement vise à autoriser les vétérinaires non pas à exercer les fonctions de biologiste médical – nous avons bien compris que, compte tenu de l’extension de l’examen de biologie médicale, cela n’était pas possible –, mais à suivre la formation de spécialisation en biologie médicale.
Pourquoi une telle demande ? Tout simplement parce que bactéries, virus, parasites et autres petites bestioles du genre ne se contentent pas de vérifier si l’individu qu’elles vont infester ou infecter est un animal ou un humain.
La santé animale et la santé humaine, notamment en matière d’infectiologie, sont extrêmement liées, aussi bien pour des raisons historiques et culturelles que par souci de cohérence de notre système sanitaire. Les maladies légalement réputées contagieuses, qui font appel tant aux compétences vétérinaires qu’aux compétences médicales, par exemple, font partie de notre environnement et de nos préoccupations de santé publique et de sécurité sanitaire.
Donc, la nécessité, me semble-t-il, pour les vétérinaires de pouvoir, une fois de plus, non pas exercer les fonctions de biologiste médical, mais suivre cette formation est sous-tendue par le fait qu’il faut impérativement que biologistes médicaux et vétérinaires formés en biologie médicale puissent continuer d’avoir les mêmes compétences, de parler le même langage, pour continuer leur travail quand ils sont sur des équipes pluridisciplinaires, pour continuer d’échanger dans les cadres des programmes de recherche, pour continuer à collaborer en matière de lutte contre le bioterrorisme, par exemple. Bref, pour de multiples raisons tenant, une fois de plus, au fait que les virus, les bactéries, tous les microbes de façon générale, l’immunologie, etc. sont vraiment des sciences qui sont communes en matière vétérinaire et en matière humaine.

La médicalisation de la biologie médicale en a exclu les vétérinaires. Cet amendement prévoit de leur ouvrir l’accès au DES à des fins de formation et de recherche uniquement.
Je crois comprendre que ceci pose des problèmes pratiques pour les études de médecine et l’organisation de l’internat. Je vous propose donc que nous nous en remettions à l’avis du Gouvernement. §
Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner que, lorsque nous avons à combattre des pathologies et à assurer la sécurité de nos concitoyens, l’origine animale ou humaine du virus, ou du microbe, ne change rien au fait qu’il est susceptible de se propager. Nous le voyons bien avec le débat sur l’antibiothérapie.
Pour autant, faut-il permettre à des étudiants vétérinaires de s’inscrire à une formation dans le cadre de l’internat en médecine ou en pharmacie ? Cela soulève plusieurs problèmes.
En premier lieu, une telle inscription reviendrait globalement à permettre à des étudiants vétérinaires d’accéder au statut d’interne sans suivre le deuxième cycle des études de médecine. Il s’agirait là d’une forme de rupture de l’égalité des études sans garantie que les étudiants vétérinaires aient l’ensemble des qualifications nécessaires pour accéder à ce niveau.
En second lieu, se poseraient également des problèmes en matière d’accès au stage, d’encadrement de la part des seniors et de financement général des études.
Ce que vous nous proposez revient en réalité à un véritable bouleversement des relations entre les professions médicales et paramédicales d’un côté, et vétérinaires de l’autre. Je suis donc amenée à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Néanmoins, le terme « bouleversement » ne me semble pas adapté. Il ne s’agit pas d’un bouleversement, compte tenu, d’abord, du nombre de vétérinaires qui seraient concernés, puisque depuis 2004 certains vétérinaires ont suivi cette filière, soit, chaque année, une dizaine de personnes, qui se sont d’ailleurs parfaitement intégrées dans le cursus.
Il me semble que, par voie de décret, tous les problèmes pratiques que vous soulevez pourraient sans difficulté être réglés. Le suivi de cette formation ne conduisant pas à l’exercice des fonctions de biologiste médical doit pouvoir trouver une appellation propre et permettant de reconnaître que la formation suivie a été un petit peu spécifique.
Quant à la coexistence des différentes professions, l’Institut Pasteur, dont la renommée est plus qu’internationale, offre aujourd’hui ce type de formation – bactériologique, virologique, immunologique – à des pharmaciens, des vétérinaires et des médecins sans que cela pose de problème.
Très sincèrement, compte tenu, je le répète, du nombre de personnes qui seraient concernées chaque année, de la culture et de l’histoire que vétérinaires, pharmaciens et médecins partagent en la matière, il me semble que tous les soucis d’ordre pratique peuvent être réglés par voie réglementaire, une fois encore, en affirmant la spécificité de la formation lorsqu’elle est suivie par un vétérinaire.
L'amendement n'est pas adopté.

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que la proposition de loi de M. Jacky Le Menn a été inscrite à l’ordre du jour par la conférence des présidents dans le cadre de l’espace réservé au groupe socialiste, c’est-à-dire pour une durée de quatre heures.
Il est vingt heures. Nous aurions pu poursuivre nos travaux jusqu’à vingt heures six. Néanmoins, pour la cohérence des débats, je vous propose d’entamer l’examen de l’article 7 le mardi 5 février, puisque, je vous le rappelle, le Gouvernement a inscrit la suite de l’examen de cette proposition de loi à l’ordre du jour de ce même mardi 5 février, à quatorze heures trente.
Dans ces conditions, à l’instar de ce que j’ai fait hier pour le texte présenté par le groupe du RDSE dans le cadre de son espace réservé, je vais lever la séance.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé ce jour le Sénat que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant :
- sur le II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 (schéma départemental de coopération intercommunale) (2013-303 QPC) ;
- et sur l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (établissement public de coopération intercommunale) (2013-304 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 février 2013 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales
Le texte des questions figure en annexe.

À quatorze heures trente :
2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l’établissement d’un bureau de l’IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (texte de la commission n° 301, 2012-2013).
3. Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (texte de la commission n° 305, 2012-2013).
4. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (texte de la commission n° 309, 2012-2013).
5. Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (texte de la commission n° 303, 2012-2013).
6. Projet de loi autorisant l’approbation de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (texte de la commission n° 307, 2012-2013).
7. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune (texte de la commission n° 312, 2012-2013).
8. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (texte de la commission n° 311, 2012-2013).
9. Suite de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale.
10. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création du contrat de génération (n° 289, 2012-2013) ;
Rapport de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 317, 2012-2013) ;
Texte de la commission (n° 318, 2012-2013).
De dix-huit heures trente à dix-neuf heures trente :
11. Débat, sous forme de questions-réponses, préalable à la réunion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013.
À vingt et une heures trente :
12. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création du contrat de génération.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures une.