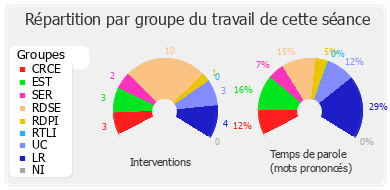Séance en hémicycle du 11 février 2013 à 16h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à seize heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le président, mon intervention se fonde sur l’article 29 de notre règlement.
Avec l’affaire Findus, nous avons assisté ce week-end à un véritable naufrage en matière de sécurité sanitaire et alimentaire. Comme pour la ministre de la santé, il ne fait absolument aucun doute pour moi que la santé du consommateur n’a jamais été menacée, à quelque moment que ce soit. Après tout, manger du cheval, pourquoi pas ? Cela étant dit, quand on connaît les contrôles minutieux et nombreux qu’exercent les services vétérinaires sur la moindre cantine rurale ou sur les abattoirs, on comprend que l’on devrait tout de même essayer de rapprocher tant soit peu les lieux de consommation de la viande de ses lieux de production ! Disant cela, je m’empresse de préciser qu’il n’est nullement dans mes intentions de revêtir la marinière d’Arnaud Montebourg !
Sourires.

Pour autant, le sujet n’est pas celui-là : je souhaiterais, monsieur le président, que la prochaine conférence des présidents inscrive à l’ordre du jour du Sénat un débat sur la sécurité alimentaire et, surtout, qu’une commission d’enquête soit constituée sur ce sujet. Je suis certaine non seulement que cela intéresserait beaucoup nos collègues membres de la commission des affaires européennes, de la commission des affaires économiques ainsi que du groupe d’études de l’élevage et, plus généralement, l’ensemble des sénatrices et des sénateurs, mais encore que les nombreux consommateurs non végétariens seraient eux aussi très heureux que le Sénat se penche sur cette question !

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du vendredi 8 février 2013, une décision du Conseil sur quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 (n° 2012-293, 2012-294, 2012-295 et 2012-296 QPC).
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (projet n° 260, résultat des travaux de la commission n° 339, rapport n° 338 et avis n° 334).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous présenter ce projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.
Ce texte, qui comporte vingt-cinq articles, n’a pas, malgré les apparences, qu’une dimension technique ; il a une vraie ambition politique. Il a en effet pour objet de renforcer la prise en compte du développement durable, la lutte contre les risques écologiques et la protection des salariés. Pour cela, il prévoit de nombreuses mesures concernant différents modes de transport, ferroviaire, routier, fluvial et maritime.
Ce projet de loi inscrit les transports dans une perspective de mobilité durable. Sa disposition majeure, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, concerne la mise en œuvre effective de l’écotaxe poids lourds.
Il s’agit non pas de la taxe en elle-même, qui a déjà été votée dans de précédentes lois de finances, mais bien du mécanisme permettant demain aux entreprises de transports routiers de majorer le prix du transport pour prendre en compte l’écotaxe et la répercuter sur leurs clients, les chargeurs.
Il est nécessaire d’en revenir aux fondements de l’écotaxe pour bien comprendre cette disposition.
Cette mesure, issue du Grenelle de l’environnement et votée en 2009 à l’unanimité par le Parlement, devait initialement être mise en œuvre en 2011. Elle concerne les poids lourds empruntant le réseau routier non payant. Il s’agit d’une fiscalité écologique, dès lors que son barème dépend de la taille et de la performance environnementale du véhicule.
Alors que nos prédécesseurs avaient posé les principes de cette écotaxe poids lourds, sa mise en œuvre pratique en incombe à l’actuel gouvernement, et j’en assume pleinement la responsabilité.
Vous le savez, l’écotaxe poids lourds a un triple objectif : d’abord, réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises par l’établissement d’un véritable « signal prix » à destination des chargeurs ; ensuite, rationaliser, à terme, le transport routier sur les moyennes et courtes distances en incitant à ne pas faire rouler des camions vides ; enfin, financer les nouvelles infrastructures nécessaires à la politique de développement intermodal des transports, étant précisé que le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, sera alimenté par les recettes issues de l’écotaxe poids lourds.
Le premier de ces objectifs est essentiel : l’écotaxe poids lourds n’est pertinente que si elle est équilibrée. Il s’agit non pas d’une taxe de plus pour renflouer le budget de l’État, mais bien d’un instrument pour inciter au rééquilibrage modal nécessaire à la rationalisation des déplacements routiers.
L’impératif de répercussion de l’écotaxe a été identifié dès le début de la réflexion, dès ma prise de fonctions. En effet, les entreprises de transports routiers de marchandises, dont les marges sont déjà extrêmement faibles, ne peuvent supporter de charges nouvelles sans garantie de pouvoir les répercuter sur leurs clients.
La difficulté dans laquelle se trouvent ces entreprises est réelle. Elles ont connu en 2012 un repli substantiel de leur activité – une baisse près de 10 % en tonnes-kilomètres sur les trois premiers trimestres de 2012 par rapport à la même période de 2011. Il était injuste socialement et dangereux économiquement de faire peser l’écotaxe sur les seuls transporteurs routiers, qui constituent un secteur important de notre économie et grâce auxquels l’ensemble de notre territoire est irrigué.
Le précédent gouvernement avait laissé un dispositif complexe et difficile à mettre en œuvre pour répercuter sur les chargeurs la taxe supportée par les transporteurs, dispositif prévu par un décret publié le 6 mai 2012, jour du second tour de l’élection présidentielle…
Ce dispositif, dans le détail duquel je n’entrerai pas, rencontrait l’hostilité unanime de la profession. Il s’agissait d’un mécanisme compliqué, coûteux pour les entreprises, lesquelles n’avaient pas besoin, en cette période difficile, de voir leur activité ainsi pénalisée.
Précisément, et j’aurai à cœur de vous le démontrer, le Gouvernement a pour préoccupation de ne pas rendre plus difficile leur situation.
J’ai alors échangé avec les professionnels du secteur sur ce sujet, et l’ensemble des organisations professionnelles sont convenues qu’il fallait revoir totalement les modalités de répercussion de cette taxe.
À la place du dispositif complexe dont j’ai parlé, le présent projet de loi prévoit la majoration du prix des prestations de transport par l’application de taux établis en fonction des régions de chargement ou de déchargement.
Ce mécanisme est plus simple et permet d’inciter au report sur des modes de transport plus durables par l’établissement d’un véritable signal prix à destination des chargeurs.
Ces taux seront fixés par arrêté et seront révisables en tant que de besoin. Ils incluent les frais de gestion supportés par les entreprises de transports routiers de marchandises. C’était une préoccupation des professionnels du secteur.
La recherche de la simplicité est un impératif pour permettre à tous, transporteurs et chargeurs, d’intégrer la taxe et son fonctionnement dans les meilleures conditions.
L’adoption rapide de ces dispositions est une nécessité pour permettre aux chargeurs et aux transporteurs de se préparer à la mise en œuvre effective de l’écotaxe poids lourds. C’est cette urgence qui justifie la procédure accélérée retenue pour l’examen de ce projet de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez le profond respect que j’ai pour le travail parlementaire et l’importance que j’y attache.
J’ai engagé une concertation et ai travaillé en veillant à rechercher un équilibre, dans un secteur où les rapports de force dans les négociations commerciales ne sont pas toujours équilibrés.
Le Gouvernement tient à honorer ses engagements en matière d’environnement et de report modal, mais tient également à soutenir le secteur des transports routiers dans ces mutations.
Je compte donc sur le Sénat, sur vous, mesdames, messieurs les sénateurs, pour permettre l’adoption de cette mesure.
Par ailleurs, le projet de loi comporte d’autres dispositions importantes en faveur du développement durable.
Tout d’abord, il contient des dispositions en matière de transport fluvial destinées à réduire les risques pour l’environnement et pour la sécurité de la navigation.
L’article 12 permet notamment de simplifier la procédure applicable au déplacement d’office des bateaux fluviaux qui stationneraient sur les voies d’eau en méconnaissance du règlement général de police de la navigation intérieure ou qui compromettraient la sécurité des usagers du domaine public fluvial. Il s’agit de vrais problèmes pour les collectivités locales qui ont des ports fluviaux, et cette mesure leur donnera les moyens et les outils pour intervenir.
Ce texte contient également des dispositions relatives à la sécurité maritime et à la lutte contre les risques écologiques.
Ainsi, ce projet de loi permet de réduire les risques pour l’environnement et la gêne à l’exploitation des ports occasionnés par la présence de navires de commerce abandonnés. L’article 15 simplifie les règles actuelles relatives à l’intervention des pouvoirs publics sur ces navires abandonnés de manière à accroître son efficacité.
Le texte améliore le cadre juridique de la procédure de déchéance des droits de propriété sur des bâtiments que leurs propriétaires jugent plus rentable d’abandonner que de réparer ou de désarmer.
L’article 16 clarifie et actualise le régime de responsabilité civile en cas de pollution marine par des hydrocarbures en le rendant totalement conforme à nos engagements internationaux.
Lors des précédentes marées noires, notamment lors de celle de l’Erika, en 1999, les tribunaux de commerce ont appliqué le régime général de responsabilité issu de la convention de l’Organisation maritime internationale de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, dite « convention LLMC », mais je vous épargne le développement du sigle en anglais.
Puisque vous insistez, il s’agit de la Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims.
Sourires.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. C’est bien la première fois qu’un parlementaire exige d’un membre du Gouvernement qu’il s’exprime en anglais !
Sourires
Je crois me souvenir qu’une certaine ordonnance plusieurs fois centenaire nous l’interdit…
Nouveaux sourires.
Or, plus sérieusement, mesdames, messieurs les sénateurs, ce régime général ne prend pas en compte les dispositions spécifiques de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite « convention CLC », qui, elles, sont plus protectrices des intérêts des victimes.
Cet article insère donc explicitement dans le code des transports le principe de la responsabilité du propriétaire du navire en cas de marée noire, dans les conditions fixées par la convention CLC de 1992.
Enfin, l’article 20 renforce le cadre juridique permettant la protection de la sécurité maritime.
Cet article prévoit que les visites et inspections à bord des navires par les agents de l’État s’exercent à toute heure. Il accroît également le montant des amendes réprimant les infractions aux règles fondamentales de la sécurité maritime, montant insuffisamment dissuasif à ce jour. Il s’agit notamment de prévenir les abordages en mer et d’assurer le respect des ordres des autorités maritimes.
Enfin, ce projet de loi se veut socialement protecteur, avec une disposition majeure qui assure des conditions de concurrence équitables entre entreprises maritimes opérant sur une même ligne ou sur un même secteur d’activité.
L’article 23 élargit ainsi le champ d’application des règles de l’État d’accueil s’appliquant aux entreprises maritimes qui pratiquent le cabotage, tel qu’il est défini dans la réglementation de l’Union européenne, ainsi qu’à celles qui assurent une prestation de service dans les eaux intérieures et territoriales.
L’objectif est d’affirmer que, si la concurrence est normale lorsque les marchés sont ouverts, et c’est précisément le cas, celle-ci ne peut se faire à n’importe quelle condition, notamment en matière sociale.
Ce texte est construit autour de quatre axes favorisant l’unicité du régime de l’État d’accueil : un champ d’application, avec la définition des activités et des navires concernés ; les dispositions qui devront être appliquées au titre de l’État d’accueil – les membres de l’équipage qui sont concernés, les droits des salariés, leur protection sociale – ; les documents obligatoires à présenter au contrôle ; les sanctions pénales dont l’armateur est passible en cas de non-respect de ces obligations.
Il s’agit d’éviter que des navires battant pavillon étranger ne viennent opérer des lignes nationales à des conditions sociales inacceptables et moyennant une concurrence déloyale.
Vous le constatez, l’objectif de ce projet de loi est de simplifier un certain nombre de dispositifs, de les rendre opposables, y compris dans le transport routier. Il s’agit d’instituer des dispositifs juridiques efficaces, susceptibles de prévenir des facteurs de risque pour la sécurité fluviale ou maritime, et de favoriser la protection de l’environnement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte répond aux définitions du développement durable d’un triple point de vue économique, écologique et social. Nous avons à cœur de rendre opposables un certain nombre de dispositions et, au moins, de rendre plus acceptables les conditions de la concurrence.
Ce projet de loi est complet. Il comporte des dispositions concrètes et efficaces. Il s’inspire de la réalité, notamment des difficultés ou des préoccupations des agents économiques dans le transport, difficultés auxquelles nous souhaitons avec ce texte législatif apporter une réponse de qualité.
En conclusion, je tiens d’ores et déjà, mais je recommencerai sans doute après le vote, à remercier le rapporteur pour la qualité de ses travaux, ainsi que l’ensemble des sénateurs qui se sont impliqués dans la préparation de ce texte.
Certes, le projet de loi peut, sous certains aspects, paraître très technique, mais il n’a pour autant d’autre objet que de simplifier les dispositions en vigueur. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons été guidés par un souci d’efficacité et mus par la volonté d’apporter davantage de sécurité juridique mais aussi davantage de sécurité économique à l’ensemble des acteurs du transport.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, il me revient de vous présenter les travaux et les conclusions de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, qui a examiné ce texte mercredi dernier.
La commission est parvenue à un résultat paradoxal qui l’a surprise elle-même : une abstention générale ! Pour une première comme rapporteur d’un texte de loi, j’avoue avoir goûté mon plaisir...
Chacun des présents s’étant abstenu, le résultat a été mécanique : la rédaction issue des travaux de la commission n’a pas été adoptée et nous débattons aujourd’hui du texte initial du Gouvernement, assorti des amendements que la commission vient d’examiner ; je rendrai compte de ses avis dans le cours de la discussion.
Pourquoi ce résultat de nos travaux est-il paradoxal ? Mais parce que, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venions tout juste de dire, toutes tendances confondues, que nous pensions le plus grand bien de ce texte ! Nous venions d’approuver chacun de ses vingt-cinq articles, avec trente-trois amendements, dont les vingt-huit que j’avais présentés !
Si nous avions réservé un si bon accueil à ces diverses dispositions, notamment à l’écotaxe poids lourds, c’est parce que nous connaissions leur importance - elles seront utiles pour que nos transports soient plus propres et plus efficaces -, et parce que nous étions tous d’accord sur le fait que, pour avoir une chance d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, nous devions mettre les bouchées doubles et rendre ses orientations opérationnelles au quotidien !
Ce texte ne se limite pas à proposer une réforme maritime que les gens de mer attendent depuis longtemps ; il ne s’arrête pas à des mesures de bon sens pour ce qui est des navires abandonnés ou des péniches qui gênent la circulation fluviale. Non, le principal objet de ce texte, qui peut justifier l’engagement de la procédure accélérée, c’est la majoration du prix du transport routier pour accompagner l’écotaxe poids lourds, ou plutôt, devrais-je dire, pour la rendre possible.
Si certains imaginent qu’il suffit de décréter une taxe sans tenir compte de la situation des transporteurs ou de la fragilité du secteur, s’ils pensent que l’écotaxe peut être appliquée sans que soit prise en compte l’inégalité entre camionneurs et donneurs d’ordre, je leur conseille volontiers d’aller examiner la situation d’un peu plus près et d’en profiter pour assister à une négociation dans la profession. Je peux leur garantir qu’ils ne seront pas déçus !
Notre commission avait donc réservé le meilleur accueil à ce texte, car elle en avait compris l’importance. Cependant, elle ne l’a pas adopté, du fait de cette abstention générale dont j’ai parlé. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation inattendue ?
Le rapporteur n’a pas à expliquer la position de l’opposition sénatoriale, …

… qui était majoritaire au sein de la commission la semaine dernière. Mais, pour ce qui concerne la majorité sénatoriale, les choses ont été très claires : lorsque l’opposition a adopté des amendements tendant à exempter d’écotaxe telle catégorie d’usagers ou telle catégorie de transporteurs, nous avons mis le holà ! Moi-même, en ma qualité de rapporteur, je me suis abstenu.
M. le ministre vient de le rappeler, l’objet de l’article 7 est de protéger les transporteurs routiers, pas de remettre en cause l’écotaxe poids lourds ! Une fois les exemptions votées, le groupe socialiste et le groupe CRC se sont abstenus, car le texte nous est alors apparu trop éloigné de ses bases : il était pour nous, en un mot, dénaturé.
Pour nous, les exemptions de l’écotaxe poids lourds menaceraient cette première grande disposition de la fiscalité écologique, souhaitée par le Grenelle de l’environnement et votée sous la précédente majorité, car il faut rendre à César ce qui est à César...
L’exemption de telle catégorie d’usagers reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, menaçant la finalité ultime de l’écotaxe : faire que le transport routier finance davantage les infrastructures routières. Tout le monde sait que l’usager de la route doit contribuer davantage à l’entretien des infrastructures routières ; c’est nécessaire ne serait-ce que pour rétablir une concurrence plus saine et plus équilibrée avec le transport ferroviaire qui, lui, participe au financement du réseau ferré.
Voilà pour l’issue des travaux de notre commission. Vous me pardonnerez d’insister : nous n’avons pas rejeté le texte du Gouvernement, nous nous sommes contentés de nous abstenir sur la rédaction à laquelle nous étions parvenus... La nuance, en l’occurrence, est de taille !
Sur le texte lui-même, maintenant, quels ont été les travaux de la commission ? Je vous les présente sommairement, par grand thème, en réservant non pas le meilleur, mais le plus délicat pour la fin.
Tout d’abord, les dispositions ferroviaires, figurant aux articles 1er à 4, sont de nature technique et n’empiètent pas sur la grande réforme ferroviaire que vous avez annoncée pour cette année, monsieur le ministre. Votre commission y a vu des mesures d’efficacité tout à fait bienvenues et elle m’a suivi pour renforcer la transparence des comptes de la SNCF envers les régions, …

… pour les lignes ferroviaires régionales ; c’est l’objet d’un amendement que je vous présenterai lors de la discussion des articles. Il s’agit d’une revendication ancienne des régions qui ne souhaitent pas être de simples guichets et qui veulent savoir ce qu’elles paient et pourquoi elles le paient. Je ne peux que les approuver.
Ensuite, avec les dispositions relatives au transport maritime, nous sommes en présence d’une véritable réforme : mon rapport en fait état et M. le ministre vient de le souligner. Il s’agit de solutions pratiques destinées à régler enfin des problèmes identifiés de longue date : c’est le cas avec les navires abandonnés dans les ports maritimes. Le sujet est important et récurrent : des navires passent des mois, et même des années dans nos ports maritimes, abandonnés par leurs propriétaires – des armateurs peu scrupuleux –, souvent avec leur équipage à qui l’on doit des arriérés de salaires. Ces navires sont abandonnés, mais les autorités publiques tergiversent, chacune attendant que l’autre prenne l’initiative et débloque les fonds nécessaires à la mise en œuvre des procédures.
Dans ce genre de situation, l’action publique devient elle-même une source de retard. L’article 15 accélère donc la déchéance de propriété et identifie clairement les responsabilités ainsi que la répartition des charges entre autorités publiques. Ces nouvelles règles, nécessaires, pour ne pas dire urgentes, sont très attendues dans les ports maritimes : la commission leur a donc réservé le meilleur accueil.
Autre élément de la réforme maritime : l’application des grands principes de notre droit social aux navires qui viennent travailler dans nos eaux intérieures et territoriales.
Les gens de mer subissent la concurrence déloyale de navires immatriculés sous pavillons d’États européens, mais qui emploient des marins à des conditions de pays pauvres. C’est le quotidien de nos ports maritimes : sur des navires battant pavillon d’États européens, en particulier des ferries, des marins travaillent aux conditions dites internationales, c’est-à-dire pour 520 dollars par mois, quasiment sans protection sociale ! Cette situation est possible parce que les règles européennes ne l’interdisent pas formellement.
Nos marins paient le défaut d’harmonisation européenne : faute de pavillon européen, les États définissent librement leur pavillon national, y compris les États qui n’ont aucune côte maritime, avec des règles sociales qu’ils refusent évidemment sur leur territoire terrestre.
Notre collègue Évelyne Didier nous avait saisis de cette situation l’an passé, avec une proposition de loi de son groupe qui n’était finalement pas venue en séance. Nous reprenons aujourd’hui les idées qui avaient alors été présentées.
Avec l’article 23, je crois pouvoir le dire, monsieur le ministre, le Gouvernement va aussi loin que les règles européennes l’y autorisent pour protéger l’emploi marin français face à cette concurrence déloyale.
Les « conditions de l’État d’accueil », c’est-à-dire les règles sociales et de sécurité que la France peut imposer aux navires étrangers qui viennent travailler chez nous, sont étendues à tous les navires « utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service ». Cette notion très large de « service » englobe les travaux portuaires et en mer, par exemple l’installation d’éoliennes et les activités à caractère commercial. La commission considère qu’il s’agit d’un grand progrès.
Enfin, troisième mesure complémentaire, l’article 20 du projet de loi renforce le contrôle maritime, avec l’instauration d’une nouvelle enquête nautique de nature administrative, plus facile à mobiliser que l’enquête judiciaire, et d’amendes d’un montant plus élevé pour sanctionner les infractions aux règles sociales et de sécurité.
La commission a donc réservé le meilleur accueil à cette réforme maritime ; elle a même souhaité l’améliorer en présentant dix amendements, dont un du groupe CRC.
Elle a reçu pareillement les trois articles, plus ponctuels, portant sur le fluvial et l’article de précision relatif aux vols d’hélicoptères de secours au-dessus des agglomérations.
La parfaite concorde, heureux prolongement du consensus obtenu lors du Grenelle, a cependant disparu lors de l’examen du volet « transports routiers » de ce texte, à l’article 7. Nous en parlerons longuement. M. le ministre vient de nous rappeler la genèse de l’écotaxe poids lourds, son importance décisive pour rationaliser le transport routier, inciter au report modal, en un mot pour mettre enfin notre pays sur la trajectoire du Grenelle de l’environnement.
Alors que les « gros émetteurs de CO2 » que sont le secteur du BTP, l’industrie ou le logement voient leur empreinte carbone diminuer année après année, le secteur des transports en général, quant à lui, continue de produire toujours plus d’émissions polluantes. Les véhicules ont fait des progrès, les normes « Euro » et la hausse du prix de l’essence apportent leur pierre à l’édifice, mais le bilan carbone des transports se dégrade : d’une part, les déplacements continuent de s’intensifier – et la tendance va se poursuivre –, d’autre part, il n’y a pas assez de report modal, la route continuant de gagner des parts dans le transport de marchandises par rapport au ferroviaire, dont la part est passée de 15 % ou 16 % à moins de 10 % aujourd’hui, malgré la libéralisation du fret ferroviaire. On le voit, l’ouverture à la concurrence n’est pas la panacée, en matière tant de transport de marchandises que de transport de personnes.
Comment faire, dans ces conditions, sinon prendre des mesures suffisamment fortes pour faire changer nos comportements ? L’écotaxe poids lourds est l’une de ces mesures ; c’était même la mesure phare de la majorité d’hier en termes de fiscalité écologique. L’écotaxe est un levier pour le report modal : c’est grâce à elle que le transport routier financera davantage la route, comme le train finance le rail. Quel parcours, cependant, pour la mettre en œuvre ! Quels retards, liés aux procédures choisies, en particulier le partenariat public-privé ! Et c’est précisément quand il faut mettre en œuvre des politiques que l’on mesure la détermination de ceux qui les ont décidées.
En l’occurrence, et je le dis sans esprit polémique, la méthode de mise en œuvre imaginée par le gouvernement précédent, qui figure dans le décret du 4 mai 2012, n’était pas viable, pour une raison très simple : elle visait, certes, à ce que la taxe payée par le transporteur pour un trajet soit répercutée sur le chargeur, mais c’était sans compter avec la réalité même du transport routier, avec le fait que le transporteur n’aurait pas su calculer, pour chaque client, la part de taxe payée dont celui-ci eût été redevable. Cette analyse a été partagée par tous au sein de la commission.
Mes chers collègues, je voudrais, comme l’a fait M. le ministre, en revenir aux fondamentaux : en choisissant l’écotaxe poids lourds, le Grenelle a aussi décidé que la charge de cette taxe ne devrait pas peser sur les transporteurs routiers, sauf à les tuer, du moins les plus fragiles d’entre eux. Nous ne voulons pas revenir sur le principe de la taxe : ce serait renoncer aux objectifs du Grenelle ! Ce que nous voulons, c’est protéger les transporteurs routiers au moment où la collectivité décide que le transport routier devra contribuer davantage à la transition écologique. Tel est bien l’objet de l’article 7 du projet de loi ; c’est même son seul objet : ne pas augmenter les charges des transporteurs, tout faire pour que l’écotaxe ne rogne pas leurs marges, qui sont déjà très faibles, puisqu’elles ne dépassent pas 1 % ou 2 % dans la plupart des cas.
Puisque la répercussion au réel, camion par camion, client par client, trajet par trajet, n’est pas possible, alors même que chaque transporteur paiera la taxe au réel pour les trajets qu’il effectuera sur le réseau taxable, comment assurer que cette taxe n’alourdira pas les charges des transporteurs ?
L’article 7 présente une solution, qui comporte des avantages et des inconvénients ; nous allons en débattre. Son principe est le suivant : le lien entre la taxe payée effectivement et les charges des transporteurs est établi à l’échelle de la région et annualisé ; il détermine un forfait que le transporteur applique à ses clients, pour majorer sa prestation de transport quel que soit l’itinéraire qu’il emprunte, sur le réseau taxable ou sur le réseau libre. Comment, concrètement, est calculé le taux de majoration forfaitaire ? Il procède de l’usage même du réseau taxable : dans les régions où le réseau est dense et beaucoup utilisé, comme, hélas ou peut-être heureusement, c’est le cas en Alsace, il sera élevé ; dans une région comme la Corse, où il n’y a pas de réseau taxable, aucune majoration ne sera appliquée.
Il faut surtout bien comprendre que la répercussion au réel n’est pas viable pour le transporteur : avec un tel système, dont je n’évoque même pas les difficultés techniques, celui-ci serait laissé seul dans sa relation inégale avec son donneur d’ordres, le chargeur.
J’insiste sur ce point, parce que cette majoration forfaitaire du prix du transport, obligatoire, inscrite dans la loi, est une condition pour que l’écotaxe poids lourds soit acceptée, pour qu’elle devienne effective. L’instauration d’une taxe n’est jamais une bonne nouvelle pour ceux qui doivent l’acquitter : l’usage des routes est gratuit, il devient payant pour les poids lourds sur la partie la plus dense du réseau ; on comprend que tous ceux qui recourent à des poids lourds s’inquiètent ! Mais c’est un choix de société, objet de consensus politique, et, aujourd’hui, nous tentons d’aménager les modalités les plus justes, les plus acceptables pour que les professionnels de la route, les transporteurs routiers ne subissent pas cette taxe. Voilà pourquoi je crois que, quand la répercussion au réel est impossible, quand la seule régulation par le marché ferait que, dans les faits, le transporteur devrait assumer la taxe, la majoration obligatoire et légale est la meilleure des solutions ou, si vous préférez, la moins mauvaise d’entre elles !
Ensuite, dès lors que le calcul est matériellement impossible à établir trajet par trajet pour garantir le lien entre la taxe et les charges du transporteur, la majoration forfaitaire, calculée à l’échelon régional ou national, est la moins mauvaise des solutions.
Mes chers collègues, le ministère des transports, en lien avec celui des finances, travaille sur le sujet depuis cinq ans. Les alternatives ont été examinées, les éléments, ô combien techniques, ont été transmis aux ministres successifs. Il nous revient de faire des choix, et notre choix d’aujourd’hui porte sur la façon dont nous pouvons protéger les transporteurs routiers d’une taxe que nous jugeons nécessaire de faire porter sur l’usage de la route.
C’est, me semble-t-il, ce qui n’a pas été bien perçu en commission, la semaine dernière. Nous avons été tous d’accord pour améliorer ce mécanisme de majoration forfaitaire ; nous avons souhaité en particulier, sur ma proposition, que le ministère en évalue très précisément le fonctionnement et que le ministre revienne devant le Parlement dans un an pour en débattre. Nous avons souhaité préciser les choses pour les contrats de location de véhicules avec chauffeur.
En revanche, nous nous sommes opposés lorsqu’une partie de la commission, qui était majoritaire, a voulu revenir sur la taxe elle-même, pour en exonérer telle ou telle activité de transport. Mes chers collègues, nous prendrions un gros risque en ouvrant une telle boîte de Pandore ! Ces exonérations, outre qu’elles sont très importantes, seraient immanquablement suivies d’autres demandes d’exonérations, alors que l’intégralité des recettes de l’écotaxe prévues est nécessaire à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. Ensuite, n’oublions pas que nous agissons dans le cadre d’une directive européenne, la directive Eurovignette, qui proscrit les distinctions entre les domaines d’activités du transport : le tarif est kilométrique et les réductions ne sont possibles que dans des cas énumérés par la directive, par exemple selon le caractère périphérique des territoires ou, bien sûr, le niveau écologique des véhicules.
Mes chers collègues, j’ai voulu, dès le début de notre discussion, rapporter les grands arguments échangés au sein de notre commission. Je sais que nous allons largement débattre. Hors cet article 7 qui nous a divisés, nous avons réservé un bon accueil aux six autres articles du texte relatifs aux transports routiers, en exprimant cependant un bémol et de fortes demandes de précision sur l’article 5, traitant de la nouvelle procédure de déclassement et reclassement d’office de routes nationales dans la voirie départementale et communale. Monsieur le ministre, vous serez interrogé sur ce point.
Vous l’aurez compris, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très favorable à ce texte que la commission n’a pas rejeté, mais qu’elle a laissé intact pour son examen en séance. Je n’en demeure pas moins attaché aux améliorations que j’ai suggérées. C’est pourquoi je vous proposerai d’adopter les vingt-huit amendements que j’avais déposés mercredi dernier en commission, que mon groupe a repris et qui ont recueilli tout à l’heure l’approbation de la commission. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 7 du projet de loi que nous examinons à partir d’aujourd’hui organise la répercussion de l’écotaxe poids lourds. La disposition, je tiens à le préciser, n’est pas fiscale, puisqu’elle ne porte pas sur le taux, l’assiette ou les modalités de recouvrement de l’écotaxe. D’ailleurs, monsieur le ministre, comme vous l’avez indiqué lors de votre audition devant la commission du développement durable, l’objet de cet article n’est pas l’écotaxe poids lourds en tant que telle.
La commission des finances a toutefois fait le choix de se saisir pour avis du texte, pour deux raisons.
Tout d’abord, la « répercussion » est un élément structurant de l’écotaxe. Elle permet de facturer au donneur d’ordres la taxe payée par le transporteur. Autrement dit, celui qui paye in fine la taxe est le vrai bénéficiaire de la route. La répercussion, c’est la traduction du principe « utilisateur-payeur » ou « pollueur-payeur ». Sans la répercussion, il n’y a pas de fiscalité écologique.
La seconde raison de la saisine de la commission des finances, c’est l’entrée en vigueur imminente de l’écotaxe, officiellement le 20 juillet 2013.
Voilà près de deux ans, nous avions organisé une table ronde sur la mise en place de l’écotaxe. Elle nous avait permis de prendre la mesure du défi technologique auquel nous faisons face. Le lancement de l’écotaxe est un chantier d’envergure et nous avons voulu faire le point, au travers de l’examen de ce projet de loi, sur son avancement.
Avant toute chose, je voudrais rappeler que la mise en place de l’écotaxe est la traduction d’un engagement du Grenelle de l’environnement. Son principe avait d’ailleurs été inscrit dans la loi de programmation « Grenelle 1 », que nous avions adoptée à l’unanimité du Parlement, moins cinq abstentions.
D’un point de vue normatif, cette taxe a été établie par l’article 153 de la loi de finances pour 2009. Elle a quatre objets.
À l’instar des péages autoroutiers, qui représentent le coût d’utilisation de l’infrastructure, son premier objet est de couvrir les coûts d’usage, par les poids lourds, du réseau routier non concédé.
Son deuxième objet – celui de la répercussion – est de réduire l’impact environnemental du transport routier, principalement par diminution de la demande.
Ses troisième et quatrième objets sont de dégager de nouvelles ressources pour développer le transport intermodal et financer de nouvelles infrastructures. C’est pourquoi l’écotaxe est principalement affectée à l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France.
Par rapport au calendrier initialement envisagé, nous constatons près de deux ans de retard. Ce n’est nullement le fait d’une volonté politique, puisque le précédent gouvernement était favorable à cette taxe véritablement écologique, tout comme l’est celui qui est actuellement en fonction.
En revanche, les défis technologiques liés à son recouvrement sont impressionnants. Selon les estimations du ministère de l’écologie, près de 800 000 poids lourds, dont 550 000 français et 250 000 étrangers, seront concernés par la taxe. Il faudra suivre leurs trajets sur les quelque 15 000 kilomètres du réseau taxable, lui-même décomposé en 4 100 sections de tarification.
Pour faire face à cette tâche titanesque, la seule solution était de s’appuyer sur un système de recouvrement automatisé, en utilisant la géolocalisation. Chaque poids lourd devra ainsi posséder un équipement électronique embarqué qui, grâce au repérage par satellite, permettra de liquider automatiquement l’écotaxe auprès du transporteur.
En 2009, devant l’ampleur et la complexité technique du système de recouvrement, l’État a fait le choix de confier à un partenaire privé le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des biens composant ce dispositif. C’est la société italienne Autostrade per l’Italia qui a remporté l’appel d’offres, au début de 2011. Elle a ensuite constitué le consortium Ecomouv’ avec SFR, la SNCF, Thalès et Steria. Chacun des membres du consortium est responsable d’une partie spécifique du système de recouvrement. L’ensemble du dispositif reviendra à l’État après onze années et demie d’exploitation.
J’ajoute que le partenaire privé est également chargé d’assurer la formation des agents de l’État et l’information des redevables. Il doit aussi permettre à ces derniers de pouvoir se doter, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, sur n’importe quel point du territoire, d’un équipement embarqué.
Toutefois, l’État n’a pas abandonné toutes ses prérogatives de puissance publique. En 2008, le Conseil d’État avait d’ailleurs indiqué au Gouvernement que, s’agissant du recouvrement d’une taxe, il était possible de recourir à un prestataire privé à la condition d’encadrer strictement ses missions.
Selon les termes de la loi de finances pour 2009, le prestataire privé a donc reçu une commission de la part de l’État : c’est un commis de l’État, auquel il ne peut se substituer dans l’exercice de missions régaliennes.
Très concrètement, la taxe est recouvrée sous la responsabilité de la direction générale des douanes. Un service dédié, composé de quelque 130 agents, a été créé et installé à Metz. Il est chargé de l’audit et du contrôle du prestataire privé. En un mot, il doit s’assurer de la fiabilité à tout moment du dispositif, s’agissant non seulement de la juste liquidation de la taxe auprès des redevables, mais aussi du bon reversement à l’État des sommes collectées.
C’est également à ce service que revient la responsabilité de sanctionner les manquements. Seule la douane détiendra la force publique en matière de recouvrement de l’écotaxe poids lourds. C’est aussi la douane qui sera en première ligne, sur le terrain, pour procéder au contrôle des poids lourds, en complément d’un important dispositif automatisé de contrôle installé tout au long du réseau taxable.
Ce dispositif, complexe, techniquement très élaboré, sera-t-il prêt à fonctionner aux dates d’entrée en vigueur de la taxe alsacienne, le 20 avril, et de l’écotaxe nationale, le 20 juillet ?
Je m’arrêterai un instant sur la taxe alsacienne, dont je n’ai pas encore parlé. La taxe poids lourds alsacienne, la TPLA, résulte d’une initiative de notre ancien collègue député Yves Bur, datant de 2006 et visant à mettre fin au report de trafic sur les routes alsaciennes induit par la mise en œuvre d’une écotaxe sur les autoroutes allemandes. Équivalente à la taxe allemande, la TPLA a une vocation expérimentale et doit être remplacée par l’écotaxe dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
Officiellement, la TPLA doit voir le jour le 20 avril 2013. Toutefois, à la lumière des auditions que j’ai pu conduire, il m’est apparu que cette taxe n’avait plus grand sens, trois mois avant l’entrée en vigueur de l’écotaxe nationale.
Il faut avant tout rester pragmatique. Ecomouv’ est en pleine phase de tests de tous les équipements composant le dispositif. Cette période est cruciale et doit être conduite avec minutie : en matière de systèmes d’information, la précipitation est souvent contre-productive. Dans ces conditions, respecter à tout prix l’échéance du 20 avril 2013 risque d’être très difficile, voire quasiment impossible. §
Enfin, les transporteurs ne savent pas, a priori, lesquels de leurs véhicules seront amenés à traverser l’Alsace… Tous les transporteurs devront donc équiper une part significative de leur flotte. Pour eux, expérimentation alsacienne et instauration de la taxe nationale reviennent en définitive au même, ce qui n’était pas du tout l’objectif visé.
Pour l’ensemble de ces raisons, il me semblerait plus sage d’abandonner la taxe alsacienne au profit d’une expérimentation nationale « à blanc », c’est-à-dire sans perception de la taxe. Une telle expérimentation serait nettement plus utile pour roder le système et éviter un pic logistique le jour du lancement. Elle pourrait débuter, par exemple, au mois de juin.
Monsieur le ministre, la commission des finances a néanmoins fait le choix de ne pas proposer, juridiquement, la suppression de la taxe alsacienne.
Tout d’abord, nous avons tenu à respecter l’intention originelle sous-tendant le présent texte, et partant à ne pas y inclure de dispositions fiscales, afin de ne pas refaire le débat sur l’écotaxe.
Surtout, il nous a semblé préférable de laisser au Gouvernement de la souplesse dans la gestion du contrat de partenariat.
L’abandon de la taxe alsacienne au profit d’une expérimentation « à blanc » à l’échelon national doit pouvoir s’opérer dans la relation contractuelle.
Un élément supplémentaire plaide en faveur d’un abandon de la taxe alsacienne : la mise en œuvre de la taxe nationale devrait elle-même faire l’objet d’un report de quelques semaines.
Lors de votre audition devant la commission du développement durable, vous avez été très prudent sur cette question, monsieur le ministre, et je le comprends. Nous avons bien compris qu’aucune décision n’a été prise et que vous trancherez à l’issue du comité de pilotage du projet qui aura lieu dans les prochains jours. §
Nous avons cependant compris – et les auditions auxquelles j’ai procédé me l’ont confirmé – qu’une mise en service au 20 juillet 2013 ne serait peut-être pas optimale.
Tout d’abord, comme je viens de l’indiquer, les phases de test du système doivent être conduites avec la plus grande précaution. Vous souhaitez que ne soit lancé qu’un système techniquement sûr, et nous vous rejoignons sur ce point : la fiabilité du recouvrement ne doit pas souffrir la moindre suspicion.
Les professionnels, quant à eux, s’inquiètent d’un lancement en pleine période estivale. Il faut convenir que la date du 20 juillet n’est peut-être pas très bien choisie, pour des raisons à la fois pratiques et comptables : opter pour un début de mois serait sans doute préférable.
Ajoutons que plusieurs de nos partenaires européens observent de près notre système, dans l’intention de s’en inspirer. L’enjeu industriel ne doit donc pas être négligé : il est impératif que la mise en place du dispositif se passe bien, et ne soit pas perturbée par les différentes difficultés que je viens d’évoquer.
J’ai pu lire dans la presse que le lancement pourrait être repoussé au 1er octobre. Il me semble que ce serait là un bon compromis, même si j’ai bien conscience que cette solution priverait l’AFITF d’une partie de ses recettes pour 2013. En tant que rapporteur des crédits relatifs aux transports terrestres, je suis particulièrement attentive à cette question !
De fait, il faut le souligner, l’écotaxe représente un enjeu important pour nos finances publiques. À raison d’un taux moyen au kilomètre de 12 centimes d’euro, elle devrait rapporter près de 1, 2 milliard d’euros en année pleine : 760 millions d’euros seront affectés à l’AFITF, 160 millions d’euros reviendront aux collectivités territoriales, propriétaires d’une partie – environ un tiers – du réseau taxable, et 280 millions d’euros, dont 50 millions d’euros au titre de la TVA, seront reversés à Ecomouv’ au titre du contrat de partenariat.
Je ne m’attarderai pas sur l’équilibre financier de l’AFITF en 2013, cet aspect étant détaillé dans mon rapport écrit. Notons simplement qu’un report au 1er octobre limiterait les recettes nouvelles de l’AFITF à 70 millions d’euros, contre 235 millions d’euros prévus initialement. Le différentiel pourrait être couvert par un fonds de roulement opportunément constitué fin 2012.
Je m’arrêterai en revanche plus longtemps sur la rémunération du prestataire, qui a, légitimement, soulevé plusieurs interrogations. Celle-ci correspond à environ 20 % du montant de la taxe collectée. Ce taux est incontestablement élevé au regard de ce que l’on constate pour les autres impôts.
Cela étant, je pense qu’il était opportun de recourir à un contrat de partenariat pour une opération d’une telle ampleur.
Je rappelle également que le prestataire a été choisi au terme d’un appel d’offres, au cours duquel le coût a constitué un critère important pour le classement des propositions.
Par ailleurs, les clauses du contrat soumettent le prestataire à un nombre important d’obligations, que j’ai relevées il y a quelques instants. À titre d’illustration, Ecomouv’ a déjà assumé plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements, tandis que l’État n’a toujours pas déboursé un centime. L’État est par conséquent conduit à rémunérer la somme de ses exigences à l’égard du prestataire privé.
Je viens de faire un tour d’horizon aussi exhaustif et bref que possible sur l’écotaxe poids lourds proprement dite. Il me reste à présent à aborder la question, cruciale, de la répercussion.
Comme je le relevais en préambule, la répercussion constitue un élément essentiel du caractère écologique de la taxe, c’est-à-dire la traduction du principe « pollueur-payeur ». Disons-le clairement, elle est également une nécessité économique, compte tenu de la faiblesse du secteur du transport routier, dont la marge nette s’établit à environ 1, 5 %.
Le principe est simple à énoncer : il s’agit de répercuter sur les clients – les chargeurs – l’écotaxe payée par les transporteurs. En pratique, c’est un véritable casse-tête. D’ailleurs, plus de quatre ans après le vote de la loi de finances pour 2009, les différents acteurs cherchent toujours une bonne solution.
Le problème tient au fait que le prix d’une prestation de transport est extrêmement difficile à calculer, et dépend en réalité fort peu de l’itinéraire emprunté. Par exemple, un poids lourd peut acheminer des marchandises pour le compte de plusieurs clients, s’arrêter en cours de route pour charger ou décharger, revenir à vide, etc. La réalité quotidienne du transport routier rend quasiment impossible une répercussion à l’euro près de l’écotaxe acquittée, à moins de mettre en place un système d’une complexité sans borne, ingérable pour les transporteurs, surtout pour les PME.
Par conséquent, la répercussion ne peut être que forfaitaire. Or, il faut le reconnaître, le forfait est en lui-même une source d’iniquité, soit que le transporteur répercute davantage qu’il ne paye, soit l’inverse.
Le précédent gouvernement avait proposé un système de répercussion qui a été critiqué par les transporteurs, car trop complexe, et attaqué devant le Conseil d’État par les chargeurs. Pour ces derniers, ce dispositif présentait l’inconvénient majeur de n’offrir aucune visibilité a priori sur le coût de la répercussion. Monsieur le ministre, j’imagine que le décret correspondant sera abrogé à compter du vote de l’article 7 du présent projet de loi. La répercussion sera dès lors établie sur des bases différentes.
Concrètement, le transporteur appliquera un taux de majoration au prix hors taxes de la prestation de transport. Le taux de majoration n’a pas vocation à reproduire fidèlement l’écotaxe poids lourds acquittée par le transporteur. J’ai d’ailleurs relevé que le Gouvernement ne parle plus de « répercussion », mais de « majoration de prix ». C’est un glissement sémantique qui tend à montrer que la majoration de prix est, d’une certaine manière, déconnectée de l’écotaxe payée par le transporteur. Du reste, le projet de loi précise que cette majoration de prix sera appliquée quel que soit l’itinéraire emprunté.
Le taux de majoration sera défini par arrêté ministériel, en fonction de la région de chargement et de celle de déchargement. Il sera calculé au regard de l’incidence moyenne de la taxe en fonction des régions, c’est-à-dire de la densité du réseau taxable dans chaque région.
C’est donc au travers du mode de calcul du taux, et non pas de l’itinéraire emprunté, que le nouveau dispositif réalise la liaison avec l’écotaxe. Il existe vingt-deux taux régionaux, pour les cas où le poids lourd se déplace simplement à l’intérieur d’une même région, et un taux national, de l’ordre de 4, 4 %.
Le nouveau système est indiscutablement mieux accueilli par les transporteurs. Le fait qu’il soit de nature législative les sécurise. Par ailleurs, ce dispositif est simple, et les taux de majoration prennent en compte les charges administratives induites par l’écotaxe, telles que, par exemple, la formation du personnel ou l’adaptation des logiciels.
Certes, ce système est loin d’être parfait. On peut évidemment lui adresser plusieurs critiques, concernant au premier chef son caractère forfaitaire, lequel est nécessairement trop simple pour qu’il puisse être adapté à la diversité des situations individuelles. Néanmoins, à la lumière des propositions auparavant formulées, c’est probablement le moins mauvais de tous, car c’est le plus opérationnel. Ses imperfections sont le prix à payer pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation.
En tout état de cause, les transporteurs et les chargeurs restent lucides. Ils savent bien que la majoration de prix n’éludera pas la discussion commerciale. L’écotaxe les contraint à déterminer un nouvel équilibre contractuel et dans leurs relations financières. Toutefois, dans le cadre d’un rapport de force parfois tendu, les transporteurs estiment que la loi les protège et leur fournit une arme supplémentaire.
L’État doit également aider transporteurs et chargeurs à objectiver leur dialogue. À ce titre, je formulerai deux préconisations, déjà évoquées par le passé.
Premièrement, il conviendrait d’établir une commission nationale de suivi, à l’image de celle que prévoyait le décret de mai 2012. Cette instance serait chargée d’évaluer l’effectivité du dispositif proposé et de fixer les taux de majoration.
Deuxièmement, il importe de mettre à disposition le plus rapidement possible un outil de simulation, accessible à tous sur Internet, de l’écotaxe à acquitter pour un parcours donné. Cela serait, à mon sens, très utile.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances, suivant ma proposition, a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 7 du présent projet de loi. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi aborde, comme l’ont souligné les deux rapporteurs, dont je veux saluer le travail, des questions très diverses liées à tous les modes de transport : ferroviaire, routier, fluvial, maritime et même aérien.
Bien que je souscrive à l’objectif de simplification des codes et des dispositifs, je reste attentif à ce que certaines des mesures proposées ne complexifient pas davantage encore nos procédures ou ne conduisent le Sénat à adopter des dispositions qui n’auraient pas été mûrement réfléchies, le diable se cachant quelquefois dans les détails…
Si ce texte se présente plutôt sous de bons auspices, il demeure néanmoins quelques inconnues à lever, monsieur le ministre : elles sont telles que la commission en a été réduite à s’abstenir ; j’y reviendrai ultérieurement.
Avant d’aborder le cœur du sujet, que l’on me permette de confesser une petite insatisfaction.
Monsieur le ministre, nous sommes dans l’attente de la discussion des réformes de fond qui doivent être menées dans le secteur des transports, afin notamment de permettre à celui-ci de se préparer au mieux à affronter la concurrence. Ce texte, avec ses vingt-cinq articles, apporte des réponses techniques et juridiques souvent utiles à des problèmes clairement identifiés se posant dans divers domaines du transport. Toutefois, il faudra bien en venir prochainement à l’essentiel ! Ce n’est que partie remise.
Pour l’heure, venons-en au projet de loi qui nous est soumis.
Trois articles du projet de loi font l’objet de débats et exigent une discussion approfondie sur les questions qu’ils soulèvent : je veux parler des articles 5, 7 et 23, auxquels je consacrerai principalement mon propos.
Comme plusieurs de mes collègues, je m’interroge sur l’article 5, qui prévoit d’étendre les possibilités de reclassement d’une route ou d’une section de route nationale déclassée dans la voirie départementale ou communale en cas d’avis défavorable de la collectivité concernée. C’est ce qui fait tout le sel de la proposition !
Certes, l’étude d’impact du Gouvernement se veut rassurante : le total de ces sections de routes délaissées ne représente que 250 kilomètres – en fait 251 kilomètres, avons-nous appris en commission – et une compensation financière couvrant les coûts de remise en état est prévue. Cette dernière mesure est classique, mais est-elle suffisante ?
À cet égard, M. le rapporteur présentera tout à l’heure un amendement dont l’objet est d’apporter des garanties supplémentaires en matière de compensation financière pour les collectivités, en permettant la mise en place d’une procédure contradictoire entre l’État et la collectivité sur le coût de la remise en état. Nous y sommes favorables.
Il n’en reste pas moins que nous demeurons réservés sur cette procédure. En effet, les élus locaux ne sont pas demandeurs et ils ont encore en mémoire les conséquences financières négatives du transfert des routes nationales aux départements. En l’absence de précisions, ils craignent – on peut les comprendre ! – une mauvaise surprise à l’arrivée.
Faute d’avoir obtenu la liste des délaissés routiers et des indications claires sur la procédure de consultation des collectivités concernées, nous avons déposé un amendement visant à permettre au Gouvernement de nous apporter des compléments d’information, afin que le Sénat puisse se prononcer en toute connaissance de cause. J’espère que vous pourrez nous donner tout à l'heure, monsieur le ministre, toutes les garanties nécessaires. En effet, on ne peut pas demander au Parlement de délibérer à l’aveugle, sans connaître les conséquences, pour les collectivités, de la mise en œuvre des mesures présentées. Nous sommes ici un peu comme des médecins qui prescriraient un traitement sans savoir à quel patient l’appliquer ; convenez que c’est troublant !
J’en viens à l’article 7, visant à instaurer les modalités du principe de la répercussion de l’écotaxe poids lourds, qui a déjà été longuement commenté à l’instant par les rapporteurs, ainsi qu’au sein de la commission du développement durable. Il s’agit, en effet, de l’article le plus important du projet de loi : il traite d’une question ancienne et controversée, restée en suspens pendant plusieurs années, faute d’application. Sur ce sujet, il faut reconnaître que vous avez le courage d’avancer, monsieur le ministre, ce qui était nécessaire.
On le sait, l’écotaxe poids lourds correspond à l’engagement n° 45 du Grenelle de l’environnement. En 2008, son principe a été entériné, l’objectif étant de faire payer aux poids lourds l’usage, actuellement gratuit, du réseau routier national non concédé, seules certaines catégories de poids lourds et certaines routes étant donc concernées.
L’instauration de cette taxe kilométrique vise à atteindre trois objectifs : réduire les impacts environnementaux ; rationaliser à terme le transport routier sur les moyennes et courtes distances ; enfin, financer, au travers notamment de l’AFITF, les infrastructures de transport.
Nous discutons aujourd'hui non pas de l’écotaxe poids lourds – ce débat est derrière nous, la loi Grenelle 1 ayant été adoptée à la quasi-unanimité –, mais du mécanisme de sa répercussion dans le tarif des prestations de transport, principe qui avait été prévu lors de la mise en place de l’écotaxe pour tenir compte des spécificités économiques des entreprises du secteur routier.
Depuis 2009, c’est, pour une large part, le problème de la définition de ce mécanisme de répercussion et des modalités de sa mise en œuvre qui empêche l’entrée en vigueur de l’écotaxe. Il faut bien sortir de l’ambiguïté, même si, comme le disait le cardinal de Retz, on n’en sort généralement qu’à son détriment… §Quoi qu’il en soit, convenons-en, le sujet est douloureux pour les professions concernées.
Une première solution avait été avancée dans un décret du 4 mai 2012, qui a été fort mal accueilli – et pour cause ! – et fait d’ailleurs l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
Dans ce texte, il est proposé d’instaurer une majoration forfaitaire. Je sais que la déconnexion de son montant du coût réel de l’écotaxe est jugée déroutante par certains de nos collègues. Pourtant, comme le rapporteur l’a fort bien souligné, cette mesure apparaît comme la moins mauvaise des solutions. Telle est aussi la position des professionnels du transport routier, qui ont participé, en concertation avec les services de votre ministère, monsieur le ministre, à l’élaboration du dispositif.
La répercussion effective des coûts engendrés par la taxe pour les transporteurs dans le prix de leur prestation est en effet vitale pour eux. En France, 82 % des 37 500 entreprises de transport, auxquelles je rends hommage, comptent moins de dix salariés. La rentabilité économique du secteur est faible. Avec la crise, de nombreuses entreprises ont disparu ou connaissent de très grandes difficultés.
À cet instant, je veux exprimer deux regrets.
Premièrement, un certain nombre de professions restent, comme on dit, sur le bord de la route : je pense aux maçons, aux coopératives laitières, par exemple. Par le biais d’amendements, certains de nos collègues exprimeront les attentes de ces professionnels. Je comprends qu’il soit difficile d’y répondre, mais il faudra évaluer l’impact de l’écotaxe pour ces professions et envisager la possibilité de revenir sur cette question si nous ne sommes pas en mesure d’apaiser aujourd’hui leurs inquiétudes.
Deuxièmement, lors du Grenelle de l’environnement, avait été prévue « l’étude de mesures à destination des transporteurs pour accompagner la mise en œuvre de la taxe et prendre en compte son impact sur les entreprises », afin de tenir compte de la spécificité et de la fragilité des entreprises du transport routier.
Monsieur le ministre, les transporteurs attendent aussi des mesures leur permettant d’être plus compétitifs et ainsi d’affronter la concurrence étrangère. On le sait, le coût de l’heure de conduite est 30 % moins élevé en Allemagne qu’en France, et l’écart est encore beaucoup plus important avec les pays de l’Est. Pouvez-vous nous indiquer si des mesures sont prévues pour soutenir les entreprises ? Parmi les mesures d’accompagnement, ont été évoqués une aide à l’achat de véhicules propres, un allégement de charges ou de la fiscalité, notamment pour faire face à la concurrence internationale sur notre territoire.
Sur ce sujet, je souhaite que l’entrée en vigueur du dispositif soit décalée au 1er octobre. Ce report est, me semble-t-il, nécessaire aux entreprises pour mettre en place le système de l’écotaxe et s’équiper. D’ailleurs, l’État doit lui aussi, nous dit-on, procéder encore à quelques réglages.
Par ailleurs, notre rapporteur alsacien a suggéré la suppression de l’expérimentation de l’écotaxe en Alsace, mesure à laquelle nous sommes favorables. En revanche, il pourrait être opportun de mettre sur pied une expérimentation nationale « à blanc » en septembre prochain.
Enfin, nous demandons qu’un rapport permette de faire le point au terme d’un an d’application du système, afin d’envisager les améliorations qui pourraient être apportées à celui-ci.
J’en viens à mon troisième point : les transports maritimes, qui font l’objet de nombreuses dispositions du projet de loi, pour la plupart attendues par la profession.
Parmi celles-ci, le dispositif de l’article 23, relatif au cabotage maritime, appelle quelques observations. Sur ce sujet, nous reprenons un débat que nous avons déjà eu l’occasion d’esquisser en commission il y a quelques mois, lors de l’examen du texte présenté par notre collègue Évelyne Didier. Comme l’avait alors expliqué Mme Didier, le transport maritime est caractérisé par une situation de concurrence déloyale entre pavillons européens, qui a des conséquences négatives pour les armateurs français et les gens de mer.
Tout en tenant compte des directives européennes, le dispositif vise à répondre à cette problématique, en favorisant l’instauration d’une concurrence loyale pour le cabotage maritime et les services portuaires, dans les eaux intérieures et territoriales françaises.
L’article 23, qui reprend les dispositions du décret de 1999 sur les conditions sociales de l’État d’accueil, tend à ce que le travail effectué dans les services de cabotage maritime « avec les îles » et, plus largement, dans les eaux territoriales et intérieures françaises relève de conditions sociales comparables à celles qui existent sur le sol français, en renforçant la législation sociale de l’État d’accueil pour les services maritimes et en l’appliquant à l’ensemble des gens de mer, et non plus seulement à l’équipage.
Toutefois, cet article va plus loin encore, en étendant l’application des conditions sociales de l’État d’accueil aux navires qui viendront effectuer une prestation de services dans les eaux territoriales françaises.
Certes, ce point peut prêter à discussion : la notion de services étant très large, de très nombreuses activités risquent d’être concernées. En commission, le rapporteur a parlé d’une proposition « audacieuse » sur le plan juridique. La compatibilité entre l’application des conditions sociales de l’État d’accueil et le principe, établi par les directives européennes, de libre prestation de services peut en effet faire débat. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point, monsieur le ministre ? L’enjeu est important pour le transport maritime, notamment pour le développement des activités offshore.
Monsieur le ministre, vous faites le choix, ici comme pour d’autres dossiers, dont celui de la gouvernance du système ferroviaire, de promouvoir des conceptions parfois quelque peu avant-gardistes en matière de règles de la concurrence européenne. En tout cas, à ce stade, elles peuvent être jugées divergentes de celles du commissaire européen, Siim Kallas. L’avenir dira quelle position adoptera la Commission européenne.
En tout cas, monsieur le ministre, votre démarche, pour audacieuse qu’elle soit, mérite d’être tentée. D’une façon générale, transposer une directive européenne – sachons le faire à temps, et non pas au dernier moment ! – en lui apportant les adaptations nécessaires ne doit pas être tabou ; reste à éprouver les limites de la méthode : j’espère que nous ne les atteindrons pas avec ce texte !
Vous l’aurez compris, le groupe UDI-UC n’est pas opposé, loin de là, à ce projet de loi, qui procède à de nombreux aménagements techniques attendus par le monde des transports ou à des adaptations indispensables, bien que douloureuses. Toutefois, nous nous prononcerons en fonction des réponses qui seront apportées par le Gouvernement au cours de l’examen des amendements.
La commission n’a pas adopté ce texte, sans doute faute d’avoir obtenu des réponses satisfaisantes. Dès lors, il vous revient, monsieur le ministre, de dissiper nos éventuelles réserves au cours de la suite de la discussion, pour conduire ce projet de loi à bon port ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de l’écotaxe poids lourds, créée par la loi de finances de 2009, à la suite du Grenelle de l’environnement, est au cœur de ce projet de loi, même si celui-ci n’a pour objet que d’en préciser les modalités d’application.
Cette écotaxe a pour atouts principaux de réduire les impacts environnementaux du transport routier et de financer de nouvelles infrastructures. Elle devrait en effet dégager en année pleine 1, 2 milliard d’euros de recettes, reversées à hauteur de plus de 1 milliard d’euros à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Pour ma part, je suis favorable à cette taxe et aux modalités d’application que vous proposez, monsieur le ministre, même si le « signal prix » ainsi envoyé aux chargeurs sera très insuffisant pour compenser l’écart de prix entre le transport routier et le fret ferroviaire.
Même si, bien entendu, je voterai le projet de loi, je vous demande, monsieur le ministre, de nous soumettre un programme d’aide à l’achat de camions moins polluants, à l’instar de ce qui a été fait en Allemagne.
Je vous demande en outre de nous présenter un véritable plan de développement du fret ferroviaire.
Enfin, puisqu’il est question de l’AFITF, je veux vous faire part du sentiment unanime des élus franc-comtois, alsaciens et bourguignons quant à la nécessité d’achever la branche est du TGV Rhin-Rhône. Cette deuxième tranche, longue de trente-cinq kilomètres entre Belfort et Mulhouse et de quinze kilomètres entre Genlis et Villers-les-Pots, a fait l’objet, en 2002, de la même déclaration d’utilité publique que la première tranche, achevée en décembre 2011. Les études et les acquisitions foncières ont été réalisées, un engagement a été pris par le précédent Président de la République et une convention d’intentions signée en janvier 2012, prévoyant le démarrage des travaux au plus tard en 2014.
Les collectivités territoriales, qui se sont mises d’accord sur une clé de répartition, ont accepté un phasage : le tronçon nord serait réalisé d’abord, puis le tronçon sud. Le tronçon nord est prioritaire parce qu’entre Belfort et Mulhouse, de nombreux TER et convois de fret circulent, ce qui force les TGV à ralentir considérablement. Le coût des travaux est modeste : 850 millions d’euros, pour une infrastructure qui fera gagner vingt-cinq minutes sur les trajets nord-sud entre Strasbourg et Lyon et près de vingt minutes sur les trajets est-ouest entre Zurich et Paris.
La réalisation de cette deuxième tranche permettra d’affirmer la double fonctionnalité du TGV Rhin-Rhône : selon l’axe nord-sud, de l’Allemagne du Sud-Ouest vers le Midi de la France et la Catalogne, et selon l’axe est-ouest, de la Suisse vers Paris, Bruxelles et Londres. Le TGV Rhin-Rhône est un TGV européen par excellence, puisqu’il relie des régions françaises, suisses, allemandes et espagnoles. D’ailleurs, la Commission européenne a fait savoir qu’elle était prête à financer substantiellement cette deuxième tranche, à hauteur de 25 % environ, sur l’enveloppe de 725 millions d’euros affectée au réseau transeuropéen de transport pour la période 2007-2013.
La branche est du TGV Rhin-Rhône est l’un des rares projets, sinon le seul, dont le caractère européen est incontestable. Dans ces conditions, autant je puis comprendre que la réalisation des branches sud et ouest soit soumise à la concertation, autant tout retard dans celle de la deuxième tranche de la branche est me semblerait préjudiciable et contraire à l’esprit même du projet. Comme l’a signalé M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin, un tel retard constituerait un gaspillage des crédits publics déjà engagés.
Les présidents des trois régions directement concernées venant d’intervenir dans le même sens auprès du Premier ministre, je me permets d’insister, monsieur le ministre, pour que les engagements de l’État soient respectés et qu’une nécessaire continuité prévale dans la réalisation d’une infrastructure européenne dont les fonctionnalités est-ouest et nord-sud sont indissociables.
Mon insistance sur la nécessité d’achever la branche est du TGV Rhin-Rhône n’implique bien sûr en aucune manière un relâchement du soutien que j’apporte par ailleurs à la poursuite des engagements de l’État au-delà du 31 décembre 2014 en ce qui concerne la ligne n° 4 Paris-Troyes-Chaumont-Vesoul-Belfort, desserte de ville à ville qui répond pleinement aux nouvelles orientations de la SNCF et de la politique d’aménagement du territoire. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant !
Monsieur le ministre, les élus de la majorité présidentielle sont ouverts au débat sur tous les sujets et attachés au respect des engagements de l’État, mais ils voteront le projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport. En particulier, vous pouvez compter sur le soutien des membres du groupe RDSE, que mon collègue Alain Bertrand vous renouvellera tout à l’heure en s’exprimant davantage sur le fond.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi qu’au banc de la commission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, le présent projet de loi traite de nombreuses questions, même si notre débat porte surtout sur la mise en place de l’écotaxe. Permettez-moi, avant d’en venir à ce dernier sujet, d’aborder brièvement les autres, sans prétendre être exhaustif.
L’article 23 du projet de loi marque une véritable avancée en matière de droit social des gens de mer. En effet, les conditions sociales et de sécurité françaises, applicables jusqu’ici au seul équipage, seront élargies à l’ensemble du personnel navigant, sur tous les navires utilisés pour fournir une prestation de services dans les eaux françaises.
En imposant ces règles aux navires étrangers, le projet de loi améliorera la protection de l’emploi de tous les marins, français ou étrangers. Nous nous réjouissons qu’il reprenne les propositions pertinentes de notre collègue Évelyne Didier, rapporteur de la proposition de loi relative aux conditions d’exploitation et d’admission des navires d’assistance portuaire et au cabotage maritime, et à l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes de cabotage. Nous tenons à saluer ce travail parlementaire du groupe CRC.
En matière de marées noires, le projet de loi vise à rendre notre droit de la responsabilité conforme à nos engagements internationaux. Il améliorera la protection des victimes de marées noires en posant explicitement le principe de la responsabilité du propriétaire du navire. Pour un Breton né à Brest, qui a connu à 15 ans le naufrage de l’Amoco Cadiz et participé, un peu plus de vingt ans plus tard, à la tentative de sauvetage un peu désespérée de dizaines de milliers de guillemots mazoutés, c’est évidemment une question importante !
Il aura fallu beaucoup trop de temps et de catastrophes pour aboutir à un encadrement juridique qui commence à organiser un régime de responsabilité propre à assurer une réparation correcte des préjudices causés par les marées noires, et par conséquent à encourager en amont les responsables à faire de la sécurité une priorité. Nous aurons l’occasion de débattre plus longuement de ce sujet lors de l’examen prochain de la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, mais je tenais à signaler les progrès déjà permis par ce projet de loi.
Je m’attarderai surtout sur l’article 7 du projet de loi, consacré à l’écotaxe poids lourds, qui est le thème principal de notre débat.
La mise en place d’une fiscalité écologique est, aux yeux des écologistes, un levier fondamental en vue de la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux. Elle est un outil au service de l’évolution de nos modes de vie, pour préparer notre économie à un monde où les ressources seront rares et où nous devrons nécessairement limiter notre impact sur le climat et la biodiversité.
Lors de la conférence environnementale, en septembre dernier, le Président de la République, François Hollande, a tenu les propos suivants : « L’écologie n’est pas une punition, c’est ce qui doit nous permettre d’être plus forts ensemble. Dès lors, il nous faudra changer des modes de prélèvement et surtout peser sur les choix, taxer moins le travail, plus les pollutions ou les atteintes à la nature ; dissuader les mauvais comportements ; encourager les innovations ; stimuler les recherches ; accélérer les mutations. »
La France est aujourd’hui classée au vingt-sixième rang parmi les vingt-sept États de l’Union européenne en matière de fiscalité écologique. Cette situation reflète les atermoiements constants des précédents gouvernements. Pour rattraper son retard sur les autres pays européens, la France devrait lever près de 20 milliards d’euros de recettes au titre de la fiscalité écologique ; ce chiffre mérite d’être relevé, car il correspond au coût du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Alors que l’écotaxe est directement issue de la concertation du Grenelle de l’environnement, en 2007, et que son entrée en vigueur était initialement programmée en 2011, le décret la concernant a seulement été publié le 6 mai 2012. Encore a-t-il suscité bien des oppositions, le système mis en place étant jugé trop complexe.
La nouvelle formule prévue par le présent projet de loi a été mieux accueillie que le décret du 4 mai 2012, comme notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx le fait observer dans son rapport pour avis. Il est prévu une modulation de l’assiette de la taxe en fonction des caractéristiques écologiques des véhicules, selon la classe « Euro », ce qui était évidemment nécessaire.
Le projet de loi simplifie aussi la répercussion de la taxe sur les chargeurs, dont le principe avait été arrêté par le Grenelle de l’environnement. Il instaure une majoration forfaitaire en pied de facture, qui prend en compte les frais de gestion pour les entreprises concernées.
Fervent partisan d’une fiscalité écologique efficace, je suis d’avis que si nous mettons en place des « usines à gaz » –soit dit sans mauvais jeu de mots –, le système ne prendra pas, voire se grippera. Or c’est un fait que le dispositif défini par le décret du 4 mai 2012 aurait posé des problèmes de gestion très complexes aux entreprises de transport routier, dont plus de 80 %, je le rappelle, comptent moins de dix salariés.
Comme vous, monsieur le ministre – mais peut-être un peu moins tout de même –, nous avons été alertés sur les risques potentiels que fait peser cette taxe sur la viabilité de plusieurs filières professionnelles. S’il faut toujours être très attentif à de telles observations, notamment à celles qui portent sur la complexité de la mise en œuvre du dispositif, il n’est pas question de transiger sur le principe « pollueur-payeur », que la taxe poids lourds vise à mettre en application.
Il est possible, en revanche, que nous péchions dans la pédagogie et l’explication de l’écotaxe, en ne mettant pas assez en évidence ses bénéfices induits pour nos industries et pour l’emploi. Pour les illustrer, je prendrai deux exemples : le transport de courte distance et le transport de longue distance.
Pour les courtes distances, un calcul rapide de l’incidence de l’écotaxe pour un poids lourd servant à la distribution de proximité permet d’envisager un surcoût de 5 000 euros environ, la marge d’incertitude étant extrêmement large, compte tenu de la diversité des situations. Réparti sur un nombre important de clients, ce surcoût représente seulement quelques dizaines d’euros par magasin. Pourtant, il peut constituer, pour les chargeurs, une incitation forte à développer des alternatives, lesquelles sont actuellement inexistantes ou presque. Je pense en particulier à un système que nous avions étudié au sein de la communauté urbaine de Nantes Métropole, à l’époque où j’en étais vice-président : faire des livraisons par tramway au petit matin, avant que les rames ne servent au transport des personnes se rendant à leur travail. D’autres modes de transport irriguant les agglomérations peuvent aussi être utilisés, ainsi que des véhicules électriques, sachant qu’actuellement une trentaine de petits poids lourds seulement roulent à l’électricité. Un constructeur de tels véhicules existe bien, mais, en raison de la faiblesse de la production, les coûts de fabrication sont extrêmement élevés, ce qui empêche cette solution de se développer. Il y a là un beau défi industriel à relever, ce que nous ferons d’autant mieux que nos industriels y seront incités : je rejoins là les propos tenus par Jean-Pierre Chevènement. L’écotaxe pesant bien moins lourdement sur les véhicules électriques, l’utilisation de ceux-ci bénéficiera d’une incitation extrêmement forte : la différence avec un poids lourd ordinaire se montera à plusieurs milliers d’euros sur la durée d’amortissement du véhicule.
Le développement du recours à des poids lourds roulant à l’électricité renforcerait en outre l’engagement des villes à améliorer la qualité de l’air et à réduire les nuisances liées aux transports : il s’agit là d’enjeux majeurs de santé publique.
L’instauration d’une écotaxe sur les poids lourds peut et doit donc donner naissance à un nouveau modèle économique, qui rende plus compétitif le transport moins polluant sur courtes distances : cette évolution apportera de réels bénéfices à l’ensemble de la société.
En ce qui concerne le transport sur longues distances, le système d’une écotaxe kilométrique permet de faire contribuer les poids lourds ne faisant que transiter par la France. À notre avis, ce transport de transit devrait être fortement surtaxé, afin de rendre attractives les alternatives au transport routier.
J’ai déjà eu l’occasion de mentionner, notamment dans mon rapport pour avis sur les crédits du programme « Transports routiers » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » du projet de loi de finances pour 2013, la possibilité de créer une quasi-obligation d’utiliser les infrastructures alternatives à la route, telle l’« autoroute » ferroviaire entre la frontière espagnole et le Luxembourg. Ne faut-il pas profiter de l’instauration de l’écotaxe pour rendre plus coûteuse la traversée de notre territoire sur les parcours où une alternative à la route existe ?
Une telle décision bouleverserait l’équilibre économique de l’infrastructure ferroviaire et permettrait la réalisation d’opérations aujourd’hui impossibles pour des raisons budgétaires. En effet, on dégagerait une recette certaine par l’instauration d’une écotaxe dissuasive sur un certain nombre d’itinéraires pour lesquels il existe une alternative ferroviaire, maritime ou fluviale. C’est une proposition que nous devrions davantage examiner dans le cadre du débat sur le schéma national des infrastructures de transport, qui, loin de se limiter à établir une hiérarchisation entre priorités de transport et priorités financières, doit porter aussi sur les recettes envisageables selon les infrastructures.
La taxe poids lourds a vocation à financer la politique de développement intermodal des transports ; c’est l’un de ses aspects majeurs, entériné à l’issue du Grenelle de l’environnement. Ainsi, le produit de l’écotaxe est reversé en grande partie à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et aux collectivités territoriales. Nous ne pouvons pas nous priver de ce levier financier essentiel et nous ne devons pas en retarder la mise en œuvre. En effet, il contribuera à financer les investissements très élevés nécessaires à l’instauration d’un système de transport intermodal efficace.
En Allemagne, d’ailleurs, les recettes de l’écotaxe poids lourds qui existe depuis le 1er janvier 2005 sont affectées à l’agence fédérale de financement des infrastructures. Appliqués aux véhicules de plus de 12 tonnes, les droits de péage sont prélevés sur près de 13 000 kilomètres d’autoroutes, sur lesquelles les poids lourds parcourent chaque année 28 milliards de kilomètres, la part des véhicules étrangers dans ce trafic étant de 35 %. Les recettes de cette taxe allemande font rêver, si j’ose dire : elles atteignent 3, 6 milliards d’euros par an ! Si nous pouvions disposer de 3 milliards à 4 milliards d’euros chaque année pour financer les projets prévus dans le cadre de notre schéma national des infrastructures de transport, cela changerait quelque peu les termes du débat…
Cela donne une illustration supplémentaire du fait que la mise en place d’une écotaxe est nécessaire, mais pas suffisante. Elle doit s’accompagner d’autres mesures de politiques publiques pour garantir le report modal du transport des marchandises, par le développement d’une offre alternative de qualité. Je rejoins, là encore, les propos de Jean-Pierre Chevènement.
Le groupe écologiste appelle donc à une montée en puissance progressive du dispositif. Des dérogations régionales existent, ainsi qu’un abattement de 10 % en cas de souscription au système d’abonnement. Dans le projet de loi, il est prévu que les taux de la taxe seront réévalués annuellement par arrêté ministériel. Nous veillerons à ce que ces arrêtés constituent la traduction d’un renforcement régulier de l’écotaxe. En effet, il y va de l’intérêt collectif, de la santé publique, de la lutte contre le changement climatique.
Il convient d’ailleurs de relativiser les conséquences sur les prix à la consommation, et donc le pouvoir d’achat, de la mise en œuvre de cette écotaxe.
Au regard de l’expérience de la Suisse et de l’Allemagne, remontant à 2005, l’écotaxe aura une incidence sur les prix de l’ordre de 0, 1 % à 0, 2 %. Il ne s’agit pas de nier les difficultés des chargeurs, mais elles ne sont pas liées à la mise en place de cette écotaxe.
Comme cela est indiqué dans l’étude d’impact, l’écotaxe est surtout un outil destiné à adresser un « signal prix », qui doit permettre de soulever la question sociétale de la nécessité de transporter mieux, c’est-à-dire moins loin et avec une optimisation des modes de transport. La diminution des distances de transport et l’amélioration du taux de remplissage des poids lourds devraient, au final, avoir une incidence positive sur les prix à la consommation et largement compenser la hausse annoncée. C’est en tout cas ce qui s’est produit en Suisse et en Allemagne.
Je conclurai en soulignant quelques points sur lesquels nous serons extrêmement vigilants.
Monsieur le ministre, vous avez autorisé les poids lourds de 44 tonnes à cinq essieux. Au départ, c’était à titre dérogatoire, pour les approches « transports combinés » autour des ports et des gares, dans un rayon de 100 kilomètres. Ensuite, cette distance a été portée à 150 kilomètres, puis finalement ce fut la généralisation de l’autorisation des poids lourds de 44 tonnes à cinq essieux !
Nous voyons se profiler une nouvelle difficulté du même ordre avec la demande, formulée par certains, que soit autorisés les poids lourds de 25, 25 mètres. Je me permets de rappeler que le produit de la taxe sert aussi à l’entretien des routes. Dès lors, il serait totalement contre-productif, pour ne pas dire contradictoire, d’instaurer l’écotaxe d’un côté, et, de l’autre, d’autoriser, après les poids lourds de 44 tonnes à cinq essieux, les véhicules de 25, 25 mètres, qui dégradent particulièrement la voirie de notre pays.
Notre vigilance portera également sur le report de trafic vers les autoroutes concédées que provoquera l’introduction de cette taxe. On estime aujourd’hui entre 250 millions et 400 millions d’euros la hausse de revenus que ce report procurera aux concessionnaires. Un relèvement de la redevance domaniale correspondant s’imposera à un moment donné. Le groupe socialiste présentera un amendement prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport sur les effets de cette taxe ; c’est une bonne chose. La remise de ce rapport interviendra donc en amont de la discussion budgétaire, ce qui permettra, le cas échéant, de faire évoluer la taxe. Nous souhaitons que, dans l’intervalle, le Gouvernement, comme il l’a annoncé, continue la discussion avec les concessionnaires d’autoroutes, qui doivent participer davantage à l’effort national en faveur du report modal.
Le groupe écologiste soutient le Gouvernement sur ce point et votera ce projet de loi, dans la mesure où il instaure un prélèvement qui, par nature, renforcera la fiscalité écologique. Nous espérons que ce n’est là qu’un début dans l’instauration d’une fiscalité écologique à la hauteur des enjeux : c’est dans l’intérêt des finances de la France, de nos filières industrielles, de la protection de l’environnement ; il n’y a donc aucune raison de s’en priver ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord faire une observation concernant la procédure.
Monsieur le ministre, alors que le Président de la République s’était, à l’inverse de son prédécesseur, engagé à laisser aux parlementaires du temps pour effectuer un travail législatif de qualité, la procédure d’urgence a une nouvelle fois été engagée pour ce texte.
Certes, cela peut se comprendre, puisque, d’une part, la mise en œuvre du dispositif est prévue pour le 20 juillet, et que, d’autre part, les entreprises doivent bien sûr avoir le temps de s’y préparer. Toutefois, je le regrette, car même si les dispositions que comporte ce texte devraient recueillir un large assentiment, il n’en demeure pas moins que les questions abordées sont vastes et complexes, du fait qu’elles touchent tous les modes de transport.
Ce projet de loi n’est certes pas la pierre angulaire de la réforme de la politique du transport que nous appelons de nos vœux, surtout en matière ferroviaire. Cette question sera l’objet de nombreux débats à venir, à l’occasion de la discussion tant du prochain projet de loi sur la réforme du système ferroviaire que vous avez annoncé, monsieur le ministre, que du texte portant acte III de la décentralisation.
Toutefois, le présent texte a le mérite d’apporter des clarifications, des précisions à la législation existante, de renforcer les capacités de contrôle de la puissance publique en matière de transport maritime et de permettre enfin la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds votée en 2009.
Il a été prévu, lors du Grenelle de l’environnement, que les modes de transport alternatifs à la route devraient représenter 25 % du fret à l’horizon 2025 ; nous sommes encore bien loin du compte, monsieur le ministre !
La prééminence de la route dans le transport des marchandises, au détriment du rail, du ferroutage et du réseau fluvial, n’a pas connu de remise en cause. Ainsi, le transport routier assure près de 90 % du transport des marchandises et, malgré un pétrole cher, le fret ferroviaire a reculé en France de près de 40 %, passant de 57 milliards de tonnes-kilomètres en 2000 à 34 milliards en 2011. Dans le même temps, la part du transport combiné ferroviaire a diminué d’environ 70 %. On ne peut, dès lors, s’étonner que la route représente 94 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
Dans ces conditions – ce n’est qu’un premier exemple –, la possibilité d’utiliser des poids lourds de 44 tonnes, qui donne un avantage concurrentiel certain à la route et entraîne de surcroît de nombreuses nuisances et une plus forte dégradation des routes, doit être remise en question.
Le rail n’est pas seulement un mode de transport complémentaire ; y recourir peut permettre aussi – le projet Euro Carex en témoigne – de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, même si cela demande des investissements importants.
Nous savons que l’acheminement routier reste indispensable : les destinataires sont nombreux, les lieux de livraison dispersés, et le train ne permettra jamais de déposer les marchandises à la porte de chaque client. Il n’empêche que le rail et le fleuve pourraient délester le réseau routier d’une part importante des véhicules qui le sillonnent chaque jour, le transport routier intervenant plutôt à la fin de la chaîne de la livraison. Le présent projet de loi peut être un outil pour favoriser une telle complémentarité.
Le développement des autoroutes ferroviaires permet de parcourir de grandes distances sans rupture de charge, améliore la rapidité et la sécurité des trajets, ce qui est une bonne chose. Toutefois, ces autoroutes doivent êtres complétées par une activité fret de proximité. C’est pourquoi – c’est une demande émanant de nombreux professionnels – il est essentiel de maintenir le wagon isolé, seule option possible lorsque des entreprises ne peuvent remplir un train complet.
Mais le schéma directeur de la SNCF, qui fixe les axes de développement du transport ferroviaire de marchandises pour les années à venir, va à rebours de la promotion du wagon isolé, qui représente 42 % du volume du fret ferroviaire et recèle un important potentiel de développement. Il consacre en effet l’abandon de cette activité à hauteur de 60 %. Aussi demandons-nous que celle-ci soit déclarée d’intérêt général, afin de permettre son subventionnement.
Parallèlement, il faut que les crédits alloués au transport combiné soient renforcés. Il est temps que l’État s’engage de nouveau sérieusement en faveur du développement du fret de proximité, pour améliorer l’aménagement et l’attractivité de nos territoires.
Dans le même ordre d’idées, permettre le rééquilibrage modal, c’est également mettre un terme aux suppressions d’emplois dans le secteur du transport fluvial, la dernière loi de finances ayant supprimé cent vingt-huit postes au sein de Voies navigables de France, et respecter l’engagement qui a été pris de financer nos voies navigables à hauteur de 840 millions d’euros.
En ce qui concerne la lutte contre le dumping social et fiscal, il s’agit tout d’abord de renforcer les conditions sociales dans le secteur du transport routier, qui est aujourd’hui dans une situation difficile, comme vous l’avez souligné lors de votre audition, monsieur le ministre. Ce texte va dans le bon sens à cet égard, puisqu’il prévoit un renforcement des contrôles du respect de la réglementation.
Plus largement, il faut également agir sur la qualité des conditions de travail dans le secteur routier. Aujourd’hui, celles-ci sont déplorables et la jurisprudence est de plus en plus défavorable. Certes, l’encadrement de ces conditions de travail est, pour la majeure partie, fixé à l’échelon européen, mais il faut que la France s’engage à soutenir au plus haut niveau l’exigence d’une harmonisation sociale par le haut. Nous comptons sur vous pour cela, monsieur le ministre.
De plus, il faut agir sur le secteur du transport routier, notamment sur les dispositifs fiscaux existants, qui sont particulièrement favorables aux transporteurs. Ainsi, à titre d’exemple, les exonérations de taxe intérieure sur les produits pétroliers coûtent chaque année 330 millions d’euros au budget de l’État. Il serait opportun de remettre ces avantages fiscaux sur la table.
J’en viens maintenant au cœur de ce projet de loi : l’écotaxe poids lourds.
Votre texte constitue une réelle avancée, que nous apprécions. En effet, depuis l’adoption du principe de cette taxe, il est prévu que les transporteurs pourront la répercuter sur les chargeurs. Or, telles qu’elles sont définies dans un décret pris par l’ancien gouvernement, les modalités de cette répercussion sont particulièrement complexes. Le présent projet de loi permet de simplifier les choses, en prévoyant de fonder le dispositif sur une majoration du coût de transport différenciée selon les régions.
Pour notre part, nous sommes d’accord avec ce mode de répercussion, qui est plus simple, plus lisible et ne changera rien au volume de recettes escompté, ni au principe devant guider la définition de cette taxe, c’est-à-dire son affectation au financement du rééquilibrage modal. Nous nous félicitons que, après de nombreuses années d’attente, cette taxe entre enfin en vigueur. Nous veillerons, tout au long des débats, à ce que toute sa force soit conservée à cette écotaxe, qui doit pouvoir répondre à une finalité que, je crois, nous approuvons sur l’ensemble des travées.
Toutefois, la mise en place de cette taxe nous contraint encore une fois à remettre en question le mécanisme des partenariats public-privé. En effet, alors que l’on estime que la taxe poids lourds devrait rapporter 1, 2 milliard d’euros, les recettes de la société Ecomouv’ – filiale notamment d’Autostrade per l’Italia –, à qui a été confiée la collecte de cette taxe par l’ancien gouvernement, s’établissent à quelque 230 millions d’euros. Un tel prélèvement apparaît bien disproportionné ! Encore une fois, un partenariat public-privé se révèle particulièrement coûteux pour la collectivité. Nous aurions, quant à nous, préféré à l’inverse que l’on fasse le pari de la performance du secteur public, en l’occurrence du service des douanes, même si nous reconnaissons la complexité de mise en œuvre de cette taxe. En tout état de cause, 750 millions d’euros seront ainsi versés chaque année à l’AFITF pour assurer le financement des infrastructures. Cela est bien, mais ne doit pas empêcher, par ailleurs, le Gouvernement de s’engager dans la voie du désendettement de RFF, première condition d’une meilleure efficacité des réseaux ferroviaires.
Monsieur le ministre, l’instauration de cette écotaxe est une formidable occasion de terminer enfin la mise à deux fois deux voies de la route Centre-Europe-Atlantique, la plus meurtrière de France.
En ce qui concerne les dispositions relatives au secteur maritime, les articles concernant les navires abandonnés, la clarification des procédures applicables en matière de constitution du fonds de limitation imposée au propriétaire en cas de marée noire ou encore les visites des navires et l’enquête nautique sont à l’évidence utiles et n’appellent pas de commentaires particuliers de notre part.
Je voudrais revenir ici sur l’article 18 du projet de loi, qui vise à rétablir les habilitations des agents des affaires maritimes à la suite de la fusion des corps des inspecteurs et des contrôleurs.
Comme vous le savez, nous considérons que cette politique de fusion de ces corps de fonctionnaires ne s’est pas faite à moindre frais et qu’atteindre les objectifs fixés en matière de mobilité des personnels pose des difficultés particulières, en raison de la spécificité des missions de contrôle dans le secteur maritime.
En effet, la spécificité du travail à bord des navires, en raison de l’existence d’un corpus de droit spécial abondant, l’imbrication des prescriptions sociales et des prescriptions techniques relatives au navire et à la navigation, la dimension internationale de plus en plus affirmée des conditions d’intervention des autorités de contrôle appellent une spécialisation de ces autorités. Or la politique de fusion des inspections du travail apparaît difficilement compatible avec la conservation des savoir-faire, de l’expertise et des expériences des personnels chargés d’assurer ces missions.
Dans son rapport de 2007 intitulé La sécurité des navires et de leurs équipages : des résultats inégaux, un contrôle inadapté, la Cour des comptes constate que les contrôles sont affaiblis au niveau local et insiste sur l’intérêt d’une approche intégrée et cohérente.
Aujourd’hui, les contrôles de sécurité du flotteur et ceux du suivi des équipages dépendent de deux administrations différentes. Cela ne va pas sans poser des problèmes, eu égard à l’importance de la dimension humaine de la sécurité.
Monsieur le ministre, vous avez dit en commission que vous étiez nostalgique du service des affaires maritimes tel qu’il était organisé auparavant. Il serait essentiel que le Gouvernement s’empare de la question de l’effectivité des contrôles dans le secteur maritime, afin de répondre aux inquiétudes des marins, des personnels à terre et des gens de mer en général.
Cela m’amène naturellement à évoquer l’article 23 du projet de loi, qui vise à élargir le champ d’application des conditions de l’État d’accueil à l’ensemble des personnels à bord. L’objectif du Gouvernement est de garantir des conditions de concurrence équitables entre sociétés maritimes opérant sur une même ligne et pratiquant le cabotage ou assurant des liaisons dans les eaux intérieures et territoriales.
L’article 23 tend à permettre aux gens de mer, qui ne bénéficient pas, dans la majorité des cas, d’une inscription au premier registre du pavillon français, d’avoir les mêmes droits que les salariés détachés. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, ce qui a pour conséquence de les soumettre aux réglementations sociales de pavillons de complaisance. Avec cet article, le Gouvernement dit aller au bout de ce que permet le droit communautaire. En effet, selon l’analyse du ministère, les règlements européens de 1986 et de 1992 précisent que, pour être admis à l’activité dans un État membre, il suffit au navire d’être immatriculé dans n’importe quel État membre. En résumé, le principe de la libre prestation de services et celui du libre établissement interdiraient une « réserve de pavillon ».
Nous défendons, quant à nous, l’idée d’instituer un pavillon européen qui serait équivalent au premier registre du pavillon français. Au-delà de la législation sociale, cela permettrait également de se prémunir contre tout dumping fiscal. De plus, nous restons très circonspects quant à l’effectivité des droits garantis au titre de l’État d’accueil. À ce sujet, Éric Bocquet a demandé, au nom de notre groupe, qu’un rapport d’information sur le détachement des salariés européens puisse être réalisé dans le cadre de la commission des affaires européennes.
Monsieur le ministre, ce texte s’inscrit concrètement dans la mise en œuvre de l’une des préconisations du Grenelle de l’environnement. Saluant votre volonté, nous voterons bien sûr ce projet de loi, que nous considérons équilibré et courageux. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen de ce projet de loi est l’occasion de rappeler comment s’organisent aujourd’hui les rapports de force politiques autour des questions environnementales.
En effet, les considérations liées à l’environnement ont pris une place fondamentale dans l’élaboration des politiques publiques. Même si, parfois, les motivations de cette prise de conscience sont quelque peu utilitaristes, voire électoralistes, il n’en demeure pas moins que le respect de la nature est désormais une dimension indispensable de toute politique publique, ce dont nous nous félicitons.
Bien qu’une conscience aiguë des questions environnementales ne soit aujourd’hui le monopole de personne, les approches diffèrent selon la place occupée dans notre hémicycle. En d’autres termes, même s’il subsiste des antagonismes profonds sur certains sujets – le cas du nucléaire en est sans doute la meilleure illustration –, je crois pouvoir dire que la prise de conscience est collective, comme en témoigne le Grenelle de l’environnement, lancé par le précédent gouvernement. Les lois dites « Grenelle », ambitieuses, même si certains les ont jugées incomplètes, ne se suffisent cependant pas à elles-mêmes. Pour cette raison, et comme notre groupe l’a toujours souligné, la séquence de consultations, puis de décisions, que furent les Grenelle de l’environnement doit se concevoir comme une étape de la course vers une appréciation complète des enjeux écologiques et, partant, vers la définition de politiques publiques environnementales pleinement abouties.
Or, bien que le projet de loi que nous allons examiner ne soit pas aussi ambitieux que les lois dites « Grenelle », il doit être conçu comme une marche, certes plus petite que ces dernières, mais tout aussi indispensable qu’elles, dont il tend parfois à assurer la mise en application concrète.
Quelles avancées ce projet de loi doit-il donc permettre de réaliser ?
Tout d’abord, il convient de dire que la majorité des dispositions de ce texte sont de nature technique. Elles visent à apporter de nouvelles réponses juridiques à un ensemble de situations que, en l’état actuel du droit, l’État, les collectivités territoriales, les administrations et les opérateurs de l’État ont du mal à appréhender.
Ces situations concernent les transports tant ferroviaire que routier, fluvial ou maritime, ainsi que, dans une moindre mesure, le transport aérien.
De cette manière, le présent texte apporte parfois des réponses à des problématiques purement juridiques qui, nous devons le reconnaître, s’avèrent neutres sur le plan politique.
À titre d’exemple, en matière de transport ferroviaire, l’article 1er, qui tend à préciser les compétences de la direction des circulations ferroviaires, et l’article 2, qui vise à permettre aux régions de participer à des groupements composés de plus de deux autorités organisatrices pour la gestion des services de transports ferroviaires transfrontaliers, sont neutres politiquement.
En revanche, l’article 3, qui a pour objet d’instaurer une plus grande transparence, dans les entreprises ferroviaires, entre les activités de gestion d’infrastructures et celles de transport, témoigne à mon avis d’une vraie volonté politique de progresser vers la mise en œuvre de la concurrence pour les trains TER – transport express régional – et les TET, les trains d’équilibre du territoire. Je m’en réjouis, car l’échéance européenne de 2019 est inéluctable. Il convient de s’y préparer au plus vite, dans l’intérêt de nos cheminots et de la SNCF.
En matière de transport routier, les articles 10 et 11, qui visent à corriger des erreurs intervenues lors de la codification de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, sont à visée technique, tout comme l’article 14, relatif aux ressources du Port autonome de Paris, pour ce qui est du transport fluvial.
Dans le même registre, je pense aussi à l’article 19, tendant à imposer de nouvelles marques extérieures aux bateaux pratiquant la navigation fluviomaritime, et à l’article 21, dont l’objet est d’élargir les prérogatives du directeur du parc naturel de Port-Cros.
Concernant l’article 5, relatif au déclassement de 250 kilomètres de routes nationales, je suis inquiet, monsieur le ministre, comme tous mes collègues. En commission, il a même été question de 251 kilomètres, ce qui signifie qu’une liste précise doit exister : nous souhaiterions en obtenir communication.
Certaines dispositions purement techniques présentent une dimension politique, dans la mesure où elles donnent le pouvoir à des agents de l’État de constater et de verbaliser des infractions et des contrevenants.
Dans le domaine du transport ferroviaire, l’article 4 vise à permettre aux agents de la SNCF et de RFF de constater les infractions, notamment les vols commis sur le réseau. Je rappelle à cette occasion que ces derniers se chiffrent en dizaines de millions d’euros et sont en constante augmentation depuis plusieurs années. M. Pepy ne manque pas de le rappeler à chaque réunion du conseil d’administration de la SNCF.
En matière d’insécurité routière, l’article 9 prévoit d’accroître les prérogatives des contrôleurs de transports terrestres. Des dispositions similaires sont proposées, en matière de sécurité maritime, aux articles 13, 18, 20 et 22.
Il y a donc bel et bien, dans ce texte, un ensemble de dispositions inspirées par des considérations sécuritaires. Elles nous semblent, pour la plupart d’entre elles, relever du bon sens et d’un souci légitime d’accorder à la sécurité toute la place qu’elle mérite dans les problématiques de transport.
Le dernier type de mesures que nous pouvons identifier dans ce projet de loi relève de considérations environnementales.
Ces dispositions partent ainsi, dans la plupart des cas, d’un constat d’impuissance, notamment l’impuissance des agents de l’État à régler une situation qui s’éternise. On pense ici aux articles 12 et 15, qui visent à permettre, respectivement, de déplacer d’office les bateaux en stationnement le long des voies fluviales et d’accélérer la déchéance de propriété pour les bateaux abandonnés.
Dans la continuité des lois Grenelle, l’article 16, qui vise à clarifier et à distinguer les procédures applicables en cas de marée noire et celles qui le sont au titre du régime général des créances maritimes, s’inscrit dans le prolongement des travaux du Grenelle de la mer. Cette mesure permettra de mettre fin aux confusions auxquelles sont confrontés les tribunaux de commerce, qui, pour l’instant, font usage des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général de responsabilité, issu de la convention LLMC, malgré la décision de 1987 de la Cour de cassation. Là encore, il me semble que cette disposition relève du bon sens.
Cela étant, la mesure phare de ce texte est sans nul doute le remplacement non pas de l’écotaxe poids lourds elle-même, mais du dispositif de majoration destiné à la répercuter auprès des clients des transporteurs. L’écotaxe ne peut en effet se concevoir sans ce dispositif de majoration, qui permet de donner une portée concrète au principe « pollueur-payeur ».
Ainsi, la majoration forfaitaire, régionale ou nationale selon que le trajet s’effectue ou non sur le territoire de plusieurs régions, obligatoirement détaillée en pied de facture de transport, permettra, de façon neutre pour le transporteur, de répercuter la taxe que celui-ci aura payée initialement. Dans la chaîne commerciale, ce seront les opérateurs suivants qui répercuteront la taxe, jusqu’au consommateur final.
Dans la mesure où une grande part des transports de proximité ne peut être assurée autrement que par la route, même si certaines expériences ont pu être tentées, par exemple en Allemagne, pour utiliser à cette fin le tramway ou la voie fluviale, il est normal que le transporteur routier ne soit pas pénalisé dans ce système. Reste à savoir si les petites entreprises de transport, très nombreuses – 80 % d’entre elles comptent moins de dix salariés –, sauront résister aux pressions commerciales des grands donneurs d’ordres pour ce qui concerne la répercussion réelle de la taxe.

Ne sous-estimons pas cette difficulté !
En tout état de cause, le nouveau dispositif voulu par le Gouvernement est, nous devons le reconnaître, plus lisible pour les professionnels du secteur, donc pour tout le monde. De plus, dans la mesure où seront conservées comme critères d’élaboration des taux des données relatives aux trafics observés, aux itinéraires, à la consistance du réseau soumis à la taxe et aux charges de gestion, la légitimité de cette taxe forfaitaire continuera d’être fondée sur le respect de considérations environnementales.
Enfin, les nouvelles modalités de l’application de l’écotaxe permettront de préserver les ressources dégagées initialement pour financer les infrastructures de transport par l’intermédiaire de l’AFITF.
Cette mesure permettra donc de rendre effective une disposition mise en place par la précédente majorité, en adaptant le mécanisme fiscal aux difficultés que rencontre la profession.
Jusque-là, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, s’il n’était trois sujets qui nous laissent perplexes.
Le premier est celui des transporteurs de proximité, qui sont généralement plus petits que les transporteurs internationaux et ne font pas toujours le poids face aux grands donneurs d’ordres. J’ai personnellement conscience de la grande difficulté qu’il y a à faire payer une taxe et à la répercuter seulement si le trajet excède un parcours routier forfaitaire. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement visant à porter de 3, 5 tonnes à 12 tonnes le seuil de tonnage à partir duquel la taxe pourra être collectée et répercutée. J’aurai l’occasion, lors de l’examen de cet amendement, d’argumenter sur ce point.
Le deuxième sujet qui pose problème est celui de la mise en œuvre anticipée de la taxe en Alsace. C’est la raison pour laquelle, avec l’ensemble des parlementaires alsaciens et des membres de mon groupe, j’ai déposé des amendements tendant à aligner la mise en application de la taxe alsacienne avec celle du dispositif national.
Le troisième sujet qui nous inquiète est celui de l’enrichissement sans cause que le nouveau dispositif de majoration pourrait permettre. En effet, la déconnexion introduite dans ce texte entre l’écotaxe et la majoration payée par les chargeurs pourrait entraîner, pour les transporteurs n’utilisant pas les tronçons routiers soumis à l’écotaxe, un enrichissement sans cause. Ce phénomène s’explique par le fait qu’en utilisant des routes secondaires non taxées les transporteurs s’exonéreraient de l’écotaxe, alors même que leurs clients se verraient facturer la majoration. Je souhaiterais que vous nous apportiez des éclaircissements sur ce point précis, monsieur le ministre.
Certes, ce projet de loi apporte des réponses juridiques pratiques à des difficultés rencontrées par l’État et d’autres agents publics, et tend à faire appliquer une fiscalité écologique élaborée sous la précédente législature. Cependant, certaines de ses dispositions suscitent des interrogations. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP déterminera sa position finale en fonction du contenu du texte qui résultera de nos travaux.
Je tiens néanmoins à préciser que les parlementaires alsaciens du groupe UMP, qui se trouvent à l’origine, par l’intermédiaire d’Yves Bur, de l’instauration de la taxe poids lourds, sont bien sûr très attachés à ce que celle-ci puisse s’appliquer sur leur territoire dans les mêmes conditions, si possible, qu’à l’échelon national, afin que ne soit pas pénalisé le consommateur local. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, mon intervention portera sur les dispositions du projet de loi relatives aux transports ferroviaire et routier.
Je formulerai d’abord quelques remarques sur le volet ferroviaire. La création de la direction des circulations ferroviaires a suscité une question : toutes les missions qui lui sont confiées par RFF doivent-elles être subdéléguées ? L’article 1er du présent projet de loi précise que seules les missions relatives à la gestion opérationnelle du trafic et des circulations sont obligatoirement subdéléguées, pour des raisons liées à la sécurité du trafic. Les études techniques, en revanche, ne sont pas concernées par cette obligation.
Par ailleurs, l’article 2 permet aux autorités organisatrices régionales de conclure des conventions tripartites.
Quant à l’article 4, en étendant le champ des catégories d’agents assermentés pouvant constater des infractions, il donne de nouveaux moyens au gestionnaire de l’infrastructure pour lutter efficacement contre les infractions du rail, tout particulièrement contre les vols de cuivre, qui lui coûtent chaque année quelque 30 millions d’euros et constituent une des principales causes d’incidents d’exploitation pour la SNCF.
J’en viens maintenant au volet routier du projet de loi.
L’article 5 prévoit le transfert de délaissés routiers aux communes ou aux conseils généraux. Comment ne pas rappeler que les élus des conseils généraux ont été quelque peu échaudés par le volume et la forme des transferts opérés à la suite de l’adoption de la loi du 13 août 2004 ? Aussi, monsieur le ministre, est-il absolument nécessaire d’apporter des précisions sur le nombre réel de kilomètres de délaissés routiers susceptibles d’être transférés, ainsi que sur les modalités de reclassement de ces linéaires routiers. Nous avons déposé un amendement en ce sens, qui prévoit, en outre, la compensation financière afférente. Nous demandons également la fourniture d’une liste exhaustive des sections de voies concernées.
L’article 7 est relatif aux modalités de mise en place de la taxe poids lourds. Cette taxe n’est pas une nouveauté, puisqu’elle a été créée, en application de la loi Grenelle 1, par la loi de finances pour 2009. Elle est perçue sur les poids lourds de plus de 3, 5 tonnes utilisant le réseau routier national non concédé et les routes départementales susceptibles de subir un report de trafic.
Cette taxe vise à atteindre les objectifs suivants, fixés par le Grenelle de l’environnement : réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises en favorisant le développement d’autres modes de transport ; rationaliser, à terme, le transport routier sur les moyennes et courtes distances ; créer de nouvelles sources de financement pour le développement des transports, en abondant les recettes de l’AFITF.
Il n’est donc pas question de remettre en cause le principe même de l’écotaxe ; il s’agit d’améliorer son mécanisme de répercussion auprès des acteurs de la filière.
Dès l’adoption de l’écotaxe poids lourds, il avait été prévu de la répercuter sur les utilisateurs de transports de marchandises, c’est-à-dire les chargeurs et les principaux donneurs d’ordres de la filière. Or le décret du 4 mai 2012 avait prévu un dispositif qui a suscité de vives réserves de la part de l’ensemble des acteurs de la filière. En effet, s’il pouvait poser de sérieux problèmes en matière de contrôle de la perception de la taxe, il risquait également d’engendrer des tensions entre les donneurs d’ordres et les transporteurs lors des négociations commerciales.
Monsieur le ministre, vous avez bien fait de mettre en place un système simplifié de majoration automatique, obligatoire et légale du prix du transport, qui permettra de reporter plus facilement la charge de la taxe sur le donneur d’ordres.
Le choix d’une majoration forfaitaire unique, simplement modulée par région, devrait permettre de limiter les problèmes de perception et faciliter les négociations commerciales, en donnant un cadre plus sûr et plus équitable aux acteurs de la filière.
Par ailleurs, les abattements acquis pour les grandes régions périphériques françaises ont été conservés, avec des taux de 40 % pour la Bretagne et de 25 % pour l’Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Trois mois à peine avant l’entrée en vigueur de l’écotaxe sur l’ensemble du territoire, il paraît désormais peu judicieux de mener une expérimentation dans la seule région Alsace. D’une part, une telle expérimentation, d’une durée trop courte, ne permettra pas de bien évaluer les incidences de la taxe, d’autant que seuls les poids lourds de plus de 12 tonnes seraient concernés. D’autre part, au-delà de l’entorse au principe d’égalité des territoires que cette expérimentation pourrait représenter, on peut se demander si tous les véhicules seront équipés à temps du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe. Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous demanderons, par le biais d’un amendement, la suppression de cette disposition, issue du décret du 4 mai 2012.
D’une manière générale, l’effort de simplification consenti par le Gouvernement a été salué par la profession. Les syndicats de transporteurs ont ainsi exprimé leur satisfaction de voir le nouveau texte éclaircir certains points, même si, sur le fond, ils restent quelque peu réservés sur le principe même de l’écotaxe. J’ai également noté que la profession entendait faire preuve de vigilance quant à la fiabilité, à la cohérence et à l’équité du dispositif.
Il paraît en outre pertinent d’effectuer un suivi de l’activité du consortium privé de recouvrement dont la création a été décidée par le gouvernement précédent. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles modalités sont envisagées pour la conduite de ce suivi, qui doit permettre d’apprécier l’activité de cet organisme, ainsi que l’impact économique, social et environnemental de la taxe ?
À ce stade de mon intervention, je souhaiterais aborder la question de la privatisation des réseaux autoroutiers décidée par le gouvernement Villepin. Pour ma part, je l’ai toujours considérée, plus encore que comme une erreur, comme une faute politique !

Les bénéfices des sociétés concessionnaires n’ont jamais été aussi importants, puisqu’ils dépassent largement, chaque année, le milliard d’euros. Dès lors, on est en droit de se demander si la mise en place de la taxe poids lourds sur les routes nationales et certaines départementales ne constituera pas, finalement, une aubaine pour les sociétés autoroutières, dans la mesure où elle pourrait favoriser un report de trafic sur leurs réseaux, ce qui leur procurerait des recettes supplémentaires.
Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement projette de tenir compte de ce probable surcroît de ressources pour les sociétés autoroutières, en faisant évoluer la fiscalité qui leur est applicable ? Dans l’affirmative, les fonds supplémentaires issus de la redevance domaniale seront-ils affectés à l’AFITF ? Sinon, serait-il envisageable de relever la taxe d’aménagement du territoire payée par les concessionnaires d’autoroutes, dont une toute petite partie seulement sert à financer les trains d’équilibre du territoire ?
La taxe poids lourds permettra aussi de rééquilibrer la concurrence entre la route et le rail, en prenant en compte les externalités négatives du transport routier. Néanmoins, son efficacité dépendra aussi de sa généralisation à l’échelle européenne : où en sont, monsieur le ministre, les discussions sur ce sujet ?
Monsieur le ministre, le groupe socialiste approuve le contenu de ce projet de loi et apportera son entier soutien au Gouvernement. Je tiens à saluer la qualité de ce texte, ainsi que celle du rapport et des amendements de Roland Ries. §

Le groupe du RDSE attache également une grande importance à la révision en cours du schéma national d’infrastructures de transport, le SNIT.
La mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds fait consensus. À travers le présent texte, vous résolvez des difficultés juridiques, monsieur le ministre, ce qui est très positif. Cela étant, le projet de loi traite davantage des services que des infrastructures de transport.
Un petit regret de notre part tient à l’absence de prise en compte de la notion d’aménagement du territoire, même si, j’en conviens, là n’est peut-être pas le propos du texte. C’est pourquoi j’ai déposé, avec plusieurs de mes collègues du groupe du RDSE, des amendements en ce sens. Nous verrons quel sort leur sera réservé. Je ne refuserai pas de les retirer, dans la mesure où nous pourrons obtenir quelques assurances en matière d’aménagement du territoire.
Il semble bien difficile de développer le report modal par l’instauration d’une taxe sur le mode routier alors que le train ne dessert plus certaines zones rurales et hyper-rurales et que nombre de territoires sont encore dépourvus d’autoroutes, de routes à deux fois deux voies, de gare importante, de desserte par TGV, d’aéroport ! Aujourd’hui, un trajet aller-retour par le train entre Mende et Paris dure dix-neuf heures… Certaines situations font grincer des dents. Beaucoup se plaignent, dont le territoire est pourtant desservi par une liaison aérienne avec Paris, tandis que d’autres n’ont rien ! Il faut parler de ces territoires démunis de tout !

M. Alain Bertrand. Je ne parle pas que pour mon département, ma chère collègue ; je suis magnanime : je parle pour tous les territoires ruraux délaissés de la République !
Nouveaux sourires.

Comment inciter à une évolution des comportements s’il n’existe pas d’alternative crédible à la route ? Sans même aborder l’aspect économique, il suffit de souligner que le transport ferroviaire de marchandises n’est plus opérationnel en bien des points du territoire.
Sur le principe, s’il n’est pas question de remettre en cause l’écotaxe poids lourds, dont l’instauration est une bonne chose au regard du développement durable, on ne saurait ignorer les difficultés que présentent les modalités de son application.
Encore une fois, cela a déjà été dit par plusieurs orateurs, les territoires ruraux et hyper-ruraux vont se trouver pénalisés. Dans ces zones, tout est déjà plus cher, à commencer par les approvisionnements et les carburants, alors que les services sont éloignés : il faut parfois parcourir trente kilomètres pour consulter un médecin, les trois centres hospitaliers universitaires les plus proches de mon département sont distants de 230 kilomètres, les enfants ne peuvent poursuivre leurs études sur place, faute d’établissements d’enseignement supérieur… Les transports coûtent donc très cher à la population, et rien ne peut se faire si l’on ne dispose pas d’une voiture ! Cette situation me semble contraire au principe républicain d’égalité entre les citoyens.
Les petites entreprises rurales assurant la distribution de proximité, déjà pénalisées par l’enclavement, souffriront de la concurrence des grands opérateurs, qui reporteront leur trafic sur les autoroutes à péage et paieront ainsi proportionnellement moins cher au titre de l’écotaxe. Sur ce sujet, monsieur le ministre, il convient d’être vigilant.
J’espère du moins que le nouveau SNIT, qui sera connu prochainement, tiendra compte de ces enjeux. Je rappelle que l’article L. 1113-3 du code des transports dispose que la programmation des infrastructures doit prendre en compte l’aménagement et la compétitivité des territoires. Si les seuls critères retenus sont la démographie et le rendement économique, la notion même d’aménagement du territoire se trouve vidée de toute substance ! Or, il ne faut pas oublier que le monde rural offre des services, notamment aux habitants des grandes villes qui viennent s’oxygéner en Ardèche, en Haute-Loire, dans le Cantal, en Corrèze, dans l’Aveyron, dans les massifs montagneux. Tous ces territoires doivent donc être convenablement desservis.
Mes chers collègues, j’aurais pu vous parler de la RN 88, de la RN 122, en Auvergne, ou de la RN 21, chère à Raymond Vall, mais, par manque de temps, je ne le ferai pas.
Il faut cesser de fonder les choix d’infrastructures uniquement sur les critères du nombre d’habitants ou de l’intensité du trafic routier. C’est une question de solidarité entre les territoires. Il n’y a pas que les grandes agglomérations, les grands ports et les capitales régionales ! Au demeurant, le président François Hollande, dont je soutiens l’action, a clairement exprimé sa volonté en la matière, par la création d’un ministère dont l’intitulé fait mention de l’égalité des territoires.
Par conséquent, si la mise en œuvre de l’écotaxe est une mesure positive, il faut, en matière d’aménagement du territoire, des actions, des décisions, du concret, en somme des preuves d’amour ! En effet, dans notre pays, tout le monde prétend aimer la ruralité, mais les actes ne suivent guère, et je ne parle même pas de l’hyper-ruralité… Or il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ! §
Certes, sur les 1, 2 milliard d’euros que rapportera chaque année l’écotaxe, les collectivités territoriales devraient toucher 160 millions d’euros, mais cela est bien moins que les 280 millions d’euros dont bénéficiera l’entreprise italienne Autostrade per l’Italia. Cette situation me choque un peu. En outre, comme l’a souligné mon collègue Michel Teston, le réseau concédé engrangera, grâce aux reports de trafic, un surcroît de recettes estimé entre 200 millions et 400 millions d’euros !
J’aimerais aborder rapidement un autre élément tout aussi choquant.
Aux termes de l’article 275 du code des douanes, « par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité ». Je trouve pour le moins surprenant que parmi les bénéficiaires de la minoration de la taxe poids lourds figurent les régions Aquitaine, Bretagne ou Midi-Pyrénées, qui comptent pourtant des agglomérations de plus d’un million d’habitants, des aéroports internationaux, des nœuds autoroutiers, …

M. Alain Bertrand. … au contraire d’un département tel que la Lozère, qui n’est desservi ni par l’avion, ni par le train, ni par des routes à deux fois deux voies… On croit rêver ! Je n’ai rien contre l’Aquitaine, la Bretagne ou la région Midi-Pyrénées, mais avouez que le Finistère, la Gironde ou les Pyrénées-Atlantiques, que je connais bien pour suivre parfois une cure d’amaigrissement à Biarritz en compagnie de Louis Nicollin
Sourires.

Monsieur le ministre, cette situation, qui résulte d’arrangements entre copains – je n’ai pas dit entre coquins… – n’est acceptable par aucun républicain ! Je vous demande d’y être attentif. Le projet de loi va dans le bon sens et nous le voterons, mais l’équité en matière d’aménagement du territoire est une dimension importante ! Le Président de la République a dit qu’il voulait une France juste : une France juste, c’est aussi un aménagement du territoire juste, une répartition des infrastructures juste ! Nombre de mes collègues pensent comme moi.
Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera essentiellement sur le titre II du projet de loi, c'est-à-dire sur le volet relatif aux transports routiers, en particulier sur le mécanisme de la taxe nationale sur le transport routier, couramment appelée « écotaxe ».
À l’origine, la mise en place d’une telle mesure correspondait à la transposition d’une directive européenne. Comme l’ont rappelé plusieurs intervenants, le mécanisme de la taxe poids lourds avait été introduit par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle 1 », et par la loi de finances pour 2009. L’objectif était triple : réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises en favorisant les autres modes de transport, rationaliser le transport routier sur courtes et moyennes distances, financer les nouvelles infrastructures nécessaires à la politique de développement intermodal des transports. Nous ne pouvons que souscrire à de tels objectifs.
Le législateur avait assorti la création de l’écotaxe poids lourds d’un mécanisme de répercussion de plein droit permettant au transporteur d’en répercuter le montant sur le chargeur. L’idée était d’adresser un « signal prix » au chargeur, afin de l’inciter à se tourner vers le transporteur le plus vertueux sur le plan environnemental ou de recourir à un mode de transport de substitution. Là encore, nous ne pouvons qu’adhérer à une telle approche.
Cet objectif environnemental, fixé par le précédent gouvernement, était parfaitement louable sur le principe ; je tiens à le rappeler aujourd’hui. J’étais favorable à une telle disposition, que j’ai votée sans hésiter, considérant bien évidemment important de se préoccuper de l’environnement, comme le font nos voisins européens : en Allemagne, par exemple, une taxe analogue est en vigueur depuis 2005.
Seulement – et cette nuance change radicalement la signification de la démarche –, préserver l’environnement ne doit pas systématiquement signifier scléroser toute activité économique sur un territoire. Or c’est bien ce qui risque d’arriver si nous appliquons l’écotaxe sans discernement. S’occuper d’écologie, oui ; fragiliser l’économie, non ! Notre collègue Alain Bertrand l’a souligné avec beaucoup de saveur et de ferveur : nous devons veiller à l’équilibre de nos territoires.
Ayant longtemps exercé les fonctions de rapporteur pour avis de la commission de l’économie pour les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables », j’ai aussi été rapporteur, en 2004, du projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l’environnement, voulue par le Président de la République de l’époque. J’ai toujours eu à cœur d’appréhender le sujet sans dissocier les enjeux environnementaux des réalités économiques ; j’ai toujours défendu l’idée que préservation de l’environnement et développement économique n’étaient pas antinomiques.
Dans le cadre de l’élaboration de la charte de l’environnement, j’avais d’ailleurs insisté sur le fait que le principe de précaution ne devait pas être érigé en principe d’inaction. Malheureusement, c’est l’interprétation qui en est faite par un certain nombre de décideurs ou d’acteurs. C'est la raison pour laquelle je n’ai de cesse, depuis cette époque, de réclamer que le principe de précaution soit assorti d’un principe d’innovation. Ce serait pertinent et cohérent avec le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi promu par le Président de la République. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler que nos amis socialistes avaient voté contre le projet de loi instaurant le principe de précaution, que nos amis du groupe CRC s’étaient abstenus et que les écologistes avaient disparu…
Je le maintiens, l’esprit était d’encourager les acteurs de la filière à adopter un comportement plus vertueux en termes d’environnement, sous couvert d’un mécanisme clairement incitatif.
Or, à la lecture du projet de loi, je constate que le mécanisme défini à l’article 7 est d’une autre nature. Il est proposé d’appliquer de plein droit à la facture de transport un taux forfaitaire de majoration fonction des points de chargement et de déchargement, quels que soient la distance parcourue, le nombre de clients livrés sur le trajet ou le réseau, taxé ou non, emprunté par le transporteur.
En d’autres termes, la majoration est désormais entièrement déconnectée du montant de taxe réellement acquitté. Cela dénature totalement le principe même de cette taxe, puisque le coût, pour le donneur d’ordres, sera indépendant du trajet effectivement parcouru. Certes, un tel mécanisme est beaucoup plus simple que celui qui avait été imaginé par le précédent gouvernement et n’avait d’ailleurs pu être mis en œuvre, du fait de sa complexité.
Il n’y a plus de réelle répercussion de l’écotaxe auprès du chargeur, qui pourra se voir facturer plus que ce qui aurait été dû. Cela est invraisemblable d’un point de vue tant juridique qu’économique. Une telle disposition ne peut être que source de contentieux entre chargeur et transporteur. Comment justifier la réalité du prix payé ? Comment éviter, pour le transporteur, d’être placé de fait dans une situation d’enrichissement sans cause ? On s’écarte totalement de l’esprit initial de la taxe, du fameux « signal prix » qui devait inciter à faire évoluer les comportements.
De même, le principe de l’application de taux forfaitaires, sans prise en compte de la silhouette et de la classe « Euro » des véhicules, ainsi que celui de la mise en œuvre de taux forfaitaires différents selon les régions, engendreront de véritables distorsions de concurrence entre les entreprises des différentes régions, les taux kilométriques variant de 6, 8 centimes à 19, 6 centimes. Même les chefs d’entreprise de Bretagne, région pourtant privilégiée à cet égard, s’inquiètent des effets d’un tel système sur le fonctionnement économique de leurs entreprises. Ainsi, d’après un article paru ce matin dans un quotidien du Grand Ouest, la société d’intérêt collectif agricole de Saint-Pol-de-Léon s’attend à un surcoût compris entre 4 millions et 7 millions d’euros du fait de la mise en œuvre de l’écotaxe. Selon le chef d’une autre entreprise implantée dans la région de Rennes et employant une cinquantaine de personnes, au-delà de 300 kilomètres de trajet, le prix du carton transporté sera inférieur au coût du transport…
Le dispositif risque donc de se révéler contre-productif. Encore une fois, je ne suis pas contre l’écotaxe : je suis simplement contre son application sans discernement. C’est ce qui m’a amené à déposer un certain nombre d’amendements.
J’illustrerai mon propos par deux exemples d’activités spécifiques de transport sur courtes distances qui seront lourdement touchées, alors qu’elles sont essentielles à la préservation de l’activité économique en zone rurale : celles des grossistes-distributeurs et celles des coopératives agricoles.
Il est évidemment souhaitable de développer le transport combiné ; tout le monde en convient. Mais, nous le savons bien, pour de courtes distances, de surcroît en zone rurale, il n’y a pas d’autre solution que la route. La livraison par camion est incontournable pour préserver le tissu économique local. Certes, certaines zones du territoire connaissent un flux important de véhicules, qu’il convient de canaliser. Pour d’autres, cependant, le transport routier est un besoin vital. Or, dans bien des cas, on constate que les professionnels de la filière se sont organisés pour optimiser l’utilisation des véhicules. C’est particulièrement vrai pour la distribution de proximité ; dans ce domaine, beaucoup d’efforts ont été réalisés pour rationaliser le transport routier. Au regard tant de l’environnement que de la compétitivité, ne vaut-il pas mieux mettre sur la route un camion un peu plus gros, desservant plusieurs clients, plutôt que de multiplier les livraisons individuelles ? Cela permet de limiter le nombre de camions sur les routes.
Or le dispositif présenté, comportant une majoration forfaitaire appliquée sans discernement ni possibilité de dérogation, risque de tout remettre en cause. Pourquoi un client privilégierait-il le modèle logistique des tournées ? Économiquement parlant, il sera préférable de créer une liaison directe.
Le problème n’est pas simple. L’ancien gouvernement avait d’ailleurs rencontré beaucoup de difficultés pour concevoir l’écotaxe.
Le dispositif proposé est également particulièrement problématique pour les coopératives agricoles. La nature même et le fonctionnement d’une coopérative impliquent le recours incontournable et fréquent à la route, sans qu’il existe d’alternative modale, pour assurer des tournées dont la fréquence croît avec le caractère périssable des produits agricoles non transformés.
Les coopératives sollicitent essentiellement les petits transporteurs, qui seront fragilisés par la mise en place et par le suivi d’un tel dispositif puisque seuls les transporteurs français auront l’obligation de majorer leurs coûts de transport pour répercuter la taxe. Cela créera forcément une distorsion de concurrence avec les transporteurs étrangers, qui paieront la taxe, mais ne seront pas tenus de majorer leurs prix de transport pour la répercuter sur le chargeur.
Parce qu’il ne tient pas compte de la fragilité et des spécificités du monde rural, ce texte n’a pas été adopté en commission. Voilà pourquoi je me suis permis de déposer un certain nombre d’amendements, que je présenterai à nouveau tout à l’heure. Il me semble indispensable de prendre en compte la spécificité et la fragilité des transports de courte distance afin de préserver la compétitivité des entreprises concernées et une économie rurale harmonieuse. À défaut, nous assisterons à la disparition des petits opérateurs au profit des grands groupes, qui auront l’assise financière et les moyens administratifs pour absorber les effets de la mesure.
Sans vouloir faire de provocation, monsieur le ministre, car ce n’est pas dans mon tempérament, j’ignore si le projet de loi a été soumis à l’examen du ministre du redressement productif, mais je doute que ce texte favorisera le made in France ou le transport français !
Au moment où le Président de la République se prononce en faveur d’un regain de compétitivité de nos entreprises et de notre économie, il convient de bien être conscient que les mesures environnementales, aussi importantes et nécessaires soient-elles, doivent être prises en préservant les contraintes inhérentes à l’activité économique.

Tel sera d’ailleurs le sens des amendements que je défendrai.
Oui à l’écotaxe, mais non à sa mise en œuvre sans discernement ! Pour le dire plus clairement encore : oui aux préoccupations écologiques, mais non à la fragilisation et à la disparition du tissu économique dans les zones rurales déjà perturbées !
Comme l’a souligné notre collègue Alain Bertrand, tout le monde aime la ruralité, mais peu sont enclins à la protéger. Sauf à imaginer que vous acceptiez les amendements que j’ai déposés et qui visent à prendre en compte les spécificités du monde rural et de son tissu économique, au travers de ses PME et de ses TPE, je ne pourrai pas voter un tel projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – M. Alain Bertrand applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports pourrait presque paraître anodin par son intitulé. En fait, plusieurs dispositions et articles sont essentiels. Le rapport de Roland Ries, présenté en commission la semaine dernière et cet après-midi, en fournit l’exacte expression. Je veux d’ailleurs le féliciter de la clarté de ses exposés, ce qui a permis à chaque fois de bien préciser les enjeux.
J’en viens maintenant aux commentaires et parfois aux interrogations sur les articles 3, 4 et 7.
L’article 3 relève de la directive communautaire 91/440/CE et vise à renforcer l’obligation, déjà faite aux entreprises ferroviaires, de séparer les comptes entre gestionnaire d’infrastructures et exploitant de services de transport. Apparemment, la Commission européenne juge que cette directive est insuffisamment mise en œuvre : elle considère que l’obligation de publication séparée des comptes n’apparaît pas explicitement en droit national. Ce ne sera plus le cas après le vote de ce texte.
Je comprends que le Gouvernement veuille se préserver d’une procédure contentieuse, mais je m’interroge : jusqu’où la très libérale directive 91/440/CE peut-elle être utilisée lorsque ses attendus ne sont pas tous exécutés ? Par exemple, l’assainissement de la situation financière des entreprises ferroviaires n’étant pas réalisé en France, l’Europe ne peut-elle pas prendre ce prétexte pour perturber la nouvelle gouvernance que vous proposez, monsieur le ministre ?
Cependant, il y a lieu aussi de se réjouir de ce texte. Je me félicite ainsi du renforcement de la protection du domaine public ferroviaire prévu à l’article 4. Depuis 2010, la SNCF a recensé une nette recrudescence des vols de métaux, qui augmentent de plus de 300 %. Ces vols ne concernent d’ailleurs pas que la SNCF, ils se multiplient aussi dans les déchetteries dont nous avons la charge dans nos collectivités locales. Ils sont également en hausse de 30 % chez les particuliers. Les vols représentent, nous dit-on, un préjudice de 30 millions d’euros pour RFF en 2010.
Il est utile que des mesures préventives soient prises. En votant l’article 4, qui vise à élargir les catégories d’agents assermentés pouvant constater les infractions, nous renforçons le dispositif de prévention des vols.
S’il est un article qui compte et donne tout son crédit à ce projet de loi, c’est bien celui qui a trait à l’écotaxe pour les poids lourds de plus de 3, 5 tonnes. L’article 7 se rattache à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement d’août 2009, qui précise dans son article 10 : « La politique des transports contribue au développement durable et au respect des engagements nationaux et internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels. » L’objectif est bien de réduire les gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 dans le domaine des transports afin de lutter contre le changement climatique.
Cette écotaxe devait être généralisée à compter de juin 2012. Elle le sera, nous l’espérons, monsieur le ministre, dans le cadre de ce projet de loi, qui permettra non pas de créer la taxe, puisqu’elle existe déjà, mais de définir le mécanisme de sa répercussion.
Cette innovation financière s’inscrit dans le cadre communautaire fixé par la directive Eurovignette du 17 juin 1999. Elle a pour objet d’externaliser et de réduire les impacts environnementaux des transports de marchandises, et de favoriser le report modal sur le fret ferroviaire. Elle prévoit également de mieux faire payer les coûts d’investissement et d’exploitation du réseau par les poids lourds, quelle que soit leur nationalité. Elle tend aussi à rationaliser à terme le transport routier sur les moyennes et courtes distances. Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, elle prévoit – de nombreux intervenants avant moi y ont fait référence – de dégager des ressources pérennes pour l’AFITF, ce qui permettra en particulier de financer l’infrastructure ferroviaire.
J’apprécie, monsieur le ministre, le souci que vous avez manifesté dès votre entrée en fonction de vous ouvrir à un système de collecte négocié avec la profession. Ainsi, votre projet, que mes collègues du groupe socialiste et moi-même adopterons, permet de reporter la charge du transport sur le donneur d’ordre afin de ne pas la faire peser intégralement sur les transporteurs, car nous savons que les marges sont faibles dans cette profession.
À la différence du décret initial, l’article 7 prévoit la mise en place un système simplifié et non contesté. Ce dispositif de majoration forfaitaire unique est proposé pour toutes les catégories d’opérations de transport routier, quel que soit l’itinéraire emprunté.
La Fédération nationale des transports routiers, la FNTR, Centre-Val de Loire, dans une circulaire du 31 janvier 2013, précise que « Ce dispositif répond aux demandes de simplification de la profession. Il respecte dans ses deux dimensions interdépendantes la volonté du législateur exprimée à l’occasion du vote de la loi Grenelle 1. »
Nous pouvons le comprendre, les professionnels s’en seraient bien passés ; mais quitte à payer une écotaxe, autant qu’elle soit acceptable.
Je suis étonné, et je ne suis pas le seul, d’entendre nos collègues de l’ex-majorité douter aujourd’hui de l’écotaxe. Cette subite angoisse face à l’acte voté n’est plus une affaire de contenu ou de contenant, mais c’est finalement les deux à la fois ! Je suis d’autant plus étonné qu’ils ont accepté en leur temps que la société Ecomouv’, filiale d’un groupe italien, soit chargée de la mise en place et de la collecte de la taxe, dont le coût est très élevé, il est vrai, mais cela ne date pas d’hier !
Nos collègues s’ouvrent maintenant à de nombreuses demandes d’exonérations, principalement à celles des grossistes. Ces derniers, que j’ai également rencontrés, mettent en avant leur activité : ils ne se considèrent pas comme des transporteurs, mais se perçoivent comme des livreurs. Chacune de ces activités, qu’il s’agisse du transport ou de la livraison, est utile, mais c’est l’usage des infrastructures, et non le type d’activité, qui permet d’identifier le champ d’application du dispositif.
Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce texte et l’article 7 sont bien dans l’état d’esprit du Grenelle 1, adopté à une large majorité. Je me réjouis que, grâce à ce projet de loi, le report financier de la route vers le rail contribue aussi pour l’avenir à réduire l’inégalité de traitement du fret ferroviaire par rapport au fret routier. Néanmoins, nous le savons tous, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur les dispositions du titre IV du présent projet de loi relatives aux infrastructures et aux services de transport maritime.
En tant que présidente du groupe d’études de la mer et du littoral et ancienne rapporteure du projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, je me félicite des mesures proposées par le Gouvernement, car elles reconnaissent les spécificités maritimes de notre pays tout en améliorant sensiblement l’arsenal juridique et administratif qui concourt au développement durable de ces espaces particulièrement vulnérables.
À travers des articles d’un abord technique, il s’agit bien, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, d’avancer dans la conciliation du dynamisme économique, dont nos territoires maritimes sont porteurs, du progrès social, qui vise à lutter contre les concurrences déloyales et à protéger les droits des salariés, et de l’exigence écologique, qui garantit la soutenabilité de l’exploitation des ressources maritimes.
Avec l’article 23, tout d’abord, comme l’a souligné notre excellent rapporteur, le Gouvernement va aussi loin que les règles européennes l’y autorisent pour défendre des emplois durables et socialement responsables en France. L’extension des conditions de l’État d’accueil à tous les navires « utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service » et à tout le personnel navigant permettra de protéger efficacement les salariés et les clients, malgré l’absence regrettable d’un pavillon européen et d’une harmonisation sociale à l’échelle de l’Union.
Même si nous ne pourrons faire l’économie d’une stratégie nationale très volontariste pour accompagner le développement des infrastructures portuaires et améliorer leur compétitivité dans un contexte de forte concurrence internationale, l’article 15 apporte une solution juste et efficace à un problème qui entrave la bonne marche de nos ports et fragilise les équilibres financiers des autorités portuaires : les navires abandonnés. Ces épaves constituent une véritable gêne économique et une source de pollution importante.
En Bretagne, en particulier à Brest – mon collègue Ronan Dantec en a parlé –, nous subissons des situations inacceptables depuis de trop nombreuses années. Je songe, notamment, au Captain Tsarev, vraquier battant pavillon du Panama, qui a accumulé des créances importantes, en particulier 430 000 euros de droits de port envers le conseil régional de Bretagne...
En accélérant la déchéance de propriété et en identifiant clairement les responsabilités, le dispositif proposé est conforme aux conclusions du rapport Cardo. Le nouvel article L. 5141-3-1 et la modification de l’article L. 5141-4 du code des transports illustrent aussi le rétablissement d’une relation de confiance entre l’État et les collectivités, dans l’affectation tant des charges que des produits liés à ces opérations. Ce point mérite d’être salué.
En matière de sécurité maritime, le rapport insiste sur la diminution passée des moyens de contrôle des affaires maritimes, particulièrement « malvenue » et même « illégitime », alors même que l’efficacité des contrôles, notamment dans le cadre des nouvelles enquêtes administratives prévues à l’article 20, dépend du nombre des contrôleurs et de leur faculté à exercer leurs missions dans des délais toujours plus réduits. Je vous avais déjà alerté, monsieur le ministre, sur le fait que certains savoir-faire et compétences locales avaient en effet été perdus ou dilués par la fusion des corps des agents maritimes et le regroupement des inspecteurs du travail maritime au sein des DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
En l’espèce, au-delà de l’article 18, qui modifie à droit constant la référence aux différents corps civils des affaires maritimes, vous avez déclaré en commission, monsieur le ministre, que la reconnaissance de l’efficacité de l’administration maritime serait notamment débattue au sein du Conseil national de la mer et des littoraux. Nous approuvons largement cette démarche de concertation et d’ouverture, et nous savons que nous pouvons compter sur vous pour renforcer les moyens dont l’administration maritime est dotée afin de préserver et de mieux définir ses missions.
Toujours dans le domaine de la sécurité maritime, le Grenelle de la mer avait mis en évidence les difficultés d’application des procédures de constitution et de répartition du fonds de limitation de responsabilité incombant aux propriétaires de navire en cas de marée noire.
Les articles 16 et 17 permettent d’y remédier en faisant référence à la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite CLC, qui s’avère beaucoup plus contraignante que la convention de 1976 relative au régime général qui prévalait jusqu’alors. En particulier, le délai de présentation des créances est porté à trois ans en cas de marée noire, alors qu’il n’est que de trente jours en cas d’incident maritime. En outre, à la différence du régime général qui limitait l’indemnisation à la valeur du navire, cette nouvelle disposition ouvre désormais droit à l’intervention du FIPOL, le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Enfin, et surtout, l’obligation d’assurance portera non plus sur les navires transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures mais sur tous les navires transportant « une cargaison d’hydrocarbures en vrac ».
Ces mesures, même si elles constituent une sérieuse avancée, ne règlent cependant pas le problème des navires qui sombrent dans les eaux internationales et y provoquent des marées noires. Les « paquets Erika » ont constitué d’appréciables avancées mais nous devrons aller plus loin, car des failles jurisprudentielles demeurent.
Il nous appartient également, puisque nous avons été en France – particulièrement sur la côte atlantique – les victimes les plus importantes de ces marées noires, d’être beaucoup plus offensifs dans le domaine de la prévention, notamment avec ce qu’on appelle la « sécurité passive embarquée », car cet enjeu est majeur pour l’avenir de nos océans, de nos littoraux et de notre économie. J’ai donc été très heureuse d’entendre les propos de M. le secrétaire général de la mer lors du salon Euromaritime.
En effet, les opportunités offertes par cette sécurité passive embarquée sont tout à fait conformes à l’article 3 de la Charte de l’environnement, qui dispose que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
Il s’agit donc là d’une véritable urgence écologique, mais aussi – et surtout, ai-je envie de dire – d’une formidable perspective économique à travers le développement d’une filière innovante et créatrice d’emplois.
Des valves anti-fuites aux systèmes de récupération rapide du pétrole, en passant par les patchs magnétiques, la marge de progression est énorme, car ce sont encore près de 20 000 navires gros porteurs qui circulent autour du globe sans système d’accès d’urgence aux produits dangereux qu’ils transportent ou tout simplement à leur « carburant » dont la quantité pour certains n’est pas loin d’approcher les 15 000 tonnes. Je vous rappelle que l’Erika transportait un peu plus de 22 000 tonnes au total.
Avec le deuxième domaine maritime du monde, la France, monsieur le ministre, doit jouer un rôle moteur dans cette dynamique. Aussi me paraîtrait-il opportun que nous installions aussi rapidement que possible à votre convenance un groupe de travail ou de réflexion associant le Gouvernement et les parlementaires qui seraient intéressés afin que la France fasse des propositions concrètes en ce sens à ses partenaires européens dans le cadre de la présidence irlandaise et initie ainsi une mobilisation internationale qui devrait trouver son aboutissement au sein de l’OMI.
Comme pour les énergies marines renouvelables, nous faisons face à un très beau mais très grand défi. Pour l’environnement, pour notre économie, nous n’avons pas le droit de rater ces rendez-vous, et il y a urgence.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous commençons aujourd’hui l’examen du projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. Ce texte regroupe diverses mesures techniques concernant l’ensemble des modes de transports – maritime, routier, ferroviaire, fluvial et aérien –, dont la ligne directrice est de rendre ces transports plus propres au service de la transition écologique de notre économie.
Cela étant, c’est sur le titre II, qui aborde le volet routier, et plus particulièrement son article 7, qui définit le mécanisme de répercussion de l’écotaxe poids lourds, que je souhaite axer mon propos aujourd’hui.
Engagement du Grenelle de l’environnement, l’écotaxe a été adoptée dans la loi de finances pour 2009, mais son mécanisme a été revu à plusieurs reprises, à l’occasion des lois de finances pour 2011 et pour 2013. Elle doit entrer en vigueur le 20 juillet 2013. Elle a fait l’objet de beaucoup de débats et de questions de la part non seulement des transporteurs, bien évidemment, mais également des agriculteurs, qui s’inquiètent de la répercussion de cette nouvelle taxe sur leurs produits.
Le texte que vous nous présentez aujourd’hui, monsieur le ministre, précise les modalités techniques du système de répercussion.
L’écotaxe, inspirée du modèle allemand, vise à faire payer aux camions de plus de 3, 5 tonnes l’usage du réseau routier français non concédé, soit 12 000 kilomètres de routes nationales et 2 000 kilomètres de routes départementales ; 600 000 camions immatriculés en France et 200 000 véhicules étrangers devraient s’acquitter de cette nouvelle fiscalité. L’objectif est d’inciter les chargeurs à privilégier des moyens de transport plus respectueux de l’environnement que la route, comme le rail, les canaux ou les liaisons maritimes.
À la suite d’une large concertation avec les acteurs du secteur – sociétés de transport routier, donneurs d’ordre et leurs représentants –, un accord est intervenu en amont du projet de loi. Il a été convenu, avec l’ensemble des organisations professionnelles, de simplifier et de revoir totalement les modalités de répercussion de cette taxe. En effet, le gouvernement précédent, par décret en date du 6 mai 2012, avait prévu un mode de calcul extrêmement compliqué, qualifié par vous-même, monsieur le ministre, d’« usine à gaz ».
Ce décret a fait l’unanimité contre lui. Tout d’abord, il créait une surcharge administrative sans précédent et difficile à assumer pour les entreprises de transport, alors que 82 % d’entre elles ont moins de dix salariés. Ensuite, il rendait plus incertains les tarifs du transport, ce qui est une gêne pour les chargeurs. Les transporteurs ont, pour leur part, regretté que leurs frais de gestion liés à la taxe ne soient pas pris en compte. Rejeté par tous, le décret a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
Je me félicite que le Gouvernement ait eu le courage de supprimer ce décret qui faisait l’unanimité contre lui.
Le projet de loi présenté aujourd’hui prévoit donc un mécanisme permettant aux entreprises de transports routiers de mettre en place une répercussion facile à calculer et qui est un véritable « signal prix » à destination des chargeurs. Il s’agira d’une simple majoration du prix du transport pour prendre en compte l’écotaxe et en répercuter les conséquences sur les chargeurs.
La majoration est un pourcentage qui s’applique à un prix de transport librement négocié ; elle ne remet donc pas en cause le principe de liberté contractuelle. Elle est, avant tout, la recherche d’un équilibre entre chargeurs et transporteurs. Cet encadrement se justifie dans un secteur où le rapport de forces dans les négociations commerciales est déséquilibré au détriment des transporteurs.
Cette « majoration forfaitaire obligatoire » verra son montant fixé annuellement et par décret, région par région, en fonction du trafic constaté, des caractéristiques du camion et des distances parcourues. Les kilométrages seront mesurés au moyen de caméras ou de satellites, qui liront les boîtiers installés dans les camions.
Comme le rappelait notre rapporteur Roland Ries, nous avons entendu les craintes des déménageurs, des grossistes, ainsi que des coopératives, si importantes pour l’activité dans les territoires ruraux. Je pense tout particulièrement à la SICA de Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère.

Une nouvelle taxe n’est jamais une bonne nouvelle pour celui qui la paie, mais il convient de ramener les choses à leur juste proportion. C’est ainsi que nous soutenons la proposition de notre rapporteur qui vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport détaillé sur les effets de ce dispositif d’ici à la fin de 2014.
D’ores et déjà, monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur le fait que l’application d’une éco-redevance ne saurait pénaliser le développement économique d’une région. Je pense bien évidemment à la Bretagne, qui présente des qualités et des contraintes géographiques propres. Il y est en effet difficile de favoriser le transfert vers les voies ferrées et les voies navigables. Ces deux derniers modes de transport y resteront marginaux pour des raisons techniques et géographiques évidentes, liées à sa situation périphérique.
J’évoque la Bretagne puisque je suis élu de ce territoire, mais je pourrais aussi évoquer l’Aquitaine ou Midi-Pyrénées.
L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que le taux envisagé serait de 3, 3 % pour le dispositif de majoration forfaitaire unique breton.
L’écotaxe se doit de soutenir le développement économique d’un territoire tout en assurant un développement propre et respectueux de l’environnement, dans des conditions d’équilibre entre divers modes de transport, chacun d’eux ayant son domaine de spécificité propre.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous donner la garantie que les engagements pris envers les régions périphériques, régions qui souffrent d’un isolement relatif aux extrémités de notre pays, soient respectés et que la mise en place de cette écotaxe soit conduite avec la plus grande rigueur afin que les situations particulières soient prises en compte de la façon la plus complète et la plus précise possible.
Toujours sur le transport routier, permettez-moi, monsieur le ministre, d’évoquer la situation des fonctionnaires chargés du contrôle et de la verbalisation sur la route des véhicules poids lourds. J’ai eu l’occasion de rencontrer un de leurs représentants.
Ces personnels seront essentiels pour la bonne mise en place de l’écotaxe, mais également pour les nouveaux contrôles issus du décret du 4 décembre 2012 portant de 40 à 44 tonnes le poids maximum des camions. Ils sont les représentants du ministère en matière de sécurité routière, mais également en matière de droit social.
Afin de débloquer leur situation, certains syndicats ont mis sur la table, en échange d’une revalorisation statutaire, la possibilité d’intercepter les camions, en lieu et place des gendarmes, comme cela se pratique dans d’autres pays européens. C’est selon eux un accord donnant-donnant. J’aimerais connaître votre sentiment, monsieur le ministre, sur les moyens de parvenir à un accord.
Enfin, je terminerai mon propos en passant de la route à la mer. J’ai déposé un amendement qui reprend un long travail entamé il y a plusieurs années sur le devenir des bateaux de plaisance hors d’usage. Ces épaves sont une source de tracas pour les collectivités locales du littoral.
Chaque année, on dénombre quelque 2 000 bateaux de plaisance arrivant « en fin de vie », retirés de la navigation, tournant à l’état d’épaves, stockées, brûlées ou coulées en mer sans égard au fait que celles-ci renferment des déchets dangereux. Ces bateaux poubelles qui se trouvent pour la grande majorité d’entre eux sur le domaine public sont un véritable fléau et représentent une pollution visuelle et environnementale.
Le Grenelle de la mer a abordé cette question. À cette occasion, les acteurs économiques du nautisme et de la plaisance ont sollicité les pouvoirs publics sur l’urgence de la mise en place d’une réglementation en faveur de la déconstruction des bateaux. S’il existe aujourd’hui des démarches industrielles de déconstruction, il est important que cette question, qui touche à la propriété privée, relève des pouvoirs publics.
J’ai donc déposé sur ce sujet un amendement dont l’objet est que la destruction des bateaux hors d’usage prenne une dimension nationale essentielle, à sa juste valeur environnementale. En ce domaine, les pouvoirs publics n’ont que trop tardé à agir. Cet amendement complète le projet de loi dans son article 15, qui prévoit de clarifier la procédure de déchéance de propriété pour les navires abandonnés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion générale ayant été riche et constructive, je ne répondrai peut-être pas à toutes les interrogations qui m’ont été posées, me laissant la possibilité d’y revenir au cours du débat.
Les intervenants ont souligné l'enjeu et l'ampleur du texte, mentionnant les thématiques qu’il aborde et insistant sur les points clés. Je remercie d’ailleurs celles et ceux d’entre vous qui ont mis en avant l'impulsion politique donnée par le Gouvernement et sa volonté d'améliorer un dispositif, qui s’avère – chacun s’accorde à le reconnaître, quels que soient son appartenance et son statut politiques – particulièrement complexe à mettre en œuvre, d'autant qu'il touche à une réalité économique.
Permettez-moi de développer brièvement mes premières réactions aux différentes interventions, souvent complémentaires, sur ce texte, qui comporte vingt-cinq articles.
Je remercie d’abord le rapporteur pour les agréables remarques qu'il a portées sur ce texte, notamment sur les dispositions de nature à le rendre le plus opérant possible.
Cher Roland Ries, vous avez signalé que nous nous engagions sur la voie d'une fiscalité écologique, mais qu'il fallait être attentif à ne pas mettre en place un dispositif d'exonérations, à ne pas ouvrir la boîte de Pandore, pour reprendre votre expression. Vous avez raison, d'autant que nous sommes soumis au droit européen et que nous devons respecter des directives européennes ; j’y reviendrai.
Concernant l'article 5, j’ai bien entendu toutes les demandes d'explication, émanant de bon nombre d'orateurs ; j’y reviendrai plus précisément dans quelques instants.
Vous avez suggéré un renforcement de la transparence des comptes de la SNCF pour les régions. Il sera temps de vous apporter réponse et – j'en suis persuadé – satisfaction.
Je vous remercie d’avoir soutenu les dispositions « maritimes » du texte ; d’autres sont relatives au fluvial, un sujet auquel vous êtes attentif.
Je vous remercie également, madame Des Esgaulx, d’avoir mis en perspective ce texte et tenté d’expliquer, comme vous l'avez d'ailleurs très bien fait dans votre rapport pour avis, les difficultés inhérentes au dispositif mis en place. Vous avez souligné la volonté du Gouvernement de le rendre lisible, d’assurer son entière application et, surtout, de ne pas pénaliser un secteur d'activité. Certains orateurs l’ont signalé, plus de 80 % des acteurs du transport routier sont de petites entreprises de moins de dix salariés. C'est dire combien les difficultés peuvent être grandes notamment en termes de comptabilité.
Vous avez eu raison de le souligner, la répercussion, c’est la traduction du principe « utilisateur-payeur » du Grenelle, instauré par l'article 153 de la loi de finances pour 2009.
Cela a été rappelé par bon nombre d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la plupart des dispositifs ont déjà été votés, à tout le moins leur cadre et leur champ d'application. Je tenais moi aussi à le rappeler, car il semblerait que certains, peut-être libérés par le fait de ne plus être dans la majorité, manifestent quelques velléités ! Quand on est dans l'opposition, on s'affranchit d'un certain nombre de réalités, qui s’imposent pourtant à tous. Je le redis, ces dispositifs ont été votés, leur cadre et champ d'application ont été mis en place. Il faut maintenant rendre l’ensemble cohérent.
Vous avez demandé un système de simulation pour les redevables, madame la rapporteur pour avis. Effectivement, c’est une sage information qui peut leur être apportée. Vous avez aussi évoqué une commission nationale de suivi et posé un certain nombre de questions quant aux dates d'application des dispositifs ; j’y reviendrai lors de la discussion des articles.
Monsieur Capo-Canellas, vous avez souhaité obtenir diverses précisions. Vous avez adhéré à certaines prises de position concernant le principe et les modalités d'application. J'y reviendrai plus précisément lorsque j’aborderai les articles qui ont été particulièrement commentés lors de la discussion générale.
J’ai entendu votre demande, monsieur Chevènement. Nous devrons faire en sorte que l’AFITF bénéficie de moyens importants. Nous sommes au cœur de la discussion, et votre soutien est une force supplémentaire.
Ronan Dantec et Odette Herviaux ont évoqué l’importance des questions maritimes. Là encore, je reviendrai sur ce point dans quelques instants.
Effectivement, madame Schurch, la procédure accélérée a été engagée sur ce texte. J'ai toutefois pris soin, autant qu'il m'était possible, de consacrer tout le temps nécessaire aux parlementaires qui souhaitaient m’interroger. Vous avez relevé les raisons pour lesquelles la procédure accélérée a été engagée, et j'ai expliqué pourquoi il était nécessaire que les dispositions du projet de loi soient applicables dans un laps de temps assez court. Ce texte doit permettre d’apporter les réponses que les professionnels attendent.
Vous m'avez également interpellé, tout comme Mme Herviaux, sur la réalité des corps professionnels et sur le rapport de la Cour des comptes concernant les administrations maritimes, auxquelles nous sommes attachés. Nous serons d’ailleurs amenés à revenir sur ce point lors d'autres débats.
Vous avez souligné que le texte était « équilibré et courageux », ce qui m’a ému et touché.
Exclamations amusées sur plusieurs travées.
Je vous remercie de cette remarque.
Monsieur Grignon, vous avez mis en exergue la volonté du Gouvernement de mettre l’accent sur les conditions de sécurité dans le transport ferroviaire et, surtout, sur l'approche environnementale. Comme Michel Teston, vous avez souhaité aborder l'ensemble des articles, et j'y ai été sensible car vous avez évoqué des articles moins commentés relatifs aux questions ferroviaires. Je pense notamment aux articles 1er, 2 et 4, et à la question de l'assermentation d'un certain nombre d'agents.
J’ai été touché, monsieur Bertrand, par vos remarques concernant l'aménagement du territoire. Vous êtes très suivi dans votre département puisque, au moment même de votre intervention dans la discussion générale, je recevais un tweet m’enjoignant de ne pas oublier la Lozère et la RN 88 ! Même si, dans votre département, il n’y a ni autoroute, ni aéroport, ni TGV, il y a des personnes qui savent relayer – et de belle manière ! – vos préoccupations. Ce clin d'œil, qui n’est peut-être que le fruit du hasard, m'amène finalement à évoquer le sujet que vous souhaitiez mettre en avant : l'aménagement du territoire.
Tous les textes relatifs aux transports sont effectivement au cœur de cette problématique, et le report modal en est l’un des enjeux. Nous avons eu l'occasion d'en parler, vous savez combien ce sujet est cher au Président de la République ; il m’appartient, avec mes collègues du Gouvernement, de lui donner réalité.
Monsieur Bizet, je vous rappelle que vous avez voté le texte de 2008. Or vous semblez aujourd'hui être en proie au remords.
Vous souhaitez revenir sur une prise de position qui a peut-être été involontaire ou contrainte. Quand on appartient à la majorité, on ne fait pas toujours ce dont on a envie ! Le fait d’avoir recouvré la liberté vous donne, me semble-t-il, la possibilité de préciser votre point de vue, mais je prends peut-être quelques libertés avec l'interprétation de vos propos…
Je tiens à vous dire que les questions que vous avez évoquées, notamment l'activité des grossistes, le transport local et la majoration forfaitaire, ont été traitées dans le texte que vous avez voté. S’agissant de l'écotaxe poids lourds et de son champ d'application – j’y reviendrai avec force détails et argumentations –, vous devez savoir que tout cela figure dans ce texte, qui est aujourd'hui opposable à tous.
Ce dont nous discutons aujourd'hui, c’est de la répercussion des dispositions de ce texte. Vous mettrez à mon crédit et à celui du Gouvernement que nous cherchons à protéger les transporteurs, particulièrement les petits transporteurs. D'ailleurs les professionnels ne s'y sont pas trompés et ont dit tout le bien qu'ils pensaient de notre démarche…
… ou, à tout le moins, de la discussion que nous avons engagée avec eux ; mais peut-être n’y avez-vous pas prêté suffisamment attention ?
Je souhaiterais revenir rapidement sur quelques articles.
Le rapporteur, la rapporteur pour avis, ainsi que MM. Capo-Canellas, Grignon et Teston, ont souhaité que j’apporte des précisions sur l'article 5, ce que je ferai lors de l’examen des amendements. Vous avez rappelé, monsieur Teston, combien la réforme de la décentralisation de 2004 avait laissé un souvenir douloureux à bon nombre d'élus locaux et de représentants nationaux. Je suis attentif à cette question, sur laquelle je vous rassurerai dans quelques instants.
S’agissant de l'article 7, il a nourri l'essentiel des interventions, que je ne vais pas toutes reprendre. Vous avez souhaité, monsieur Capo-Canellas, connaître les mesures d’accompagnement et savoir s'il était possible de décaler de quelques semaines. Je reviendrai sur ce point. Il a également été question de l'expérimentation à blanc, qui fait l’objet d’un amendement de M. Ries, et particulièrement du sort que vous souhaitez réserver à l'expérimentation alsacienne.
Vous avez cité le cardinal de Retz ; je ne sais pas si c’est à mon détriment que je sortirai de l’ambiguïté, en l’occurrence laissée par d’autres… Vous avez tout de même estimé que le projet de loi était audacieux et que la politique du Gouvernement l’était également, au moins sur deux points : la future réforme ferroviaire et l'écotaxe poids lourds. Je pourrais donc reprendre à mon compte cette célèbre citation : « De l'audace, encore de l'audace, toujours de l’audace ! » Mais puisque nous sommes ici au Sénat, et non à l'Assemblée législative en 1792, laissons à Danton ses propos et revenons à notre débat sur l'écotaxe poids lourds…
Monsieur Dantec, vous avez évoqué les propos du Président de la République ; il est toujours agréable d'entendre les parlementaires le citer. L'écologie n'est pas une punition. Nous devons replacer ce texte dans le cadre de la fiscalité écologique ; le Gouvernement, par l’intermédiaire de ma collègue Delphine Batho, s’est engagé dans cet enjeu qu’est la transition énergétique, afin que nous puissions atteindre un rang de classement plus honorable dans ce domaine. Sur les 20 milliards d’euros nécessaires, en voilà déjà 1, 2 milliard !
Vous avez mentionné d'autres points, comme les poids lourds de 25, 25 mètres et les discussions avec les SCA, les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Les longues heures de débat qui nous attendent me permettront de vous apporter quelques précisions à ce sujet, sur lequel vous avez des préventions. Vous n'êtes d’ailleurs pas le seul, Michel Teston ayant dit en termes très clairs combien il se souvenait, comme certainement une grande majorité des parlementaires, de la privatisation des autoroutes. Nous avons aujourd'hui des rapports compliqués avec les SCA, qui gèrent un bien public, un domaine public.
M. Grignon a souligné que l’article 7 rendait plus lisible le dispositif du décret initial, qui ne survivra pas au vote – je l’espère positif – de votre assemblée. Néanmoins, il a également mis en avant un certain nombre de sujets posant des difficultés, comme les petits transporteurs, les poids lourds de plus de 12 tonnes, l'écotaxe alsacienne et l'expérimentation, sur lesquels je reviendrai.
M. Teston a apprécié la clarté du texte, mais est revenu sur l'activité d’Ecomouv’ et sur la nécessité d'évaluer, j'y faisais référence, l'effet d'aubaine dont les sociétés concessionnaires d’autoroutes pourraient bénéficier à la suite de la mise en place de l’écotaxe poids lourds.
Je remercie Jean-Jacques Filleul d’avoir évoqué l'importance des discussions avec les professionnels, parce que nous avons cherché à mesurer les enjeux et, surtout, à prendre en considération la réalité économique de ce secteur particulièrement en difficulté.
J’aurai également l’occasion de rassurer Jean-Luc Fichet sur l’application de la mesure aux régions périphériques.
J’en viens maintenant à un certain nombre d’articles qui ont été évoqués.
Jean-Jacques Filleul, Francis Grignon, Michel Teston et d’autres ont fait référence aux articles 3 et 4. Même si tous les articles portant sur le ferroviaire ont leur importance, vous avez eu raison de souligner, madame Schurch, qu’il ne s’agit pas encore de la grande réforme attendue. La concertation a ses nécessités, en termes de temps, de calendrier…
En attendant, ces articles m’offrent l’occasion de donner quelques précisions sur la compatibilité européenne, sur laquelle Jean-Jacques Filleul et vous-même vous êtes interrogés. Dans ce texte, l’« eurocompatibilité » existe, s’agissant notamment des questions maritimes. Nous avons aussi à cœur d’avoir une position nationale exigeante en matière d’interprétations européennes.
En ce qui concerne l’article 16, Ronan Dantec, Francis Grignon et Odette Herviaux ont regretté que nous n’allions pas suffisamment loin. Toutefois, dans la mesure où le dispositif juridique découlant des engagements internationaux de la France n’était pas applicable, nous avons souhaité que ce texte puisse permettre – c’est l’objet des articles 16 et 18 – une meilleure indemnisation, une meilleure prévention, une meilleure couverture des risques. Bien évidemment, nous aborderons les autres sujets dans le cadre de la politique maritime intégrée que nous souhaitons construire, à laquelle vous êtes attachée, madame Herviaux ; je le suis tout autant que vous !
Nous aurons également à revenir sur l’article 23, qui, d’une certaine manière, exprime la réalité que nous souhaitons donner à un cadre de concurrence. La concurrence existe mais ne peut être sauvage. Elle ne peut notamment se faire au détriment de dispositions sociales ou aboutir à ce que des statuts sociaux soient retenus pour certains services et écartés pour d’autres – je pense notamment au cabotage maritime.
Je reviendrai sur les précisions demandées. En tout état de cause, si les règles de la concurrence constituent une réalité incontestable de la compatibilité européenne, encore faut-il que leur application ne se fasse pas au détriment des règles nationales sociales et que les mêmes dispositifs soient applicables pour les mêmes types d’activités, particulièrement lorsqu’il s’agit du cabotage national.
Mme Schurch a souhaité la création d’un pavillon européen ; nous y sommes tous favorables. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous appelions de nos vœux la construction de ce pavillon européen, qui est la vraie solution face au défi maritime. Malheureusement, il faudra encore et toujours convaincre ! Vous avez vu combien il était nécessaire d’obtenir une majorité européenne pour construire les orientations d’une Europe de la croissance, de l’avenir et du respect des ambitions sociales qui doivent nous réunir…
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai essayé de citer les lignes de force de l’intervention de chacune et de chacun, mais, bien évidemment, vos prises de parole ont été beaucoup plus complètes, beaucoup plus riches, beaucoup plus denses que ne pourraient le laisser penser mes propos incomplets. Dans les prochaines heures de cette soirée et au cours de la journée de demain, il nous appartiendra de pouvoir vous donner des précisions et, peut-être, de convaincre ceux qui ne le seraient pas encore de l’efficacité et de la solidité de ce texte ainsi que de la motivation qui est la nôtre.
Il nous appartiendra aussi de redonner des perspectives de confiance à tous les transporteurs. Je pense notamment aux routiers, qui ont besoin de stabilité, de clarté et de simplicité face aux enjeux de demain. Ils ont déjà suffisamment de soucis, suffisamment de difficultés ! Et je ne parle pas de l’enjeu environnemental, du transfert modal et des modes de transports alternatifs. Il nous appartient d’avancer sur ces dossiers, dans le respect de chacun.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles du projet de loi initial.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de trente kilomètres ou de trente minutes d’automobile soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservant la capitale sans changement, soit d’un aéroport desservant la capitale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Bertrand.

Cet amendement vise à ajouter au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports un article précisant que, en 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de trente kilomètres – par opposition aux quarante-cinq kilomètres retenus dans l’amendement n° 79 rectifié – ou de trente minutes d’automobile soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservant la capitale sans changement – on aurait pu écrire « d’une ligne de TGV » –, soit d’un aéroport desservant la capitale.
L’objet de cet amendement est de symboliser la triple peine qui frappe toute une partie des territoires hyper-ruraux, qui, non seulement n’ont, en leur centre, ni autoroutes ni voies express en continuité avec le réseau national, mais n’ont pas non plus d’aéroport ni de lignes ferroviaires desservant directement Paris.
À mon sens, ces territoires doivent être prioritaires à l’avenir, au moins pour ce qui est de l’aménagement des territoires. Il faut donc inscrire une telle disposition dans le code des transports, la loi Voynet ayant quelque peu rompu avec cette volonté d’aménagement et de développement durable du territoire. Tous les élus qui tiennent à l’égalité des territoires et à une justice territoriale ne peuvent que partager ces objectifs.
Mes chers collègues, imaginez la situation des territoires qui subissent cette triple peine : ni avion, ni train, ni autoroute ! Or les citoyens sont égaux sur le territoire. À ce titre, ils ont un droit à l’avenir, ils ont un droit aux services publics, ils ont aussi un droit à l’aménagement du territoire. De même, les entreprises ont le droit de se développer, et les jeunes ont le droit de faire des études ! On ne peut pas non plus entasser tout le monde dans les mégapoles régionales ou, dans les régions maritimes comme le Languedoc-Roussillon, le long du littoral. On ne peut pas plus les entasser dans les grandes villes ou dans les zones des grandes conurbations ! D'ailleurs, de telles concentrations posent des problèmes de vie en société et de citoyenneté.
En cela, notre amendement, qui s’adresse à l’hyper-ruralité, est finalement bien ordinaire.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – En 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera situé à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Bertrand.

Cet amendement ne s’attaque qu’à deux éléments de la triple peine : il vise à ce qu’aucune partie du territoire français métropolitain ne soit située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. Autrement dit, s’il envisage des cas un peu moins graves, il va dans le même sens que l’amendement précédent.
Je le répète, ces amendements devraient être votés par la totalité des sénateurs. Il ne peut y avoir des sénateurs qui mettent un quart d’heure pour se rendre à l’aéroport le plus proche, disposent d’une autoroute ou de trains à grande vitesse et arrivent au Sénat frais comme des roses et d’autres qui commencent à se taper deux heures de voiture le matin sur des routes enneigées, puis dix-huit heures de train aller-retour.

Ce rééquilibrage répond à une exigence républicaine. C’est le b.a.-ba de la République !
Il faut que l’ensemble des sénateurs et des députés se mettent une bonne fois dans la tête que les ruraux sont solidaires de toutes les difficultés que connaissent les villes : le chômage, les problèmes de mixité et d’intégration, la délinquance, les difficultés qui se posent sur le plan scolaire ou familial. Réciproquement, parce que l’on est en France, qui est une grande République, il faut que l’ensemble des élus de la ville, en particulier des grandes villes, à l’Assemblée nationale et au Sénat, votent des lois qui donnent un signal aux ruraux. Les ruraux aiment la République, mais ils sont désespérés, et ils ont besoin de tout le monde.

Rassurez-vous, monsieur Bertrand, dans les grandes villes, nous sommes aussi solidaires. Pour autant, je ne suis pas absolument convaincu que le dispositif des amendements que vous proposez soit complètement opérationnel, même à l’horizon de 2020.
Vous souhaitez que la loi prévoie qu’en 2020 aucune partie du territoire français ne soit à plus de trente kilomètres ou de trente minutes de voiture – cinquante kilomètres ou quarante-cinq minutes selon l’amendement n° 79 rectifié – d’une deux fois deux voies ou d’une autoroute, d’une gare desservant la capitale sans changement ou bien encore, pour ce qui est de l’amendement n° 92 rectifié, d’un aéroport. Vos amendements ont quelque chose de revigorant, dans la confiance qu’ils portent au pouvoir de la loi...
Il est vrai que tel était encore l’esprit du Gouvernement en février 1995, ce qui ne nous rajeunit pas… L’article 17 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire disposait alors qu’ « aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse ». C’était en février 1995 ! Aujourd'hui, nous sommes encore loin de telles réalisations, et, sur ce point, je partage évidemment vos vues.
Pour ma part, je pense que l’on ne peut que souscrire à l’idée d’un équilibre dans l’aménagement du territoire, mais qu’il doit s’agir d’une orientation que nous défendons dans le cadre de nos travaux parlementaires, et non d’une disposition législative contraignante, que nous n’arriverons pas à respecter.
Par réalisme, la commission a émis un avis défavorable, mais, fondamentalement, nous sommes de tout cœur avec vous. D’ailleurs, monsieur le ministre, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements.
Monsieur Bertrand, autant je suis d’accord avec les orientations qui sous-tendent vos amendements, autant je suis sceptique sur l’obligation qu’ils visent à instaurer, l’aménagement du territoire ne pouvant miraculeusement changer en l’espace de quelques années.
Comme M. le rapporteur, j’ai entendu le cri du cœur qui retentit dans les amendements de MM. Bertrand et Mézard. Comment ne pas être sensible à la réalité des territoires, particulièrement dans cette Haute Assemblée ? Comment ne pas être attaché à ce qu’ils représentent en termes de traditions de vie, de patrimoine, mais également de réalité économique, de proximité, nécessaire à la richesse, de diversité ?
On ne peut se contenter d’évoquer ces belles images de la France, sans porter de considération au développement des services publics, des voies de communication, des infrastructures. Sans ce respect de la ruralité, on en reste à de belles images de vacances estivales ou de traditions culinaires. Bien au contraire, nous devons œuvrer à l’équilibre de ces territoires. Au reste, c’était tout le sens du débat démocratique qui s’est engagé lors de l’élection présidentielle.
Mesdames, messieurs les sénateurs, voyez le clivage qui peut exister entre, d’une part, un schéma national des infrastructures de transport estimé à 245 milliards d’euros et, d’autre part, les attentes des territoires.
Monsieur Bertrand, vous avez exprimé la nécessité de pouvoir rejoindre un chef-lieu de canton ou de département dans de bonnes conditions. Pour les habitants, ce sont aussi des enjeux de sécurité !
Soyez assuré que le Gouvernement travaille sur ces questions. Je pense notamment à Marisol Touraine, s’agissant de la santé : il faut maintenir, à proximité des territoires, dans des conditions non pas simplement économiques, mais répondant également à des critères d’aménagement du territoire, des établissements de santé accessibles au plus grand nombre, en particulier à ceux qui se trouvent dans des zones qui n’ont pas la chance d’avoir des services adaptés et en densité suffisante.
Le souci qui est le vôtre est légitime. Vous avez souhaité le rappeler en introduction à la discussion de ce texte, et vous avez raison. Je vous ai signalé combien le Président de la République souhaitait gommer la fracture territoriale ; c’est aussi l’ambition et peut-être l’un des critères de travail de la commission Mobilité 21, qui est présidée par Philippe Duron et où les sénateurs sont présents et représentés, mais – j’ai retenu votre remarque – parfois insuffisamment. La réflexion sur la notion d’aménagement du territoire doit donc aussi sous-tendre ses travaux.
Le Gouvernement souhaite améliorer en priorité les conditions de transport au quotidien. Cela implique d’intervenir sur les crédits d’entretien routier, qui doivent être augmentés. Vous avez raison d’indiquer que vous n’êtes pas seulement concerné par les grandes infrastructures. J’évoque le cadre des programmes de modernisation des itinéraires routiers et celui des contrats de plan État-région – ils seront augmentés de 13 millions d’euros pour l’année 2013. Nous souhaitons aussi mettre l’accent sur les questions de sécurité des infrastructures. D’une façon générale, les crédits seront sensiblement augmentés, avec 312 millions d’euros en 2012, 325 millions d’euros en 2013 et 350 millions d’euros en 2014.
Par ailleurs, l’écotaxe poids lourds ne répond pas à la volonté – je l’ai dit dans mon propos initial – de venir abonder le budget de l’État : elle est destinée à celui de l’AFITF, pour financer des infrastructures de transport.
Je le répète, vous exprimez une inquiétude légitime. M. le rapporteur a lui aussi souligné la force de votre propos, qui est à la fois touchant, je l’ai indiqué, et authentique, exprimant les attentes de vos territoires. Malheureusement, la loi ne fait pas tout. Ainsi, la loi Pasqua de 1995 était très ambitieuse du point de vue de l’aménagement du territoire. Elle comprenait des dispositions législatives opposables qui ne se sont pas appliquées.
Parfois, à trop vouloir donner de force à un message, on affaiblit la loi car son opposabilité n’est plus assurée. Bien entendu, là où la loi ne peut garantir la réalisation des objectifs, il faudra que la volonté politique s’exprime. Ce sera l’enjeu de l’action du Gouvernement.
Tout en étant très favorable au principe que vous exprimez, j’ai le regret d’émettre un avis défavorable sur ces amendements pour une question tenant à la forme.

Je voudrais rappeler que, en 2003, un rapport de la DATAR dressait déjà le constat que plusieurs territoires étaient enclavés en raison de leur éloignement d’une grande infrastructure routière, d’une gare ou d’un aéroport desservant Paris.
Dans ces conditions, je comprends qu’Alain Bertrand et Jacques Mézard appellent notre attention sur cette situation inacceptable. Leurs amendements ont ce mérite ; ils proposent de modifier le code des transports en fixant soit un temps de parcours à ne pas dépasser, soit une distance kilométrique maximale. Toutefois, cela fait de nombreuses années que nous réfléchissons à la question posée et il ne me semble pas que ces amendements constituent le meilleur moyen de lui donner une réponse adaptée.
Je pense qu’il vaudrait mieux profiter de la réflexion qui est actuellement menée sur la révision du schéma national des infrastructures de transport pour tenter de rendre prioritaire le désenclavement des territoires qui avaient été fléchés par la DATAR en 2003. M. le ministre a fait référence à ce travail, confié à un groupe constitué autour de M. Philippe Duron.
Je veux indiquer à Alain Bertrand et Jacques Mézard qu’il serait souhaitable de ne pas soumettre ces amendements au vote et de demander plutôt à M. le ministre si l’interprétation que je viens de donner des possibilités offertes par la révision du SNIT est envisageable. Ainsi, on obtiendrait certainement une réponse plus rapide et plus adaptée à la question soulevée, qui est fort légitime. Sinon, je crains que le texte que nous voterons ne reste lettre morte…

Nous sommes tous ici de fervents partisans de l’aménagement du territoire. J’avoue toutefois ma grande inquiétude à la lecture de ces amendements. Ainsi, si l’on fait un calcul rapide sur la base d’une maille de trente kilomètres, le territoire national se retrouverait zébré de lignes de TGV et d’autoroutes et l’on arriverait à une consommation de notre espace rural, …

… qui, même en tenant compte du « ou » figurant dans vos amendements, atteindrait des sommets inégalés en Europe et dans le monde.
Un autre élément m’inquiète encore plus : l’idée selon laquelle il serait nécessaire qu’une gare desserve la capitale sans changement ou qu’un aéroport permette cette liaison directe. Cette conception de l’aménagement du territoire me semble furieusement IIIe République. Ce pays a changé ! Les grandes villes – je regarde Roland Ries – ne raisonnent plus uniquement en se tournant vers Paris, même s’il faut bien un TGV Strasbourg-Paris.
L’avenir d’un certain nombre de territoires – nous sommes tous convaincus de la nécessité de leur développement – se joue désormais différemment. Je pense notamment au besoin croissant du renforcement des villes moyennes au regard du développement des deuxièmes et troisièmes couronnes dans les grandes agglomérations – phénomène qui ne concerne pas seulement la région parisienne. Or ces amendements n’intègrent pas ce qu’est devenu ce pays en termes d’enjeux d’aménagement du territoire – évolution que la loi Voynet avait amorcée en mettant l’accent sur le développement endogène de nos territoires.
Je voterai donc contre ces amendements, qui portent une vision de l’aménagement du territoire quelque peu datée et ne correspondant plus guère aux enjeux actuels. En tout cas, j’espère qu’un groupe de travail ou de réflexion permettra d’aller au fond de ces questions.
Par ailleurs, nous n’avons pas les moyens de tout faire et il faudra donc hiérarchiser les priorités. L’ardoise financière dépasse ici de loin les capacités du pays. Néanmoins – je me rapproche ici d’une partie des dispositions proposées –, il existe des territoires proches de Paris en TGV, avec des parlementaires qui arrivent frais et dispos en moins de deux heures – le temps de prendre son café en quelque sorte –, qu’une desserte autoroutière achève de désenclaver et qui souhaiteraient néanmoins que soient réalisés des investissements massifs parce que leur aéroport international n’est pas assez développé…
Il y a une vraie concurrence des offres de mobilité à grande vitesse autour de certaines métropoles. Avant de renforcer encore ces offres dans ces territoires déjà bien dotés – où elles arrivent en outre à se concurrencer entre elles, si bien que le retour sur investissement s’affaiblit –, il serait préférable d’investir soit dans la mobilité à grande vitesse au profit des territoires qui en sont dépourvus, soit dans une mobilité de qualité dans l’interconnexion entre les grands centres urbains régionaux et les villes moyennes – cela n’implique pas la grande vitesse –, ce qui est un enjeu majeur d’aménagement du territoire.
Je pense que nous pouvons nous retrouver sur ce point et, si un groupe de travail est créé, la question de la concurrence des offres de mobilité à grande vitesse dans des territoires très bien dotés y sera, à mon avis, d’actualité.

Monsieur le ministre, je savais qu’il y avait dans votre commune un footballeur exceptionnel, mais je ne savais pas que s’y trouvait aussi un ministre talentueux et brillant.

Vous défendez le Gouvernement, non pas de façon inconditionnelle, mais en manquant peut-être un peu d’objectivité…
Ici, personne n’a de monopole pour s’exprimer sur un sujet. Reste que quand on est malade ou handicapé, on parle de sa maladie ou de son handicap avec plus de vérité.
Le gouvernement d’hier – dont vous pourriez reprendre les propos – comme celui d’aujourd’hui oublient « la France d’en bas ». Disons-le franchement, peut-être parce que cette dernière est silencieuse, parce qu’elle compte moins d’électeurs ou parce qu’elle s’est un peu résignée.
Cher collègue Bertrand, cher voisin. En Lozère, vous êtes dans l’un des trois départements de France qui est totalement en zone de revitalisation rurale. Pour ma part, je suis dans un département où vingt-deux cantons sur trente-cinq sont en ZRR. Or, même s’il ne faut pas opposer les zones rurales et les zones urbaines, parce qu’elles sont complémentaires, il faut bien dire que la France rurale, la France d’en bas, on l’oublie depuis des années !
Avec ce projet de loi, dont certaines dispositions ont été votées en 2008, les départements ruraux subissent un nouveau tir, et je ne dirai pas sur une ambulance, car nous sommes des hommes qui avons un idéal. L’ancien gouvernement et celui d’aujourd'hui – vous avez évoqué ce qu’on pourrait appeler des images d’Épinal, monsieur le ministre – nous disent que la France rurale est belle. Oui, en Haute-Loire il y a des vallées, des cours d’eau, une alternance de forêts et de pâturages, mais il y a aussi des hommes qui ont un idéal, je l’ai dit, et qui veulent y rester !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP. – M. Alain Bertrand applaudit également.

J’ai beaucoup d’estime pour les amendements de MM. Bertrand et Mézard, dont je comprends les motivations, étant moi-même l’élu d’un département dont la densité moyenne est de trente et un habitants au kilomètre carré, cette densité étant même inférieure à quinze habitants au kilomètre carré dans la plupart des cantons.
Ayons toutefois la lucidité de reconnaître que notre territoire national métropolitain, celui visé par ces amendements, subit à la fois des contraintes géographiques, historiques et, dans les décisions d’aujourd'hui, économiques. Dans ces conditions, pouvons-nous raisonnablement voter ces amendements ?
Nous pourrions le faire : nous sommes dans l’opposition – ce serait faire malice au Gouvernement – et, avec un peu de bonne volonté, nous parviendrions à rassembler une majorité de circonstance sur des dispositions qui suscitent l’adhésion spontanée de l’ensemble des membres de cet hémicycle. Reste que cela ne serait assurément qu’un signal d’alarme, un témoignage d’alerte, comme vient de le faire, avec beaucoup d’émotion, Jean Boyer.
Monsieur le ministre, nous vous faisons crédit de votre ambition de nous présenter, après les travaux que M. Philippe Duron conduit suivant un calendrier que vous pourriez peut-être nous préciser, une réflexion globale sur l’ensemble des infrastructures dans notre pays. Dans ce débat, nous pourrions en effet reprendre les questions évoquées par nos collègues Bertrand et Mézard ainsi que les autres signataires de ces amendements.
Si nous votions ces dispositions, l’Assemblée nationale les retoquerait en soulignant que la Haute Assemblée a travaillé avec superficialité dans le registre de l’émotivité. Ce n’est pas notre culture ; sur un sujet majeur et grave, nous voulons travailler sur le fond et attendons du Gouvernement qu’il nous dise, connaissant les contraintes financières générales, particulièrement celles de l’AFITF – pour lequel l’écotaxe est assurément un soutien, quoique insuffisant –, comment gérer la pénurie.
Pour prolonger les propos de Jean Boyer, j’aimerais savoir pourquoi la région la plus dense, la plus riche, où la circulation est la plus forte et où les embouteillages sont les plus fréquents, soit également celle où les péages routiers sont inexistants. Tout provincial qui prend l’autoroute paie un péage au premier kilomètre !
Les douze millions de Franciliens vivent mal très largement parce que leurs réseaux routiers sont gratuits, ou l’étaient jusqu’à présent. Grâce à l’écotaxe, la Francilienne, l’A106 vont commencer à participer au financement d’infrastructures coûteuses qui pénalisent non seulement les Franciliens, mais également les provinciaux qui ont toujours, dans ce pays centralisé, la nécessité de venir à la capitale. Ils sont d’ailleurs deux fois perdants : parce qu’ils ont du mal à quitter leur territoire faute d’infrastructures et, quand ils en ont – ce qui est le cas de la Lorraine –, parce qu’ils arrivent dans une région parisienne saturée où les Franciliens sont certes mécontents mais accèdent à des infrastructures que nous, provinciaux, je le répète, payons dès le premier kilomètre parcouru.
Ce que nous attendons de vous, monsieur le ministre – les amendements de nos collègues Bertrand et Mézard sont manifestement des amendements d’appel –, c’est que, au-delà de la mise en œuvre de l’écotaxe, vous puissiez nous indiquer un calendrier. Les élus des territoires doivent pouvoir se retrouver pour assumer des choix, en sachant que les contraintes économiques, les réalités géographiques et l’histoire même de nos infrastructures et de l’organisation politique de notre pays ne nous permettront pas de tout réaliser. Il faut en effet accepter des priorités, qu’il vous appartient de nous donner au nom du Gouvernement, puis les accompagner par des financements.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne choisirons pas la facilité, qui serait de vous mettre en difficulté ; nous nous abstiendrons dès lors que vous nous fixerez un calendrier précis.

Je remercie M. Bertrand d’avoir engagé ce débat. J’habite pour ma part le Massif central et, à l’échelle de la France, on peut dire que le Grand Centre est le grand oublié de l’aménagement du territoire.

Au-delà des réseaux ferré et routier, nous avons des difficultés d’accès au haut débit, au très haut débit, à la santé. Nous faisons partie de ce qu’on appelle les déserts médicaux, les zones blanches.
Monsieur Bertrand, l’égalité des territoires est un sujet d’ampleur qu’il faut traiter de façon globale, en considérant non seulement les réseaux routier et ferré, mais également l’ensemble des accès de première nécessité dans les zones délaissées. C'est pourquoi je m’abstiendrai sur ces amendements, tout en vous remerciant de les avoir défendus, car il est important que la Haute Assemblée appelle l’attention du Gouvernement sur ce grand sujet.
Puisque le Gouvernement compte un ministère de l’égalité des territoires, ce que nous apprécions, j’invite Mme Duflot à nous fixer un rendez-vous afin que nous puissions avancer.
Le sujet de l’aménagement du territoire, de l’équilibre des territoires, même s’il a sa place dans le cadre de ce texte, relève en effet d’une politique globale et d’un débat à l’échelon national.
J’entends, monsieur Longuet, votre invitation à de la clarté, à de la méthode, peut-être même à des réponses…
Nous avons effectivement eu la volonté de saisir une commission ad hoc de parlementaires de différentes sensibilités sur l’équilibre du territoire.
Je ne dis pas que vous avez agi dans l’opposition entre les territoires, mais il est vrai que 80 % du transport transite chaque jour par l’Île-de-France et qu’un seul problème sur une ligne de RER affecte des centaines de milliers de personnes. Cela ne signifie pas pour autant, vous avez eu raison de le souligner, que les territoires de moindre densité ne doivent pas recevoir la même attention, le même intérêt. Les infrastructures peuvent induire le rayonnement d’un territoire et en tout cas éviter que les perspectives de chacun ne diffèrent, par un enclavement, sur notre territoire.
C’est donc un sujet qui concerne tous les territoires. J’entends d'ailleurs rarement les élus dire que leur région est très bien dotée.
Il faut toujours un TGV supplémentaire, plus rapide, une voie nouvelle, éventuellement un aéroport, d’autres autoroutes… Chacun adresse des demandes, voire des suppliques pour obtenir des infrastructures de transport sur son territoire.
Il faut pouvoir prendre en compte les attentes légitimes d’un certain nombre de territoires insuffisamment dotés d’infrastructures de transport. Dans le même temps, nous sommes confrontés à une attitude consommatrice de la part de certaines régions, qui veulent parfois additionner les modes de transport. Parmi les critères de réflexion de la commission Duron figureront bien évidemment le désenclavement et l’équilibre des modes de transport. Peut-on à la fois disposer d’une ligne à grande vitesse ferroviaire et maintenir un aéroport ?
De telles questions se posent régulièrement.
Il convient donc d’adopter, en la matière, une approche raisonnable. Les conclusions des travaux de la commission Duron seront l’occasion d’engager le débat. Les grandes infrastructures sont nécessaires, surtout lorsqu’elles ont une dimension européenne ou s’il s’agit de modes de transport alternatifs.
Pour autant, le désenclavement et l’aide aux collectivités les plus éloignées des infrastructures de transport sont un sujet à part entière. Je n’ai pas encore reçu Philippe Duron, parce que je ne souhaitais pas intervenir dans la classification des critères. Chaque euro d’argent public dépensé doit avoir aujourd’hui la plus grande utilité. Il reste à savoir ce que cette notion signifie. À cet égard, l’équilibre des territoires ne saurait être relégué au second plan ; il appartiendra à chaque élu, en toute responsabilité, d’avoir une telle approche.
Le Gouvernement, qui n’est pas aux affaires depuis très longtemps, vous en conviendrez, monsieur Boyer, s’efforce d’adopter depuis quelques mois une approche différente en matière de politique de transports. J’ai demandé que chaque territoire, je l’ai rappelé devant les préfets de région et de département, fixe la liste des infrastructures imparfaites et insuffisamment suivies.
Nous trouvons un peu partout sur notre territoire des exemples de mauvaise utilisation de l’argent public, ou en tout cas de programmes échelonnés sur plusieurs dizaines d’années, dont les prémices ont souvent pour vertu, certes non dénuée d’intérêt, de faire patienter les territoires, de donner les signes d’une volonté politique. Je pourrais citer la L 2 à Marseille, pourtant située sur un territoire très peuplé. Les exemples ne manquent pas de telle ou telle réalisation, ici un rond-point, là un viaduc, qui attend désespérément la voie qui doit la relier aux zones urbaines ou rurales.
Bref, j’ai demandé aux préfets d’opter pour l’efficacité en la matière, y compris en s’affranchissant parfois de l’excellence. Il s’agit non pas de remettre en cause la sécurité ou de belles réalisations dont nous sommes fiers, mais d’éviter de vouloir absolument construire une deux fois deux voies si elle n’est pas nécessaire, faute de se retrouver avec un objectif inatteignable et, au final, de perdre dix ou quinze ans de financements et de réalisations.
Il convient donc de revenir à plus de réalisme dans les équipements, y compris en termes de capacité financière. À cet égard, chaque territoire sera interrogé sur ses possibilités de réalisation, sur ses ambitions, mais aussi leur respect, notamment en appauvrissant certaines demandes excessives, tout en restant dans l’efficacité au service de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur Bertrand, les amendements n° 92 rectifié et 79 rectifié sont-ils maintenus ?

Comme en témoignent les propos qui ont été tenus tant par MM. Longuet, Boyer et Teston que par M. le rapporteur et M. le ministre, tout le monde a à cœur l’aménagement du territoire. J’espère que nous aurons réalisé un progrès sensible, monsieur le président de la commission, car nous avons tous intérêt à ce que notre territoire vive harmonieusement. Nous ne pouvons plus continuer à concevoir les infrastructures uniquement en fonction du nombre d’habitants, du rendement économique, du coût ; c’est contraire à l’esprit de la République.
Sans doute ma proposition sera-t-elle plus appropriée dans un texte concernant la décentralisation, l’égalité des territoires ou le SNIT ; je vous fais confiance. Dans ces conditions, je retire mes amendements. J’indique simplement à notre collègue écologiste que je ne défendais pas mon département, mais bien l’ensemble des territoires ruraux et hyper-ruraux. Je ne suis pas assez bête pour demander un TGV, un aéroport, une autoroute ou une deux fois deux voies ; je sais que l’argent est rare et qu’il doit être compté. M. le ministre a d’ailleurs insisté sur le fait que, dans la période actuelle, l’ambition de certains projets devait être revue à la baisse.
Quoi qu’il en soit, je vous remercie, monsieur le ministre, mes chers collègues, de la qualité du débat.
Applaudissements.
Au deuxième alinéa de l’article L. 2111-11 du code des transports, les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des circulations ».
L'article 1 er est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.