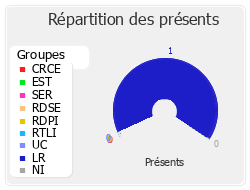Mission d'information sur l'action extérieure de la France
Réunion du 22 mai 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. jean-françois delfraissy directeur de l'agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales anrs (voir le dossier)
- Audition de m. patrick guillaumont président de la fondation pour les études et recherches sur le développement international ferdi et de mme sylviane guillaumont-jeanneney professeur émérite au centre d'études et de recherches sur le développement international cerdi
La réunion

Je voudrais vous remercier, Professeur Delfraissy, d'avoir répondu à l'invitation que nous vous avons adressée. Nous y sommes extrêmement sensibles et en sommes très honorés, car nous sommes impressionnés par votre parcours. Nous attendons donc beaucoup de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'information portant sur l'action extérieure de la France en matière de recherche et de développement.
Cette mission, constituée à l'initiative de Madame Ango Ela et de membres de son groupe, nous conduit à procéder à des auditions afin d'y voir plus clair dans la partie « recherche et développement » de la politique de développement de la France - politique qui a toujours joué un rôle important pour la France et pour les pays qui peuvent en bénéficier. Nous souhaiterions également voir si nous pouvons, à la faveur de ces rencontres et des cas concrets que nous examinons, formuler quelques propositions nouvelles en vue d'obtenir des résultats encore meilleurs que ceux constatés aujourd'hui. L'esprit qui nous anime est naturellement celui d'un partenariat actif et réciproque entre le Nord et le Sud.
Nous savons quelles responsabilités sont les vôtres, notamment à la tête de l'Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales. Nous connaissons aussi l'implication de la France dans la lutte contre le Sida. Nous n'avons pas ménagé nos concours et nous sommes parmi les premiers contributeurs à l'échelon mondial.
Un dîner de l'UNITAID aura d'ailleurs lieu ce soir à Paris, en présence de Bill Clinton, lui-même très engagé dans la lutte contre cette maladie. Je vous laisse la parole.
Je suis médecin. Je dirige un service de médecine et d'immunologie clinique à l'hôpital Bicêtre. Je suis fondamentalement un médecin puisque je garde « les pieds dans le cambouis », tous les matins, à l'hôpital. Je dirige l'Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales depuis 2005. La réforme de la recherche médicale en France a été pilotée par l'alliance Aviesan qui regroupe les grandes structures de recherche (Inserm, CNRS, IRD, Institut Pasteur, universités, hôpitaux...). Aviesan a été divisée du point de vue opérationnel et fonctionnel en une série d'instituts thématiques, les ITMO. Ceux-ci couvrent ainsi différents domaines (neurosciences, maladies cardiovasculaires, génétique), parmi lesquels la microbiologie et les maladies infectieuses. Il semblait assez cohérent que le directeur de l'ANRS dirige aussi l'IMMI (Institut de microbiologie et des maladies infectieuses). C'est pourquoi je dirige l'IMMI, avec Bernadette Murgue à mes côtés.
Compte tenu des problèmes rencontrés récemment sur les maladies infectieuses, avec des germes émergents venant de pays du Sud, on ne peut évoquer les maladies infectieuses sans parler du Sud. C'est pourquoi nous avons créé au sein de l'IMMI le groupe « Aviesan Sud », qui regroupe les différents acteurs de la recherche sur le terrain.

Je suis très heureuse que nous puissions avoir ce moment d'échange car l'ANRS a beaucoup apporté et innové dans la recherche, en particulier au Sud, mais aussi en rapprochant les sciences humaines des sciences biomédicales et de la médecine. Des apports innovants et importants ont vu le jour dans ce domaine, par le rapprochement d'équipes du Nord et du Sud ou le rapprochement d'équipes de différentes disciplines qui n'avaient pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Dans ce processus partenarial, comment s'opère l'identification des objets de recherche, tant au Sud qu'au Nord ?
Le Sida offre un modèle intéressant mais il n'est pas unique et il faudra l'élargir pour parler de santé de façon plus globale.
L'ANRS est une agence de coordination et de moyens, ce qui constitue une particularité en France. Elle est essentiellement financée par le ministère de la recherche, dans une moindre mesure par le ministère de la Santé. Elle n'est plus du tout financée par le ministère des affaires étrangères, sauf, de façon indirecte, à travers cinq postes d'assistants techniques. Nous consacrons 28 % des financements de la recherche au Sud, tant pour le VIH que pour les hépatites virales.
Ce tournant de la recherche avec le Sud a été pris par mon prédécesseur, Michel Kazatchkine (devenu ensuite ambassadeur pour le Sida puis directeur du fonds mondial à Genève), qui a lancé au début des années 2000, comme une priorité stratégique de l'agence, ce partenariat avec le Sud. Les fondements de ce partenariat ont alors été posés. Nous l'avons poursuivi en l'élargissant par la suite.
Le milieu associatif est présent partout au sein de l'ANRS, c'est-à-dire au sein du Conseil d'administration et du Conseil scientifique ainsi que dans les différentes instances de décision. Des représentants des associations de malades sont présents dans nos instances, ce qui constitue un modèle très particulier. Les origines de ce modèle s'expliquent aisément. Il existe dans le domaine du Sida des associations assez fortes et il y a eu beaucoup de lobbying autour des associations de malades. Ce modèle de construction de la recherche me paraît pertinent, car il revient à inscrire d'emblée la recherche dans le cadre d'une vision sociétale. Il faut qu'il existe une recherche « pour la recherche », qui se préoccupe peu des enjeux sociétaux ; mais une partie de la recherche doit aussi contribuer à répondre à de grands enjeux sociétaux. Ces deux volets sont nécessaires et sans doute avons-nous trop privilégié, à un moment donné, la recherche « pour la recherche ». Le milieu associatif permet ainsi de contrebalancer la tendance que nous pourrions avoir à privilégier la recherche « pour la recherche ».
Ce modèle a été construit au Nord, puis il a été construit au Sud : des représentants des associations du Sud sont également présents dans nos instances de décision pour le financement de la recherche au Sud. On nous avait dit que les associations du Sud n'étaient pas formées et ne seraient pas capables de suivre des projets aussi compliqués que ceux que nous menons. Ce n'est pas vrai du tout. Nous avons d'ailleurs contribué à leur formation et elles sont tout à fait en mesure de suivre ces activités scientifiques. Les décisions scientifiques restent prises par une majorité de chercheurs, ce qui est normal. Mais ce modèle fait une place, dans nos instances de décision, à une vision sociétale.
S'agissant de la construction de la recherche au Sud, notre budget nous imposait de faire des choix : nous avons considéré que nous ne pouvions être partout. Il faut ensuite préciser qui fait les choix : ceux-ci appartiennent-ils aux décideurs politiques, au ministère des affaires étrangères, aux scientifiques, aux agences ? Des choix sont en tout cas indispensables. On ne peut plus continuer de voir la France essayer de « papillonner » partout. Faire des choix est difficile, car cela revient à exclure un certain nombre de pays ou de partenaires potentiels. C'est néanmoins nécessaire pour être pertinent dans les pays où l'on demeure. Or les choix scientifiques ne correspondent pas nécessairement aux choix politiques.
Nous avons fait le choix d'inscrire notre action dans la durée, ce qui renforce la crédibilité de l'Agence depuis sa création il y a quatorze ans. Nous avons bien sûr fait le choix de l'Afrique francophone, qui demeure terriblement d'actualité, compte tenu de la prévalence de l'épidémie de VIH, de la visibilité et des enjeux qui existent dans cette région. Nous avons perdu un tour avec la Chine. Laissons-le passer et prenons délibérément un engagement africain qui nous donnera peut-être dix ans d'avance par rapport à d'autres, en particulier les Etats-Unis. Nous sommes également présents en Afrique du Sud, pour des raisons plus spécifiquement scientifiques, car c'est le pays qui est le plus touché par l'épidémie. Nous sommes présents en Egypte, où existe une épidémie d'hépatite C ancienne, suite à l'une des guerres israélo-égyptiennes. Le Président Nasser avait souhaité apporter quelque chose au peuple égyptien.
A l'époque, une maladie apportée par les eaux du Nil touchait une grande part de la population. Un traitement venait d'être mis au point, il y a vingt ou vingt-cinq ans, avec une administration par voie intramusculaire. Le Président Nasser a acheté ce traitement en grande quantité. Il a guéri de nombreuses personnes de la bilharziose mais il a contaminé environ 14 millions de personnes car les mêmes seringues avaient été utilisées. Il existe ainsi une épidémie d'hépatite C particulièrement forte dans ce pays.
Enfin, nous sommes présents au Cambodge et au Vietnam ainsi qu'au Brésil, à travers une collaboration sur un site. Au total, nous sommes ainsi opérationnels sur une dizaine de sites, où il existe à chaque fois un responsable « Nord » et un responsable « Sud », situés au même niveau. Ces sites génèrent des projets de recherche, car nous sommes une agence de recherche et non une agence d'aide au développement, même si elle peut, indirectement, y contribuer. Ces projets de recherche sont portés par les équipes du Nord et du Sud, à travers un « investigateur principal Nord » et un « investigateur principal Sud ».
Nous avons deux appels d'offres blancs, l'un le 15 mars et le second le 15 septembre, à travers lesquels les projets sont soumis. Puis ils sont retenus ou non. L'ANRS est divisée en grandes commissions qui évaluent les projets (recherche fondamentale, recherche translationnelle, sciences humaines et sociales). Une commission, chargée des projets du Sud, comprend des chercheurs du Nord, des chercheurs du Sud et du milieu associatif. Suite aux décisions de cette commission, où intervient un jugement par les pairs, une liste de projets est arrêtée. Le directeur de l'ANRS ne fait ensuite que valider la liste. Il peut arriver, de façon assez exceptionnelle, qu'il « rattrape » un projet, s'il le juge important pour des raisons stratégiques.
Nous avons accompagné cette action par la formation de jeunes médecins et de jeunes chercheurs dans les pays du Sud. Nous nous appuyons aujourd'hui sur des scientifiques, en Afrique, qui sont très bien formés, souvent après avoir fait une thèse aux Etats-Unis ou en France, dans différents domaines (recherche fondamentale, épidémiologie, sciences humaines et sociales). Le principal risque, pour ces élites, réside dans l'attraction que peuvent exercer l'OMS (où ils gagnent dix fois plus) et les grandes structures de Genève ou les grandes fondations américaines (Fondation Clinton, Fondation Gates, etc.), qui sont de véritables outils politiques pour les Américains. Après avoir formé ces élites, celles-ci restent à nos côtés si elles ont les moyens de travailler. Ces scientifiques sont prêts à faire des choix et à gagner moins, pourvu qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps : il faut que nous leur donnions les moyens de faire leur travail et de s'accomplir. Il y a là un enjeu particulièrement important.

Si je comprends bien, le lien entre la recherche et le développement, à vos yeux, passe davantage par la recherche qu'à travers les outils d'une politique de développement.
Je suis un médecin et un chercheur. Je m'intéresse bien sûr au développement mais mon métier est de produire des réponses à des questions de recherche, pour ensuite mieux les transférer au pouvoir politique en vue de la prise de décisions de santé publique. Les décideurs politiques doivent pouvoir prendre des décisions qui s'appuient sur des faits scientifiques. Telle est la production que nous devons générer.
La France a toujours défendu, pour ses structures de recherche, la vision selon laquelle il fallait des institutions de recherche plutôt tournées vers le développement, à l'image par exemple de l'IRD. A l'inverse, les Etats-Unis considèrent qu'il n'y a pas de recherche au Sud : ils embrassent les grandes thématiques de recherche sans a priori géographique, en considérant que ces thèmes existent au Nord comme au Sud. C'est le cas des maladies infectieuses. Nous le voyons pour les maladies émergentes, pour les virus émergents (par exemple le coronavirus). Cela vient du Sud puis touche le Nord, avant de repartir vers le Sud. Les résistances bougent. La notion de Nord et de Sud n'a plus grand fondement, en termes de recherche, sur le plan épidémiologique. Les Etats-Unis n'ont donc aucune structure de recherche dédiée au Sud : chacun des grands instituts thématiques travaille à la fois pour le Nord et pour le Sud. Cette vision me paraît solide pour la recherche, car elle est garante de la meilleure pertinence scientifique. On peut ensuite se demander s'il faut engager les équipes du Nord vers le Sud. Il faut trouver des aménagements et toute une série de questions sur lesquelles nous pourrons revenir se pose. Cela permet en tout cas de nouer des liens beaucoup plus solides avec les équipes du Sud. Nous rejoignons ici les enjeux du développement : lorsque vous avez formé une génération de jeunes qui sont habitués à une recherche de haut niveau, ils sont formés pour leur vie entière.

Le fait d'intégrer des associations dans vos processus de décision, au Sud comme au Nord, vous semble-t-il propre à vos objets de recherche (le Sida et les hépatites) ou vous paraît-il pouvoir être transposé à d'autres domaines ? Quels avantages et inconvénients avez-vous pu y trouver ?
Le modèle « Sida », du fait de l'interaction du milieu homosexuel, il y a une vingtaine d'années, est très particulier mais il me semble aujourd'hui sinon généralisable, du moins très largement extensible. Il renvoie à la place du citoyen dans les décisions de recherche ou de santé : les structures ne doivent pas uniquement être conçues pour vivre sur elles-mêmes. Elles doivent s'ouvrir davantage aux questions et aux préoccupations de la société.
Cette idée ne nous est pas venue de la communauté des chercheurs ou des médecins : elle nous a été imposée. Nous fêtons ces jours-ci le 30ème anniversaire de la découverte du VIH par Françoise Barré-Sinoussi. J'ai le souvenir de la période (où j'étais jeune médecin) à laquelle l'intrusion du milieu associatif a imposé un changement complet de notre vision. Ce ne fut pas simple. Nous passions d'une toute-puissance médicale à un échec complet, en ce qui concerne le Sida. Nous voyions des gens de notre âge en train de mourir et le milieu associatif savait autant de choses que nous, puisque nous ne savions rien. Il s'est donc naturellement imposé. Cette phase d'intégration a été lourde. C'est toute l'histoire d'Act Up que vous connaissez sans doute.
Nous sommes ensuite passés à une deuxième phase dans laquelle nous nous trouvons encore, marquée par un changement d'état d'esprit des médecins, qui ont reconnu la place du milieu associatif dans les instances de décision. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec le milieu associatif, loin de là. L'objectif n'est pas d'arriver au consensus. Mais nous échangeons et il existe une plate-forme de discussion, ce qui alimente un débat très riche.
Au sein de l'ANRS, nous sommes depuis trois ans dans une troisième phase, puisque nous confions même au milieu associatif la possibilité de conduire des recherches, en particulier sur des questions de sciences humaines et sociales.
Les premières données parues en France sur l'utilisation du test rapide non médicalisé sont par exemple issues d'études pilotes de l'Agence que nous avions confiées au milieu associatif. Cela n'est pas allé de soi. AIDES, par exemple, a été agitée par des réactions violentes lorsque ce principe a été proposé. Du côté des chercheurs, des interpellations ont également surgi, certains se demandant en quoi le milieu associatif pouvait porter des sujets de recherche. Evidemment, en biologie moléculaire, pour trouver l'expression d'un gène, il faut être un professionnel pour discuter. Lorsqu'il s'agit de savoir si le test de dépistage doit être proposé en milieu médicalisé, à l'hôpital, ou s'il faut le proposer près des bars du Marais, ou s'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une mise à disposition de ce test en prison en Côte d'Ivoire, pour savoir qui est séropositif, on peut se demander si la participation du milieu associatif n'est pas envisageable.
Au total, cette collaboration n'est pas simple mais s'avère extrêmement positive. Elle doit s'étendre à d'autres domaines que celui du VIH/Sida. L'Inserm est en train de le faire sur les maladies rares et s'est doté d'un comité ad hoc issu de réflexions de l'ANRS. Avec Bernadette Murgue, nous nous sommes occupés de la recherche sur la grippe H1N1 il y a quatre ans. Lorsqu'il a fallu trouver des femmes enceintes (chez qui la grippe H1N1 prenait des formes plus graves) touchées par la maladie, nous nous sommes heurtés à une difficulté.

Comment faire pour être efficace dans la lutte contre les épidémies, si l'on doit se limiter à un certain nombre de pays ? Cela veut dire qu'il y a de gigantesques « trous » dans le dispositif.
On collabore et on coopère. Nous ne pouvons nous limiter à une vision franco-française : il faut monter des projets au niveau européen, ce que nous nous efforçons de faire de plus en plus, avec une répartition des zones à couvrir. Certains pays peuvent rester le siège d'une présence plus importante pour la France, notamment pour des raisons historiques. Les Américains, les Allemands, les Néerlandais et les Britanniques sont ailleurs. En outre, nous sommes concurrents dans les activités de recherche mais nous savons aussi additionner nos forces dans certains cas ou dans certaines conditions. On ne peut plus papillonner un peu partout. Les services de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont quelques dizaines de milliers d'euros à allouer ici ou là. Cela ne sert à rien. De la même façon, il ne sert à rien que les universitaires français aillent faire des cours de façon extrêmement décousue, en fonction des personnes qu'ils ont rencontrées dans tel ou tel pays. Le nombre très élevé d'universitaires français qui allaient dispenser des cours au Vietnam avait été mis en lumière. On peut le comprendre, car le Vietnam est un pays agréable. Mais à quoi cela sert-il ? Il faut que cette présence soit un peu organisée et que nous fassions des choix stratégiques. Ceux-ci peuvent être faits par les agences, comme l'a fait l'ANRS. Je comprendrais très bien qu'il s'agisse de choix politiques, à la suite de quoi les opérateurs seraient chargés de les « mettre en musique ». Si nous ne procédons pas de cette manière, nous ne serons plus compétitifs. Or tel est bien l'objet d'une agence de recherche.

On peut certainement élargir cette analyse à la politique de développement, qui se déploie traditionnellement selon une logique de guichet.
Elle atteint aujourd'hui les limites de ce modèle, car si les sommes en jeu sont globalement importantes, les effets produits ne sont sans doute pas à hauteur de ce qui était attendu au départ. C'est la raison pour laquelle nous nous penchons sur la question, les uns et les autres, dans différentes sphères, afin d'identifier des pistes d'amélioration.
En matière de politique de développement, nos amis britanniques, également confrontés à des tensions budgétaires, se sont concentrés sur un certain nombre de pays et d'actions, là où notre vocation universaliste nous incite plutôt, pour le moment, à continuer de saupoudrer. L'ANRS est donc en avance dans ce mouvement.
Pour des raisons qui ne sont pas seulement financières, car elles tiennent aussi à la construction intellectuelle de la part du MSI et du Wellcome Trust, les Britanniques ont effectivement fait des choix qui s'avèrent payants. Ils privilégient, sur le moyen et le long terme, de grosses structures associant la formation à la recherche, la recherche et l'enseignement. Je considère que la recherche médicale pour le développement constitue un outil politique majeur, car une fois que vous avez formé des médecins et des chercheurs, vous avez formé un certain type d'élite dans les pays du Sud. Or ces élites deviennent souvent des élites politiques.
A titre d'illustration, dans l'histoire de l'ANRS, parmi les jeunes moniteurs d'études cliniques que nous avons formés figurent des personnes qui ont ensuite occupé des fonctions aussi importantes que ministre de la santé en Côte d'Ivoire, ministre de la santé au Sénégal, ministre des universités au Burkina-Faso, ministre de la femme au Cambodge, ministre de la santé au Vietnam... Les choses ne se déroulent évidemment pas de la même manière, lorsqu'on arrive dans ces pays et qu'on tutoie ces interlocuteurs.

Vous avez fort bien expliqué l'apport de ce partenariat au regard des pays du Sud et l'étroitesse des relations que nous pouvons nouer avec eux. Quel est l'apport, pour les deux partenaires, de ce type de relations dans le domaine de la recherche en santé ?
Il faudrait sans doute poser la question à nos partenaires du Sud. L'objectif de la recherche avec le Sud ne vise pas à financer tout à fait les mêmes actions que celles conduites par l'Institut Pasteur. Nous sommes davantage dans la recherche translationnelle, qui se situe entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Elle s'efforce par exemple d'aboutir à de meilleures stratégies de prise en charge et de traitement au bénéfice des populations. A titre d'exemple, avant 2005, lorsqu'est apparu un débat sur le coût des médicaments antirétroviraux au Sud, une série d'études parues dans Lancet et dans les meilleures revues anglo-saxonnes ont posé la question de l'opportunité de l'investissement dans ces nouvelles molécules, dès lors que les Africains étaient incapables, selon eux, de prendre un médicament. Ils prédisaient, de ce fait, un taux d'échec important. Nous avons lancé, à l'époque, un essai au Cameroun montrant que les médicaments génériques marchaient aussi bien que les médicaments de l'industrie pharmaceutique. Au Sénégal, d'autres préjugés ont été battus en brèche par une autre étude : celle-ci a mis en évidence 80 % de bons résultats à quatre ans parmi la cohorte suivie, ce qui est tout à fait comparable à ce que l'on observe au Nord.
Autrement dit, les Africains comprennent très bien les enjeux de santé, pour peu qu'on les leur explique. Encore fallait-il le montrer. La même démonstration a été faite au Cambodge.
Ce type d'approche nous laisse une grande liberté, dans la mesure où l'activité de recherche nous met relativement à l'abri de pressions politiques et permet d'aller à l'encontre d'un certain nombre de préjugés. Nous travaillons aujourd'hui sur une épidémie qui est parfois cachée, pour diverses raisons, en Afrique. L'homosexualité existe sur ce continent et la transmission du VIH à l'occasion de relations homosexuelles fait donc partie des modes de transmission de la maladie sur ce continent. Pour des raisons culturelles, politiques et stratégiques, ce mode de transmission est nié. La recherche en sciences humaines et sociales permet d'explorer ces aspects pour présenter aux autorités de santé des résultats susceptibles de déboucher sur des pistes d'action. Voilà ce que peuvent apporter des questions de recherche.

Je partage tout à fait votre sentiment. J'ai eu l'expérience de projets de recherche conduits par l'ANRS sur l'homosexualité dans des pays où elle est délictuelle. Le fait de s'y intéresser sous l'angle de la recherche conduit à aborder le phénomène de manière différente, ce qui peut contribuer à faire évoluer le regard porté sur ces réalités.
Nous abordons ces sujets par le biais de la recherche pour ensuite apporter des informations, car tel est l'objet de nos activités. Il peut en résulter une meilleure prise en compte par le pouvoir politique. Aborder ces questions directement sous l'angle politique conduit souvent à se heurter à des tabous.

La formation de vos partenaires du Sud a-t-elle rencontré des difficultés, en particulier en termes de mobilité ?
Nous avons fait de la formation par la recherche. Nous avons surtout créé des laboratoires associés. Il existe par exemple un laboratoire associé de l'IRD et de l'ANRS au Cameroun. Il existe un laboratoire associé de l'ANRS et de l'Inserm à Dakar, de même qu'en Côte d'Ivoire, où nous sommes restés, malgré tous les événements qui ont agité le pays, alors que les Américains avaient quitté le pays. Il existe aussi un laboratoire associé ANRS-Institut Pasteur au Cambodge et au Vietnam. Nous avons donc poursuivi une stratégie institutionnelle de création d'institutions, en complément de notre stratégie de projet. C'est d'ailleurs une ouverture récente de l'Inserm, sous la Présidence d'André Syrota, que de nouer de tels partenariats au travers de laboratoires, en particulier au Sud, sur les questions liées aux maladies infectieuses.
Ces partenariats permettent d'échanger des doctorants : des doctorants français vont passer deux ans sur place et des doctorants africains se rendent à Bordeaux, Montpellier et dans les grosses structures associées. Globalement, il n'existe pas de difficulté majeure pour la venue de doctorants africains en France. La plus grande difficulté a trait aux visas, en particulier de façon ponctuelle, lorsqu'il s'agit d'inviter des participants à un congrès.
Malgré les dispositions récentes, il reste un frein de ce point de vue. La circulaire Guéant a été extrêmement mal perçue et a produit des effets extrêmement négatifs du point de vue de la visibilité de la France sous cet angle. Elle est en train d'être rattrapée - insuffisamment à mes yeux.

S'agissant de l'éligibilité des projets, compte tenu du rôle des pairs, comment vous prémunissez-vous contre d'éventuels conflits d'intérêt ?
Il existe des conflits d'intérêt. L'Agence est divisée en deux parties : une moitié de l'Agence gère les appels d'offres, évalue les projets et donne le signal de financement, à travers une décision budgétaire. L'autre partie de l'Agence s'attache à la coordination et à l'animation de projets. Nous avons bien dissocié ces deux activités.
La question des conflits d'intérêt se pose pour les partenariats avec le Sud mais elle se pose aussi au Nord, car les projets sont évalués par les pairs. Or la communauté des chercheurs n'est pas si importante que cela. Depuis mi-2012, des déclarations d'intérêt ont été mises en place en vue de déclarer les intérêts qui lient un chercheur à l'industrie pharmaceutique ou à d'autres équipes de recherche. Cette première approche ne me paraît guère satisfaisante mais je ne sais pas s'il existe une solution « idéale » de ce point de vue. Par ailleurs, chacune de nos commissions d'évaluation comprend depuis plusieurs années un tiers d'intervenants étrangers, ce qui permet de relativiser de nombreux problèmes, car leur parole est beaucoup plus libre.
Il demeure néanmoins une possibilité de conflits d'intérêt. Lorsqu'on me transmet le classement des projets établi par la commission, j'essaie de voir si ce biais a pu intervenir. Il existe des modalités pratiques qui visent à limiter le problème : les gens sortent de la commission, par exemple, lorsqu'un membre de leur équipe présente un projet. Il s'agit d'appels d'offres blancs et toutes les structures d'évaluation doivent vivre avec ce risque. Faire venir des intervenants étrangers n'est pas non plus totalement anodin, car nous leur donnons des idées liées aux meilleurs projets de recherche qui se font jour en France. Nous leur offrons, d'une certaine façon, la science en mouvement et ils peuvent repartir avec des idées. Rien n'est simple et il faut trouver un équilibre entre les différents termes de l'équation. J'ai l'impression que nous avons évité, jusqu'à présent, les écueils majeurs qui auraient pu se faire jour.
Je regarde, tous les trois ans, les projets qui n'ont pas été retenus par la commission d'évaluation de l'Agence, en me demandant à côté de quoi nous passons. Il arrive, de temps en temps, que nous passions parfois à côté d'un projet présentant un grand intérêt. Le milieu associatif constitue aussi une soupape de sécurité, car il est libre de s'exprimer, ce qui constitue indiscutablement un stimulant. Nous avons ainsi deux garde-fous non négligeables.

Nous allons fêter les 30 ans de la découverte du Sida et on a parfois l'impression que la mobilisation amorce un ralentissement à l'international.
Comment projetez-vous votre action dans l'avenir, en particulier en vue d'améliorer l'efficacité de l'action de l'ANRS au cours des prochaines années ? Quels outils et quelles méthodes pourrions-nous utiliser pour renforcer notre action ?
La France a toujours eu un engagement politique sur le VIH/Sida, soutenu par des résultats importants qui ont été obtenus (à commencer par le Prix Nobel décerné à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier). L'Agence est dotée d'un budget de 45 millions d'euros, tout compris. Celui du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), notre équivalent aux Etats-Unis, s'élève à 3 800 millions de dollars, ce qui donne une idée des écarts - sans compter qu'il existe d'autres financements aux Etats-Unis pouvant bénéficier à la recherche sur le Sida, notamment le Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La France est le deuxième producteur scientifique international en termes de publications, ce qui constitue un critère comme un autre. Globalement, dans la biologie « santé », la France est en 6ème position. Nous avons donc une sorte de pépite d'excellence dans le domaine du VIH et ce constat vaut aussi dans celui des hépatites. Ce résultat est à mon avis lié à deux éléments. En premier lieu, nous avons une communauté extrêmement soudée, avec de jeunes chercheurs qui témoignent toujours d'un très fort engagement dans la lutte contre le Sida (avec un engagement humain qui dépasse le strict engagement scientifique de chercheurs). La France, à travers ses différents gouvernements, a aussi fait le choix d'appuyer l'ANRS, qui est la seule agence européenne qui poursuive cette dynamique. Un tel instrument constitue un bon moyen de faire avancer les choses. Mes propos sont nécessairement biaisés, puisque je défends l'Agence que je dirige.
Je vois cependant les apports spécifiques permis par une institution qui porte un projet en s'inscrivant dans la durée, en s'appuyant sur une vision et une reconnaissance internationale fortes. Il existe bien sûr des enjeux stratégiques, en termes de recherche, sur le VIH et les hépatites. La recherche se construit au point de rencontre entre un pilotage « par le haut », via des scientifiques qui définissent des priorités pour les années à venir, et des idées qui émergent « par le bas », lorsqu'un groupe de chercheurs soumet une idée neuve, qu'il faut savoir saisir. Il y a donc un équilibre à trouver entre ces deux pôles d'alimentation de la recherche scientifique : un pilotage par le haut, qui doit être très souple, tout en ayant une colonne vertébrale formée par quelques grandes idées stratégiques en fonction de la compétition internationale, et les projets « libres » que la communauté peut déposer tous les six mois. Nous menons des actions sur la prévention, sur le vaccin avec le Sud, sur les traitements de deuxième et troisième ligne, sur l'homosexualité dans un certain nombre de pays africains, sur le passage de résultats scientifiques à des résultats opérationnels dans le cadre de la circoncision ou pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Nous avons tout un programme que nous pouvons décliner, construit avec la communauté et avec les chercheurs du Sud.
Je souhaiterais également vous dire quelques mots de la microbiologie et des maladies infectieuses en général. De nombreuses maladies infectieuses sont au Sud. Elles représentent la deuxième grande cause de mortalité au niveau mondial. Les diarrhées ou les pneumopathies chez l'enfant, par exemple, constituent des causes de mortalité très importante.
S'il existe, au niveau français, une construction autour d'une Agence, des financements, des choix stratégiques, il n'en est pas de même dans le domaine des maladies infectieuses en général : nous n'en sommes qu'aux balbutiements et la recherche avec les pays du Sud, sur ces sujets, n'a pas de source de financement en France. Les chercheurs qui travaillent sur les mutants de la grippe ou sur le coronavirus, par exemple, se heurtent à de grandes difficultés pour financer leurs projets. L'ANR (Agence nationale de Recherche) finance la recherche au Nord mais ne peut, pour des raisons statutaires, financer des équipes au Sud. Le PHRC (programme hospitalier de recherche clinique) ne peut pas non plus financer la recherche au Sud. Autrement dit, il manque un guichet pour ce pan de l'activité. L'ANR objecte à ce constat qu'elle est prête à financer des équipes françaises travaillant avec la Corée, par exemple, pourvu que celle-ci finance les équipes coréennes, et ainsi de suite dans les autres pays. Qu'advient-il cependant lorsque nous travaillons avec des pays qui n'ont pas les moyens d'apporter ces financements, alors même qu'un certain nombre d'infections émergentes (tuberculose multi-résistante, bacilles multi-résistants, nouveaux virus émergents) proviennent des pays du Sud. Il n'existe pas de frontière dans ce domaine : la microbiologie et les maladies infectieuses constituent un domaine universel. Comment mettre en place un guichet sur projet qui permette de financer des projets ? Des aménagements sont possibles, au travers de mécanismes assez complexes. L'ANR a cependant une très faible marge de manoeuvre. Ce constat vaut d'ailleurs pour la recherche au Sud d'une façon générale. Seuls les financements européens permettent de contourner cette difficulté mais ils ne suffisent pas, d'autant plus qu'ils ne permettent pas de construire la recherche translationnelle avec de grandes cohortes ou des équipes étoffées.
Il faut également promouvoir une meilleure visibilité et une meilleure coordination des acteurs français qui travaillent dans ces domaines, en particulier dans la recherche et développement. Il existe l'IRD, qui est un EPST (établissement public scientifique et technique) dont 25 % du budget sont consacrés à la santé. A l'intérieur de cette enveloppe, 70 % ou 80 % des fonds sont consacrés aux maladies infectieuses. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons éluder ce sujet.
L'Inserm conduit de nombreuses études avec le Sud mais il s'agit plutôt d'opérations ponctuelles, notamment du fait de liens noués « de chercheur à chercheur ». L'Institut Pasteur joue un rôle fondamental, notamment au travers de son réseau, très hétérogène. Sur les 30 sites de Pasteur, il n'existe plus que trois sites de l'Institut Pasteur stricto sensu, les 27 autres étant des instituts nationaux. Marc Jouan, qui dirige la recherche au Sud à Pasteur, vous confirmera qu'il ne dispose d'aucun guichet. L'Institut Pasteur ne finance pas de nombreux projets qui sont menés au Sud.
Nous avons essayé de combler ce manque à travers Aviesan, alliance autour de la recherche en biologie « santé », pilotée par André Syrota. Nous nous efforçons de construire un groupe « Aviesan Sud » qui regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans la recherche au Sud. Ce groupe rassemble des acteurs institutionnels et des chercheurs. Il vise à mieux s'organiser sur de grandes thématiques.

Pourrait-on envisager une meilleure coordination et une meilleure organisation des acteurs français à travers la création d'un guichet unique ou une simplification ? Ne peut-on envisager qu'il existe une seule grande agence, ou la mise en place d'un guichet unique ?
Je serais partisan d'une telle simplification. J'ai d'ailleurs fait évoluer l'ANRS, qui était un GIP (groupement d'intérêt public), en en faisant une agence autonome au sein de l'Inserm, qui était notre principal partenaire, ce qui nous assure une meilleure visibilité.
Pour le reste, il s'agit de choix stratégiques importants. La recherche au Sud existe-t-elle ? S'agit-il d'une thématique ? Tel n'est pas le cas sur le plan scientifique. Il se pose au Sud des questions de recherche, qui sont « mixtes » en matière de biologie-santé, ce qui valide l'approche américaine. Les Etats-Unis n'ont pas d'agence dédiée au Sud. Ce sont les instituts thématiques du NIH qui exercent leurs fonctions au Nord comme au Sud. Il existe néanmoins des domaines particuliers au Sud. Des questions liées par exemple au climat et à l'eau se posent dans des termes assez spécifiques. En biologie-santé, je ne suis pas convaincu qu'une agence dédiée soit nécessaire. Ma vision est plutôt celle d'un scientifique : il existe de grandes questions scientifiques qui doivent être prises en charge par des instituts couvrant l'ensemble du spectre, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, du Nord au Sud, qui animent des équipes dans une logique de coordination. Telle est la logique que je défends.
Cela dit, l'IRD a eu le mérite de faire émerger un certain nombre de profils de carrière pour les chercheurs du Sud et de partenariats politiques. Il s'agit plutôt d'une fonction de relations politiques. S'agissant de la recherche à proprement parler, on pourrait plaider pour le croisement d'une approche transversale et d'une approche verticale, guidée par les grandes thématiques scientifiques.

L'expérience de l'ANRS constitue néanmoins un atout pour faire de la recherche avec des équipes du Sud, puisque vous parvenez à intégrer ces dernières et à faire vivre un véritable dialogue avec elles, notamment grâce à l'organisation bicéphale que vous avez décrite.
L'existence d'un coordinateur de la recherche pour le Nord et d'un coordinateur pour le Sud, placés sur le même plan, favorise effectivement ce dialogue. Pour autant, l'IRD a aussi un partenariat important avec le Sud.
Certes. Sans doute des aspects générationnels expliquent-ils certaines de ces différences. Pour ma part, le milieu associatif m'a poussé à me demander dans quelle direction je souhaitais aller. Il existe aujourd'hui une génération de jeunes chercheurs (autour de 35 ans) qui sont ouverts vis-à-vis du Sud. Ils sont même demandeurs d'échanges avec ces pays. Pour un jeune chercheur, le fait d'aller passer deux ans dans une structure au Sud n'était pas valorisé dans les parcours français, alors que le Royaume-Uni, par exemple, a depuis longtemps fait prévaloir une meilleure valorisation de tels échanges.
La stratégie qui va dans cette direction devrait donc contribuer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Il est vrai aussi que certains chercheurs ne bougeront pas de la rue du Docteur Roux, car ils ne voudront pas bouger de l'Institut Pasteur. Il en faut aussi.
Nous organisons au mois de novembre, avec Bernadette Murgue, une journée et demie de formation à l'intention des chercheurs de toutes disciplines, sur le principe d'une journée de préparation à la recherche avec le Sud, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la coopération avec le Sud. Nous organisons cette formation en partenariat avec tous les organismes.
La principale tutelle de l'ANRS est le ministère de la recherche, qui finance environ 80 % de notre budget (15 % à 20 % de notre budget étant obtenu à l'étranger, notamment au travers de l'Union européenne et de fondations). L'IMMI (Institut de microbiologie et des maladies infectieuses), qui fait partie des instituts d'Aviesan, a pour tutelle Aviesan.

Le ministère de la recherche ne participe pas de la même manière au financement des différentes agences. Nous voyons aussi que le ministère des affaires étrangères est plus présent dans le financement d'autres agences, puisqu'il ne prend en charge que 5 assistants techniques en ce qui concerne l'ANRS. Faut-il y voir le fruit de l'Histoire ?
Le ministère des affaires étrangères a longtemps financé l'ANRS, en particulier entre 2000 et 2009. Depuis sa restructuration, alors que les contraintes budgétaires se sont resserrées autour du MAE, nous avons vu peu à peu se tarir les financements provenant de ce ministère. Je comprends mal cette situation mais il s'agit de choix budgétaires difficiles.

C'est d'autant moins compréhensible si l'on prend en compte, parallèlement, notre contribution à la recherche sur le Sida.
Vous touchez effectivement le point sensible. Le ministère des affaires étrangères nous répond qu'il ne dispose plus de fonds disponibles pour la recherche, car tout son financement, dans le domaine du Sida, passe par les politiques multilatérales internationales, notamment au travers du Fonds mondial. La France est le deuxième contributeur de ces efforts. Cet effort international de financement du Fonds est très important mais ne relève pas de la recherche. Il s'agit d'une action distincte.
Allouer 360 millions d'euros à un domaine de la santé, quel qu'il soit, implique de mener une activité d'évaluation.
C'est pourquoi je considère qu'au moins 5 % à 10 % de ce budget devrait porter sur des activités de recherche opérationnelle en vue d'évaluer ce qui est fait de façon plus qualitative, dans une logique de recherche opérationnelle et d'évaluation programmatique. Il ne suffit pas d'annoncer que 7 millions de personnes bénéficient de médicaments antirétroviraux. J'ai un peu de mal à faire passer ce message mais il ne faut pas baisser les bras.

Les contraintes de financement sont telles que, comme nous le voyons avec un oeil un peu exercé, on recycle de l'argent. On le prend ici pour le mettre là, où il n'est pas toujours dépensé.
Je souhaite évoquer trois autres points, si vous me le permettez. En premier lieu, le secteur privé n'est quasiment pas impliqué dans la recherche et développement au Sud. Celui-ci lui fait peur. Il est vrai aussi que les décisions du secteur privé (notamment dans l'industrie pharmaceutique) sont prises pour chaque grande région du monde. Or les régions qui gèrent l'Afrique du Nord ou l'Afrique n'ont généralement pas leur centre de décision en Europe : pour les grands laboratoires, elles englobent souvent l'Australie. En d'autres termes, rien ne se décide à Paris. Nous sommes en contact avec les décideurs des grandes compagnies pharmaceutiques internationales mais nous touchons rarement ceux qui décident pour le Sud. Plus globalement, ces acteurs ont vécu le développement des génériques et la coupure de la propriété intellectuelle comme une épreuve très difficile. Il existe donc un besoin pour le montage de partenariats privés dans le domaine de la santé, au-delà du VIH/Sida.
Je suis également frappé par l'absence de concertation entre les ministères. Il est bien difficile de savoir par exemple qui décide au ministère des affaires étrangères, où existent deux grands services, l'un chargé de la recherche et des universités et l'autre de la santé. Le ministère de la santé comporte une Direction des affaires internationales et s'appuie sur sa propre vision, en développant sa propre politique, sans nécessairement échanger avec le ministère des affaires étrangères. C'est la réalité que nous vivons au quotidien. Enfin, le ministère de la recherche, qui finance plus de la moitié de l'IRD et qui alloue 22 millions d'euros à l'Institut Pasteur, est finalement celui où la répartition des responsabilités est la plus claire. Nous y connaissons nos interlocuteurs. Il existe un réel problème pour la prise de décisions stratégiques dans ce paysage institutionnel en France.

En tant que ministre de la coopération, j'ai participé à des dizaines de réunions interministérielles. Sauf erreur de ma part, pas une seule fois le ministère de la santé n'y a été convié.
Ce constat illustre bien les blocages français. Comme je l'ai souligné, la France ne peut plus être partout. Des choix s'imposent. Les choix scientifiques appartiennent aux agences. Les agences peuvent participer aux choix géopolitiques et géo-scientifiques mais ceux-ci leur échappent pour une part, ce qui est tout à fait normal. Je serais très content que le pouvoir régalien nous indique telle ou telle direction, charge ensuite aux agences de mettre en oeuvre ces orientations, pourvu qu'elles aient les moyens de le faire.
Il est clair que si vous nous demandez d'être présents dans 40 pays, nous vous répondrons que nous n'avons pas les moyens de le faire. Ce dialogue n'existe pas. Nous ne pouvons continuer ainsi. Nous disposons de forces scientifiques de haut niveau en France. Les réseaux de l'Institut Pasteur, de l'IRD, de l'ANRS et de l'Inserm ont une visibilité. Il faut que des choix politiques soient faits, comme va le faire le ministère de la recherche pour les grandes orientations stratégiques de recherche en général. Si tel n'est pas le cas, nous prenons le pouvoir. Je suis prêt à le faire mais je trouverais cela dommage, car ce choix doit être partagé. Il ne doit pas être à la merci de la visite d'un directeur d'institut qui se rend à tel endroit.
Enfin, je crois que l'enjeu scientifique majeur, sur lequel nous avons une réelle visibilité, et qui est à notre portée (compte tenu notamment de l'atout que nous confère la langue française), porte sur la recherche en « biologie santé » en Afrique. Si des choix sont à faire, cette priorité doit figurer tout en haut de notre liste. L'Afrique est le continent de demain et nous avons des élites que nous pouvons former. C'est un choix d'avenir. J'ai par exemple décidé de n'avoir aucune coopération sur le VIH/Sida avec la Chine. Cela me sera peut-être reproché un jour. J'ai essayé d'aller dans cette voie et je me suis rendu compte que les Américains mobilisaient des budgets mille fois supérieurs à ce que nous pouvons faire. Dès lors, à quoi cela sert-il ? Par contre, nous avons investi dans des activités qui se situent un peu « en marge », par exemple au Cambodge et au Vietnam, où nous avions des ressources déjà présentes. Compte tenu des enjeux budgétaires qui existent, définissons comme une priorité, pour les vingt ans qui viennent, la recherche en biologie-santé avec l'Afrique.

Merci beaucoup pour ces informations. Nous sommes toujours heureux de rencontrer des gens passionnés.
Audition de M. Patrick Guillaumont président de la fondation pour les études et recherches sur le développement international ferdi et de Mme Sylviane Guillaumont-jeanneney professeur émérite au centre d'études et de recherches sur le développement international cerdi
Université d'auvergne

Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaiterions disposer d'une vision un peu plus précise de ce qui se fait en matière de recherche pour le développement. Il existe de nombreux intervenants dans de nombreux domaines et de nombreux pays. Nous souhaiterions également identifier, in fine, d'éventuelles propositions, afin que l'efficacité soit au rendez-vous des actions de la France dans le cadre de cette politique, plus particulièrement pour les partenariats avec les pays du Sud.
Je vous remercie de nous avoir invités pour essayer d'alimenter vos réflexions. Nous sommes très heureux d'avoir à intervenir devant cette mission commune d'information. Je signale que nous intervenons demain devant le groupe de travail de la commission des affaires étrangères du Sénat sur la présence française en Afrique.
S'agissant d'une des premières auditions de votre mission, sauf erreur de ma part, il sera sans doute utile de formuler quelques remarques d'ensemble avant de cibler sur la partie du sujet que nous connaissons le mieux. Si j'ai bien compris, votre mission porte sur l'efficacité de l'action publique en matière de recherche pour le développement. Chaque mot pose un problème, car l'efficacité ne s'apprécie qu'au regard de critères à définir. Il peut s'agir, en l'espèce, du développement des pays considérés mais nous pourrions également retenir le critère de visibilité de l'action française. L'expression de « recherche pour le développement » comporte une ambiguïté qui a donné lieu à de nombreuses exégèses. Je comprends qu'il s'agit de la recherche pour le développement quelle que soit la discipline de recherche mobilisée. Il s'agit d'une recherche distincte de celle qui porte sur le développement, qui est de nature principalement socio-économique - aspect que nous connaissons le moins mal, puisque nous sommes des économistes. La notion de recherche pour le développement est elle-même révélatrice d'un problème, car il y a une recherche pour le développement en épidémiologie, en géographie et dans de nombreuses autres disciplines.
Or elle ne trouve sa pleine efficacité que si elle est adossée à une recherche sur le développement, c'est-à-dire qui traite les problèmes de développement. Il me semble précisément que la recherche française pour le développement n'intègre peut-être pas suffisamment la recherche sur le développement, qui est de nature socio-économique. On dit souvent que les économistes sont impérialistes. Elle ne saurait se limiter, bien sûr, à cet angle d'analyse.
Les canaux de l'action publique, en matière de recherche pour le développement, sont multiples. On peut en distinguer trois :
- les institutions de recherche spécialisées dans les questions de développement
Entrent particulièrement dans cette catégorie l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et le CIRAD, qui sont les institutions emblématiques de ce domaine.
- des institutions de recherche qui, sans être dédiées au développement, comportent des équipes ou des laboratoires tournés vers ces aspects
Parmi ces institutions figurent des universités, dont l'activité de recherche apparaît comme assez éparpillée, certaines universités étant beaucoup plus engagées dans le développement que d'autres. C'est également le cas du CNRS, qui comporte des unités en ethnologie ou en géographie plus particulièrement tournées vers le développement. En économie, il existe aussi des unités mixtes de recherche CNRS-universités. Seul le CERDI (Centre d'études et de recherches sur le développement international), dont nous provenons, constitue une entité mixte de recherche sur le développement. Il est considéré par le CNRS comme le centre d'excellence en économie du développement. L'INRA compte aussi un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur le développement. Citons aussi le Cemagref et l'Institut Pasteur, parmi d'autres.
- les institutions de coopération pour le développement qui mènent des activités de recherche
L'Agence française de Développement a développé, sous la Présidence de Jean-Michel Severino, un important département de recherche qui n'existait pas antérieurement. La Banque de France conduit elle-même des recherches sur le développement avec d'autres services de la zone « franc ». Le Trésor mène également des réflexions sur les questions relatives à la zone « franc ». Les institutions multilatérales de développement (Banque Mondiale, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, etc.) conduisent aussi ou demandent des recherches sur le développement.
Cette recherche publique est donc fortement dispersée, comme l'est elle-même la politique de coopération, divisée entre plusieurs acteurs (Trésor, ministère des affaires étrangères, AFD...). S'agissant du ministère des affaires étrangères, des activités de recherche sont conduites au sein des services mais une part de cette activité incombe aussi aux centres de recherche extérieurs, placés sous la tutelle du ministère et depuis peu sous celle du CNRS. Il existe de tels centres de recherche français à Delhi, à Pondichéry, à Hong Kong, au Caire ou encore en Amérique latine. Il y a là un potentiel considérable de recherche, qui n'atteint sans doute pas l'efficacité ou du moins la visibilité qu'il pourrait avoir. A cet égard, le travail de cette commission me semble particulièrement bienvenu.
Comme vous l'aurez compris, nous ne connaissons qu'une petite fraction de la recherche pour le développement. Nous serions bien en mal d'évoquer la recherche publique en épidémiologie ou en recherche océanographique, par exemple. A travers le champ de l'économie du développement, certains enseignements généraux peuvent certainement être tirés de notre expérience. Je vous soumets trois thèmes de réflexion à partir desquels des questions pourront sans doute être soulevées.
Un premier problème, de nature comptable, est lié à la définition de l'aide publique au développement. Il surgit dès lors que nous évoquons ces sujets et il va revenir au premier plan de l'agenda au cours des mois à venir. Comme vous le savez, en effet, un processus de révision du concept d'aide publique au développement -qui a fait l'objet de discussions depuis son émergence il y a quarante ans - est en cours. Lorsque l'IRD paie un chercheur, dans quelque discipline que ce soit, qui travaille dans les montagnes du Forez, les fonds mobilisés relèvent de l'aide publique au développement. Si un chercheur est recruté par le CNRS pour travailler sur les questions de développement économique, sa rémunération ne fait pas partie de l'aide publique au développement. Il ne faudrait pas que ces modes de comptabilisation aient une influence sur le contenu des actions conduites. Nous ne devons pas choisir les modes d'action en fonction de leur traduction comptable.
En matière d'économie du développement, nous constatons la présence d'une grande diversité d'organismes, qui n'ont pas, le plus souvent, la taille critique requise pour l'enrichissement mutuel que permettent des échanges entre chercheurs. L'expérience montre en effet qu'il faut que les équipes atteignent une taille minimale pour que des interactions quotidiennes aient lieu et pour assurer le renouvellement des générations de chercheurs, support de la continuité des institutions.
Le CERDI (centre d'études et de recherches sur le développement international), que nous avons fondé en 1976, localisé à Clermont-Ferrand, est devenu le principal centre de recherches sur l'économie du développement. On peut considérer qu'il a atteint la taille critique mais il demeure fragile : pour devenir un concurrent de poids face aux grands centres anglo-saxons et acquérir une visibilité suffisante, sans doute faudrait-il qu'il soit deux fois plus grand qu'il ne l'est. Il existe d'autres centres de recherche en économie du développement à Aix, à Toulouse ou encore à Paris I. Ces ressources sont cependant dispersées. Il y a eu des tentatives pour fédérer cette recherche, notamment au travers de l'action de groupements, qui n'ont pas eu l'efficacité que l'on pouvait souhaiter.
Depuis dix ans, nous avons créé à partir du CERDI une Fondation, la FERDI, reconnue d'utilité publique. Elle a pour buts de valoriser la recherche et d'assurer la coordination d'activités de recherche en matière d'économie du développement.
Cette action a notamment été favorisée par les soutiens obtenus au titre de laboratoire d'excellence. Nous nous efforçons de mettre en contact des chercheurs provenant d'organismes différents (Paris I, Aix, Clermont, IRD, etc.).
Outre ce problème de fragmentation, le partage entre les institutions spécialisées (telles que l'IRD) et les universités constitue une difficulté récurrente. La situation est quelque peu ambiguë. Il y a quelques années, l'IRD a reçu le mandat d'être une agence de moyens mais il est resté, dans le même temps, un opérateur. En tant qu'agence de moyens, l'IRD pourrait coordonner pleinement l'action de recherche pour le développement, qu'elle soit menée par le CNRS, les universités ou par toute autre institution. En tant qu'opérateur, toutefois, il privilégie, au travers des moyens dont il dispose, les opérations propres à l'IRD. Si la réforme engagée allait dans la bonne direction, nous sommes en quelque sorte restés au milieu du gué.
Cette activité propre, à côté de celle d'organismes tels que le CNRS, pose problème, car l'IRD n'a ni les mêmes critères de recrutement ni les mêmes critères d'évaluation des chercheurs, bien que ceux-ci travaillent dans la même discipline. Le rôle de l'IRD était justifié lorsque l'ancien ORSTOM abritait une majorité de chercheurs qui travaillaient sur le terrain, en Afrique, avec parfois des implantations immobilières importantes, voire considérées comme intrusives. L'IRD s'est retiré de ces bases et la majorité de ses chercheurs sont aujourd'hui basés en France, de même que la majorité des crédits de l'IRD est dépensée en France, sauf erreur de ma part.
Ces caractéristiques réduisent la légitimité de l'IRD en tant qu'institution spécifique. Sans doute la présence physique et humaine de l'IRD dans des pays récemment décolonisés était-elle trop importante et trop prégnante. Nous voyons aujourd'hui des institutions nord-américaines s'implanter dans les mêmes pays, avec des implantations physiques plus importantes que celles de la France, du moins dans le domaine des sciences humaines et sociales. Cette tendance au repliement national pose à mes yeux un problème d'efficacité, voire un problème de légitimité.
J'identifie un autre problème lié à l'IRD, quelle que soit l'admiration que je porte à cet Institut, et malgré le formidable potentiel de cette institution (qui a été sous-utilisé durant cinquante ans) : celle-ci peine à passer des accords tels que ceux qui donnent naissance, avec le concours du CNRS, à des unités mixtes de recherche. Celles-ci permettent aux chercheurs de se confronter aux exigences de la recherche académique, pourtant essentielles pour la qualité de la recherche en matière d'économie du développement. Une seule unité mixte, le DIAL (« Développement, Institutions et Mondialisation »), dispose d'une visibilité.
Elle regroupe des chercheurs de qualité, dont plusieurs ont d'ailleurs été formés au CERDI. DIAL a passé un accord avec l'université Paris-Dauphine, excellente en gestion et management, alors qu'il existait peut-être d'autres universités en France plus spécialisées en économie du développement.
Lorsqu'on évoque le Sud, on embrasse naturellement plusieurs régions du monde, l'Afrique mais aussi les pays émergents dans de nombreuses autres régions. Il est communément admis qu'on doit nouer des partenariats avec le Sud, ce qui passe par la signature de conventions. Celles-ci sont littéralement innombrables, s'agissant des universités, mais ces conventions constituent souvent des coquilles vides. La mission des relations internationales de telle université se rend dans tel pays, signe un accord, à la suite de quoi la direction de la recherche de l'IRD signe un MoU (Memorandum of Understanding). Qu'advient-il après ? Le CERDI lui-même a signé, il y a une vingtaine d'années, une convention de coopération avec le Niger. Depuis lors, il ne s'est rien passé.
Pour faire vivre une convention, il faut y allouer des moyens. Là aussi, la fragmentation est trop grande et les actions sélectives trop peu nombreuses. Par comparaison, des universités étrangères établissent des coopérations fortes avec des établissements bien choisis, qui permettent d'atteindre un certain niveau d'excellence. Nous n'avons pas toujours les moyens requis pour assurer cette sélectivité.
Un autre problème majeur réside dans la faiblesse des institutions locales, du moins en Afrique. Les universités y sont dans une situation de grande fragilité. Peut-être notre vision est-elle biaisée, sur ce point, par la discipline à laquelle nous nous rattachons. Il existe néanmoins très peu de centres actifs et solides avec lesquels un partenariat robuste puisse être conclu. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de recherche économique et sociale en Afrique, le CIRES (centre ivoirien de recherche économique et sociale) était systématiquement mentionné. Un groupe s'y était développé et il faisait figure de « chouchou » de toutes les institutions internationales. Il était victime de son succès et était arrosé de crédits. Ceux qui en sortaient ont aussi été captés par le champ politique. Tous les meilleurs sont devenus ministres, conseillers du Premier ministre ou du Président de la République, recteurs, etc. Le CIRES s'est ainsi trouvé « décapité » et plus personne n'en a parlé. Un petit groupe s'est alors reformé à Dakar, où un nouveau centre s'est développé. Toutes les institutions internationales s'y sont précipitées. J'ai moi-même monté un consortium pour suivre la mise en oeuvre du programme d'Istanbul pour les pays les moins avancés, avec différents partenaires du Sud. Il était tant sollicité qu'il peinait à produire une activité tangible. Un problème de la recherche française réside dans le renforcement des institutions de recherche, qui implique beaucoup de sélectivité.
Par ailleurs, la France a été absente d'un certain nombre d'instances qui se sont avéré les plus influentes en matière de recherche économique en Afrique. De grands réseaux de recherche se sont créés dans cette discipline, à l'image par exemple du réseau Global Development Network (GDN), basé à Delhi et présidé aujourd'hui par le français Pierre Jacquet, ancien chef économiste et directeur de la stratégie de l'AFD. Il existe aussi des réseaux continentaux, plus ou moins indépendants du GDN. Un réseau a eu pendant vingt ans une grande importance en Afrique, le CREA (Consortium pour la recherche économique en Afrique). Créé à l'initiative de la Banque Mondiale en 1989, il y a près de 25 ans, ce réseau s'est développé, à la faveur de la diversification de ses sources de financement. J'ai organisé des contacts entre le directeur exécutif et le ministère des affaires étrangères. Nous avons conduit des projets de FSP pour aider le CREA.
L'African Capacity Building Foundation (ACBF), de son côté, visait à renforcer les capacités économiques en Afrique, notamment à travers les programmes de troisième cycle. Il existait toujours des difficultés administratives, au-delà des aspects financiers. Le CREA a néanmoins fonctionné. Créé sous une influence anglo-saxonne évidente, il invitait à raison de deux sessions par an des chercheurs africains qui disposaient de moyens pour préparer un document de recherche, qui pouvait ensuite donner lieu à une deuxième, voire une troisième présentation devant le CREA, en vue d'aboutir à un produit fini de recherche. Les moyens mobilisés étaient considérables. J'avais alors créé, au sein de l'agence universitaire de la francophonie un réseau « analyse économique et développement ». L'écart dans les moyens dont nous disposions, par rapport à ceux du CREA, était de l'ordre d'un à soixante-dix. Le CREA conviait, lors de ses deux sessions annuelles, les meilleurs spécialistes mondiaux du développement pour expliquer à de jeunes chercheurs africains ce qu'était un bon article de recherche. Cette structure a eu une influence considérable sur la formation des chercheurs économiques en Afrique, du moins dans le monde anglophone. Le CREA avait même prévu d'accueillir des chercheurs francophones, moyennant un dispositif de traduction simultanée. Un gros effort était donc fait pour la recherche francophone et notre influence au sein du CREA aurait pu être beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été.
Aujourd'hui, l'aide publique au développement consacrée au renforcement des universités africaines n'est plus d'un niveau très élevé. Nous retrouvons là un problème de sélectivité. Il existe une multitude d'universités en Afrique et nous ne pouvons les aider toutes. Il faut accepter de faire des choix si l'on veut être efficace. Or la plupart d'entre elles sont dans un état de grande fragilité, avec des grèves récurrentes, une instabilité du personnel, etc. Dans certaines universités, il y a des années blanches, sans examen, ou alors les examens sont reportés de six mois. Il existe aussi des universités de grande valeur qui s'efforcent de faire ce qu'elles peuvent. Nous voyons depuis peu apparaître des universités privées en Afrique, qui tendent à se substituer à la défaillance des Etats, lorsqu'elle est trop manifeste. Certains projets portés par des Africains de la diaspora, qui ont gagné leurs galons dans des universités américaines, nous semblent prendre une place significative, avec des ressources importantes. Tel est le cas par exemple au Bénin, ou au Cameroun, avec l'université jésuite qui s'y est développée.
Une des meilleures contributions potentielles à la recherche au Sud réside dans la formation des doctorants. Or nous nous heurtons à deux problèmes, qui ont trait au recrutement des doctorants d'une part et au devenir des docteurs d'autre part. S'agissant du recrutement des doctorants, nous voyons que, dans les disciplines des sciences sociales, nous sommes progressivement remplacés par le Canada, la Belgique, voire l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Il se pose un problème de financement, notamment en raison du manque de bourses, alors que nous avions la capacité de former de grands docteurs africains. Il serait très triste de voir les meilleurs s'orienter vers des universités non françaises, faute de financements. Il se pose aussi un problème de mode d'allocation des bourses. Celles-ci sont attribuées localement, pour un Master 2 ou pour un doctorat, par les ambassades. Ce principe présente un intérêt, du fait de la connaissance du terrain que peuvent avoir les ambassades. Dans le même temps, l'efficacité d'activités de recherche dépend de l'affectation dans un centre de recherche ou une université capable d'offrir aux jeunes chercheurs le meilleur soutien et le meilleur encadrement. Or de ce point de vue, notre système est défaillant. Il serait préférable d'attribuer les bourses à des centres universitaires, qui effectueraient ensuite la sélection. Ce serait assez simple, en termes d'enveloppe budgétaire globale, tout en renforçant l'efficacité globale du système.
Cela ôterait un peu de pouvoir aux ambassades, ce qui constitue sans doute le principal frein à cette évolution.
Lorsqu'un Africain est reçu à l'Ecole Polytechnique ou au concours du magistère, il reçoit une bourse. Auparavant, nous faisions passer les concours dans les ambassades de France et nous sélectionnions les meilleurs Africains de leur génération. Ils étaient reçus mais ne recevaient aucune bourse, ce qui était très frustrant.
Le deuxième problème porte sur le devenir des docteurs. Nous avons formé de nombreux docteurs africains, dont certains étaient de tout premier plan. Mis à part l'un d'entre eux, qui se trouve à Abidjan, pas un seul ne travaille dans une université ou un centre de recherche africain : ils exercent tous des responsabilités dans des organisations internationales (Banque Mondiale, FMI, Banque africaine de Développement). Ces cadres ne sont peut-être pas perdus pour l'influence française, dans la mesure où ils peuvent y exercer une influence teintée par une part de culture française. Nous devons cependant constater une « déperdition » importante au regard de l'influence qu'aurait pu avoir la France à travers tous les cadres qu'elle a contribué à former. Lorsqu'ils sont un peu plus âgés, il arrive qu'ils reviennent en Afrique à un haut niveau de responsabilités. La dimension financière entre indéniablement en ligne de compte. Un bon docteur se situe sur un marché international et son diplôme lui donne accès à des emplois bien rémunérés, en France, aux Etats-Unis ou ailleurs. Le Canada, notamment, recrute de nombreux universitaires venant de pays du Sud.
Nous avons formé plusieurs personnes du Sud (Afrique, Chine) qui sont ensuite entrées dans des universités du Canada.
Ces talents ne sont pas perdus pour la science ni pour la recherche mais il serait normal qu'une certaine proportion d'entre eux fasse profiter des institutions françaises de leur talent. Pour cela, il faut pouvoir leur offrir une structure et une rémunération qui, sans être l'équivalent de ce que peuvent leur offrir des entités de Montréal, soient attractives.
Ce problème ne pourra être résolu qu'avec des universités privées, car seules ces dernières pourront rémunérer de jeunes chercheurs africains qui voudraient travailler en Afrique à des niveaux compétitifs au plan international.
Nous pourrions aussi envisager que des centres inter-Etats, pluri-nationaux, avec un statut international, soient en mesure d'offrir à ces chercheurs une rémunération compétitive.
Il en existe quelques-uns. Il existe par exemple un organisme intégré de 3ème cycle à Ouagadougou, même s'il n'a pas suffisamment d'autonomie ni de support international pour prétendre à un certain rayonnement.

Il existe des universités régionales, comme l'UCAC (Université catholique d'Afrique centrale), et des écoles régionales. Au Cameroun, l'IRIC (Institut des Relations internationales du Cameroun) fait un peu de recherche également.
Il existe davantage d'écoles professionnelles, formant par exemple à des spécialités telles que l'administration fiscale.
Ces institutions ne font pas beaucoup de recherche. En termes de formation, certes, de nombreux progrès ont été faits. Il existe par exemple à Ouagadougou un centre de formation professionnelle (financé par l'AFD) qui monte en puissance de façon très importante.
En matière de valorisation scientifique, un problème essentiel a trait, en économie comme dans les autres disciplines, aux revues et aux publications. En matière de valorisation de la recherche française en sciences sociales, il existe deux modèles. Le premier est celui de l'IRD ou de l'AFD, consistant à publier dans des supports « maison », qui permettent une expression originale. La revue Autrement de l'IRD et les documents de travail de l'AFD en constitue des exemples, avec pour inconvénient une faible visibilité à l'international, malgré le grand intérêt de ces publications.
Le deuxième modèle est celui des universités et du CNRS, dont les chercheurs publient essentiellement dans des revues internationales (principalement anglo-saxonnes), où se joue désormais, de plus en plus, la carrière des chercheurs, au point de donner l'image d'une dictature exercée par les revues à comité de lecture. Dans le domaine des sciences sociales et de l'économie, les meilleurs chercheurs tendent ainsi à vouloir publier dans les revues anglo-saxonnes. Ils doivent alors se conformer aux exigences de ces supports et se couler dans le « moule » de la pensée qui les domine. Quelle que soit leur qualité scientifique, il s'avère difficile de faire une place, dans ces supports, à la spécificité de la pensée française ou francophone en matière de développement. Nous avons voulu placer la Revue d'économie du développement (éditée en français) au niveau des standards internationaux. Nous allons fêter cette année le vingtième anniversaire de cette revue, dans laquelle ont contribué de grands noms.
Nous atteignons les limites de l'exercice, car les meilleurs chercheurs français et francophones, sur les questions d'économie et de développement, vont directement soumettre leur article à des revues anglo-saxonnes. Le Journal of African Economies, créé à peu près en même temps que la Revue d'économie du développement, comporte quasiment une moitié d'auteurs francophones dans son dernier numéro. C'est presque un succès. On peut toutefois regretter qu'aucun passage n'ait été recherché par nos canaux de publication.
Il est une solution envisageable, que nous essayons de mettre en oeuvre : promouvoir une revue qui comporte les mêmes exigences scientifiques que les revues anglo-saxonnes, éditée en français et traduite en anglais, pour percer dans le monde anglo-saxon et accroître son attractivité pour les jeunes auteurs.
Ce problème a touché d'autres grandes revues françaises comme La Revue économique, la revue internationale du CEPII et dans une moindre mesure aujourd'hui La Revue d'économie politique. Ces revues, qui étaient francophones, ont décidé de publier la moitié de leurs articles en anglais. Elles tendent ainsi à devenir des revues anglophones et le risque de voir totalement disparaître les revues francophones existe désormais, ce qui pose un problème considérable au regard de notre influence dans le Sud francophone. Si le principe de la double publication est coûteux, il paraît indispensable pour conserver une présence en langue française, tout en conservant vis-à-vis des universités francophones.

Connaît-on le nombre d'étudiants et de doctorants qui se rendent plutôt aux Etats-Unis qu'en France ?
Je ne dispose pas de chiffre sur ce point mais le nombre d'étudiants du Sud qui choisissent d'aller aux Etats-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne est en hausse. La Grande-Bretagne, notamment, attire de plus en plus de jeunes chercheurs et étudiants. Ce pays a maintenu un budget extraordinaire pour la recherche en économie du développement.

La Grande-Bretagne a fait des choix stratégiques. Ce ne sont pas tant les montants en jeu qui ont crû : la Grande-Bretagne a concentré son action sur un certain nombre de priorités qu'elle a courageusement définies. Nous sommes plutôt restés dans le cadre d'une conception relativement ancienne, consistant à « semer à tout vent ».
La fragmentation de tous les organismes intervenant dans le champ que vous avez décrit les rend fragiles. Peut-on imaginer un rassemblement de ces forces aujourd'hui éparpillées, et à quelles conditions ? Les agences pourraient-elles par exemple être regroupées, ne serait-ce que dans la sphère publique ?
On peut certainement envisager un regroupement des chercheurs dans des centres qui soient en mesure d'assurer la pérennité et le renouvellement des générations. Il existait à Bordeaux une tradition de recherche africaine. Plus personne ne parle aujourd'hui de la recherche économique tournée vers l'Afrique dans cette université. Cette force reposait sur deux ou trois personnes et leur départ a entraîné la disparition de ces compétences.
Le dispositif reposant sur des unités mixtes de recherche, c'est-à-dire le modèle du CNRS, l'IRD, de l'INRA ou encore du Cemagref, assure un soutien public aux activités de recherche. Nous avons vu s'éparpiller dans ces organismes, à la faveur des publications de postes, différents chercheurs qui avaient fait leur doctorat chez nous, et qui avaient souvent de très solides compétences en matière d'économie du développement.
A l'occasion de l'attribution des postes, l'on peut aussi renforcer certaines unités qui paraissent meilleures que d'autres. C'est un peu l'objectif qui était poursuivi à travers le Grand Emprunt.

Nous avons évoqué cet aspect hier en présence de la directrice de l'Agence nationale de la Recherche (ANR).
Je voudrais évoquer, pour conclure, la valorisation politique de la recherche. Dans le domaine des sciences sociales et de l'économie du développement, il ne suffit pas de produire une « bonne » recherche : celle-ci doit aussi avoir un impact et influencer les idées, qui finissent par influencer, plus ou moins lentement et directement, les politiques conduites. Les Britanniques l'ont parfaitement compris et les sommes considérables qu'ils consacrent en attestent. Leur force dans les institutions internationales, de Bruxelles à la Banque Mondiale en passant par le PNUD, est infiniment plus grande que celle de la France.
La valorisation politique incombe davantage aux laboratoires d'idées et aux think tanks. Nous avions un grand retard dans ce domaine. Nous avons essayé de le combler grâce à une initiative de la puissance publique, à travers son bras armé dans ce domaine, l'Agence française de Développement, alors placée sous la direction de Jean-Michel Severino. Je veux parler de la création de l'Initiative pour le développement et la gouvernance mondiale (IDGM). Elle a consisté à apporter un soutien financier, à travers un prêt sans intérêt sur quinze ans, à deux fondations, l'IDDRI (Institut de développement durable et des relations internationales) et la FERDI que je préside. Ce soutien s'est avéré décisif pour nous apporter davantage de visibilité à l'international en tant que laboratoires d'idées.
Il a favorisé la montée en puissance de ces deux fondations, dans une deuxième étape, par l'obtention d'un LabEx (label « Laboratoire d'excellence »). Lors de la parution de l'appel d'offres pour le Grand Emprunt, l'IDDRI, la FERDI, associée au CERDI, ont monté un « IDGM+ », avec pour objectif de contribuer à la définition de nouvelles politiques de développement, sur la base des résultats de la recherche. Ce label, que peu d'équipes de recherche en économie ont reçu, nous a permis de mobiliser une grande partie du potentiel de recherche puisqu'une centaine de chercheurs français et européens ont donné leur accord pour participer, autant que de besoin, aux activités du LabEx. Les moyens combinés de l'IDDRI et de la FERDI ne représentent toutefois qu'un septième du budget du Center for Global Development, principal think tank américain en matière de développement, basé à Washington, qui accueille régulièrement à bras ouverts les têtes pensantes de la Banque Mondiale lorsque celles-ci quittent la grande institution. Nous aimerions faire de même mais nous en sommes encore loin. Un autre exemple est celui de l'ODI (Overseas Development Institute), soutenu par la politique britannique de coopération et extrêmement influent, notamment dans les cercles européens.
Nous avons indiscutablement besoin de renforcer cette activité, car la valorisation des idées et l'animation, à travers les publications ou des événements organisés à Bruxelles, à New York et dans diverses capitales est extrêmement importante pour la valorisation de la recherche française en matière de développement.

Merci beaucoup pour ce vaste panorama de la recherche sur le développement. Avec le recul dont vous disposez, en quoi la recherche conduite en partenariat avec le Sud a-t-elle pu améliorer et renforcer les capacités du Sud en matière de recherche ?
Notre réponse ne vaudra que pour l'économie. A travers les projets de développement de l'AFD, nous voyons par exemple de fortes synergies se dessiner en matière de recherche agronomique entre des centres locaux et le CIRAD, qui a l'avantage de travailler sur place.
Nous aurions beaucoup plus d'influence en économie si les doctorants que nous avons formés étaient retournés dans les universités. Ce fut le cas pour quelques-uns d'entre eux. Les premiers que nous avons formés sont retournés dans des universités. Je pense par exemple à un ancien étudiant devenu professeur au sein de l'université de Saint-Louis. Son activité a dynamisé l'activité de recherche de cette université.
Lorsque nous avons l'occasion de conduire des activités de recherche en collaboration, nous faisons appel à lui, qui peut nous aiguiller vers un assistant. Le travail en réseau est évidemment très important.
C'est le cas aussi à Dakar. D'importantes recherches ont été conduites sur des problèmes d'impact.
Ils ont travaillé avec cet ancien professeur de Saint-Louis et avec un autre professeur de Dakar, ce qui a contribué à former des étudiants à l'analyse d'enquêtes pour des évaluations d'impact, aspect très important dans l'analyse des projets de développement. Nous aurions pu développer des projets avec la Côte d'Ivoire mais la situation politique a rendu quasiment impossible toute collaboration avec ce pays, d'autant plus que de nombreux chercheurs ont rejoint les ministères sous le gouvernement Gbagbo.

En quoi les partenariats existants ou susceptibles d'être noués avec des équipes de recherche du Sud en économie ont-ils des effets en termes de valorisation politique ?
Nous avons peut-être eu davantage d'influence sur l'action politique à travers d'autres modes de formation qu'à travers la recherche. Depuis environ vingt ans, nous animons notamment un programme de formation en gestion de la politique économique. Il s'agit d'un programme de Master en un an, dans lequel nous accueillons des personnes âgées de 30 à 45 ans, qui exercent déjà des responsabilités administratives, parfois élevées (directeurs de ministères, chefs de service, etc.). Ils viennent mettre à jour leur formation en matière de gestion de la politique économique. Ce réseau d'anciens compte près de 500 personnes et cadres répartis aujourd'hui dans pays. Je crois que nous avons eu une réelle influence à travers leur formation, notamment du fait des responsabilités que certains d'entre eux ont exercées par la suite.
Ces responsables étaient très influencés par les travaux de recherche que nous avions menés au sein du Centre. Prenons l'exemple de la fiscalité, qui revêt une grande importance en Afrique (transition fiscale et augmentation de la part des impôts internes, etc.). A Dakar, le gouvernement a consenti un effort extraordinaire d'ajustement vers le haut des taux d'imposition, politique conduite en large partie par un directeur des impôts qui avait participé à notre programme. Il avait été très influencé par les enseignements dispensés par un des meilleurs spécialistes de la fiscalité en Afrique, Gérard Chambas, chercheur du CNRS qui travaille chez nous et auprès de la Banque Mondiale. Il a réellement donné lieu à un « héritier » de sa pensée. Peu de temps après la formation, l'étudiant devenu plus tard directeur des impôts du Sénégal nous a quasiment fait un cours et nous avions l'impression de réentendre un cours de Gérard Chambas. Ces personnes restent un an et sont, durant cette période, au contact des chercheurs. Ils réalisent des travaux d'étude et de petits mémoires, encadrés par un chercheur de notre centre, ce qui leur donne une bonne vision de la recherche. Ils ont aussi le droit de participer aux séminaires de recherche que nous organisons. Certains font aussi le choix de rester en France, même si nous ne les y encourageons pas.
Lorsqu'une personne qui a été formée chez nous à des activités de recherche accède ensuite à des responsabilités gouvernementales, il est permis de penser que quelque chose est passé. Nous avons connu des bons et des mauvais exemples. Je ne parlerai ici que des bons et il est vrai que dans plusieurs cas, nous avons des raisons de penser que la formation qu'ils ont reçue a eu une influence sur la suite de leur parcours.

Vous évoquez beaucoup la formation en direction de personnes qui oeuvrent dans la sphère publique. Quel regard portez-vous sur les partenariats qui peuvent être noués avec la sphère privée ?
Nous avons incontestablement assisté, depuis vingt ou trente ans, au renforcement des capacités de gestion dans le secteur privé africain. Il ne faut pas y voir le résultat de la recherche mais plutôt celui d'évolutions plus larges touchant le système d'éducation et d'enseignement supérieur des pays considérés. Par contre, je ne suis pas sûr que le secteur privé installé en Afrique fasse beaucoup appel à la recherche pour ses propres activités, comme le font certaines entreprises en France.

Vous avez très peu évoqué les difficultés de financement. Vous disposez d'une expérience particulièrement intéressante à travers la Fondation FERDI, qui est alimentée par l'AFD mais aussi par des partenariats public-privé.
La FERDI, fondation reconnue d'utilité publique, a été créée en 2000, au terme d'un long processus. La création d'une telle structure était un parcours du combattant à l'époque, même si elle s'est quelque peu banalisée depuis lors.

La France avait des craintes quant à la création de fondations, qui étaient parfois perçues comme un moyen d'échapper au contrôle de la puissance publique.
Le ministère de l'éducation nationale a particulièrement tenté de freiner la création de telles structures.
La création d'une fondation d'utilité publique nécessitait, à l'époque, de pouvoir s'appuyer pour moitié sur des financements privés et pour moitié sur des financements publics. Je ne pense pas que cette exigence ait disparu. J'ai rencontré moins de difficultés pour rassembler le tour de table que pour surmonter des obstacles administratifs. Une fois qu'ils ont été franchis, les revenus tirés des apports étaient très limités (l'équivalent d'un million d'euros).
Le prêt de l'AFD, étalé sur 15 ans, sans intérêt, a été complété par l'apport du LabEX, sur dix ans. Ces deux sources de financement nous ont fourni une base de fonctionnement importante. La troisième étape consisterait à compléter ces ressources par des financements privés mais il est très difficile d'intéresser des acteurs privés à des actions publiques en faveur du développement des idées, sur des thèmes tels que l'allocation internationale de l'aide et le développement régional.
Ces enjeux sont bien sûr importants, de façon indirecte, pour des acteurs privés mais nous ne parvenons pas toujours à les en convaincre suffisamment. Nous ne désespérons pas d'y parvenir et l'influence de fondations étrangères, dans les mêmes domaines, pourrait paradoxalement nous y aider.
Le CGDEV (Center for Global Development) est financé par le secteur privé. Sauf erreur de ma part, ce financement lui est apporté principalement par des fondations.
C'est une histoire un peu particulière. Au départ, Nancy Birdsall animait une émission à la télévision, centrée sur les questions de développement. Un milliardaire américain sans enfants, séduit par ce programme, lui a fait un chèque d'un montant considérable. C'est ainsi qu'est né le CGDEV. Puis le relais a été pris par des fondations (par exemple celle de Hewlett-Packard) et des apports privés importants. Cette structure, basée à Washington, constitue un relais important et jouit désormais d'une influence sur le Congrès.
Michelin fait partie des fondateurs de notre Fondation, car François Michelin s'intéressait beaucoup aux problèmes de développement.

Le CERDI a-t-il eu accès à des financements européens pour des recherches qu'il a conduites, en partenariat ou non avec le Sud ?
Plusieurs chercheurs du CERDI ont travaillé pour l'Union européenne, le plus souvent en tant que consultants, sur des questions de politique économique et non dans des programmes de recherche. On peut y voir un échec ou un manque de diligence dans notre action. La seule fois où nous avons été associés à un projet européen, celui-ci n'a pas été renouvelé. Les fonds sont versés à des consortiums et il faut être « dans le bon bateau » (ou en être le capitaine).
Nous avons notamment connu un échec qui me semble assez symptomatique. Depuis quatre ans, la Commission européenne a lancé un rapport européen sur le développement. L'entreprise était risquée, car il fallait faire aussi bien mais différemment du rapport sur le développement dans le monde élaboré par la Banque Mondiale, qui y avait consacré des moyens considérables. Cette idée a été dévoyée au fur et à mesure de son exécution. Les premiers rapports ont été confiés à un groupe très sérieux conduit par Madame Giorgia Giovannetti, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Ils ont été élaborés dans une collaboration très ouverte avec l'ensemble de la recherche européenne. Pour le troisième rapport, un appel d'offres a été lancé, de façon assez curieuse, pour ne pas dire davantage. Nous nous étions associés au Professeur Giovannetti mais le marché a été attribué à un groupe conduit par ODI (Overseas Development Institute), associé à un centre néerlandais et un centre allemand, suite à la réunion d'un petit comité où siégeaient les représentants des Etats-membres finançant le projet.
Trois personnes, en réalité, étaient dans la salle, un Allemand, un Britannique et un Français. De nombreux doutes sont apparus quant à ce mode de décision. Puis le processus a été reconduit pour un an sur un sujet central, qui est l'agenda post-2015. J'ai laissé entendre qu'il serait intéressant de revoir la conception de ce rapport pour que le meilleur de la recherche européenne soit sélectionné par un comité dont la composition varierait chaque année. Nous avons vu s'affronter, en l'espèce, une Europe du Nord et une Europe du Sud. Le commissaire Piebalgs m'a demandé de le conseiller sur les questions d'allocation de la dette mais il n'a pas sollicité mon avis sur ces programmes européens.
Les programmes européens ont une taille considérable, ce qui excède les possibilités des centres français, dont les moyens administratifs sont limités. En outre, comme le soulignait Patrick, il faut miser sur le bon consortium.
Le montage d'un projet requiert plusieurs mois de travail, sans être sûr d'aboutir.

En fonction de quels critères définissez-vous les priorités de vos programmes de recherche ?
Les thèmes des programmes de formation sont relativement stables (fondamentaux de la politique de change, politique fiscale, etc.), même si le contenu évolue chaque année en fonction des problèmes d'actualité. Les programmes de recherche d'un centre comme le CERDI constituent l'émanation, par les chercheurs eux-mêmes, de ce qu'il leur semble intéressant de faire, même si la direction du centre fixe de grandes orientations (microéconomie, macroéconomie, environnement, etc.). Dans un centre de recherche, les sujets de recherche sont choisis, pour une large part, individuellement, sauf en cas de réponse à un appel d'offres.
S'agissant de la FERDI, la situation est un peu différente. En tant que laboratoire d'idées, nous avons un programme, élaboré dans le cadre d'un contrat d'objectifs avec le Trésor et le MAE. Il s'articule autour de thèmes convenus à l'avance, tout en conservant une certaine flexibilité pour nous adapter à l'actualité. Si une réunion a lieu à Busan, il faut s'y préparer pour y dire des choses sensées, si possible différentes de ce que vont dire les autres. Une conférence a lieu régulièrement sur les pays les moins avancés. Nous avons un programme important dans ce domaine et nous avons créé un événement sur ce sujet.
Il y a un mois, nous avons organisé un événement à New York avec le ministère de la Coopération, le gouvernement du Burkina Faso et l'OCDE afin de nous exprimer sur les objectifs postérieurs à 2015 en matière de développement. Le risque est de voir les pays les plus vulnérables marginalisés. Nous avons donc insisté sur la nécessité de veiller à la place faite à ces pays dans cet agenda. Nous avons aussi un programme portant sur les nouveaux objectifs de développement. Il faut en ajuster le contenu au fil de l'actualité car c'est notre rôle de think tank. Cette approche est très différente de celle d'un laboratoire de recherche.
Le contenu des programmes de recherche est surtout influencé par les recrutements. Lorsque des chercheurs spécialisés en économie internationale partent vers d'autres universités, le risque est de voir cesser ce type de recherche jusqu'à un nouveau recrutement dans cette spécialité. C'est ainsi que nous parvenons à peu près à couvrir tous les thèmes que nous souhaitons embrasser, en microéconomie comme en macroéconomie. Si un déséquilibre se fait jour, nous allons nous efforcer de recruter un jeune chercheur dans la spécialité à renforcer.
Le commerce international constituait un des points forts du CERDI dans le passé. Nous avions notamment une excellent chercheuse, qui a fait le choix de partir à l'université de Genève, où elle a été recrutée comme professeur. Nous l'associons encore aux activités de la FERDI, dans le cadre du LabEx. Mais elle n'est pas sur place.
Nous avons connu, dans un centre comme le CERDI, de nombreux départs vers la Suisse, qui offre des salaires trois fois plus élevés que ceux des enseignants français.

Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous disposez d'une expertise et d'une expérience assez uniques, avec une grande antériorité sur les sujets que nous avons passés en revue. Vos éclairages nous ont été particulièrement utiles.