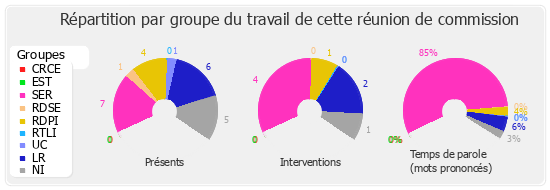Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 16 juillet 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission organise une table ronde sur la jeunesse avec la participation de :
- M. Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse ;
- Mme Yaëlle Amsellem-Mainguy et M. Joaquim Timoteo, chargés d'études et de recherches à l'Institut national de la jeunesse et des politiques de la jeunesse (INJEP) ;
- Mme Delphine Bergère-Ducote, adjointe au chef de bureau des méthodes et de l'action éducative de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
- M. Jean-Luc Prigent, directeur de cabinet de l'Agence Europe-éducation-formation France (A2E2F) ;
- Mme Marie Dacheville, chargée de communication de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France (MOF).

Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde consacrée à la jeunesse, à laquelle nous avons convié des spécialistes institutionnels et des experts de la société civile.
La jeunesse, dont le Gouvernement a fait la première de ses priorités, regroupe une très grande diversité de publics, chacun nécessitant bien souvent une réponse adaptée de la puissance publique. Cette table ronde sera l'occasion de dresser un panorama de la situation actuelle des jeunes et de mieux comprendre comment les pouvoirs publics appréhendent les jeunes dans toute leur diversité et prennent en compte leurs besoins réels dans la définition des politiques publiques. Nous tâcherons aussi de recueillir l'appréciation de nos invités sur l'efficacité des différents dispositifs publics mis en place en faveur des jeunes.
En prenant la mesure de la transversalité des problèmes soulevés, nous pourrons aborder plusieurs thèmes et défis déterminants pour l'avenir de notre jeunesse : leur scolarisation, leur formation, leur insertion professionnelle et leurs conditions d'accès à l'emploi -notamment pour des publics en difficulté- mais aussi leur bien-être dans la société, avec tout ce que cela comporte en termes d'égalité entre filles et garçons, de lutte contre les discriminations et l'exclusion, de santé et de prévention des risques.
Enfin, nous pourrons nous interroger sur les nouvelles sociabilités des jeunes : comment interagissent-ils entre eux et avec la société, par exemple dans leur usage des nouveaux médias et d'Internet.
Sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités pour un bref panorama de la situation des jeunes et leur appréciation globale des dispositifs publics qui les concernent.
Nous aurons ensuite l'opportunité de réagir après leur propos liminaire, de leur poser des questions et de solliciter des compléments d'information
Je voudrais dire quelques mots d'introduction sur la stratégie globale du Gouvernement. La priorité gouvernementale accordée à la jeunesse, qui a été rappelée à plusieurs reprises par le Président de République, s'exprime en peu de mots : il s'agit de faire en sorte que les jeunes de 2017 vivent mieux que ceux de 2012.
Deux phases se sont succédé depuis 2012, l'une consacrée aux mesures d'urgence, avec toute une série de mesures -garantie jeunes, contrats de génération, emplois d'avenir, refondation de l'école- l'autre, apparue à compter de l'automne 2012, qui repose sur la conceptualisation d'une véritable stratégie interministérielle des politiques de jeunesse, à travers le Comité interministériel de la jeunesse (CIJ), réactivé à cette occasion. Il s'agit d'un outil national, qui se décline ensuite à l'échelon territorial, à l'initiative des préfets de région.
L'interministérialité des politiques de jeunesse n'est pas un vain mot ; elle consiste à faire travailler ensemble vingt-quatre ministères. Je n'ai pas, à moi seul, en tant que délégué interministériel, la prétention de résumer l'ensemble de ces politiques, fondamentalement interministérielles pour la raison que vous avez évoquée : il n'y a en effet pas qu'une jeunesse, mais des jeunesses, confrontées à divers types de difficultés qu'il faut toutes appréhender.
La définition est elle-même problématique : on pourrait débattre des heures durant des bornes d'âge qu'il conviendrait de retenir. Commence-t-on dès l'enfance, à six ans, à douze ans, à quinze ans ? S'arrête-t-on à vingt ans, à vingt-cinq ans, à trente ans, voire à trente-cinq ans pour certains dispositifs européens ? On a là une palette de personnes et de problématiques extrêmement large. J'ai renoncé pour ma part à fixer des bornes d'âge et chaque dispositif a d'ailleurs fixé les siennes propres, ce qui est un facteur supplémentaire de difficulté. Sans doute la jeunesse peut-elle être définie par une situation de transition : être jeune, c'est finalement passer de quelque chose à autre chose, de la famille qu'on n'a pas choisie à celle qu'on a choisie, de l'éducation à l'emploi.
L'objectif des politiques de jeunesse est bien de tenir compte des difficultés propres à ces parcours, à ces transitions et d'essayer de les traiter globalement.
Le CIJ s'est réuni à deux reprises en 2013, puis en 2014. Une nouvelle réunion doit se tenir d'ici la fin de l'année, accompagnée d'un débat sur les questions de jeunesse, qui sera l'occasion de donner une nouvelle dimension à ces questions en associant plus étroitement la représentation nationale.
La politique de la jeunesse recouvre treize chantiers, implique vingt-quatre ministères et passe par plus de soixante mesures. Quatre principes directeurs sont supposés structurer l'ensemble. Le premier est le droit commun. On a prononcé plusieurs fois le mot de « dispositif » ; c'est un mot qu'il faudrait essayer de bannir de notre vocabulaire.
L'idée qu'on adopte une série de solutions spécifiques, adaptées à telle ou telle problématique, est souvent mal perçue par les jeunes avec lesquels nous travaillons, qui aspirent à être traités comme les autres et à accéder aux mêmes choses que les autres -logement, santé, loisirs, culture- afin de rejoindre de plain-pied le reste de la société.
Le deuxième principe consiste à viser l'autonomie et la sécurisation des parcours dans leur globalité. Les jeunes sont confrontés à toute une série de difficultés dans différents domaines : emploi, santé, culture, loisirs, insertion au sens large. L'objectif des politiques de jeunesse est de traiter l'ensemble de ces dimensions et donc l'ensemble de la personne.
Le troisième principe, très important, consiste à lutter contre les discriminations et les inégalités dont sont victimes les jeunes en tant que tels, mais aussi certains, parmi cette population, à divers degrés. C'est assez frappant en matière de politique de l'emploi : par rapport au taux de chômage global, le nombre de jeunes est multiplié par deux et dans les quartiers, ce taux est à nouveau multiplié par deux, et avoisine les 40 % ! Il existe donc des problèmes de discrimination et d'égalité d'accès à des biens supposés être partagés par tous.
Le quatrième principe structurant de ces politiques de jeunesse réside dans la participation des jeunes à la co-construction des politiques publiques. Ce n'est pas, là non plus, un vain mot. Au-delà de la consultation, il s'agit de partager et d'adapter les dispositifs ou les politiques publiques à l'avis exprimé par les jeunes.
L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) a réalisé d'intéressants travaux de recensement des dispositifs existant dans les différents ministères destinés à associer les jeunes. Beaucoup apparaissent hétérogènes et présentent une insuffisance globale à l'échelon ministériel. Un gros effort reste à faire sur ce sujet. Le CIJ et moi-même avons des rendez-vous extrêmement réguliers avec les associations de jeunes ; cette demande est très forte : ils se vivent et se pensent comme des acteurs des politiques publiques de la jeunesse.
Un point me paraît très important : ce dispositif national se décline territorialement. Ceci me paraît central : dès juin 2013, les préfets ont reçu pour instruction, après la première réunion du CIJ, de décliner le plan « Priorité jeunesse » à l'échelon territorial. Cela s'est traduit par des comités d'administration régionale (CAR) de la jeunesse. C'est la première fois que ce type de mécanisme a été mis en place. Il n'a pas été forcément très naturel pour des préfets de région de se pencher sur des questions de jeunesse. Ce sont souvent les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) qui en ont été pilotes. Ceci a été très positif pour faire travailler l'État en régions sur ces questions. Chaque région s'est aujourd'hui dotée d'un plan qui décline, spécifie et enrichit le plan national.
Dans les régions où les choses se sont le mieux passées, ceci se fait en partenariat étroit avec le conseil régional, qui est un acteur de premier plan des politiques de jeunesse, leader en la matière sur un certain nombre de sujets.

Nous allons à présent entendre l'INJEP, représenté par Mme Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d'études et de recherches, accompagnée de M. Joaquim Timoteo. Les collectivités ont également eu et ont toujours recours aux analyses et à la connaissance fine de cet institut, bien qu'il ait récemment changé de position vis-à-vis du ministère.
Pas encore !

Vous pourrez donc nous faire le point sur les dynamiques qui sont en cours, le Parlement contrôlant l'action du Gouvernement.
L'INJEP est, pour le moment, un établissement public autonome dépendant du ministre chargé de la jeunesse. Je ne me mettrai pas davantage en difficulté face à ma tutelle.
Même s'il est impossible de dresser un portrait de la jeunesse en cinq minutes, il me semble important d'insister sur le fait qu'il existe une jeunesse et des jeunes. Il s'agit bien de passer de l'enfance à l'âge adulte, il s'agit bien de parcours de vie, de biographies, de transitions. On n'est plus dans des trajectoires uniformes comme on a pu les connaître pendant longtemps, où l'on se transmettait une entreprise de père en fils ou, plus rarement en France, de mère en fille.
On le voit bien au cours des entretiens que l'on mène, et des enquêtes statistiques que l'on réalise, toutes les biographies des jeunes sont faites d'allers et de retours. Il n'y a plus de passage net et définitif vers l'âge adulte. Toutes les enquêtes que nous menons montrent que les étapes qui pouvaient exister naguère ne s'enchaînent plus comme auparavant : finir ses études pour accéder à l'emploi, se marier, partir de chez ses parents, et enfin avoir un enfant, ce qui constituait le but ultime.
Aujourd'hui, on arrête ses études, puis on peut les reprendre, on part de chez ses parents, on vit en colocation, on revient chez ses parents et on part mener des études ailleurs. On déménage temporairement, on a un partenaire ou une partenaire, puis le couple se sépare et l'on revient chez ses parents.
Le passage à la parentalité, sur l'ensemble du territoire, ne constitue plus un marqueur du passage à l'âge adulte : ainsi nombre de jeunes couples avec enfants vivent chez leurs parents, notamment, en outre-mer ou en Picardie.
Ces éléments, qui ont beaucoup marqué les étapes du passage à l'âge adulte jusqu'aux années 1980, sont beaucoup moins opérants aujourd'hui, même s'ils restent des indicateurs importants dans le parcours de vie, notamment dans la manière dont les jeunes les racontent.
Il me semble important de rappeler que l'adolescent constitue un public spécifique, même si les problématiques qui lui sont liées dépassent largement cette tranche d'âge. Cette étape échappe largement aux politiques publiques, puisqu'elle est située entre l'enfance et l'âge adulte, entre dix et dix-sept ans, entre le collège et le lycée. C'est une période qu'on saisit mal, qu'on saisit peu.
Les jeunes passent d'un environnement marqué par l'importance de la famille, où les valeurs sont prescrites par les parents ou par l'école, à un environnement marqué par les amis, qui imposent peu à peu de nouvelles normes et de nouveaux codes sociaux. C'est bien là que réside la difficulté de savoir que faire de ces jeunes, comment les accompagner, entendre ce qu'ils veulent, même si cela ne correspond pas forcément à nos souhaits.
Si, entre douze et quatorze ans, les préoccupations et les rythmes scolaires sont primordiaux dans leurs discours, et les occupations de loisirs vécues davantage comme une contrainte, à partir de quatorze - quinze ans, les jeunes sont partagés entre leurs amis, qui prennent de plus en plus de place dans leur vie sociale et les activités extrascolaires. Il faut l'entendre : sortir entre amis, aller au cinéma, dans des centres commerciaux, rester sans rien faire, c'est extrêmement important quand on est jeune. Même si les adultes passent leur temps à dire que, lorsqu'on ne fait rien, on perd son temps, pour les jeunes, quand on ne fait rien, on fait beaucoup de choses : on parle, on lit, on écoute de la musique, on débat de l'actualité, de la société, on parle avec ses copains !
Derrière cette impression de génération homogène, les jeunes sont cependant loin d'être égaux devant les difficultés qui se concentrent sur les moins diplômés ou les non diplômés, sur ceux qui sont les plus éloignés des centres urbains ou des métropoles. Les parcours d'entrée dans la vie adulte se sont diversifiés et la jeunesse est de mieux en mieux formée. Elle a donc des attentes de plus en plus fortes et les exprime, ce qui change de la jeunesse d'il y a quarante ans, qui était moins formée, avait des attentes moins précises et des déceptions moins fortes, à la hauteur de la formation qu'elle avait reçue.
70 % d'une génération sortent aujourd'hui du système éducatif avec au moins le baccalauréat en poche, 42 % sont diplômés de l'enseignement supérieur mais, à l'autre bout de l'échelle, près de 20 % ont quitté le système éducatif sans aucun diplôme. Ces constats sont à nuancer selon l'origine sociale : un enfant d'enseignant a quatorze fois plus de chances de décrocher un baccalauréat qu'un fils d'ouvrier non qualifié ; à l'inverse un enfant d'ouvriers a presque autant de risques (un sur quatre) de sortir sans diplôme que de chances (un sur quatre aussi) d'être diplômé du supérieur.
La jeunesse est confrontée à deux phénomènes particulièrement alarmants, à propos desquels on doit tous être vigilants, qui sont l'appauvrissement et l'exclusion. Ces phénomènes frappent aujourd'hui quasiment le quart des jeunes, contre 13 % de la population en général.
Presque un jeune sur quatre se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Tout ceci fait émerger un public que les structures luttant contre l'exclusion sociale -Restos du coeur, Croix-Rouge, ATD Quart Monde- ne connaissaient pas jusqu'alors : personnes de plus en plus jeunes, sans lien avec leurs parents, sans ressource financière, plutôt peu qualifiées. Depuis peu, on voit également de plus en plus de jeunes femmes.
Les « NEET » (« not in education, employment or training »), ces jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, et qui ont fait l'objet d'un article dans Le Monde il y a deux jours, constituent un indicateur pour l'Europe. C'est surtout le cumul de certains facteurs qui explique leur mise à l'écart. Ils sont plus souvent issus de l'immigration, ont fréquemment un faible niveau d'éducation, vivent ordinairement dans une région reculée, appartiennent plus généralement à des ménages à faibles revenus.
Les « NEET » représentent environ 18 % à 20 % de la tranche d'âge des 18-24 ans, et sont 21 % des 25-29 ans, avec un gros écart entre les femmes, plus touchées, et les hommes. Ceci doit nous alerter sur les inégalités territoriales, et les inégalités entre les hommes et les femmes, vécues par les jeunes.
L'éducation populaire et informelle peut et doit servir de levier pour permettre à ces jeunes d'accéder différemment à des qualifications et développer ainsi des compétences sociales et psychosociales reconnues, qu'ils n'ont pu faire valoir au sein du système scolaire. C'est ce que proposent le dispositif du service civique et le programme européen « Jeunesse en action », devenu « Erasmus Plus - Jeunesse et Sports ».
C'est également ce qu'offre, dans une autre mesure, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), sur lequel j'ai particulièrement travaillé et qui offre la possibilité d'exercer une fonction d'encadrement à partir de dix-sept ans. Cette fonction peut se révéler importante sur le marché du travail, même si elle n'est pas forcément définie comme telle, sans conditions de diplôme. Le BAFA permet à tous les jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle ou dans le domaine du volontariat. Il s'agit pour des jeunes d'encadrer d'autres jeunes, ce qui correspond à une demande d'une partie de la jeunesse de vivre dans l'entre-soi à un moment de sa vie.
Les animateurs participent à l'extension et à l'élargissement des activités éducatives en direction de lieux, de publics et d'âges de la vie que n'avait pas ou peu investi l'éducation nationale. Le BAFA est l'occasion d'un passage entre l'enfance et l'âge adulte où, d'un seul coup, on a des responsabilités et des personnes sous sa responsabilité. C'est aussi une manière de construire et de participer à un projet d'équipe important dans la définition de soi, surtout en situation de difficulté.
Ce qui pose à chaque fois difficulté, c'est la différence entre les attentes des jeunes et celles des familles. Pour une grande part, les familles veulent bénéficier d'un « retour sur investissement » en matière de loisirs, de culture, de choix d'orientation. Les jeunes, quant à eux, se situent dans des enjeux d'épanouissement, de construction identitaire, de diversité, de curiosité. Ce n'est pas sans conséquence sur la façon dont on considère les loisirs, ni sur la manière dont les milieux sociaux investissent certains loisirs, quelques-uns pouvant devenir disqualifiants parce qu'investis par les milieux populaires, par exemple.
Ceci pose la question qu'évoquait jadis Pierre Bourdieu et qui demeure d'actualité : où en est-on de la culture légitime ? Que penser de ces jeunes, dont les adultes considèrent qu'ils ne lisent pas, alors qu'ils passent leur temps sur Facebook : quand on est sur Facebook, on passe bien son temps à lire ! Sur Twitter, ils passent leur temps à écrire ! Ils passent leur temps à lire des mangas, à écouter de la musique. Ce sont des pratiques culturelles, même si elles ne sont pas considérées comme légitimes.
J'évoquerai à ce sujet une des perles du baccalauréat : un examinateur demande à un candidat de lui parler de Corneille : l'adolescent cite alors les paroles d'un titre du chanteur Corneille ! Cela a donné lieu à un certain décalage générationnel et culturel entre le lycéen -pour qui Corneille est un musicien d'aujourd'hui- et l'enseignant, qui n'a su que faire.
À force de répéter aux jeunes qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne mangent pas bien, qu'ils consomment trop d'alcool et ne font pas ce que l'on attend d'eux, ils finissent par penser que, pour être jeune, il faut mal manger ! On le voit très bien dans les enquêtes qui sont faites en matière de santé. Quel message envoie-t-on à la jeunesse en lui répétant qu'elle ne lit pas, n'écoute pas la bonne musique, ne sait pas s'habiller, mange mal, boit trop d'alcool, fume trop, regarde trop d'écrans, alors qu'il est légitime que les adultes consultent leur smartphone à table, parce qu'ils ont du travail, et que le travail est plus important que les copains ?
Il existe un décalage entre ce que l'on voudrait qu'ils soient, ce qu'ils sont, et la manière dont on apprécie ce qu'ils font, leurs compétences qui, notamment pour les moins qualifiés, peuvent être réelles et doivent être reconnues par la société.

Certains jeunes, dans leurs parcours, ont affaire au ministère de la justice. Qui sont-ils ? Que fait-on en matière de prévention, d'enfermement, d'accompagnement ? Quelles garanties leur apporte-t-on dans le cadre de leur parcours éducatif ?
Je représente ici la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Nous avons essentiellement en charge les mineurs de treize ans à dix-huit ans, mais aussi de jeunes majeurs, jusqu'à vingt et un ans, qui nous sont confiés par décision judiciaire des juges des enfants ou des juges d'instruction.
Quel est le profil type de ces mineurs -même s'il s'agit d'un public très hétérogène ? Ce sont en grande majorité des mineurs en situation de difficulté scolaire, voire de rupture scolaire, à la scolarité parfois chaotique, interrompue, reprise. La majorité sont totalement déscolarisés et sans qualification et la plupart n'ont aucun projet professionnel défini. Bien souvent, ils sont loin de l'accès à la culture et en marge du droit commun.
Il existe aussi des problématiques particulières de prise en charge des mineurs isolés étrangers, pour lesquels se pose la question de l'absence de référent parental, mais aussi de la barrière de la langue.
Notre mission est d'intervenir pour ne plus avoir à intervenir : nous sommes présents à un moment de la vie du mineur, lorsqu'il a commis une infraction ; l'objectif est de prévenir la réitération, la récidive, mais aussi de lui permettre d'accéder au droit commun.
L'enjeu, pour nous, consiste à être présent au sein des politiques publiques de la jeunesse. J'ai apprécié que vous ne parliez pas de dispositif, ce terme pouvant avoir une image fermée. L'objectif est d'assurer une continuité du parcours du mineur, sa fluidité, afin de lui permettre d'avoir accès à toutes les politiques publiques.
Les enjeux que l'on se fixe en la matière consistent à renforcer l'accès à la formation et à l'orientation et à permettre d'accéder à l'emploi ainsi qu'aux soins et au logement.
Nous nous occupons de ces jeunes à 95 % en milieu ouvert, mais également dans le cadre du placement judiciaire et de la détention.
La détention est un temps très singulier ; notre mission est d'éviter que ce soit un temps de rupture, durant lequel il ne se passe rien. L'adolescence se déroule très vite : il faut donc faire en sorte que ce temps permette de favoriser une prise en charge des mineurs et assurer, autant que faire se peut, la continuité de leur parcours.
Il faut essayer de mettre en oeuvre, pour les primo-délinquants incarcérés pour des affaires très graves, ou de continuer, pour les mineurs déjà connus de la justice, une action qui s'inscrit dans le temps. Parfois, il s'agit de leur permettre d'accéder, en détention, à une culture qu'ils n'ont pas connue par ailleurs, ou d'accéder à la formation.
C'est une mission conjointe de l'administration pénitentiaire et de la PJJ, que nous menons en pluridisciplinarité avec les acteurs de l'éducation nationale présents en prison, mais aussi avec les acteurs de la santé présents dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
L'objectif, lorsqu'un mineur est incarcéré, est d'évaluer sa situation et ses besoins et de lui offrir une prise en charge individualisée sur le temps de détention. Il s'agit souvent d'un temps assez court. En moyenne, un mineur reste détenu trois mois, que ce soit dans le cadre de la détention provisoire ou au titre d'une peine.
Nous sommes tenus de permettre au mineur d'accéder à l'enseignement, aux soins et aux programmes d'activités. Après une phase de bilan et d'évaluation, nous proposons un emploi du temps au mineur incarcéré. L'axe structurant de celui-ci repose sur l'enseignement. Que le mineur ait plus ou moins de seize ans, il est soumis à l'obligation scolaire, ce qui n'est pas le cas en dehors de la prison, l'obligation d'enseignement étant imposée dans le droit commun jusqu'à seize ans. En détention, nous souhaitons que l'ensemble des mineurs puissent bénéficier de l'enseignement. Le taux de scolarisation actuel en détention, que ce soit en quartier pour mineurs ou en établissement spécialisé, est de 95 %. L'objectif est donc atteint.
Nous faisons en sorte de proposer un emploi du temps qui garantisse au mineur un certain nombre d'heures d'enseignement. Il atteint dix-huit à vingt heures hebdomadaires en établissement pénitentiaire pour mineurs et douze heures dans les quartiers pour mineurs. Le mineur est affecté dans un groupe scolaire de quatre à sept jeunes. Ce groupe est géré par un enseignant. Dans un souci d'individualisation, cette petite taille permet à l'enseignant d'accéder aux demandes de chaque mineur.
Nous proposons aussi des activités socio-éducatives, à raison de trois jours et demi par semaine en quartiers pour mineurs et de cinq jours et demi dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. Ces activités sont animées par la PJJ. Les surveillants gèrent certaines activités et nous sollicitons beaucoup d'intervenants extérieurs. Ce faisant, nous nous inscrivons totalement dans une logique de politiques publiques. Nous faisons en effet appel à des associations, soit rémunérées ou avec lesquelles nous passons des conventions. Nous faisons également appel à des partenaires institutionnels, notamment en matière de politiques de prévention concernant la santé.
Ces associations nous permettent par ailleurs de conduire par ailleurs des actions autour de la citoyenneté. Ainsi, en détention, nous organisons des journées défense et citoyenneté qui, normalement, s'adressent à un public de scolaires de dix-sept ans à dix-huit ans. Généralement, notre public n'a pas accès à ces journées à l'extérieur.
Des actions d'éducation à la santé et à la culture sont également menées, avec beaucoup d'initiatives autour de la radio, de la production d'un journal, de la musique et du cinéma. Nous travaillons aussi sur des connaissances plus poussées en matière technique et scientifique et sur les activités sportives, comme à Marseille, où nous avons noué un partenariat avec l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Nous travaillons avec de grandes associations reconnues d'utilité publique, comme le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI), la Croix-Rouge, la Ligue de l'enseignement ; ceci nous permet de proposer, dans les six établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et les quarante-trois quartiers pour mineurs, une palette d'activités assez variée.
Ces activités ne visent pas à la formation professionnelle mais à l'acquisition d'un minimum de culture générale. L'objectif de l'enseignement est de permettre aux mineurs d'accéder aux savoirs de base en mathématiques, français, histoire ou géographie, de façon à ce qu'il leur soit possible de reprendre par la suite un parcours de formation destiné à les préparer à leur sortie. Lorsqu'il quitte la détention, le mineur se voit remettre un dossier de sortie ; l'éducateur, accompagné du chargé d'enseignement, mais aussi des représentants du centre d'information et d'orientation (CIO), et parfois des coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, préparent un projet permettant à l'intéressé de rejoindre ensuite le droit commun en matière de formation et d'enseignement.
Nous prenons également en charge les mineurs dans d'autres types de dispositifs de la PJJ. En milieu ouvert, il s'agit de travailler avec tous les partenaires de l'enseignement pour favoriser la rescolarisation. Néanmoins, beaucoup sont dans une situation telle qu'ils ne peuvent accéder au droit commun. C'est pourquoi nous proposons, dans nos services et nos établissements, un dispositif d'activité de jour, qui permet de remettre à niveau les mineurs en milieu ouvert et en établissements de placement. Ces activités proposent une remise à niveau dans la perspective de les rescolariser. Si ce n'est pas possible, ils intègrent, à la PJJ, des unités chargées de l'enseignement, où l'on essaye de leur proposer une préformation professionnelle. Pour ce faire, on leur donne le statut de stagiaires de la formation professionnelle, qui leur permet d'avoir des droits, une protection sociale, de commencer à cotiser à la retraite, mais aussi d'avoir un statut. Il est très important, d'emblée, de pouvoir dire au mineur que nous allons le réinscrire dans un statut soit d'élève, soit de stagiaire de la formation professionnelle.
La PJJ a toujours proposé un dispositif d'insertion. Une inspection des dispositifs a démontré, il y a quelques années, qu'un nombre insuffisant de mineurs y avait accès, du fait des procédures d'admission. Une réforme a été mise en place ; en parallèle, le législateur a voté, en 2007, une mesure d'activité de jour, prononcée par le juge des enfants, qui oblige le mineur, sur une période donnée, à exercer une activité. Cette mesure existe toujours, mais est très peu utilisée.
Entre-temps, à la suite d'une inspection, la PJJ a complètement revu et réformé son dispositif d'insertion. Nous avons voulu que toutes les entités de la PJJ soient en capacité de proposer des activités d'insertion aux mineurs. Dès qu'il arrive, le mineur bénéfice d'une mesure d'activité de jour ; si tel n'est pas le cas, nous proposons d'emblée un bilan scolaire de sa situation et faisons en sorte de lui proposer un dispositif « accueil accompagnement », avec un emploi du temps et des activités liées à la scolarité comportant l'accès aux savoirs de base, à la culture et au sport. L'objectif est de travailler avec les partenaires institutionnels que sont les CIO et les missions locales, afin de raccrocher le mineur au droit commun de la scolarité et de la formation professionnelle.
Pour autant, certains mineurs n'y ont pas accès. Il s'agit d'éléments totalement déscolarisés, à qui nous proposons un module de préformation professionnelle leur permettant d'accéder à des activités comme le bâtiment, la coiffure ou la restauration, ces activités leur permettant de s'inscrire par la suite à une formation de type certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou brevet d'études professionnelles (BEP).

Nous allons à présent entendre M. Jean-Luc Prigent, directeur de l'Agence Europe-éducation-formation France. Il s'agit d'une autre population de jeunes, ceux de L'Auberge espagnole. Cette caricature ne résume toutefois pas toute l'action des jeunes qui se déplacent hors de nos frontières.
En effet. Jusqu'en 2014, la Commission européenne désignait pour la France un certain nombre d'agences chargées de mettre en oeuvre un programme appelé « Éducation et formation tout au long de la vie ». C'est le panorama des âges de la jeunesse que l'on évoquait tout à l'heure. À partir de 2014, et pour les sept années à venir, le programme s'est intitulé « Erasmus Plus » ; il intègre de nouvelles dimensions, comme la jeunesse. Désormais, le sport en est également partie prenante. On y retrouve toutes les compétences du citoyen que l'on recherche -formations qualifiantes, qualifications informelles- qui associées, constituent les qualités du citoyen actuel.
Jusqu'à présent, le programme était découpé en différentes dimensions avec, pour l'enseignement supérieur, le fameux « Erasmus » du film L'Auberge espagnole, « Leonardo » pour les apprentis, « Comenius » pour l'enseignement scolaire, et « Grundtvig » pour l'éducation des adultes.
Erasmus Plus les a désormais remplacés, permettant ainsi d'en revoir la dimension sectorielle. Dorénavant, nous travaillons transversalement, avec des mobilités individuelles, des mobilités de coopération et des soutiens aux politiques européennes.
L'agence nationale qui gère ces mobilités traite chaque année soixante-quinze mille départs de citoyens français qui partent en Europe et au-delà pour certains programmes de masters spécialisés ou doctorants, connus sous le vocable « Erasmus Mundus ».
Quel est le plus du programme Erasmus Plus ? Il s'agit tout d'abord de financements renforcés, de l'ordre de 40 % de budget supplémentaire. L'impact aura lieu dans deux ans. L'objectif est globalement de doubler les mobilités européennes, pour dépasser l'idée que celles-ci ne profitent qu'à un petit nombre de personnes -ce qui est vrai en soi. Elles restent néanmoins accessibles. Dans un contexte de crise, l'objectif est de mieux cerner les compétences et les formations que l'on développe pour aller vers l'emploi.
L'Agence affiche cinq objectifs vis-à-vis des jeunes. Il s'agit d'une part d'un programme intégrateur pour les publics les plus en difficulté ou les plus éloignés de la mobilité internationale ou européenne. Ce programme est également présent dans les territoires ; il s'appuie sur une mobilisation des acteurs, notamment des régions, qui financent ces mobilités, soit en complément de l'Europe, soit de façon isolée, selon des financements plus ou moins importants. Il s'agit aussi d'une dimension internationale renforcée. Ce sera notamment le cas pour l'enseignement supérieur, à partir de 2015.
L'objectif est aussi de préserver une image positive et un capital de sympathie fort auprès des citoyens. Un sondage réalisé récemment par TNS-Sofres valide notamment cette idée, plaçant Erasmus quasiment à l'échelon de l'euro et de la politique agricole commune (PAC), avec des investissements financiers évidemment bien moins importants que pour la PAC. Le programme Erasmus véhicule une image très positive auprès du citoyen. À nous d'y être attentifs et d'intégrer un maximum de jeunes à ces programmes, qui sont bien plus ouverts qu'auparavant, toute la jeunesse étant désormais concernée.
Enfin, ce programme est bien géré et promeut des projets de qualité. La gestion du programme constitue en effet notre coeur de métier : en quoi les aspects pédagogiques sont-ils pertinents ? En quoi les programmes sont-ils innovants ? En quoi impliquent-ils des acteurs intéressants ? En quoi un euro dépensé à l'échelon européen est-il plus performant qu'un euro dépensé à l'échelon national ?

Autre type de population : les meilleurs ouvriers de France. Nous allons à présent entendre Marie Dacheville. Qui sont ces jeunes ? Quel est leur parcours ? Quel est leur devenir ?
La Société nationale des meilleurs ouvriers de France est une association de type loi de 1901 qui a vocation à rassembler et à représenter les meilleurs ouvriers de France, notamment à faire reconnaître les deux cents métiers qui se cachent derrière ce titre.
Cependant, nous ne sommes pas organisateurs du concours des meilleurs ouvriers de France, qui est assuré par un autre organisme rattaché à l'éducation nationale. Le concours que nous organisons quant à nous s'intitule « Un des meilleurs apprentis de France », que vous connaissez, la cérémonie de remise des médailles ayant lieu chaque année au Sénat, en salle des conférences.
La volonté des meilleurs ouvriers de France, à travers ce concours, est de transmettre leur savoir-faire, leur goût pour l'excellence aux jeunes générations, afin d'assurer la relève. Le concours touche une centaine de métiers chaque année. Ce sont des métiers de l'artisanat, des métiers de bouche, de l'industrie, du luxe -couture, bijouterie- ou qui touchent à l'environnement et aux travaux paysagers. C'est un concours qui s'adresse aux moins de vingt et un ans pour la grande majorité des métiers, à des jeunes en deuxième année de CAP, de BEP, ou en baccalauréat professionnel. On touche donc les filières professionnelles de niveau IV et V. Les jeunes qui passent le concours sont pour moitié en alternance, l'autre moitié suivant une formation plus classique.
Notre fonctionnement est délocalisé et comporte une déclinaison territoriale, avec un échelon d'épreuves départementales, puis régionales et une finale nationale. Nous nous appuyons sur un réseau de bénévoles, tous meilleurs ouvriers de France, qui organisent le concours local, en coordination avec le siège national.
Le travail avec les centres de formation des apprentis (CFA), les entreprises qui accueillent les jeunes apprentis et les chambres des métiers et de l'artisanat est assez actif. Tous les acteurs locaux participent à ce concours.
Les épreuves ont généralement lieu entre février et septembre, la remise des médailles ayant lieu au Sénat, en mars de l'année qui suit. Trois cent vingt lauréats nationaux ont été distingués l'année passée parmi quatre mille huit cent candidats. Par ailleurs, cette année, nous dénombrons cinq mille candidats, ce qui démontre l'engouement pour ce concours. Il s'agit de jeunes qui ont envie de réussir, de faire leurs preuves, de montrer qu'on peut atteindre l'excellence dans les métiers manuels, ce qui est le but du concours. Notre rôle est de les accompagner, de les aider à atteindre l'excellence et de les pousser.
L'objectif principal est aussi de revaloriser les filières professionnelles et les métiers manuels qui, à tort, sont souvent mal perçus. Il faut leur redonner leurs lettres de noblesse. Je citerai l'exemple d'une jeune spécialiste en marqueterie : très bonne élève, elle aurait pu faire de bonnes études générales et elle a dû se battre contre ses parents pour pouvoir exercer le métier qu'elle aimait. Le fait qu'elle veuille suivre un apprentissage était mal perçu par son entourage.
Il faut montrer que l'on peut réussir dans les métiers manuels et donner envie aux jeunes de se lancer dans ces voies. Ce ne sont pas des voies de garage, mais des voies de réussite. Ce savoir-faire fait partie des atouts de la France. Il faut donc donner envie aux jeunes de se lancer dans ces domaines.
Nous saluons donc le Gouvernement et Benoît Hamon, qui souhaitent accentuer les mesures en faveur de l'apprentissage et prévoir un budget destiné à inciter les entreprises à embaucher des jeunes.
Enfin, je voudrais citer une étude remontant à 2012, qui démontre que les lauréats de ce concours, notamment pour les jeunes issus de l'immigration, ont plus de chances que les autres de trouver un emploi à l'issue de leur formation. Cela fait partie de nos objectifs et c'est donc un motif de satisfaction.

Nous avons entendu vos préconisations. Trois membres du Conseil supérieur des programmes siègent dans notre commission ; nous serons très attentifs au fait que la valorisation de ces métiers figure en bonne place par rapport aux autres filières.
L'été ayant débuté, nous n'avons pas de représentants du panel des lycéens ou des jeunes thésards. J'aurais aussi voulu vous faire entendre des personnes d'ATD Quart Monde, mais aurions pu alors consacrer une journée entière à notre table ronde. Ces situations existent néanmoins, et nous devons toutes les prendre en compte.
La parole est à présent aux membres de la commission et, tout d'abord, à M. Jacques-Bernard Magner, président du groupe d'études sur l'éducation populaire ; ce secteur recouvre beaucoup d'activités fortement appréciées par les jeunes.

La diversité de la jeunesse est effectivement fort grande, et il n'est pas facile d'en traiter en une heure de débats. Pour ce qui est de l'éducation populaire, vous avez bien traduit un certain nombre des priorités qui ont été tracées par le ministère, notamment par Najat Vallaud-Belkacem.
Je pense que le service civique fait aujourd'hui partie de ces éléments importants ; il s'adresse à tous les jeunes, même si les plus diplômés y accèdent plus facilement que ceux qui le sont moins -bien que l'objectif soit de s'adresser à des jeunes moins diplômés. C'est un peu comme les emplois d'avenir : il n'est pas toujours aisé d'avoir de jeunes non diplômés qui s'orientent vers ces dispositifs.
La question que je souhaitais poser au représentant du ministère est la suivante : pourra-t-on atteindre l'objectif de cent mille jeunes dans le service civique d'ici 2017, sachant que l'on est aujourd'hui à trente-deux mille, considérant les moyens financiers que cela sous-tend ?
Toutefois, je l'ai constaté dans beaucoup d'associations d'éducation populaire dépendant de la Ligue de l'enseignement : c'est une réussite pour les jeunes et pour ceux qui les accueillent.
On parle beaucoup de l'État et de la région, mais on oublie souvent que les communes remplissent un rôle très important auprès des jeunes, car on s'adresse d'abord au maire, notamment dans les communes rurales. Tout l'intérêt des regroupements de jeunes européens, en particulier des derniers entrants, réside dans le contact qu'ils peuvent avoir entre eux et avec les jeunes Français. En matière de formation et d'acculturation, c'est important.

Madame Bergère-Ducote, vous avez évoqué les partenaires de la PJJ sans mentionner les départements. Or, le conseil général du Finistère intervient dans les différents secteurs que vous avez évoqués et il finance notamment l'un des éducateurs associés aux maîtres des classes relais. Dans certains collèges, c'est un premier pas vers la formation et l'éducation des jeunes qui décrochent.
Par ailleurs, les jeunes de plus de vingt-cinq ans pour lesquels la mission locale ne parvient pas à trouver une orientation tombent dans le dispositif du revenu de solidarité active (RSA) qui relève également du conseil général. Ce sont donc tous les acteurs du département qui doivent alors agir, en lien avec les dispositifs existants.
Dès 2003-2004, le département du Finistère a mis en place un fonds d'avenir pour les jeunes ; nous avons été avant-gardistes en la matière ; ce fonds rassemblait l'État, les missions locales, le département, l'éducation nationale, et développait des projets de neuf mois, payés 300 euros mensuels, afin d'aider ces jeunes en complète rupture avec leur famille et l'éducation à se remobiliser et à essayer de trouver une orientation. Ce dispositif survit, mais a désormais pris le nom de « garantie jeunes », et accompagne bien évidemment les différents acteurs, qu'il convient de ne pas négliger.
Enfin, on n'a pas abordé le problème des jeunes dans la ville ; or, l'espace public et les jeunes sont des sujets importants qui, dans l'urbanisation et l'aménagement d'une ville, doivent être considérés. Les urbanismes ont d'ailleurs commencé à intégrer ce phénomène.

Je voudrais m'adresser à Mme Bergère-Ducote concernant l'accès des jeunes détenus aux moyens informatiques.
Il y a quelques années, j'ai fait partie d'une commission d'enquête sur les conditions de détention. J'ai été frappé, à l'époque, par le fait que l'utilisation des moyens informatiques était très restreinte, pour des raisons de sécurité. On peut le comprendre ; cependant, si on considère que la détention a avant tout deux objectifs -la privation de liberté et la préparation à la réinsertion- n'est-il pas particulièrement regrettable que les jeunes soient privés de ces outils, qui tiendront une grande place dans leur vie le jour où ils seront libérés ?
Peut-être les choses ont-elles changé depuis que j'ai participé à cette commission d'enquête, mais je pense qu'il faudrait trouver le moyen de ne pas entraver ces possibilités, même si des questions de sécurité peuvent se poser car, le jour où ils sortiront, ils découvriront un monde qu'ils ne connaissent pas et ils seront dépassés, ce qui serait regrettable !

Je suis aussi élu local : lorsqu'on entend décliner des programmes, on est toujours sensible à ce qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible. J'ai également travaillé sur la garantie jeunesse et l'articulation avec l'Europe. Il s'agit d'abord de trouver ce public qui est introuvable !
Pensez-vous que les multiples guichets à la disposition des politiques et des administrations permettent d'aller chercher le jeune qui n'a pas d'emploi et ne poursuit pas d'études, ni de formation ? Le discours peut être agréable, mais sommes-nous opérationnels ? Avons-nous les outils pour répondre à l'enjeu majeur que vous avez présenté ?

Même si nous n'avons pas réuni tous les acteurs du sujet, vous nous avez dressé un panorama assez large des préoccupations de l'État et de la jeunesse dans toute sa diversité.
Je m'attacherai à poser des questions sur la PJJ et sur l'ouverture à l'enseignement supérieur. Nous sommes très attachés à la PJJ ; c'est un service précieux. En tant qu'élue locale, comme d'autres, j'ai l'occasion de beaucoup travailler avec les agents de la PJJ ou avec les associations partenaires. On constate cependant que les jeunes sont parfois en difficulté du fait de l'influence néfaste de leur entourage ou de leur propre famille, alors qu'ils sont bien pris en charge par leur éducateur, qui leur montre le chemin et les accompagne dans leur parcours. Certaines loyautés sont antagonistes, et on assiste à des échecs cuisants, à la fois pour le jeune, mais aussi pour le service qui s'en occupe. Comment appréhendez-vous ces difficultés, au-delà des principes et des objectifs de votre mission de politique publique ?
J'ai par ailleurs fait part à Mme la présidente d'une expérimentation menée par la région Île-de-France, suivie d'une recherche et d'une analyse sur l'ouverture à l'enseignement supérieur des jeunes incarcérés. Je pense que c'est un vecteur d'émancipation et de formation des esprits très importants. Il s'adresse bien évidemment à des jeunes incarcérés pour de plus longues périodes, et qui sont intéressés par une telle démarche. Avez-vous connaissance de ce dispositif ? Êtes-vous en mesure de le mettre en oeuvre, que ce soit à la PJJ, à l'INJEP ou à l'A2E2F ? Certaines convergences peuvent être ainsi mises en oeuvre.

J'aimerais obtenir un éclaircissement de Mme Amsellem-Mainguy à propos du « retour sur investissement » qu'attendent les familles, alors que les jeunes sont plutôt dans l'épanouissement. Il me semble que l'épanouissement, c'est aussi de l'investissement pour les familles !
Plusieurs interventions ont pointé un certain décrochage de la jeunesse par rapport à une société qui semble ne pas savoir appréhender leurs particularités.
Par ailleurs, quelle est la réalité de la problématique de la santé chez les jeunes -pratiques de prévention, soins ?
Enfin, la détention de jeunes en semi-liberté à la prison de Gradignan m'est apparue très positive. Avez-vous une idée de la manière dont ces initiatives sont déployées sur le territoire ? À quelles difficultés se heurtent-elles ? En Gironde, l'expérience semble être positive à plus de 90 % !

Je me félicite que par vos interventions vous vous soyez penchés sur la jeunesse avec bienveillance, dans un pays dont ce n'est pas la culture ! Notre pays n'aime pas sa jeunesse : on la considère toujours comme un problème, beaucoup plus que dans d'autres pays, comme l'Italie, où elle représente un atout, une chance et où elle bénéficie de beaucoup d'encouragement.
Chacun de vous a traité le sujet de la diversité du parcours des jeunes. On l'a aujourd'hui comprise et on y répond. Toutefois, il y a à tout cela un effet très pervers : on n'y comprend plus rien.
Bien que j'aie accès à toute la diversité de l'offre, j'ai d'énormes difficultés avec mes propres enfants, et eux-mêmes sont complètement perdus ! Or, vous l'avez dit, pour que les jeunes soient acteurs de leur propre vie, il faut qu'ils aient accès à l'information.
Je ne mésestime pas la diversité des offres, mais le guichet unique -je rejoins sur ce point Dominique Bailly- n'existe pas du tout ! C'est dans ce domaine qu'il faut concentrer les efforts, afin d'optimiser toutes les actions engagées. En a-t-on conscience ? Certes, il existe bien un délégué interministériel, mais a-t-on compris qu'il faut une plateforme où trouver des réponses aux différentes questions que l'on se pose -emploi, orientation scolaire, loisirs ?
Certains -ce n'est pas mon cas- sont nostalgiques du service militaire, qui constituait un creuset. Ceux qui pouvaient y échapper ne s'en privaient toutefois pas. On l'a remplacé par le service civique, mais la diversité de l'offre acte le fait que chacun doit être dans sa case et avoir son parcours. Je vis dans le XXe arrondissement de Paris, où les ateliers d'artistes côtoient les cités, dont les jeunes ne sortent pas, alors qu'ils pourraient découvrir autre chose, échanger avec d'autres !
Ceci va donc à l'inverse de la réponse individuelle ; il faut, à un certain moment, des dispositifs où tout le monde se mélange. C'est pourquoi je vois le service civique d'un très bon oeil, si on y met les moyens et que les plus défavorisés puissent aussi y accéder.

Monique Dagnaud, dans un article du journal Le Monde, il y a quarante-huit heures, insistait sur le fait que les jeunes s'opposent de nos jours assez peu à leurs parents, dont ils ont besoin de plus en plus longtemps ; elle évoquait, de façon assez allusive, une possible société de la défiance non vis-à-vis des parents, mais vis-à-vis des élites, tant politiques qu'économiques. Comment jugez-vous ce point ?
En second lieu, l'un des problèmes de la France ne vient-il pas du fait que notre pays ne fait pas confiance à la jeunesse et que les baby-boomers s'accrochent désespérément à leurs postes, l'entrée des jeunes dans la vie active ne pouvant se faire du fait que les places sont déjà prises ?

Je constate que les résultats du baccalauréat progressent année après année. En même temps, la pauvreté continue d'augmenter parmi les jeunes, ce qui est désolant.
Par ailleurs, a-t-on analysé tous les bénéfices que l'on peut tirer du service civique pour l'insertion de notre jeunesse ?
D'autre part, n'existe-t-il pas un profil type pour ceux qui réussissent mieux en alternance qu'en lycée professionnel ? Il me semble que les jeunes qui ont rejeté l'école, qui n'ont pas réussi à l'école primaire ni au collège, ont un meilleur profil pour réussir dans l'alternance plutôt qu'en lycée professionnel. Je ne sais pas si cela a été mesuré pour aider notre jeunesse, qui a besoin d'être conseillée, à trouver la solution.

Ma question porte sur le service civique. Ce sujet, qui fait l'actualité de temps à autre, est-il véritablement pris en compte dans la politique que vous avez énoncée en introduction ? Si tel est le cas, quelles sont les avancées concrètes -qui supposent bien entendu des financements ?

J'ai souvent, par le passé, dénoncé le fait qu'à chaque fois qu'on compose un gouvernement, on se croit obligé d'y mettre un ministre ou un secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, comme si le sport ne concernait que la jeunesse, et comme si la première préoccupation de la jeunesse était de faire du sport ! On voit bien que la jeunesse éprouve un problème pour trouver sa place dans la société française.
Estimez-vous, les uns et les autres, que l'organisation gouvernementale actuelle en la matière soit la bonne ? Disposer d'un délégué interministériel à la jeunesse est-il une bonne chose ? N'est-ce pas plutôt au ministre chargé de la jeunesse d'exercer l'interministérialité, et d'être placé auprès du Premier ministre, de manière à pouvoir mener une action globale ?
Nous devrions peut-être nous poser la question. La réponse que l'on y apporte lorsqu'on compose un gouvernement témoigne de l'attention réelle que l'on porte à la jeunesse dans ce pays !
Madame Blondin, le conseil général est parfois notre plus proche partenaire, même s'il nous arrive de l'oublier ! Nous travaillons énormément avec les conseils généraux, du fait de notre mission de protection de l'enfance ; par ailleurs, la grande majorité des mineurs dont nous avons la charge, même s'ils sont connus pour des faits de délinquance, sont dans une situation assez compliquée, et ont une histoire familiale qui a pu donner lieu au suivi administratif par les services du conseil général. Nous sommes donc amenés à travailler de concert sur l'ensemble de ces problématiques, ainsi que sur celle de l'insertion sociale et professionnelle des mineurs, la réforme de la formation professionnelle qui vient d'intervenir, en donnant compétence aux conseils régionaux et généraux sur ces questions. Nous serons donc amenés à travailler ensemble davantage encore.
Nous nous situons à un niveau interministériel, mais nous insistons beaucoup pour que l'ensemble des politiques publiques et des partenariats trouvent des déclinaisons jusqu'à l'échelon territorial. Le territoire pertinent est celui qui se situe au plus près du mineur et de sa famille, qu'il s'agisse de la ville ou du département.
Nous individualisons donc ces partenariats le plus possible, afin de pourvoir répondre au mieux aux problèmes des mineurs, avec le souci de toucher tous les interlocuteurs. Les conseils généraux sont donc parmi les premiers interlocuteurs de la PJJ.
Nous intervenons également dans les classes relais, et aimerions le faire davantage ; faute de moyens, nous avons été obligés de nous limiter au fil des années.
Les fonds d'avenir jeunes constituent une autre déclinaison territoriale. Dans une circulaire sur les politiques publiques, nous demandons à chaque directeur territorial et à chaque directeur d'établissement ou de service de se rapprocher des partenaires, de façon à pouvoir être présents, à identifier nos publics afin de les réintroduire dans le droit commun et à participer à ces partenariats de manière à ce que les publics de la PJJ soient pris en compte.
Monsieur Domeizel, la question des moyens informatiques est d'une totale actualité : une circulaire conjointe vient d'être signée entre la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), la PJJ et le ministère de la culture et de la communication. Nous avons tenu, le 20 mai dernier, un comité de pilotage destiné à faire vivre cette circulaire. La question de l'accès au multimédia et à l'informatique des mineurs détenus y est soulevée. Chaque quartier pour mineurs et chaque établissement pénitentiaire pour mineurs disposent de bibliothèques, alimentées d'ailleurs par des partenariats, mais assez peu de médiathèques permettant aux mineurs d'accéder à l'informatique et à d'autres supports que les livres.
Comme vous l'avez rappelé, l'informatique soulève bien entendu des questions de sécurité. Il faut éviter que le mineur puisse communiquer avec l'extérieur -même si, dans la réalité, c'est malheureusement le cas- mais on doit faire en sorte qu'il puisse accéder à l'informatique, sans toutefois compromettre les règles de sécurité, auxquelles la DAP est très attachée et dont elle est garante.
Un nombre croissant d'ateliers informatiques se créent avec des partenaires extérieurs ; ils comportent de plus en plus de projets, comme l'élaboration d'un journal, qui nécessite des recherches dans la presse pour développer des thématiques. Ceci suppose d'utiliser l'outil informatique. D'autres projets portent sur la réalisation de courts métrages ou sur la musique. On essaye de profiter du temps de détention pour initier ou parfaire la connaissance des mineurs en matière d'informatique, avec certaines limites toutefois. On ne peut leur permettre d'accéder aux réseaux sociaux, qui constituent une ouverture un peu trop large sur l'extérieur, et encore insuffisamment contrôlée.
Madame Gillot, la question de la loyauté constitue un grand sujet. Le mineur que la PJJ prend en charge arrive avec une histoire, notamment familiale, qui s'inscrit dans un quartier. Il est parfois très éloigné du droit commun, mais très impliqué dans la logique et la vie de son quartier. Notre premier travail consiste à évaluer sa situation, à étudier la façon dont sa famille et son quartier interagissent. Il faut travailler avec ces forces et ces difficultés, et déterminer sur qui l'on peut s'appuyer. Nous menons un important travail avec la famille, que nous mobilisons avant tout en matière de prise en charge éducative, afin d'empêcher le mineur de réitérer et l'inscrire dans le droit commun.
Nous essayons de travailler sur le quartier, en déterminant les appuis ou les difficultés qui existent. À partir de cette évaluation, nous nous efforçons d'individualiser la prise en charge, de construire un parcours qui peut passer par un éloignement temporaire. L'objectif reste de maintenir des liens familiaux, voire de permettre au jeune de revenir dans sa famille. Parfois, il faut malgré tout éloigner le mineur et lui proposer un projet d'insertion sociale, scolaire et professionnelle visant à son autonomie, loin de son milieu.
Le premier regard que nous portons s'attache à la famille et à l'environnement. Nous avons essayé d'avoir une bonne expertise de la situation et de travailler de manière pluridisciplinaire, avec des éducateurs, des assistants sociaux, des pédopsychiatres, des spécialistes de l'environnement des mineurs, afin de proposer au mineur un projet en adéquation avec sa problématique.
Une question a été posée à propos des jeunes détenus diplômés. Il y a plusieurs années, la PJJ a passé une convention avec la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) et la DAP. L'objectif est, encore une fois, de pouvoir individualiser la prise en charge. Cette convention nationale est déclinée sur le territoire entre les rectorats et les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires (DISP), afin d'apporter des réponses à l'ensemble des mineurs détenus, quel que soit leur niveau scolaire. Celui-ci peut relever de l'enseignement primaire ou du collège, mais aussi du lycée, voire de l'enseignement supérieur. L'idée est de leur assurer un enseignement correspondant à leur situation, de leur faire passer des diplômes et de leur permettre d'accéder, à la fin de leur détention, à une qualification professionnelle -CAP, BEP, voire diplôme supérieur. Cette question est gérée au cas par cas par les rectorats, qui travaillent en liaison avec des interlocuteurs de l'administration pénitentiaire.
Vous avez également évoqué le sujet de la semi-liberté. Il existe très peu de condamnés parmi les mineurs. Il s'agit généralement de peines courtes, qui ne permettent pas un aménagement de peine. Pour autant, des consignes assez fortes sont données sur la nécessité de proposer de tels aménagements et nous travaillons avec la DAP pour expérimenter des lieux de semi-liberté pour mineurs. Cette semi-liberté répond à un cahier des charges très précis ; on ne peut toutefois aujourd'hui garantir l'étanchéité entre majeurs et mineurs, que l'on ne peut mélanger. Nous devons retenir trois lieux afin de proposer une première expérimentation, qui figure dans nos projets.
S'agissant du rôle des départements, la Société nationale des meilleurs ouvriers de France dispose d'une structure délocalisée, avec un siège national et des groupements départementaux gérés par des bénévoles eux-mêmes meilleurs ouvriers de France, en lien avec tous les acteurs locaux -conseils généraux et régionaux, mairies de grandes villes, chambres des métiers et de l'artisanat. Des conventions de partenariat sont établies avec beaucoup de départements ; nous travaillons ensemble main dans la main.
Dans le département du Rhône, certains des meilleurs ouvriers de France ont pu se rendre dans des collèges pour parler de leur métier et peut-être déclencher des vocations, comme on peut l'espérer.
Mme Bouchoux a évoqué la défiance vis-à-vis des élites. C'est un constat que l'on peut en effet établir. Nous essayons quant à nous de donner aux jeunes la chance de faire partie de l'élite, en gagnant une compétition. Nous leur faisons prendre conscience de leurs compétences et du fait qu'ils peuvent eux aussi réussir.
Quant au fait que les générations les plus anciennes ne veulent pas céder leur place, ce n'est pas le cas des meilleurs ouvriers de France, qui ont pour volonté d'accompagner les jeunes, de leur transmettre un savoir-faire, un goût pour l'excellence et de préparer la relève. On peut par ce biais acquérir une vision positive de la société.
Enfin, concernant l'interministérialité, la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, qui touche de nombreux métiers, est en liaison avec plusieurs ministères, comme l'économie, l'éducation nationale, le travail, la jeunesse et les sports. C'est donc un réel problème.
Bien que j'aie surtout cité les régions dans mon introduction, les conseils généraux sont bien évidemment des acteurs de la mobilité. Je pense ici à l'opération menée avec le conseil général de la Gironde autour de la citoyenneté européenne, qui implique chaque année des écrivains européens qui viennent parler, dans un certain nombre de collèges participant à ce concours, de la façon dont ils vivent l'Europe.
Quant aux élus et à leur connexion avec l'Europe, certaines petites communes mènent à bien de formidables programmes. Sans eux, nombre de jeunes ne seraient certainement jamais sortis de leur département. Grâce à de telles initiatives, beaucoup peuvent partir en Europe et découvrir un autre monde, permettant peut-être de porter un regard différent sur les élites que vous avez évoquées. C'est la comparaison des modèles qui permet de remettre le sien en question de manière positive.
À l'issue des élections municipales, nous avons envoyé un courrier à cent quinze nouveaux élus de villes de plus de trente mille habitants, pour les inviter à donner une coloration européenne à leur mandat. Certains nous ont déjà sollicités à ce sujet.
Il y a quelques semaines, les élections européennes ont permis de renouveler le Parlement européen de façon démocratique ; l'élection du président de la Commission européenne permettra peut-être aux politiques de se rapprocher des citoyens. C'est un élément important. La France consulte-t-elle suffisamment les citoyens ? Ce n'est pas certain ! Lorsqu'ils s'expriment, ils le font parfois de façon assez radicale. Il faut donc se poser des questions sur la manière dont on aborde les usages démocratiques.
Concernant l'école et la défiance vis-à-vis des systèmes, il faut aujourd'hui travailler sur l'acquisition de compétences opérationnelles, plus que sur une transmission des savoirs. C'est de métiers qualifiés dont l'Europe a besoin, quel que soit le niveau de qualification. C'est sur ce sujet qu'il faut travailler : quelles compétences donne-t-on aux jeunes. Même s'ils sont bacheliers, ont-ils des compétences ?
Par ailleurs -et c'est une tendance positive- l'apprentissage revient désormais en force à tous les niveaux, même dans l'enseignement supérieur. C'est un élément qu'il faut s'employer à développer, en valorisant les parcours, et non pas en considérant qu'il existe deux univers cloisonnés, celui de la formation professionnelle d'un côté et, de l'autre, la voie royale de la formation générale.
S'agissant du guichet unique, les agences européennes concernées sont invitées à le mettre en place. C'est le cas en France. C'est également ce à quoi invite la Commission européenne, qui a relevé le manque d'investissement des élus dans les programmes européens, à travers toute l'Union.
C'est pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux décideurs. La Commission européenne l'a clairement indiqué : c'est l'implication des élus qui permettra d'avoir un effet prescriptif. La Commission insiste également sur le fait que les formateurs, quels que soient les disciplines, doivent être mobiles, se déplacer en l'Europe, et promouvoir ainsi une image positive de l'Europe vis-à-vis des jeunes.
De manière transversale, on a du mal à faire entrer dans un dispositif ceux que l'on appelle, à La Réunion, les « jeunes au bord du chemin », ou, en métropole, les « jeunes restés sur le carreau » ou encore les « punks à chien ».
Le service civique, comme les missions locales, en raison des difficultés d'accès de la jeunesse à l'emploi, sont surinvestis par des étudiants ou de jeunes diplômés, qui ont certes toute la légitimité pour cela mais qui, ce faisant, laissent moins de place et de temps aux travailleurs sociaux pour accéder en première ligne aux jeunes les plus démunis.
Je précise que même si les missions locales accueillent les jeunes jusqu'à vingt-cinq ans, certains y restent jusqu'à trente ou trente-cinq ans. Le travail entrepris par les acteurs sociaux perdure dans le temps, ceux-ci ayant du mal à lâcher les jeunes en demande du jour au lendemain.
Pourquoi a-t-on des difficultés avec les jeunes au bord du chemin ? En France, il existe encore une « familialisation » très forte des politiques publiques, dans laquelle les aides passent par l'intermédiaire des parents. De fait, les jeunes en rupture familiale se trouvent doublement en difficulté. Il existe beaucoup d'autres raisons, mais on n'a pas le temps de les exposer ici.
Une question m'a été posée sur le retour sur investissement des familles. On le voit bien dans le choix des colonies de vacances opérés par les parents, même lorsqu'il s'agit d'adolescents : il faut qu'ils apprennent quelque chose qui soit transférable aux compétences scolaires -anglais, mathématiques, sport.
Une colonie de vacances qui ne proposerait que de passer du bon temps ferait très peur aux parents. Une colonie de vacances qui prévoit des activités différentes toutes les deux heures -canyoning, rafting, spéléologie, mathématiques, anglais, anglais américain, anglais canadien, pour saisir toutes les subtilités de la langue- rassure, car il s'agit de compétences transférables et exploitables.
C'est en ce sens qu'il existe un surinvestissement très fort des loisirs, afin qu'ils servent également à l'école et assurent la continuité avec le diplôme. En France, on considère en effet toujours le diplôme comme une reconnaissance sociale : il faut être diplômé pour être quelqu'un. Quand on n'a pas son brevet, même s'il ne représente rien, on est moins que rien ! Quand on n'arrive pas à avoir son BEP, son CAP ou son baccalauréat, il est très compliqué de pouvoir accéder à un stage !
L'idée du guichet unique est revenue à plusieurs reprises. Comment faire avec ces jeunes qui sont perdus face à la diversité de l'offre ? Les jeunes eux-mêmes demandent que les choses soient plus claires. On pourrait imaginer un module qui invite à la découverte de la vie en société dès le collège, présentant les dispositifs qui existent, expliquant ce qu'est la sécurité sociale, Pôle emploi et la vie en société. Certes, cela s'appelle de l'instruction civique, mais personne ne le fait !
Dans certains territoires, le guichet unique qui fonctionne le mieux est le réseau information jeunesse. Bien qu'il existe de manière très hétérogène en France, c'est un acteur de première ligne pour capitaliser, connaître et diffuser les informations en matière d'emploi, de logement, de santé, de loisirs, de travail, etc.
Enfin, s'agissant de la question de la mobilité, je vous indique que l'Observatoire de la jeunesse rendra, fin 2014, un rapport sur la question des jeunes et du territoire, du quartier à la ville et du département à la région.
Plusieurs questions ont été posées sur le service civique, notamment sur son efficacité au regard de l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Une évaluation menée l'an dernier par l'Agence du service civique, à laquelle l'INJEP a participé, montre qu'il représente aujourd'hui une plus-value importante pour les jeunes ayant effectué ce service, que ce soit en termes d'accès à l'emploi ou de retour à la formation. Même si les inégalités entre les jeunes perdurent, notamment du fait de leurs différences de diplôme ou d'origine sociale, le service civique les réduit.
Le service civique joue également un rôle important dans le dispositif de lutte contre le décrochage, qui comptait trois mille jeunes cette année et en comptera sans doute cinq mille l'an prochain.
La question des mobilités est également revenue à plusieurs reprises dans différentes interventions, qu'il s'agisse de la difficulté de sortir de son quartier, comme l'évoquait M. Assouline, ou du territoire national. Le Comité permanent de la mobilité, installé auprès de Mme Najat Vallaud-Belkacem, a aujourd'hui quelques difficultés à mesurer ces mobilités. Il existe en effet une défaillance de l'appareil statistique pour les qualifier. Même si elles se déroulent fort bien dans le cadre des programmes Erasmus, elles sont bien plus difficiles à caractériser à d'autres niveaux territoriaux et engendrent de véritables problèmes dans la connaissance de leur impact dans les parcours de vie des jeunes concernés.
Faut-il un délégué interministériel à la jeunesse ? C'est une bonne question ! Ce n'est pas à moi d'y répondre. C'est une fonction jeune, créée en janvier 2014, que je n'occupe que depuis un mois. Je n'ai donc pas encore pu faire la preuve de son efficacité !
On l'a dit en commençant, il s'agit d'une politique totalement interministérielle. Je suis personnellement convaincu de l'utilité du délégué ou d'une personne en charge de ce sujet. La question du positionnement a été tranchée en janvier dernier. Je suis évidemment très heureux de travailler pour Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui porte haut les couleurs de ce ministère.
On a parfois brocardé le périmètre ministériel : il existe en fait une véritable cohérence entre la jeunesse, le sport, la ville, la vie associative et les femmes, ces sujets présentant beaucoup de points communs.
Le CIJ qui a été mis en place, permet, avec des correspondants dans chaque ministère, d'animer cette politique sur le plan administratif a, je crois, fait la preuve de sa relative efficacité pour faire vivre cette thématique.
S'agissant du service civique, de la montée en charge de ses moyens et du fait que le sujet revient à la surface de temps à autre, je ne vois pas les choses sous le même angle : j'ai été le premier directeur de l'Agence du service civique, en 2010. À l'époque, il n'y avait aucun volontaire ! Aujourd'hui, on en compte trente-cinq mille et l'objectif est de cent mille.
Même si je ne m'en occupe plus directement sur le plan opérationnel, j'ai pu mesurer les grandes avancées qui ont été accomplies. Un certain nombre de débats ont initialement perturbé la montée en charge du service civique -caractère volontaire ou obligatoire, rapport à l'emploi, type de compétences, etc. Comment aller chercher les jeunes qui en avaient le plus besoin ? On a tranché toutes ces questions et organisé une montée en charge irréversible -pour reprendre les propos de Martin Hirsch.
L'objectif des cent mille volontaires est de ce fait symbolique, et destiné à renverser la logique, afin d'installer totalement le service civique dans le paysage. L'idée est de fixer un seuil à cent mille personnes, soit environ 15 % d'une classe d'âge, afin que la question se pose systématiquement et que chaque jeune se positionne sur le fait de faire ou non son service civique.
Ceci a un coût et implique des moyens, dans un contexte budgétaire délicat. Le triennal qui est en train de s'esquisser est assez douloureux pour l'ensemble des ministères. Cela étant, les crédits du service civique sont relativement préservés. Ils vont progresser substantiellement ; la ministre a annoncé que 100 millions d'euros sur trois ans seraient consacrés à cette montée en charge. Le président de l'Agence du service civique, François Chérèque, a remis un rapport sur ces questions. Il réclame un triplement du budget, ce qui excède largement les 100 millions annoncés. Il faut donc faire appel au financement d'autres ministères, le service civique étant utile pour les jeunes, mais aussi pour les politiques publiques, les collectivités locales, les ministères. Cela permet aussi de participer à toute une série de missions qui ont une plus-value sociale.
Il conviendra par ailleurs de faire appel à des fonds privés. Ce matin, le Président de la République rend visite à l'association Mona Lisa, spécialisée dans l'action intergénérationnelle : c'est une action au service de la collectivité, que la montée en charge du service civique, à l'horizon 2017, va permettre de réaliser.
Pour conclure, on a souvent tendance à caractériser les jeunes par un défaut ou par un manque -pas de formation, pas de stage, pas d'emploi- ce qui donne d'eux une image quelque peu négative. Le service civique illustre une face un peu plus positive de la jeunesse, qui veut s'engager, qui veut donner, qui veut entreprendre. C'est aussi cela, la jeunesse de France !
La commission examine le rapport de M. Jean-Jacques Lozach et élabore le texte de la commission sur le projet de loi n° 677 (2013-2014) habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage (Procédure accélérée).

Le Gouvernement a déposé au début du mois, mercredi 2 juillet, un projet de loi l'habilitant à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du nouveau code mondial antidopage.
Ce nouveau code mondial antidopage a été adopté lors de la quatrième conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s'est tenue en novembre 2013 à Johannesburg. Il s'agit de la troisième version de ce code qui a été adopté pour la première fois en 2003. Il est prévu que cette nouvelle actualisation entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi pose un certain nombre de questions que je me permettrai de résumer ainsi :
- en premier lieu, quelle est la portée juridique de cette nouvelle version du code mondial antidopage et quelle est la nécessité de la transcrire dans notre droit interne et dans quel délai ?
- en deuxième lieu, quels sont les apports de ce nouveau code mondial antidopage ?
- en troisième lieu, quels risques pourraient présenter ce texte ?
- enfin, je vous proposerai d'évoquer les principales dispositions qui devraient figurer dans l'ordonnance que le gouvernement nous demande l'autorisation de prendre et, enfin, de porter un jugement global sur ce projet de loi.
Concernant tout d'abord la portée du nouveau code mondial antidopage et la nécessité de le transcrire dans notre ordre juridique interne. Il convient de rappeler que le statut du code mondial antidopage est particulier puisque selon les termes mêmes de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 et ratifiée par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 : « les États parties s'engagent à adopter des mesures appropriées (...) conformes aux principes énoncés dans le code mondial antidopage » et « à respecter les principes énoncés dans le code ». Cela signifie que le texte du code ne fait pas partie intégrante de la convention et ne crée aucune obligation contraignante en droit international pour les États parties.
Concernant les délais de transcription, cela signifie également qu'il n'y a pas d'obligation pour la France à transcrire dans son droit interne les dispositions nouvelles du code mondial antidopage au 1er janvier 2015, date de son entrée en vigueur.
On peut rappeler à cet égard que, dans le passé, le législateur n'a pas hésité à sursoir à la transcription des précédentes versions du code. Ainsi, la version du code entrée en vigueur le 1er janvier 2009 n'est pleinement devenue effective que deux ans plus tard suite à l'adoption de l'ordonnance du 14 avril 2010 et à la publication du décret du 13 janvier 2011.
Si la transcription du nouveau code n'est donc pas une obligation juridique, elle n'en demeure pas moins une nécessité politique et, j'oserais même dire, éthique. La lutte contre le dopage est devenue une nécessité universelle ne serait-ce que pour protéger nos propres sportifs à la fois d'une concurrence déloyale et de la tentation de se délocaliser sous des cieux moins regardants. L'exemplarité de la France et de l'Europe dans l'application des règles internationales constitue la meilleure garantie pour inciter l'ensemble des autres pays signataires de la convention de 2005 à être eux-mêmes irréprochables.
C'est ainsi qu'il faut comprendre, me semble-t-il, les déclarations du secrétaire d'État aux sports, M. Thierry Braillard, devant notre commission le 4 juin dernier, lorsqu'il nous a annoncé que le Gouvernement souhaitait avoir engagé le processus de transcription avant que la France n'accueille en novembre prochain sur son sol le comité exécutif de l'agence mondiale antidopage (AMA).
Après avoir évoqué la question de la portée du nouveau code et de son délai de transcription, interrogeons-nous sur son intérêt et ses apports. À ce sujet, on peut observer que les modifications apportées au nouveau code mondial ne modifient pas l'économie générale du dispositif, mais visent, selon l'exposé des motifs du projet de loi, à « renforcer l'efficacité du contrôle et à élargir la gamme des sanctions, tout en veillant à leur proportionnalité ».
Les modifications apportées sont trop nombreuses pour être citées toutes. La plupart sont d'ailleurs très techniques et ne nécessitent pas de transcription législative.
Permettez-moi néanmoins d'évoquer devant vous quelques-unes de ces dispositions qui illustrent bien, à mon sens, les progrès qui ont été accomplis et l'intérêt de transcrire ce nouveau dispositif.
Concernant tout d'abord les périodes de suspension, un fort consensus s'est dégagé pour considérer que les tricheurs intentionnels devaient être suspendus pour une période de quatre ans. Ce principe prévu par l'article 10.2 devient donc la norme sauf si le sportif peut établir que la violation des règles n'était pas intentionnelle.
Le nouveau code mondial antidopage met ensuite l'accent sur l'importance croissante des enquêtes et sur le recours aux renseignements pour lutter contre le dopage. Plusieurs articles de ce code sont modifiés pour favoriser la coopération et les échanges d'informations entre les différentes institutions qui concourent à la lutte antidopage.
Les possibilités de réduction des sanctions pour aide substantielle aux autorités antidopage dans la conduite de leurs enquêtes sont, par ailleurs, étendues.
Enfin, le délai de prescription est porté à 10 ans contre 8 ans dans le code actuel pour tenir compte du fait qu'il faut aujourd'hui beaucoup de temps pour découvrir des programmes de dopage sophistiqués.
Une autre priorité du nouveau code concerne la mise en cause du personnel d'encadrement du sportif impliqué dans le dopage. Le nouveau code sanctionne ainsi les « associations interdites » qui caractérisent le fait pour un sportif de s'associer à des encadrants qui ont été suspendus ou condamnés pour des faits en lien avec le dopage.
Un point essentiel concerne la recherche d'un meilleur équilibre des rôles entre les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage (ONAD). C'est sans doute le point qui aurait mérité des développements plus importants pour reprendre, par exemple, les propositions de la commission d'enquête sénatoriale présidé par notre collègue Jean-François Humbert, qui a présenté ses conclusions, il y a un an.
Dans les faits, les prérogatives des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage ne sont pas significativement modifiées. On peut toutefois mentionner que le nouveau code ouvre la possibilité pour une organisation nationale antidopage d'effectuer des contrôles en dehors des lieux des manifestations organisées par une fédération internationale ou par une organisation responsable de grandes manifestations.
Au final, comme je vous le disais, les avancées sont réelles même si elles ne sont pas révolutionnaires.
Il en est autrement des risques juridiques attachés à ce nouveau code, qui ont été soulevés tant par l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que par le Conseil d'État. Ces risques d'ordre constitutionnel, qui justifiaient toute l'attention de notre commission, sont de trois ordres et d'importance différente.
Le premier problème tient à la compétence reconnue par le nouveau code au tribunal arbitral du sport (TAS). Comme l'indique de manière constante le Conseil d'État, il n'est pas possible de soumettre au contrôle d'une autorité internationale les décisions d'autorités nationales investies par la loi de prérogatives de puissance publique, qu'il s'agisse d'instances disciplinaires des fédérations sportives ou de l'agence française de lutte contre le dopage.
Cette difficulté était déjà présente dans les précédentes versions du code et une solution « équivalente » en termes de garanties a alors été trouvée consistant à ouvrir à l'agence mondiale antidopage et aux fédérations internationales la possibilité de contester, devant la juridiction administrative, les décisions prises en matière de sanction du dopage par les instances fédérales ou l'AFLD.
L'ordonnance ne devrait donc pas transcrire dans notre droit cette disposition concernant la compétence du tribunal arbitral du sport.
La deuxième difficulté est peut-être plus sérieuse puisqu'elle a trait à l'automaticité des sanctions prévue par l'article 10 du nouveau code mondial antidopage qui vient heurter le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Pour contourner cet obstacle, le Conseil d'État a estimé dans son avis que les dispositions du nouveau code devaient « être lues comme permettant d'instaurer un régime de sanction maximale », ce qui permet d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité.
Le dernier problème est le plus considérable puisqu'il concerne l'obligation faite par le nouveau code à tous les sportifs de se rendre disponibles pour des contrôles « à tout moment et en tout lieu ».
Si l'on comprend bien l'intérêt de ce principe de totale disponibilité pour éviter des pratiques dopantes en dehors des temps de la compétition effective, force est de reconnaître qu'il heurte de front deux principes essentiels de notre droit : l'inviolabilité du domicile qui est constitutionnellement garantie entre 21 heures et 6 heures, sauf sous le contrôle du juge judiciaire par exemple dans des cas en rapport avec la grande criminalité et le droit au respect de la vie privée qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'Homme.
L'agence française de lutte contre le dopage avait proposé sans succès à l'agence mondiale antidopage une solution de compromis intéressante, comme me l'a expliqué son président Bruno Genevois, qui aurait consisté à pratiquer uniquement lors de compétitions internationales se déroulant sur une semaine ou plus, des contrôles au lieu d'hébergement du sportif entre 6 heures et 23 heures.
Cette solution n'ayant pas été retenue par l'agence mondiale antidopage, l'exposé des motifs comme le texte même du projet de loi se contentent de mentionner que la transcription devrait se faire dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels, une précaution ajoutée par le Conseil d'État mais qui reste, à mon sens, un peu vague.
J'ai donc demandé au Gouvernement de plus amples informations sur le dispositif envisagé pour transcrire cette mesure en laissant entendre que nous ne pouvions nous satisfaire d'un engagement trop flou sur le respect des principes constitutionnels.
Je dois saluer, à cet égard, la qualité des échanges que j'ai eu avec l'administration du ministère des sports qui ont abouti à ce que me soit transmis l'avis du Conseil d'État qui fixe le cadre précis de la transcription que le Gouvernement s'est engagé à respecter.
Le dispositif qui figurera dans l'ordonnance devrait ainsi prévoir que :
- le contrôle après 21 heures ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement du sportif ;
- le contrôle devra se limiter au prélèvement d'échantillons ;
- enfin, le contrôle devra garantir une proportionnalité entre les atteintes portées aux droits des sportifs, droit à l'intimité par exemple, et les enjeux liés à la lutte contre le dopage.
Cette triple garantie permet à mon sens de lever toute inquiétude sur la constitutionnalité du dispositif et, ce faisant, sur l'ensemble de l'ordonnance à venir, les autres dispositions législatives ne posant pas de difficulté particulière.
J'ai déjà évoqué précédemment certaines modifications législatives prévues par la future ordonnance qui figurent parmi les principales avancées du nouveau code mondial antidopage :
- l'aide substantielle apportée par un sportif à la découverte d'infractions ;
- la modification du délai de prescription des actions disciplinaires, actuellement de 8 ans, à 10 ans ;
- l'interdiction faite aux sportifs de faire appel aux personnes ayant fait l'objet de sanctions ;
- l'ouverture de la possibilité aux ONAD, telle que l'AFLD, d'effectuer des contrôles en dehors des sites où se déroulent les manifestations sportives internationales ;
- et, bien sûr, les contrôles antidopage à tout moment et en tout lieu.
Il convient d'ajouter que la future ordonnance devrait également introduire des modifications du code du sport afin de prévoir :
- l'extension du champ des institutions susceptibles d'accorder des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) ;
- la création d'une nouvelle infraction relative à la complicité en matière de trafics de substances ou de méthodes dopantes ;
- l'implication des fédérations sportives nationales et du personnel encadrant dans les enquêtes menées par les ONAD.
Comme vous pouvez le constater, le nouveau code antidopage comporte un certain nombre d'avancées et les quelques risques, réels, sur le plan juridique qu'il pouvait comporter ont été à la fois bien identifiés et suffisamment circonscrits que l'on peut estimer que l'autorisation donnée au Gouvernement est correctement encadrée.
Je vous proposerai donc d'adopter l'article unique de ce projet de loi en formant le voeu que le Gouvernement poursuivra ses efforts auprès de l'AMA pour améliorer encore les dispositifs en vigueur en n'hésitant pas à s'inspirer de nos propositions qui demeurent pleinement pertinentes pour combattre le dopage.

Nous remercions notre collègue pour son rapport sur ce texte qui va dans le bon sens et que nous voterons.

Je souhaiterais demander à notre rapporteur si la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été consultée au regard de la conformité de ce projet de loi à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

D'ici le mois d'octobre, nous interrogerons le secrétariat d'État aux sports sur la question de la conformité à la loi de 1978 mais on peut déjà rappeler que l'AFLD a pris l'habitude de signer des conventions avec les autres organismes, afin d'échanger des informations qui sont précieuses pour mener des enquêtes et recueillir des témoignages.

Après cet échange qui a montré un large consensus, je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
La commission adopte sans modification le texte du projet de loi n° 677 (2013-2014) habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage.
Compte tenu de l'absence d'ordre du jour la semaine prochaine, il s'agit très probablement de notre dernière réunion avant le renouvellement de septembre prochain. Je tenais à vous dire que c'est avec plaisir que j'ai travaillé à vos côtés depuis trois ans.
La réunion est levée à 12 h 20.