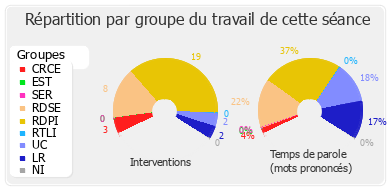Séance en hémicycle du 30 avril 2009 à 9h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Dépôt d'une proposition de résolution
- Dépôt de rapports en application d'une loi
- Conférence des présidents (voir le dossier)
- Communication sur les suites du sommet du g20 (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que je dépose sur le bureau du Sénat une proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
Cette proposition de résolution sera imprimée sous le n° 377, mise en ligne et distribuée.
Elle est envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Monsieur le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le rapport relatif aux agréments des conventions et accords applicables aux salariés des établissements sociaux et médicosociaux privés à but non lucratif pour 2008 et aux orientations en matière d’agrément des accords et d’évolution de la masse salariale pour 2009.
M. Dominique Latournerie, président de la Commission nationale des accidents médicaux, a transmis au Sénat, en application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, le rapport pour 2007-2008 de la Commission nationale des accidents médicaux.
Acte est donné du dépôt de ces deux rapports, qui seront transmis à la commission des affaires sociales et seront disponibles au bureau de la distribution.

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (suite)
Jeudi 30 avril 2009
À 9 heures :
1° Communication sur les suites du sommet du G20 des sénateurs membres du groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale
demande de la commission des finances
La conférence des présidents :

À 15 heures :
2° Questions d’actualité au Gouvernement ;
3° Proposition de résolution européenne sur la communication de la Commission européenne sur sa stratégie politique annuelle pour 2009, présentée par Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (no 57 rectifié, 2008 2009)
avancement d’un texte inscrit initialement à l’ordre du jour réservé aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires du jeudi 7 mai
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 29 avril 2009 ;

4° Débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat:
- Évolution du système d’information Schengen ;
- Association des parlements nationaux au contrôle d’Europol ;
- Mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement ;
- Application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
Chacun de ces sujets donnera lieu à un débat ;

Semaine d’initiative sénatoriale
Mardi 5 mai 2009
À 15 heures :
1° Débat sur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires de l’État
demande du groupe UMP
La conférence des présidents :

2° Débat sur la politique de l’État en matière de gestion des ressources halieutiques et des pêches §;
La conférence des présidents :

Mercredi 6 mai 2009
À 14 heures 30 :
1° Proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, présentée par M. François-Noël Buffet
texte de la commission, n o 330, 2008-2009
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 5 mai 2009 ;

2° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le développement économique des outre-mer.
Jeudi 7 mai 2009
Journée mensuelle réservée aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires :
À 9 heures, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1° Question orale avec débat n° 30 de M. François Rebsamen (Soc.) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des grandes entreprises du secteur de l’énergie ;
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 6 mai 2009 ;

2° Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire, présentée par MM. Nicolas About (UC) et M. Pierre Jarlier (UMP) (no 378 rectifié bis, 2007-2008) ;
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 6 mai 2009 ;

3° Proposition de loi relative à l’évaluation et au contrôle de l’utilisation des aides publiques aux entreprises, aux banques et aux établissements financiers, présentée par M. Robert Hue et ses collègues du groupe CRC-SPG (no 239, 2008-2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

Semaines réservées par priorité au Gouvernement
Mardi 12 mai 2009
À 9 heures 30 :
1° Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 476 de Mme Bernadette Bourzai à Mme la ministre du logement ;
Aide à la gestion locative sociale

- n° 479 de Mme Maryvonne Blondin à Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité ;
- n° 483 de M. Michel Boutant à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
- n° 488 de Mme Françoise Férat à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 489 de M. Claude Bérit-Débat à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- n° 493 de M. Marc Laménie à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 497 de M. Jacques Blanc à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 498 de M. Jacques Mézard à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- n° 500 de Mme Bernadette Dupont transmise à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 501 de M. Jean-Claude Danglot à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 502 de Mme Catherine Dumas à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 503 de M. Hervé Maurey à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 505 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la ministre de la santé et des sports ;
Suicide des jeunes

- n° 506 de M. Jean-Jacques Mirassou à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Délocalisation injustifiée de l’entreprise Molex

- n° 507 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Évolution et usage des crédits du conservatoire de la forêt méditerranéenne

- n° 511 de M. Guy Fischer à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
Projet de décret relatif à la création d’un répertoire national commun de la protection sociale

- n° 512 de M. Michel Teston à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- n° 513 de M. Alain Vasselle à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Coordination entre projets de traitement des déchets et plans départementaux en cours de révision

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 16 heures et le soir :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (no 290, 2008 2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

Mercredi 13 mai 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Jeudi 14 mai 2009
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1° Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ;
À 15 heures et le soir :
2° Questions d’actualité au Gouvernement ;
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3° Suite de l’ordre du jour du matin.
Vendredi 15 mai 2009
À 9 heures 30 et à 15 heures
Lundi 18 mai 2009
À 15 heures et le soir
Mardi 19 mai 2009
À 15 heures et le soir
Mercredi 20 mai 2009
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
La prochaine conférence des présidents se tiendra le mercredi 6 mai 2009, à 19 h 30.
Mes chers collègues, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que la conférence des présidents a considéré, eu égard à l’importance du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires et au nombre d’amendements dont il fait l’objet, qu’il convenait de laisser un délai plus important à la commission des affaires sociales afin de lui permettre de mener ses travaux dans les meilleures conditions possible. C’est la raison pour laquelle la séance publique initialement envisagée le lundi 11 mai n’a pas été maintenue ; de même, la séance de l’après-midi du mardi 12 mai ne commencera qu’à 16 heures, le matin étant réservé aux questions orales.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...
Ces propositions sont adoptées.

L’ordre du jour appelle une communication sur les suites du sommet du G20 des sénateurs membres du groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale.

Avant de donner la parole au premier orateur, je veux remercier nos collègues sénateurs de la part très importante qu’ils ont prise dans ce groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale, qui était une nouveauté dans notre République.
Je souhaite maintenant, parce que la tenue des sommets ne suffit pas, me semble-t-il, pour que l’on puisse considérer le travail comme achevé, que nous entrions dans des phases concrètes.
Je tiens à saluer le travail en commun réalisé par l’ensemble de nos collègues, y compris par nos collègues de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. le coprésident du groupe de travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise qui est apparue aux États-Unis pendant l’été 2007 – crise financière, crise de confiance, crise de la titrisation, crise de la liquidité, crise de la mondialisation – ne cesse de plonger des cohortes de salariés dans le chômage. Bien sûr, elle interpelle directement le Parlement.
Le groupe de travail Assemblée nationale-Sénat est un objet nouveau dans l’univers parlementaire. C’est sur votre initiative, monsieur le président, ainsi que sur celle de votre homologue Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, qu’il a été constitué : douze sénateurs et douze députés, douze parlementaires de la majorité et douze parlementaires de l’opposition. Il compte quatre rapporteurs : Gilles Carrez et Nicolas Perruchot pour l’Assemblée nationale ; Philippe Marini et Bernard Angels pour le Sénat.
Ensemble, sur la base de nos expériences personnelles et des travaux menés dans chaque assemblée, nous essayons de conduire une réflexion sur la crise financière en cours et d’apporter une vision parlementaire sur la refondation de la finance mondiale. C’est ainsi que nous avons pu transmettre des notes au Président de la République avant les réunions du G20 à Washington, le 15 novembre 2008, et à Londres, le 2 avril 2009. Le Président nous a également reçus, le 15 avril dernier, pour nous rendre compte de cette dernière réunion.
Cette méthode, convenons-en originale, s’est révélée jusqu’à présent plutôt fructueuse et, sans que l’on puisse pour autant parler de consensus, a permis, en ce qui concerne tant le diagnostic que les préconisations, des rapprochements et des convergences qui n’étaient pas forcément attendus lors de la création du groupe.
Je laisserai à Philippe Marini et à Nicole Bricq, en remplacement de Bernard Angels, le soin de dresser le bilan de nos réflexions et de donner notre point de vue sur les suites du dernier G20. Pour ma part, je commencerai mon intervention par un bref compte rendu de la mission que vient d’effectuer aux États Unis le bureau de la commission des finances. Ce propos liminaire sur le pays où est née la crise, le pays qui détient aussi une partie des réponses à cette crise, me donnera l’occasion de vous livrer certains constats auxquels j’accorde une importance toute particulière.
Au cours de la semaine écoulée, nous avons rencontré les principaux responsables du Fonds monétaire international, du Congrès, des institutions monétaires et financières américaines ainsi que plusieurs banquiers, dirigeants d’entreprises et responsables de hedge funds. Qu’en avons-nous retenu ? Essentiellement un constat et deux interrogations.
Le constat est simple. La crise actuelle, la plus grave depuis la grande dépression des années 1930, puise certes son origine dans le surendettement des ménages américains et l’incapacité où se sont trouvés nombre d’entre eux à faire face à leurs obligations de remboursement d’emprunts. Il n’en demeure pas moins qu’elle a servi de révélateur et a mis en exergue l’incroyable fragilité du secteur financier, caractérisé notamment par le développement considérable, et aussi largement anarchique, des produits dérivés depuis les années 1970.
Le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, considérait récemment que l’innovation financière a amélioré l’accès au crédit et réduit les coûts, au point qu’il paraît inenvisageable de revenir trente ans en arrière. Soit ! Mais nous allons devoir faire face dans l’immédiat à deux difficultés majeures, qui correspondent à mes deux interrogations.
Première question : les États-Unis, qui restent la première économie du monde, mettront-ils effectivement en place des mécanismes de régulation et de supervision qui seront à la hauteur de leurs responsabilités dans le fonctionnement du système financier international ?
Seconde question : dans un contexte où c’est en pratique la Réserve fédérale qui assume de plus en plus le risque systémique en intégrant certains actifs douteux dans son bilan et en se comportant finalement comme une banque, …

… quelle sera la sortie de crise ? Le choix des États-Unis se résume-t-il à autre chose qu’une alternative entre plus d’impôts ou plus d’inflation ? À l’inverse, avons-nous échappé à tout risque de déflation ?
J’en reviens au premier point : les mécanismes de régulation et de supervision.
S’il y a bien un constat que tous nos interlocuteurs ont fait, c’est celui des lacunes importantes du contrôle des banques et des institutions financières aux États-Unis, y compris les compagnies d’assurance. Le paysage réglementaire apparaît à la fois complexe et morcelé, fractionné, caractérisé par la présence d’une myriade d’organismes dont les fonctions et les moyens d’action ne sont pas toujours clairement définis. Si certains comportements préjudiciables ont pu avoir libre cours, sans jamais rencontrer d’obstacle – je pense bien sûr en premier lieu à l’affaire Madoff –, c’est à cette absence de structuration et de vision globale efficace qu’on le doit.
Les autorités américaines ont-elles pris la claire mesure des changements à apporter à leur organisation et ont-elles commencé à les mettre en œuvre ? Je serais tenté de répondre plutôt « oui » à la première question et plutôt « non » à la seconde, du moins dans un très proche avenir.
Il existe aujourd’hui aux États-Unis un consensus très fort en faveur de la création d’une instance de régulation du risque systémique ayant vocation à chapeauter l’ensemble du système. Le débat n’est cependant pas encore tranché sur deux questions essentielles : l’autorité qui sera investie de cette fonction, même si la Réserve fédérale apparaît comme la plus apte à jouer ce rôle et, surtout, la place de cette autorité. Le danger est, en effet, qu’elle se superpose au « patchwork » existant, sans se substituer à lui, au risque d’accroître encore la confusion et les phénomènes de déresponsabilisation si préjudiciables, à l’origine de la situation actuelle.
En ce qui concerne la régulation spécifique des produits dérivés, il apparaît là aussi une convergence très nette en faveur de la construction d’un marché organisé autour d’une chambre de compensation. Parce qu’elle assure une parfaite transparence, parce qu’elle permet de réduire les risques de défaillance grâce au contrôle quotidien des positions et aux appels réguliers de marges, la technique de la chambre de compensation est la plus appropriée, me semble-t-il, et sa généralisation préventive aurait sans doute permis de réduire fortement l’ampleur de la crise financière actuelle.
Au-delà du constat, le débat ne fait cependant que commencer sur le statut que prendra cette structure. Il est clair que, si elle devait rester aux mains des seules banques, comme la plupart d’entre elles le souhaitent, le revendiquent, et cela sans réel contrôle externe, l’objectif de transparence ne serait pas atteint. Autant dire que l’on n’aurait rien fait !
D’autres thèmes se rattachent aux questions de régulation et de supervision, les délocalisations vers les « paradis fiscaux » notamment – j’en parlerai dans un instant – mais aussi tout ce qui tourne autour de la séparation des activités de banque de dépôt, d’une part, et de banque d’investissement, d’autre part, de la procyclicité des normes comptables, de la surveillance des agences de notation et du contrôle des hedge funds.
Nous avons évoqué à plusieurs reprises avec nos interlocuteurs le too big to fail. La concentration des établissements n’atteint-elle pas une taille excessive ? À partir d’un certain stade, le risque systémique ne va-t-il pas au-delà des capacités des États que l’on appelle au secours lorsque surviennent les difficultés ?
On a entendu différentes propositions, les unes tendant à fractionner des institutions qui seraient devenues trop importantes, faisant encourir un risque systémique excessif.
On a également évoqué la possibilité pour l’État, qui est l’assureur systémique, de percevoir une redevance, un impôt, qui serait fonction de la dimension des établissements. Puisque le risque systémique est assumé par l’État, par la puissance publique, il est légitime que cette assurance fasse l’objet du paiement d’une prime.
Je n’ai pas le temps de les développer ici, mais je souhaite que notre débat nous permette d’aborder tous ces points, qui sont autant de sujets d’intérêt commun avec nos amis américains et sur lesquels leur niveau de réflexion est souvent proche du nôtre.
Je serai plus rapide sur la seconde interrogation que nous ramenons des États-Unis et qui se résume à cette question simple : quelle sortie de crise ?
Les Américains ont, comme nous, présente à l’esprit la crise japonaise des années quatre-vingt-dix et les années de stagnation qui ont suivi. Le premier impératif qui s’impose à la puissance publique est de favoriser le « nettoyage », le plus rapidement possible, des actifs des banques, si l’on veut éviter que l’économie ne subisse une stagnation, faute pour le secteur bancaire de pouvoir de nouveau assurer son rôle normal de financeur des agents économiques.
Premier constat : ce travail est en cours, mais n’est pas encore achevé. Et d’autres mauvaises surprises ne sont pas à exclure, notamment parce que les banques n’ont pas encore enregistré comptablement leurs pertes sur des prêts accordés dans certains secteurs potentiellement sinistrés, comme l’immobilier d’entreprise. A-t-on extrait tous ces actifs toxiques ? Le Fonds monétaire international estime ainsi le montant total des pertes que l’ensemble des banques pourraient devoir constater sur leurs actifs à 4 000 milliards de dollars, dont 2 700 milliards pour les seuls établissements américains. Tout cela doit inciter à la plus grande prudence à l’égard des propos optimistes de ceux qui évoquent les prémices d’un redémarrage. Faisons attention aux fausses bonnes nouvelles qui ne pourront qu’exercer un impact encore plus dépressif sur l’économie réelle si les prédictions de ce début de printemps ne se réalisent finalement pas ! À court terme, le risque de déflation reste réel.
Second constat : aux États-Unis, c’est la Réserve fédérale qui a été amenée à gérer la faillite ou la quasi-faillite des institutions jugées systémiquement importantes comme Bear Sterns, Lehman Brothers, AIG, Citigroup, Freddie Mac et Fanny Mae, sorte de Crédit foncier des années quatre-vingt-dix.
Le résultat est que le bilan de la Réserve fédérale a été multiplié par près de trois, passant en quelques semaines de 800 milliards de dollars à plus de 2 000 milliards. Ce bilan pourrait même prochainement atteindre plus de 4 000 milliards de dollars. Parallèlement, la Réserve fédérale, comme la Banque centrale européenne, a injecté massivement des liquidités dans l’économie afin de lui permettre de surmonter le choc subi.
Si l’on peut raisonnablement espérer que nos banques centrales sauront convenablement gérer la sortie de crise en retirant à temps les liquidités injectées en surplus, il faudra cependant surveiller de très près le comportement de la Réserve fédérale à l’égard des actifs douteux qu’elle a inscrits à son bilan et dont elle assume le risque direct.
Il y a aux États-Unis un ensemble constitué par la Réserve fédérale et l’État fédéral et son budget, comme si l’idée que nous nous faisions de l’indépendance de la Réserve fédérale par rapport au gouvernement avait été quelque peu estompée.
En conclusion, et comme je l’ai dit tout à l’heure, il faut avancer aussi sur la question des paradis fiscaux et juridiques, ces espaces non coopératifs, qui préservent jalousement le secret bancaire. De ce point de vue, entre les déclarations du G20 et les avancées réalisées, il pourrait y avoir un écart qui ferait obstacle à la cohérence des politiques à mener.
Nous devrons être extrêmement vigilants sur la publication des listes noires ou des listes grises. Veillons à ce que la présentation de ces listes ne se fasse pas sur des considérations politiques. Pourquoi n’y figurent ni l’État américain du Delaware ni certains territoires dépendant pour l’essentiel des pays du G20 ? L’OCDE devra rester très vigilante. Il faudra beaucoup de détermination et de volonté pour aboutir sur ce terrain et faire disparaître les trous noirs de l’économie mondiale.
Enfin, si nous devons veiller à l’application de toutes les dispositions prévues par le G20, il faudrait peut-être que l’Union européenne donne l’exemple et que nous passions à l’acte sur l’ensemble de son territoire.
Il est formidable de pouvoir proclamer la pertinence de nos recommandations, dès lors faisons de l’Europe le champ d’expérimentation et d’application. Faisons disparaître les espaces non coopératifs, soyons convaincants auprès de nos partenaires luxembourgeois, autrichiens et suisses, puisqu’ils sont associés à l’Europe en matière bancaire et financière.

C’est un vrai sujet, monsieur Chevènement.
Toujours est-il qu’à la veille des élections européennes la crise et ses conséquences pourraient éclairer le débat. Il y a là à l’évidence un défi majeur pour l’Union européenne.
Par ailleurs, cette crise met en évidence le fait qu’un certain nombre d’États consomment manifestement plus qu’ils ne produisent et que les déficits des finances publiques et les déficits commerciaux en résultant ne peuvent être couverts que par l’endettement. Cette situation doit être corrigée, il importe de redonner de la compétitivité au travail et à nos économies pour sortir définitivement de cette crise.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les sujets dont nous traitons ce matin sont à la fois essentiels et très difficiles à aborder dans une assemblée parlementaire.
Ce sont des sujets essentiels : ce n’est pas une clause de style de dire que notre avenir à tous en dépend et que du devenir de l’économie financière dépend le devenir de l’économie réelle. Mais ce sont des sujets difficiles qui échappent très largement à la vision du législateur national, car ils sont nécessairement traités de façon simultanée à plusieurs niveaux.
Certes, la crise impose un retour des États et de la régulation et cette question se traite dans les parlements nationaux. Mais la responsabilité de l’Union européenne est très grande, notamment celle du Parlement européen, qui ne se comporte pas comme un vrai parlement et qui sera prochainement renouvelé.
L’essentiel se situe ensuite au niveau mondial. Les deux réunions successives du G20 l’ont montré avec des résultats que je persiste à considérer comme très contrastés.
D’un côté, des avancées ont été faites, peut-être même l’amorce de quelques percées intellectuelles. De l’autre, le risque est très grand, madame Nicole Bricq, d’une autosatisfaction généralisée.

Nous devons d’abord nous prémunir de ce risque d’autosatisfaction et d’autoglorification…

M. Jean-Pierre Chevènement, membre du groupe de travail. On va avoir du mal !
Sourires

Je prendrai un exemple et je vous remercie de votre réaction, mes chers collègues.
Il n’est aucune réunion de chef d’État ou de gouvernement qui ne commence par des réactions indignées à l’encontre du protectionnisme. C’est une clause obligée.

Or, de retour chez lui, que fait-il ? Dans les limites du droit international, européen ou national, il préconise, lorsque c’est possible, un peu de protectionnisme. Nous ne le savons pas très bien, ce domaine évoluera-t-il vraiment ou s’agit-il simplement de s’organiser pour faire face à des aléas momentanés, en d’autres termes, pour traiter un simple trou d’air avant que le système recommence à fonctionner comme avant ?
À l’instar de notre excellent président Jean Arthuis, telle est la remarque que je tire de la visite de ces derniers jours aux États-Unis.
Les États-Unis sont un monde très divers, …

…où règne une certaine liberté d’esprit, plus qu’on ne le croirait d’ailleurs !

Mais j’y ai observé que, dans les milieux professionnels, nombre de nos interlocuteurs ne parviennent pas à remettre en cause les schémas intellectuels qui ont fait le succès des marchés pendant au moins une décennie. C’est une très grande difficulté de raisonner en termes de discontinuité, alors que tout serait tellement plus simple et plus commode s’il ne s’agissait que d’amender, de replâtrer et de recréer des conditions pour que tout redevienne comme avant.
Quels sont les points principaux sur lesquels peuvent porter nos observations ?
Je souscris totalement aux propos de Jean Arthuis, qui a pointé, comme premier sujet, l’évolution du rôle des banques centrales.
Il est bien vrai que leurs bilans ont changé d’ordre de grandeur en l’espace d’une année et la nature de ceux-ci s’est profondément transformée. Ainsi que l’a indiqué Jean Arthuis, cela signifie que les banques centrales, pour une bonne part, se sont substituées aux banques commerciales et ont pris des risques directs sur la solvabilité des entreprises pour le compte des États, c'est-à-dire de nous. Cela ne veut pas dire autre chose !
Or, nous le savons bien, l’une des raisons de la crise que nous affrontons réside bien dans le rôle beaucoup trop limité et stéréotypé des banques centrales, issu des enseignements d’une période révolue.
Comme l’a souligné le groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale, l’une des raisons principales pour lesquelles la crise et ses prémices n’ont pas été prévues est due au fait que l’on s’était exclusivement concentré sur le niveau général des prix et la prévention de l’inflation, alors que l’appréciation, le suivi, le contrôle des marchés, c'est-à-dire les causes profondes de déséquilibre, les niveaux absolus de prix des actifs des différentes catégories, n’ont pas fait l’objet de la vigilance qui eût été indispensable.
À cet égard, je citerai certes une référence parmi d’autres, mais qui est très concrète, à savoir le petit livre de Patrick Artus intitulé Les Incendiaires, publié un an avant la crise. Cet économiste parmi d’autres y rapprochait les appréciations qu’il faisait tant de la Réserve fédérale américaine que de la Banque d’Angleterre ou de la Banque centrale européenne. À la vérité, quelles que soient les institutions, qu’elles se trouvent aux États-Unis, dans la zone euro ou à l’extérieur, un banquier central, c’est un banquier central ! Il parle le langage des banquiers centraux, certes avec tous les mérites qui y sont attachés, à savoir la technicité et l’esprit d’intérêt général, mais il a peut-être des images trop persistantes du passé et reste prisonnier d’approches et de méthodologies qui ne sont pas et ne peuvent pas être fondées sur l’anticipation de l’avenir !
Or, mes chers collègues, seuls les États, les élus du suffrage universel et les politiques ont la capacité d’anticipation permettant d’assumer les rebonds nécessaires et d’opérer les changements de nature, de méthode et de concept qu’appelle une crise, comme celle que nous connaissons, c'est-à-dire non pas une discontinuité momentanée de certains mouvements de marché, mais une vraie crise.
J’évoquerai maintenant l’architecture des banques et leurs fonctions.
Il n’est pas certain que l’on doive revenir à la segmentation issue de la grande crise du XXe siècle, ce que les Américains ont appelé le Glass-Steagall Act.

Jean-Pierre Fourcade, qui a présidé une banque de dépôt, s’en souvient certainement, autrefois, les catégories étaient bien distinctes : banques de dépôt, banques d’investissement, banques de marché, banques de financements spécialisés, institutions financières spécialisées, …

… chacune obéissant à une régulation qui lui était propre et étant apte à prendre des risques proportionnés à son activité et aux capacités de son bilan.
Aujourd'hui, peut-on revenir à une telle approche, alors que nous sommes dans une autre époque et que nous nous sommes habitués à une amplification, à une plus grande profondeur des marchés liée à des besoins de financement de l’économie globale eux-mêmes plus larges ? Car l’époque dont nous parlons, celle du Glass-Steagall Act, correspondait à un monde fragmenté et à des marchés qui ne connaissaient pas la globalisation.
Il n’en reste pas moins que nous ne pouvons nous satisfaire du modèle de la banque universelle à l’anglo-saxonne, car tous les risques y sont confondus, tout circule d’un bilan à un autre, …

… ni pour la visibilité, la transparence ou l’information des marchés et des acteurs économiques. Manifestement, il s’agit d’inventer un modèle qui ne doit être ni le retour à des schémas révolus ni le statu quo des banques d’investissement dites globales, telles que nous les avons vues fonctionner et telles qu’elles revendiquaient, en réalité, l’absorption, en leur propre sein, de l’essentiel des transactions de marché.
J’en viens maintenant à l’innovation financière, qui s’est beaucoup développée.
Comme toute innovation, il s’agit d’un facteur de progrès, mais peut-on continuer à transformer, dans les conditions débridées de ces dernières années, en financements la mobilisation de créances et à la « marchéiser » en quelque sorte dans le monde entier ? Sincèrement, je ne le crois pas. Et, au moins, faut-il que l’entité économique à l’origine d’une créance conserve dans son bilan une part raisonnable du risque ! C’est une question de principe, de bon sens et de transparence.
Toutefois, nous avons constaté que nos interlocuteurs américains étaient certes de plain-pied avec nous, mais qu’ils hésitaient beaucoup à en assumer les conséquences. En effet, il s’agit là d’un changement de nature dont les différents effets ne sont absolument pas anticipés et assumés aujourd'hui. Pourtant, c’est une nécessité impérieuse pour les travaux préparatoires du G20, car il faudra certainement se diriger vers une standardisation des produits du marché, avec une répartition plus claire des risques. Cela pose naturellement la question de la gouvernance des institutions techniques internationales chargées d’assumer cette standardisation et de mettre en place les chambres de compensation ou infrastructures financières d’intérêt général auxquelles le président Jean Arthuis a fait allusion tout à l'heure.
Enfin, je tiens à dire que la même problématique s’applique aux principes comptables.
Monsieur le secrétaire d'État, on croit avoir agi en suspendant, pour partie, la norme de valorisation des actifs bancaires à la valeur de marché.

Mais c’est, à mon avis, une mesure très provisoire, très aléatoire et très insatisfaisante.

Il ne faut pas dire que ce problème est résolu !
De la même façon, l’une des frustrations durant la récente présidence française de l’Union européenne, quels qu’eussent été ses grands succès, c’est, à mon sens, l’incapacité à traiter de la question des normes comptables des compagnies d’assurance.
Voilà quelques jours, le Parlement européen a validé la directive Solvabilité II. Toutefois, je persiste à le dire, et j’en prends la responsabilité, celle-ci est une profonde erreur économique, qui va aboutir à raréfier les placements en actions, comme l’avait prévu, il y a quelques années, bien avant la crise, l’ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, trop tôt disparu, Francis Mayer.

C’est mécanique et nous n’y pourrons rien ! Nous nous serons ainsi placés nous-mêmes dans cette situation, faute de vision et de volonté politique, alors que nous, Français, serons plus sanctionnés que d’autres !
Je me permets donc de mettre en garde le Gouvernement sur les conséquences de ce que l’on est en train de faire ; vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, je vous le dis en toute amitié.
Pour ce qui concerne les normes comptables, que l’on ne nous dise pas que le fait de répartir entre le livre de marché et le livre bancaire la valorisation des actifs et des fonds propres est une solution ! Ce n’est qu’une situation transitoire ! Nous l’avons vu aux États-Unis, ce principe transitoire est appliqué de manière très différente d’une banque à une autre, d’un régulateur à un autre. Ainsi que l’a souligné Jean Arthuis, les États-Unis sont non pas un bloc, mais un monde très complexe.
À New York, il y a la Réserve fédérale, …

… la grande puissance du système. Mais il y a également le surintendant à la supervision des banques. Or que fait-il ? Il supervise les petites banques, à savoir des centaines de banques en contact direct avec le public et des sociétés de crédit à la consommation, mais aussi le nouveau holding Goldman Sachs !

Je conclurai avec cet exemple concret, monsieur le président !
Mes chers collègues, demandez-vous simplement pourquoi, dans l’accord passé entre le groupe Goldman Sachs et les autorités des États-Unis, a été confié au superviseur de l’État, qui dépend du gouverneur de l’État, le nouveau holding Goldman Sachs ! Je ne mets en cause personne ; le système américain a ses règles, ses équilibres, ses checks and balances. Ce système est, à certains égards, admirable, mais abordons-le sans naïveté, et sachons au moins trouver les vrais enjeux pour définir une vraie position.
Telles sont, mes chers collègues, les quelques réflexions que je souhaitais vous livrer dans le cadre des travaux du groupe de travail paritaire que le président Gérard Larcher a eu la grande intelligence de lancer dès sa prise de fonctions à la présidence. Cette idée lui revient !
Comme tout enfant bien constitué, il prend sa personnalité. Je ne dis pas qu’il échappe à ses concepteurs, mais il faut au moins souhaiter qu’il vive sa vie propre !
Sourires. - Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

La parole est à Mme Nicole Bricq, en remplacement de M. Bernard Angels, corapporteur du groupe de travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe des vingt-quatre parlementaires, ...
Sourires

Appelons-le le G24 !
Ce groupe, mis voilà peu sous les feux de la rampe, mais pas pour de bonnes raisons, a accompli selon moi un travail très fructueux à l’occasion des deux sommets du G20, l’un à Washington au mois de novembre et l’autre à Londres le 2 avril.
Nous étions aux États-Unis lorsque nous avons eu les échos de cette péripétie médiatique qui nous a paru vraiment ridicule de loin et encore plus de près ! J’espère que cette péripétie microcosmique n’oblitérera pas le travail accompli par notre groupe et qu’à l’avenir celui-ci pourra suivre les écarts entre les volontés que nous avons exprimées au nom du Parlement, monsieur le président, et les actions engagées aux niveaux mondial, européen et national. C’est en tout cas ce à quoi je me suis attachée ce matin.
Avant le premier G20, nous avions émis – et c’est tout à l’honneur de ce groupe ! – un diagnostic partagé sur les causes de la crise que je veux vous rappeler en citant ce que, les uns et les autres, nous avons écrit collectivement : la déformation du partage des revenus du capital et du travail, ...

... le développement irresponsable du crédit aux États-Unis, le taux de rentabilité à deux chiffres exigé par les marchés, l’hypertrophie de la sphère financière conduisant à multiplier les pratiques à risques, notamment dans les modalités de rémunération et les normes comptables « procycliques ».
Comme nous l’avons écrit dans notre premier texte, cette énumération illustre assez bien les renoncements successifs des États, de l’Europe, bref, de la politique !

La crise nous rappelle tous à l’ordre, un rappel sans doute plus brutal pour ceux qui étaient séduits par le capitalisme à l’anglo-saxonne et moins brutal pour ceux qui, parce qu’ils appelaient à la régulation et à l’État, étaient encore récemment qualifiés de ringards !
Mais, comme le président Jean Arthuis l’a rappelé, le temps n’est pas à la polémique quand le taux de chômage explose partout en Europe et qu’aux États-Unis les Américains craignent qu’il n’avoisine les 12 %, taux assez exceptionnel dans ce pays.
Il s’agit plutôt, et c’est ce que je m’efforce de faire ce matin, de tirer un bilan très provisoire et non exhaustif des orientations définies par les deux sommets, le second ayant sans doute plus de relief, puisque l’administration nord-américaine était quasiment en place.
Le Président des États-Unis avait proposé au Congrès un plan de relance ambitieux qui a fait l’objet d’âpres débats budgétaires. C’est peut-être ce qui explique que les premières négociations n’aient pas abouti. C’est ce que nous avons ressenti lors de notre rencontre avec le président de la commission du budget de la Chambre des représentants.
Comme le corapporteur, Bernard Angels, que je remplace ce matin, je suis attachée au fait de vérifier si les propositions que nous avons émises sont ou seront traduites au niveau pertinent, national, européen ou mondial, dans des dispositions contractuelles ou législatives. Ce n’est pas très habituel, mais je profite, monsieur le secrétaire d’État, de votre présence au banc du Gouvernement. J’y tiens d’autant plus que le 7 avril, donc quasiment à chaud, Mme Lagarde a présenté devant la commission des affaires européennes du Sénat le bilan très clair que tirait le Gouvernement de la France du compromis de Londres.
Que peut-on retenir de tous ces éléments ?
Lors de la préparation du G20 de Londres a souvent été évoqué le bras de fer opposant l’Europe et les États-Unis. Les Européens insistaient sur les nouvelles régulations, alors que les Américains insistaient davantage sur l’ampleur de la relance.
Il est vrai que le sommet de Washington avait abouti à une déclaration d’intention dans laquelle, des deux côtés de l’Atlantique, les uns et les autres pouvaient trouver un appui à leurs revendications respectives.
Au milieu, si je puis dire, le Fonds monétaire international attendait plus de moyens – il les a eus, notamment pour la prise en compte des pays émergents – et une nouvelle orientation de ses missions dans la crise, son directeur général ne cessant – nous l’avons entendu lors de notre voyage – d’appeler au nettoyage des bilans des banques, au cantonnement des actifs toxiques, en laissant la voie ouverte à chaque pays pour régler ce problème par la technique qu’il jugerait la plus appropriée à son système.
C’est un élément important, car il n’y a pas d’exemple de crise financière qui n’ait été résolue sans que l’on procède à un tel nettoyage. J’y reviendrai lorsque j’évoquerai le système américain.
Concernant la relance, on l’a bien vu, ni la France, ni l’Allemagne n’ont voulu, lors de ce sommet, s’engager pour l’instant à faire plus et mieux. Elles estiment ne pas être en capacité d’utiliser davantage l’arme budgétaire compte tenu de l’ampleur des déficits. Il s’agit pour nous d’un débat franco-français à propos duquel mon groupe et moi-même avons déjà eu et aurons encore l’occasion de nous exprimer, car les mauvais indices économiques et sociaux nous y conduiront forcément.
Au moins pouvons-nous affirmer que les plans de relance nationaux au sein de l’Union européenne ont le grand défaut, s’il en est un, de ne pas être coordonnés. Cela pourrait aboutir à un paradoxe. Si nous ne coordonnons pas nos efforts au sein de l’Union européenne, l’économie des États-Unis, où est née la crise systémique, pourrait en effet repartir plus tôt et plus vite que sur le vieux continent, et qui plus est avec un saut qualitatif, notamment à travers ce qu’il est convenu d’appeler la « croissance verte ». À ce propos, il est dommage que le G20 n’ait pas repris une proposition du Royaume-Uni en ce sens.
Concernant la régulation, qui est quand même notre sujet de réflexion, le compromis de Londres constitue une base de départ. Les Européens ont obtenu une réglementation de la finance à l’échelon mondial, malgré les réticences américaines et chinoises. Sans doute faut-il mieux en cerner le contenu, y compris à propos des paradis fiscaux.
La création du Conseil de stabilité financière à base élargie, qui succède au forum de stabilité financière, pourrait correspondre au souhait émis par le groupe de travail de disposer à l’échelon mondial d’un dispositif d’alerte du risque systémique. Nous souhaitons que l’Union européenne suive les recommandations du rapport Larosière quant à la création d’un conseil européen du risque systémique. Mais nous avons bien compris que le Royaume-Uni, fidèle à lui-même, était jusqu’à présent fermement opposé à la mise en place d’un tel outil. C’est dommage ! Il faudra batailler pour parvenir à créer ce conseil !
Nous avons aussi émis de nombreuses propositions relatives aux agences de notation. J’ai constaté que le Parlement européen avait adopté un règlement jetant les bases d’une surveillance en Europe des agences qui devront se faire enregistrer auprès du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, le CERVM, mais c’est purement formel. En pratique, ce sont les pays où sont implantées les agences ou leurs filiales qui délivreront l’accréditation.
Il est regrettable que le pouvoir de supervision n’ait pas été confié à une seule autorité européenne. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous direz peut-être quelles ont été les résistances nationales, voire les contraintes de calendrier qui ont empêché cette supervision. Peut-être la France a-t-elle elle-même souhaité que les autorités nationales contrôlent les agences implantées, y compris les filiales sur notre sol.
Un autre sujet attendu est celui des modes de rémunération qui, je l’ai dit, devraient être moins adossés au court terme. La Commission européenne a décidé d’examiner en priorité les bonus des opérateurs de marché. Elle devait, le 29 avril, émettre une recommandation sur la rémunération des dirigeants d’entreprises.
En France, nous avons eu ce débat. Il n’est pas clos par l’adoption par le Parlement du dispositif prévu dans la loi de finances rectificative que nous avons votée avant la suspension des travaux parlementaires. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Concernant les paradis fiscaux, on est évidemment très loin de ce que nous avons écrit et dit ! On ne peut même pas affirmer que le verre est au quart plein. Nous comptons en France sur la surveillance du rapporteur général et du président de la commission, qui font partie du comité de suivi des mesures d’aides de l’État mis en place par Mme la ministre, afin de vérifier que les banques et les sociétés remplissent bien la conditionnalité désormais inscrite dans la loi de finances rectificative de ne pas utiliser, elles ou leurs filiales, les paradis fiscaux. La base législative existante permet maintenant de demander des comptes.
À l’échelon mondial, les résultats du G20 sont très loin des exigences que nous avions posées. Monsieur Jean Arthuis, vous avez évoqué le passage du noir, au gris, au blanc... Tout cela est quand même très flou !
Il est une exigence à laquelle je suis attachée, c’est l’alourdissement des taxations des opérateurs en lien avec les juridictions non coopératives qui pourraient figurer sur la liste de l’OCDE. À cette occasion, je voudrais répondre à l’interpellation de notre collègue Jean-Pierre Chevènement.
La Commission européenne a demandé au commissaire Charlie McCreevy de réfléchir à un projet de directive pour encadrer les fonds spéculatifs, les hedge funds. J’ai constaté qu’il avait procédé à un toilettage. Je sais que la France, l’Allemagne et l’Italie n’accepteront pas en l’état ce projet de directive et j’espère que le Conseil européen retoquera M. José Manuel Barroso et M. McCreevy !

Je suis tout à fait d’accord !
L’encadrement ne porte pas sur les fonds. Il vise les gestionnaires qui, une fois enregistrés auprès des instances européennes, pourraient démarcher tous les investisseurs, même off shore, et disposeraient d’un passeport dans tout l’espace européen. Ils géreraient des portefeuilles dépassant 250 millions d’euros. Que se passera-t-il pour ceux d’un montant inférieur ? Tout cela n’est pas sérieux !

Le Parti socialiste européen s’est opposé très vigoureusement à un tel projet de directive. Je sais aussi que la France, l’Allemagne et l’Italie ont marqué leurs préventions. Il faut arrêter les sottises, surtout en ce moment !
Quant aux normes comptables contracycliques qu’il faut élaborer au niveau mondial, nous avons pu vérifier, lors de notre déplacement aux États-Unis, l’effet néfaste des normes actuelles, lesquelles ne disposent d’aucune légitimité démocratique et constituent un bon alibi – je ne citerai pas les grands banquiers que nous avons rencontrés, pour ne pas leur porter tort – pour entretenir l’opacité sur les bilans et les actifs toxiques, élégamment rebaptisés aux États-Unis « actifs hérités », …

… dont la présence dissimulée dans des banques ou des établissements non encore « purgés » nous fait craindre de nouvelles catastrophes.
Ces quelques illustrations témoignent de la nécessité de poursuivre la tâche entreprise par le groupe de travail. C’est le seul moyen dont dispose le Parlement pour faire la preuve de son efficacité dans la crise, qui sera longue et profonde, mais aussi dans la sortie de crise.
Notre voyage aux États-Unis nous a permis de rencontrer autorités, banquiers et opérateurs. Comme M. le rapporteur général, et bien que n’ayant pas eu l’occasion de m’en entretenir avec lui depuis notre retour, j’ai été frappée de constater que, pour nos interlocuteurs, le modèle développé aux États-Unis et dans le monde au cours des trente dernières années n’est pas mort. Souvent de bonne foi, du reste, ils étaient dans l’incapacité de se projeter dans un autre modèle, incapacité à mon sens plus intellectuelle qu’idéologique. Selon moi, il s’agit d’un problème de construction mentale.

Leur objectif est de stopper la crise financière, pour que tout reparte comme avant, la crise ayant joué à leurs yeux sa fonction habituelle, celle d’une purge, certes sévère, mais provisoire, qui aura écarté les canards boiteux, permettant ainsi à la machine de fonctionner de nouveau à l’identique.

Rétrospectivement, cela nous permet de comprendre les raisons pour lesquelles le G20 n’a fait qu’ouvrir le dossier des régulations. Nous saisissons mieux les réticences outre-Atlantique.
Ma conclusion sera identique à celle que j’ai formulée hier, au nom de mon groupe, lors du débat sur la crise financière internationale proposé par le groupe CRC-SPG.
La crise nous le révèle, il n’y a pas de mondialisation sans régulation, non seulement financière, mais aussi commerciale et sociale. Si nous voulons être tout aussi efficaces qu’utiles, nous devons travailler à élaborer des propositions et à les traduire dans l’action politique.
Sans vouloir être pompeuse, je pense que notre génération politique sera jugée par l’Histoire à l’aune de la réponse que nous aurons apportée à cette crise.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Bernard Vera, membre du groupe de travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les parlementaires communistes et apparentés des deux assemblées ont participé aux travaux de la commission mixte mise en place pour diagnostiquer les causes de la crise financière et proposer remèdes et solutions.
La crise que traversent les économies occidentales capitalistes est inscrite dans la logique même du fonctionnement de l’économie : recherche de la rentabilité maximale des capitaux, partage inégal de la richesse créée au détriment du travail, gaspillage de ressources naturelles et financières dans des opérations spéculatives. Tout a concouru, depuis des dizaines d’années, à créer les conditions de la crise actuelle.
Le contexte étant rappelé, on voit que, dans le travail de la commission mixte comme dans le débat politique, forte est la tentation du Gouvernement et de l’Élysée de créer les conditions d’une forme d’union sacrée.
Les parlementaires du groupe CRC-SPG ne peuvent s’associer à une analyse qui tend à laisser croire que la crise n’aurait qu’un caractère passager, qu’elle ne serait que le produit du dérèglement d’un système que quelques mesures ciblées suffiraient à rendre de nouveau vertueux. Ils refusent notamment de séparer les solutions à apporter à la crise d’une véritable remise en question des choix politiques aujourd’hui à l’œuvre, au plan national comme au plan européen, choix qui ont anticipé et amplifié les effets mêmes de la crise.
Hier, dans le cadre du débat qui s’est déroulé dans cet hémicycle sur l’initiative de notre groupe, nous avons donné notre sentiment sur l’ensemble des pistes de réflexion et des solutions visant à résoudre la crise financière internationale.
Aujourd’hui, je centrerai mon propos sur les conclusions du dernier G20.
Avantageusement présenté par le Président de la République comme le gage de l’efficacité de son action, le sommet de Londres a pourtant souffert de plusieurs défauts majeurs.
Tout d’abord, il ne réunissait que vingt pays de la planète, même si, pour un certain nombre d’entre eux, il s’agissait de pays émergents. Ce sont les instances réunissant l’ensemble des pays et des continents de la planète qui devraient être le lieu naturel de la discussion et de la signature des accords internationaux en matière économique et monétaire.
Ce n’est pas l’axe trilatéral États-Unis – Europe - Japon, contraint de s’adjoindre la Russie, la Chine, l’Inde et les plus peuplés des pays émergents d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, qui peut s’autoriser à donner la mesure du devenir des relations économiques et monétaires internationales !
Ensuite, en raison de cette vision rétrécie de la réalité planétaire, peu de décisions véritablement importantes ont été prises, les plus déterminantes étant reportées à plus tard. De fait, les problèmes les plus graves n’ont pas trouvé d’autre réponse que celle qui consiste à « faire avec la crise », chacun chez soi !
Force est de constater que les orientations fixées lors du sommet de Londres sont loin de correspondre à la gravité des problèmes. Rien, dans les mesures prises, ne semble répondre tout à fait aux exigences du temps et apporter de véritables solutions à la crise financière et économique.
Le sommet de Londres a surtout matérialisé la volonté du président américain, Barack Obama, d’assurer un leadership mondial, bien qu’il ait été amené à prendre en compte plusieurs facteurs : la montée irrépressible des pays émergents, à commencer par la Chine, la Russie et l’Inde ; le souci des dirigeants européens de préserver les moyens pour l’euro de rivaliser avec le dollar ; l’inquiétude grandissante de tous les dirigeants capitalistes face à la persistance de la crise systémique et aux incertitudes pour l’avenir, qui obligent les États-Unis eux-mêmes à chercher des collaborations pour maintenir leur domination.
Si l’on devait évaluer les engagements du G20, on pourrait le faire à partir des sommes qui seront mobilisées pour faire face à la situation. Car les appels de fonds sont pour le moins spectaculaires et appellent certaines observations.
Ils interviennent en effet sans remise en cause des privilèges exorbitants que confère au dollar le statut de « monnaie mondiale de domination ». Ils sont effectués sans qu’une profonde transformation de la gouvernance du FMI soit envisagée, alors même que, au sein de son conseil d’administration, les États-Unis disposent d’un droit de veto qui ne reflète pas la place que l’on doit reconnaître aux pays émergents et aux pays du Sud.
Ces appels de fonds interviennent aussi sans remise en question des critères du crédit, alors que, pourtant, grandit la crainte d’un krach des endettements publics, y compris de l’endettement des États-Unis eux-mêmes.
Ils atteignent 500 milliards de dollars pour le FMI : actuellement de 250 milliards de dollars, les ressources du Fonds vont être triplées. Ainsi, 250 milliards de dollars proviendront d’apports bilatéraux : 100 milliards de dollars pour le Japon comme pour l’Union européenne, et 50 milliards de dollars pour le Canada, la Chine et la Norvège. Par ailleurs, 250 milliards de dollars seront dégagés pour les nouveaux accords d’emprunts.
Si la France devait, à ce titre, « remettre au pot », cela entraînerait soit une ponction sur son budget d’État, soit un prêt de la Banque de France au FMI.
Un autre appel de fonds concerne les 250 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, ou DTS. Nous sommes davantage en accord avec cette mesure, qui ouvre la perspective d’une nouvelle allocation générale de DTS et fait écho à la proposition chinoise de faire des DTS un nouvel instrument de réserve internationale pour remplacer le dollar. Notons d’ailleurs que cette allocation générale donnerait lieu, pour 19 milliards de dollars, à des subventions, et non des prêts, aux pays les plus vulnérables, dont cependant il n’a pas été envisagé d’annuler la dette.
Ces décisions témoignent également de la crainte pour l’avenir qu’éprouvent les dirigeants capitalistes. Si le FMI se voit, comme jamais, renforcé dans son rôle de gendarme, il lui revient aussi désormais d’assumer une mission de soutien de l’activité, reflet de la crainte du camp occidental à l’égard des risques profonds de déstabilisation des pays dominés.
Ces apports sont censés mettre fin au fort reflux des mouvements de capitaux subi par les pays émergents et en développement depuis l’éclatement de la crise financière.
Ainsi, 250 milliards de dollars seront consacrés au commerce mondial via l’augmentation des garanties qui pourraient être apportées par des assureurs-crédits pour couvrir le financement des échanges entre pays, augmentation assortie d’une réaffirmation quasi obsessionnelle des principes libre-échangistes et l’appel à une conclusion du cycle de Doha.
Par ailleurs, 100 milliards de dollars iront à la Banque mondiale. Les pays actionnaires ont accepté que celle-ci augmente ses capacités d’emprunt à due concurrence pour fournir des crédits aux pays en développement.
Enfin, 25 milliards de dollars seront affectés aux banques régionales de la Banque mondiale.
Pour autant, puisque nous n’avons que peu de temps pour faire le tour de la question, comment ne pas souligner que l’essentiel de l’effort vise à remettre sur pied les marchés financiers occidentaux et nord-américains, bien avant toute considération quant aux équilibres économiques futurs de la planète ?
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, pouvait-il en être autrement, dans le cadre d’un sommet où les pays directement responsables du désordre financier économique s’étaient assignés pour tâche d’aller demander à quelques économies encore en croissance de leur donner les subsides leur permettant d’apurer le passif de leurs institutions et établissements financiers ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
M. Roger Romani remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, membre du groupe de travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi à titre liminaire de me réjouir à mon tour de l’initiative prise à l’automne dernier par le Président du Sénat de constituer un groupe de travail associant députés et sénateurs, pour réfléchir sur les réponses à donner à la crise financière. C’est une première qui, assurément, a montré sa pertinence dans un débat d’importance internationale dépassant dans une large mesure les clivages partisans.
Le sommet du G20 qui s’est tenu à Londres a été salué comme un relatif succès de l’action coordonnée des grandes nations contre la crise financière. Alors qu’on en prédisait un possible échec, les négociations ont en effet permis d’enregistrer différentes avancées qui paraissaient encore irréalistes voilà peu. Le cas de la lutte contre les paradis fiscaux est, à ce titre, symbolique de la rapidité avec laquelle la volonté politique s’est imposée sur un sujet figé de longue date.
La France a fait entendre sa voix et a pesé dans cette avancée. L’action du Président de la République pour mettre notre pays au centre du débat international sur la sortie de crise ne peut qu’être unanimement reconnue. Dans ce cadre, notre groupe a été reçu à trois reprises par le Président de la République, preuve que la revalorisation du rôle du Parlement n’est pas un vain mot.
Avant de revenir sur les constats auxquels a donné lieu ce sommet et sur les principales décisions prises à cette occasion, j’exprimerai, au nom, du moins je le pense, de tous les parlementaires membres du groupe de travail, ma satisfaction d’avoir été non seulement consulté, mais aussi entendu.
Tout d’abord, j’évoquerai les constats sur lesquels ont reposé nos travaux. Ils sont, je le crois, largement partagés et s’articulent autour de l’idée d’une nécessaire régulation face aux excès du capitalisme financier. Il s’agit non pas forcément de tout réguler ou de réguler plus, mais de réguler mieux. Le contrôle des marchés et de la sphère financière doit ainsi être confié non pas à leurs propres acteurs, mais bien au politique, qui doit reprendre la main, comme le soulignait dans ses conclusions le groupe de travail, que je cite : « La crise a mis en évidence les limites et les effets pervers de l’autorégulation. Le groupe de travail rappelle la nécessité d’affirmer la primauté de la régulation et de replacer les États – et donc le politique – au centre du jeu monétaire et financier international. »
Parmi les éléments qui ont contribué à la violence de la crise figurent en priorité un certain nombre de dysfonctionnements de la finance et des marchés, qui ont exposé des ménages et des institutions financières à des risques incontrôlés, en abusant des possibilités offertes par la loi, jouant à l’excès de l’effet de levier et exacerbant les possibilités de gains.
La dénonciation des paradis fiscaux, refuge de l’argent sale, mais aussi et surtout facteur d’opacité des circuits financiers, nous est apparue à ce titre comme une nécessité, à l’heure où le retour de la confiance et la juste évaluation des risques nécessitent une transparence accrue.
Notre groupe s’est également interrogé sur le fonctionnement des agences de notation, qui ont souvent failli dans leur analyse, se montrant peu à même d’évaluer correctement le risque inhérent à certains actifs ou produits complexes ou encore à la solvabilité d’émetteurs souverains.
Le caractère pervers de certaines normes comptables a, de même, été souligné. Nous pensons notamment aux normes américaines qui, en permettant la réévaluation permanente des actifs figurant au bilan des banques au fur et à mesure que les marchés immobilier et boursier étaient orientés à la hausse, ont amélioré les ratios fonds propres sur encours et accentué la capacité de prêt de manière artificielle.
Comme d’aucuns l’ont rappelé, ce schéma a permis la période de croissance des années deux mille, mais il a aussi précipité le retournement de situation avec d’autant plus de violence qu’il a asséché la source du crédit.
Notre groupe de travail s’est ensuite attaché à formuler des propositions. Je ne parlerai ici que des axes prioritaires qui ont été évoqués à l’occasion du G20.
En premier lieu, nous avons insisté sur la nécessité d’assainir les relations avec les pays qualifiés de paradis fiscaux, bancaires ou réglementaires. La publication d’une liste isolant les États qui n’ont pas mis en place une coopération suffisante ni émis de signes clairs de bonne volonté représente un saut qualitatif majeur vers une transparence accrue et un meilleur contrôle des placements offshore. La simple évocation de la fin du secret bancaire suisse ou luxembourgeois aurait fait sourire voilà quelques mois ; pourtant, aujourd’hui, ce secret est bel et bien en passe d’être largement aménagé.
Comme cela a été souligné tout à l’heure, il faut cependant rester vigilant face à la persistance de zones ou d’États qui, sans figurer sur la liste établie, conserve une législation très éloignée des standards internationaux en matière de transparence, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des sociétés commerciales.
En deuxième lieu, nous avons plaidé en faveur d’une révision de l’architecture de la supervision internationale qui passerait, notamment, par un renforcement des rôles respectifs du Fonds monétaire international et du Forum de stabilité financière, sous le contrôle des États membres du G20.
L’augmentation considérable des moyens octroyés au FMI, qui voit ses pouvoirs étendus et son budget triplé pour atteindre 750 milliards de dollars, a été l’un des apports majeurs de ce deuxième sommet du G20.
La crise aura donc eu également pour mérite d’ébaucher une gouvernance mondiale dans les questions qui relèvent de la sphère financière et d’étendre aux nouvelles grandes puissances, comme la Chine ou l’Inde, le cercle des pays appelés à participer sur une base régulière à ces sommets internationaux.
De nouveau, je cite les conclusions de notre groupe de travail, lesquelles résument l’esprit d’une nouvelle régulation dans le but de prévenir les risques systémiques : « Il est nécessaire […] de soumettre tous les pays à des inspections et évaluations régulières, de disposer d’une connaissance précise de l’ampleur et de la nature des flux financiers, d’identifier les facteurs de risque et d’établir une “courroie de transmission” avec les régulateurs nationaux pour qu’ils prennent, le cas échéant, les réglementations qui s’imposent. »
Au niveau européen, nous proposons d’appliquer les recommandations du groupe d’experts présidé par Jacques de Larosière, qui prône notamment la création d’un Conseil européen du risque systémique.
De la même manière, notre groupe a proposé d’associer les banques centrales, notamment la BCE, à la prévention de ces risques, en élargissant leur mandat au-delà de l’actuel suivi de l’évolution des prix et de la lutte contre l’inflation, pour toucher également les actifs financiers et immobiliers.
Enfin, le groupe de travail a souhaité une plus grande régulation des produits et des acteurs financiers à risques. Les agences de notation doivent ainsi faire l’objet d’une attention particulière : elles devraient se soumettre à des principes déontologiques étendus et pourraient voir leur responsabilité engagée.
Nous avons également proposé la création d’une chambre de compensation des produits dérivés négociés de gré à gré, en particulier des dérivés de crédit, ainsi qu’une plus grande standardisation de ces contrats. Cela répondrait à un impératif de clarté et faciliterait les comparaisons, donc les évaluations des actifs lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une cotation.
Nous estimons en outre nécessaire de préciser les normes prudentielles applicables aux établissements de crédit, notamment la méthodologie d’évaluation des produits titrisés, et de réfléchir à une interdiction de la titrisation intégrale des prêts, comme cela s’est pratiqué.
Il serait également nécessaire de clarifier certains principes comptables, notamment pour permettre l’évaluation des instruments financiers complexes en cas de marché peu liquide.
J’aimerais enfin conclure mon propos en soulignant, à titre personnel, combien il a pu paraître surprenant de constater le silence ou, du moins, le manque d’efficacité de l’Europe sur ces questions essentielles.
À quelques semaines des élections européennes, force est, hélas, de constater que l’Europe a été très largement absente de ces débats, s’effaçant notamment derrière le couple franco-allemand. La Commission européenne, qui aime à s’intéresser à des sujets de détail et qui sait réglementer jusque dans les plus fines subtilités certaines activités économiques, aurait gagné à donner de la voix sur ces sujets primordiaux. Les tenants d’un retour des États-nations y trouveront sans doute quelques motifs de satisfaction. Au contraire, je souhaite pour ma part que la construction européenne se poursuive aussi autour de ces grands sujets et qu’une concertation s’établisse avec les parlements nationaux.
La démarche de notre groupe de travail s’inscrit dans cette logique d’une force de proposition vigilante et exigeante. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser sans lendemain les annonces faites, et c’est pourquoi nous souhaitons obtenir des réalisations concrètes dans tous les domaines évoqués.
Un troisième sommet du G20 est d’ores et déjà prévu, dont l’une des missions sera de contrôler la mise en œuvre des mesures annoncées. Notre groupe de travail répondra à l’invitation du Président de la République à l’occasion de ces travaux.
En définitive, la régulation financière doit être ambitieuse, sans tomber dans l’écueil d’un interventionnisme national trop marqué. De la même manière que la crise peut conduire à s’interroger sur l’idée d’un protectionnisme éclairé, soucieux de la sauvegarde justifiée des emplois et des solidarités collectives, il faut réfléchir à la notion de nouvelle réglementation publique, qui veille à corriger les excès du capitalisme financier sans étouffer la compétitivité de nos économies dans un carcan trop étroit. C’est un défi dans lequel les parlementaires que nous sommes ont leur mot à dire, en rappelant le cas échéant les décideurs à une juste mesure.
Comme l’ont souligné Jean Arthuis et Philippe Marini, nous devons aussi rester modestes, sachant que toute régulation efficace ne pourra être que supranationale. Nous sommes donc, avec mes collègues députés et sénateurs, toujours aussi fortement engagés dans le processus de concertation et de réflexion qui a été enclenché. À l’instar du président du Sénat, je souhaite que nos travaux se poursuivent maintenant sur des sujets plus techniques.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi qu’au banc des commissions.

La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, membre du groupe de travail.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si nous n’avons pas tous la même analyse de la crise, les divergences qui peuvent exister sur les causes de celle-ci n’ont pas empêché le groupe de travail Assemblée nationale-Sénat de formuler, à l’unanimité, des pistes de réforme qui concernent l’assainissement des relations avec les paradis fiscaux, bancaires et réglementaires, l’architecture de la supervision internationale et, enfin, la régulation des produits et acteurs financiers.
Reconnaissons d’emblée que ce G20 marque une avancée, car, à la différence du G7, il associe la plupart des grands pays émergents et reflète la nouvelle multipolarité du monde. Le renforcement de son rôle politique et son institutionnalisation, souhaités par notre groupe de travail, paraissent en bonne voie, même si de nombreux progrès restent à accomplir.
Sur le fond, les positions prises par le G20 le 2 avril dernier vont souvent dans le bon sens. Elles restent cependant insuffisantes, voire inappropriées pour certaines d’entre elles. À titre d’exemple, l’assainissement des relations avec les paradis fiscaux – un problème important, même s’il ne se situe pas à la racine de la crise – prendra du temps et demandera une résolution sans faille. Celle-ci manque, évidemment, comme l’a d’ailleurs relevé Mme Bricq à propos des propositions faites par les commissaires européens MM. Barroso et McCreevy.
De même, la limitation de la réglementation des hedge funds à ceux qui ont une importance systémique pourra facilement être contournée. Dans une interview accordée au journal Les Échos, Joseph Stiglitz observe que, sur ce point essentiel, aucun engagement n’a été pris en raison de l’influence des banques américaines dans le système. Il ajoute qu’il n’existe pas de volonté réelle de venir à bout des facteurs qui ont contribué à la crise. Il cite en particulier, comme l’a d’ailleurs fait excellemment le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, le problème du traitement des produits dérivés, qui ont pourri le système. Il est évident qu’il n’existe pas d’instances claires au sein desquelles la transparence pourrait s’exercer dans ce domaine qui, je vous le rappelle, représente la somme colossale de 60 trillions de dollars – 60 000 milliards de dollars, plus que le PIB mondial ! – liée à la fluctuation des cours des monnaies, des matières premières et des taux d’intérêt.
Les deux problèmes essentiels, celui de l’assainissement financier et celui de la relance économique, sont très étroitement connectés.
Il ne suffit pas d’injecter des capitaux dans le système bancaire pour l’assainir. Il est même choquant de voir le contribuable venir au secours de banquiers faillis qui ne souhaitent, une fois remis en selle, que recommencer le grand jeu de la mondialisation libérale, et inégale, et reprendre leurs pratiques déresponsabilisantes de titrisation ainsi que la course à des taux de rentabilité exorbitants, lesquels étaient censés justifier leurs extravagants bonus.
Il faudrait au moins exiger que les banques conservent à leur bilan les risques les plus lourds et ne puissent titriser qu’une partie de leurs prêts, comme M. Marini vient, à juste titre, de le rappeler. Nos concitoyens ne peuvent accepter que la dette publique prenne simplement le relais de la dette privée creusée par ceux-là mêmes que l’on maintient en place, alors qu’ils n’ont rien perdu de leur arrogance et de leurs prétentions financières.
Oui, monsieur le secrétaire d’État, la question de la nationalisation des banques se pose, comme je l’avais suggéré dès les 8 et 15 octobre 2008, à l’occasion du débat sur la crise financière et bancaire et de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie. Elle se pose notamment pour Dexia et pour la banque issue de la fusion de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de la Banque fédérale des banques populaires.
La renationalisation de tout ou partie du système bancaire, en France comme ailleurs – regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis –, obéit à une double nécessité, politique, d’abord, car il est normal que celui qui paye commande, économique, ensuite, dans la mesure où la reprise du crédit ne se fera que par une entente coopérative entre les banques. Comme l’a bien montré M. Jean-Luc Gréau, c’est à l’État d’organiser et de surveiller cette entente coopérative durant toute la période nécessaire au retour à la normale. Il ne suffit pas de nommer un médiateur.
J’en arrive maintenant aux plans de relance économique.
M. Strauss-Kahn a mis en cause la frilosité des pays européens. Il ne faut certes pas exclure un nouveau plan de relance axé sur l’investissement, la préservation du tissu productif, les revenus les plus bas, les chômeurs et les jeunes, mais il est légitime de veiller à ce que l’injection de crédits publics n’aboutisse pas, selon l’expression consacrée, à « arroser le sable ». Il est malheureusement trop évident que, jusqu’ici, l’effort du contribuable a servi pour l’essentiel à renflouer le système bancaire, en vertu du principe : « On prend les mêmes et on recommence. »
Un traitement insuffisant de la crise ne sera pas toléré, d’abord parce que cela ne marche pas : le risque principal réside aujourd’hui dans le mitage du système « banque-assurances » par des engagements irraisonnés ; je rappelais à l’instant que plus de 60 trillions de dollars avaient été titrisés sous forme de CDS, ou credit default swaps, et que le sujet des produits dérivés n’avait pas été traité lors du sommet de Londres.
Il est certes vrai que le redressement de nos économies pose un problème d’une immense ampleur, mais, pour redonner un horizon à nos démocraties et rétablir durablement la confiance, il faut une perspective de progrès partagé, qui passe par une progression des rémunérations égale à celui de la productivité et par un partage plus honnête des salaires et du profit.
Il est évident que la déformation du rapport entre les revenus du travail et du capital n’est guère compatible avec un libre-échange généralisé, dès lors que les écarts de salaires sont de un à vingt. Il faut donc instaurer une concurrence équitable. Je parle non pas d’un repli autarcique mais d’une régulation négociée des échanges internationaux qui permettrait une sortie de crise à l’échelle mondiale, et d’abord en Europe et aux États-Unis, à partir d’une revalorisation salariale substantielle, à l’abri d’une protection modérée, corrigeant les distorsions de salaires abusives.
Or le sommet de Londres, on l’a rappelé tout à l’heure, s’est borné à fulminer une excommunication contre le protectionnisme, au nom d’une lecture d’ailleurs biaisée de l’histoire des années trente.
Les mêmes qui ont failli veulent persévérer : alors que le commerce international devrait se contracter de 9 % cette année – pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le protectionnisme –, ceux-là mêmes qui ont présidé à une mondialisation qu’ils disaient « heureuse », mais qui s’est révélée catastrophique, entendent à nouveau – et encore plus – « libéraliser » le commerce international à Doha, en juillet prochain.
Il n’y a aucune guérison à attendre de ces mauvais médecins.
Il faudrait, au contraire, mettre en place une régulation par grandes zones économiques regroupant des pays de niveau comparable en termes de salaires, sans se fermer à une raisonnable concurrence des pays à bas coûts. Ces derniers seraient fortement incités, en contrepartie, à développer leur marché intérieur, leur système de sécurité sociale et la protection de leur environnement.
Tout cela passe par une grande négociation internationale, qui prendra beaucoup de temps. Mais, heureusement, le G20 s’est mis en place. Il se réunira à plusieurs reprises, au niveau des ministres des finances et des chefs d’État et de gouvernement. Il conviendra, dans ce cadre, d’aller dans le sens que j’ai indiqué.
J’ajouterai un mot sur le FMI, dont on voit tripler les ressources, ce qui fera l’affaire des pays au bord de la banqueroute comme des grands pays exportateurs. Mais cela ne remédiera pas aux déséquilibres fondamentaux dont souffre l’économie mondiale, du fait notamment du déficit abyssal de la balance commerciale américaine.

En effet, monsieur Marini, mais aujourd’hui le débiteur tient son créancier !

Le dollar est peut-être fragile, mais cela reste à démontrer.
Le problème du système monétaire international n’a pas été abordé à Londres par le G20. Il devrait l’être à l’avenir.
On voit que la Banque centrale américaine a non seulement pris en charge dans son bilan des actifs douteux colossaux, comme l’ont d’ailleurs relevé MM. Arthuis et Marini, mais aussi commencé à souscrire pour 300 milliards de dollars de bons du Trésor, ce qui constitue une forme de prise en charge par la dette publique américaine.

On me dit que la Banque d’Angleterre va faire de même. Le président de la Banque populaire de Chine a mis le doigt sur le problème essentiel en proposant de créer un nouveau système de réserve monétaire constitué d’un panier de monnaies, comme les droits de tirage spéciaux, ou DTS, émis par le FMI.
Qu’en pense le Gouvernement français, monsieur le secrétaire d’État ? Vous vous souvenez peut-être de la mise en cause par le général de Gaulle, en 1964, du privilège du dollar !
M. Jean-Pierre Fourcade sourit.

Il n’est pas normal que le monde dépende des émissions de monnaie des États-Unis. Ceux-ci doivent sortir du modèle rentier dans lequel ils se sont enfermés.
Tout démontre que cet objectif est inaccessible sans une remise en cause d’un libre-échange généralisé et dogmatique qui, en comprimant les salaires dans les pays anciennement industrialisés, est, avec le privilège du dollar – car les deux facteurs ont joué –, à l’origine de la crise actuelle.

En conclusion, le G20 sera très utile pour négocier les transitions nécessaires et la réforme du système monétaire international doit être mise à l’ordre du jour du prochain sommet.
Le groupe de travail sur la crise financière, très heureusement constitué de douze députés et douze sénateurs, doit poursuivre ses réflexions. Nous devons multiplier nos échanges, comme l’a d’ailleurs suggéré le Président de la République lui-même, avec les parlements voisins – il a cité le Bundestag et le Bundesrat – et les institutions européennes ; je pense à la Banque centrale européenne, voire à la Commission.
Il faut que nos propositions nourrissent le débat public : c’est aussi ce qu’attendent du Parlement nos concitoyens.
Applaudissements

« Le capitalisme est en train de s’autodétruire ». Cette affirmation formulée il y a déjà quatre ans par un économiste français dont M. Marini vient d’ailleurs d’évoquer un autre ouvrage, Les Incendiaires, illustre le fait que la crise que nous connaissons était annoncée depuis de nombreuses années ; les excès qui ont été constatés ne pouvaient conduire qu’à la situation que nous vivons depuis quelques mois.
Bien sûr, dans une telle situation, la tentation est forte de chercher des boucs émissaires. On a ainsi évoqué, parmi bien d’autres causes et responsables, M. Ben Bernanke.
En réalité, de nombreux observateurs se sont rapidement convaincus que cette crise était générale, structurelle, et qu’il fallait affronter les problèmes de façon sérieuse et rigoureuse.
Le groupe de travail sur la crise, constitué de députés et de sénateurs, a, à cet égard, élaboré une réflexion constructive. J’ai d’ailleurs plaisir à constater que plusieurs des thèses que nous défendions ici même depuis plusieurs années ont été reprises, notamment sur la nécessité d’une régulation accentuée.
En ce qui concerne le G20, on constate, bien sûr, un certain nombre d’avancées. Pour autant, j’ai noté l’extrême prudence de notre rapporteur général, M. Marini, pour ce qui est des perspectives offertes par les décisions annoncées dans les conclusions du G20.
En outre, à côté des avancées, on peut noter des bizarreries et des non-dits. L’une de ces bizarreries consiste à ne faire figurer sur la liste noire des paradis fiscaux que quatre malheureux pays, le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l’Uruguay, dont on ignorait même qu’ils avaient ce statut !
Le Brunei et le Guatemala avaient, quant à eux, eu la bonne idée de faire téléphoner le matin même de la réunion du G20 pour promettre qu’ils seraient plus coopératifs, ce qui leur a permis d’être rayés in extremis de la liste, tandis que l’on a miraculeusement classé Jersey parmi les pays « blancs », c’est-à-dire ceux qui sont au-dessus de tout soupçon !
Mme Nicole Bricq s’esclaffe.
Sourires

Il y a également des non-dits lourds de sens sur des sujets majeurs. Pas un mot, par exemple, sur la réorganisation du système monétaire international et la remise en cause du dollar comme étalon.
Pas un mot non plus sur les moyens de s’attaquer aux gigantesques déséquilibres commerciaux, largement responsables de la crise.
Pas un mot, surtout, sur la façon dont les États comptent s’y prendre pour assainir un jour leurs finances publiques.
S’agit-il donc, en réalité, d’un changement profond ? Je crains que non. Certains observateurs notaient d’ailleurs qu’à Londres vingt dirigeants représentant 85 % du PIB mondial et 65 % de la population de la planète ont décidé d’unir leurs efforts comme jamais, ce qui est louable, et de mobiliser plusieurs milliers de milliards de dollars pour sauver le système, et non pour en changer. Il s’agit là pour nous d’un motif de déception majeur, car cela dénote un certain nombre de limites.
Il nous faut savoir tirer plusieurs enseignements de cette crise, qui est loin d’être terminée.
Premièrement, le krach accuse de façon indéniable les excès du capitalisme.
Deuxièmement, cette crise met en évidence la folie des crédits pervers, des hypothèques, des swaps, notamment. On peut craindre, comme l’ont dit certains tout à l’heure, les répercussions de ces crédits structurés sur les financements de nos collectivités dans les mois, voire les deux années à venir.
Troisièmement, il faut souligner l’irresponsabilité des acteurs de la chaîne financière, au nombre desquels figurent, parmi bien d’autres, les agences de notation.
Quatrièmement, la nationalisation des pertes s’est révélée nécessaire pour faire face à la crise, ce qui nous invite à poser la question des contreparties : qu’attendons-nous en retour de la part des acteurs – banques et entreprises – que nous avons aidés à se remettre à flot ? Il s’agit là, selon moi, d’une question essentielle.
Cinquièmement, la purge des systèmes financiers entraîne une décroissance, des ruptures et des pertes d’emplois considérables, ce qui aura pour conséquence une augmentation de la pauvreté. Ce constat appelle de notre part une action publique forte.
Sixièmement, enfin, on constate une absence de politique commune européenne véritablement efficace, ce qui conduit nécessairement à réfléchir, pour l’avenir, sur la consolidation de ces politiques.
Face à cette situation, quelles exigences devons-nous formuler, et quelles suites faut-il donner, pour l’heure, à ces différents constats ?
La première exigence tient, bien sûr, à la consolidation d’une économie en crise. Un certain nombre de pistes ont été tracées lors du G20 ; elles doivent entraîner une adaptation de nos politiques publiques. Telle est la réalité : nous n’avons pas le droit de pratiquer la politique du pire ; il faut bien essayer de consolider le système.
Mais la seconde exigence, que j’examinerai plus longuement, concerne nos capacités d’anticipation face aux risques aujourd’hui détectés.
D’abord, dans cette situation de crise, s’affirme la nécessité d’un véritable volontarisme politique pour accroître la régulation. De ce point de vue, et en ce qui concerne notre pays, nous avons quelques doutes sur la durabilité des engagements pris aujourd’hui par le Président de la République et par le Gouvernement.
Pour les besoins du moment, ils se sont ralliés à l’idée de la régulation politique, mais cela durera-t-il ? Nous en doutons, car, dans les valeurs qui sont aujourd’hui prônées au sommet de l’État, ne figure pas la solidarité qui doit, à nos yeux, guider les politiques publiques.
Un observateur attentif de la vie politique – François Bayrou, pour ne pas le citer –, dénonce, dans un ouvrage paru aujourd’hui même et dont la presse s’est déjà fait l’écho, l’affirmation en France d’une « idéologie de l’argent, présenté comme valeur » et d’une « idéologie de la généralisation de la loi du profit ».
Nous retrouvons dans ces analyses un certain nombre de thèses que nous défendons depuis de longues années. J’ai le sentiment que, dans notre pays, une large part de l’opinion publique se rallie à cette préoccupation pour une régulation accrue et une redynamisation des valeurs fondées sur la solidarité et non plus sur le « chacun pour soi ».
Au-delà du volontarisme politique, on peut également évoquer l’action de l’Europe. Il importe de refonder la surveillance financière et de consolider à tout prix les politiques européennes.
Enfin, et c’est à mes yeux l’essentiel, un autre partage des richesses doit être recherché dans notre pays. « Face à la crise, partager devient nécessaire », disait récemment un commentateur. Il s’agit bien là d’un sujet de préoccupation majeur, y compris d’ailleurs aux États-Unis, comme beaucoup l’ont noté. Mais c’est également particulièrement vrai en France et dans le reste de l’Europe : il nous faut rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires, et surtout mieux répartir les revenus.
Certains ont cru possible une sorte de « keynésianisme des riches » : la hausse des inégalités aurait, selon eux, tiré l’économie par le biais des dépenses des plus aisés.
Il n’en a rien été, et ce pour une raison simple : le taux d’épargne s’élève avec le revenu. L’argent ainsi dégagé a largement alimenté le patrimoine financier des couches les plus aisées, participant au gonflement de la bulle spéculative.
À la place de la fuite des personnes, on a orchestré une fuite des capitaux, à la recherche de gains toujours plus spéculatifs. Nous payons aujourd’hui l’addition de ce vaste gaspillage : les baisses d’impôt n’ont eu pour résultat que d’enfoncer les comptes publics, sans avoir d’effet sur la croissance.
Il est impossible de répondre à la crise économique sans un effort de solidarité nationale, sauf à aggraver de façon vertigineuse le déficit public, qu’il faudra de toute façon payer un jour.
Cet effort ne saurait être réalisé sans tenir compte des gains obtenus dans les années récentes par les plus aisés. Selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la contribution commune doit être « répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » C’est l’impôt sur le revenu, dont le taux augmente avec le niveau de vie, qui tient le mieux compte des « facultés » des uns et des autres.
Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais dire au nom du groupe socialiste. L’effort de répartition des richesses sera encore, dans les années qui viennent, une condition nécessaire – quoique non suffisante – d’une amélioration durable de la situation économique et sociale dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été fort bien dites, et de ces différentes interventions se dégagent sans conteste un certain consensus.
En effet, l’ampleur de la crise financière a ébranlé les fondements du capitalisme financiarisé dans sa version anglo-saxonne. Elle impose de repenser la régulation et les valeurs du système économique mondial, dont l’instabilité a mis en évidence plusieurs défaillances, notamment en matière de réglementations, de systèmes d’informations et d’incitations, tous s’étant révélés particulièrement inadéquats. Tout le monde en a pris conscience, même ceux qui vantaient il n’y a pas si longtemps encore les vertus du modèle capitaliste américain !
Prenant acte de la faillite du système financier mondial, les pays du G20 se sont donné pour objectif, dès novembre 2008, de dessiner les contours d’un nouvel ordre financier mondial sur la base de mesures destinées à améliorer la supervision du système financier dans de nombreux domaines. L’objectif principal est en effet de remettre de l’ordre dans la finance, car ce secteur a pris une place démesurée dans le capitalisme contemporain. La production de nouvelles normes permettrait d’éviter, ou du moins de limiter considérablement, la possibilité d’une nouvelle crise.
Au-delà, la profondeur et la nature multidimensionnelle de la crise conduisent à repenser le système de régulation à plusieurs niveaux. Il s’agit de garantir la stabilité financière en appliquant de nouvelles normes au secteur financier, à l’échelle tant nationale que supranationale, pour renforcer notamment la coordination économique mondiale.
Plus précisément, la crise économique actuelle révèle sur le plan microéconomique les insuffisances de la production d’informations et des pratiques du secteur financier. Sur le plan macroéconomique, elle illustre le caractère problématique des déséquilibres internationaux. En effet, la crise est née d’une conjonction de mauvaises incitations, de réglementations inadéquates et d’un défaut de coordination des politiques économiques au niveau mondial. Tout le monde pose ce diagnostic. C’est pourquoi il faut repenser, d’une part, la régulation du secteur de la finance et, d’autre part, les contours d’une gouvernance mondiale dont les principales institutions ont été formatées voilà plus de cinquante ans.
Prenant acte de cette défaillance, les pays du G20 se sont engagés, lors du récent sommet de Londres, sur les principaux chantiers de la régulation : encadrer les activités bancaires ; renforcer les politiques de maîtrise des risques des banques ; encadrer les marchés de produits financiers sophistiqués et s’attaquer aux paradis fiscaux. Ce sont ces différents aspects que je me propose d’aborder à présent.
La crise a, en effet, révélé les insuffisances des normes prudentielles destinées à limiter le risque systémique. Les crises financières importantes récentes résultent de l’éclatement de bulles, dont la formation, originellement aux États-Unis, résulte non pas forcément de la distribution excessive de crédits, mais des subprimes, qui étaient en réalité des prêts risqués accordés à une clientèle peu ou pas solvable. C’est pourquoi il faut non seulement inciter fortement les banques à mettre plus de capital de côté pendant les périodes d’euphorie, mais également instaurer un contrôle plus efficace. Cela est possible en rémunérant mieux les contrôleurs internes, en encadrant les rémunérations des traders, et en mettant en place des systèmes d’information capables de fournir un état de leur exposition totale aux risques pris. En outre, il faut rééquilibrer les incitations individuelles au profit du long terme.
Ce que nous enseigne également la crise dans ce domaine, c’est qu’il est nécessaire que les banques, principalement les banques d’affaires, disposent en permanence d’actifs de qualité susceptibles d’être apportés aux banques centrales en cas de problème.
Le G20 de Londres a a priori pris en compte les questions prudentielles. Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, ainsi que M. le rapporteur général l’a indiqué dans son intervention, force est de reconnaître que, lorsqu’ont été adoptées, sur un plan mondial, les normes IFRS édictées par l’IASB, les pays d’Europe continentale se sont montrés bien complaisants.
Aujourd’hui, les méthodes du mark to market ou de la fair value impliquent l’existence réelle d’un marché. Mais, en l’absence d’un tel marché, il devient impossible de se référer à une quelconque valeur. C’est bien ainsi qu’il faut expliquer les « cantonnements » auxquels les banquiers ont procédé.
Aux incitations défaillantes s’est ajoutée une insuffisance de l’information financière. Ainsi, l’existence de marchés dits « de gré à gré », c’est-à-dire ceux dont les conditions sont laissées à la libre négociation, pose problème dans la mesure où les transactions restent opaques.
Il est également nécessaire d’encadrer les produits dérivés structurés, dont même ceux qui les conçoivent ne savent pas bien ce qu’ils recouvrent. Là est le problème !
Au centre de la crise, les agences de notation, rétribuées par ceux-là mêmes dont elles étaient chargées de noter les produits, ont montré leurs défaillances en diffusant de mauvaises informations ou en accordant des notes AAA à des produits financiers qui se sont révélé des créances pourries. Ce faisant, elles ont conduit les investisseurs à minimiser les risques qu’ils prenaient.
Cela prouve que le G20 devra encore revenir sur les règles applicables à ces agences de notation et sur leur façon de se rémunérer. Avec les normes IFRS, celles-ci ont certainement contribué à l’accélération de la crise financière mondiale.
Limiter la dissémination et l’opacité des risques financiers est un enjeu majeur de la régulation. Il existe aujourd’hui un consensus politique international en faveur de la lutte contre les paradis fiscaux.
Si l’on a pu parfois inclure parmi les paradis fiscaux des pays qui n’en étaient pas, en revanche, on en a ignoré certains autres, pourtant beaucoup plus proches de nous, y compris au sein de l’Union européenne, par exemple les îles anglo-normandes.
La meilleure régulation financière sera facilement contournée si l’ensemble des paradis fiscaux peuvent continuer à œuvrer comme bon leur semble. On peut agir au niveau national en renforçant les moyens de l’administration fiscale, au niveau européen en rendant effectives les différentes directives dans ce domaine, et, enfin, au niveau international en exigeant le reporting, pays par pays, des multinationales.
En renforçant la complexité et l’opacité des instruments financiers, les paradis fiscaux ont contribué à un accroissement des prises de risque par les acteurs financiers et à la perte de la traçabilité de ces risques. Jean-Pierre Chevènement indiquait d’ailleurs les sommes fabuleuses que représentent l’ensemble de ces produits structurés.
C’est le cas également des hedge funds, ces fonds spéculatifs enregistrés pour la plupart aux îles Caïmans, responsables pour une grande part de la panique boursière dans la mesure où, en prenant des risques excessifs, ils ont introduit une trop grande volatilité sur les marchés financiers. De fait, ils ont nourri la crise et contribué à faire de la finance internationale une zone de non-régulation.
L’action du G20, dans ce domaine, paraît déterminée, même si l’on peut s’interroger sur l’absence sur la liste publiée par l’OCDE de certains États américains, asiatiques ou européens, pourtant notoirement connus pour être des paradis fiscaux.
Dans ce contexte, il me semble nécessaire d’instituer un superviseur européen des établissements financiers. De nombreux orateurs ont indiqué l’absence de l’Europe, dont le silence était assourdissant. Il faudra qu’elle se réveille !
La multiplication des faillites bancaires en Europe a montré les faiblesses du contrôle opéré sur ces établissements. En effet, ce contrôle reste toujours national, alors que les établissements bancaires développent leurs activités aux niveaux européen et mondial. Il faudra y remédier.
En outre, ce contrôle devra être indépendant des États et pourra, ce à quoi je suis tout à fait favorable, être rattaché à la BCE.
Enfin, l’autorité de contrôle pourrait donner son agrément aux agences de notation. Un régulateur indépendant et de qualité est une condition essentielle à la prévention des futures crises.
Comme on le voit, tout nous rappelle qu’une gouvernance économique européenne est indispensable pour faire face à la crise financière et en prévenir une nouvelle.
Il paraît indispensable de renforcer la gouvernance économique mondiale. La crise a démontré la nécessité de réponses coordonnées des gouvernements. Les déséquilibres mondiaux, qui ont largement alimenté la crise, sont en partie le résultat de politiques monétaires et de politiques de change non coopératives.
Devant le risque d’une déflation mondiale, la coordination des États doit œuvrer à une relocalisation des liquidités émanant des pays émergents. Il faut donc conduire l’ensemble des pays à mener des politiques monétaires et budgétaires concertées. Il est d’ailleurs regrettable que, lors du sommet de Londres, aucune discussion n’ait eu lieu sur ces déséquilibres monétaires et budgétaires.
La crise financière rappelle, en outre, la nécessité de nouvelles institutions élargies de coordination des politiques économiques au niveau mondial. Le G20, qui s’est imposé à cette occasion comme l’instance politique de régulation de la crise, a décidé de confier cette coordination au FMI avec des moyens renforcés, notamment dans sa fonction de surveillance financière, en contrepoint de la production de normes comptables ou prudentielles.
La crise financière internationale, en mettant fin au mythe de l’autorégulation des marchés, a replacé les États et la politique au centre du jeu monétaire et financier international. C’est une bonne chose. Si les conclusions du G20 vont dans le bon sens et marquent sans conteste une avancée, il faudra s’assurer, comme l’a souligné M. le coprésident du groupe de travail, que ces engagements ne restent pas à l’état de vœux pieux et qu’ils se traduisent véritablement par de nouvelles règles financières internationales. Le prochain rendez-vous du G20 sera l’occasion de le vérifier.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, les différents orateurs qui se sont exprimés, notamment M. de Montgolfier, qui est intervenu au nom du groupe UMP, ont parfaitement rendu compte des travaux du groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale. La constitution de ce groupe est une innovation : elle a permis de mettre en lumière les causes de la crise et d’avancer un certain nombre d’idées importantes pour dessiner les perspectives de son règlement.
Je n’ajouterai rien aux propos qu’ont tenus Albéric de Montgolfier et Jean Arthuis sur les résultats précis du G20. Néanmoins, il me semble nécessaire de signaler trois faits positifs issus de ce sommet, directement imputables aux initiatives du Président de la République.
Premièrement, le Fonds monétaire international a vu ses moyens partiellement renforcés, alors qu’il avait quelque peu abdiqué son rôle de régulateur général, à l’époque où se développaient aux États-Unis des outils innovants en matière financière.
Deuxièmement, et j’y insiste particulièrement, l’accord franco-allemand a permis d’aboutir à des propositions convenables sur la régulation financière.
Troisièmement, contrairement à ce qui avait prévalu lors de la grande crise des années trente, les banques centrales ont amélioré leur coordination et ont pris dès le début des initiatives communes en matière de taux, de rachat de papiers, de surveillance des banques.
Aussi, de manière positive, le G20 a préparé les conditions d’une sortie de crise.
Je me dissocierai néanmoins de certains de mes collègues, car je discerne trois sources d’inquiétude.

Monsieur le secrétaire d'État, je crains en effet que nous ne connaissions des prochains mois ou des prochaines années moins triomphants.
Premièrement, je partage l’avis du directeur général du FMI, M. Strauss-Kahn, selon lequel nous ne sommes pas allés assez loin dans le nettoyage des actifs bancaires.

Au sein même de cette assemblée, ma chère collègue, la question des bonus et des rémunérations des dirigeants de banques a plus fait l’objet de discussions que le problème fondamental des actifs, du hors-bilan et des risques qui pourraient se concrétiser au cours des prochains mois.

Hier, la commission des finances, dans le cadre des auditions de suivi sur la crise financière internationale et le dispositif de financement de l’économie française, a reçu le dirigeant d’une grande banque en constitution. Ce dernier nous a avoué l’existence d’un déficit de plus de 400 millions d’euros consécutif à des opérations risquées sur des produits inventés par M. Madoff, aux États-Unis. J’ai peur que l’on ne découvre, au cours des prochains mois et des prochaines années, qu’il subsiste quelques vices cachés et actifs toxiques.
Faut-il engager une procédure de défaisance ? Je ne le pense pas. Nous l’avions fait pour le Crédit lyonnais et nous n’en sommes toujours pas sortis.
Monsieur le secrétaire d’État, il est nécessaire de nettoyer les actifs des banques. Il faut, en utilisant tous les moyens administratifs et juridiques qui sont à notre disposition, obliger les banques françaises, et si possible européennes, à faire apparaître leurs actifs toxiques dans leur bilan. Nous ne l’avons pas fait, et cela risque de peser sur la sortie de crise.

Par ailleurs, je constate avec tristesse, et c’est ma deuxième inquiétude, que, lors du sommet du G20, les pays européens ne se sont pas comportés de manière suffisamment concertée.
Alors que la présidence française de l’Union avait permis de redynamiser l’Europe, de la relancer sur le plan tant politique que financier, lors du sommet du G20, les petits problèmes ont de nouveau émergé et la coordination n’a pas été suffisante s’agissant du niveau de la relance et des modalités de la régulation.
Je considère, contrairement à certains de mes collègues, que le traité de Lisbonne doit être approuvé rapidement. Il est en effet de nature à accroître la puissance de l’exécutif européen. Force est de reconnaître que, lors du G20, les pays de l’Union, notamment les membres de l’Eurogroupe, n’ont pas été suffisamment unis faute d’une coordination suffisante de leurs efforts de relance, de régulation et de maîtrise de la crise.
J’en viens à ma troisième inquiétude, qui concerne un point que personne n’a abordé ce matin, à l’exception peut-être de M. Jégou, à la fin de son intervention.
Les dirigeants chinois ont déclaré qu’ils ne pourraient pas continuer à l’infini à financer le déficit américain et qu’il faudrait bien, un jour, trouver une monnaie de réserve internationale autre que le dollar des États-Unis.
Connaissant la finesse de diagnostic des dirigeants financiers chinois, cette déclaration m’a beaucoup inquiété. Elle signifie en effet que, dans un délai indéterminé – quelques mois ou quelques années –, les rapports de change entre les grandes monnaies risquent de varier.
Or, monsieur le secrétaire d’État, tous les efforts que nous avons faits en matière de relance, de maîtrise du déficit budgétaire, de contrôle de l’augmentation de l’endettement risquent d’être réduits à néant si les rapports de change entre l’euro, le dollar, le yuan, la livre sterling et le yen évoluent de manière désordonnée au cours des prochaines années.
Depuis deux ou trois ans, les rapports de change entre les monnaies chinoise, américaine, japonaise et l’euro sont relativement stables. Le G20 n’a pas osé s’engager sur la voie de l’examen des rapports de change afin de déterminer des rapports sinon fixes – ne rêvons pas –, du moins mieux maîtrisés.

Voilà déjà bien longtemps, j’ai signé les accords de la Jamaïque sur le flottement des monnaies : nous n’y reviendrons pas !
Mes chers collègues, lorsque les indicateurs économiques repasseront au vert, si le rapport entre l’euro et le dollar est non plus de un euro pour 1, 30 dollar, mais de un euro pour 1, 50 ou 1, 60 dollar, nous ne pourrons plus exporter et nous éprouverons de grandes difficultés pour équilibrer nos comptes. Les variations des rapports de change risqueront de modifier de manière assez considérable nos perspectives de reprise.
Telles sont mes trois inquiétudes, que je me permets de synthétiser : premièrement, nous n’avons pas suffisamment nettoyé les actifs toxiques des banques ; deuxièmement, l’Europe, du fait du rejet du traité de Lisbonne par certains pays, n’a pas pu participer aux négociations avec toute la force et le dynamisme qui lui auraient été nécessaires ; troisièmement, les rapports de change risquent de nous être défavorables. Je crains que l’importance du plan de relance décidé par le président Obama ne se traduise assez rapidement par une baisse de la monnaie américaine. Nous connaissons la capacité des États-Unis à laisser baisser le dollar sans le défendre. J’ai peur que les relations entre les monnaies, que l’on n’a pas voulu traiter dans le cadre du G20 avec les pays émergents, lesquels sont aussi concernés que nous, ne pèsent sur nous comme une épée de Damoclès.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que le Gouvernement français prenne en compte ces préoccupations, à l’échelon tant national qu’international, dans la préparation du prochain G20 qui aura lieu en septembre. Il apaiserait ainsi mes inquiétudes. Je sais bien qu’il n’est pas habituel et qu’il est même parfois mal vu de ne pas s’exclamer devant le succès d’un G20 censé résoudre tous les problèmes !
L’expérience que j’ai acquise, les inquiétudes que je ressens, les nombreux problèmes qui n’ont pas été traités me conduisent à demander un effort de lucidité.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement doit, en liaison avec l’Allemagne et avec nos principaux partenaires commerciaux, préparer de manière précise et approfondie le G20 du mois de septembre prochain, qui devrait marquer de nouveaux progrès dans la sortie de crise.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialistes.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le fait d’être le dernier orateur inscrit dans ce débat me permettra de revenir sur certains des points qui ont été évoqués.
Je me réjouis de constater que notre hémicycle se peuple un peu, car il est bien triste qu’un débat d’une telle importance se déroule non pas à huis clos, mais devant un auditoire réduit.

Monsieur le secrétaire d’État, le G20 a sans doute été un grand succès en termes de diplomatie et de politique économique. Il a donné un sens au concept de multilatéralisme. Il a montré que nous allons vers un rééquilibrage, qu’il y a non plus une omnipuissance mondiale, mais une foultitude de partenaires. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le nombre des pays et des grandes organisations internationales qui étaient invités. Sans doute faudra-t-il quelque peu institutionnaliser le G20, en veillant toutefois à ne pas sombrer dans le bureaucratisme.
Comme cela a déjà été souligné, la grande absente de ce sommet fut, de sa propre faute, l’Union européenne. Le cœur de tous les vrais Européens a saigné en voyant l’Europe céder la deuxième place à la Chine.
Certes, la Commission manque d’allant, joue petit bras. Certes, le président Barroso traîne un peu la patte. Mais ce n’est pas la seule explication. Cette situation relève aussi du comportement des différents États qui, tels l’Allemagne et la France, ne parviennent pas à s’entendre. Quant au Royaume-Uni, il reste fidèle à lui-même.
En fait, nous nous agitons. Nous sautons sur notre chaise en demandant une politique coordonnée. Mais rien ne se passe !
Sourires

Il est bien sûr difficile de définir une action commune, car les problèmes de chaque pays sont différents : les importations et la dévaluation compétitive pour l’Allemagne, le marché intérieur, la consommation et la faiblesse de l’appareil de production pour la France, une bulle immobilière gigantesque qui explose pour l’Espagne. Quant à l’Angleterre… c’est l’Angleterre !
Une politique unique ne peut certes pas remédier à des situations aussi diverses. Néanmoins, les États auraient dû coordonner leur action. Il est bien triste de constater que tel ne fut pas le cas.
J’en viens au système bancaire. Le problème des actifs toxiques reste entier. On n’a nettoyé ni le système bancaire mondial, ni le système bancaire américain, ni le système bancaire anglais, même si c’est sans doute dans ce pays que l’on a fait le plus.

De la même façon que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté à nos frontières, tous les pays ont des actifs toxiques, sauf la France ! C’est merveilleux ! Notre système bancaire ne détient pas d’actifs toxiques !

Tout le monde sait bien que tel n’est pas le cas. Du simple fait de la titrisation, outil diabolique, chaque fois que vous achetez des actions, vous acquérez 10 % ou 15 % d’actifs toxiques. En fait, vous ne savez pas exactement ce que vous achetez. Rappelez-vous l’expression de Warren Buffett : « Si je ne comprends pas, je n’achète pas ! »

Certes, mais il possède tout de même la deuxième fortune mondiale. En tout état de cause, je souscris à ce principe.
Monsieur le secrétaire d’État, la question est de savoir ce que veut faire la France.
En Allemagne, Mme Merkel a institué un double système de structure de défaisance : le premier s’applique aux banques privées qui s’organisent en consortium et sera probablement assorti d’une garantie de l’État ; le second vise les banques des Länder et ne fera pas l’objet d’une garantie de l’État. Ces banques devront donc réaliser leur consortium et prendre leurs responsabilités.
J’admets volontiers qu’un tel modèle n’est pas transposable à la France. Mais c’est un exemple, et je demande au Gouvernement ce qu’il envisage pour nettoyer le système bancaire français.
Il faut, me semble-t-il, redescendre sur terre et revenir à des choses simples. Une banque commerciale a vocation non pas à spéculer, mais à recueillir des dépôts, à les rémunérer au taux normal du marché et à les transformer en prêts à l’économie.
Il est extraordinaire qu’une banque comme Dexia, issue de la fusion du Crédit local de France et du Crédit communal de Belgique, banque de père de famille qui finance les travaux d’assainissement ou d’électricité des communes, se retrouve avec 800 millions d’euros investis dans je ne sais quels produits spéculatifs : les bras m’en tombent !

Les banquiers sont devenus fous ! Il faut revenir à des choses simples.

Privatiser ! Nationaliser ! Ne s’agit-il pas de concepts d’un autre temps ?
Afin d’approfondir la réflexion, permettez-moi de me référer à l’audition, hier, de M. François Pérol, président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, par la commission des finances, dans le cadre des auditions de suivi sur la crise financière internationale et le dispositif de financement de l’économie française.
Je me suis permis de rappeler que, parmi les actifs les plus douteux de Natixis, figurent pour une bonne part ceux qui avaient été acquis par la Caisse des dépôts et consignations. Je précise d’ailleurs, pour déterminer les responsabilités, que les choses se sont passées avant 2002 : un établissement public totalement sous la main de l’État s’est engagé aux États- Unis pour des montants à haut risque sur des marchés spécifiquement américains !
La possession par l’État n’est pas une vertu en soi. Ce n’est pas le paravent indispensable pour éviter de faire des erreurs et de prendre des risques. Ne l’oublions pas ! D’ailleurs, les banques nationales, gérées par l’État sous le contrôle direct de fonctionnaires, qui ont pris des risques très importants et ont fait de graves erreurs, sont légion…

C’est beaucoup plus compliqué que cela !
Je me permets simplement d’instiller ce doute dans vos esprits pour que vous acceptiez de considérer que la situation n’est pas aussi simple, et qu’il n’y a pas une dichotomie aussi manifeste entre l’ombre et la lumière.

Mon propos ne portait pas sur la question de la propriété publique ou privée.
Simplement, il ne faut pas tout confondre ! Si l’on veut spéculer, il existe pour cela des structures spécifiques permettant de mesurer le degré de risque que l’on prend, contrairement à ce qui se passe dans d’autres banques, notamment commerciales, dont ce n’est pas la fonction.

Je me limiterai à faire deux autres remarques, compte tenu de mon temps de parole.
Tout d’abord, à l’instar des précédents orateurs, je suis très heureux du renforcement des moyens du FMI, qui est une excellente mesure. Cela dit, il convient dans le même temps de poser le problème des conditions d’octroi des aides du FMI aux gouvernements en difficulté. Par le passé, cela a entraîné beaucoup de problèmes et de malheur, en particulier en Afrique. Le FMI doit avoir une approche souple et ouverte ; c’est le cas maintenant, me semble-t-il, mais il convient de souligner cette nécessité.
Par ailleurs, j’interrogerai le Gouvernement sur les paradis fiscaux. On en a beaucoup parlé, et la liste noire a mystérieusement disparu.

Oui, mais n’y figurent plus que de tout petits poissons, ceux qui ne peuvent pas se défendre ! Les gros n’y sont pas !
Un mandat de négociation a été prévu à l’article 24 des anciens accords du GATT, ou accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Monsieur le secrétaire d’État, ma question est la suivante : comment envisagez-vous la négociation avec les pays qui étaient inscrits sur la liste noire et qui figurent maintenant sur la liste grise ? Je suppose que, après avoir été rayés de la liste, ils partent en courant…
Pour conclure, j’évoquerai la sortie de crise, sujet qui a été abordé par le précédent orateur. Nous espérons tous, bien évidemment, que la crise s’achèvera le plus rapidement possible, car les coûts induits sont gigantesques. Nous ne pouvons même pas concevoir les chiffres en jeu, tellement ils dépassent l’entendement ! Lorsque la croissance reviendra et que les économies seront de nouveau stabilisées, il faudra faire face à tout cela. De quelle manière ? Aurons-nous la force, comme je le souhaite, d’être vertueux ? La tentation de la dévaluation, des jeux de parité, avec, comme corollaire, l’inflation, ce mal terrible qui tue tout le monde, est bien là ! C’est la solution la plus attrayante, car personne ne sent rien. Mais elle est mortelle !
Telles sont, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les réflexions que je voulais vous soumettre. Je n’ai pas de réponse immédiate, mais nous devons à mon avis y penser dès maintenant.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. –MM. Jean-Pierre Chevènement, Jean-Jacques Jégou et Jean-Pierre Fourcade applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de participer aujourd’hui avec vous à cet exercice d’un genre nouveau, puisque le Président de la République a proposé une réforme de la Constitution que vous avez adoptée : une plus grande initiative a été confiée aux élus, renforçant ainsi les pouvoirs du Parlement. Ce débat est l’une des concrétisations de cette volonté.
L’échange que nous avons aujourd’hui est aussi l’occasion de saluer le travail remarquable effectué par le groupe de travail parlementaire sur la crise financière internationale. Je tiens à saluer son coprésident et l’ensemble de ses membres.
Indiscutablement, les conclusions du G20 démontrent rétrospectivement à quel point vous étiez dans le vrai, puisqu’une bonne partie des recommandations que vous aviez formulées a été reprise dans le communiqué final du sommet.
Vous me permettrez également de vous prier d’excuser Christine Lagarde, qui a été retenue ce matin et m’a demandé de la remplacer. Je voudrais vous remercier des propos que vous avez tenus tout à l’heure à son égard. Effectivement, depuis le début de la crise, elle a souhaité à tout moment faire preuve d’une totale transparence vis-à-vis du Parlement, en particulier du Sénat, pour vous tenir informés de l’évolution des négociations internationales sur la crise financière.
M. Albéric de Montgolfier acquiesce.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce G20 a marqué une étape historique du fait même de son existence, et vous avez été plusieurs, sur ces travées, à le rappeler dans vos propos.
En effet, pour la première fois, les vingt pays les plus importants de la planète, représentant 85 % de la population mondiale, étaient rassemblés dans un même lieu. Il convient de s’attarder sur ce point pour méditer les progrès que le monde a réalisés en quelques années. Songeons que, voilà vingt ans seulement, deux blocs s’affrontaient encore, scindant le monde en deux. Voilà vingt ans, la Chine jouait sa partition en dehors du concert des nations. Voilà vingt ans, l’Inde était plus source de désespoir que d’espérance en matière économique, avec une démographie galopante et une pauvreté qui semblait absolument endémique.
Le G20 a été une bonne nouvelle pour la démocratie. Il a marqué la primauté du politique face à l’économique. Et le retour du politique, c’est le retour du pouvoir légitime, c’est-à-dire celui qui est exercé par le peuple.
On peut noter avec satisfaction que, pour l’instant, cette crise, si violente soit-elle sur le plan économique mais aussi sur le plan social, n’a pas eu, sur le plan politique, les effets dévastateurs qu’avait eus la crise des années trente. Jusqu’à présent, aucun régime démocratique n’a été mis à bas par la crise.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le G20 a été une réunion historique par son contenu. Les pays présents ont su dégager des consensus forts sur quelques grands principes : tout d’abord, la réaffirmation de l’économie de marché comme seul système économique viable ; ensuite, la nécessité de mieux réguler l’économie financière, son corollaire, grâce à une approche internationale, collaborative et multilatérale ; enfin, le refus du protectionnisme, qui se traduira, pour résoudre la crise, par une plus grande solidarité et le rejet des égoïsmes nationaux.
La tenue du G20 démontre une véritable inflexion idéologique de certains pays. L’intervention des États n’est aujourd’hui plus taboue. Elle a d’ailleurs été massive depuis le début de la crise. À ce propos, je voudrais souligner que le directeur du Fonds monétaire international, M. Strauss-Kahn, rappelait récemment l’effort budgétaire, en 2009, des différents pays en matière de relance, indiquant qu’il était assez homogène selon les pays : aux alentours de 2 % du produit intérieur brut. Je rappelle que, pour la France, cet effort s’approchera de 2, 4 % du PIB en 2009.
Le G20 a aussi marqué le retour de l’Europe sur la scène politique internationale. Il faut se souvenir que le premier G20 organisé à Washington est né d’une initiative de notre Président de la République, alors président de l’Union européenne, à la suite de son discours aux Nations unies. L’Europe a, depuis, apporté un soutien constant à la démarche multilatérale et coopérative qui avait été prônée par la France.
Le dernier G20, à Londres, a été l’occasion de réaffirmer l’importance de l’axe franco-allemand. Christine Lagarde a travaillé en amont avec son homologue allemand, M. Steinbrück. Un certain nombre de propositions fortes ont été officialisées lors du conseil des ministres franco-allemand du 12 mars et soutenues par les membres de l’Union européenne le 2 avril, à Londres.
Le communiqué final du G20 a repris une grande partie de ces propositions. Ces dernières sont d’ailleurs, et l’on ne peut que s’en féliciter, extrêmement proches de celles qui ont été formulées par votre groupe de travail Assemblée nationale-Sénat sur la crise financière internationale, en matière tant de régulation que de redéfinition du rôle des institutions internationales chargées d’exercer cette régulation.
Les pays présents ont défini les modalités de refonte de la régulation du secteur financier, et le renforcement de cette régulation a fait l’objet d’une déclaration spécifique de près de six pages, avec un véritable plan d’action.
D’abord, la régulation nouvelle s’appuiera sur le contrôle de tous les acteurs : les territoires, les établissements financiers, les agences de notation, et même les particuliers. Il ne pourra plus y avoir de trou noir ou d’exception, comme c’était le cas jusqu’à présent.
En ce qui concerne le contrôle des territoires, on le sait, les centres non coopératifs en matière fiscale, les fameux paradis fiscaux, abritent deux tiers des fonds spéculatifs. Nous avons pu, au G20, obtenir que l’OCDE publie des listes, et ces dernières ont déjà produit leurs effets, puisque les quatre pays de la liste noire – le Costa-Rica, la Malaisie, les Philippines et l’Uruguay – se sont engagés à respecter les conventions internationales, ce qui les a donc fait passer de facto en liste grise, celle des pays ayant pris des engagements mais ne les respectant pas pleinement aujourd’hui. Ce sont ces pays que la communauté internationale doit aujourd’hui surveiller et accompagner dans leurs efforts.
La régulation nouvelle s’appuiera ensuite sur le contrôle des hedge funds, qui représentent 1 200 milliards de dollars de placements et, certains jours, plus de 50 % des volumes de transactions sur les marchés. À l’heure où les États sont appelés en soutien des banques, nous devons nous assurer que, demain, ces dernières ne seront pas fragilisées par des acteurs comptant parmi leurs plus importants clients et sur lesquels les autorités n’ont aujourd’hui aucune information. C’est pourquoi le G20 a décidé d’imposer une régulation spécifique : immatriculation obligatoire, transparence dans la gestion et contrôle des engagements des banques.
Est également prévu le contrôle des agences de notation, qui ont une lourde part de responsabilité dans cette crise, indiscutablement celle de la mauvaise appréciation des risques. Ces agences seront dorénavant enregistrées, et un code de bonne conduite permettra d’éviter les conflits d’intérêts. Elles devront mettre en place des notations différenciées, car il est impossible de noter de la même manière des entreprises, des États et des produits structurés.
Enfin, la régulation reposera aussi sur le contrôle des particuliers. Cette crise, c’est aussi celle de politiques de rémunérations qui ont failli. Ces politiques participent à la gouvernance économique. Quand la rémunération de traders ne dépend pas de la rentabilité finale des opérations qu’ils concluent, tout est réuni pour que des opérations qui n’auraient jamais dû voir le jour soient nouées. Cette question est centrale, et le G20 a fixé des principes forts pour que le versement des bonus soit directement lié à la performance réelle des transactions.
Notre défi, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est de mettre en place des dispositifs de coopération internationale entre superviseurs, qui permettent d’avoir une vision consolidée et de contrôler les groupes financiers internationaux ayant une importance systémique. Nous avons confié cette mission au forum de stabilité financière.
Cependant, ce G20 a également permis de consacrer un nouveau rôle pour les institutions financières internationales, au premier rang desquelles le FMI, qui doit jouer un double rôle, celui de suivi des risques financiers et celui de soutien aux pays émergents et en développement affectés par la crise.
Nous attendons du FMI qu’il joue un véritable rôle d’alerte précoce sur les risques financiers et sur les déséquilibres macroéconomiques. Il devra le faire en lien avec le nouveau Conseil de stabilité financière, sorte d’organisation mondiale de la finance, qui prend la place du forum de stabilité financière, dont le mandat est élargi.
Dès le mois d’avril, ces deux organisations vont présenter deux fois par an une carte des risques financiers, économiques et mondiaux. Avec le rôle d’alerte précoce confié au FMI et la constitution du Financial stability board, la communauté internationale dispose enfin d’une véritable capacité de contrôle de ces risques.
Les institutions seront plus fortes, mais elles seront aussi plus inclusives. Le nouveau forum de stabilité financière est en effet élargi aux membres du G20 ainsi qu’à l’Espagne et à la Commission européenne ; le FMI devrait, quant à lui, s’engager dans une revue des quotes-parts des États à son capital.
Enfin, le G20 a consacré des avancées certaines pour réformer les normes comptables et prudentielles, même si – je dois le reconnaître – nous aurions voulu aller encore plus loin.
La déclaration est claire sur la nécessité de revoir les principes comptables lorsque les références de marchés n’ont pas de sens et pour les placements à long terme.
Elle prévoit également l’adoption du principe du provisionnement dynamique, qui consiste à constituer des réserves de fonds propres en période de croissance pour ne pas avoir à durcir les exigences de fonds propres en bas de cycle, lorsqu’il est nécessaire de disposer de crédits pour l’économie.
Quels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les enseignements de cette crise et de ces mesures prises par le G20 pour la place financière de Paris ? Objectivement, la France – vous avez été nombreux, au sein du groupe de travail, à le souligner, comme Mme Christine Lagarde l’a d’ailleurs fait à plusieurs reprises – a bien résisté, ce qui prouve l’efficacité d’un cadre de supervision tout à la fois souple et rigoureux.
La France a globalement, sur le plan financier, bien résisté à la crise : d’une part, les banques françaises sont solides et saines ; elles détenaient des montants très limités d’actifs toxiques ; d’autre part, le modèle de la banque universelle et de dépôt qui est celui des banques françaises s’est, à notre sens, révélé être le bon pour traverser la crise actuelle. Le marché immobilier, en comparaison de celui d’autres pays, est sain et ne constitue pas un facteur de risques aggravés.
Cette solidité s’explique également par la qualité de la régulation et du contrôle bancaire et assurantiel français, qui, lui aussi, a bien fonctionné.
Cette solidité a, de surcroît, été renforcée par une intervention des pouvoirs publics sous la forme de dispositifs simples d’octroi de garanties, et de dispositifs ciblés de consolidation de fonds propres.
Ceux d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui sont rompus à l’exercice des négociations internationales pourront reconnaître avec moi le caractère inédit de ce G20, par sa forme, bien sûr, mais aussi et surtout par les décisions qui en ont découlé. Rarement les sommets internationaux aboutissent aussi vite et aussi clairement à des décisions concrètes. Les pays réunis ont dépassé les grandes déclarations de principe, pour donner des gages de leur volonté réelle de réformer le système financier international.
S’il est vrai qu’à quelque chose malheur est bon, la crise aura été l’occasion de repenser en profondeur un système qui, par ses iniquités et son manque de régulation, a mené l’économie mondiale au bord du gouffre.
Ma conviction est que cette crise et les leçons que nous en tirons doivent nous permettre de réorienter nos économies fortement et, je l’espère, pour longtemps, vers un modèle capitalistique plus entrepreneurial, plus respectueux des équilibres de long terme, plus juste et, finalement, plus efficace.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Mes chers collègues, nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané.
Chaque sénateur peut intervenir pour deux minutes au maximum. Les membres du groupe de travail ou le Gouvernement, s’ils sont sollicités, pourront répondre.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Monsieur le secrétaire d’État, M. Richard Yung et moi-même avons évoqué tout à l’heure, dans nos interventions, le problème des actifs toxiques.
Sans trahir de secret, je puis indiquer que le Président de la République, lorsqu’il a reçu le groupe de travail, a envisagé la possibilité, à l’échelle nationale, de résoudre ce problème en se référant à la proposition de Mme Angela Merkel : un consortium privé des banques et établissements qui mutualiserait les actifs. L’État apporterait-il sa garantie ? Nous avons posé la question.
Le sujet est capital. Je suis en effet convaincue que, comme M. Dominique Strauss-Kahn l’a dit et répété, le système bancaire et celui du crédit resteront paralysés tant que le problème des actifs toxiques n’aura pas été réglé.
Je l’ai dit voilà un instant, il n’existe pas un seul exemple d’une crise financière qui se serait achevée sans qu’il ait été procédé à un tel nettoyage. M. Fourcade a insisté à juste titre sur ce point : cette préoccupation est partagée par nous tous ici, quel que soit le banc sur lequel nous siégions.
Cette proposition du Président de la République a-t-elle déjà été évaluée par les services compétents du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et, par conséquent, figurera-t-elle au programme des négociations intra-européennes ? Si tel n’était pas le cas – M. Fourcade a parfaitement raison –, la sortie de la crise risquerait de se faire attendre : au Japon, où ce travail n’a pas été réalisé, les choses ont traîné pendant dix ans.
Cette question n’est certes pas la seule qui mérite d’être posée, mais elle est malgré tout d’importance, à l’heure actuelle.
Madame le sénateur, nous estimons que si l’instrument des bad banks peut être utile en certaines circonstances, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n’est pas forcément adapté à la situation des banques françaises.
Un débat a lieu – vous l’avez indiqué –, mais les banques françaises sont, dans leur ensemble, plutôt bien capitalisées et disposent de marges de manœuvre pour absorber d’éventuelles nouvelles dépréciations d’actifs.
Dès lors, l’instrument d’une bad bank, quiconduirait à mettre en place un nouveau dispositif de garanties en faveur des banques, ne nous semble pas d’actualité.
L’éventualité évoquée par le Président de la République était l’examen d’un système mutualisé que pourrait mettre en place le système bancaire, mais non l’instauration d’un système de bad banks.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, y a deux oubliés dans le débat sur le G20 et dans les conclusions provisoires du sommet de Londres.
Ces oubliés, ce sont, d’une part, les salariés des entreprises des pays développés, …

… notamment ceux de l’Europe, plus particulièrement de la France, qui sont aujourd’hui transformés en variable d’ajustement pour permettre à quelques entreprises de se refaire une santé sur le plan financier.
D’ailleurs, Carlos Ghosn déclarait, dans le Financial Times du 14 avril dernier, que la crise était l’occasion de faire passer des réformes dans l’entreprise et de faire des choses qui n’auraient pu être réalisées voilà quelques années. Il citait, à l’appui de ce propos, la réduction du temps de travail et la baisse des salaires, auparavant impossibles.
Les plans sociaux en œuvre dans de nombreuses entreprises sont la manifestation de cette situation.
Monsieur le secrétaire d’État, en réponse aux différents intervenants, vous avez parlé de solidarité. Mais les oubliés, ce sont, d’autre part, les pays du Sud et leurs peuples.
Dans Le Monde Economie, daté du mardi 28 avril dernier, il est indiqué que « la crise frappe encore plus violemment les pays pauvres », puisque, « en 2009, 55 à 90 millions de personnes tomberont dans l’extrême pauvreté, surtout en Afrique et en Asie du Sud ».
Les 100 milliards de dollars de pertes d’AIG représentent une somme considérable, mais cela ne doit pas nous faire oublier que le dixième de cette somme, chaque année, pourrait permettre aux peuples du Sud de bénéficier de l’accès à l’eau potable.
Ma question sera très simple : quel rôle entend jouer la France, dans le cadre des instances internationales adaptées – la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, ou CNUCED, notamment – pour faire valoir, en vue de sortir de la grave crise économique, sociale et sanitaire qui frappe aujourd’hui la planète, des choix permettant de répondre aux attentes légitimes des peuples du Sud ?
Quelles initiatives souhaitons-nous promouvoir au niveau de l’Union européenne, loin du rejet de l’immigration économique et du pillage des ressources naturelles auxquels on assiste aujourd’hui, pour aller vers la définition de politiques partenariales mutuellement avantageuses ?
Enfin, quelle appréciation portons-nous sur l’émergence d’alternatives à la domination du dollar comme monnaie commerciale internationale ? Disant cela, je songe à l’initiative sud-américaine autour de la création du Sucre, le système unitaire de compensation régionale.
Monsieur le sénateur, les premières victimes de cette crise d’une violence inouïe sont bien entendu les salariés, qui ont à subir restructurations industrielles, fermetures d’usines et suppressions de postes.
Toute la politique que mène actuellement le Gouvernement a pour objet à la fois de préserver notre outil industriel, c’est-à-dire de conserver une compétence technique et économique dont nous aurons besoin dans les années qui viennent, et de sauvegarder le capital humain. C’est la raison pour laquelle il a pris des mesures sans précédent visant à maintenir le lien entre l’entreprise et le salarié.
Les dispositifs d’accompagnement financier, qui permettent aux entreprises de traverser cette période de grande difficulté, et les dispositifs de chômage partiel sont liés et ont précisément tous pour objet d’amortir le choc, avec des contingents d’heures de chômage partiel, et de préserver le lien entre l’entreprise et le salarié.
La disposition qui consiste à revaloriser l’indemnisation pour le chômage partiel en la portant à 90 % du salaire précédent est elle aussi une réponse.

À Sandouville, certains salariés sont contraints de travailler plus d’heures tandis que d’autres sont mis au chômage !
Monsieur le sénateur, vous n’ignorez pas que la crise actuelle est d’une violence inouïe et sans précédent. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement tente, à chaque fois que cela est possible, de maintenir le lien entre le salarié et l’entreprise.
La disposition visant à augmenter le contingent des heures de chômage partiel pour les secteurs les plus frappés par la crise en faisant passer à 90 % le montant de l’indemnisation pour le chômage partiel et en augmentant la part de l’État dans l’indemnisation afin que les entreprises voient leur charge allégée et puissent ainsi traverser cette période de grande difficulté me semble être adaptée et constituer un réel geste de solidarité.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, il convient de rappeler les mesures de solidarité que le Gouvernement vient de mettre en œuvre.
Ainsi, les 4 millions de ménages les plus modestes qui bénéficieront, à partir du 1er juillet prochain, du revenu de solidarité active, ont perçu, ce mois-ci, une prime de solidarité active.
Les contribuables relevant de la tranche la plus basse d’impôt sur le revenu n’ont pas été oubliés. Il s’agit de l’ensemble des classes moyennes, celles qui travaillent, celles à qui on demande volontiers de payer des impôts sans qu’elles bénéficient forcément de la redistribution des richesses. Le mois prochain, elles verront leur deuxième tiers provisionnel supprimé et n’auront pas non plus à payer le troisième. Voilà un vrai geste de solidarité !
J’en viens maintenant à la deuxième partie de votre question, qui porte sur la situation des pays du Sud.
Dans ce domaine, la France, par la voix du Président de la République, a exprimé, et ce depuis le début, sa volonté d’associer au maximum les pays dits « émergents ». C’est ce qui a conduit au sommet du G20 du 2 avril dernier, sommet dont la composition a fait l’objet d’âpres négociations entre les parties prenantes, notamment la France, les États-Unis et les autres pays de l’Union européenne. Je l’ai indiqué tout à l’heure, 85 % de la population mondiale était représentée au G20. Y siégeaient en particulier le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.
Le G20 a décidé d’augmenter les ressources du FMI, ce qui profitera aux pays émergents et aux pays pauvres. Mme Lagarde s’est rendue à Ouagadougou il y a quelques jours pour évoquer ce sujet avec les représentants de la « zone franc » et les assurer du soutien de la France en la matière. Ils ont ensemble lancé un appel aux institutions financières internationales pour les sensibiliser à la nécessaire prise en compte de la situation des pays les plus pauvres d’Afrique. Ce message, c’est celui de la France, et nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, devant le G20, le FMI et la Banque mondiale.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte justement sur les moyens qui seront octroyés au FMI, moyens que les États membres du G20 se sont engagés à tripler.
Quelle est, à ce stade, la nature de l’engagement de la France ? A-t-elle signé une lettre d’engagement, et, si oui, pour quel montant ? S’agit-il d’un engagement de nature budgétaire, auquel cas le Parlement devra en décider, ou est-ce simplement un engagement de trésorerie de la part de la Banque de France ?
Monsieur de Montgolfier, à la suite de la décision de renforcer les ressources du FMI, le Conseil européen, qui s’est tenu au mois de mars dernier, s’est effectivement engagé à soutenir cette institution à hauteur de 75 milliards d’euros.
À Washington, le 22 avril dernier, Mme Lagarde a ainsi signé avec M. Strauss-Kahn, le directeur du FMI, une lettre d’intention qui prévoit une contribution de 15 milliards de dollars de la France à cet effort. Nous avons également décidé de mobiliser un milliard de dollars supplémentaire pour renforcer les moyens d’action de ce fonds vers les pays les plus pauvres, que je viens d’évoquer, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.
Ces opérations sont de nature monétaire et se traduisent par la mise en place d’une ligne de crédits à la Banque de France au bénéfice du FMI : celle-ci ne sera tirée qu’en fonction des besoins et n’aura donc aucun impact sur le plan budgétaire.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez souligné les avancées obtenues lors du G20 de Londres, et je voudrais revenir sur deux points, certes d’importances diverses, mais qui me paraissent tout de même essentiels.
Premièrement, n’est-il pas caricatural de se féliciter de la fin des quatre paradis fiscaux que vous avez cités, sachant que peu de gens, même les plus avertis, connaissaient leur véritable situation ? D’ailleurs, les vrais paradis fiscaux, eux, n’ont pas été inquiétés, à l’image de la place de Londres, pourtant notoirement connue en la matière, ou des îles anglo-normandes et d’autres pays européens intracommunautaires.
Derrière cette satisfaction de façade, ne convient-il donc pas d’agir plus sérieusement ?
Deuxièmement, comme vous l’avez vous-même reconnu dans votre intervention, le système comptable IFRS, l’International financial reporting standards, a montré ses limites, et les Anglo-Saxons, qui l’ont défendu, se sont retrouvés dans la situation de l’arroseur arrosé !
En tout état de cause, l’absence de reprise des relations interbancaires continue de geler la situation et de creuser encore plus cette crise financière, qui a plongé l’économie mondiale dans la récession. Pour prolonger ce que vous avez vous-même esquissé, ne faut-il pas prévoir des dérogations à l’IFRS et apporter des modifications au système, en prenant des mesures à la fois circonstancielles et plus profondes ?
Monsieur Jégou, reconnaissez-le, le G20 a objectivement permis des progrès considérables concernant les paradis fiscaux, sans commune mesure avec ce qui avait pu être fait par le passé.
C’en est fini du secret bancaire. Toutefois, vous avez indiscutablement raison, il importe de concrétiser ces engagements positifs, et c’est le G20 qui sera chargé d’en assurer le suivi.
Au niveau français, nous allons demander aux pays de la liste grise d’engager des négociations pour se mettre en conformité avec les conventions fiscales et les standards de l’OCDE. Quant aux îles anglo-normandes, elles ont signé une convention en la matière.
À propos des normes comptables, ensuite, un certain nombre d’orateurs sur plusieurs travées se sont en effet demandés si nous étions allés assez loin sur cette question.
Il convient avant tout de rappeler que, voilà un an, nous étions très isolés sur ce sujet. Depuis, nous avons pu obtenir des avancées au niveau européen, avec la possibilité de changer de méthode de valorisation des actifs détenus jusqu’à leur maturité et éviter ainsi l’utilisation de la valeur de marché.
Il s’agit vraiment d’un point important.
Autre avancée, lors du dernier conseil Écofin de Prague, la présidence a appelé l’IASB, l’International accounting standards board, à prendre en compte l’impact de la crise financière sur l’application des normes comptables et a menacé de réviser le règlement de 2002 qui confie à cet organisme la tâche de produire les normes applicables en Europe.

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais évoquer le sort de nos industries dans cette crise, question très sensible que vous connaissez bien. À partir du moment où il existe des écarts de salaires de un à huit en Europe et de un à vingt à l’échelle internationale, notamment dans les pays de l’Asie de l’Est, quel peut être l’avenir de l’industrie automobile, qui est au cœur de notre secteur industriel ? Y a-t-il des moyens permettant de la sauvegarder ?
Le Président de la République a dit, à Vesoul, avoir découvert avec effroi que cette activité était devenue déficitaire. Elle était excédentaire en 2006. Au début de la décennie, la France produisait 3 millions d’automobiles, contre un peu plus de 2 millions aujourd’hui.
Pour nous tous, notamment pour le titulaire du portefeuille de l’industrie que vous êtes, il est donc raisonnable de se poser la question de la protection de notre industrie automobile, surtout dans la perspective d’un affaissement du dollar, que M. Fourcade a évoquée tout à l’heure. Il nous faut y faire face, même si, pour le moment, la concurrence est plus intraeuropéenne qu’asiatique.

Néanmoins, la concurrence avec l’Asie et l’Amérique est une réalité. Par conséquent, je souhaite connaître les moyens que vous allez utiliser.
Monsieur le secrétaire d’État, le fonds de modernisation des équipementiers automobiles sera alimenté, à hauteur de 200 millions d’euros, par l’État au travers du fonds stratégique d’investissement, ainsi que par Peugeot et Renault pour un montant équivalent. Cela sera-t-il suffisant ou envisagez-vous des moyens supplémentaires ?
Que vont devenir les entreprises qui souffrent ? Dans ma région, pour Rencast, Sonas, Wagon et Trevest, trouver des repreneurs potentiels n’a rien d’évident. Les grands groupes tels que Peugeot seront-ils sensibilisés à la nécessité de maintenir le tissu productif ? Quelles mesures allez-vous prendre, notamment dans le cadre de la taxe carbone, pour assurer à nos industries une nécessaire protection ?
Monsieur le secrétaire d’État, ne pas répondre à toutes ces questions signifierait que le Gouvernement se résout à voir l’industrie automobile péricliter, ce qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions sur d’autres secteurs et toucherait, par exemple, nombre d’entreprises dans la sidérurgie, l’électronique, le caoutchouc ou le pneu.

C’est véritablement une question stratégique, que vous devez vous poser ! À cet égard, de quelle batterie de moyens disposez-vous ?
Lorsque l’on entend les déclarations formulées dans le cadre du sommet de Londres, reprises d’ailleurs au niveau de la Commission européenne, dont l’état d’esprit ultralibéral et dogmatique n’est plus à démontrer, on se dit que nous ne sommes pas défendus ! Telle est en effet la réalité : Bruxelles ne nous défend pas ! Nous sommes donc pieds et poings liés, sans aucune possibilité de préserver ce qui constitue le cœur de notre industrie !
Monsieur Chevènement, nous croyons à l’avenir de l’industrie automobile en France, mais à plusieurs conditions. C’est l’objet du pacte automobile, qui a été présenté à l’Élysée par le Président de la République le 9 février dernier.
L’urgence de la situation commandait de répondre à la gravité de la crise traversée par ce secteur industriel, qui, parce qu’il a d’importants besoins de financement en matière de trésorerie et d’investissement, a été le premier à être victime de la violence de la crise financière.
Il fallait donc répondre à cette urgence, et c’est ce que nous avons fait. Cela nous a permis de constater que la crise frappant l’industrie automobile est beaucoup plus structurelle : problèmes de compétitivité, d’adaptation de l’offre à la demande des consommateurs, prise en compte de l’évolution en matière environnementale ; en définitive, c’est l’ensemble du modèle économique qu’il faut repenser avec les industriels.
À cet égard, le pacte automobile a l’intérêt d’être « multi-leviers », en prévoyant à la fois des mesures de court terme et de long terme, beaucoup plus structurelles. D’un côté, nous mobilisons des moyens financiers pour aider les constructeurs qui n’arrivent plus à se financer sur les marchés, pour débloquer, via OSEO, des liquidités en faveur des sous-traitants qui ont besoin de lignes de trésorerie, pour encourager le chômage partiel et éviter les licenciements dans ce secteur. De l’autre, nous prenons des mesures structurelles non seulement pour gagner en compétitivité, au travers de la suppression de la taxe professionnelle, …
…mais aussi pour améliorer la gestion de la production, par la promotion du lean management et du lean manufacturing. Si l’industrie automobile française n’est pas suffisamment performante, c’est aussi parce qu’il y a des gains de productivité à réaliser dans l’organisation de la production. Nous y consacrons donc des moyens considérables. En outre, nous entendons développer les dispositifs innovants pour l’avenir tels que le véhicule « décarboné », le moteur propre et le véhicule électrique.
Nous avons, pour ce faire, débloqué des moyens et nous allons organiser tout cela autour de consortiums, car il faut une solution française pour le véhicule du futur.
Enfin, monsieur le sénateur, vous évoquez les restructurations industrielles dans votre région, où, c’est vrai, un certain nombre d’entreprises souffrent. J’étais d’ailleurs à Besançon, voilà quelques jours, pour installer le commissaire à la réindustrialisation, puisque le Président de la République a souhaité la présence d’un relais des services de l’État pour coordonner l’action de ces derniers dans chaque région qui souffre sur le plan industriel.
Le rôle de ce relais est à la fois d’anticiper, quand cela est encore possible, en travaillant avec le Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, afin d’éviter des licenciements et des fermetures d’usines, et d’étudier les possibilités de reprises.
Je vous citerai un chiffre, monsieur le sénateur : depuis le début de la crise, ce travail a permis de sauvegarder 22 000 emplois en France. S’agissant des cas précis que vous avez évoqués, nous étudions toutes les hypothèses de reprises potentielles. Nous essayons de le faire dans la discrétion, car c’est souvent un gage de réussite dans ce type de dossiers.
Lorsque cette démarche d’anticipation n’a pas permis d’obtenir des résultats positifs, il existe des mesures d’accompagnement social. En France, on ne ferme pas une usine en quinze jours ! Des lois d’accompagnement social permettent de protéger les droits des salariés, et le rôle de l’État est de veiller à la mise en œuvre correcte de ces mesures.
Le dernier volet que je souhaite évoquer concerne au premier chef votre région, qui est la première région industrielle de France : il s’agit de la revitalisation, de la réindustrialisation. Lorsqu’une usine ferme ses portes dans des régions aussi industrielles que la vôtre, c’est un drame humain et économique. Il convient donc, ultérieurement, de réindustrialiser ces régions. Ce sera également le rôle de ces commissaires.

La vraie question qui se pose est celle de la sortie de crise. Comment parviendrons-nous, demain, à mieux équilibrer nos niveaux de consommation et de production ?
Monsieur le secrétaire d’État, cette crise nous éclaire sur toutes nos contradictions. Au fond, dans notre conception de l’économie de marché, nous voulons parvenir à la fois aux prix les plus bas possible et aux profits les plus élevés. En effet, il faut lutter contre la vie chère ; d’ailleurs, politiquement, cela se vend bien. Si je suis Premier ministre, ma priorité doit être de me battre contre la vie chère et de casser les prix.
Selon cette vision de l’économie de marché, il faut donc à la fois casser les prix et maximiser les profits. Or, compte tenu de l’état de nos législations, de nos règlementations, de nos régimes de protection sociale, du financement de la sécurité sociale, notamment des branches santé et famille, et accessoirement de la taxe professionnelle, nous chargeons la production d’un certain nombre de contributions, ce qui a pour conséquence d’augmenter le prix de revient de ce que nous produisons.
Cette contradiction ne peut être surmontée qu’en délocalisant, même s’il paraît que la délocalisation, cela n’existe pas ! En effet, si l’on en croit M. Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, l’avenir, c’est l’économie de la connaissance. Formidable ! Allez expliquer à des ouvriers qui perdent leur boulot que ce n’est pas grave, car leur avenir, c’est l’économie de la connaissance !

C’est extraordinaire et très encourageant ! Et voilà comment l’on pousse des milliers, voire des millions d’hommes et de femmes au chômage !
Dans une société équilibrée, les emplois forment un ensemble très divers, avec des niveaux de valeur ajoutée très contrastés.
Dans notre société, qui veut rendre compatibles les profits les plus élevés et les prix les plus bas, on désindustrialise massivement ; cela n’est soutenable que par des recours massifs à l’emprunt pour financer les déficits publics et les déficits commerciaux. Comment faire pour surmonter cette contradiction ? Quelles réformes devons-nous conduire pour rendre sa compétitivité au travail dans notre pays ?
Voyez l’exemple des stratégies successives dans le secteur de l’automobile ! Voilà quelques années, lorsque Renault s’est implanté en Roumanie pour produire la Logan, on nous a dit de ne pas nous inquiéter, cette voiture étant destinée aux consommateurs des pays émergents. Trois ans plus tard, on se demande pourquoi il faudrait priver les Français d’une voiture à si bon marché !
Aujourd’hui, au-delà du pacte automobile, lorsque les constructeurs lancent des appels d’offre auprès des équipementiers et des sous-traitants, les offres ne comportant pas au moins 70 % de production hors de France ne sont pas prises en considération.
Cessons toutes ces hypocrisies ! Osons dire les choses comme elles sont afin d’en tirer les conséquences, pour que les forces du conservatisme et parfois de l’immobilisme renoncent à leurs revendications et qu’ensemble nous puissions bâtir, au-delà du pacte automobile, un autre pacte social. Ce sont ces contradictions que nous devons surmonter, monsieur le secrétaire d’État !
Sur la question du protectionnisme, sur laquelle Philippe Marini a ouvert son propos, laissez-moi vous faire part de notre rencontre la semaine dernière, à New York, avec l’Association des banques étrangères, c’est-à-dire non américaines.
Il existe, aux États-Unis, deux programmes très importants : le Troubled asset relief program, le TARP, et le Term asset-backed securities loan facility, leTALF. Le TARP est destiné à la reprise d’actifs toxiques et le TALF à des opérations tout aussi complexes, mais fiscalement avantageuses. Le Congrès américain a posé le principe que ces opérations ne seront possibles qu’au profit des banques américaines ! Si ce n’est pas là du protectionnisme ... Au lendemain des déclarations du G20 sur la prohibition du protectionnisme, nous constatons que chacun défend ses intérêts !
Je suis tout à fait favorable, pour ma part, à l’économie de la connaissance. Mais je n’ai pas encore trouvé la solution qui nous permettra de redonner un rôle dans les entreprises à tous les Français qui perdent leur emploià cause de la désindustrialisation.

Croire que l’on fera de la recherche, demain, là où il n’y a pas d’industrie, cela relève de la fiction !
J’ai noté que vous considériez la taxe professionnelle comme un vrai sujet
Mme Nicole Bricq sourit.

Je souhaite réunir au travers de cette question deux sujets évoqués lors de précédentes interventions, les paradis fiscaux et la politique commerciale, sur lesquels on ne peut s’en tenir aux bonnes intentions et aux principes généraux. Nous devons au contraire y être très attentifs.
J’évoquerai d’abord les paradis fiscaux.
Il est assez facile au gouvernement des États-Unis, quand il se rend compte de la perte de ressources fiscales liée au statut privilégié des paradis fiscaux, de faire pression politiquement sur ces territoires, en l’absence de quelque convention que ce soit, sachant que nombre d’entre eux sont très dépendants de ce pays.
Je pense que nous allons bientôt voir apparaître de tels comportements chez nous. C’est une bonne prise de conscience, mais cela ne suffit pas. Pour nous, Européens, des règles du jeu doivent prévaloir en matière d’assistance administrative et de transmission d’informations. Il nous faut obtenir que, dans toutes les procédures fiscales ou civiles, l’assistance soit aussi conséquente que dans le domaine pénal. Je considère qu’une telle symétrie est souhaitable, et j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement à cet égard.
Il existe en Suisse une loi très bonne et extrêmement contraignante relative à l’entraide internationale en matière pénale. Il suffirait de la démarquer : elle serait tout aussi excellente et efficace en matière de procédure fiscale, et permettrait de poursuivre des infractions constatées dans un autre territoire que la Suisse. Je souhaite que le Gouvernement soit pugnace sur ces sujets et ne se contente pas de bonnes intentions. Même si celles-ci constituent un bon début, on doit pouvoir élargir la brèche.
En matière de politique commerciale et de spécialisation du travail, ce qui est en cause, c’est la division internationale du travail.
Nous avons rencontré à Washington, entre autres interlocuteurs, Olivier Blanchard, l’économiste en chef du FMI, grand conseiller de cette institution et homme éminemment brillant, qui nous a dit sans vergogne que l’économie des pays développés allait devoir se redéployer, car l’avenir était à l’économie de la connaissance. Et lorsque nous lui avons fait remarquer qu’il n’était pas évident d’adapter toutes les qualifications à cette évolution, il nous a répondu qu’il faudrait de toute façon en passer par là. Il s’agit là, je tiens à le souligner, d’une vision mécanique, inéluctable et idéologique !
Sur ces sujets, monsieur le secrétaire d’État, il nous faut sortir du politiquement convenable. Nous avons un véritable problème de définition de la stratégie européenne en matière de politique commerciale, un vrai problème d’équilibre européen qui concerne la zone euro, mais également, au-delà, les Vingt-sept ! Nous sommes à la veille d’un grand débat européen. Or, si l’Europe ne sait pas clarifier ses structures, ses fonctions et ses responsabilités, comment pourra-elle constituer un pôle de stabilité dans le monde ?
Si l’Europe est simplement une croyance dont on se sert pour raconter sans cesse aux électeurs des choses plus ou moins fausses, comment éviter qu’elle ne devienne, aujourd’hui même, et de plus en plus dans les années à venir, le bouc émissaire dans tous les débats, surtout si la crise s’aggrave ? En effet, s’il est possible de penser que, sur le plan des marchés et de la crise purement financière – même si on n’a pas fait l’inventaire complet de tous les actifs toxiques ! –, le processus de correction est bien en cours, la crise de l’économie réelle est encore devant nous. ! Nous ne devons nous faire aucune illusion à ce sujet, et de nombreux spécialistes nous en avertissent à juste titre.
Vous savez tout cela, monsieur le secrétaire d’État, vous qui êtes aux prises avec des problèmes sociaux et industriels très graves. Je tiens d’ailleurs à vous rendre hommage, car je suis concerné de près par un conflit que vous avez pris en charge, dès le départ, avec efficacité, franchise et pugnacité. Vous connaissez ces sujets tout particulièrement.
Nous savons que les annonces qui nous parviennent se concrétiseront dans trois mois, six mois ou un an, et que les statistiques du chômage, dans notre pays comme aux États-Unis et dans bien d’autres pays, continueront à s’aggraver de manière significative pendant une certaine période. Nous n’avons pas touché le fond ! Et cela alimentera des anticipations qui, elles-mêmes, seront défavorables. Le rééquilibrage s’opérera, bien sûr, mais il ne faut pas promettre la prospérité au coin de la rue !
Le vrai problème qui se pose est celui de la division internationale du travail et de la compétitivité de nos industries. Nous ne devons pas nous faire d’illusion : on ne tranchera pas le débat européen sans clarifier ce sujet. Je rejoins donc Jean Arthuis sur tous les points qu’il a abordés, sauf sur la taxe professionnelle !
Jean Arthuis, coprésident du groupe de travail, sourit.

Monsieur le secrétaire d’État, puisque vous êtes très au fait de l’ensemble des problèmes de restructuration et des difficultés du tissu social et industriel, nous souhaitons que, en conclusion de ce débat, vous puissiez nous faire part de votre vision et de votre stratégie qui nous permettront, je l’espère du fond du cœur, de franchir cette période difficile.
Monsieur Arthuis, la réponse à votre question réside à mon avis dans une industrie plus compétitive et plus innovante.
Nous n’avons pas tiré un trait sur l’industrie française.
Le Président Sarkozy dit souvent qu’un pays sans usine est un pays qui ne croit pas à l’avenir de son économie. Toutes les mesures que le Gouvernement a mises en œuvre depuis deux ans vont dans le sens de l’amélioration de la compétitivité et de l’incitation à l’innovation des entreprises.
La suppression de l’impôt forfaire annuel permet de redistribuer un milliard d’euros et d’améliorer ainsi la compétitivité de nos entreprises. En triplant le crédit d’impôt recherche et en le portant à 30 %, nous mettons en place le meilleur système d’innovation incitatif des pays de l’OCDE.
Ce dispositif devrait faire remonter de 0, 2 à 0, 3 point le pourcentage du PIB consacré à l’investissement en recherche et développement, ce qui permettrait de faire passer le niveau actuel de 2, 2 %-2, 3 % à 2, 5 %-2, 6 %. Certes, nous n’atteignons pas encore les objectifs de Lisbonne. Sans doute faudra-t-il aller plus loin et imaginer d’autres mesures incitatives en matière d’innovation ; mais ce dispositif fiscal favorise d’ores et déjà la compétitivité de notre industrie. Je rencontre régulièrement des industriels : hier encore, le président de Sanofi Aventis m’a dit que ces mesures avaient guidé son choix d’investir en France plutôt que dans d’autres pays européens.
En accordant, dans le cadre du plan de relance, une exonération de charges sociales à toutes les entreprises de moins de dix salariés qui embauchent un nouveau salarié, nous faisons un autre geste pour doper la compétitivité de nos entreprises et encourager l’investissement.
Les dispositifs d’accompagnement de trésorerie, qui représentent 11 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance, relèvent de la même logique. En période de crise, il est important d’orienter l’argent des entreprises vers les besoins les plus urgents, qui consistent à soutenir l’activité et l’investissement.
Il nous faut donc des mesures structurelles.
Nous avons commencé à en prendre, et nous continuerons.
Il nous faut aussi du volontarisme. C’est ainsi que, dans le cadre du pacte automobile, nous avons exigé des donneurs d’ordres du secteur automobile qu’ils mettent fin à des pratiques trop souvent constatées par le passé, qui consistaient à exiger de leurs sous-traitants la délocalisation d’une partie de leur production dans des pays à bas coûts. Faire valider ce code de bonnes pratiques par l’ensemble des parties fut un combat très difficile à mener, sans doute le plus difficile de ce pacte automobile, mais nous avons réussi à obtenir la fin de ce type de comportement.
Monsieur Marini, non seulement nous avons l’intention de coopérer avec certains pays dans le cadre de l’OCDE, mais nous avons la volonté d’obtenir une coopération de tous les États, y compris en matière d’entraide administrative. Je note d’ailleurs, à titre d’exemple, que le Luxembourg a décidé de traiter de la même manière les questions d’entraide administrative et les questions d’entraide judiciaire, ce qui n’était pas le cas précédemment. Et, bien sûr, avancée importante et attendue de longue date, le secret bancaire ne pourra plus être opposé !
Enfin, je partage vos réflexions sur la question européenne. J’attache beaucoup d’importance au débat qui va nous occuper pendant les deux prochains mois sur la vision européenne économique en matière de coopération commerciale vis-à-vis de l’extérieur.
Je relève, certes, inquiétude, désarroi et souffrance chez les salariés victimes de la conjoncture. Et je pense, comme vous, que la situation deviendra plus difficile encore si nous voyons s’amorcer des signes de reprise. En effet, il y a toujours un décalage entre le moment où l’on ressent les premiers frémissements de la reprise économique et l’impact réel de cette dernière sur le tissu économique. Malheureusement, il y aura encore pendant quelque temps des restructurations industrielles qui justifieront l’engagement de l’État que j’ai évoqué tout à l’heure.
En me gardant de crier victoire trop tôt et en demeurant extrêmement prudent, à l’instar de Christine Lagarde, je tiens à souligner l’évidence d’indicateurs qui, aujourd’hui, se tiennent. La consommation des ménages en est un, qui mérite d’être souligné.
De plus, le déstockage des entreprises témoigne d’une situation plutôt saine, qui devrait entraîner un rebond technique sur le plan industriel. Et, depuis quelques semaines, les conditions de financement s’améliorent plutôt. Je vois dans ces trois éléments des signes d’encouragement, même si, encore une fois, le Gouvernement veut rester très prudent en la matière.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Je me réjouis de la qualité du débat que nous avons eu ce matin et du fait que la crise nous conduise à approfondir nos réflexions parlementaires sur les voies et moyens nous permettant de la surmonter.
Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous remercier pour votre présence, votre écoute et la qualité des précisions que vous avez bien voulu nous livrer à l’occasion de ce débat.
Je me réjouis aussi de l’initiative prise par le président Gérard Larcher, qui nous a invités à constituer un groupe de travail composé de douze députés et de douze sénateurs réunis au-delà des considérations partisanes, dans le respect de la diversité des familles politiques présentes au Parlement. Ce faisant, une autre forme de réflexion parlementaire est apparue, qui, en dépassant les clivages traditionnels, nous a permis de parvenir à un diagnostic partagé et à la formulation de propositions consensuelles. Nous sommes ainsi sortis des tranchées partisanes. Sans doute le caractère supranational de la crise nous y a-t-il poussés. En tout cas, ce travail doit être poursuivi et approfondi.
Nous avons pu également, nous, parlementaires, prendre la mesure de nos obligations en matière monétaire et financière qui restaient, jusque-là, le fait de quelques spécialistes. Plutôt adeptes de l’autorégulation, les acteurs du monde financier se donnaient rendez-vous à Bâle ou ailleurs pour y définir, entre gens de bonnes manières, entre spécialistes, les guides de bonnes pratiques. Et, de temps en temps, on venait au Parlement parce qu’il fallait transcrire une directive européenne ou mettre au point quelques textes de nature législative. Mais peut-être chacun d’entre nous n’avait-il pas les éléments d’information suffisants pour pouvoir, de retour dans sa circonscription ou son département, présenter à ses concitoyens les enjeux de ces innovations dans le code monétaire ou financier.
La crise nous a fait prendre conscience de la nécessité de nous réapproprier les problématiques en matière monétaire et financière. Mesurant les limites de l’autorégulation, nous avons vu la nécessité pour l’État de se remettre au cœur du dispositif en vue de rétablir la confiance. Nous mesurons aussi à quel point chaque État, pris isolément, est incapable d’assumer ses prérogatives. En effet, faute de consensus supranational, les dispositions que nous prendrons pourront nous apporter les satisfactions intellectuelles les plus intenses, mais elles resteront sans effet parce que les acteurs économiques, eux, ignorent aujourd’hui les frontières !
Si le G20 a été, à mon sens, une vraie réussite, il reste un ensemble d’annonces. Toute la difficulté, maintenant, c’est de faire vivre chacune de ces annonces. La remarque vaut, en particulier, pour la lutte contre les paradis fiscaux, contre ces espaces non coopératifs.
À cet égard, je crois qu’il faut s’accorder sur la définition du paradis fiscal. Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? Du temps de la vignette automobile, le département de la Marne a été momentanément un paradis fiscal. Mais ce paradis fiscal ne pratiquait pas le secret bancaire ! Or la vraie difficulté réside dans le secret et la non-coopération. Aujourd’hui massivement investis dans la dépense publique, les États prennent tous conscience du fait que les paradis fiscaux et le secret bancaire ne peuvent être les complices de l’évasion fiscale et de la perte de ressources, mettant ainsi en cause le pacte républicain.
Des discussions hier encore impossibles se concrétisent. De ma rencontre récente avec nos collègues luxembourgeois, je retiens une discussion, certes un peu vive, mais surtout la réalité d’échanges sur des sujets que nous n’aurions jamais osé aborder voilà quelques années.

Les mentalités évoluent. Il faudra aller jusqu’au bout. Politiquement, ce sera très difficile.
C’est vrai aussi en matière de supervision prudentielle, en matière de contrôle des marchés, des acteurs et des produits. Il est quand même extraordinaire que les institutions financières aient pu ainsi se faire piéger par des agences de notation ! Faute de connaître le contenu du « paquet cadeau », elles s’en remettaient aux appréciations de ces dernières !
Hier matin, nous avons entendu le président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne, directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, nous expliquer comment Natixis, ce fleuron de la créativité financière bancaire
Sourires

On imagine les masses de commissions qui en ont résulté ! Il faut aussi que ce petit monde financier sorte de sa cupidité, qui a été également l’un des facteurs de déclenchement de la crise. Tout cela va devoir évoluer dans les mois qui viennent.
Mais, au fond, pour être crédibles, les Européens ne devraient-ils pas commencer par essayer de transcrire et de faire appliquer au sein de l’Union européenne toutes les dispositions qu’ils recommandent au monde entier ? Sommes-nous capables de convaincre le Luxembourg, l’Autriche, la Suisse, Monaco, Andorre et quelques autres encore ?

Commençons par faire le ménage chez nous ! Nous serons d’autant plus crédibles sur le plan mondial que nous aurons fait vivre tous ces principes au sein de l’Union européenne. Voilà un beau projet !
Monsieur le secrétaire d‘État, notre groupe de travail, encouragé par les présidents de nos deux assemblées et par le Président de la République, va poursuivre sa tâche. Nous essaierons de faire un peu de diplomatie parlementaire en nous rendant au Luxembourg, en Autriche, en Suisse, à Monaco, voire en Andorre.

M. Philippe Marini, co rapporteur du groupe de travail. Autant de séjours agréables !
Sourires.

Nous essaierons de visualiser ce que peuvent être des paradis fiscaux ou des espaces non coopératifs. Voilà qui doit nous rassembler au-delà de nos convictions partisanes.
Au fond, peut-être cette crise était-elle nécessaire pour que nous cessions de marcher sur la tête, de nous raconter des histoires et de faire vivre une politique virtuelle !
Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous remercier à nouveau de votre présence, tout comme je remercie les nombreux sénateurs qui, ce matin, ont tenu à participer à ce débat sur la crise financière internationale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Jean-Pierre Chevènement applaudit également.
Je voudrais, à mon tour, rendre hommage à la Haute Assemblée. Je commencerai par remercier MM. Arthuis et Marini pour le travail de fond qui a été conduit dans le cadre de ce groupe de réflexion constitué sur l’initiative du président Gérard Larcher, dont je salue la présence parmi nous ce matin.
Ce groupe a joué un rôle très important. Il a permis, au-delà des différences constatées sur les travées des différents groupes parlementaires, de partager parfois un constat, en tout cas des objectifs pour aboutir à des propositions unanimes. Il a ainsi conforté la position de la France.
Le Président de la République a en effet eu à négocier dans des conditions très difficiles dans le cadre du G 20, d’abord avec ses homologues européens, puis avec ses homologues mondiaux. La position commune que vous avez défendue a conforté celle du Président de la République. Elle a permis de faire bouger d’autant plus les lignes sur le plan international et d’obtenir un certain nombre d’avancées. Je voulais vous en remercier.
Je tiens enfin à vous féliciter pour la qualité du débat de ce matin. Attendu dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle, cet exercice, qui renforce la démocratie parlementaire et l’équilibre des pouvoirs, est beaucoup plus lisible pour nos concitoyens compte tenu de l’interactivité des débats, malheureusement trop souvent absente des échanges parlementaires.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.