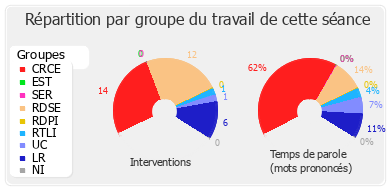Séance en hémicycle du 28 octobre 2010 à 15h00
Sommaire
- Communication du conseil constitutionnel
- Démission de membres de commissions et candidatures
- Développement du fret ferroviaire (voir le dossier)
- Nomination de membres de commissions
- Indépendance du président de la république et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.

La séance est reprise.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 28 octobre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-90 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

J’ai reçu avis de la démission de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale et de celle de Mlle Sophie Joissains, comme membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.
J’informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des finances en remplacement de M. Alain Lambert, dont le mandat de sénateur a cessé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution relative au développement du fret ferroviaire, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Mireille Schurch, Isabelle Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche (proposition n° 612 [2009-2010]).
Dans débat, la parole est à Mme Mireille Schurch, coauteur de la proposition de résolution

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de la discussion sur le Grenelle de l’environnement, les sénateurs du groupe CRC-SPG ont demandé que l’activité de fret ferroviaire soit reconnue d’intérêt général.
Lors de la discussion sur la mise en œuvre de ce même Grenelle de l’environnement, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a proposé un amendement tendant à déclarer d’intérêt général le trafic de wagons isolés. Elle reconnaissait ainsi qu’il s’agissait d’une activité essentielle et pointait la nécessité de déclarer ce trafic d’intérêt général, ce qui constituerait « la première étape, nécessaire, mais non suffisante, pour autoriser le versement de subventions au secteur du fret en général ».
Pourtant, lors des débats en séance publique, le Gouvernement n’a pas suivi la commission et cette reconnaissance a été remise à plus tard.
C’est donc pour respecter les engagements pris lors des discussions sur le Grenelle de l’environnement que nous vous proposons aujourd’hui, mes chers collègues, de voter notre résolution.
Il est temps de dépasser les déclarations d’intention et de s’exprimer sur le caractère d’intérêt général de ce mode de transport des marchandises !
Parce que nous avons conscience de l’importance de ce sujet et de la responsabilité des parlementaires, la présidente de mon groupe, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, avait proposé au président Larcher la tenue d’une table ronde sur ce thème.
Cette table ronde a eu lieu le 29 avril 2010 et a permis un échange nourri entre les différents acteurs du secteur des transports : les directions de la SNCF et de Réseau ferré de France – RFF –, des opérateurs ferroviaires et routiers, des chargeurs, des entreprises, les organisations syndicales et les parlementaires.
Je veux aussi saluer ici le travail mené au sein du groupe de travail sénatorial sur l’avenir du fret ferroviaire, dont je suis membre. Je remercie son président Francis Grignon, ainsi que les administrateurs ayant suivi ces travaux.
Le rapport, publié il y a quelques jours, est de qualité et nous confirme l’urgence d’un Grenelle ferroviaire.
Le transport de marchandises est une activité d’utilité sociale, dans la mesure où, à travers ses infrastructures, une énorme part du capital productif de cette activité est propriété de la collectivité. C’est d’ailleurs vrai pour le transport ferroviaire, mais aussi pour le transport routier qui se déroule sur le domaine public.
Monsieur le secrétaire d’État, une intervention étatique particulière y demeure nécessaire et légitime.
Après-guerre, la SNCF comptait plus de 500 000 employés ; ils sont aujourd’hui 156 000. Son organisation est régie par des décrets de 1940. Avec la SNCF, la France dispose d’un atout considérable de maîtrise publique, capable d’influer sur l’ensemble du système de transport et de servir son pays.
Ce service public, assujetti à des contraintes techniques et à des exigences de sécurité particulièrement fortes, est un modèle de qualité, de compétence, de traitement équitable des agents et de respect de l’éthique collective.
S’il est vrai qu’il faut avancer sur un certain nombre de propositions, il ne faut pas démanteler la SNCF, en séparant l’infrastructure de l’activité d’opérations, ou la direction voyageurs et la direction marchandises, et, bientôt, la Direction de la circulation ferroviaire.
C’est donc d’une entreprise publique intégrée dont le fret ferroviaire a besoin pour son développement.
Nous ne reviendrons pas sur le déclin du fret ferroviaire – le constat est unanime et a été largement commenté. Il est dû essentiellement à des choix politiques budgétaires.
Ainsi, le programme « Infrastructures et services de transports », recouvrant l’exploitation, l’entretien des réseaux, le soutien au transport combiné, les aides aux opérateurs, est pour 2011 de 3, 104 milliards d’euros, soit une baisse de 7 % par rapport à 2010. Le concours de l’État pour le plan de rénovation ferroviaire n’évolue pas en 2011. La subvention versée à RFF chute de 50 millions d’euros par rapport à l’exercice 2010, qui avait déjà enregistré une baisse de 75 millions d’euros par rapport à 2009. Nous sommes donc bien loin des 500 millions d’euros supplémentaires demandés dans l’audit de l’École polytechnique de Lausanne pour seulement maintenir l’intégralité du réseau en l’état. Je ne cite là que quelques chiffres…
Inversement, des choix de politiques publiques favorables au secteur routier ont permis, au cours des dernières années, une densification du réseau routier. Celui-ci a presque doublé depuis 1980.
Le 25 octobre 2007, le ministre de l’écologie Jean-Louis Borloo indiquait au journal Le Monde : « Pendant trente ans, on a fait beaucoup de routier et d’autoroutier. C’est fini : on n’augmentera plus la capacité routière. Notre stratégie est de développer le ferroviaire et le fluvial. »
Pourtant, l’avant-projet du schéma national des infrastructures de transport – le SNIT –, présenté en juillet dernier, n’inclut pas moins de dix-neuf projets routiers ou autoroutiers, accroissant ce réseau de 1 166 kilomètres.
Incidemment, il permet aux sociétés d’autoroute, qui ont été privatisées, d’augmenter encore leur marge nette, laquelle s’établissait pour certaines d’entre elles à plus de 18 % du chiffre d’affaires pour le premier semestre de 2010.
Autre exemple, dans le budget de 2010, le secteur routier est encore une fois privilégié, notamment grâce aux exonérations fiscales qui atteignent 330 millions d’euros, et ce alors que dans le même temps le fret ferroviaire n’a connu aucune innovation technologique, structurelle ou commerciale.
Monsieur le secrétaire d’État, vous favorisez toujours une concurrence « non libre et faussée » au profit du fret routier, bien loin des objectifs de rééquilibrage modal.
Pour notre part, nous jugeons nécessaire de rompre avec les discours comptables sur les pertes économiques du fret pour intégrer toutes les dimensions qu’offre ce mode de transport de marchandises en termes d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. Pourquoi ne pas raisonner aussi en termes d’utilité sociale ?
D’un point de vue environnemental, le bilan écologique du fret ferroviaire est très positif. Une tonne de marchandise transportée génère deux grammes de dioxyde de carbone, ou CO2, par train en traction électrique, et jusqu’à mille grammes par route ou par avion.
De ce point de vue, il n’est pas suffisant de rappeler la mobilisation de l’État en faveur du fret ferroviaire lorsque, simultanément, la direction de la SNCF poursuit sa politique d’abandon de 60 % de l’activité « wagon isolé ».
N’envisage-t-elle pas d’abandonner à la route 255 000 wagons de marchandises ? Ne prévoit-elle pas un recul d’un tiers des volumes transportés par rapport à 2008 ?
Le rapport du cabinet Carbone 4, qui lui avait été remis, affirmait pourtant qu’il fallait garder la messagerie, afin de bénéficier de la spécificité française d’un réseau maillé fin et de permettre à notre pays de réduire ses émissions de CO2 au plus vite.
Dès lors, la pertinence économique invoquée contre le wagon isolé est biaisée, puisqu’elle ne prend pas en compte les externalités négatives produites par le transport routier. Ces coûts externes sont pourtant estimés à plus de 80 milliards d’euros : pollution, insécurité routière, congestion du trafic et détérioration du réseau routier, dont la charge revient à l’État et de plus en plus, aujourd’hui, aux collectivités locales.
Il est vrai que l’impossibilité de calculer réellement ces coûts est souvent mise en avant. Mais plusieurs recommandations européennes permettent de les évaluer. Pourquoi ne pas saisir cette occasion ?
Aujourd’hui en France, le système de calcul des externalités négatives est en retrait par rapport aux recommandations européennes et aux exigences d’un développement durable.
De cette absence de prise en compte résulte un avantage comparatif pour la route, pourtant globalement plus coûteuse pour la collectivité nationale.
Ainsi, les comités opérationnels du Grenelle de l’environnement prévoyaient une écotaxe prélevée sur les poids lourds à compter de 2011.
Malheureusement, comme vous le savez, mes chers collègues, l’avenir de cette écotaxe est compromis, faute de courage politique. Après le retrait de la taxe carbone et de l’éco-redevance poids lourds, son application était prévue pour 2011. On parle maintenant de 2012, et ce malgré les propos de Nicolas Sarkozy. En juin 2007, celui-ci déclarait : « Nous devons créer une redevance pour l’utilisation de notre réseau routier et autoroutier par les camions, qui reflètera le coût porté au réseau et surtout à l’environnement par ce mode de transport des marchandises. La taxe à l’essieu, qui en pratique n’est payée que par les transporteurs français, sera supprimée. »
Le manque à gagner résultant du report de cette écotaxe est de 1, 3 milliard d’euros brut pour les ressources de l’État. C’était pourtant le seul engagement de ressources financières du Grenelle de l’environnement, sa vocation étant de sortir le transport routier de la sous-tarification par prise en compte des externalités.
Le Gouvernement vient de franchir une nouvelle étape en autorisant la circulation des camions de 44 tonnes sur le territoire.
Je peux citer un autre exemple, alarmant pour ma région. L’usine Adisseo de Commentry dans l’Allier a un projet de biomasse sur son site. Quelque 150 000 tonnes de bois doivent être acheminées. Le fret ferroviaire a-t-il été choisi ? Non ! Il est prévu, pour cela, des camions de 57 tonnes mesurant 25, 5 mètres de long. C’est le comble pour un projet qui se veut vertueux !
Du point de vue de l’aménagement du territoire, le fret ferroviaire et, surtout, l’activité « wagon isolé » permettent la desserte des territoires et contribuent au maillage qui a été historiquement un motif de fierté nationale.
Alors que le wagon isolé est la clé de valorisation de l’atout réseau, donc du report modal et de l’intérêt général, la direction de la SNCF continue à le charger de tous les maux économiques. Pourtant, l’abandon de cette activité tournerait le dos à la massification multi-clients, qui est nécessaire au report modal, et conduirait à la marginalisation du mode ferroviaire.
Comment justifier, alors, le choix de la Deutsche Bahn, qui considère le wagon isolé comme une activité d’avenir ?
Cette activité représente 42 % du volume fret ferroviaire en France et recèle un important potentiel de développement. J’ai reçu hier soir des salariés et la direction de l’usine Dunlop-France à Montluçon, dans l’Allier. La SNCF a acheminé, depuis le début de l’année, 1 455 tonnes de noir de carbone et 87 tonnes d’oxyde de zinc, qui sont des matières polluantes. Bien qu’elle ait réalisé en 2009 des travaux d’infrastructure pour un coût de 100 000 euros, elle a brutalement annoncé l’arrêt de cet acheminement, sans concertation, à compter du 31 octobre prochain. Je crois que, dans ce cas comme dans de trop nombreux autres, le mot « abandon » n’est pas trop fort.
Pourtant, le quotidien Les Échos du 5 juillet 2010 rapportait que plusieurs industriels avaient demandé un report du plan fret tel que proposé par la SNCF. Pour les signataires du communiqué, la nouvelle organisation telle qu’elle est projetée devrait « entraîner un transfert massif de l’activité vers le transport routier ». Le wagon isolé « représente 50 % des flux ferroviaires de la sidérurgie, 60 % de ceux de la chimie et 80 % de ceux des constructeurs automobiles ».
Certains vont même jusqu’à parler de « danger mortel pour des PME » ou n’hésitent pas à évoquer « la possibilité de voir des entreprises délocaliser à l’étranger pour éviter ces nouvelles contraintes coûteuses ». Pour un gouvernement si attaché au développement économique et à la compétitivité de nos territoires au sein de la concurrence mondialisée, il y a là une contradiction majeure.
De plus, comment mettre en place un réseau fret orienté sachant que les gares françaises sont saturées par les TER et les TGV et que la direction annonce la fermeture de nombreuses gares et plateformes de triage ? On ne peut pas prétendre, dans le discours, faire jouer à l’entreprise un rôle de leader européen et être incapable, dans le même temps, de desservir une grande partie du territoire national.
N’y a-t-il pas d’autres moyens pour sauver le fret que de sacrifier la branche « wagon isolé » ou de mettre en concurrence le transport de voyageurs et le transport de marchandises ?
Du point de vue social, il est vrai qu’il y a « une augmentation plus rapide des coûts salariaux à la SNCF par rapport au transport routier » et que, entre 2003 et 2008, le salaire annuel moyen a crû de 6, 2 % à la SNCF, hors intégration industrielle de la traction au sein du fret, contre 3 % pour le mode routier. Mais le statut des cheminots est une source de fiabilité et de sécurité, a fortiori si ceux-ci doivent travailler bien au-delà de 60 ans !
Ce constat est réel, alors pourquoi prôner le nivellement par le bas ? Je vous rappelle, mes chers collègues, que le développement durable repose sur trois piliers – un pilier économique, un pilier écologique et un pilier social – et que vous ne pouvez oublier le troisième.
Selon nous, le groupe SNCF, avec Geodis, doit devenir, pour la France et l’Europe, le laboratoire d’une nouvelle conception du transport multimodal du fret, de son financement et des conditions sociales des salariés. Il est l’outil majeur de la mise en œuvre de la politique multimodale intégrée que nous avons décidée dans la loi Grenelle 1 et inscrite dans la loi d’orientation des transports intérieurs, la LOTI.
Rendez-vous compte, mes chers collègues : la France dispose – c’est unique en Europe – d’un groupe de transport et logistique multimodal sous sa maîtrise. Oserions-nous en faire une machine industrielle de report modal vers la route ? Nous marcherions à contresens de l’avenir. Ne laissons pas passer cette chance d’atteindre nos objectifs du Grenelle ! Je rappelle, en effet, que l’autorité environnementale a attiré notre attention, dans un récent avis, sur le fait que, en l’état des orientations actuelles, ces objectifs sont inatteignables.
La SNCF compte aujourd’hui 650 filiales, mais a supprimé 21 500 emplois entre 2002 et 2009 dans son établissement public à caractère industriel et commercial, ou EPIC, soit l’équivalent de 30 usines Molex et de 8 usines Continental. En cette période de crise et de précarité, l’État ne devrait-il pas donner l’exemple ? Ne devrait-il pas protéger la notion de service public ?
Cela pose la question essentielle du type de modèle social d’entreprise que l’État veut promouvoir.
Les solutions avancées aujourd’hui ne portent malheureusement pas la marque d’un véritable volontarisme politique, d’une ambition réelle que mérite pourtant le fret.
Ainsi en est-il de la question récurrente de la dette de RFF. La Cour des comptes précisait à ce sujet : « Le désendettement de la SNCF aurait pu être obtenu par le transfert d’une partie de ses dettes à l’État, ce que la directive 91-440 autorise. Dans la plupart des autres pays européens, l’État a ainsi repris une grande partie des dettes de l’opérateur ferroviaire historique. En Allemagne, l’État a effacé les dettes financières des chemins de fer à hauteur de 35 milliards d’euros en 1994. […] Ainsi soulagée, [la Deutsche Bahn] s’est ensuite endettée de nouveau pour financer des investissements, y compris de croissance externe, qui en font en 2007 l’entreprise la plus puissante sur le marché ferroviaire européen. »
En France, RFF, asphyxié par le poids de la dette, ne peut faire face aux immenses besoins qu’appelle la régénération du réseau.
De plus, des propositions sont avancées alors qu’aucun bilan des différents plans et de la libéralisation du secteur n’a été entrepris.
L’Union européenne a mené depuis le début des années 1990 une politique de libéralisation progressive. Or, vingt ans plus tard, le constat du déclin du fret est toujours d’actualité ! C’est pourquoi nous demandons qu’un bilan soit dressé avant d’aller plus loin dans cette direction.
Le plan fret proposé par la SNCF n’est pas acceptable : rappelons que, en 2007, le plan, approuvé par la Commission européenne, a fait baisser le trafic de 47 milliards à 40 milliards de tonnes-kilomètres, a supprimé près de 7 000 emplois de cheminots, fermé 4 triages, 100 gares principales fret et plus de 100 points de dessertes, a réduit le parc de locomotives de 24 % et le parc de wagons de 21 %, a divisé par deux les agences commerciales fret. Le plan actuel est loin des ambitions du Grenelle !
De même, certaines propositions avancées par le rapport sur l’avenir du fret laissent perplexe.
Ainsi en est-il de la proposition visant à garantir l’indépendance de la direction de la circulation ferroviaire au sein de la SNCF. Elle n’a tout simplement rien à voir avec le fret, elle s’inscrit seulement dans la logique de démantèlement de l’entreprise.
Ce qui est proposé en vérité, c’est l’externalisation des missions de service public, puisque c’est actuellement la direction de l’infrastructure qui est chargée du pilotage de la sécurité à la SNCF.
J’en viens au développement des opérateurs ferroviaires de proximité, les OFP.
L’émergence des opérateurs ferroviaires de proximité, là où le fret ferroviaire est traditionnellement absent, pourrait contribuer au report modal, à condition toutefois qu’ils ne se créent pas sans la SNCF, ou a fortiori contre elle. L’assemblage de l’offre et de la production nécessite d’organiser une complémentarité avec la SNCF. Celle-ci, avec son groupe, doit donc être un acteur pivot de ce développement. Concevoir les OFP comme alternative et en substitution de la SNCF conduira à un échec assuré.
Pas moins de huit associations environnementales, la FNAUT, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, et les syndicats ont demandé, dans un texte commun du 19 mars dernier, la révision pour partie du plan fret de la SNCF. Ils estiment que « la SNCF [est] seule à même d’assurer un maillage du réseau, pour le wagon isolé et en organisant une complémentarité avec les opérateurs de fret de proximité – OFP – […] pour activer concrètement un report modal. Ces OFP ne doivent pas être des low cost contournant les standards sociaux, environnementaux et de sécurité actuels par dumping. En l’absence de cette synergie, ce sera l’échec assuré avec, en plus, 8 000 emplois SNCF bradés. »
Ces organisations concluaient qu’il faut examiner des « organisations nouvelles de la production SNCF en proximité, spécialement adaptées et en coopération avec les opérateurs nouveaux pour, ensemble, donner de la pertinence économique aux convois ».
Vous le voyez, il n’y a pas de blocage, alors profitons de ces larges convergences de vues. Le fret SNCF, et ferroviaire en général, sera d’avenir s’il conjugue des acheminements massifs et un aménagement fin du territoire, en réponse aux activités humaines et économiques, industrielle ou de distribution. Pour réussir, la responsabilisation de la SNCF est incontournable.
Il est aussi parfaitement envisageable de reconnaître à la SNCF des droits exclusifs sur les acheminements déficitaires sur la base de contrats de service public, afin d’assurer un maillage territorial efficace et de reporter la part du modal routier vers le ferroviaire.
Le fret de proximité, indispensable à nos territoires, a un réel avenir. Encore faudrait-il faire preuve d’un véritable volontarisme !
Sur la question du financement, nous regrettons la privatisation des concessions autoroutières, qui privent l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, de ses capacités d’intervention. Ces sociétés, qui sont largement excédentaires, pourraient utilement être mises à contribution financièrement : il y aurait alors un vrai report du transport routier vers le transport ferroviaire, comme nous y invite le Grenelle de l’environnement. L’opinion publique, les entreprises et les élus le souhaitent.
De plus, nous pensons qu’il faut donner la priorité à la régénération et à l’aménagement des lignes existantes et ne pas se lancer à bras-le-corps dans « le tout grande vitesse ».
J’en viens à nos propositions.
Le concept de développement durable s’impose de plus en plus. Dans ce cadre, la marginalisation du transport ferroviaire de marchandises interpelle les citoyens dans leur vie quotidienne, et les décideurs dans les politiques à mettre en œuvre.

J’ai bientôt terminé, monsieur le président.
Le mode ferroviaire est peu polluant, économe en espace et en énergie, il est aussi un élément structurant de l’espace économique et social. Il doit donc être un levier stratégique pour la satisfaction des besoins actuels et futurs.
Nous proposons donc de réintroduire les facteurs sociaux et environnementaux, qui sont également pertinents, dans le débat sur l’avenir du fret. Cosignataire de l’appel des 365, j’aimerais que soit organisé un « Grenelle du ferroviaire », un souhait partagé par Louis Nègre.
Mme Brigitte Bout manifeste son impatience.

Pour cela, nous vous proposons, d’une part, un moratoire sur l’abandon partiel de l’activité « wagon isolé » et, d’autre part, la préservation des installations ferroviaires.
Par ailleurs, dans le même ordre d’idées, une approche globale de la rentabilité de chacun des secteurs d’activité de la SNCF permettrait d’avoir une démarche de péréquation entre les différentes branches. Pour cela, il faut reconnaître le caractère d’intérêt général de l’activité fret.

J’en termine, monsieur le président.
Parce que le bilan du fret est la résultante de choix stratégiques, nous vous demandons, dans l’objectif d’un rééquilibrage modal, qu’une législation spécifique au secteur routier permette d’internaliser les coûts externes, notamment environnementaux. Nous proposons d’instaurer au plus vite une taxe poids lourds, dont les ressources doivent être fléchées pour les investissements sur le réseau ferré.
Pour ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, représentants des citoyens et de leurs territoires, à adresser, avec cette proposition de résolution, un signal fort en faveur de la préservation de nos territoires et des services publics qui les structurent.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Michel Teston applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je m’exprimerai en tant que président du groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire, constitué au sein de la commission de l’économie sur l’initiative du président Jean-Paul Emorine, que je tiens à remercier ici chaleureusement.
Madame Schurch a bien voulu évoquer ce groupe de travail, auquel elle a participé. J’en profite pour la remercier. Je remercie également de leur engagement les autres participants à ce groupe de travail, Michel Teston, Claude Biwer, Louis Nègre, ainsi que l’administrateur en charge de ce dossier à la commission.
Ce groupe a rendu, la semaine dernière, son rapport sur un sujet qui préoccupe, à juste titre, les auteurs de la proposition de résolution. Notre commission s’est également interrogée, dès novembre 2009, sur l’avenir de ce mode de transport, et disons clairement que, si nous partageons beaucoup d’éléments du diagnostic de la crise du fret avec les auteurs de la proposition, nous divergeons sur les préconisations, en particulier sur la déclaration d’intérêt général pour l’ensemble du fret ferroviaire et, donc, sur le moratoire de la réforme du wagon isolé à la SNCF.
Mes chers collègues, permettez-moi de ne pas revenir sur l’état des lieux, que tout le monde connaît, mais de rappeler brièvement les réformes ambitieuses déjà engagées par le Gouvernement, avant de vous présenter les propositions du groupe de travail.
Première mesure gouvernementale : RFF se voit confier des objectifs précis au travers du contrat de performance signé avec l’État le 3 novembre 2008. C’est une grande avancée dans l’organisation du trafic ferroviaire, notamment à travers l’attribution et le contrôle qualité des sillons.
Deuxième mesure : le 16 septembre 2009, le Gouvernement a présenté l’Engagement national pour le fret ferroviaire, ENFF, pour une enveloppe financière globale de 7 milliards d’euros qui devrait s’étaler sur une dizaine d’années.
Troisième mesure : la SNCF a engagé une nouvelle réforme du fret en 2009 ; c’est la fameuse offre « multi-lots multi-clients ». Ce plan a justement pour objet de rationaliser et de massifier le trafic de wagon isolé. Il y va de la survie financière de la branche fret de la SNCF et peut-être même du groupe SNCF. Qui peut croire un seul instant que la branche fret de la SNCF peut supporter 3 milliards d’euros de déficit cumulé depuis 2003 sans que la direction s’en inquiète ?
Quatrième mesure : l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, ARAF, est enfin mise en place et a vocation à devenir le juge de paix dans le domaine ferroviaire.
J’en viens maintenant aux propositions du groupe de travail. Elles sont structurées autour de trois axes.
Le premier axe est le renforcement de la qualité de service des opérateurs ferroviaires à travers trois propositions.
La première proposition est de réaliser au plus vite les corridors de fret, afin de faire émerger un réseau ferroviaire européen compétitif là où le fret ferroviaire est compétitif par rapport à la route.
La deuxième proposition est d’exhorter la SNCF à passer d’une logique de l’offre à une logique de la demande, afin de répondre aux attentes concrètes des entreprises clientes. Satisfaire les besoins de ses clients doit être la préoccupation première de la SNCF.
La troisième proposition est de mener une réflexion sur la possibilité d’attribuer des aides publiques pour l’exploitation de certaines lignes de faible trafic de wagons isolés qui répondent à une logique d’aménagement du territoire. La SNCF est, en effet, la seule entreprise qui assure aujourd’hui le trafic de wagons isolés, source des deux tiers du déficit de l’activité fret, alors qu’elle doit, dans le même temps, rendre des comptes à l’État.
Le deuxième axe de nos propositions est l’amélioration de l’organisation du système ferroviaire.
Nous avons appelé le Gouvernement et la SNCF à prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance fonctionnelle de la direction de la circulation ferroviaire, conformément à l’avis motivé du 1er octobre 2009 de la Commission européenne qui reprochait à notre pays de ne pas avoir donné la personnalité juridique à cette direction.
Le groupe de travail a également proposé que le raccordement entre les grands ports maritimes et leur arrière-pays économique soit érigé au rang de priorité stratégique. Par ailleurs, nous fondant sur l’exemple suisse, nous sommes favorables, dans certains cas, à la création de subventions publiques pour les voies de raccordement aux zones d’activité, afin d’inciter les entreprises à recourir au fret ferroviaire.
Enfin, nous appelons de nos vœux la mise en place rapide des opérateurs ferroviaires de proximité, les OFP.
Alors que l’Engagement national pour le fret ferroviaire prévoyait, à partir de 2010, la création d’au moins un opérateur ferroviaire de proximité dans chaque grand port maritime, un seul a vu le jour au port de la Rochelle, avec Euro Cargo Rail, filiale de la Deutsche Bahn, et non la SNCF.
Il existe un autre OFP sur le terrain dans le pays Cathare, mais son activité et ses ambitions demeurent modestes.
Je ne l’ignore pas, certains observateurs craignent que les OFP ne sortent de leur champ de compétence en concurrençant la SNCF plutôt qu’en faisant du transfert modal. Mais le groupe de travail estime que ces craintes sont exagérées et que des accords doivent être trouvés entre Voies ferrées locales et industrielles, VFLI, et les représentants des entreprises ou des ports.
Le troisième et dernier axe est la recherche de sources de financement pérennes pour garantir la réalisation de l’Engagement national pour le fret ferroviaire.
Nous appelons le Gouvernement à assurer des ressources pérennes à l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France, AFITF. Le groupe de travail souhaite notamment la mise en place rapide, à l’échelon national, de la taxe poids lourds, son extension à terme aux autoroutes concédées, une fois révisée la directive Eurovignette II, et, enfin, la hausse raisonnable des redevances domaniales payées par les sociétés d’autoroute, bien évidemment dans le cadre des équilibres contractuels.
La taxe poids lourds devrait voir le jour en 2012, conformément aux engagements pris devant le Parlement. Mais n’oublions pas que chaque année de retard représente pour l’AFITF environ un milliard d’euros de manque à gagner que le Gouvernement doit combler à partir de son budget général.
Enfin, nous avons proposé de relever progressivement le montant des péages ferroviaires. D’après une étude conduite par l’OCDE en 2008, les péages moyens du fret français se trouvent en effet parmi les moins chers d’Europe : environ 2 euros par train-kilomètre en France, contre 2, 6 euros en Allemagne et 6, 2 euros au Royaume-Uni.
Avant de conclure, je voudrais faire le point sur deux sujets qui me sont chers et qui sont connexes aux sujets abordés ici : l’impossibilité aujourd’hui de créer une entreprise ferroviaire intégrée, d’une part, et l’impossibilité d’une uniformisation soudaine des conditions sociales dans le secteur ferroviaire, que ce soit par le haut ou par le bas, d’autre part.
S’agissant de l’entreprise ferroviaire intégrée, les directives communautaires nous imposent une séparation au moins comptable entre les opérateurs ferroviaires et le gestionnaire du réseau. La concurrence est là, elle s’impose aux opérateurs ferroviaires de fret. Que l’on s’en félicite ou non, c’est un fait : il n’y a plus de monopole de la SNCF. La péréquation traditionnelle, au sein de la SNCF, entre les activités rentables et les activités déficitaires est donc désormais impossible. C’est pourquoi il faut changer d’échelle, de paradigme, instaurer des comptes de ligne, comme en Suisse, et instituer de la péréquation à l’échelon national, ligne par ligne, ce que nous avons proposé pour les lignes de fret répondant à un impératif d’aménagement du territoire.
Je fais souvent référence à la Suisse car, pour moi, c’est un modèle en matière ferroviaire. En effet, bien que ce pays ne soit pas soumis aux règles de l’Union européenne, il a su, sans introduire la concurrence, moderniser le système et devenir l’opérateur ferroviaire le plus performant en Europe.
Quant à l’uniformisation des conditions sociales dans le secteur du transport ferroviaire, je crois qu’il faut rappeler quelques évidences, tant économiques que juridiques.
Sur le plan économique, le rapport Bain, qui a été commandé par la direction de la SNCF et qui fait désormais référence, a montré qu’il existe un surcoût de 30 % de la main-d’œuvre des cheminots SNCF par rapport aux agents de VFLI, filiale privée de la SNCF.
Cette différence de coût s’explique d’abord par des écarts de productivité liés à la polyvalence, au salaire moyen moindre et au nombre de jours travaillés plus importants des agents de VFLI, ensuite par des coûts de structure et d’encadrement deux fois plus importants à la SNCF que chez VFLI et, enfin, par des charges spécifiques à la SNCF.
Vous savez tous que le fret ferroviaire est pénalisé par sa faible compétitivité. Imposer ce surcoût de 30 % à tous les opérateurs concurrents de la SNCF serait, à coup sûr, le meilleur moyen de ralentir son redressement et de ne pas atteindre les objectifs de report modal fixé par le Grenelle de l’environnement. C’est à la SNCF de réduire progressivement et dans le temps cet écart, afin de ne pas pénaliser le personnel régi par le statut.
Sur le plan juridique, il ne faut pas méconnaître la liberté contractuelle et rayer d’un trait de plume tout le travail réalisé par les partenaires sociaux. En effet, les syndicats et les organisations professionnelles ont signé en juin 2007 un accord de branche pour définir justement le champ d’application de la convention collective nationale de branche du transport ferroviaire. Un accord de branche a été conclu le 14 octobre 2008 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, et un autre accord vient d’être conclu sur la classification et la qualification.
Plutôt que de parler de convention collective harmonisée, avec le risque que les instances communautaires jugent cette uniformisation contraire au droit de la concurrence, il vaut mieux, selon moi, parler de convergence entre les multiples accords de branche du privé et le décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, le fameux RH 0077.
Voilà, mes chers collègues, le fruit des réflexions du groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire que j’ai eu l’honneur de présider, et les raisons personnelles qui m’incitent à être défavorable à la proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Claude Biwer applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis de l’occasion qui nous est donnée aujourd’hui de débattre du fret ferroviaire au détour de la proposition de résolution déposée par mes collègues du groupe CRC-SPG. C’est une préoccupation majeure, parce que le fret est frappé par deux crises.
La première, la crise économique, conjoncturelle, a terriblement affecté les volumes de trafic entre 2008 et 2010. Les indicateurs semblent heureusement repartir à la hausse.
La seconde crise que connaît le fret est plus grave, car elle est structurelle.
En effet, le secteur du fret ferroviaire connaît, depuis sa séparation des activités de transport de voyageurs, des déficits structurels. Le maillage territorial autour de grands axes souffre à la fois d’un retard dans les investissements du réseau et d’un manque d’ambition pour le report de l’activité de transport de marchandises longue distance de la route, grande productrice de CO2, vers le rail.
Certes, des réformes ont été engagées, que ce soit en matière de déploiement du personnel, de rationalisation de la carte des dessertes, d’ouverture théorique à la concurrence, mais nous sommes loin, très loin, d’une réforme d’ampleur, ambitieuse, telle que l’Allemagne l’a conduite ces dernières années.
Il est donc urgent de porter une ambition nationale pour le fret, ce que le Grenelle avait amorcé, pour deux raisons principales.
La première raison est que le développement du fret est une réponse à la problématique environnementale. En effet, sur les longues distances, il est nettement moins polluant que le transport par camions. En outre, en reportant sur le rail une partie du transport routier de marchandises, on améliore sensiblement la fluidité du trafic sur les grands axes autoroutiers, et donc la sécurité routière.
La deuxième raison qui fonde le nécessaire développement d’une politique publique forte en faveur du fret relève d’une approche globale.
En effet, le fret ferroviaire constitue un levier pour développer une politique cohérente de développement industriel, en améliorant le transport des produits chimiques ou encore des produits industriels lourds ou volumineux.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne peux m’empêcher, vous le comprendrez, de penser au transport des déchets nucléaires qui, un jour, seront stockés dans mon département. On s’apercevra peut-être qu’il est plus sûr de profiter d’un transport par le rail...
Le fret ferroviaire est aussi un vecteur important d’aménagement économique du territoire. En effet, le fret doit servir le désenclavement des bassins de production, industrielle, agricole, sylvicole, en les reliant aux métropoles nationales et aux grandes infrastructures, telles que les ports de marchandises, les aéroports, en France comme dans les pays frontaliers.
D’ailleurs, réciproquement, le développement des ports fluviaux et maritimes favorisé par l’internationalisation des échanges ne se fera pas sans l’intermodalité du rail.
Bref, la politique publique en faveur du fret est un levier considérable de développement économique et d’aménagement du territoire, à condition qu’on lui donne les moyens de se développer. En ce sens, les propositions du groupe CRC-SPG ne me semblent pas complètement satisfaisantes.
En effet, d’une part, la restructuration profonde de ce secteur va nécessairement de pair avec une rationalisation des emplois, de la carte des dessertes. Les syndicats allemands ont d’ailleurs participé à la détermination des mesures assez radicales – fermeture d’un tiers des gares de fret, diminution de la moitié des effectifs du principal opérateur, flexibilisation accrue du temps de travail –, afin de réaliser les gains de productivité indispensables à la relance de l’activité.
Certes, c’est un coût social qu’il faut assumer, mais, aujourd’hui, le fret allemand est solide, en croissance ; il embauche de nouveau et se déploie dans l’ensemble de l’Europe.
En outre, je ne partage pas complètement votre point de vue sur le wagon isolé. Oui, il est nécessaire de conserver, à titre de service public, le wagon isolé, ainsi que les embranchements sur site. Mais la revitalisation du fret passe, en premier lieu, par le développement économique de ses acteurs et par une remise aux normes de son réseau.
Or, la première priorité est de redonner confiance aux entreprises et donneurs d’ordres en améliorant la fiabilité et la qualité du réseau. Dans ce domaine, le défi est sans précédent !
En outre, si le maintien du wagon isolé est une préoccupation importante en termes d’aménagement du territoire, il faut accepter que celle-ci ne soit pas forcément la première mesure de sauvetage du fret.
Il faut fiabiliser le réseau dans son ensemble pour redonner confiance au secteur du transport par fret. Pendant les travaux de rénovation, et peut-être même au-delà, les trains de marchandises pourraient d’ailleurs emprunter, la nuit, les axes structurants de transports de voyageurs. Actuellement, même les TGV parcourent des distances importantes sur des réseaux existants, dans l’attente de la construction de réseaux nouveaux.
Ce n’est pas sans raison si, pour le nord de la Lorraine, dont je suis, l’acheminement se fait par Rotterdam et Anvers, qui ont une gestion humaine et rationnelle de l’emploi dans ce secteur désormais concurrentiel.
En revanche, l’idée d’une taxe sur les poids lourds pour financer la rénovation des infrastructures de fret est, selon moi, souhaitable. Dans le cadre d’un rapport que j’avais conduit, en collaboration avec Mme Alquier, notre collègue socialiste, sur le niveau d’équipement de la France en infrastructures de transports et ses conséquences sur le désenclavement des régions françaises, nous avions proposé une « taxe au kilomètre », qui aurait remplacé la taxe à l’essieu payée uniquement par les entreprises françaises. Elle aurait été payée par tout le monde, son application étant contrôlée par satellite, et aurait apporté à l’AFITF, outre des mesures portant notamment sur des plus-values, des compléments de financement non négligeables.
Malheureusement, si la délégation à l’aménagement et au développement durable du territoire du Sénat – je me tourne vers vous, monsieur le président de la commission de l’économie – a unanimement adopté ce rapport, ses propositions n’ont jamais franchi les portes de l’Assemblée nationale, ce que, bien sûr, je regrette.
Nous avons mené une tentative identique, par le biais du groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire, dont le président, M. Grignon, s’est exprimé tout à l’heure. Or, nous sommes contraints de le constater, la situation est de nouveau difficile, et les voies – politiques, cette fois-ci ! – se resserrent. Nous cherchons encore à trouver le bon créneau pour évoquer ce problème de manière efficace.
Malgré une ambition commune pour développer le fret ferroviaire, notre point de vue diverge de celui du groupe CRC-SPG sur les mesures à prendre et la priorité qu’il convient de donner à chacune d’entre elles.
Telles sont les observations que je souhaitais formuler au nom du groupe de l’Union centriste, qui estime que cette proposition de résolution devrait être amendée afin de pouvoir être soutenue et adoptée.
Au demeurant, nous comptons sur vous, monsieur le secrétaire d’État, pour que la voie du fret ferroviaire ne soit jamais barrée.
Sourires. – Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au sein des modes de transport de marchandises, la part du fret ferroviaire et fluvial est tombée de 42 % en 1984 à 14 % en 2007. Depuis, cette part a encore baissé, le fret ferroviaire ne représentant plus en France, en 2008, que 40 milliards de tonnes-kilomètres, soit 10 % de tous les modes de transport intérieur confondus.
L’activité fret de la SNCF a été divisée par deux. Elle a entraîné chaque année des pertes importantes conduisant à plusieurs plans de relance et à deux refinancements au moins.
L’ouverture à la concurrence, depuis 2006, s’est traduite pas l’arrivée de nouveaux opérateurs, qui détiennent désormais une part de marché de 16 %. Le développement de leur activité s’est fait essentiellement au détriment de Fret SNCF.
Cet état des lieux nous conduit à nous poser plusieurs questions. Quelles sont les causes du déclin des transports de marchandises par le train ? Les pouvoirs publics ont-ils pris conscience de cette situation ? Quelles sont les mesures à prendre pour relancer l’activité du fret ferroviaire en France ?
Je commencerai par évoquer les causes principales du déclin du fret ferroviaire.
La première, c’est le mauvais état d’un certain nombre de lignes sur lesquelles circulent des trains de fret.
La deuxième cause, ce sont des règles du jeu qui pénalisent le mode ferroviaire par rapport au mode routier. Actuellement, en effet, tous les coûts externes du transport routier de marchandises – pollution de l’air, CO2, insécurité routière, usure et congestion des réseaux routiers – ne sont pas intégrés à sa tarification. Il en résulte un avantage important pour le transport routier de marchandises, pourtant globalement plus coûteux pour la collectivité nationale que les autres modes de transport.
La troisième cause, c’est la désindustrialisation de la France et la faiblesse en tonnage des ports maritimes français.
Les pouvoirs publics ont-ils pris conscience de cette situation ? La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 », a mis l’accent sur un développement performant et sobre en carbone du transport des marchandises. Il s’agit de faire passer de 14 % à 25 % à l’échéance 2022 la part modale du non-routier et du non-aérien, avec une première étape à 17, 5 % en 2012. Cette croissance serait assurée par le fret ferroviaire pour 85 % et par le transport fluvial pour 15 %.
En 2009, l’État a arrêté un engagement national pour le fret ferroviaire d’un montant de 7 milliards d’euros. On pouvait donc penser que les pouvoirs publics avaient pris conscience de la nécessité de relancer le fret ferroviaire. Cette impression ne résiste toutefois pas à l’analyse.
En effet, la loi dite « Grenelle 2 » est très en retrait par rapport aux bonnes orientations du Grenelle 1. Quant à l’Engagement national pour le fret ferroviaire, son financement n’est pas réellement assuré. Le Gouvernement vient, en outre, de repousser la mise en place de l’eurovignette et de la taxe carbone.
En revanche, la SNCF, qui, dans le cadre de cet engagement national, doit investir 200 millions d’euros par an pendant cinq ans pour conforter son activité fret, a tenu, à ce jour, son engagement.
Le constat de la faible motivation de l’État nécessite donc de prendre des initiatives à sa place. C’est la mission que s’est assignée le groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire mis en place par la commission de l’économie du Sénat, qui a, notamment, organisé une table ronde réunissant de nombreux acteurs œuvrant dans le ferroviaire. Il convient de noter, monsieur Bussereau, que le secrétariat d’État chargé des transports n’y était pas représenté.
La proposition de résolution déposée par nos collègues du groupe CRC-SPG, dont nous débattons aujourd’hui, constitue une autre initiative intéressante, approuvée par le groupe socialiste.
En effet, les ambitieux objectifs du Grenelle 1 nécessitent la mise en place d’un plan volontaire en matière de développement du fret ferroviaire.
Dans le contexte de libéralisation voulue par la Commission européenne, libéralisation que le groupe socialiste désapprouve, mais qui est une réalité, ce plan doit nécessairement comporter les trois actions suivantes.
Première action, il faut fixer des règles du jeu qui ne pénalisent pas un mode de transport par rapport à un autre, ou un ou des opérateurs ferroviaires par rapport à son ou leurs concurrents.
En effet, le constat est le suivant : tous les coûts externes – pollution de l’air, CO2, insécurité routière, congestion du trafic et détérioration des réseaux routiers –, qui pourraient représenter, selon la Commission européenne, 210 milliards d’euros à l’horizon 2020, ne sont pas intégrés. L’instauration de l’eurovignette, d’ailleurs prévue par la législation européenne, serait un bon moyen d’internaliser dans la tarification l’ensemble des coûts externes du transport routier de marchandises. Il en va de même pour la taxe carbone, qui devrait s’appliquer à tous les engins thermiques polluants, qu’ils soient routiers ou ferroviaires. Malheureusement, le Gouvernement a repoussé la mise en œuvre de ces deux mesures.
De fait, bien que bon nombre d’entre eux y soient réticents, les transporteurs routiers français auraient intérêt à ce que soit mise en place une fiscalité écologique leur permettant de lutter à armes égales avec les transporteurs routiers des autres États, lesquels peuvent effectuer des acheminements intérieurs en profitant de la possibilité ouverte par le cabotage.
Au sein du mode ferroviaire, il apparaît que la SNCF est plus chère que la concurrence, en raison, notamment, de coûts d’organisation plus élevés.
Comme il n’est pas envisageable d’égaliser « par le bas » les conditions sociales des personnels, il convient d’œuvrer en faveur d’une harmonisation sociale européenne et française « par le haut », seule susceptible de créer des conditions équitables de concurrence.
Dans l’attente de cette harmonisation, qui ne pourra intervenir qu’à moyen ou à long terme, pourquoi ne pas mettre en place un dispositif qui, à l’instar de ce qui existe en Allemagne, permettrait de faire supporter le différentiel financier, tant qu’il existera, par une structure ad hoc ?
Le transport par wagon isolé est essentiel pour assurer un bon maillage du territoire. Son coût est cependant jusqu’à deux fois plus élevé que celui du transport par la route. Il apparaît en outre que les nouveaux opérateurs se limitent au transport de trains entiers, laissant la SNCF supporter les pertes du transport par wagon isolé.
C’est pourquoi le groupe socialiste estime qu’il est indispensable d’adopter des mesures favorisant le développement de la demande de transport en wagon isolé, de manière à soutenir l’offre de service et l’augmentation de la qualité. Il pourrait être prévu, par exemple, d’octroyer des primes, ou des avantages fiscaux, aux entreprises qui ont recours aux services ferroviaires pour acheminer leurs produits.
La Commission européenne pourrait en outre réfléchir à d’autres mesures de soutien. Malheureusement, dans la proposition de règlement, actuellement en discussion, relative aux réseaux ferroviaires européens pour un fret compétitif, centrée essentiellement sur la mise en place de mécanismes de marché, cette possibilité n’est pas évoquée.
Pourtant, le Grenelle de l’environnement a montré qu’une approche fondée sur la seule pertinence économique n’est plus tenable. Une autre logique, qui s’appuie sur la dimension « aménagement du territoire » est nécessaire. Elle repose sur la reconnaissance du caractère d’intérêt général du fret ferroviaire, reconnaissance permettant le recours à la procédure de la délégation de service public. Cela permettrait au fret ferroviaire de bénéficier d’un modèle économique solide autorisant les aides non seulement à l’investissement, mais également, si nécessaire, à l’exploitation.
Deuxième action, il convient de mettre à niveau le réseau ferré existant afin d’assurer le développement du fret ferroviaire, dans le respect du Grenelle de l’environnement.
Entre 1980 et 2008, l’évolution des réseaux autoroutier et ferroviaire a été diverse : le réseau autoroutier est passé de 4 800 kilomètres à plus de 11 000 kilomètres et le réseau ferroviaire, de 34 362 kilomètres à 29 473 kilomètres.
Voilà cinq ans, le rapport de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, dit rapport Rivier, a pointé le mauvais état d’un certain nombre de lignes, particulièrement celles des groupes UIC 7 à 9, sur lesquelles circulent essentiellement les TER, mais aussi des trains de fret.
Depuis quelques années, un effort important a été consenti par RFF, qui a augmenté le montant des crédits consacrés à la régénération, mais sans atteindre le niveau préconisé par le rapport Rivier. Certaines régions sont également intervenues, et interviennent encore aujourd’hui, pour améliorer les infrastructures ferroviaires sur lesquelles circulent des TER.
Le programme de régénération doit donc être amplifié. Il convient d’électrifier un certain nombre de lignes – je pense en particulier à la ligne Serqueux-Gisors en région parisienne – en vue de constituer des corridors dédiés ou principalement affectés au fret.
La question est posée, en outre, de savoir s’il ne faudrait pas rendre obligatoire la connexion au réseau ferroviaire des zones d’activités le justifiant.
Pour réaliser cette mise à niveau, il incombe à l’État d’arrêter rapidement un plan de résorption de l’énorme dette de RFF, qui atteignait 27, 8 milliards d’euros en 2009.
Quant aux enveloppes financières mises à disposition de l’AFITF, elles doivent être pérennisées.
J’en viens à la troisième action du plan de développement du fret ferroviaire : le développement de nouveaux services à côté des services existants. Je me bornerai à décrire quelques exemples de services envisageables.
Premier service envisageable : les trains longs. Un protocole d’accord a été signé, le 25 mars 2010, entre RFF, les acteurs du fret ferroviaire et les chargeurs afin d’expérimenter ce type de trains. En prévoyant de porter à 1 000-1 500 mètres la longueur moyenne des trains et de 2 000 à 4 000 tonnes le poids moyen, contre 750 mètres et 1 400 tonnes actuellement, le train long devrait rendre le transport de fret moins coûteux en sillons pour le transporteur.
Deuxième service envisageable : le soutien aux opérateurs ferroviaires de proximité, notamment dans les ports. Si le fait que sept sociétés européennes de fret ferroviaire ont conclu l’alliance X-Rail pour accroître la qualité et la compétitivité du transport européen par wagon isolé face au transport routier est une bonne chose, il est dommage que la SNCF ne fasse pas partie de cette alliance. Elle s’en tient pour le moment à son projet d’activité « multi-lots multi-clients », organisée autour de onze sites seulement, et s’oriente vers des accords bilatéraux.
La SNCF doit prendre sa part de ce défi, rejoindre cette alliance, conserver ses gares de triage et s’engager dans le capital des opérateurs de proximité, reconnus par la loi. Dans le même temps, le rôle et les missions des opérateurs ferroviaires de proximité doivent être circonscrits à leur zone de chalandise, pour éviter qu’ils ne deviennent des opérateurs ferroviaires en tant que tels. On a cité tout à l’heure le port de La Rochelle ; je crois, monsieur le secrétaire d’État, que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Une nouvelle loi est par conséquent nécessaire pour définir avec précision les missions de ces opérateurs ferroviaires de proximité.
Troisième service envisageable : le développement du transport de messagerie à grande vitesse. J’insiste sur cette notion de messagerie, qui ne doit pas être confondue avec celle de transport lourd. Il s’agit donc du développement du TGV fret et du développement des trains de messagerie à vitesse élevée sur les lignes classiques réaménagées.
Cela étant, les services traditionnels comme le transport combiné – qui associe le rail et la route – sont essentiels. Cela passe notamment par le renforcement des autoroutes ferroviaires. La liaison entre Bettembourg, ville du Luxembourg, et Rivesaltes étant concluante, il convient d’étendre la liaison entre Aiton et Orbassano, ville italienne, à la liaison Lyon-Turin, et d’ouvrir de nouvelles autoroutes ferroviaires, notamment sur la façade ouest de la France entre le Nord et la Méditerranée, ainsi qu’en provenance du Havre.
En conclusion, le développement du fret ferroviaire nous paraît constituer l’une des priorités européennes et nationales. Il exige donc la mise en place et la réalisation de toutes les actions que je viens de décrire et qui devraient être inscrites dans un plan global.
La question est la suivante : la volonté politique existe-t-elle au niveau de l’État ? Comme nous en doutons, nous demandons un moratoire sur l’abandon partiel de l’activité « wagon isolé » et la préservation des installations ferroviaires en attendant l’organisation d’états généraux, ou d’un « Grenelle », du fret ferroviaire, que nous appelons de nos vœux dans un avenir proche.
Quant à la Commission européenne, elle devrait, avant toute révision du premier paquet ferroviaire – actuellement en cours d’examen –, dresser un bilan objectif et contradictoire des effets de l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, et accepter de modifier sa position en autorisant des mesures de soutien.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste est favorable à l’adoption de la proposition de résolution du groupe CRC-SPG.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la résolution relative au développement du fret ferroviaire, sur laquelle nous devons nous exprimer cet après-midi, permet de rappeler combien le transport ferroviaire de marchandises correspond à une activité d’intérêt général. Elle propose, pour ce faire, l’instauration d’une taxe sur les poids lourds pour tenir les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, en termes de réduction d’émission de gaz à effet de serre dus aux transports et pour soutenir réellement l’activité du fret ferroviaire. Elle prévoit également un moratoire sur l’abandon partiel de l’activité « wagon isolé » et la préservation des installations ferroviaires.
En effet, dès la mise en place des protocoles inhérents au Grenelle de l’environnement, le Gouvernement s’était engagé à diminuer la pollution – notamment l’émission de gaz à effet de serre – provoquée par le transport de marchandises par les poids lourds. Plus exactement, il s’agissait de faire passer les modes de transports alternatifs à 25 % au moins à l’horizon 2012. Pour cela, il était prévu de mettre en place une taxe sur les camions, taxe qui n’a toujours pas vu le jour en raison sans doute des risques de conflits sociaux et de blocages économiques qu’elle ferait courir au pays.
Simultanément, pour des raisons de rentabilité, Réseau Ferré de France et la SNCF ont décidé de geler leurs investissements relatifs à l’augmentation du fret ferroviaire. En chiffres, cela s’est traduit par une régression du nombre de kilomètres de voies réservés à ce type de transport. En 1980, notre pays disposait de 34 000 kilomètres de voies ; en 2009, il n’en comptait plus que 29 000. On le voit bien, le réseau ferré souffre ainsi d’une dégradation évidente de ses infrastructures.
Réseau Ferré de France est aujourd’hui un établissement étouffé par la dette contractée à sa création qui obère ses capacités d’investissement et de rénovation du réseau. Il est évident que d’un strict point de vue économique la route reste donc plus compétitive que le rail.
Aujourd’hui, quel constat peut-on faire ? Nous sommes tous d’accord dans cet hémicycle pour affirmer, avec force et vigueur, qu’il est urgent de donner un nouveau souffle au fret ferroviaire par un programme de grande ampleur en faveur d’un nouveau réseau de transport écologique de marchandises. De la même façon que nous sommes passés il y a quelques années, pour le transport de voyageurs, du Corail au TGV, nous devons donner au plus vite corps à une réelle ambition nationale pour le transport de marchandises et passer à une nouvelle étape favorisant l’innovation et la créativité.
Pour cela, les axes de proposition peuvent être multiples. Il peut s’agir de la mise en place d’autoroutes ferroviaires, du développement du transport combiné, voire de la multiplication des opérateurs ferroviaires de proximité, ou même de la suppression progressive des principaux points de congestion du réseau ferré national.
Quoi qu’il en soit, les entreprises ferroviaires opérant en France doivent se développer au niveau européen pour proposer des offres de transports performantes et innovantes, et renforcer ainsi leur compétitivité par rapport aux transports routiers.
Cet engagement national, que nous appelons tous de nos vœux, doit impérativement se traduire par un investissement public massif de la part de l’État et des établissements concernés. Il importe donc que RFF et la SNCF se mobilisent pleinement pour atteindre ces objectifs. Cet engagement national pour le fret ferroviaire doit correspondre à terme à une réduction annuelle drastique du nombre de poids lourds en circulation sur nos routes. Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’avec la mobilisation et la participation de tous les acteurs économiques concernés. L’État devra obligatoirement accompagner fortement la SNCF par des mesures significatives, pour que celle-ci se positionne au mieux dans le transport du fret du XXIe siècle.
Nos collègues du groupe CRC-SPG demandent au Gouvernement d’instaurer rapidement une taxe poids lourds dont les recettes doivent être fléchées pour les investissements sur le réseau ferré. Cette taxe contribuerait fortement à une politique de « croissance verte », de création d’activités économiques de substitution et, par conséquent, d’emplois, ainsi que de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
C’est un fait, l’État ne doit pas se contenter d’un rôle de régulateur et de soutien aux initiatives favorisant le fret ferroviaire, il ne doit pas se soustraire à ses responsabilités en arguant du fait que la concurrence entre les acteurs pourrait encourager de telles initiatives. Non, nous pensons que l’État doit aller encore plus loin en utilisant intelligemment et à bon escient tous les outils se trouvant à sa disposition, singulièrement l’outil fiscal, qui pourrait être un instrument de régulation.
C’est pourquoi le groupe RDSE, dans sa grande majorité, apportera son soutien à cette proposition de résolution dans la mesure où elle permettrait à notre Haute Assemblée d’affirmer combien le fret ferroviaire doit constituer une priorité pour notre politique nationale de transports.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Michel Teston applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Mireille Schurch vient de rappeler notre attachement au développement du fret ferroviaire dans l’intérêt de la population et de l’aménagement du territoire, pour la qualité de notre environnement. Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, le fret ferroviaire est une question qui concerne éminemment le développement économique de notre pays.
Je me suis adressée à vous le 9 octobre 2007 à propos de la fermeture de deux cent soixante-deux gares de fret, puis le 14 septembre dernier à propos de l’intérêt économique, social et écologique du « wagon isolé ».
En 2007, je tirais la sonnette d’alarme en m’appuyant sur l’inquiétude exprimée par les entreprises de ma région. Je vous rappelais que là où l’économie repose sur le dynamisme des petites et moyennes entreprises, dans le Grand Ouest, vous organisiez le vide. J’insistais en ces termes : « Avant d’avoir à déplorer la désindustrialisation de notre région, il serait bon de préserver les principales dessertes ferroviaires. »
Au nom des chefs d’entreprise concernés je vous invitais à apporter des solutions pérennes. Aussi, c’est avec intérêt que j’ai écouté votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, le 14 septembre dernier. Vous affirmiez : « Concernant l’activité « wagons isolés », ce schéma s’appuiera sur une organisation de transport qui comportera, d’une part, des services sur mesure pour les produits industriels lourds, encombrants et dangereux et, d’autre part, des trains composés de wagons « multi-lots multi-clients ». Dans ce cadre, les clients grands comptes dans un premier temps, puis les PME-PMI dans un second temps, ont été rencontrés afin de préciser leurs besoins. »
Or, monsieur le secrétaire d’État, j’ai voulu vérifier sur le terrain la mise en œuvre des facilités accordées aux PME pour qu’elles puissent continuer à faire transporter leurs produits par le rail. J’ai constaté que les entreprises concernées se comptaient à peine sur les doigts d’une main.
Les « multi-lots multi-clients » me semblent en effet appropriés pour certains chargeurs. Or, j’ai remarqué que pour ceux à qui cela pouvait convenir, malgré les efforts effectués au niveau local par les services de la SNCF, l’aboutissement et la réalisation étaient bien souvent difficiles, et pour une durée bien incertaine.
Les entreprises vont être assujetties à des surtaxes ou des augmentations dont le coût risque d’être dissuasif. Ces chargeurs vont être poussés vers la route, alors que de nombreux routiers eux-mêmes commencent à être acquis à l’idée que ce mode de transport n’est véritablement pertinent et rentable que pour les derniers ou les premiers kilomètres, dans un rayon de cent cinquante kilomètres maximum. Quant au transport des matières dangereuses dont chacun s’accordera, je pense, à estimer que nous avons tous intérêt à ce qu’il se fasse par le rail, j’apprends que, comme pour les wagons isolés, la SNCF lance un véritable ultimatum à ses interlocuteurs. Je vous parle de la situation dans laquelle se trouve la société Primagaz, et il s’agit de 130 000 tonnes transportées sur le territoire national chaque année depuis vingt ans.
Nous sommes loin de la négociation dont vous parliez dans votre réponse à ma question orale.
Je pense donc, monsieur le secrétaire d’État, qu’il est urgent de retravailler avec la SNCF pour qu’une réponse véritablement adaptée aux besoins des entreprises soit enfin apportée. Aussi, je vous demande que, avant la fin de l’année, une étude précise des flux ferroviaires soit réalisée par la SNCF. C’est la seule solution pour que l’économie locale de nos régions puisse se développer en respectant des critères sociaux, économiques et écologiques.
J’ai voulu vérifier comment une gare de fret SNCF comme celle de Saint-Pierre-des-Corps fonctionnait aujourd’hui après les différents plans et réformes. Ma collègue Evelyne Didier aurait pu vous faire part de l’état de la situation sur le site de Conflans-Jarny.
Lors d’une visite effectuée lundi dernier, j’ai pu me rendre compte des conséquences des mesures prises ces dernières années. La dégradation des voies est impressionnante. Sur les trente-quatre voies de l’ex-gare de triage, vingt sont complètement inutilisables. Avec les quatorze autres voies, « on se débrouille », comme le disent les responsables du site. Compte tenu de l’état dans lequel j’ai pu les voir, je me demande même si elles seront encore en activité l’année prochaine. C’est un véritable gâchis ! Surtout quand on sait que quatorze cents wagons passaient sur ce site chaque jour jusqu’en 2007. Qu’est-ce qui justifie un tel abandon ? Des critères de rentabilité immédiate, un refus de prendre en compte l’importance de cet outil dans un plan relatif aux transports, que vous avez préféré développer par la route – la décision concernant les poids lourds de quarante-quatre tonnes va bien dans ce sens.
Je dois vous le dire, si je ne m’attendais pas à ce que la dégradation matérielle du site soit aussi importante, j’ai en revanche été très impressionnée par une équipe de direction fortement impliquée dans son travail, et convaincue qu’il est encore possible de faire vivre du fret ferroviaire, particulièrement sur le site de Saint-Pierre-des-Corps. Ils savent, et ils sont bien placés pour le savoir, que c’est un carrefour, un nœud, actuellement sous-exploité économiquement.
La remise en état des voies serait la première mesure à prendre pour réactiver cette gare de fret. Si la SNCF veut véritablement jouer son rôle, RFF doit pouvoir engager les investissements nécessaires.
Le 14 septembre dernier, monsieur le secrétaire d'État, vous proposiez de faire de Saint-Pierre-des-Corps la plateforme dont le Grand Ouest a besoin. Comme le dit ma collègue Mireille Schurch, il faut donc entrer dans le concret dès maintenant !
De l’avis de nombreux professionnels, il y a moyen de réactiver et de développer un trafic Nord-Sud, que tout le monde reconnaît comme dynamique. Pourquoi ne pas étudier également les possibilités sur l’axe Ouest-Est, qui, de Nantes à Lyon, pourrait déboucher sur l’Est européen ?
Des études doivent être rapidement mises en place. Mais, monsieur le secrétaire d'État, comment une entreprise telle que la SNCF peut-elle développer son action commerciale en n’ayant plus que quatre commerciaux sur la très grande région Ouest, laquelle est, de surcroît, dirigée par ou depuis Paris ?
Aujourd’hui, c’est à partir des demandes des entreprises, à partir des capacités de développement de nos territoires, que peut être relancée l’activité fret, en particulier celle des wagons isolés. C’est pourquoi je ne comprends toujours pas pourquoi la France s’est retirée du projet européen X-Rail.
Je prends de nouveau l’exemple de Saint-Pierre-des-Corps. Vous savez que nous rachetons les anciens magasins généraux. C’est un site de seize hectares embranchés qui pourrait donner un véritable coup de fouet à notre économie. Mais comment progresser sur un tel projet pour que des entreprises s’intéressent à des liaisons ferrées si, en même temps, le site de triage devient un cimetière de wagons laissés à l’abandon ?
J’ai été intéressée par les propos que vous teniez le 14 septembre dernier concernant les plateformes « multi-lots multi-clients ». Vous déclariez ceci : « Elles seront principalement approvisionnées par le mode ferroviaire. Les décisions concernant leur localisation seront arrêtées à l’issue de la concertation en cours. » Vous ajoutiez pour illustrer votre propos : « La SNCF s’est ainsi engagée à mettre en place, en concertation avec les acteurs économiques et politiques locaux, des dispositifs d’accompagnement de son schéma directeur pour le transport de marchandises au service des territoires, dont Saint-Pierre-des-Corps, qui est une plaque tournante importante. »
Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'État, qu’il est temps que le Gouvernement concrétise les choix qu’il a décidé d’inscrire dans le Grenelle de l’environnement et qu’il s’en donne les moyens ? Vous avez décidé d’abandonner les recettes des autoroutes, préférant que de grands groupes privés en fassent profiter leurs actionnaires. La mise en place de la taxation sur les poids lourds devait alimenter l’AFITF, mais elle est encore retardée. Pourtant, une telle taxation a déjà été mise en place en Suisse, en Allemagne et en République tchèque.
Au travers de notre projet de résolution, nous affirmons notre volonté politique de faire le choix du rail pour le transport de marchandises, le choix de la SNCF comme entreprise intégrée. Ce choix ne se réduit pas aux aspects techniques ; il est celui d’une autre conception d’organisation de notre vie économique, du respect de l’environnement, et il est aussi celui d’un autre type de société. De plus, il est urgent de prendre des décisions.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Michel Teston applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au préalable, je voudrais féliciter Francis Grignon de son excellent rapport, dont, bien évidemment, je soutiens l’intégralité des propositions, qui sont constructives. Cela m’est d’autant plus aisé que je tiens à souligner la haute qualité des échanges au sein du groupe de travail – auquel j’ai eu l’honneur de participer –, malgré les sensibilités politiques très diverses de ses membres.
Pour autant, la situation actuelle nous interpelle. Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics pour relancer le fret ferroviaire, que ce soit le contrat de performance de novembre 2008, que ce soit l’engagement national pour le fret ferroviaire de septembre 2009, que ce soit le schéma directeur pour un nouveau transport écologique des marchandises de 2009, plus connu sous le terme d’offre « multi-lots multi-clients », malgré toutes ces actions, nous faisons tous le même diagnostic, monsieur le secrétaire d'État : la situation est très dégradée.
En effet, pour reprendre un titre du rapport, nous constatons « un déclin continu du fret ferroviaire en France ». En 1950, le train assurait le transport des deux tiers des marchandises en France, le transport de marchandises étant alors le fer de lance de la SNCF. Aujourd’hui, elle en assure seulement 10 %, et ce en dépit des nombreux plans de réforme successifs du fret qu’elle a menés. §C’est la vérité !
Cette situation est d’autant plus inquiétante que cet effondrement du fret ferroviaire, hors effets de la crise, n’est pas systématique en Europe. Je constate qu’il ne s’est pas produit dans certains pays européens de niveau équivalent à la France.
Force est donc de constater que le fret ferroviaire résiste moins bien en France que chez certains de ses voisins. Cette distorsion pose problème et nous interpelle.
En Allemagne, le trafic total est aujourd’hui quatre fois plus important qu’en France, avec 110 milliards de tonnes-kilomètres en 2008, contre seulement 30 milliards dans l’Hexagone.
En Suisse, le trafic de marchandises transportées par voie ferroviaire a enregistré une croissance d’un tiers entre 1990 et 2007, passant de 53 millions à 71 millions de tonnes de marchandises.
Enfin, en Grande-Bretagne, où les droits de péage sont pourtant trois fois plus cher qu’en France, le fret a crû de 11 % depuis 2002, alors même, mes chers collègues, qu’il baissait de 67 % dans notre pays au cours de la même période !
Bref, vous l’avez compris, le déclin du fret ferroviaire n’est pas une fatalité ; des pays comparables au nôtre réussissent mieux que nous. Sommes-nous condamnés à échouer ? Nous avons, ici même, voté le Grenelle de l’environnement, avec les objectifs ambitieux que l’on sait. Il serait tout de même consternant que la France vote le Grenelle, mais que ce soient ses voisins qui le mettent en pratique !
Que répondre, monsieur le secrétaire d'État, à notre collègue Jean-Pierre Vial, élu en Savoie, qui s’inquiète, à juste raison, de l’absence de décision officielle du gouvernement français sur le projet d’infrastructure majeur pour le fret que constitue la liaison Lyon-Turin, alors que l’échéance expire à la fin de l’année 2010 ?
Que répondre à notre collègue Antoine Lefèvre, élu dans l’Aisne, où les élus locaux ont engagé un million d’euros pour desservir, par voie ferroviaire, une zone qui risque de ne plus l’être ?
Enfin, que répondre à une très grande entreprise française qui, après vingt ans de partenariat avec la SNCF, se sent brutalement abandonnée par l’entreprise publique ?
Pour ma part, je me refuse à rester dans la sphère des vœux pieux et des incantations. Je souhaite que tous les moyens soient mis en œuvre pour que la loi dite « Grenelle 1 », qui prévoit, à son article 11, que la part modale du non-routier et du non-aérien passe de 14 % à 25 % à l’échéance de 2022, soit respectée.
Je voudrais maintenant m’attarder sur le contenu de la proposition de résolution présentée par le groupe CRC-SPG, en rappelant quelle a été la position du groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire.
Les auteurs de la proposition de résolution souhaitent que le transport ferroviaire de marchandises soit déclaré d’intérêt général. Or, comme l’a excellemment indiqué notre collègue Francis Grignon, cette proposition ne nous paraît pas crédible. Nous préférons, quant à nous, lancer la réflexion sur la possibilité d’attribuer des subventions pour des lignes de fret déficitaires qui répondraient à une logique forte d’aménagement du territoire.
J’ajouterai que nous devons mener deux actions en parallèle : d’une part, il faut rétablir le fret SNCF sur des fondations saines, ce qui passe par la mise en application, au minimum, du plan « multi-lots multi-clients » ; d’autre part, et c’est pour nous essentiel, il nous faut avoir une vision plus volontariste et plus ambitieuse pour repartir à la reconquête des parts de marché, à l’instar des autres opérateurs européens.
Pour cela, nous devons libérer les énergies en transformant la SNCF pour la faire passer du statut d’administration à celui d’entreprise, en stimulant le recours aux opérateurs ferroviaires de proximité ou en subventionnant les voies de raccordement. Déclarer globalement d’intérêt général le fret ferroviaire aboutirait à rendre inutile toute réforme en interne de la SNCF, ce qui, selon nous, serait le meilleur moyen, à terme, d’affaiblir voire de faire mourir l’activité fret de la SNCF.

Cela, je ne l’accepterai pas, car la SNCF est une entité majeure, au savoir-faire reconnu, qui doit conserver un rôle de premier plan.
Les auteurs de la proposition de résolution souhaitent également une législation spécifique au secteur routier permettant d’internaliser les coûts externes – notamment les coûts environnementaux – d’un transport qui fait partie intégrante désormais de toute logistique moderne.

Sur ce point, comme je l’ai proposé la semaine dernière en commission de l’économie, je souhaite que l’on dépasse les combats idéologiques ou les guerres de tranchées, qui ne permettent pas de progresser objectivement.
Aussi, je confirme ma proposition qu’on mette fin à ces querelles stériles une fois pour toutes, en confiant l’étude des coûts externes du secteur routier à un organisme impartial comme le Conseil général de l’environnement et du développement durable.
En conséquence, et bien évidemment dans la lignée des propositions différentes que nous avons faites dans le rapport, nous ne pouvons, mes collègues du groupe UMP et moi-même, accepter cette proposition de résolution.
Marques ironiques de déception sur les travées du groupe CRC-SPG.

Je voudrais cependant profiter de ce débat pour approfondir une thématique qui m’est chère, à savoir l’achèvement de la réforme portuaire.
Qui peut accepter parmi nous que le port d’Anvers soit le premier port maritime de la France ? Qui peut accepter parmi nous que, aujourd’hui, l’exportation dans le monde entier de notre beaujolais national se fasse à partir d’un port belge ? Qui peut se satisfaire parmi nous d’une situation aux termes de laquelle l’ensemble du tonnage des ports français est équivalent au trafic du seul port de Rotterdam ?
Alors que la France, avec le port du Havre, est le premier pays atteint par les navires traversant l’Atlantique et qu’elle dispose, avec le port de Fos-Marseille, d’une ouverture extraordinaire sur le monde méditerranéen, nos ports connaissent aujourd’hui un déclassement continu dans la compétition internationale.
Mes chers collègues, à cet égard, la situation est catastrophique. Nous n’avons plus de grands ports maritimes à la hauteur de nos ambitions, de notre industrie, de notre place en Europe, en dépit des efforts continus de notre collègue Charles Revet, rapporteur de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Les transferts d’outillage et de personnel prévus par ce texte tardent à être effectifs. Des syndicats n’hésitent pas à bloquer l’accès à certains terminaux : ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et leur action excessive, jusqu’au-boutiste, conduit, concrètement, en dehors de tout discours idéologique, à l’affaiblissement du tissu économique régional, à la délocalisation des entreprises et, par conséquent, à la perte d’emplois pour les salariés de notre pays. Quel gâchis !
Le droit de grève est une chose, paralyser un pays en est une autre, surtout lorsque les employés en cause bénéficient de conditions de rémunération plutôt attrayantes…
Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.

Bref, je souhaite que les directoires dans les grands ports maritimes achèvent de toute urgence la mise en œuvre de la réforme portuaire, condition sine qua non d’une relance pérenne et véritable du fret ferroviaire, notamment de ces fameux corridors européens de fret qui représentent en grande partie l’avenir du fret et des ports dans notre pays.
Je terminerai mon intervention en proposant que la France, au-delà de ses plans successifs, se donne donc les moyens d’une véritable ambition nationale pour le fret et retrouve une dynamique, comme dans d’autres pays européens, conforme aux engagements que nous avons votés dans le cadre des lois Grenelle.
En définitive, mes collègues du groupe UMP et moi-même ne saurions souscrire à cette proposition de résolution, qui ne me paraît pas réaliste. En revanche, je souhaite, pour sortir de l’impasse où nous sommes, que soient abordées, dans le cadre d’un Grenelle du ferroviaire que j’appelle de mes vœux, toutes les questions qui se posent aujourd’hui pour l’avenir des chemins de fer français, notamment au regard des dispositions qui ont été prises par notre principal concurrent, l’Allemagne. Alors que la SNCF est en déficit de plusieurs centaines de millions d’euros, réduit le nombre de ses emplois, perd des parts de marché, la Deutsche Bahn réalise quant à elle plusieurs centaines de millions d’euros de bénéfices.

Dans ce Grenelle du ferroviaire, toutes les questions devront être mises sur la table. Comment, s’appuyant sur l’exemple du plan allemand de 1994, remettre la SNCF et RFF à égalité avec leurs concurrents européens ? Comment, à travers le SNIT, dans le cadre d’une enveloppe financière contrainte, harmoniser au mieux nos actions en faveur des lignes LGV et de la rénovation des lignes ferroviaires ? Comment établir un système tarifaire équitable entre les différents modes de transport, comme le préconise le commissaire européen Siim Kallas ? Enfin, comment renforcer l’efficacité et la compétitivité de notre chère SNCF ?
À mon sens, la situation actuelle n’est pas une fatalité !
Je conclurai sur une note d’optimisme en rappelant que le célèbre milliardaire Warren Buffett a investi, au début du mois de novembre 2009, 34 milliards de dollars dans l’entreprise de chemin de fer Burlington Northern Santa Fe et qu’il prendra en charge les 10 milliards de dollars de dettes détenues à ce jour par l’entreprise.
Cet investissement est le plus élevé de toute l’existence du milliardaire américain. J’ai la faiblesse de penser, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, qu’il n’a pas agi sans raison et qu’il considère le fret ferroviaire comme un transport d’avenir respectueux de l’environnement. À nous de faire de même !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour examiner cette proposition de résolution relative au développement du fret ferroviaire.
Je profite de cette occasion pour exposer devant le Sénat la politique que mène le Gouvernement en matière de fret ferroviaire, qui doit devenir une solution de remplacement au transport routier.
Il s’agit d’un sujet important, sur lequel la Haute Assemblée a beaucoup travaillé. Je remercie les sénatrices et les sénateurs qui ont pris la parole aujourd’hui et reprendrai chacune de leurs interventions, en développant certains points.
Je tiens à saluer la qualité du rapport d’information sur l’avenir du fret ferroviaire réalisé par le groupe de travail composé de cinq sénateurs issus de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et présidé par Francis Grignon.
Je fais mienne l’appréciation que vient de porter Louis Nègre sur les propositions contenues dans ce rapport d’information et je les partage. Celles-ci s’inscrivent dans la droite ligne de notre politique, dont la priorité est d’assurer l’essor du fret ferroviaire au cours de la prochaine décennie.
Vous avez voté, dans le Grenelle I, un objectif clair et particulièrement ambitieux : faire passer de 14 % à 25 % la part des modes alternatifs à la route et à l’aérien – le ferroviaire, le maritime et le fluvial – d’ici à 2022.
Comment faire pour bâtir une offre de fret ferroviaire utile et compétitive ?
Vous l’avez tous rappelé, le fret ferroviaire en France, à la différence d’autres pays européens, connaît depuis plusieurs années, et quels que soient les gouvernements et les majorités à l’Assemblée nationale, de graves difficultés et peine à trouver sa cohérence économique. Il a été touché de plein fouet par la crise économique que nous connaissons depuis deux ans et, si des signes de reprise sont perceptibles, ils restent encore bien modestes.
Les crises sociales qui ont lieu depuis le début de l’année, particulièrement au cours des dernières semaines, auront malheureusement des conséquences sur l’activité de la SNCF. C’est par centaines que des trains sont actuellement « calés », comme on dit dans le langage cheminot, et certains clients partiront vers d’autres opérateurs ferroviaires, vers le transport fluvial dans le meilleur des cas, ou, pire, vers le fret routier.
Dans ce contexte difficile, l’entreprise publique a joué un rôle important dans l’acheminement des produits pétroliers qu’elle a traité en priorité, ce qui témoigne de la réactivité de ses équipes.
Désormais, notre objectif n’est pas de conquérir des parts de marché. Nous voulons les reconquérir. Les chargeurs sont demandeurs, vous l’avez tous relevé, mesdames, messieurs les sénateurs, en illustrant vos propos d’exemples.
Se pose également, vous le savez, un problème de rénovation du matériel. Autant le matériel ferroviaire à destination des voyageurs, qu’il s’agisse des TGV, des TER ou des transiliens, s’est modernisé, autant, en matière de fret, y compris d’équipement de triage que citait tout à l’heure Mme Beaufils, on en est resté à des technologies des années soixante-dix, pour ne pas dire des années cinquante ! Le parc de wagons, à quelques exceptions près, n’est pas un parc de qualité, notamment en termes de bruit ou de freinage.
Par conséquent, nous devons engager des améliorations en ce sens et faire en sorte que la concurrence se déroule convenablement. Je vous le rappelle, avant la crise sociale actuelle, la SNCF assurait 85 % du fret ferroviaire, les entreprises publiques ou privées autres que la SNCF ayant pris en quelques années à peu près 15 % de parts de marché. Malheureusement, la situation risque d’évoluer au détriment de la SNCF et les chiffres seront certainement très différents dans quelques semaines.
Nous avons mis en place avec le concours du Parlement – M. le président Emorine et la commission de l’économie ont joué un rôle important en ce sens – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Cette haute autorité d’arbitrage est en place, son siège est fixé dans une ville ferroviaire, Le Mans. Elle est dotée de pouvoirs étendus : elle peut notamment se prononcer sur tous les litiges relatifs à l’accès au réseau ferroviaire ainsi que sur la tarification des péages. Elle est donc aujourd’hui opérationnelle.
Vous avez tous évoqué l’engagement national pour le fret ferroviaire. De quoi s’agit-il précisément ? C’est un programme d’actions que Jean-Louis Borloo et moi-même avons lancé, dans le cadre duquel il est prévu de déployer 7 milliards d’euros d’ici à 2020 uniquement pour le fret ferroviaire. Il constitue évidemment une feuille de route pour l’État, RFF et l’ensemble des entreprises et des acteurs concernés.
Quels sont les moyens mis en place ?
Nous avons prévu de dégager des sillons pour le fret, en augmentant la construction de lignes nouvelles de 4 500 kilomètres dans les trente prochaines années, 2 000 avant 2020 et 2 500 après.
Par exemple, lorsque nous construirons une ligne nouvelle au sud de Tours en direction de Bordeaux, madame Beaufils, c’est la ligne classique partant de Saint-Pierre-des-Corps à Bordeaux qui sera disponible pour l’autoroute ferroviaire ou le TER. Nous allons dégager sur les lignes classiques énormément de sillons pour le fret ferroviaire.
Que souhaitons-nous faire dans ce plan ? Notre action s’articule autour de huit axes que vous avez tous rappelés : la création d’un véritable réseau d’autoroutes ferroviaires cadencées, le doublement du transport combiné de marchandises, l’installation d’opérateurs ferroviaires de proximité, le développement du fret à grande vitesse, l’instauration d’un réseau orienté fret, la mise en place de mesures favorisant la desserte des ports, que M. Nègre vient d’évoquer, la suppression des goulets d’étranglement et l’amélioration du service offert aux transporteurs.
S’agissant de la création d’un réseau d’autoroutes ferroviaires cadencées, comme l’a souligné M. Teston, nous avons démarré entre le triage de Bettembourg, au Luxembourg, et Portbou. Alors qu’il n’existait au départ qu’une seule navette par jour, nous en serons bientôt à quatre navettes quotidiennes, la quatrième devant être mise en place tout prochainement. Cette liaison se développe de façon satisfaisante.
Sur l’Atlantique, nous avons engagé une consultation pour désigner le futur opérateur ; nous recevrons les offres des trois candidats le mois prochain.
L’idée est de venir du nord de la France, de transiter par la région parisienne, de descendre vers Saint-Pierre-des-Corps et d’utiliser ensuite la ligne classique vers Poitiers-Angoulême-Bordeaux, avec, pendant la mise au gabarit B 1 pour le combiné des tunnels au sud de Poitiers, l’utilisation de l’ancienne ligne de l’État par Niort-Saintes et Bordeaux.
L’adaptation du réseau est en cours pour atteindre cet objectif.
Sur le Mont-Cenis et Orbassano que Michel Teston a également cités, il s’agit d’élargir la phase de transport. Nous avons donc lancé un appel avec les Italiens pour partir plus près de Lyon et aboutir plus loin en Italie, le but étant de saturer le Mont-Cenis avant le tunnel Lyon-Turin dont je reparlerai tout à l’heure.
Nous étudions actuellement une quatrième autoroute ferroviaire avec RFF, sur un itinéraire nord-sud et est-ouest.
Pour favoriser le transport combiné de marchandises, nous avons augmenté de 50 % environ l’aide à l’exploitation des services de transport combiné. Nous voulons également augmenter la longueur des trains de fret, qui est limitée par la réglementation à 750 mètres. Depuis 2009, nous faisons déjà circuler des trains de 850 mètres sur l’axe Paris-Marseille et nous travaillons actuellement avec les opérateurs du transport combiné pour permettre la mise en service de trains de 1 000 mètres sur les axes Paris-Marseille et Bettembourg-Portbou en 2012 et Lille-Bayonne en 2013.
La SNCF joue un rôle important dans le développement du transport combiné. Sa filiale NAVILAND CARGO, qui a pris le contrôle de la société NOVATRANS, est en effet le premier opérateur français de transport combiné. La SNCF s’est engagée auprès de l’Autorité de la concurrence à proposer aux autres opérateurs de transport combiné de constituer une société d’exploitation en commun sur certains terminaux, afin que chacun y ait accès librement.
J’en viens aux opérateurs ferroviaires de proximité.
Vous avez parlé tout à l’heure de Warren Buffett et des compagnies américaines qui, voilà trente ou quarante ans, étaient celles qui perdaient le plus d’argent. Aujourd’hui, grâce à un énorme marché issu de l’accord de libre échange nord-américain, l’ALENA, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, elles sont devenues des sociétés très profitables.
Aux États-Unis, avant l’installation de ces très grands trains de fret qui traversent les États-Unis du nord au sud et d’est en ouest, il existait déjà les short lines, opérateurs ferroviaires de proximité qui rassemblent les wagons et préparent les trains.
Dans le port de Hambourg, d’où partent environ 50 % à 60 % de son fret au-delà de 350 kilomètres par la voie ferroviaire, on dénombre 150 opérateurs ferroviaires de proximité.
L’évolution du fret ferroviaire dépend donc fortement de ces opérateurs.
Le rapport d’information du groupe de travail présidé par le sénateur Francis Grignon propose de favoriser le développement des OFP. Nous avons fait évoluer le cadre législatif et réglementaire pour faciliter leur mise en place. La loi ORTF – je n’aime pas beaucoup ce sigle, parce qu’il nous renvoie à la suppression de l’ORTF en 1975 !
Sourires
Ces évolutions ont permis l’émergence de trois OFP en Languedoc-Roussillon, Bourgogne et Poitou-Charentes – avec celui du grand port maritime de La Rochelle, j’y reviendrai. En Auvergne, l’opérateur – il s’agissait au départ d’une entreprise de transport routier – se lance actuellement : …
… il commencera à fonctionner le mois prochain, à la suite de l’accord que M. Hortefeux et moi-même avons signé avec le préfet de région et le président de la chambre de commerce, M. Marcon.
D’autres projets de toutes natures sont à l’étude en Bretagne, dans la région Centre, en Midi-Pyrénées. Nous souhaitons par exemple développer le fret à grande vitesse, afin que les marchandises dont le transport est actuellement assuré par DHL ou FEDEX soient mises au départ de l’aéroport de Roissy ou d’autres lieux sur des TGV fret, comme il existe des TGV postaux.
Le projet porté par l’association CAREX, présidée par le député Yanick Paternotte, avance bien, mais il ne se concrétisera pas avant un an ou deux ans.
Nous avons par ailleurs défini un réseau orienté fret, sur lequel nous améliorerons la qualité de service, l’interopérabilité du réseau et l’électrification de ses itinéraires. Actuellement, près de 700 millions d’euros sont consacrés à des programmes d’électrification du réseau : je pense à Bourges-Saincaize et Serqueux-Gisors, qui a été cité tout à l’heure pour la desserte du Port du Havre.
Nous allons investir, avec RFF, 380 millions d’euros pour ces itinéraires, notamment afin de les rendre tous destinataires d’installations permanentes de contresens, ou IPCS, qui permettent une meilleure fluidité des circulations.
Nous allons également déployer sur le réseau orienté fret, après l’avoir fait à titre expérimental sur le TGV Paris-Strasbourg, l’ERTMS ou european rail traffic management system, la nouvelle signalisation européenne.
En outre, parmi les projets européens actuellement acceptés par le conseil des ministres des transports européens figure le raccordement des ports du Havre et de Dunkerque aux corridors de fret européen Rotterdam-Anvers-Lyon-Bâle et Aix-la-Chapelle-Terespol. Nous relions donc nos itinéraires aux grands parcours de fret européens.
L’amélioration de la desserte ferroviaire de nos ports est un enjeu majeur pour le développement du fret ferroviaire. Notre objectif est de doubler la part de marché du fret ferroviaire pour les acheminements à destination et en provenance des ports. Le port de Dunkerque, en France, est un bon exemple ; malheureusement, pour d’autres, les avancées sont moins significatives. Pour atteindre nos objectifs, il faut mettre en place des OFP dans les ports.
Vous le savez, depuis la réforme portuaire, les ports sont responsables de leur réseau. Par exemple, le port de Dunkerque en a confié la gestion à Europort, qui est l’opérateur d’Eurotunnel, d’autres l’ont confiée à la SNCF. Des opérateurs ferroviaires de proximité sont en train d’être créés au Havre, à Dunkerque, à Marseille, au port fluvial de Strasbourg.
Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre de la loi portant réforme portuaire, représentent des investissements très importants pour les grands ports maritimes. En particulier, une grande plateforme multimodale sera mise en service au Havre dès 2013 et le projet du terminal de Mourepiane à Marseille est bien avancé, puisque les travaux devraient commencer l’an prochain.
J’en profite d’ailleurs pour préciser, M. Teston ayant pris cet exemple, que le port de La Rochelle avait initialement conclu un accord avec la SNCF. Cette dernière a toutefois pêché par excès de prudence et, désormais, les trains sifflent en allemand…
Sourires.
Quant aux goulets d’étranglement, ils sont nombreux, le plus important d’entre eux résultant de la traversée de l’agglomération lyonnaise et du complexe de la gare de la Part-Dieu.
Pour remédier à ce problème, que le président Guy Fischer connaît bien, …
…nous avons lancé le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, le CFAL. Ce projet n’est pas aisé à conduire, parce qu’il faut tenir compte tout à la fois de la géographie, de l’aéroport Saint-Exupéry, du raccordement au sud de Lyon, de l’urbanisation et de la connexion des axes nord-sud et Rhin-Rhône.
Par ailleurs, les contournements de Nîmes et de Montpellier seront engagés l’année prochaine.
En ce qui concerne le service offert aux transporteurs, il mériterait vraiment d’être amélioré. RFF a déjà lancé une plateforme commerciale pour ses clients.
Afin de travailler à la mise en œuvre de ces huit axes, qui sont largement en accord avec les propositions développées dans le rapport d’information, nous avons installé un comité de suivi réunissant tous les acteurs concernés, des représentants des ports, de France Nature Environnement, de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, la DATAR, etc.
Le rôle de la SNCF est également très important. L’entreprise va investir un milliard d’euros sur cinq ans dans des projets de développement du fret. Elle a déjà engagé l’essor de l’offre de transport en trains massifs et transforme son offre de wagon isolé. Il faut encore accomplir des progrès pour répondre aux besoins des entreprises – certaines d’entre elles rencontrent des difficultés avec la nouvelle offre « multi-lots multi-clients » – et prendre des mesures sociales d’accompagnement pour les personnels en interne.
J’évoquerai rapidement le transport routier de marchandises. La mise en place de l’écotaxe, dont le principe et les modalités ont été adoptés dans le Grenelle de l’environnement et dans la loi de finances pour 2010, ne prend pas de retard, mais il convient de tenir compte de l’étendue du réseau concerné. La République tchèque, que vous avez citée en exemple, madame Beaufils, ne compte que 805 kilomètres d’autoroutes. Quant aux Allemands, ils ont mis quatre ou cinq ans pour mettre en place leur système Toll Collect.
Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il s’agit d’inclure toutes les autoroutes gratuites, le réseau de routes nationales qui subsistent ainsi que, le cas échéant, les routes départementales, en fonction des souhaits exprimés par les conseils généraux. Les discussions ont été particulièrement longues – croyez-en mon expérience en Charente-Maritime ! – et le nombre de routes départementales concernées sera finalement beaucoup plus important que prévu, les élus locaux craignant un report du trafic vers les routes qui ne seraient pas intégrées dans le dispositif.
C’est donc un réseau extrêmement vaste qui se profile. Il devrait nous rapporter 1, 2 milliard d’euros par an, montant dont il faudra naturellement déduire les frais de fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. Je précise également que les recettes provenant des routes départementales seront naturellement perçues par les départements.
Il s’agit donc d’un projet d’envergure.
Nous expérimenterons d’abord le dispositif adopté au Sénat et à l’Assemblée nationale en Alsace, avant de désigner le concessionnaire d’ici à la fin de l’année et de mettre en service le dispositif sur l’ensemble du territoire en 2012.
Le déploiement d’un tel système sur un réseau à l’échelle de la France qui compte des autoroutes, des routes nationales et des routes départementales prend du temps, d’autant qu’il convient d’utiliser une technologie compatible avec celle qui est utilisée par les autres pays, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le domaine ferroviaire, …
… où chaque pays avait inventé son propre système d’électrification et de signalisation. Il s’agit de ne pas prévoir de système de lecture qui transforme l’avant des camions en cabine de conduite. La mise en place du dispositif en 2012 constitue donc déjà une prouesse technique et un défi pour les entreprises ; j’espère que nous réussirons.
J’en viens aux camions de 44 tonnes. Il s’agit non pas de les généraliser, mais de permettre, à la demande du monde agricole, la circulation des produits agricoles et agroalimentaires. Je vous rappelle qu’il existait déjà de nombreuses dérogations autour des ports maritimes et fluviaux, ainsi que pour transporter les chablis ou les récoltes après les moissons. Il s’agit en réalité de mettre un peu d’ordre dans ce régime dérogatoire et de le limiter aux activités liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire.
Je conclurai en évoquant quelques-uns des sujets connexes que vous avez abordés, mesdames, messieurs les sénateurs.
En ce qui concerne la réforme portuaire, ce qui se passe à Marseille est en effet dramatique, monsieur Nègre. §
Les lignes se détournent sur Civitavecchia, Gênes, Barcelone, Tanger Med ou encore Tunis ; il ne sera pas évident de les faire revenir. Pourtant, partout ailleurs, la réforme de la gouvernance a été mise en œuvre et les transferts, y compris de personnels, ont lieu. Il subsiste un abcès de fixation sur une petite partie du port de Marseille, les instigateurs de cette action étant d’ailleurs en désaccord avec d’autres syndicats à Marseille ainsi qu’avec la CGT à l’échelon national. Il s’agit donc d’un phénomène local, mais il touche le premier port de France et peut priver la deuxième ville française d’une activité économique importante et tuer des milliers d’emplois.
C’est assez dramatique, en effet. Le Gouvernement en est conscient et ne restera pas sans agir.
Enfin, le projet de liaison Lyon-Turin avance bien et l’on ne perdra pas le bénéfice des crédits de l’Union européenne, ceux-ci étant reportés jusqu’en 2015. Nos amis italiens ne partagent pas complètement notre vision des choses quant aux modalités de financement. Les discussions sont donc vives, mais restent amicales !
(Sourires. –M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sourit également.) J’espère avoir répondu à vos questions et démontré que le fret ferroviaire était une préoccupation du Sénat, du Gouvernement, mais aussi de tous les Français.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, mon intervention fut un peu longue, je vous prie de bien vouloir m’en excuser. Mon collègue Alain Marleix vient d’arriver et je le vois déjà trépigner, ce qui constitue pour lui un exercice très difficile étant donné les circonstances. §

Personne ne demande plus la parole ?...
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
Vu le chapitre VIII bis du Règlement du Sénat,
Considérant que l’article 10 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement donne pour objectif au niveau national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports d’ici à 2020 ;
Estime que le transport ferroviaire de marchandises correspond à une activité d’intérêt général ;
Considère que le Gouvernement doit se fixer comme objectif le rééquilibrage modal, fondé sur une législation spécifique au secteur routier permettant d’internaliser les coûts externes notamment environnementaux ;
Appelle par conséquent de ses vœux l’instauration rapide d’une taxe poids lourds dont les ressources doivent être fléchées pour les investissements sur le réseau ferré ;
Propose également un moratoire sur l’abandon partiel de l’activité wagon isolé et la préservation des installations ferroviaires.

Je rappelle que la conférence des présidents a fixé la durée des explications de vote à cinq minutes par groupe, les non-inscrits disposant de trois minutes.
La parole à Mme Isabelle Pasquet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous parlerai de Miramas, une ville des Bouches-du-Rhône à mi-chemin entre Marseille et Fos-sur-Mer, deux grands ports de la Méditerranée qui, juridiquement tout du moins, n’en font qu’un : le Grand Port maritime de Marseille. Ce port n’est rien moins que le quatrième port européen, avec un trafic de près de 100 millions de tonnes, le troisième port pétrolier mondial et le premier port de la Méditerranée pour les conteneurs devant Gênes et Barcelone. Non seulement il sert de plateforme d’échanges avec les pays sud-méditerranéens, mais, surtout, il est situé dans l’une des cinq premières zones logistiques françaises. C’est un port en pleine expansion puisqu’il va doubler son activité dans les cinq prochaines années.
« Avec un investissement global de 3 milliards d’euros sur les prochaines années, 83 millions de tonnes de marchandises en 2009 passant à 120 millions d’ici à 2013, avec une volonté écrite et affichée des décideurs et chargeurs de porter la part du transport ferroviaire de 13 % à 30 %, placé à côté d’un monstre économique qu’est le port et dans une région fortement industrialisée, le triage automatisé de Miramas doit vivre et se développer. » Voilà résumé, en quelques mots, le projet économique présenté par les cheminots à la direction du fret pour le maintien du tri par gravité sur le site de Miramas.
Ce site faisait partie des gares menacées par le plan de « rationalisation » annoncé par la SNCF au mois de septembre 2009, une décision paradoxale au moment où le Gouvernement confiait justement une mission pour améliorer les dessertes du port de Marseille, afin de promouvoir le développement durable dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Des propositions sont d’ailleurs en cours d’élaboration pour améliorer la fluidité des trafics à l’intérieur du port ainsi que son accessibilité dans les trente prochaines années.
Dans ce contexte, le ferroviaire est un atout considérable. La direction de la SNCF a été obligée de le reconnaître puisque, le 25 octobre dernier, elle a annoncé le maintien du tri à gravité à Miramas. Elle a été contrainte de prendre en compte les propositions portées par les organisations syndicales et, en premier lieu, par la CGT, lesquelles s’appuyaient sur une argumentation très précise, en termes tant de coûts économiques que de réponses aux problématiques environnementales.
C’est une victoire importante pour les cheminots, leurs organisations syndicales et la population, tous particulièrement mobilisés sur ce dossier majeur pour le développement du fret et, plus largement, pour le développement économique de la région PACA. L’arrêt du triage signifiait la perte de deux cents emplois et la mise sur nos routes de 300 000 camions supplémentaires par an.
Ce retournement de situation est le fruit de l’acharnement de tous les acteurs concernés pour sauver « leur » triage. Il aura fallu plusieurs mois de mobilisation et de multiples interventions des élus – maire, conseillers généraux, conseillers régionaux, parlementaires – auprès de la direction de la SNCF, du préfet et des ministres – certaines sont malheureusement restées sans réponse – pour qu’enfin la raison l’emporte.
Je profite de cette intervention pour saluer le travail considérable accompli par les organisations syndicales, notamment la CGT. Elles ont fait preuve d’une très grande responsabilité en sollicitant tant les élus que les pouvoirs publics avec beaucoup de persévérance.
Cela nous renvoie à notre propre responsabilité en tant que parlementaire et à notre capacité d’écoute. Nous avons en l’occurrence la démonstration que le dialogue est la clef de résolution de bien des conflits et que les organisations syndicales, loin d’être des fauteurs de troubles, sont d’abord porteuses de propositions crédibles et argumentées qui méritent d’être étudiées consciencieusement, pour peu que l’on prenne le temps de les écouter et de travailler avec elles.
Si je prends cet exemple, c’est qu’il m’est cher à plusieurs titres. Certes, il s’agit de mon département, de mon entreprise, et je suis convaincue que le fret est le moteur du développement économique des régions. Mais, surtout, il montre que d’autres solutions existent et qu’il convient d’étudier toutes les possibilités en lien avec les partenaires sociaux pour que, enfin, soit mise en œuvre une politique du transport de marchandises rationnelle du point de vue économique et écologique, sécurisée, juste et équilibrée.
Cela passe d’abord par l’adoption de cette proposition de résolution, sur laquelle nous demandons un vote par scrutin public.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Monsieur le secrétaire d’État, si vous avez communiqué un certain nombre d’informations intéressantes sur des dossiers relatifs au transport ferroviaire, particulièrement dans le domaine du fret ferroviaire, vous n’avez en revanche pas répondu sur les principaux points de la proposition de résolution du groupe CRC-SPG.
Je ne prendrai que quelques exemples.
Premièrement, vous n’avez répondu ni sur l’organisation d’états généraux ou d’un Grenelle du fret ferroviaire ni sur la mise en place d’un moratoire sur l’abandon partiel de l’activité wagon isolé et la préservation des installations ferroviaires.
Deuxièmement, vous n’avez pas apporté de réponse à notre demande de mise en place d’un plan de résorption de l’énorme dette de Réseau ferré de France, qui doit s’élever aujourd’hui à 28 milliards d’euros et qui interdit quasiment aux gestionnaires du réseau de pouvoir consacrer les crédits nécessaires à une régénération rapide du réseau ferroviaire existant.

Troisièmement, vous n’avez pris aucun engagement en matière de rééquilibrage modal, qui suppose à notre sens de pouvoir intégrer les coûts externes du transport routier dans la tarification du transport.
Quatrièmement, enfin, le Gouvernement ne semble pas non plus favorable à notre proposition visant à reconnaître le caractère d’intérêt général du fret ferroviaire. Or c’est vraisemblablement la seule solution de nature à permettre son développement.
En fait, monsieur le secrétaire d’État, vous rejetez toutes les avancées que Mireille Schurch, pour le groupe CRC-SPG, et moi-même, pour le groupe socialiste, avons formulées dans le cadre du groupe de travail sur l’avenir du fret ferroviaire. Pourtant, celles-ci sont clairement exposées dans la proposition de résolution soumise à notre assemblée.
C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera cette proposition de résolution.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC-SPG et, l'autre, du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Je rappelle au Sénat que le groupe de l’Union pour un mouvement populaire a présenté une candidature pour la commission des finances et une pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, membre de la commission des finances, à la place laissée vacante par M. Alain Lambert, dont le mandat de sénateur a cessé ;
- Mlle Sophie Joissains, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, démissionnaire.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l’indépendance du Président de la République et des membres du Gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique, présentée par Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Éliane Assassi et Josiane Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du Parti de gauche (proposition n° 603 rectifié [2009-2010], rapport n° 40) (demande du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du Parti de gauche).
Dans la discussion générale, la parole est Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous présenter une proposition de loi constitutionnelle visant à mieux garantir l’indépendance du Président de la République et des membres du Gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique.
Comme le souligne M. Gélard dans son rapport, « la volonté de mettre les dirigeants politiques et les responsables publics au-dessus de tout soupçon et de garantir aux citoyens que l’exercice de mandats électoraux ou de fonctions électives ne soit pas, pour ceux qui les détiennent, l’occasion d’un enrichissement personnel, a été une préoccupation constante tout au long de l’histoire de notre pays : dès 1795, des obligations de déclaration de patrimoine sont imposées aux élus par la Convention, qui entendait ainsi assurer la confiance des mandés en leurs mandants ».
M. le rapporteur évoque ensuite la loi organique du 11 mars 1988, qui est relativement récente et donc tardive dans la France postrévolutionnaire.
Certes, la République s’est dotée d’un cadre juridique destiné à éviter la confusion d’intérêts – ou conflit d’intérêt – entre les missions publiques et les intérêts privés ou particuliers de ceux qui les exercent.
L’indépendance des acteurs publics, la morale publique peuvent, en principe, faire partie de notre consensus républicain.
Force est de constater toutefois qu’en matière de transparence financière notre législation est récente et bien modeste.
En effet, les différentes situations sur lesquelles le législateur a éprouvé la nécessité de prévenir ou de sanctionner d’éventuels manquements aux vertus républicaines concernant les élus et les fonctionnaires ont donné lieu à des règles d’inéligibilité, d’incompatibilités entre fonctions électives et professions ou fonctions.
Les obligations de transparence concernent principalement le financement des partis politiques – on en voit les insuffisances –, les campagnes électorales et le patrimoine des élus.
Hélas ! on peut constater tous les jours que ce cadre juridique, s’il est utile, n’est pas suffisant, voire se révèle dépassé, tant s’est établie une proximité, une « porosité » pourrait-on même dire, entre les pouvoirs publics et l’argent.
Bien évidemment, cette proximité est d’autant plus grande dans le monde et en France, et la frontière entre intérêt général et intérêts particuliers est d’autant plus fragile que l’idéologie libérale, voire ultralibérale que vous défendez prône la primauté des intérêts privés sur l’intérêt général, la primauté de l’économie sur le politique, et que sont imbriqués les pouvoirs économiques et politiques dans les classes dirigeantes.
Ajoutons que notre pays est le champion de l’extrême concentration des pouvoirs, tant économiques que politiques. Le débat sur le cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice d’une fonction exécutive locale qui s’est déroulé ce matin et celui sur les mandats dans les conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises hier après-midi en ont été l’illustration.
Ajoutons aussi que l’évolution récente, avec la privatisation des grandes entreprises publiques et des banques, le recours aux partenariats public-privé, la délégation croissante de services publics au privé, est telle que se multiplient les possibilités de créer des liens étroits entre pouvoirs politiques et pouvoirs économiques ainsi que les passerelles entre fonctions publiques et fonctions économiques.
Ajoutons, enfin, que cette réalité est encore plus manifeste depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel Président de la République : il affiche lui-même sa proximité avec le monde des affaires, il en a fait un symbole en fêtant son élection au Fouquet’s avec ses amis de la finance, puis sur le yacht de Vincent Bolloré !
Depuis, les exemples de proximité se sont multipliés, tant par les nominations de conseillers du Gouvernement à la tête d’entreprises en voie de privatisation que par les rapports étroits de membres du Gouvernement ou de parlementaires avec le monde des affaires.
Je n’ai pas l’intention de faire ici la chronique des gazettes.
En revanche, ce que tout le monde peut constater, ce sont les nombreuses dérives, qu’elles puissent ou non faire l’objet d’une sanction au vu de notre législation actuelle. C’est le lot d’une société hyper-médiatisée. C’est une forme de transparence, mais une transparence extrêmement dangereuse.
Les dérives que s’autorisent certains rejaillissent sur tous les autres. Elles nourrissent chez nos concitoyens le rejet des politiques, des institutions et nuisent gravement à la santé de la démocratie !
Il est navrant de constater que, au pays de Saint-Just, de Jaurès et de Zola, 60 % à 70 % de nos concitoyens pensent que leurs élus sont corrompus ou sensibles à la corruption.
On est loin, bien loin, de la République « irréprochable » dont parlait le candidat Nicolas Sarkozy. Paroles, paroles !
Tout cela est tel, d’ailleurs, qu’à la rentrée de septembre – après un été édifiant sur la question – la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique est devenue un sujet d’actualité et qu’une commission d’« experts » a été chargée par décret du 10 septembre 2010 d’y réfléchir et de formuler des propositions. Nous verrons ce qu’il en ressortira !
La proposition de loi constitutionnelle que je présente aujourd’hui n’est donc pas hors sujet. Elle est antérieure à l’institution de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, même si elle est discutée aujourd'hui dans le cadre de la semaine d’initiative sénatoriale. Elle est modeste et s’attache à une question qui n’est pas forcément directement liée aux conflits d’intérêts. Cependant, elle traite de situations bien réelles pouvant concerner non seulement les membres du Gouvernement, mais aussi le Président de la République lui-même.
Je constate d’ailleurs que M. le rapporteur signale, pour mieux le repousser, que ce texte « soulève des questions cruciales ». Il a d’abord tenté de s’y opposer sur la forme, en déposant une motion d’irrecevabilité. Nous savons que la majorité use de procédures sur la plupart des propositions de loi de l’opposition pour éviter les débats de fond. En la matière, les exemples sont nombreux et répétés. Nous avons donc rectifié ce texte hier en le transformant en proposition de loi constitutionnelle. Il n’en reste pas moins que M. le rapporteur invoque diverses raisons pour en demander le rejet, raisons qui me paraissent peu convaincantes.
Ce texte a pour objet d’étendre au Président de la République et aux membres du Gouvernement l’interdiction de recevoir tout don ou avantage de personnes morales, sous quelque forme que ce soit, et de créer une obligation de déclaration des dons provenant de personnes physiques lorsque ceux-ci excèdent un montant annuel fixé par la loi ordinaire. Vous remarquerez, mes chers collègues, que le montant ne figure plus dans cette proposition de loi constitutionnelle : nous renvoyons à une loi ordinaire le soin de le fixer, ce qui est juridiquement normal.
Les dons concernés sont soit directs, soit indirects. Tout don ou avantage en nature effectué par une tierce personne, mais dont les personnes visées par ce texte bénéficient également, est pris en compte dans le calcul des sommes déclarées. Ces nouvelles dispositions seront applicables au Président de la République et aux membres du Gouvernement.
Si la loi de 1995 exclut partiellement les personnes morales du financement des campagnes électorales et des partis politiques, rien n’est prévu pour le Président de la République, les membres du Gouvernement et les élus.
Par ailleurs, en vertu de la loi de 1988, la Commission pour la transparence financière de la vie politique, la CTVP, « contrôle » certes les patrimoines des élus et des membres du Gouvernement en début et fin de mandat, mais elle ne contrôle ni les revenus ni les cadeaux et donations qui ne sont pas des biens patrimoniaux. Rien n’empêche donc une personne physique ou une personne morale d’octroyer certains avantages financiers ou en nature, de façon directe ou indirecte, aux élus, aux membres du Gouvernement ou au Président de la République.
Monsieur le rapporteur, vous essayez de décrédibiliser cette proposition de loi constitutionnelle en affirmant que notre texte pourrait priver les ministres ou le Président de la République des moyens d’exercer leur mandat. Pourtant, vous ne pouvez pas confondre la notion de dons effectués par des personnes morales avec celle de moyens matériels dévolus à l’exercice d’une fonction !
Par ailleurs, vous nous reprochez de ne pas avoir fixé de sanctions afférentes à l’interdiction des dons, dont le plafond pourrait être limité à 4 600 euros, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre des campagnes électorales ou du financement des partis politiques. Vous auriez pu amender notre texte en ce sens ! En revanche, vous êtes resté bien discret sur notre souhait d’améliorer la transparence en exigeant une déclaration publique de ces dons.
Transparence rime avec indépendance. La sanction politique évoquée par M. le rapporteur comme la seule sanction possible, notamment contre le Président de la République, celle des urnes, ne pourra intervenir que si la publicité des liens financiers existe. Ce n’est que si les citoyens sont informés en dehors du jeu médiatique qu’ils pourront former leur jugement !
M. le rapporteur considère également que cette proposition de loi constitutionnelle aurait pour effet de réglementer la vie quotidienne de ceux qui exercent des responsabilités et de mettre en quelque sorte leur vie privée sous les yeux des citoyens. Passez-moi l’expression, mais c’est un peu fort !
Nombre de responsables politiques, à commencer par le Président de la République lui-même, étalent leur vie privée, ce que, pour notre part, nous réprouvons. Mais la transparence de leur situation financière, c’est tout autre chose !
Aujourd’hui, les médias s’emparent de dérives inacceptables. C’est à la loi d’organiser la transparence, le contrôle et la sanction s’il y a lieu. Nul n’est obligé d’être élu, membre d’un Gouvernement ou Président de la République ! La contrepartie est d’accepter que sa situation financière soit publique et irréprochable.
Mes chers collègues, nous défendons l’honneur des élus qui, dans leur grande majorité, n’ont rien à se reprocher…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la proposition de loi. … et, par là même, la démocratie.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l’indépendance du Président de la République et des membres du Gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique, qui est présentée par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres de son groupe et dont nous sommes saisis, est loin d’être inintéressante.
Toutefois, nous avons déjà examiné par le passé un certain nombre de textes qui régissent actuellement le statut du Président de la République et des membres du Gouvernement dans leurs relations avec les puissances d’argent.
Ainsi la loi organique du 11 mars 1988 impose-t-elle au Président de la République de faire une déclaration de situation patrimoniale, dont l’évolution fait l’objet d’une publication.
Nous disposons également d’une législation particulièrement importante qui reprend le code électoral, pour ce qui concerne notamment l’élection présidentielle. Ainsi, l’article L. 52-4 du code électoral prévoit l’obligation pour tout candidat à une élection de recourir à un mandataire financier ; l’article L. 52-8 du même code prohibe les dons de personnes morales et plafonne les dons des personnes physiques à 4 600 euros, tandis que l’article L. 52-15 permet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le parquet en cas d’irrégularités.
Le texte initial – une proposition de loi ordinaire – était irrecevable dans la mesure où un texte d’une telle nature ne peut modifier le statut du Président de la République. Nous l’avions souligné lors de son examen en commission et avions indiqué à Mme Borvo Cohen-Seat qu’il fallait déposer une proposition de loi constitutionnelle. C’est désormais chose faite et le texte que nous examinons est recevable.

Cela dit, même sous une forme adéquate, ce nouveau texte n’est pas sans poser plusieurs problèmes.
Avant de les évoquer, je ferai remarquer qu’une proposition de loi constitutionnelle doit d’abord être approuvée en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat, puis transmise au chef de l’État, qui devra recourir au référendum. Or je crains qu’un référendum sur un tel sujet ne suscite pas l’enthousiasme des foules et ne recueille un nombre considérable d’abstentions.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

Je profite de cette occasion pour rappeler que je regrette, pour ma part, que nous n’ayons pas fixé, lors de la dernière révision constitutionnelle, un taux de participation au moins égal à 50 % des votants pour valider un référendum.
Tout d’abord, cette proposition de loi constitutionnelle est sans portée juridique. Elle fixe une interdiction, sans constituer de délit ou de crime. Par conséquent, les intéressés pourront faire ce qu’ils voudront ! Il est évident que les agissements visés ne sont pas moralement acceptables, mais tout cela relève du domaine de la vertu et non pas du domaine législatif.
En outre, en cas de manquement aux dispositions prévues, il ne sera pas possible de poursuivre les membres du Gouvernement devant la Cour de justice de la République. Quant au Président de la République, à moins de le poursuivre devant la Haute Cour, je ne vois pas très bien quelle sanction nous pourrions lui appliquer. Ce texte n’a donc aucune portée juridique, car il ne prévoit pas de sanction.

Par ailleurs, la proposition de loi constitutionnelle mélange les dons et les avantages en nature.
Concrètement, cela signifie que le Président de la République devra déménager de l’Élysée – c’est un avantage en nature ! – et, à l’instar de l’ensemble des ministres, abandonner ses voitures de fonction – c’en est un autre ! –. Voilà qui est totalement irréaliste, à moins d’imaginer que tous bénéficieront dorénavant d’une liste civile qui leur permettra de régler l’intégralité de leurs dépenses, à l’image de la reine d’Angleterre !
Enfin, on ne peut empêcher un chef d’État de recevoir des cadeaux de ses homologues étrangers lors de ses déplacements ou voyages officiels. C’est impensable, sauf à vouloir mettre les relations diplomatiques sous haute tension ! Refuser les cadeaux, cela ne se fait pas !
Madame la sénatrice, vous avez affirmé que les dispositions de ce texte ne touchaient pas à la vie privée. Bien sûr que si ! En réalité, ce que vous nous proposez, ce n’est pas de la transparence, c’est du voyeurisme ! Demander à l’ensemble des ministres de déclarer tous les cadeaux qu’ils reçoivent, y compris à l’occasion de leur anniversaire ou de repas avec des amis, …

Vous visez dans ce texte tous les dons, à l’exception des donations familiales. C’est impossible à mettre en pratique et il faut protéger quelque peu la vie privée !
En fait, cette proposition de loi constitutionnelle favorise la dissimulation des dons et cadeaux. Le Président de la République ou les ministres auront tout intérêt à les cacher, parce que les conditions prévues pour les rendre publics sont insupportables.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a décidé de ne pas revoir le texte qui nous est proposé et d’émettre un avis défavorable sur l’article unique.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes saisis d’une proposition de loi constitutionnelle présentée par le groupe CRC-SPG visant à garantir l’indépendance du Président de la République et des membres du Gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique.
Ce texte prévoit d’interdire au Président de la République et aux membres du Gouvernement de recevoir des dons en espèces ou en nature de la part de personnes morales. Par ailleurs, lorsque ces dons émanent d’une personne physique, ils doivent faire l’objet d’une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, s’ils excèdent un montant global fixé par la loi.
À l’origine, il s’agissait, comme l’a rappelé M. le rapporteur, d’une proposition de loi ordinaire. Le contenu des dispositions proposées relevant clairement, selon les constitutionnalistes auditionnés par la commission des lois, d’une norme supérieure, M. le rapporteur avait proposé à la commission, qui l’a suivi, de la déclarer irrecevable. Il aurait alors soutenu en séance publique une motion d’irrecevabilité, que le Gouvernement vous aurait demandé, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir voter.
Cependant, face à cette difficulté juridique, les auteurs de cette proposition de loi ordinaire ont transformé celle-ci en une proposition de loi constitutionnelle, qui prévoit d’inscrire dans la Constitution les dispositions qui figuraient dans le texte originel.
Compte tenu de cette modification intervenue hier, c’est sur le fond que le Gouvernement se placera pour vous exposer ses arguments en vue de vous demander, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir rejeter cette proposition de loi constitutionnelle.
Ce texte ainsi que la proposition de loi organique visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice d’une fonction exécutive locale, que vous avez renvoyée ce matin en commission, doivent être rapprochés des quatre propositions de loi présentées par le parti socialiste et repoussées, conformément au souhait du Gouvernement, par l'Assemblée nationale voilà une dizaine de jours.
Ces quatre propositions de loi portaient, d’une part, sur l’interdiction du cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice d’une fonction exécutive locale et, d’autre part, sur la réglementation des financements privés des partis politiques et la prévention des conflits d’intérêts concernant les membres du Gouvernement.
Permettez-moi de vous faire part des critiques émises par le Gouvernement à l’encontre de ces textes.
Premièrement, il s’agissait de textes dont la motivation était à l’évidence politicienne ; ceux qui les proposaient n’avaient aucune envie de les voir mettre en pratique.
Deuxièmement, cette motivation avait conduit à une précipitation dans leur élaboration. En conséquence, ces textes présentaient des défauts que l’on pourrait qualifier, pour rester aimable, de « techniques ». Le Gouvernement a clairement indiqué à l’Assemblée nationale, par la voix de votre ancien collègue Henri de Raincourt, que la défense de la moralité publique n’est le monopole d’aucun parti, comme aurait pu le laisser supposer l’intitulé la proposition de loi constitutionnelle et de la proposition de loi organique : « pour une République décente ».
Le Gouvernement avait également mis en garde les signataires de ces textes contre les risques de démagogie. Enfin, il avait indiqué – Michel Mercier l’a confirmé ce matin devant vous – qu’il n’était pas hostile à ce que certaines questions évoquées fassent l’objet d’un examen moins précipité et plus approfondi permettant de parvenir à des réponses consensuelles.
Le Gouvernement peut reprendre ces critiques et les formuler à l’encontre de la proposition de loi constitutionnelle déposée par les sénateurs du groupe CRC-SPG que nous examinons aujourd’hui.
Ce débat est l’occasion pour le Gouvernement de rappeler que notre République s’est dotée d’un ensemble solide de dispositions juridiques en matière de transparence financière de la vie politique.
Je ferai d’ailleurs observer que les principales lois de ce dispositif ont été votées alors que l’actuelle majorité parlementaire était aux responsabilités. Ainsi, ce sont la loi organique du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, votée sous le gouvernement de Jacques Chirac, et la loi du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions, votée sous le gouvernement d’Édouard Balladur, qui ont, d’une part, réglementé le financement des campagnes électorales, d’autre part, organisé le financement des partis politiques, qu’il soit privé ou public.
L’ensemble de cette réglementation est appliqué sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics à qui l’ordonnance du 8 décembre 2003, prise sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, a conféré le statut d’autorité administrative indépendante.
Ce dispositif ne concerne pas seulement le financement des partis politiques et des campagnes électorales : il s’intéresse également au patrimoine des membres du Gouvernement et à celui de nombreux élus.
Ainsi est-il imposé aux membres du Gouvernement d’établir notamment une déclaration de leur patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent leur nomination et dans les deux mois qui suivent leur cessation de fonctions. À cela s’ajoute l’obligation qui leur est imposée de faire état de toutes les modifications substantielles de leur patrimoine intervenues au cours de leur présence au Gouvernement.
En outre, il revient à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui est également considérée comme une autorité administrative indépendante, d’apprécier le caractère normal ou non de l’évolution des patrimoines des uns et des autres.
Cette instance peut mettre en demeure les intéressés de fournir des explications sur certaines évolutions patrimoniales. Et, si celles-ci lui paraissent insuffisantes, elle peut saisir le Premier ministre et le parquet.
S’agissant du financement des élections présidentielles, la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel s’inspire largement des dispositions des lois organiques du 11 mars 1988 et du 19 janvier 1995.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle du patrimoine du Président de la République, le système précisé par la loi du 6 novembre 1962 prévoit que les candidats à l’élection présidentielle doivent remettre au Conseil constitutionnel, sous peine de nullité de leur candidature, une déclaration relative à leur situation patrimoniale. Celle-ci est complétée par un engagement de déposer une nouvelle déclaration à l’issue du mandat. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. Ainsi tout citoyen peut-il être juge de l’évolution du patrimoine du Président de la République pendant la durée son mandat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a beaucoup de mal à considérer que la réglementation actuelle relative au financement des campagnes électorales présidentielles et au contrôle de l’évolution du patrimoine du Président de la République et des membres du Gouvernement constitue un ensemble de dispositions anodines. Il le considère avec d’autant plus de difficultés que, s’agissant de la transparence financière de l’exécutif, depuis le début de l’actuel quinquennat, le budget de l’Élysée est contrôlé chaque année par la Cour des comptes, dont le rapport est rendu public.
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de ce texte dans l’exposé des motifs, on ne peut raisonnablement déplorer l’existence d’un « vide juridique » concernant le contrôle des relations entre l’exécutif et le monde économique et, plus généralement, l’absence de dispositif relatif à la transparence financière de l’exécutif. Nous disposons en cette matière d’un ensemble solide de mesures qui peuvent, à elles seules, motiver un rejet au fond de cette proposition de loi constitutionnelle.
Cet argument de fond peut être corroboré par deux éléments complémentaires qui témoignent de la précipitation dans laquelle ce texte a été élaboré.
D’une part, telle qu’elle est rédigée, cette proposition de loi constitutionnelle autorise des interprétations extensives qui conduiraient à des interdictions peu compréhensibles. Le rapport de la commission des lois en cite quelques-uns, qu’il s’agisse des moyens matériels mis à la disposition du Président de la République ou des membres du Gouvernement pour assumer leurs fonctions ou de présents qu’ils recevraient dans le cadre de leurs fonctions de représentation, y compris diplomatiques.
D’autre part, l’application des dispositions de ce texte aurait pour conséquence un contrôle largement excessif de la vie quotidienne du chef de l’État et des membres du Gouvernement.
Enfin, je rappelle que le Président de la République et le Gouvernement ne sont pas fermés à toute prise en considération de la notion de conflit d’intérêt dans la vie politique.
J’en veux pour preuve le décret du 10 septembre 2010, pris à la demande du Président de la République, qui a instauré une commission de réflexion sur cette question, s’agissant notamment des membres du Gouvernement. Cette instance, qui a déjà commencé à travailler, doit remettre son rapport avant la fin de cette année. Au vu de ses conclusions, nous apprécierons s’il convient de compléter les textes actuels que j’ai précédemment évoqués.
Le projet de loi organique relatif à l’élection des députés et la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, déposée par les députés Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière, pourraient constituer des vecteurs législatifs susceptibles d’accueillir d’éventuelles dispositions portant sur les conflits d’intérêts entre l’exécutif et le monde économique.
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est conduit à vous demander de rejeter cette proposition de loi.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, une querelle de famille qui se transforme en feuilleton où le ministre de la comptabilité vient s’égarer et où le parquet assume sans complexe son rôle de bouclier judiciaire du pouvoir, un ex-ministre de la charité prêchant la fin des conflits d’intérêts à des petits camarades outragés sur fond de crise qui s’éternise et de rigueur sélective : tel est le contexte de cette discussion, contexte qui suffit à expliquer la fin de non-recevoir de la majorité sénatoriale et du Gouvernement à la présente proposition de loi constitutionnelle. À politicien, politicien et demi !
Pourtant, ce texte, qui concerne uniquement les acteurs les plus importants de la vie politique, s’en tient à des propositions très modérées. On s’étonnerait – n’était le contexte, comme je l’ai dit – qu’elles n’aillent pas de soi.
Interdire au Président de la République durant son mandat ainsi qu’aux membres du Gouvernement de recevoir des avantages en espèces ou en nature de la part de personnes morales, mais l’autoriser de la part de personnes physiques – ce qui préserve la sociabilité et les liens d’amitiés –, est-ce si scandaleux ? On pourrait commencer par là avant d’aller plus loin ; c’est d’ailleurs ce à quoi nous invite cette proposition de loi constitutionnelle.
On pourrait le faire en donnant par exemple aux institutions dont c’est déjà la mission – ce qui a été rappelé – les moyens d’exercer celle-ci correctement.
Il existe un corpus de textes relatifs au sujet ainsi qu’une Commission pour la transparence financière de la vie politique. Le rapporteur et le secrétaire d’État n’ont pas manqué de le rappeler.
Le problème, c’est que ce corpus est passablement « à trous » et que la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dont la composition et le mode de nomination pourraient être améliorés, ne dispose pas vraiment des moyens de ses fins.
Cette institution le déplore d’ailleurs régulièrement, à chacun de ses rapports. En effet, elle insiste sur le trop grand nombre d’élus à contrôler, de l’ordre de 3 000. Elle pointe ses moyens d’investigation trop limités, puisqu’elle n’a accès ni aux revenus des intéressés ni à leur dossier fiscal et ne dispose aucunement du pouvoir de demander des explications complémentaires, susceptibles en tout cas d’être obligatoirement suivies d’effet. Le contrôle est donc limité à la détection des progressions inexplicables du patrimoine, le revenu dépensé ou évadé se trouvant exclu. En outre, elle signale que des déclarations de patrimoine ne sont pas rendues publiques et que leur absence ou leur caractère mensonger ne peut pas être sanctionné. Elle note à cet égard la particulière discrétion des dirigeants d’entreprises publiques, de Gaz de France à La Poste, puisque, à en croire le rapport de 2007, cette année-là, 112 non-dépôts ont été constatés.
Rien d’étonnant donc à ce que, depuis 1988, 13 dossiers seulement aient connu une suite judiciaire, aucune d’ailleurs ne visant plus haut que l’échelon de conseiller général.
On pourrait aussi s’intéresser au régime baroque des incompatibilités entre fonctions gouvernementales, mandats parlementaires et activités professionnelles. Étrangement, si l’on ne peut pas être sénateur et professeur de philosophie, on peut en revanche être parlementaire et conseiller des entreprises dans leurs opérations fiscales ou leurs opérations de fusions-acquisitions ou vendre des armes et des avions à l’État. Rien de plus simple ! Il suffit de ne pas exercer de fonctions de direction ou d’influence significatives entrant dans le champ des incompatibilités dans les filiales de la holding que l’on dirige, laquelle n’entre pas dans ce champ.
Le byzantinisme flamboyant des décisions du Conseil constitutionnel qui le confirment mérite toute notre admiration. Ce n’est plus un bouclier, c’est du blindage !
On pourrait aussi étendre les pouvoirs des commissions d’enquêtes parlementaires, rendre leur ouverture possible à la demande de l’opposition, lever l’obstacle si commode de l’ouverture d’une instance judiciaire. Le judicaire n’étant pas un pouvoir mais une autorité, rien ne l’en empêche, à part l’absence de volonté politique.
On pourrait aussi s’arrêter sur le pantouflage multiforme et sur ce que je qualifierai de « pantouflage inversé », à savoir la mise en couveuse des futurs – qui sont aussi souvent d’ailleurs d’anciens – élus locaux ou nationaux et des fonctionnaires à responsabilité par les grands délégataires de services publics, les grandes entreprises travaillant pour les collectivités ou l’État. Ces décideurs, une fois parvenus ou revenus aux affaires, pourront, en respectant le code des marchés publics – ce qui n’est pas un problème –, contracter en toute légalité, au nom de leur collectivité ou de l’État, avec leurs anciens employeurs. Les marchés publics représentant de l’ordre de 120 milliards d’euros, par les temps qui courent, l’enjeu n’est pas mince !
S’agissant du pantouflage des fonctionnaires, la réglementation – rigoureuse sur le papier – s’accompagne dans les faits d’une tolérance molle dans son application, quand ce n’est pas d’un encouragement en vertu de la nécessaire perméabilité du public et du privé au nom de l’efficacité.
Quant au pantouflage du personnel politique, il est devenu une pratique mondialement si courante que, sur ce chapitre, la France est en retard. Nous manquons encore de Gerhard Schröder pour passer au service de Gazprom ou de Tony Blair pour conseiller les banquiers... Mais ce n’est probablement qu’une question de temps : nous allons certainement nous moderniser en ce domaine !
Des frontières de plus en plus diaphanes entre haute fonction publique, gouvernement et cabinets ministériels, entourage présidentiel, direction des grands groupes économiques et financiers, publics ou privés, organes de contrôle prétendument indépendants ; une classe dirigeante endogamique, habitant les mêmes lotissements parisiens ou azurés ; une oligarchie rompue au jeu des chaises musicales, des renvois d’ascenseurs, des participations croisées : quelle place peut-il bien rester à l’intérêt général ?
Plus fondamentalement, cela a-t-il un sens de demander à l’État moderne libéral de faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, quand sa fonction est uniquement de permettre le jeu libre et non faussé des intérêts particuliers, quand l’intérêt collectif est conçu comme la résultante de ce jeu concurrentiel ?
Manquer aux « devoirs de probité », pour reprendre la formulation du code pénal, a-t-il encore un sens pour le serviteur d’un État reformaté selon les principes du management moderne, lequel connaît seulement des coûts et ignore les valeurs et pour qui il n’existe qu’un seul impératif catégorique : faire du profit et s’enrichir ?
Le général de Gaulle considérait que « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». C’était hier. Aujourd’hui, non seulement la politique se fait à la corbeille et pour la corbeille qu’il faut à tout prix rassurer puisque l’on s’est placé entre ses mâchoires, mais celle-ci est installée au cœur de l’action publique.
J’illustrerai mon propos par deux exemples.
D’une part, le Fonds de réserve pour les retraites fonctionne ouvertement comme un fonds spéculatif. Ainsi, son conseil de surveillance, lors de la réunion du 16 juin 2009, après avoir constaté les pertes du Fonds, à la suite de la crise, n’entend pas remettre « en cause les bases sur lesquelles il avait fondé ses choix initiaux, à savoir qu’un investisseur de long terme qui n’a pas de contrainte de liquidité avant 2020 peut bénéficier dans la durée du surcroît de performance attendu des catégories d’actifs présentant une volatilité importante et, en particulier, les actions ».
En français courant, ce jargon signifie que le FRR entend bien récupérer par la spéculation ce qu’il a perdu par la spéculation !
D’autre part, l’Agence des participations de l’État, l’APE, a été créée pour veiller aux « intérêts patrimoniaux » de l’État – comme si ce dernier était une personne privée … – et pour exercer la mission de l’État actionnaire dans les entreprises où celui-ci détient des participations, majoritaires ou minoritaires.
Le problème est le suivant : la mission de l’État actionnaire est-elle de gagner le plus d’argent possible ou de conduire une politique industrielle ? La réponse ne va pas de soi, comme l’a montré l’affaire EADS. Je la rappelle en deux mots.
En 2005, EADS traverse une crise grave, entraînant un plan de suppression de 10 000 emplois et la chute de 35 %, en moyenne, du titre. Seule l’oligarchie, au sommet de laquelle figurent l’ex-coprésident d’EADS, Noël Forgeard – ancien haut fonctionnaire ! –, et les dirigeants des groupes Lagardère et Daimler, réussira à retirer ses billes à temps, empochant ainsi 90 millions d’euros de plus-values. Un instant suspectés de délit d’initié, tous les bénéficiaires seront mis hors de cause par l’Autorité des marchés financiers, en novembre 2009, dans la plus grande discrétion.
Voilà pour la partie privée.
S’agissant de la partie publique, celle qui nous occupe aujourd’hui, on apprendra que, à la fin de 2005, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de l’époque avait été informé de la situation par l’APE, qui lui avait conseillé de se désengager au plus vite. Thierry Breton n’a pas suivi cet avis, faisant passer la politique aéronautique de la France avant la protection du patrimoine de l’État. Ce dilemme est la preuve que le « conflit d’intérêt » est désormais niché au cœur même de l’État.
Pour en finir avec les conflits d’intérêts, il faudra donc beaucoup plus que des déclarations, beaucoup plus qu’une réforme des programmes de l’ENA, beaucoup plus qu’un code d’éthique, des circulaires ou le renforcement des pouvoirs d’autorités prétendument indépendantes, même si, comme je l’ai dit, cela ne ferait pas de mal de commencer par là.
Puisque le texte proposé aujourd’hui est « inefficace » et « contestable », pour reprendre les qualificatifs du rapporteur, on aurait pu le renvoyer en commission, comme on l’a fait ce matin pour la proposition de loi organique visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l’exercice d’une fonction exécutive locale.

Vous auriez ainsi pu l’enrichir, au lieu de l’exécuter !
Reste que je suis d’accord sur un point avec notre rapporteur : la question posée est essentiellement politique. C’est celle d’une Constitution qui concentre l’essentiel du pouvoir politique à l’Élysée, sans garantir son indépendance par rapport au pouvoir économique et financier ; c’est celle d’une organisation politique sans autre contre-pouvoir que le pouvoir économique et financier. En l’occurrence, peut-on même encore parler de contre-pouvoir ?
Ce n’est donc pas parce que cette proposition de loi constitutionnelle a des ambitions modestes, et qu’elle ne s’attaque pas à l’immense chantier qui est devant nous, que l’on est fondé à la rejeter. C’est pourquoi le groupe socialiste la votera.

M. Pierre-Yves Collombat. Merci de nous soutenir dans cette action, mon cher collègue ! Bravo ! Avec vous, on ne s’ennuie jamais !
M. Alain Gournac s’exclame.

Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi avant tout de me réjouir de vous retrouver en meilleure santé.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis frappé de constater que seuls neuf sénateurs sont présents cet après-midi pour participer à l’examen d’une proposition de loi constitutionnelle relative à la transparence financière de la vie politique.

Même si la qualité est au rendez-vous, il manque tout de même le nombre, et c’est regrettable.

Notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a eu raison de se référer à la Convention, régime qui a honoré notre nation, sous la conduite de l’Incorruptible.

Parfois, cela peut être utile, monsieur le président de la commission …

Cette proposition de loi, nouvellement constitutionnelle, nous amène à nous pencher sur la probité dans la vie politique, question de plus en plus prégnante dans le débat public.
Et le débat va au-delà du problème posé par le présent texte. Il concerne très clairement les relations entre le monde politique et le monde économique ou la justice. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article du juge Régnard dans l’édition du Monde datée du 29 octobre 2010.
Ce combat est commun à l’ensemble des responsables politiques, toutes sensibilités confondues. À juste titre, la demande de transparence de nos concitoyens ne cesse de croître ; dans le même temps, force est de reconnaître que la confiance qu’ils nous accordent est fragilisée, encore que les élus municipaux jouissent toujours d’une très large confiance, au reste méritée.

Mes chers collègues, il est impératif de conforter la confiance en la chose publique. Certes, le chemin sera long et semé d’embûches : selon un récent sondage, 60 % à 70 % de nos concitoyens considéreraient que leurs élus sont corrompus ou sensibles à la corruption. Cela étant, je me méfie de ce type de sondage, car je ne suis pas convaincu que les chiffres reflètent la réalité : on le voit bien avec la confiance qu’accordent nos concitoyens à leurs élus de terrain.
Cela étant, cet état de fait a été causé en grande partie par les trop nombreuses affaires qui ont émaillé la vie politique au cours de chaque république, au cours de chaque régime. Au demeurant, je tiens à écarter immédiatement toute polémique partisane : aucun bord politique ne peut se prévaloir d’être ou d’avoir été exempt de comportements contestables ; …

Mais ce n’est pas l’unique raison. Le manque de transparence, la légèreté du cadre juridique qui entoure nos statuts, ont été le terreau de cette véritable défiance, phénomène qui a été accéléré, il faut le dire, par les crises financières, comme celle de 1928 ou celle de 2008.
Mais, de grâce, ne tombons pas dans un antiparlementarisme inacceptable, …

… utilisé par les véritables ennemis de la démocratie : l’extrême droite et l’extrême gauche !

En nous intéressant à l’indépendance des membres du Gouvernement et du chef de l’État, nous ne pouvons faire l’économie de l’étude de la question du conflit d’intérêt.
Notion large, protéiforme, ne faisant l’objet d’aucune définition légale ou jurisprudentielle, le conflit d’intérêt est pourtant au cœur de l’actualité politique de ces derniers mois. L’un des premiers à s’y être intéressé est sans conteste le duc de La Rochefoucauld, qui, dans une phrase devenue célèbre, nous rappelle que « Les vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves dans la mer ».
Plus récemment, on peut se référer aux travaux de l’OCDE, en particulier aux recommandations de son conseil, en date du 28 mai 2003. À la lecture de la définition retenue, on constate aisément que les situations de conflit d’intérêt concernent non pas uniquement les membres du Gouvernement, mais également l’ensemble des décideurs publics.
Forts de ce constat, plusieurs membres du groupe du RDSE, sous la conduite, à l’époque, de Michel Charasse, ont déposé l’année dernière une proposition de loi tendant à interdire ou à réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeant d’une entreprise du secteur public et d’une entreprise du secteur privé. L’existence d’intérêts publics et d’intérêt privés divergents, voire opposés, ne peut en effet aller qu’à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’État.
Je remarque que notre proposition de loi, adoptée ici même il y a près d’un an, n’a toujours pas été examinée par l’Assemblée nationale…

Les auteurs de la présente proposition de loi constitutionnelle partagent cet objectif global, et ce même si le texte se consacre uniquement à la manifestation la plus voyante du conflit d’intérêt que constitue l’enrichissement personnel.
Je rappelle que l’OCDE a dégagé sept situations créant les conditions de potentiels conflits d’intérêts. Aujourd’hui, dans notre législation, des failles demeurent, indiscutablement.
Je le répète, il est important de ne pas non plus noircir le tableau et de rappeler qu’un contrôle des patrimoines respectifs des membres du Gouvernement et du Président de la République existe déjà, dont la double déclaration de patrimoine. Toutefois, les modalités du contrôle divergent. Pour les membres du Gouvernement, il est effectué par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, sans sanction directe. Pour le Président de la République, le système retenu est celui du contrôle du peuple, lequel est censé ne pas redonner sa confiance en cas de pratiques douteuses. §(M. Pierre-Yves Collombat s’esclaffe.) C’est un autre débat ...
Durant la campagne présidentielle, le contrôle est accru. Les dons provenant de personnes morales sont interdits quand ceux qui émanent de personnes physiques sont limités à 4 600 euros. Il est dommageable que de telles limitations n’aient pas cours durant l’exercice des fonctions ministérielles.
Nous avons proposé des pistes ambitieuses pour renforcer le contrôle des membres du Gouvernement et du Président de la République, tout en sachant que de nombreux obstacles devront être franchis pour parvenir à davantage de moralisation et de limpidité de la vie politique.
Nous considérons comme impératif que les auteurs d’infractions liées à l’exercice d’un mandat politique fassent systématiquement l’objet de poursuites pénales. L’image de l’État en général, des politiques et des magistrats en particulier, est meurtrie par les affaires que nous connaissons.
La Chancellerie doit avoir le courage de prendre une directive générale de politique pénale en matière de trafic d’influence et de prise illégale d’intérêts ainsi que de donner mandat aux parquetiers de poursuivre les auteurs de ce type d’infractions. D’ailleurs, à cette occasion, on se rendra compte que ceux-ci ne sont pas très nombreux et que des exemples sont souvent utiles dans la République.
Mes chers collègues, afin de ne pas revivre le fiasco estival, il est essentiel d’étendre les incompatibilités ministérielles et d’interdire qu’un ministre, directement ou indirectement, ait des intérêts dans des entreprises publiques ou privées, associations ou organismes soumis au contrôle de son administration. Il faudra bien régler la question du cumul des mandats électifs et des mandats d’administrateur de grandes sociétés ou celle de l’inflation du nombre de parlementaires avocats d’affaires.
Le dossier n’est pas mince, mais il faudra bien nous attaquer à cette réalité. Loin de moi l’idée de jeter l’opprobre sur la classe politique à laquelle je suis fier d’appartenir, mais, en les affranchissant des intérêts privés, nous rendrons aux uns et aux autres leur liberté d’élus et de citoyens. C’est indispensable !
Le texte présenté mériterait d’être complété. Tout d’abord, aucune sanction n’est prévue. Ensuite, le problème du contrôle de la véracité de la déclaration ou de son absence pure et simple demeure. En outre, il aurait peut-être également été utile d’attendre les conclusions de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé.

M. Jacques Mézard. Malgré quelques réticences techniques, nous considérons que poser le problème comme le fait cette proposition de loi constitutionnelle est utile. La majorité des membres de mon groupe apportera donc son soutien à ce texte, car il vise à lutter contre un mélange des genres tout à fait malheureux pour l’image de notre vie publique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers mais peu nombreux collègues, le pouvoir et l’argent ne font pas bon ménage, mais les conflits d’intérêts semblent avoir de beaux jours devant eux si nous ne nous décidons pas à endiguer ces abus.
La démocratie est en grand danger lorsque des proximités se développent entre les pouvoirs publics et l’argent, en témoignent les nombreuses dérives auxquelles nous avons récemment assisté.
Les frontières entre ces deux sphères sont terriblement poreuses, à tel point que l’on en vient à décorer les heureux contributeurs de la campagne présidentielle de 2007 de la Légion d’honneur, transformant ainsi la médaille napoléonienne en hochet pour riches.
Je ne vais pas citer toutes les affaires ici, mais leur grand nombre fait prendre aujourd’hui à la France des allures de République bananière. Elles sont très éloignées de l’exigence démocratique de transparence que beaucoup semblent appeler de leurs vœux. Il est visiblement difficile de passer des paroles aux actes…
De même que la privatisation des moyens de renseignement, les généreux cadeaux fiscaux, le cumul des fonctions et le lobbying installé au cœur du pouvoir témoignent d’une mise sous tutelle inacceptable de l’État par des personnes morales.
Nous avons rectifié notre proposition de loi afin de répondre à l’argument d’inconstitutionnalité qui allait nous être opposé, la commission estimant que les dispositions proposées devaient relever à tout le moins d’un texte de valeur organique.
Mais, au regard de tous les scandales politico-financiers, on pourrait considérer que la politique de M. Sarkozy est, dans son ensemble, inconstitutionnelle, dès lors que l’article 4 de notre loi fondamentale dispose que « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »
Nous sommes aujourd’hui très loin du compte. Nos concitoyens nous ont mandatés pour les représenter, les écouter et les relayer. Nos mandats politiques ne doivent théoriquement pas nous permettre d’agir avec cupidité.
Car un État est démocratique dans le sens où chacun concède son pouvoir décisionnel, non à un autre individu ou à un groupe déterminé, mais à la société dont il constitue une composante.
Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui le pouvoir est invariablement détenu et transmis au sein d’un groupe particulier. La grande majorité de la population se trouve exclue de l’élaboration de nos politiques publiques, ce qui est, vous en conviendrez, fortement dommageable pour ce qui reste de notre État de droit et de notre République. Nous regrettons d’ailleurs que notre pays ne se soit pas acheminé vers l’établissement d’une véritable démocratie participative.
Le 12 juillet dernier, à l’occasion de son intervention sur France 2 destinée à désamorcer la bombe « Woerth-Bettencourt », le Président de la République déclarait qu’il demanderait « à une commission représentant toutes les familles politiques de réfléchir à la façon dont on doit ou non compléter ou modifier la loi pour éviter dans l’avenir toute forme qui pourrait intervenir de conflit d’intérêts », admettant, de fait, qu’il y avait un problème.
À la suite de la publication du livre de M. Hirsch faisant état de situations quelque peu gênantes, trois personnalités – un magistrat, un conseiller d’État et un président de la Cour des comptes – ont été récemment chargées par Nicolas Sarkozy de réfléchir aux « situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait ».
En tant que parlementaires, au titre du mandat qui nous a été confié, nous devions prendre la responsabilité d’agir. Face à la multiplication des dérives, confortées par une législation lacunaire en la matière, nous avons donc été incités à développer notre réflexion sur l’indépendance du pouvoir exécutif et à vouloir aller plus loin dans notre détermination à combattre ces abus.
La législation actuelle présente des insuffisances, beaucoup s’accordent à le reconnaître, tant dans son champ d’application, qui est aujourd’hui limité aux seuls partis et candidats, que dans l’effectivité de son application.
L’interdiction faite aux personnes morales de participer à la vie politique du pays ne concerne que les périodes de campagne électorale et le financement des partis politiques, alors qu’elle devrait concerner l’ensemble de la vie politique.
Afin de remédier à cette contradiction, nos propositions ont pour objet d’étendre l’interdiction de recevoir tout don ou avantage, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de créer une obligation de déclaration des dons provenant de personnes physiques, lorsque ceux-ci excèdent un montant annuel fixé par la loi ordinaire. Ce dernier pourrait être établi à 4 600 euros, à l’instar de la législation actuelle en matière de financement de la campagne des candidats à une élection.
Comme l’a rappelé Nicole Borvo Cohen-Seat, les dons concernés sont directs ou indirects. Tout don ou avantage en nature effectué par une tierce personne dont bénéficient également les personnes visées par notre texte sont pris en compte dans le calcul des sommes déclarées. Cette nouvelle législation serait applicable non seulement au Président de la République, mais aussi aux membres du Gouvernement.
Les sanctions envisagées sont celles prévues par la Constitution pour le Président de la République et par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour les membres du Gouvernement.
Cette proposition de loi constitutionnelle n’a d’autre objet que de renforcer la transparence de la vie politique, en accord avec la loi suprême de notre république, à savoir le respect de la souveraineté nationale.
La démocratie ne peut trouver son accomplissement que dans une société où les hommes, librement associés, exercent activement leur souveraineté, sans s’en faire dépouiller par d’insidieux dispositifs politiques ou autres copinages de circonstance.
Pour réaliser la démocratie, il ne faut pas seulement que les décisions soient prises en accord avec la majorité, il faut aussi qu’elles soient prises pour la majorité ! C’est tout le sens de nos propositions.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, préoccupation constante des responsables politiques, la volonté d’écarter tout soupçon d’enrichissement par une sujétion à la sphère économique a fait l’objet de plusieurs évolutions législatives.
La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est une concrétisation de cette volonté. Un candidat à une élection ou un parti politique ne peuvent plus recevoir de dons de la part d’une personne morale. De plus, afin de démontrer que leur fonction n’a pas été source d’enrichissement personnel, les élus sont soumis à une obligation de déclaration de leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. Ce mécanisme de contrôle est même renforcé à l’égard des candidats à la présidence de la République. En effet, à peine de nullité de leur candidature, les candidats sont tenus de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale.
Par la suite, la loi du 8 février 1995 a étendu cette obligation de déclaration aux membres du Gouvernement et aux titulaires de certaines fonctions. Comme l’affirmait récemment le Président de la République : « Il ne suffit pas que la République soit irréprochable. Il faut encore qu’elle ne puisse même être suspectée de ne pas l’être ».
À cet égard, le texte présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et plusieurs membres du groupe CRC-SPG vise à renforcer la transparence entre le monde politique et le monde des affaires.
Compte tenu de la rectification apportée par ses auteurs pour transformer la proposition de loi en proposition de loi constitutionnelle, deux dispositions sont proposées en un article unique : la première vise à interdire au Président de la République et aux membres du Gouvernement, pendant toute la durée de leur mandat, de recevoir des dons de personnes morales ; la seconde a pour objet de soumettre les dons des personnes physiques au régime de déclaration obligatoire.
Comme l’a souligné notre rapporteur, Patrice Gélard, si cette proposition de loi constitutionnelle se fixe l’objectif légitime d’encadrer des cadeaux et des avantages en nature dont le Président de la République et les membres du Gouvernement pourraient être les destinataires, son dispositif comporte d’importantes lacunes.
Le texte qui est soumis à notre examen comporte deux limites majeures, d’une part, quant à son opportunité, d’autre part, quant à l’efficacité de son dispositif.
Tout d’abord, ce texte semble prématuré. Sur l’initiative du Président de la République, une commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique a été mise en place en vue de traiter la question de la régulation des relations entre les responsables politiques et le milieu des affaires. Présidée par M. Jean-Marc Sauvé, la commission doit rendre ses conclusions avant le 31 décembre 2010. Il serait donc peu opportun de légiférer sur cette question avant même que la commission n’ait achevé ses travaux.
Par ailleurs, le mécanisme que ce texte prévoit serait inopérant. En effet, il présente une profonde vacuité en proposant de soumettre les membres de l’exécutif à l’interdiction de percevoir des dons sans qu’il ait été prévu de sanctions pour les cas où ce dispositif ne serait pas respecté.
De plus, la notion d’« avantages en nature » ne saurait fonder juridiquement une telle interdiction, tant ses acceptions sont floues et pourraient faire l’objet d’une interprétation extensive. Comme l’a présenté notre rapporteur à titre d’exemple, avec un tel mécanisme, « il serait interdit [aux membres de l’exécutif] de se rendre en vacances chez des amis si ceux-ci ont acheté leur maison sous la forme d’une société civile immobilière : les SCI étant des personnes morales, le fait de jouir d’une habitation ainsi constituée tomberait en effet sous le coup de l’interdiction de recevoir des avantages en nature procurés par des personnes morales ».
Nous voyons bien ici que les faiblesses de cette proposition de loi constitutionnelle pourraient conduire à des situations absurdes et induire des sanctions totalement disproportionnées, d’autant plus que ce texte se heurte à la nécessaire protection de la vie privée des membres de l’exécutif.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre cette proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle initiale.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – Est interdit le fait, pour tout candidat élu à la Présidence de la République, et durant toute la durée de son mandat, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Ces dons ainsi définis qui lui sont consentis par des personnes physiques, à l’exception des donations familiales, font l’objet d’une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique s’ils excèdent un montant global fixé par la loi. » ;
2° Après l’article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – Est interdit le fait, pour les membres du gouvernement, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l’exception des donations familiales, font l’objet d’une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique s’ils excèdent un montant global fixé par la loi. »

Je ne suis saisi d’aucun amendement.
Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, je donne la parole à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais ce n’est sans doute pas une raison de voter sans s’expliquer !
Je voudrais répondre aux objections qui ont été formulées par notre rapporteur, reprises par M. le secrétaire d’État puis par notre collègue Robert Laufoaulu.
Première volée d’arguments : ce texte serait inefficace parce qu’il prévoit une obligation sans sanction.
Mes chers collègues, tout de même, nombre de textes que nous votons, présentés notamment par la majorité sénatoriale, comportent des déclarations non assorties de sanction ! Ce n’est nullement une particularité de la présente proposition de loi constitutionnelle !

C’est le cas des comptes de campagne lors des élections présidentielles. Vous imaginez le Conseil constitutionnel invalidant l’élection de M. Sarkozy en invoquant des « incertitudes » ?

Cela n’a rigoureusement aucun sens !
Ensuite, la notion même d’avantages en nature et de dons serait trop large. Les membres du Gouvernement, le Président de la République ne pourraient plus avoir de logement ni de voiture de fonction, considérés comme des avantages en nature. Cet argument ne tient pas, dans la mesure où un logement, une voiture de fonction sont liés à des obligations de service, sont partie intégrante de ce service.
Vous avez aussi évoqué les cadeaux diplomatiques. De deux choses l’une : soit il s’agit d’un cadeau offert par un chef d’État étranger au chef de l’État français, auquel cas, c’est une affaire d’État et le cadeau en question va rejoindre, le cas échéant, un musée prévu à cet effet - on en connaît un exemple, les touristes adorent -, soit il s’agit d’un cadeau offert dans le cadre d’une relation interpersonnelle, ce qui est parfaitement toléré !
Quant aux SCI, vous avez vraiment failli me faire pleurer ! Chers collègues, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre… On sait à quoi servent les SCI, personnes morales. Ma foi, si vous allez habiter dans la maison de votre ami président des États-Unis, qui n’est pas la propriété d’une SCI, il n’y a aucun problème particulier !
Vous invoquez par ailleurs de larges possibilités de contournement. Mais nous passons notre temps à voter de nouvelles lois, ce qui prouve bien que les anciennes ont été contournées. Voilà donc un argument d’aussi peu de poids que les précédents !
Mais le meilleur, monsieur le rapporteur, c’est quand vous invoquez l’argument de la protection de la vie privée ! Faut-il le rappeler ici ? la vie privée d’une personne publique n’est pas exactement la même que celle d’une personne qui ne l’est pas. En outre, vous savez comme moi que la mise en scène de la vie privée est désormais devenue un outil de gouvernement. Je ne vais pas vous réciter Nice-matin, mais il y est souvent question du fils, de la femme, du Président lui-même, de son jogging, de son vélo, de la pizza au Cap Nègre…
Vous nous dites également, monsieur le rapporteur, que ce texte est contestable. Certes, en cas de manquement au devoir de probité personnelle, la sanction est politique. Toutefois, actuellement, les élus autres que ceux qui sont visés par la proposition de loi constitutionnelle qui manqueraient au devoir de probité sont soumis au code pénal, lequel prévoit une liste de ces manquements.
De ce fait, le système français actuel, que ce soit constitutionnellement ou dans la pratique, est de nature consulaire. Il n’y a pas de contre-pouvoir : le pouvoir fait exactement ce qu’il veut, sans contrôle.
Si seule la sanction électorale est recevable, quid des membres du Gouvernement, qui, conformément à la Constitution, d’ailleurs, ne sont pas des élus ? Quid des dispositions et des organismes comme le Conseil constitutionnel, qui existent, mais que les électeurs ne peuvent pas mettre en cause ?
Ce texte serait au surplus prématuré, une commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique ayant été mise en place. Mais, précisément, chers collègues, la mise en place de cette commission ne prouve-t-elle pas qu’il y a un petit problème ?
Pour conclure, je dirai que le dispositif ici proposé n’est pas plus inefficace que l’absence actuelle de dispositif. Il n’a rien d’inutile non plus, comme le montre bien la mise en place de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique. Je pense d’ailleurs que cette commission ne réglera pas les questions qui se posent aujourd'hui, car nous faisons face non pas à des conflits d’intérêts, mais à des problèmes de moralité publique.

Je ne prolongerai pas inutilement notre débat, Pierre-Yves Collombat ayant repris un certain nombre des arguments qu’Éliane Assassi et moi avons développés lors de nos interventions, mais je tiens tout de même à avouer ma très grande surprise d’entendre dire ici que, si elle était adoptée, cette proposition de loi constitutionnelle donnerait lieu à des contournements, comme j’ai pu le lire d’ailleurs aussi dans le rapport de la commission.
Cette conception de la transparence et des obligations faites aux élus de la République et aux personnes exerçant les plus hautes responsabilités est franchement inacceptable.
Si la transparence, la probité, le respect de la morale publique, font partie de notre consensus républicain et de nos valeurs communes, il est normal de poser des principes et de faire en sorte que les personnes publiques exerçant les plus hautes responsabilités s’y conforment, en prévoyant des garde-fous pour les cas où certaines failliraient, car la faiblesse est humaine. Mais considérer d’emblée que les femmes et les hommes publics exerçant les plus hautes responsabilités n’auront qu’une idée, à savoir contourner ces règles, c’est bien triste. On ne devrait pas entendre de tels propos dans cet hémicycle.
Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous êtes défavorables à cette proposition de loi constitutionnelle, mais si les conflits d’intérêts font aujourd'hui l’actualité, vous y êtes sans doute pour quelque chose !
En tout cas, nous serons là pour dire ce que nous avons à dire lorsque la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique rendra ses conclusions et pour solliciter qu’elles se traduisent, si elles sont pertinentes, par un texte législatif.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement se sont prononcés contre.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 2 novembre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
2. Débat sur l’accession à la propriété.
3. Question orale avec débat n° 33 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la nécessaire réforme des dispositifs « amiante ».
M. Jean-Pierre Godefroy attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessaire réforme des dispositifs « amiante ».
Aujourd’hui, plus personne n’ignore l’ampleur de ce drame sanitaire, qui se traduira par 100 000 décès dans les 20 à 25 ans à venir.
Depuis plusieurs années, les rapports et les propositions de réforme se succèdent sans qu’aucune suite n’y soit jamais donnée. Les rapports du Sénat – 2005 - et de l’Assemblée nationale - 2006 - ont ouvert la voie à une évolution des dispositifs de prise en charge des maladies liées à l’amiante, non sans considérer d’ailleurs leur coût financier. L’inspection générale des affaires sociales, IGAS, la Cour des comptes, le groupe de travail chargé de recenser toutes les victimes de l’amiante et de proposer au Gouvernement une réforme du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, CAATA, mais aussi le Médiateur de la République ont également souligné les carences des dispositifs de préretraite - Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, FCAATA - et d’indemnisation des victimes - Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, FIVA.
Pourtant, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, le Gouvernement restreint le traitement de cette question à son aspect purement financier et les règles en matière d’irrecevabilité financière empêchent les parlementaires de proposer par amendements les évolutions positives attendues par les milliers de salariés confrontés au problème de l’amiante.
Aujourd’hui, il est urgent d’agir afin de rendre plus justes les conditions d’attribution des « allocations amiante » mais aussi de rendre plus pérennes les modalités de financement des « fonds amiante ». C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
4. Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur le traitement des déchets.
5. Débat sur la participation de la France au budget de l’Union européenne.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous souhaite un complet rétablissement. Quant à vous, mes chers collègues, je vous souhaite un bon week-end.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq.