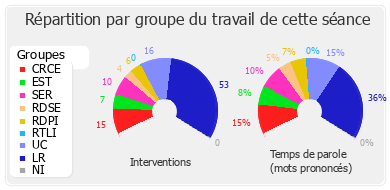Séance en hémicycle du 13 novembre 2020 à 21h30
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.

La séance est reprise.
I. – L’article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160-8. »
II. – L’article L. 2212-10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212 -10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
III. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161-34 », est insérée la référence : «, L. 162-1-21 ».
IV. – Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après la référence : « L. 161-15 », est insérée la référence : «, L. 162-1-21 ».

Aujourd’hui, en France, lorsqu’une interruption volontaire de grossesse, ou IVG, est pratiquée, le forfait de prise en charge des frais causés est remboursé en totalité par l’assurance maladie, mais la dispense d’avance de frais, elle, n’est pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées.
L’absence de pratique systématique du tiers payant intégral ne permet pas, aujourd’hui, de garantir le respect du secret pour les assurées qui ont la volonté de garder leur parcours confidentiel.
Cet article, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, tend à mettre fin à cette situation. Nos collègues députés ont en effet voté en faveur du tiers payant intégral systématique en cas d’interruption volontaire de grossesse, avec le souci de permettre cette confidentialité dans tous les cas de figure. Je partage cette volonté !
L’amendement adopté tendait à préciser que la prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse était protégée par le secret, afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. Oui, les femmes doivent pouvoir y avoir recours si elles le souhaitent, sans que l’information ne soit révélée à leurs parents ou à leur conjoint !

L’amendement n° 169, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.

Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 33 bis, qui tend à étendre le bénéfice du tiers payant à toutes les assurées au titre des frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse et à prévoir que la prise en charge d’une IVG soit protégée par le secret.
Cet article est issu de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement adoptée par l’Assemblée nationale le 8 octobre dernier.
Rappelons que les interruptions volontaires de grossesse sont intégralement prises en charge par l’assurance maladie et que les assurées les plus vulnérables bénéficient déjà du tiers payant : assurées mineures, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, et bénéficiaires de l’aide médicale d’État.
Le tiers payant est, en outre, largement pratiqué dans les établissements de santé. Le dispositif proposé aurait donc essentiellement un effet sur les frais relatifs aux IVG médicamenteuses prescrites en ville.
Concernant la confidentialité entourant la prise en charge des IVG, certaines dispositions permettent déjà de la garantir dans certains cas : la confidentialité est absolue pour la prise en charge des IVG des mineures sans consentement parental. Pour les assurées majeures, la feuille de soins peut être aménagée de façon à préserver la confidentialité des patientes ; le médecin de ville peut aussi les orienter vers un établissement de santé garantissant leur anonymat.
Les évolutions des dispositions encadrant l’IVG, qui doivent assurer un recours effectif au droit à l’avortement, méritent un débat approfondi.
Or la commission n’a pas pu apprécier pleinement la portée des dispositifs proposés, qui ont été introduits par voie d’amendement à l’Assemblée nationale et qui ne relèvent pas tous du champ d’une loi de financement de la sécurité sociale.
Il est préférable d’évaluer l’opportunité de ces mesures dans le cadre d’un texte spécifique. C’est pourquoi la commission présente cet amendement de suppression.
Si je comprends bien les propos de Mme la rapporteure, la commission ne s’oppose pas sur le fond au principe figurant dans cet article. Elle considère simplement qu’une telle mesure devrait plutôt s’inscrire dans le cadre d’un autre véhicule législatif.
Je pense que nous partageons tous ici, sur ces travées, l’objectif de rendre le recours à l’IVG le plus effectif possible pour les femmes, d’une part, et d’être le plus protecteur possible pour ces femmes, d’autre part.
Dès lors, il nous semble opportun de mettre en place le plus rapidement possible le dispositif essentiel prévu par cet article, afin de proposer un accès pleinement effectif à l’IVG pour les femmes majeures qui pourraient subir une pression ou des représailles de la part de leurs proches. Il faut que les femmes puissent effectivement bénéficier de la protection que ce dispositif leur assure.
Enfin, je précise que cette mesure a des implications financières, ce qui explique qu’elle figure dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pourquoi s’en priver ? Pourquoi retarder la mise en place d’un dispositif qui garantit une plus grande effectivité de l’accès à l’IVG et une meilleure protection des femmes dans notre pays ?
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Je vous remercie de vos explications, monsieur le secrétaire d’État.
Sur la forme, je comprends ce que dit notre rapporteure, mais, mon Dieu, ce ne serait pas la première disposition n’ayant pas de lien direct avec la loi de financement de la sécurité sociale que nous adopterions !
Je faisais même remarquer tout à l’heure qu’il manquait des éléments financiers en ce qui concerne les maisons de naissance et que l’existence de cet article, tout à fait bienvenu par ailleurs, pouvait se discuter dans le cadre d’une loi de financement de la sécurité sociale.
Par conséquent, les raisons de forme qui ont été avancées ne me paraissent pas rédhibitoires, et il faut s’en tenir réellement au fond : cet article améliore l’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse, dans la mesure où celles-ci pourront bénéficier du tiers payant pour l’ensemble des frais occasionnés par une IVG.
Pour notre part, nous ne voterons donc pas cet amendement de suppression, dont l’adoption enverrait un message négatif et, d’une certaine façon, exprimerait une position de fond.

Il est extrêmement important que nous votions cet article.
Je me réjouis d’ailleurs que l’Assemblée nationale ait pu l’adopter sans que cela ait apparemment posé le moindre problème. Il est important que le Sénat puisse également l’adopter, pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées.
Il est également important de ne pas s’en tenir uniquement à la forme, car la forme, c’est aussi le fond.

On cherche finalement à faire en sorte que toutes les femmes, qui le souhaitent évidemment, puissent égalitairement avoir accès à l’interruption volontaire de grossesse, dans les meilleures conditions qui soient, y compris en prévoyant les conditions financières leur permettant d’y accéder sans aucun frein d’aucune sorte.
Voilà la question posée à notre Haute Assemblée ; voilà le sujet sur lequel, me semble-t-il, nous devons nous prononcer.
Dans cette période de pandémie, on a vu que l’accès aux soins, d’une manière générale, était difficile ; l’accès à l’IVG l’était donc d’autant plus. À la lumière de tous ces éléments, il serait extrêmement positif que notre assemblée vote majoritairement, voire unanimement, contre cet amendement de suppression.

Je mets aux voix l’amendement n° 169.
Je mets aux voix l’article 33 bis.
L ’ article 33 bis est adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 441 rectifié bis est présenté par Mme Billon, MM. Poadja, Hingray, Capo-Canellas et Lafon, Mmes de La Provôté et Férat, M. Delcros, Mmes C. Fournier, Perrot, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, Tetuanui et Létard, MM. Cadic, J.-M. Arnaud, Longeot, Levi, Détraigne et Kern, Mme Sollogoub et MM. Le Nay, Janssens, Canevet et Duffourg.
L’amendement n° 581 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 441 rectifié bis.

Je présente cet amendement au nom de ma collègue Annick Billon.
Il s’agit d’une demande de rapport, mais peu importe : il arrive en effet que de telles demandes soient acceptées, d’autant plus que cette proposition est réellement très pertinente !
Ma collègue souhaitait attirer l’attention et, surtout, demander un état des lieux très précis du dispositif « engagement maternité », dispositif extrêmement important, dont avait parlé l’ancienne ministre de la santé. Il serait surtout très intéressant qu’on l’étende à tout le territoire.
L’« engagement maternité » a été annoncé pour organiser des schémas de prise en charge des parturientes qui résident à plus de quarante-cinq minutes d’une maternité. En fait, cet engagement semble avoir du mal à prendre corps.
Pourtant, il faudrait qu’il devienne une réalité dans chaque territoire, et ce, finalement, quelle que soit la distance avec la maternité. Un tel engagement devrait définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences.
Je défends très volontiers l’amendement de ma collègue, parce que ces dispositifs constituent un réel enjeu stratégique. Ils soulèvent en effet un problème d’aménagement du territoire.
Je vais parler au nom d’un certain nombre d’élus : on a beau avoir des enveloppes budgétaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, qui augmentent et qui nous permettent de construire des salles fêtes très attractives et un tas d’équipements très intéressants pour faire venir les gens sur nos territoires, il reste compliqué d’attirer les jeunes familles quand la maternité est à plus de quarante-cinq minutes de chez elles.
Si l’on pouvait au moins leur donner accès à ce dispositif, leur expliquer comment agir dans ce genre de circonstances, et faire en sorte que les choses soient extrêmement cadrées, alors ce rapport ferait partie des documents utiles pour le développement et l’essor de l’attractivité de nos territoires.

L’amendement n° 581 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Pour les raisons que vous connaissez – les demandes de rapport sont en général peu suivies d’effets –, la commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 796 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou et Meunier, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les modalités de prise en charge intégrale de tous les moyens de contraception existants par l’assurance maladie.
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Je présente cet amendement en votre nom, madame la présidente, vous qui en êtes la première signataire, et au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Cet amendement tend à s’inscrire dans une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes : il vise à réduire une inégalité sexuée spécifique au système de soins en vigueur. Certains moyens de contraception, pourtant indispensables à la santé de leurs usagères, ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, ou le sont seulement partiellement.
Cet amendement d’appel vise à inciter le Gouvernement à se pencher sur la persistance de cette inégalité, qui peut être onéreuse, puisqu’elle peut atteindre 500 euros annuels pour certaines contraceptions non remboursées.

La commission est hostile aux demandes de rapport, mais je pense que le Gouvernement aura entendu votre appel, ma chère collègue.
La commission émet donc un avis défavorable.

Tout d’abord, si l’on est attentif, on s’aperçoit que, depuis lundi, jour où nous avons commencé à examiner ce texte, plus d’une trentaine de rapports ont été demandés. S’ils avaient tous été acceptés, monsieur le secrétaire d’État, je vous aurais souhaité bien du courage !
Il me semble logique de rejeter ces demandes. Au reste, l’année passée, dans le cadre de la loi Ma santé 2022, nous en avions accepté une bonne vingtaine et, au total, seuls deux ou trois ont été publiés.
Ensuite, je voudrais poser une question à Mme Meunier : quels sont les moyens de contraception coûtant plus de 500 euros dont vous parlez ?

J’ai entendu les interventions des uns et des autres à propos des rapports, mais l’ensemble de nos travaux repose souvent sur ce type de documents, qu’on les appelle études ou rapports, et on est très content de pouvoir s’appuyer dessus.
Pour répondre concrètement à votre question, monsieur Milon, je connais de jeunes femmes qui utilisent des éponges contraceptives, des gels ou des crèmes spermicides, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
M. Valérie Boyer s ’ exclame.

Ce débat est récurrent et, d’une année sur l’autre, on échange toujours à peu près les mêmes arguments au sujet des demandes rapports, que ce soit dans un sens ou dans l’autre.
Personnellement, j’aimerais bien – je crois même l’avoir déjà dit, mais sans succès – que soit enfin définie une doctrine sur les rapports, y compris ceux du Gouvernement. En effet, s’il est inutile de demander trop de rapports, il ne faut pas oublier que ces documents sont nécessaires à l’éclairage de l’action publique.
Il est temps que l’on se réunisse, avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale, pour définir une vraie doctrine à ce sujet, fixer un nombre limité de rapports à remettre au parlement et rendre obligatoire l’élaboration desdits rapports par le Gouvernement.
Il me semble avoir déjà fait une intervention de ce genre il y a un ou deux ans, mais, malheureusement, chaque année, on a toujours à peu près les mêmes débats et on n’avance pas.
Il est vraiment temps que l’on établisse une doctrine claire : ne demander aucun rapport n’a pas de sens, mais, à l’inverse, se retrouver avec trop de rapports ne va pas non plus. Je plaide pour un cadrage précis dans ce domaine !

Je ne reviendrai pas sur la problématique des demandes de rapports.
Sur le fond, tous les contraceptifs ne bénéficient pas d’un remboursement, y compris parmi les contraceptifs oraux d’ailleurs. En outre, ma collègue Michèle Meunier a cité des produits qui ne bénéficient pas non plus d’une prise en charge.
Le problème, vous l’avez bien compris, c’est qu’il existe un reste à charge en matière de contraception. Ce n’est certes pas toujours le cas, mais il peut y en avoir un, et ce sont les femmes qui en supportent le coût, ce qui est anormal.
Il est nécessaire, dans un premier temps, d’évaluer l’état réel de la situation pour, éventuellement, si nécessaire, remettre à plat les différents remboursements des contraceptifs.
Actuellement, nous manquons de visibilité et de données complètes sur le coût de la contraception et sur le reste à charge pour les femmes.

Je voudrais évoquer la question des rapports demandés au Gouvernement dans le cadre de l’examen de textes de loi.
Pourquoi y en a-t-il autant ? En réalité, c’est pour contourner le risque que des amendements soient jugés irrecevables au titre de l’article 40 ou de l’article 41 de la Constitution. Pour aborder le sujet que l’on souhaite en séance publique, la seule solution est alors de formuler une demande de rapport.
C’est ainsi que cela fonctionne, mais il est vrai que l’on ne peut absolument pas accepter tous les rapports : il y en a un nombre incalculable ! Alain Milon l’a dit, seuls deux rapports ont été rendus sur la vingtaine de rapports qui ont été demandés l’an dernier, dont aucun n’avait été accepté par le Sénat.
J’estime que le travail des parlementaires, au-delà de l’examen des textes, consiste aussi à fournir des rapports d’information, qui sont souvent de bien meilleure qualité que ceux que l’on peut attendre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national, notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; »
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1 ».

L’amendement n° 992, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Nous souhaitons la suppression de l’article 33 ter.
Tout d’abord, cet article est issu d’un amendement du Gouvernement introduit en séance à l’Assemblée nationale. Il n’a donc pas pu faire l’objet d’un examen approfondi en commission par nos collègues députés, et encore moins d’une analyse de son bien-fondé via l’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En fait, cet article a pour objet de réguler l’installation des centres de santé dans les zones prétendument surdotées. L’application des mesures de régulation aux centres de santé, au nom d’une meilleure répartition de l’offre de soins, sur le territoire n’est pas cohérente avec la situation que nous vivons aujourd’hui avec une cruelle acuité.
D’ailleurs, c’était l’objet du débat que nous avions juste avant la suspension de ce soir, lors duquel nous avions tous et toutes constaté le manque de médecins et le besoin de disposer de diverses solutions, dont celle des centres de santé où travaillent des médecins salariés.
Des maires issus de toutes les familles politiques se battent sur leur territoire pour faire en sorte que des centres de santé voient le jour.
Or, avec cet article, on est en train de dresser des obstacles et de limiter l’essor des centres de santé sur nos territoires ! Il y a là quelque chose qui ne va pas : on ne peut pas, d’un côté, constater que l’on manque de médecins, et, de l’autre, faire obstacle et essayer de réguler un dispositif qui pourrait contribuer à ce que des médecins salariés s’installent ensemble.
Avec cet article, ce qui est sûr, c’est que vous allez limiter le développement des centres de santé, à l’opposé de l’exercice coordonné prôné par le plan Ma santé 2022 et plébiscité par les jeunes médecins, qui ne souhaitent plus exercer isolément leur métier.
Pour nous, il faut encourager les aides à la création de centres de santé, qui sont également une excellente réponse en matière d’accès aux soins, car, je vous le rappelle, ces structures pratiquent le tiers payant – le secteur 1 –, ce qui répond aux besoins de la population, notamment des plus fragiles.
La Fédération nationale des centres de santé nous a alertés sur la dangerosité d’une telle disposition : je vous encourage, mes chers collègues, à voter la suppression de cet article.

Je comprends que l’introduction de ce dispositif par le Gouvernement, qui plus est par voie d’amendement, ne soit pas satisfaisante.
Toutefois, cet article me semble répondre à un souci de cohérence entre les règles applicables aux professionnels de santé dans un cadre libéral ou salarié.
L’article renvoie la définition des conditions et modalités à la négociation avec les fédérations de centres de santé dans le cadre de l’accord national. Je ne vois pas d’obstacle à ce que ces discussions puissent aborder cet enjeu. Même si, en l’état, le dispositif soulève des interrogations de la part de ces acteurs, il ne s’oppose pas à des discussions sur le sujet.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement.
Je tiens à rassurer Mme la sénatrice Cohen, qui souhaite supprimer un article ouvrant la possibilité aux partenaires conventionnels de négocier sur la régulation démographique au conventionnement des centres de santé, et lui rappeler la nécessité d’en discuter au préalable avec les représentants des centres de santé.
Madame la sénatrice, nous partageons votre souci de prendre en compte les spécificités de l’offre de soins de ces centres de santé, car, vous l’avez dit, celle-ci n’est pas en tout point comparable avec l’offre libérale, en particulier lorsque les centres de santé sont pluriprofessionnels.
C’est la raison pour laquelle cet article renvoie la déclinaison de la limitation de l’accès au conventionnement à la négociation conventionnelle, au lieu d’imposer des régulations existantes pour les professions libérales concernées.
Aujourd’hui, des mesures de régulation au conventionnement existent pour certaines professions de santé libérales.
Or les partenaires conventionnels ne sont pas habilités à négocier sur ce sujet pour les centres de santé, et aucune régulation en zone surdotée n’est donc appliquée pour les professions concernées exerçant en centre de santé, ce qui peut aboutir à des situations incohérentes.
À l’inverse, des mesures d’aide à l’installation en zone sous-dense sont proposées à la fois dans les conventions nationales monoprofessionnelles et dans l’accord national des centres de santé. Il apparaît donc justifié de permettre une négociation sur une mesure de régulation au conventionnement des centres de santé dans les zones surdotées.
Enfin, si, comme vous le mentionnez, la majorité des centres de santé s’installent dans des zones sous-denses, alors la majorité des soins de santé ne sera pas concernée par une éventuelle mesure de régulation et conservera le bénéfice des éventuelles dispositions d’aide à l’installation. Cet article n’aura donc pas l’effet que vous redoutez, madame la sénatrice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le secrétaire d’État, vos explications ne me rassurent que fort peu !
Compte tenu de ce que vous venez de dire, pourquoi vous précipiter ainsi et introduire un tel article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Depuis le temps que l’on examine ce texte, il y avait tout de même d’autres urgences et d’autres dispositifs à faire figurer dans ce projet de loi de financement. Or, tout à coup, on a l’impression qu’il y a urgence !
Je le répète, quelle que soit notre famille politique, nous savons tous et toutes pertinemment que, dans les communes, il existe une vraie bataille et un véritable engagement pour faire en sorte que les centres de santé s’installent sur les territoires. Je ne prétends pas que c’est la solution à tous les problèmes, mais, ce qui m’inquiète beaucoup, ce sont les propos de Mme la rapporteure, à savoir l’espèce de parallélisme avec l’exercice libéral, parallélisme auquel vous ne nous êtes d’ailleurs pas livré, monsieur le secrétaire d’État.
Pourquoi ce parallélisme avec le secteur libéral ? Les centres de santé ne bénéficient pas des mêmes dispositifs avantageux que le secteur libéral. Je n’en donnerai qu’un exemple, celui des contrats de praticien territorial médical de remplacement.
Pourquoi dresser des obstacles à un système qui peut apparaître comme une solution et qui peut contribuer à un meilleur maillage territorial de notre système de santé ? Il faut l’avouer, ce dispositif est complètement inopérant ; une fois de plus, vous allez susciter le malaise et accentuer le renoncement et les difficultés d’accès aux soins.

Je ne partage pas votre analyse, madame Cohen.
J’ai été alertée par des professionnels de santé, qui m’ont bien expliqué que ce qui est visé dans l’article, ce sont les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. Il ne faudrait pas que des professionnels de santé salariés viennent s’installer en surnombre dans certains centres de santé, là où l’offre de soins est déjà importante.
La version initiale de l’article est déjà meilleure, car elle permet d’éviter une surconcentration des professionnels. Aujourd’hui, je me suis entretenue avec le président d’un ordre : il m’a demandé de ne surtout pas toucher au dispositif introduit par le Gouvernement, car il est protecteur.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 615 est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 932 est présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié
par les mots :
l’installation des centres de santé
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires
L’amendement n° 615 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 932.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je constate un retour de l’appétence pour la régulation. Tout à l’heure, nous avions une discussion semblable au sujet de l’installation des médecins libéraux dans les zones surdenses, et il ne fallait surtout pas les contraindre ! Mais quand il s’agit des centres de santé, tout à coup, on aime la régulation…
Sourires sur les travées des groupes GEST et CRCE.

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite éviter de freiner le développement des centres de santé et le déploiement de l’ensemble de leurs missions, comme le regroupement de professionnels de santé.
Nous proposons également de prendre en compte dans les mesures de régulation la dimension de l’accès socio-économique aux soins, car les centres de santé, en secteur 1 essentiellement, pratiquent le tiers payant, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires qu’il ne s’agit pas de réguler ; on l’a bien compris.
Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients, covid-19 comme non-covid-19, alors qu’elles sont impliquées dans le déploiement des stratégies de tests et qu’elles le seront encore demain dans le cadre de la stratégie vaccinale contre la covid-19, ces mesures de régulation nous paraissent précipitées et inopportunes.

L’amendement n° 1056, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié
par les mots :
la création des centres de santé
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires, comme l’accès au tiers payant et tarifs de secteur un prenant en compte la vulnérabilité sociale des patients sur le territoire
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à ne pas freiner le développement de centres de santé, malgré l’adoption du conventionnement des centres.
Pour ce faire, nous demandons la prise en considération des caractéristiques des centres de santé dans les mesures de régulation.
Ces caractéristiques, qui constituent aussi des principes fondamentaux, sont les suivantes : la dimension de l’accès socio-économique aux soins, car les centres de santé sont bien souvent les dernières structures présentes sur un territoire après la disparition des professionnels libéraux, la pratique du tiers payant et l’absence de dépassements d’honoraires.

J’entends bien les inquiétudes des auteurs de ces amendements, qui relaient celles qui ont été exprimées par le représentant des centres de santé.
Toutefois, les modifications proposées tendent à s’éloigner de la cohérence avec les dispositions applicables aux professionnels libéraux, par exemple dans le cadre des maisons de santé, qui n’ont pas de régime d’exception quand ils proposent le tiers payant ou les tarifs responsables.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Mes chers collègues, il y a là confusion des genres ! Ou peut-être n’en est-ce pas une, en réalité…
Dans les maisons de santé, l’exercice est libéral ; dans les centres de santé, il est salarié. C’est totalement différent et, au nom d’une sorte de parallélisme, on est en train, en fait, de sanctionner les centres de santé et l’exercice salarié.
Je vous demande de réfléchir : vous allez freiner l’exercice au sein des centres de santé, ce qui m’étonne assez, car nombre d’entre vous ont été moteurs, dans les territoires, pour l’installation de tels centres. Je ne comprends pas comment, à l’heure où nous affrontons une pandémie montrant qu’il n’est vraiment pas nécessaire d’ajouter des freins aux difficultés que nous vivons déjà, vous choisissez d’en introduire dans ce PLFSS.

Il y a deux poids, deux mesures !
D’un côté, il ne faut pas imposer de contraintes aux professionnels de santé libéraux, chacun doit pouvoir s’installer où il veut. De l’autre, parce que l’on parle d’un établissement public avec des salariés – comme tout le monde l’a dit, les jeunes médecins sont de plus en plus nombreux à vouloir être salariés –, il faut contrôler et freiner, pour éviter tout abus.
Notons, mes chers collègues, que ces centres de santé sont souvent vivement souhaités par une partie des professionnels de santé libéraux. En moyenne banlieue – c’est là où mes enfants habitent –, il faut, si tout va bien, quatre à cinq jours pour obtenir le moindre rendez-vous chez le généraliste, par exemple pour un enfant qui a de la fièvre.

Pour une famille dans laquelle on se débrouille, qui a un bon niveau culturel et un peu de science médicale, cela passe : on peut relativiser, se dire qu’un peu de fièvre, ce n’est pas si grave, et attendre. Mais les familles extrêmement modestes, celles qui, culturellement, seront mal à l’aise pour évaluer la gravité de la maladie, elles se retrouvent sans rien !
Je connais donc un certain nombre de libéraux, dans ces territoires, qui se réjouissent qu’il y ait des centres de santé. Eux n’y arrivent plus, donc ils sont contents de voir que des structures plus adaptées existent.
Pas de dogmatisme ! Je l’ai dit pour les zones rurales : innovons avec des centres de santé et des maisons de santé. C’est la complémentarité et la diversité qui permettront de répondre à l’offre. C’est précisément cela, d’ailleurs, qui a fait la richesse du système français : une offre publique, une offre privée et la possibilité de choisir son médecin.
Or vous voulez mettre des verrous pour limiter la création de centres de santé… Je trouve cela irresponsable !
Ces centres sont une demande de certains élus. On passe son temps à dire qu’il faut laisser les élus libres ; laissons-les libres ! Et voilà que, par je ne sais quel dogmatisme idéologique, vous voulez vous opposer aux interventions publiques.

Pour ma part, donc, je plaide pour que l’on soutienne cet amendement de repli.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 1056.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 20 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 170, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux
La parole est à Mme la rapporteure.

Cet amendement vise à s’assurer de la cohérence entre mesures applicables aux professionnels libéraux et mesures applicables aux professionnels salariés, justement par souci d’équité.
Il ne s’agit donc pas, pour nous, de ne défavoriser les centres de santé ou de nous opposer à leur développement.
Le Gouvernement va s’évertuer à être cohérent avec lui-même et avec les positions défendues sur les amendements précédents, en exprimant un avis défavorable.
En effet, cet amendement tend à ce que les négociations conventionnelles sur un dispositif de régulation démographique au conventionnement des centres de santé se fondent sur les dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux.
Le présent article 33 ter vise à réguler l’offre de soins, notamment à éviter les situations incohérentes dans lesquelles un professionnel de santé libéral ne pourrait pas se conventionner dans une zone surdotée, alors qu’un centre de santé accueillant le même type de professionnels le pourrait.
L’objectif de cette disposition est bien, je le confirme, que la régulation retenue soit cohérente avec celle qui s’applique aux professionnels libéraux. D’ailleurs, dans la plupart des cas, la méthodologie pour réaliser le zonage prend bien en compte, à la fois, les professionnels des centres de santé et les professionnels libéraux.
On peut donc considérer que l’article en lui-même satisfait la demande portée par cet amendement. Pour autant, il est nécessaire que les spécificités des centres de santé puissent être prises en compte dans les négociations et, je le répète, il n’est pas souhaitable que ces négociations soient juridiquement subordonnées aux négociations de conventions monoprofessionnelles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 33 ter est adopté.

L’amendement n° 993, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le i du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Dans le cadre du PLFSS pour 2019, un amendement autorisant l’expérimentation d’exercer à titre libéral en centre de santé a été adopté. Cela a créé une grande confusion, car cette disposition entrait en contradiction avec l’un des principes fondant l’activité des centres de santé, à savoir le salariat, qui participe de l’efficacité et de la pertinence de ce mode d’exercice regroupé et coordonné.
Avant cette expérimentation, rien n’interdisait à des praticiens libéraux d’exercer dans les centres de santé, en étant salariés de ceux-ci. Comprenons-nous bien : dans ce cas, ils exercent en cabinet en tant que libéraux et, quand ils sont au centre de santé, ils exercent en tant que salariés ; il n’y a pas de mélange des genres au sein de la même structure.
De nombreux praticiens optent pour un tel cadre d’activité mixte libérale salariée. Celui-ci est satisfaisant pour le professionnel, comme pour le centre de santé.
Lors de l’examen de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dite « Buzyn », notre groupe avait fait adopter un amendement visant à supprimer ce dispositif expérimental. Cette proposition avait donc recueilli une majorité au sein de notre hémicycle, mais l’expérimentation avait été rétablie par la CMP.
Nous renouvelons, ici, notre demande, pour qu’il soit mis fin à cette expérimentation, brouillant les pistes et, surtout, ouvrant la voie à l’exercice libéral de la médecine à l’intérieur même des centres de santé, ce qui crée un mélange des genres incompatible avec la nature même de ces centres.
Il s’agit non pas de limiter ou d’interdire l’exercice libéral, mais de faire en sorte que celui-ci demeure à l’extérieur des centres de santé. À l’intérieur, l’exercice doit être salarié. Je le répète, cela n’empêche pas un praticien salarié en centre de santé d’exercer en libéral ailleurs, et cela convient à tout le monde.

Comme vous l’avez rappelé, ma chère collègue, la disposition qu’il est proposé de supprimer avait été introduite au Sénat par un amendement voté dans un précédent PLFSS.
Elle nous était apparue comme une souplesse bienvenue, apportée aux praticiens dans les différents modes d’exercice libéral ou salarié. Laissons les acteurs de terrain se saisir, ou non, de cette possibilité d’expérimentation.
L’avis de la commission est donc défavorable.

Mes chers collègues, je sais que l’on se lasse parfois des prises de parole quand il ne s’agit pas de ses propres amendements, mais, vraiment, le sujet est ici important.
Pour ma part, je voudrais savoir ce qui pousse à prévoir la possibilité d’un exercice libéral à l’intérieur d’un centre de santé. Quel plus cela apporte au centre ? Dites-moi, mes chers collègues, va-t-on prévoir des tarifications différentes ?
Aujourd’hui, dans un centre de santé, que les soins soient apportés par un médecin généraliste ou par un médecin spécialiste, il y a une stricte égalité : les mêmes tarifications sont appliquées à tous, et il y a le tiers payant. Le professionnel que vous autorisez à exercer, sous forme d’activité libérale, à l’intérieur du centre de santé, va-t-il adopter un tarif de secteur 1, 2 ou 3, alors que le centre est en secteur 1 ?
Je ne comprends pas, ou alors il s’agit vraiment d’un recul par rapport au maillage actuel de nos territoires en termes d’offre de soins !
Si encore on m’apportait une explication, qui permettrait de comprendre en quoi cela va améliorer l’offre de soins et permettre, éventuellement, de développer plus de centres de santé, je pourrais y réfléchir. Mais, en fait, c’est une position que l’on adopte, prétendument pour mettre tout le monde à niveau, qui va complètement ficher en l’air le système des centres de santé.
Veillons tout de même aux mesures que nous prenons, mes chers collègues ! Soyons conscients de leurs effets, aujourd’hui comme demain.

Vous devriez être choqués, mes chers collègues adeptes du libéralisme, par une telle rupture de concurrence !

En effet, voilà que des médecins vont pouvoir exercer en libéral dans des centres de santé, en ayant des frais fixes, notamment pour l’utilisation des locaux – la plupart du temps, on ne comptera pas toutes les heures où ils auront exercé, et ils ne seront pas facturés comme les autres.
Il y aura, d’un côté, des médecins libéraux, qui s’installent tout seuls et font vivre leur cabinet, et, de l’autre, des médecins libéraux qui s’installent, tels des bernard-l’hermite, dans une coquille qui est celle du centre de santé. Et l’on est incapable de formuler clairement les avantages que les uns auront par rapport aux autres.
Il est beaucoup plus sain de prévoir que, à l’intérieur du centre de santé, on est salarié, et que, en dehors, on peut être libéral.
D’ailleurs, en général, dès qu’il y a activité mixte, on demande l’étanchéité à Bercy. Là, rien n’a été demandé… Franchement, mes chers collègues, vous mettez le doigt dans un engrenage absurde !

Pour ma part, je ne vois pas quelle difficulté créerait le fait d’autoriser certains professionnels de santé à exercer à titre libéral dans un centre de santé.
C’est seulement une possibilité supplémentaire qui leur est offerte, et c’est bénéfique pour le praticien, s’il en a envie, et pour le centre de santé. En effet, si celui-ci ne trouve pas de médecin à salarier, pourquoi ne pas permettre au médecin libéral du coin d’aller y faire quelques vacations ?
Sur mon territoire, nous avons un centre de santé. Voilà un an qu’une annonce est posée, et il nous est impossible de trouver un médecin salarié. Si un médecin libéral accepte de venir faire deux après-midi, je ne vois pas trop où est la difficulté.
Nous avons aussi, au sein d’un hôpital privé à but non lucratif, qui fait office d’hôpital public sur le territoire, des chirurgiens venant exercer à titre libéral ; ce sont des Belges, en l’occurrence. Cela ne casse pas le maillage territorial. Cela ne met pas à sac le centre de santé.
Je vois donc, dans cette mesure, une simple chance de plus, pour un exercice différent de l’activité.

Je suis assez d’accord pour dire qu’il ne faut pas de mélange des genres.
Si un centre de santé fonctionne avec une médecine salariée, il doit rester centre de santé fonctionnant avec une médecine salariée. Mais, en sens inverse, la médecine libérale doit rester libérale, et il ne faut pas que l’on vienne y apporter des coercitions. Si ces deux logiques sont respectées, alors je n’ai plus rien à dire.
Je voterai l’amendement de Mme Laurence Cohen, parce qu’il me semble intéressant. Arrêtons le mélange des genres ! Respectons la médecine libérale dans sa liberté d’installation, et respectons les centres de santé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et de certains niveaux minimaux de prise en charge mentionnés aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.

Où en sommes-nous actuellement en ce qui concerne le déploiement du tiers payant ?
Dans le cadre du PLFSS pour 2018, nous avions eu un long échange avec Agnès Buzyn, à propos de l’article qui revenait sur l’objectif de généralisation fixé dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
La ministre avait développé une argumentation centrée sur deux points.
D’une part, elle avait insisté sur la nécessité de bien identifier les publics en difficulté financière, qui ne peuvent accéder au tiers payant.
D’autre part, elle avait explicité la méthode qu’elle allait privilégier : rendre le tiers payant simple d’accès par la mise en place d’un flux unique, qui permettrait de concilier l’objectif de justice sociale et celui consistant à rendre du temps médical aux médecins.
Nous avions plutôt souscrit au constat. Le tiers payant n’est pas obligatoire, par exemple, pour les pharmaciens ; pourtant, la procédure est si simple qu’elle s’est naturellement généralisée.
La ministre nous avait présenté son calendrier de travail à venir, articulé autour de l’identification des publics prioritaires autres que ceux qui bénéficient déjà du tiers payant – par exemple, les étudiants – et du travail à engager avec les complémentaires de santé pour lever les difficultés techniques. On sait effectivement que ces complémentaires constituent le principal obstacle à la facilitation de la procédure.
Il existe environ deux cent cinquante complémentaires de santé, qui sont différentes et dont les niveaux de contrat sont hétérogènes. Le niveau de remboursement peut évoluer d’une année sur l’autre, en fonction du statut de la personne, si elle change d’entreprise, etc. Tout cela est relativement complexe.
Un rapport précisant le calendrier de cette mise en œuvre opérationnelle devait être remis au Parlement avant le 31 mars 2018. J’espère ne pas me tromper, mais il me semble que nous ne l’avons pas reçu…
Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le secrétaire d’État, où nous en sommes de ce travail, censé répondre à une attente forte et légitime des Français ?

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 231 rectifié ter, présenté par Mme Deseyne, MM. Cambon, Boré, Le Rudulier et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. B. Fournier, Houpert et Grosperrin, Mmes Dumas et Deromedi, MM. Brisson, Cardoux et Duplomb, Mme Gruny, MM. Piednoir, Bascher et Meurant, Mme Thomas, MM. Saury, Mandelli et Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse, Gremillet et Regnard et Mme Noël, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant intégral pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale, l’article 33 quater vise à améliorer la réforme du reste à charge zéro, en généralisant le bénéfice du tiers payant intégral pour les prestations de soins visuels, auditifs et dentaires dits « 100 % santé ».
Si cette mesure va dans le bon sens, force est de constater qu’elle peut être améliorée pour pousser encore plus loin la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières. En effet, une enquête conduite par Ipsos en octobre 2020 montre que 20 % à 30 % des porteurs de lunettes ne bénéficient pas d’avance de frais.
Cet amendement tend donc à étendre le champ de l’article 33 quater à l’ensemble des frais couverts par un contrat responsable.

L’amendement n° 68 rectifié ter, présenté par Mme Deseyne, M. Cambon, Mme Lassarade, MM. Boré, Le Rudulier et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. B. Fournier, Houpert et Grosperrin, Mmes Dumas et Deromedi, MM. Brisson, Cardoux et Duplomb, Mme Gruny, MM. Piednoir, Bascher et Meurant, Mme Thomas, M. Bonhomme, Mme Chauvin, MM. Mandelli et Savary, Mme Garriaud-Maylam, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gremillet et Regnard et Mme Noël, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
garanties,
insérer les mots :
y compris lorsqu’elles sont associées à un produit ou prestation appartenant à une autre classe que les classes à prise en charge renforcée,
La parole est à Mme Chantal Deseyne.

J’ai défendu cet amendement en même temps que le précédent, madame la présidente.

L’amendement n° 650 rectifié, présenté par Mmes Doineau et Guidez, M. Henno, Mmes Sollogoub et Jacquemet, M. Duffourg et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et de certains niveaux minimaux de prise en charge mentionnés aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du présent article
par les mots :
et à hauteur des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l’article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 ainsi qu’à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l’article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Le présent amendement est un amendement de précision.
L’article 33 quater rend effectif le tiers payant intégral sur les équipements et soins du panier dit « 100 % santé », afin de supprimer l’avance de frais et, ainsi, de lever tout obstacle financier à l’accès à ce panier. Il oblige les organismes de complémentaire de santé proposant des contrats responsables, à compter du 1er janvier 2022, à mettre à la disposition des professionnels de santé des solutions techniques de réalisation du tiers payant qui soient fiables.
Cet amendement tend à clarifier le périmètre des soins sur lequel cette obligation portera, en visant expressément les paniers de soins « 100 % santé » optique, dentaire et d’audiologie.

S’agissant de l’amendement n° 231 rectifié ter, le tiers payant est déjà obligatoirement garanti pour toutes ces prestations dans le cadre des contrats responsables, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.
L’avis de la commission sera donc défavorable.
L’amendement n° 68 rectifié ter tend à inclure, dans le tiers payant obligatoire, les équipements, notamment optiques, composés pour partie de produits dont le prix dépasse les tarifs plafonds du panier « 100 % santé ».
La rédaction de l’article 33 quater n’exclut pas le tiers payant pour ces équipements. Toutefois, préciser cette obligation pourrait apporter un plus aux assurés dont la complémentaire rembourse les équipements concernés.
La commission souhaite donc s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
Enfin, j’exprime un avis favorable sur l’amendement de clarification n° 650 rectifié.
Précisons tout de même, monsieur le secrétaire d’État, que cette mise en œuvre du tiers payant pour le panier « 100 % santé » s’avère chaotique et qu’elle peut mettre en difficulté certains professionnels de santé, qui, lorsqu’ils l’acceptent, peinent parfois à être remboursés. Il convient donc de ne pas brûler les étapes : il faut évaluer la mise en place du tiers payant sur ce panier « 100 % santé », négocié avec les différentes parties prenantes, avant d’aller plus loin.
Comme la commission, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° 650 rectifié, mais il sera défavorable aux amendements n° 231 rectifié ter et 68 rectifié ter.
Le motif en est, justement, qu’il ne faut pas brûler les étapes, comme semblent le proposer les auteurs de ces amendements.
Nous sommes évidemment tout à fait attentifs au déploiement du tiers payant intégral, qui facilite l’accès aux soins en supprimant toute avance de frais.
C’est pourquoi j’ai soutenu l’amendement qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et dont l’objet était de mettre en place une obligation de tiers payant sur les paniers de soins « 100 % santé », qu’il s’agisse de lunettes, d’aides auditives ou de prothèses dentaires, et ce à compter de l’année 2022.
Sur les produits « 100 % santé », la prise en charge est intégralement garantie pour tous les assurés couverts par un contrat responsable ou par la complémentaire de santé solidaire. Le professionnel de santé connaît donc, dans tous les cas, la part prise en charge par la complémentaire de santé, ce qui ne sera pas le cas avec la proposition de Mme la sénatrice Deseyne.
En ce qui concerne les autres produits remboursables, les contrats responsables n’imposent que la couverture du ticket modérateur.
Assurer le tiers payant intégral sur un panier de soins autre que le panier « 100 % santé » est donc techniquement plus complexe. Il nous semble prématuré de vouloir l’imposer dès cette année ; nous jugeons préférable, comme nous y a invités Mme la rapporteure, de traiter en priorité, dans un premier temps, la mise en place du tiers payant intégral sur le panier « 100 % santé ».
Telles sont les raisons des avis défavorables du Gouvernement sur les amendements n° 231 rectifié ter et 68 rectifié ter.

Les amendements n° 231 rectifié ter et 68 rectifié ter sont retirés.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
J’ai juste omis de répondre à M. Bernard Jomier, qui se demandait si le Gouvernement avait bien remis le rapport qu’il avait promis de rendre pour le mois de mars 2018.
C’est le cas : il s’agit d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, qui a été transmis au Parlement en avril 2018.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 907 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Les dispositions du I s’appliquent dès lors que l’assuré bénéficie en amont du mécanisme de tiers payant par son professionnel de santé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Artano.

L’article 33 quater vise à rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2022, le bénéfice du tiers payant dans les contrats responsables des complémentaires santé pour l’ensemble des prothèses optiques, dentaires et auditives. C’est évidemment une bonne chose pour les assurés, en particulier dans le contexte social difficile que nous connaissons.
Par cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Jean-Yves Roux, nous souhaitons que le professionnel de santé intervenant en amont propose le tiers payant. Il s’agit, à terme, de relancer la perspective d’un tiers payant généralisable, abandonnée en 2018.
Les difficultés sociales que rencontrent les assurés et les retards de diagnostic engendrés par la première vague de l’épidémie en mars 2020 exigent que l’on facilite les consultations pour tous.

Cette mise en application conditionnelle du tiers payant ne semble pas opérante.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 907 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 33 quater, modifié.
L ’ article 33 quater est adopté.

L’amendement n° 429 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Henno et Détraigne, Mmes Billon et Férat, MM. Levi, Cazabonne et Duffourg, Mmes Sollogoub, Gatel, Loisier et de La Provôté, MM. Delcros, Louault et Kern, Mmes Saint-Pé et Guidez, M. P. Martin, Mme C. Fournier, M. Cadic, Mme Jacquemet et MM. Canevet, H. Leroy, Capo-Canellas, Le Nay, Hingray, Poadja, Longeot et Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport d’évaluation de la prise en charge des pathologies du lymphœdème, les différents soins et médicalisations associés ainsi que l’accessibilité aux traitements recommandés par la Haute Autorité de santé, afin de définir un panier de soins garantissant une meilleure prise en charge par l’assurance maladie.
La parole est à M. Olivier Henno.

Cet amendement, présenté sur l’initiative de Mme Valérie Létard, est une demande de rapport – formulée, bien évidemment, sans illusion –, mais aussi un moyen, comme Mme la présidente de la commission l’indiquait, d’attirer l’attention sur le problème des lymphœdèmes.
On en compte de deux types : les lymphœdèmes secondaires, après traitement du cancer, et les lymphœdèmes primaires, liés à une anomalie.
Il s’agit d’une pathologie chronique, évolutive et invalidante. Or la prise en charge par l’assurance maladie est partielle, quels que soient les types de lymphœdèmes, et le reste à charge important pour le patient. Il peut représenter 10 % des revenus du quintile le plus pauvre de la population et 3, 5 % pour les patients ayant les revenus les plus élevés.
Actuellement, la prise en charge du lymphœdème comme maladie chronique ne répond donc pas aux enjeux de médicalisation de cette maladie et d’accessibilité aux traitements, et contrevient de fait à l’amélioration de la vie des patients, contraints pour certains de renoncer aux soins.
Nous lançons donc un appel, dans la lignée des recommandations de la Haute Autorité de santé, pour que cette pathologie, qui doit être mieux définie, soit prise en charge.

Vous l’avez dit, monsieur Henno, c’est une bonne occasion d’évoquer cette pathologie chronique et invalidante. Je vous remercie donc d’avoir défendu cet amendement.
Néanmoins, s’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.
Monsieur le sénateur, je vous remercie, ainsi que Mme Létard, d’évoquer les lymphœdèmes. Je vais vous donner quelques éléments de réponse sur le fond puisque, comme nous l’avons bien compris, cette demande de rapport n’aura pas de suite…
Il existe plusieurs types de lymphœdèmes et leur prise en charge implique une association de traitements : physique, pharmacologique ou chirurgical. L’approche doit donc être individualisée en fonction des besoins particuliers des patients.
Pour les formes primaires, qui sont plus rares, il existe un protocole national de diagnostic et de soins, qui a été élaboré par la Haute Autorité de santé, et une étude financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui a été publiée en avril 2019.
Plusieurs travaux ont été lancés qui devraient permettre d’apporter une réponse aux personnes atteintes de ces pathologies.
La Haute Autorité de santé a été saisie de la question des dispositifs médicaux de contention, qui peuvent, dans certains cas, entraîner un reste à charge pour les patients. Elle a rendu son évaluation, et l’objectif est à présent de travailler à une révision de la nomenclature sur la base de ses recommandations.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, sachez que les CHU de Montpellier et de Toulouse ont déposé auprès de l’Agence régionale de santé d’Occitanie un projet sur ce thème, au titre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, que vous connaissez bien. Ce projet vise à créer un parcours de soins ville-hôpital, l’ambition étant d’améliorer la qualité des soins tout en contrôlant le reste à charge pour les patients. Ce projet est en cours d’instruction par l’ARS.
Tels sont les éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Cela étant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Même s’il s’agit là d’un sujet important, nous ne pouvons être favorables à une demande de rapport.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie des éléments de réponse que vous venez de porter à notre connaissance.
Le groupe d’études sur le cancer avait reçu au début de l’année 2020 le docteur Vignes, lymphologue à la Fondation Cognacq-Jay, qui nous avait alertés sur la question du reste à charge pour les patients atteints de lymphœdèmes. Il visait non pas tant les traitements en tant que tels que les éléments annexes, par exemple les bas de contention, entre autres dispositifs médicaux, qui peuvent sembler secondaires, mais dont le coût est élevé. De ce fait, certains patients n’en portent pas ou les gardent très longtemps. C’est un réel souci.
En juillet dernier, j’avais interrogé le Gouvernement à ce sujet lors d’une séance de questions orales sans débat du mardi ; une réponse identique à celle que vous venez de nous donner m’avait alors été apportée.
Enfin, je rappelle qu’un article relatif au parcours de soins après un cancer a été adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. J’aimerais savoir où en sont les décrets d’application, sachant qu’ils n’avaient toujours pas été publiés en juillet dernier. Le suivi des personnes ayant été traitées pour un cancer est un sujet important – je pense en particulier aux soins de support.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :
1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ;
2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;
3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.

L’amendement n° 171, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
ans
insérer les mots :
à compter de la publication de la présente loi
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport s’attache à mesurer l’évolution de la couverture des obligations légales et réglementaires à la charge des services de santé au travail concernés, l’évolution dans le ressort des services concernés du suivi des salariés les plus à risque et des saisonniers agricoles, ainsi que l’incidence de l’expérimentation sur l’organisation et le fonctionnement des services concernés. Il comporte une analyse comparative avec les services de santé au travail en agriculture non parties à l’expérimentation.
La parole est à Mme le rapporteur.

L’article 34 prévoit une expérimentation permettant le transfert d’activités aux infirmiers en santé au travail, dans le cadre de protocoles de coopération, dans des services de sécurité et de santé au travail relevant de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.
Cet amendement vise à préciser les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation au regard des objectifs de l’expérimentation, afin d’en tirer des conclusions pertinentes en vue d’une éventuelle généralisation.
Cet amendement nous paraissant satisfait, nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’article 34 renvoie à un décret en Conseil d’État la mise en œuvre de l’expérimentation, notamment ses modalités d’évaluation. Il a ainsi été considéré que le choix et le suivi des indicateurs mis en place relèveraient du domaine réglementaire.
Madame la rapporteure, je tiens toutefois à vous rassurer : le Gouvernement entend bien se donner les moyens de suivre les effets de cette expérimentation, tant sur la couverture des obligations à la charge de ces services que sur le suivi des salariés les plus à risques et les saisonniers agricoles, ou encore sur le fonctionnement des services concernés. Ces indicateurs figurent d’ailleurs dans l’étude d’impact de cet article, sauf erreur, et seront mentionnés dans le décret d’application.
Enfin, une analyse comparative avec les autres services de santé au travail en agriculture sera également effectuée pour les besoins de cette expérimentation.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je le maintiens, madame la présidente, afin de nous laisser le temps de faire les vérifications nécessaires. On ne sait jamais…
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 34 est adopté.
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-4, les mots : «, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 752-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. –
Adopté.
I. – La section 2 du chapitre II du livre VII du titre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172 -1 -1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021. –
Adopté.
I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. » ;
3° À l’article L. 621-3, les mots : « aux articles L. 621-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-1 et au premier alinéa de l’article » ;
4° À l’article L. 622-1, les mots : « aux articles L. 640-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
5° L’article L. 622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622 -2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
« 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;
« 2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.
« La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.
« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ;
6° L’article L. 641-2 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ;
b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021.

L’amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Bizet et Grand, Mmes Gruny, Dumas et Puissat, MM. Panunzi, Cambon, Cardoux, Chatillon, Cuypers et Rapin, Mme Jacques, M. Courtial, Mme Thomas, M. Charon, Mme F. Gerbaud, M. Bouchet, Mme Deromedi, MM. Calvet, Lefèvre et Belin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Saury et Le Gleut, Mme Demas, M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Babary, E. Blanc et Gremillet, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Pointereau, Mme Ventalon et M. Houpert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, dernière phrase
Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de chacune des sections professionnelles
II. – Alinéa 13
1° Au début
Ajouter la mention :
I. –
2° Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de chacune des sections professionnelles
III. – Alinéa 16
Après le mot :
décret
insérer les mots :
sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
IV. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres paramètres de calcul de ces indemnités journalières sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
V. – Alinéa 17, au début
Ajouter la mention :
II. –
VI. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Chaque section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et les projections financières sur cinq ans.
VII. – Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de la section compétente
VIII. – Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Pascale Gruny.

En 2018, le Gouvernement a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 622-2 permettant aux professions libérales qui le souhaitent de créer, section par section, un régime d’indemnités journalières pendant les 90 premiers jours d’incapacité de travail – l’assurance invalidité pouvant prendre le relais au-delà. Ce régime est bien adapté aux professions libérales, dont les besoins en la matière sont très variables.
Toutefois, aucun dispositif d’indemnités journalières n’a été mis en place par les professions libérales sur ce fondement : seul le conseil d’administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) s’est prononcé en faveur de la mise en place de ce régime en juin 2019, mais sa démarche n’a pu aboutir.
Cette absence d’un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail a posé problème pendant la crise sanitaire. Selon l’objet de l’amendement n° 2699 déposé par le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, « l’État a décidé d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle des indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels libéraux, financées par l’assurance maladie ».
Cette affirmation est parfaitement inexacte : seules les professions de santé ont bénéficié, à titre dérogatoire, d’indemnités journalières si elles ont été amenées à interrompre leur activité professionnelle en raison de la covid-19. Toutes les autres professions libérales ont bénéficié soit d’aménagements du règlement des cotisations sociales, soit d’aides directes financées par les sections professionnelles sur leurs fonds propres au titre de l’action sociale.
Si la création d’un régime obligatoire peut se justifier, la création d’un régime unique, uniforme, n’est pas conforme à la tradition sociale des professions libérales, très attachées à leur autonomie.
Le présent amendement vise donc à conserver la création obligatoire d’un régime d’indemnités journalières dans les professions libérales au 1er juillet 2021, tout en préservant l’autonomie de gestion, de prestations et de cotisations des sections professionnelles.
Ainsi, il tend à confier au conseil d’administration de chacune des sections professionnelles dans le cadre de leur régime invalidité-décès, sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et du ministère de la santé par voie de décret, le soin de fixer le taux et le plafond de la cotisation, ainsi que le montant des prestations.

Cet amendement vise à transférer au niveau des sections professionnelles le pilotage que le texte prévoit de confier à la CNAVPL.
Je comprends cette logique qui tend à faire correspondre le régime créé aux réalités de chacune des professions. Je suis consciente également des craintes de voir là un nouveau régime venir alourdir les charges pour des professionnels libéraux qui ne le réclamaient pas tous et qui avaient des besoins inégaux. Rappelons que, depuis deux ans, ils avaient la possibilité de mettre ces indemnités en place, mais que toutes les caisses ne l’ont pas fait.
Cependant, l’approche retenue consistant à confier ce pilotage à la CNAVPL me semble plus opportune. Renvoyer ce pilotage à chacune des sections paraît pertinent à première vue, mais risquerait, me semble-t-il, de freiner considérablement la mise en œuvre de ce dispositif.
La CNAVPL réunit bien la diversité des professions libérales et des différentes sections, tandis que son conseil d’administration est bien chargé de proposer des adaptations.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Comme Mme la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable.
La mise en place d’un tel dispositif par section, ainsi que vous le proposez dans cet amendement, ferait peser un risque sur les sections comptant de faibles effectifs et serait plus pénalisante pour les professions aux revenus les plus faibles, par exemple les infirmières.
En outre, madame la sénatrice, contrairement à ce que vous indiquez, des indemnités journalières exceptionnelles ont bien été versées au cours du premier confinement aux professionnels libéraux qui ne pouvaient pas télétravailler et qui assuraient la garde d’un enfant ou qui étaient considérés comme personnes vulnérables. Au total, 176 millions d’euros d’indemnités journalières ont été versés aux professionnels de santé et 72 millions d’euros aux autres professionnels libéraux.
Je confirme donc ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi.

En dépit des deux avis défavorables qu’il a recueillis, cet amendement me paraît intéressant en ce que ses auteurs expriment, à travers lui, une volonté d’unification de l’ensemble des régimes d’indemnités journalières des professions libérales regroupées au sein de la CNAVPL – au nombre de treize, quand même. Ce n’est pas incohérent !
Que certaines professions ne soient pas d’accord et demandent que leur régime d’indemnités journalières continue d’être géré par leur régime complémentaire – les indemnités handicap et décès –, on peut le comprendre. Sauf que confier cette gestion à la CNAVPL, la caisse de base regroupant l’ensemble de ces professions, présente un intérêt : cela permettrait une mutualisation de ces régimes. Je partage la position de la rapporteure, selon qui cette mutualisation ne serait pas inintéressante.
Néanmoins, il ne faudra pas oublier de signaler aux intéressés qu’ils devront s’acquitter d’un surcroît de cotisations de 0, 3 %, même si ce n’est pas énorme. Selon l’étude d’impact, que je cite de mémoire, cela représente au minimum 51 euros de cotisations annuelles pour des indemnités journalières à hauteur de 22 euros pendant 90 jours.
Ce n’est pas incohérent dans la mesure où ces professionnels font appel à des assurances privées.
En revanche, il faudra être attentif aux délais de mise en œuvre de cette mesure. Elle ne pourra l’être d’ici à 2021, monsieur le secrétaire d’État, compte tenu du fait que la plupart des professionnels concernés devront résilier leur assurance, sauf à les conserver à titre complémentaire.
Le problème, c’est qu’il n’y a pas eu de concertation : l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) était favorable au principe de cette caisse supplémentaire – c’est bien un nouveau régime qui est créé – ; en revanche, la concertation a été insuffisante avec les professions, certaines comme les experts-comptables, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes nous ayant fait part de leur désaccord.
Aussi, je vous invite à vous rapprocher de ces professions de manière à améliorer ce dispositif.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Bonne, Bascher et Bocquet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme V. Boyer, MM. Brisson et Courtial, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Dumas et Deromedi, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Micouleau, M. Moga, Mmes Noël et Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Sautarel, Segouin et Vogel, Mme Di Folco et MM. Charon et H. Leroy.
L’amendement n° 286 rectifié quater est présenté par MM. Milon, Grand, Burgoa et Calvet, Mme Berthet, MM. Dallier et de Legge, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mandelli, Piednoir, Savary et Houpert, Mme Delmont-Koropoulis et M. Regnard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, cette limite étant égale au plafond de l’assiette de la cotisation supplémentaire prévu au second alinéa de l’article L. 621-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.

Cet amendement s’inscrit lui aussi dans une logique de simplification et d’unification. Il tend en effet à fixer le même plafond de revenu applicable au calcul de la cotisation et de l’indemnité journalière.

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié quater.

Ces amendements visent à faire correspondre la limite retenue pour les revenus servant au calcul des prestations avec le plafond retenu pour l’assiette des cotisations.
Le problème, c’est que les régimes de sécurité sociale n’ont pas toujours une identité entre l’assiette des cotisations et le plafond retenu pour les prestations. C’est le cas, par exemple, du régime d’indemnités journalières des indépendants rattachés au régime général, qui cotisent sur deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) pour des prestations calculées sur un PASS.
C’est aussi l’hypothèse retenue par le Gouvernement pour ce nouveau régime, avec une cotisation sur cinq PASS et des prestations sur trois PASS.
Cette dissociation permet de répondre plus facilement, me semble-t-il, à l’impératif d’équilibre financier en assurant une redistribution.
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 56 rectifié et 286 rectifié quater.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 172, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au début du premier alinéa, la mention :
« I. - » est supprimée ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Cet amendement tend à supprimer une coquille figurant dans le code depuis quinze ans : il était temps de la corriger !
Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 34 quater est adopté.
Après l’article L. 4151-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151 -4 -1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2021, par dérogation à l’article L. 2212-2, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »

L’amendement n° 173, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.

L’article 34 quinquies prévoit d’autoriser, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentales.
Il convient de rappeler que, depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG par voie médicamenteuse. En revanche, les IVG instrumentales ne peuvent être réalisées que par des médecins.
La pratique d’IVG instrumentales par les sages-femmes ne fait pas l’unanimité. Sur la forme, la mesure proposée, qui a trait aux compétences d’une profession de santé, est une disposition non financière, qui ne relève donc pas du champ de la loi de financement de la sécurité sociale.
Pour ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article.
Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 34, qui nous semble important.
Vous le savez, les sages-femmes s’investissent pleinement dans les questions de santé sexuelle et reproductive, dans une approche globale. À ce titre, elles peuvent, depuis 2016, réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Ouvrir une pleine compétence en orthogénie à ces professionnelles de santé, qui pratiquent déjà des gestes endo-utérins, comme la pose de stérilets, la délivrance artificielle ou la révision utérine, pourrait véritablement renforcer l’accès des femmes à l’IVG en tous points du territoire et leur garantir de pouvoir choisir plus librement entre l’IVG médicamenteuse et l’IVG instrumentale, objectif que nous partageons tous, j’en suis convaincu.
Cet article définit les conditions nécessaires afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins dans le cadre de cette expérimentation, notamment en termes de formation et d’expérience professionnelle attendue des sages-femmes. La qualité et la sécurité des soins sont évidemment des exigences avec lesquelles nous ne transigerons jamais.
Bien sûr, l’expérimentation sera, par nature et par définition, évaluée. Elle permettra de décider de manière éclairée si, et dans quelles conditions, nous devons généraliser cette nouvelle compétence.
Enfin, pour répondre au dernier argument de Mme la rapporteure, j’indique qu’une modification du recours à l’IVG instrumentale est à attendre en regard. Au vu des forfaits IVG, qui varient selon les méthodes, la mesure proposée pourrait avoir un impact financier sur les dépenses d’assurance maladie. C’est d’ailleurs ce qui justifie la présence de cet article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je partage les propos de M. le secrétaire d’État. Notre groupe a d’ailleurs déposé à plusieurs reprises des amendements en faveur d’une telle expérimentation. Nous sommes donc ravis de la voir figurer dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale.
Pour rappel, ces professionnels de santé sont habilités à pratiquer des IVG médicamenteuses depuis 2016. Le code de la santé publique garantit aux femmes la liberté de choisir entre ces deux méthodes, mais nous savons bien que, dans les faits, les IVG instrumentales représentent une part minoritaire des IVG, faute de praticiens en nombre suffisant.
J’avoue ne pas comprendre les réticences de certains ou de certaines, qui pensent sans doute que le fait que les sages-femmes ne soient pas des médecins pourrait mettre en danger la vie des femmes. Mais, mes chers collègues, puisque l’IVG médicamenteuse ou instrumentale n’est pas un acte relevant de la pathologie gynécologique, elle est, de fait, de la compétence des sages-femmes !
Cette extension des tâches, qui correspond aux objectifs du plan Ma santé 2022, est d’ailleurs très largement soutenue par nombre de médecins, qui reconnaissent les compétences des sages-femmes.
Elle permettrait par ailleurs de garantir la liberté de choix de la méthode et rendrait plus accessible le recours à l’IVG partout sur le territoire, alors que plus de 130 centres IVG ont fermé en dix ans et que l’accès à celui-ci est rendu encore plus difficile en ces temps de crise sanitaire.
Au-delà de cette question, je regrette que nos deux amendements sur l’IVG, l’un visant à allonger de deux semaines le délai légal, l’autre visant à supprimer la double clause de conscience, aient été déclarés irrecevables, pour des motifs très contestables.
Nous sommes donc tout à fait hostiles à cet amendement de suppression de l’article 34 quinquies. Son adoption serait une erreur.

Je ne comprends pas bien le sens de cet amendement de suppression, indépendamment des raisons de forme qui, à l’identique d’un amendement précédent, ont été invoquées par la rapporteure.
Sur le fond – car c’est bien ce qui est ici en question –, si cet amendement était adopté, l’accès à l’IVG s’en trouverait compliqué. Les médecins qui pratiquaient des IVG partant en grand nombre à la retraite, un certain nombre de femmes n’auront plus le choix entre la méthode médicamenteuse et la méthode instrumentale, contrairement à ce que prévoit le code de la santé publique.
Comme l’a rappelé Corinne Imbert, les sages-femmes pratiquent des IVG médicamenteuses depuis la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé. L’IVG instrumentale est-elle d’une technicité telle qu’elle devrait être réservée à des spécialistes en actes quasi chirurgicaux ? Non ! Les médecins généralistes pratiquent des IVG instrumentales ; la technique en est simple et la formation extrêmement rapide. Une fois que vous savez pratiquer un frottis, l’étape suivante consiste à introduire dans l’utérus le matériel d’aspiration, cette opération n’étant pas compliquée. Cette formation est parfaitement accessible aux sages-femmes, qui, je le rappelle, exercent une profession médicale, prescrivent et accomplissent des actes techniques.
Rien ne justifie, sur le plan technique, ce refus qui est opposé aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales, alors qu’elles sont parfaitement compétentes pour ce faire dès lors qu’elles auront suivi une courte formation complémentaire. De surcroît, cela compromet le droit des femmes à choisir leur méthode d’IVG.
Nous aurions accepté de débattre plus précisément des modalités de cette expérimentation, mais nous ne comprenons pas, je le répète, que l’on veuille supprimer l’article. Nous voterons donc contre cet amendement.

Permettez-moi de revenir sur ce que vient de dire M. Jomier.
C’est vrai, l’IVG instrumentale consiste, pour commencer, à introduire une canule dans l’utérus aux fins d’aspiration. Le problème, c’est que l’utérus n’est pas vide. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez comparé l’IVG instrumentale à la pose d’un stérilet ; or la pose d’un stérilet se pratique dans un utérus vide. Lors d’une IVG, celui-ci est « occupé » – pour ne pas dire autre chose.
En outre, l’introduction d’une canule dans un col d’utérus « occupé » nécessite au préalable que celui-ci soit dilaté, cette opération n’étant pas nécessairement très aisée à réaliser. §Ensuite, il faut vérifier l’absence de tout saignement après l’aspiration.
Je suis d’accord pour considérer que les sages-femmes, dès lors qu’elles auront suivi une formation à cette fin, pourraient très bien pratiquer des IVG instrumentales. En revanche, monsieur le secrétaire d’État, je ne veux surtout pas qu’il soit établi une comparaison entre une IVG instrumentale et la pose d’un stérilet. L’une et l’autre n’ont rien en commun.
Je veux rassurer M. Milon, qui pourra relire mes propos : je n’ai pas comparé l’une et l’autre, pour les raisons que vous avez d’ailleurs très bien évoquées ; j’ai simplement dit que les sages-femmes pratiquaient d’ores et déjà un certain nombre d’actes.
L ’ amendement est adopté.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.
Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, je profite de l’examen de cet article pour alerter M. le secrétaire d’État sur le remboursement de frais médicaux liés au diabète.
J’ai récemment fait la connaissance d’un jeune homme que certains d’entre vous ont déjà eu, eux aussi, l’occasion de rencontrer : Hakaroa Vallé. Âgé de 15 ans, il est diabétique de type 1 et mène un combat formidable contre les discriminations que subissent les personnes diabétiques dans notre pays, notamment dans l’emploi, principalement dans la fonction publique.
J’évoquerai la problématique du remboursement des capteurs de glycémie, qui sont au nombre de deux en France.
Avec 80 % d’utilisateurs, le système Freestyle est le plus utilisé en France. Il l’est même désormais par les cyclistes professionnels pour le suivi de leur glycémie dans l’effort. Or ce capteur flash, sans piqûre, n’est aujourd’hui pas remboursé pour les enfants de moins de 4 ans, âge auquel il n’est pas évident de verbaliser les symptômes d’une hypoglycémie. Pour les familles, le coût de ce dispositif peut atteindre 1 750 euros par an.
Le second type de capteur, le Dexcom, est, quant à lui, remboursé dès lors que le taux d’hémoglobine glyquée est supérieur à 8 %, taux à partir duquel on se situe dans la zone de croissance exponentielle des risques de complications.
En deçà de 7 %, il est impossible d’être remboursé alors même qu’un tel remboursement éviterait des complications qui coûtent beaucoup plus cher à la sécurité sociale.
Je tenais vraiment à aborder cette question, car cette problématique touche des milliers d’enfants et de familles en France.
Nous devons tendre vers un remboursement sans condition pour les personnes insulino-dépendantes et insulino-requérantes – 500 000 Français sont concernés.
Aborder cette question lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, même si celle-ci n’est pas directement liée à cet article, c’est aussi rendre hommage à ce jeune homme de 15 ans, à sa détermination et à son combat pour améliorer notre système. Il est source d’inspiration pour nous tous et un formidable porte-parole pour les personnes diabétiques.
Mme Nadia Sollogoub applaudit.

L’amendement n° 174, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.

Avant de présenter cet amendement, je tiens à dire que je souscris aux propos de notre collègue. Le non-remboursement de ce dispositif pour les enfants de moins de 4 ans soulève de nombreux problèmes pour eux et pour leurs familles.
J’en viens à la présentation de l’amendement n° 174 tendant à supprimer l’article 34 sexies.
Cet article s’inspire du forfait de suivi post-cancer institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui ne constitue pas cependant une expérimentation, comme celle qui est envisagée dans cet article.
Si la volonté d’accompagner les patients atteints de pathologies chroniques dans une logique de parcours non pas seulement de santé, mais aussi de soins est partagée, le fait est que de nombreux dispositifs répondent déjà à cette finalité.
L’expérimentation proposée pourrait notamment s’inscrire dans le cadre général pour l’innovation au sein du système de santé ouverte par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui avait précisément vocation à renforcer la cohérence des actions de coordination des parcours tout en renforçant leur suivi et leur évaluation.
Afin de ne pas superposer les dispositifs, il est proposé de supprimer cet article.
Permettez-moi, pour commencer, de faire un double aparté.
Comme Mme la rapporteure, je partage les propos du sénateur Iacovelli. Aussi, je vous propose d’avancer ensemble sur la problématique que vous avez soulevée.
Par ailleurs, permettez-moi de revenir sur l’expérimentation prévue à l’article précédent, dont vous avez voté la suppression à l’instant. Il s’agissait d’autoriser les sages-femmes, à titre expérimental, à pratiquer des IVG instrumentales. Avec cette suppression, je me demande quel message nous envoyons aux femmes de ce pays et, accessoirement, aux sages-femmes elles-mêmes, mais nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la longue navette parlementaire qui nous attend.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, GEST, SER et CRCE.
J’en viens à l’amendement n° 174.
Mme la rapporteure a raison de souligner les possibilités offertes par le dispositif de l’innovation en santé, créé par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Plus de soixante-dix expérimentations, portant sur des thèmes variés, ont été autorisées à ce titre, dont douze favorisant la pratique de l’activité physique adaptée. C’est la voie principale pour les expérimentations, d’autant qu’il n’existe aucune restriction quant au statut juridique des porteurs de projets.
En première lecture, l’Assemblée nationale a voté une expérimentation visant à mettre en place un parcours de soins pour l’accompagnement des personnes souffrant de diabète. Nous y sommes favorables, pour plusieurs raisons que je vous précise de nouveau.
Premièrement, cet article souligne très clairement que le Gouvernement est fortement engagé en faveur du développement du sport santé. J’espère qu’il en est de même du Sénat !
Deuxièmement, il favorise le déploiement sur le terrain de toutes les initiatives qui rencontrent un véritable succès dans les territoires. Je pense notamment aux maisons sport-santé – certains d’entre vous en comptent sans doute dans leur département.
Troisièmement et enfin, il met en avant les innovations, permises par le dernier PLFSS, en faveur de l’activité physique adaptée. Parmi elles, figure bien sûr le parcours post-cancer, que vous avez voté l’an passé et dont les décrets d’application sont en cours de finalisation en vue d’un déploiement avant la fin de l’année 2020.
Le sport santé est l’une des priorités d’Olivier Véran et il s’inscrit dans l’action du Gouvernement : l’examen du PLFSS me donne l’occasion de le réaffirmer. Pour cette raison, nous avons appuyé les amendements de députés visant à expérimenter l’accompagnement pluridisciplinaire des diabétiques de type 2. En conséquence, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Savin, Kern, Piednoir, Savary, Somon, Moga et Hugonet, Mmes Dumas et N. Goulet, MM. Cambon et Joyandet, Mme Deromedi, M. Sol, Mmes Demas et Boulay-Espéronnier, M. Bouchet, Mme Puissat, MM. Vogel, Calvet, Daubresse, B. Fournier et Burgoa, Mme Estrosi Sassone, M. Gremillet, Mme Belrhiti, MM. Laugier, Wattebled et Brisson, Mmes M. Mercier et Lassarade, M. Pointereau, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mmes Sollogoub, Berthet et Malet, MM. Mandelli, Longeot, Belin, Longuet et Decool, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Ventalon, MM. Darnaud, Houpert, Regnard et Cuypers, Mme Borchio Fontimp, MM. Meurant, Tabarot, H. Leroy, E. Blanc, J.M. Boyer et Dallier, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Saury et Mmes Mélot et Di Folco, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
traitées pour une hypertension artérielle ou
La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Même si j’ai voté pour la suppression de l’article 34 sexies, je défendrai cet amendement, déposé par Michel Savin.
Monsieur le secrétaire d’État, vous le savez, notre collègue est très engagé en faveur du sport santé. Par cet amendement, il propose d’étendre l’expérimentation prévue au traitement de l’hypertension artérielle.

Initialement, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, mais puisque l’on semble décidé à accompagner toutes les pathologies chroniques, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Madame la sénatrice, vous avez compris combien le Gouvernement est engagé en faveur du sport santé. Il s’agit non pas d’accompagner et de traiter toutes les pathologies, mais de développer une approche nouvelle, axée sur la prévention : nous sommes tous conscients du virage que notre pays doit prendre à cet égard.
Plusieurs mesures concrètes sont déployées sur le terrain. Je pense, une nouvelle fois, aux maisons sport-santé : ces structures connaissent le succès que l’on sait. Les derniers PLFSS nous ont également permis d’encourager l’activité physique adaptée grâce à diverses innovations, dont le parcours cancer et les douze expérimentations que je viens d’évoquer, au titre de l’article 51, favorisant la pratique d’activités physiques.
Cela étant, l’offre que nous déployons sur le terrain doit être lisible pour les Français. En ce sens, je rejoins Mme la rapporteure : il ne faut pas complexifier à l’excès le dispositif expérimental prévu dans ce PLFSS pour les personnes atteintes de diabète de type 2 en l’étendant, comme vous le proposez, aux personnes souffrant d’hypertension artérielle.
Nous sommes très engagés sur ce terrain, mais, à mes yeux, il vaut mieux procéder par étape. Comme Mme la rapporteure, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 34 sexies est adopté.
I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la Caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.
II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation.

L’amendement n° 175, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.

Mes chers collègues, la commission vous propose un nouvel amendement de suppression.
Cet article met en œuvre à titre expérimental, pour une durée d’un an, une consultation longue en santé sexuelle pour les assurés âgés de 15 à 18 ans, financée par l’assurance maladie.
Évidemment, la mesure est intéressante, mais il me semble dommage de limiter l’expérimentation à une année. De plus, elle viendrait s’ajouter à plusieurs dispositifs existants : outre la première consultation de contraception et de prévention dont peuvent bénéficier les filles de 15 à 18 ans, il existe – je le rappelle – un examen médical obligatoire entre 15 et 16 ans, lequel fait partie des vingt examens obligatoires de l’enfant.
Certains conseils régionaux, en lien avec les ARS, ont également mis en place des pass santé jeunes qui offrent, notamment aux jeunes, un accompagnement en matière de santé sexuelle. C’est une bonne chose.
Il ne semble donc pas opportun d’adopter une mesure de portée si limitée, qui viendrait s’ajouter aux dispositifs déjà mis en œuvre pour améliorer la prévention en santé des adolescents et des jeunes adultes.
Madame la rapporteure, j’entends bien vos observations et je suis sûr que nous visons le même but : accroître le niveau d’information et de sensibilisation de l’ensemble de nos jeunes.
Évidemment, la promotion de la santé sexuelle est une des priorités du Gouvernement. À preuve, nous avons déployé une stratégie nationale en santé sexuelle, qui s’étend jusqu’à l’horizon 2030 – elle traduit donc bien une certaine ambition !
Nous avons à cœur de permettre le développement des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, lesquelles vont de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH. Vous le savez, il y va également de l’égalité entre les femmes et les hommes, principe fondateur de notre République.
Grâce à ce dispositif, nous atteindrons mieux encore notre objectif global : améliorer l’information et la sensibilisation de l’ensemble de nos jeunes. Vous souhaiteriez que nous soyons plus ambitieux encore, mais cet article fait déjà œuvre utile. Nous nous opposons donc à sa suppression.

Nous avons voté contre les précédents amendements de suppression : pour les mêmes raisons, nous nous prononcerons pour le maintien de l’article 34 septies.
Bien sûr, on peut entendre les arguments de Mme la rapporteure : des dispositifs similaires existent déjà. Néanmoins – l’examen de ce PLFSS le prouve –, les questions liées à la santé publique en général et à la santé sexuelle en particulier sont trop souvent balayées d’un revers de main par notre commission.
Madame la rapporteure, si la portée de cette mesure vous semble trop limitée, pourquoi ne proposez-vous pas d’étendre la durée de l’expérimentation et d’en faire bénéficier plus de territoires, au lieu de demander la suppression pure et simple de cet article ?
À mon sens, il est dommageable de se priver d’un outil supplémentaire à destination des jeunes, notamment des garçons, qui pourraient ainsi bénéficier d’une consultation.
On sait très bien l’importance de la prévention et de l’information à destination des jeunes sur les IST, les maladies sexuellement transmissibles (MST) ou encore sur la contraception. Les chiffres sont alarmants. On assiste à la résurgence de certaines maladies, comme la syphilis : à l’évidence, les dispositifs existants ne suffisent pas.
Nous voterons contre la suppression de cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Pardonnez-moi d’intervenir dans ce débat de spécialistes : depuis quelques instants, je ressens un certain malaise. Amendement après amendement, le Sénat semble freiner les différentes initiatives prises en faveur des femmes. À présent, il s’agit des jeunes.
Laurence Cohen a eu raison de parler des garçons. Quand on est élu local, on connaît toute l’importance de ces politiques, souvent destinées aux adolescentes et aux adolescents.
Madame la rapporteure, cet article prévoit que, « à titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement » de cette consultation : ce n’est pas la révolution ! Vous relevez que, parfois, les collectivités territoriales mènent déjà de telles politiques : parfois ! Mais quels sont ces dispositifs ? Sont-ils suffisamment robustes ?
Nous tous ici avons été, ou sommes encore, élu local. Personnellement, je trouve réellement utile que l’État puisse, pendant un an, observer ce qui se passe sur l’ensemble du territoire. Ce faisant, il verra ce que les collectivités territoriales font ou ne font pas et pourra repérer les initiatives méritant d’être complétées.
Dès l’adolescence, nos enfants doivent apprendre ce que sont la sexualité, les maladies sexuellement transmissibles et la reproduction, nous le savons bien ! Ceux qui, dans cet hémicycle, s’inquiètent du recours à l’IVG ou des maternités non désirées devraient, eux aussi, être favorables à ces dispositions.
J’ai pris la liberté de m’immiscer dans ce débat de connaisseurs. À mon sens, il faut repousser cet amendement, car il faut accepter cette action de l’État !

Pour ma part, je ne vois pas ce qu’apporte cet article. Il existe déjà un examen obligatoire entre 15 et 16 ans, au titre des examens de l’enfant. Pourquoi le doublonner par une telle expérimentation ?
En parallèle, les collectivités territoriales ont leurs propres dispositifs. Ainsi, la région des Pays de la Loire, où je suis chargée de la mission santé, a étendu le pass contraception pour en faire un pass santé, lequel ouvre droit à des consultations médicales, à des préservatifs gratuits ou encore à des tests.
J’y insiste, pourquoi s’offusquer ? Si la commission rejette cet article, c’est parce qu’il est satisfait par l’examen obligatoire que nous avons voté il y a un an ou deux.

J’abonde dans le sens de Catherine Deroche et j’ajoute qu’il ne faut pas multiplier les examens, car les adolescentes doivent rester réceptives.
Au demeurant, monsieur le secrétaire d’État, les examens obligatoires de 15 à 18 ans sont-ils bien effectués ? Quel est leur taux de réalisation ? Il faut commencer par procéder à un état des lieux ! Je ne suis pas du tout sûr que cette visite soit entièrement prise en compte, au titre de la surveillance de nos jeunes…

Une fois que l’on s’en sera assuré, cette consultation permettra également l’éducation sur laquelle nous insistons ce soir.
Madame la présidente de la commission, monsieur Savary, il ne s’agit pas de doublonner la consultation obligatoire entre 15 et 18 ans, qui peut certes porter sur des questions de santé sexuelle, mais dont l’objet est bien plus large.
Ce dispositif vise à expérimenter, pour les jeunes garçons, ce que le droit commun prévoit déjà pour les seules jeunes filles : une consultation auprès du médecin traitant – les jeunes femmes peuvent également s’adresser à un gynécologue ou à une sage-femme –, dans une approche globale de la santé sexuelle et reproductive. Cette consultation est donc tout à fait différente de l’examen obligatoire en vigueur, dont l’objectif est plus général. Nous pourrons mesurer dans un an les effets de cette expérimentation !

Je mets aux voix l’amendement n° 175.
L’amendement n° 432 rectifié, présenté par Mmes Billon, C. Fournier, Perrot, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, Tetuanui et Létard, MM. Cadic, J.M. Arnaud, Longeot, Levi, Détraigne et Kern, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Janssens, Canevet et Delcros, Mmes Férat et de La Provôté et MM. Lafon, Hingray, Poadja et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux articles L. 162-8-1 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes, à titre dérogatoire, peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Après cet intense suspense, je vais pouvoir défendre l’amendement de ma collègue Annick Billon !
Sourires.

En tant que présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes, Mme Billon insiste sur l’intérêt de l’expérimentation : elle propose donc de l’élargir et, ce faisant, d’offrir à tous, filles comme garçons, une consultation longue et globale dédiée à la santé sexuelle.
En outre, cet amendement vise à permettre aux sages-femmes de réaliser cette consultation. Grâce à un meilleur maillage territorial, les jeunes auront plus facilement accès à cette consultation.
Enfin – cet aspect n’a pas encore été évoqué –, pour apporter aux adolescents des garanties de confidentialité, cet amendement tend à lever l’obligation pour le mineur d’être accompagné d’un adulte et à ouvrir la possibilité de bénéficier du secret des dépenses. En effet, un tel examen ne peut être assimilé aux consultations proposées aux enfants.

Nous demandons le retrait de cet amendement – à défaut, nous émettrons un avis défavorable –, car il semble a priori satisfait : peut-être M. le secrétaire d’État nous le confirmera-t-il ?
Je le confirme ! Je demande moi aussi le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 34 septies est adopté.

L’amendement n° 408 rectifié ter, présenté par MM. Henno et P. Martin, Mme Dindar, MM. Kern, Janssens et Moga, Mme Guidez, M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Laugier, S. Demilly et Détraigne, Mme Perrot, MM. Hingray, Lafon, Le Nay et Cazabonne, Mme de La Provôté, M. Chauvet, Mmes Saint-Pé et Morin-Desailly, M. Duffourg et Mme Doineau, est ainsi libellé :
Après l’article 34 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de son congé prénatal, qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. »
La parole est à M. Olivier Henno.

Avec cet amendement, nous voulons mettre fin à une disparité entre les salariées et les indépendantes en autorisant l’ensemble des professionnelles exerçant en libéral, lorsqu’elles mènent leur grossesse jusqu’à son terme dans des conditions de santé optimales, et dans des conditions médicales strictes, à reporter une partie de leur congé prénatal sur leur congé postnatal.
Ainsi, les mères concernées pourront, sans bouleverser les dispositions actuelles et sans coût supplémentaire, disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant.

Il me semble que cette possibilité soit déjà offerte, même si le code de la sécurité sociale ne la détaille pas de manière si explicite : afin de nous en assurer, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
Madame la rapporteure, nous vous confirmons que cet amendement est satisfait.
Monsieur Henno, les textes réglementaires du code de la sécurité sociale permettent déjà aux travailleuses indépendantes de reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal. À ce titre, elles se voient appliquer les mêmes règles que les salariées. En effet, les durées du congé de maternité des travailleuses indépendantes sont totalement alignées sur celles des salariées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Cette évolution résulte d’un amendement de la députée Marie-Pierre Rixain. Présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Mme Rixain est très investie sur ces sujets, notamment pour ce qui concerne les indépendants. Nous aurons probablement l’occasion d’y revenir, lors de l’examen de l’article 35, que nous attendons tous, car il prévoit l’allongement de la durée du congé de paternité dans notre pays !
Une travailleuse indépendante peut donc reporter une partie de son congé prénatal, dans la limite de trois semaines de congés obligatoires en prénatal, afin de bénéficier de ces semaines de congé après la naissance de l’enfant.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement n° 408 rectifié ter est retiré.
Chapitre II
Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, » ;
2° Après l’article L. 1225-35, il est inséré un article L. 1225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225 -35 -1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;
3° L’article L. 1225-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot « trente-deux » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
4° L’article L. 3142-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »
5° L’article L. 3142-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-deux » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot « onze » est remplacé par le mot « vingt-cinq » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;
2° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente-deux jours » ;
3° Le premier alinéa du II de l’article L. 623-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :
« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande, d’une allocation de remplacement.
« Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

« Il n’y a pas de bon père, c’est la règle : qu’on n’en tienne pas grief aux hommes mais au lien de paternité qui est pourri. » Cette citation n’est pas de moi, elle est d’un écrivain-philosophe, qui n’est autre que Jean-Paul Sartre !
Très longtemps, le père a été essentiellement perçu comme le pourvoyeur de revenus ; son objectif principal n’était pas de créer une relation avec ses enfants. Aux mères, les soins quotidiens ; aux pères, l’éducation au savoir et la protection financière de la famille.
Toutefois, cette vision patriarcale de la société a profondément changé. Aujourd’hui, ceux que l’on appelle « les nouveaux pères » cherchent à construire une paternité fondée sur la proximité et la complexité affective avec leurs enfants. De plus, la naissance n’est plus uniquement une affaire de femmes : c’est un événement qui bouleverse l’existence des deux parents, du couple et de la famille.
Parce qu’il répond aux attentes des familles et de très nombreux pères, l’allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est une avancée sociale majeure.
Tout d’abord, la présence des deux parents pendant les premiers mois de la vie a une incidence positive durable et déterminante sur la santé et le développement des enfants.
Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui préside la commission des 1 000 premiers jours, plus le père est présent pendant la grossesse et pendant les premiers jours qui suivent la naissance, plus la mère est sécurisée et plus le bébé trouve autour de lui ce qu’il lui faut pour se développer. Nos voisins européens l’ont d’ailleurs bien compris, à l’instar de nos jeunes.
Ensuite, cette mesure renforce l’égalité entre les hommes et les femmes en favorisant le partage des tâches au sein de la sphère familiale et en incitant à une répartition équitable entre vie familiale et vie professionnelle.
Enfin, alors que les femmes ont été considérées jusqu’à présent comme des mères en puissance, tous les salariés deviendront des parents en puissance.
Dans quelques instants, nous débattrons d’amendements visant à réduire la portée de cette mesure. Je ne les voterai pas. Nous le savons, les pères qui, aujourd’hui, ne prennent pas la totalité de leur congé s’autocensurent souvent, parce qu’ils craignent d’être mal vus dans leur entreprise, ou tout simplement parce qu’ils sont sous l’influence de représentations sociales.
Si ce dispositif devient facultatif, les pères ne seront certainement pas libres de prendre ou non leur congé. À mon sens, il faut donc maintenir son caractère obligatoire. C’est dans cette même logique que la parité en politique a pu progresser.
Les pères ne veulent pas être traités comme des parents de seconde zone : nous devons accompagner cette évolution sociétale. Aussi, j’espère que la Haute Assemblée aura la sagesse de repousser ces amendements, pour enfin donner aux pères la place qui leur revient dans l’accueil de l’enfant.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est la première fois que je prends la parole dans cet hémicycle et je suis heureuse que ce soit pour une telle occasion : l’allongement de la durée du congé de paternité est une avancée que je tiens à saluer.
C’est une avancée pour les hommes c’est une avancée pour les femmes, c’est une avancée pour les familles, c’est une mesure qui répond à l’intérêt de l’enfant. C’est également une avancée pour toute notre société, qui a besoin d’aller encore plus loin vers l’égalité entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, du partage des tâches ou de l’implication des deux parents, dès les premiers jours de la vie de l’enfant.
Ces questions sont essentielles. Elles nous concernent tous. J’y ai été fortement sensibilisée lors de stages que j’ai effectués il y a quelques années au Québec. Je garde en mémoire plusieurs témoignages de parents. De jeunes pères soulignaient notamment tout ce que le congé de paternité avait de positif : grâce à lui, ils pouvaient s’investir auprès de leur enfant et prendre conscience de la parentalité, qu’il est si important d’apprendre à deux.
Ce congé permet aux deux parents de s’épauler l’un l’autre. De surcroît, il donne, notamment aux pères, l’envie de prolonger ce moment par un congé parental, dans un cadre bienveillant – le mot a toute son importance – et protecteur.
Ces envies, je les retrouve aujourd’hui dans notre société ; je les perçois autour de moi.
Prolonger le congé de paternité, c’est donc accompagner un changement de mentalités. De telles évolutions ne se décrètent pas : elles s’apprennent. Il est parfois nécessaire de passer par l’obligation, précisément pour concrétiser les changements. Il s’agit d’inciter, d’impliquer et d’encourager ; en particulier, le père doit se sentir légitime à prendre un congé lors de la naissance de son enfant.
Il s’agit aussi de créer un climat favorable pour que tout un chacun puisse demander et obtenir un tel congé. Ainsi, l’on favorisera la sérénité au sein du couple, qui est souvent chamboulé par l’arrivée d’un enfant.
Enfin – je le rappelle à mon tour –, il s’agit de permettre à l’enfant de passer ses premiers jours avec ses deux parents : nous savons combien cette double présence est bénéfique pour son développement.

L’allongement du congé de paternité est une avancée nécessaire, mais il n’est pas le seul enjeu. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Je pense notamment…

Mme Elsa Schalck. … à l’accompagnement des familles à la parentalité. Ces questions me paraissent essentielles !
MM. Martin Lévrier et Stéphane Artano applaudissent.

L’article 35 vient consacrer l’une des mesures phares de ce PLFSS : l’allongement de la durée du congé de paternité.
Ce doublement à vingt-huit jours, dont sept obligatoires, est un nouveau symbole du fameux « en même temps ». En avril 2019, la France faisait tout pour limiter la portée de la directive européenne relative au congé parental. Fidèle à la logique comptable qui guide son action, le Président de la République déclarait alors : « […] C’est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. »
Nous avons observé un changement de pied heureux, cinq mois plus tard, avec le lancement de la commission Cyrulnik, censée faire des 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant une priorité de l’action publique. Le rapport rendu un an plus tard préconise l’extension du congé de paternité à neuf semaines et une réforme du congé parental, qui serait beaucoup mieux rémunéré et d’une durée plus courte.
Entre les grandes promesses présidentielles et la logique comptable, il a fallu trancher et, comme souvent, c’est le portefeuille qui a gagné l’arbitrage. Le congé de paternité est étendu à quatre semaines, dont une seule est obligatoire, et la réforme du congé parental est renvoyée aux calendes grecques.
Nous saluons ce premier pas, mais nous restons sur notre faim, car la réforme du congé de paternité et des congés parentaux est essentielle à bien des égards.
Cette réforme est essentielle pour les enfants – les précédents orateurs l’ont rappelé. Elle permettra de les accueillir dans les meilleures conditions, de favoriser leur développement cognitif et de renforcer leur sécurité affective.
Elle est essentielle pour permettre au père, ou au second parent, de soulager la mère après l’épreuve de l’accouchement et, au-delà, pour assurer une meilleure répartition des tâches domestiques.
Elle est également essentielle pour que les parents, notamment celui qui n’a pas porté l’enfant neuf mois, puissent appréhender et découvrir la parentalité en nouant des liens avec leur progéniture.
Elle est essentielle, enfin, au combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Seul un congé de paternité allongé dans des proportions similaires au congé de maternité permettrait de lutter contre la discrimination à l’embauche des futures mères et contre les inégalités salariales. Tant que la parentalité n’aura pas des conséquences similaires, que l’employé soit père ou mère, ces discriminations perdureront.
Nous n’avons pas pu amender ce dispositif et nous le regrettons : de l’Espagne, avec ses seize semaines de congés payés, à la Suède, avec ses dix-huit mois de congés parentaux partageables, il y avait bien des modèles à suivre.
J’espère que, au-delà de la naissance, on imaginera demain dans notre pays un congé parental utilisable tout au long de la vie de l’enfant, pour l’accompagner beaucoup mieux quand le besoin s’en fait sentir !

Mes chers collègues, le congé de paternité est actuellement de onze jours : il peut succéder au congé de naissance, qui dure, lui, trois jours. Dans ce cas, le père peut rester deux semaines auprès de son enfant. Qu’est-ce que deux semaines ?
Que change cet article ? Le congé est porté à vingt-huit jours. Sa durée est doublée : aux trois jours de congé de naissance, qui seront indemnisés par l’employeur, s’ajouteront vingt-cinq jours de congé de paternité, qui seront indemnisés par la sécurité sociale. En cas de naissance multiple, ce total sera porté à trente-deux jours.
Disons-le : il s’agit d’une avancée remarquable. Cette réforme, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2021, est un marqueur social fort du quinquennat.
Les jeunes pères auront l’obligation de prendre sept de ces vingt-huit jours immédiatement après la naissance de l’enfant. Les vingt et un jours de congé restants pourront être pris dans la foulée ou ultérieurement, de manière fractionnée.
Cette mesure vient soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est voulue, revendiquée, attendue par tous les parents. Depuis la création du congé de paternité, en 2002, aucun allongement n’avait été décidé. La commission des 1 000 premiers jours, qui a rendu son rapport en septembre dernier, met en avant la nécessité de renforcer ce temps parental afin de favoriser la création de liens d’attachement durables entre le second parent et l’enfant et, ainsi, d’accompagner le développement de celui-ci.
Il ne faudra pas laisser entendre que cette mesure est une contrainte : c’est au contraire une démarche positive et un élément fort de nos politiques sociales et familiales.
Nous voterons évidemment cet article, avec fierté : il va dans le sens de l’histoire ! Nous nous opposerons aux mesures qui auraient pour conséquence de réduire sa portée.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Émilienne Poumirol applaudit également.

Deux minutes trente : c’est le temps dont je dispose pour défendre l’allongement de la durée du congé de paternité et le caractère obligatoire de celui-ci.
Deux minutes trente : c’est aussi le temps que les pères accorderont en plus aux soins des enfants si nous ne faisons rien, et encore faudra-t-il attendre cinq ans pour obtenir ce résultat. Ce n’est pas moi qui le dis : cette tendance, qui n’est évidemment pas satisfaisante, a été mesurée par le Centre d’analyse stratégique en 2012.
Nous connaissons l’immense déséquilibre entre le temps consacré par les mères et par les pères aux soins des enfants. Cet écart ne nous semble pas acceptable ; il est le ferment d’une société inégalitaire, qui fait peser principalement sur les femmes la charge du soin parental, des tâches éducatives et du travail domestique.
Ne nous étonnons pas, si l’on maintient cet injuste déséquilibre, que le travail professionnel des femmes soit minoré et que le principe « à travail égal, salaire égal » demeure un slogan. Ne nous étonnons pas que les femmes travaillent gratuitement depuis mercredi 4 novembre à seize heures seize, ce qui sera le cas jusqu’à la fin de l’année.
Nous voulons modifier de façon radicale la répartition du temps de travail parental au sein du couple, et nous l’assumons. Nous entendons en finir avec le modèle « monsieur gagne-pain » et « madame au foyer ».
La seule manière d’avancer rapidement vers l’égalité, c’est de rendre ce congé de paternité obligatoire. Sans cela, il est à craindre qu’une telle avancée ne prenne trop de temps, le risque étant de se heurter à certains obstacles, comme ce cliché qui veut qu’un homme qui pouponne ne soit pas viril. En outre, le risque existe, en dépit de la formidable attente que suscite ce congé dans la population française, que certains hommes ne demandent pas à en bénéficier, par crainte de le demander à leur employeur.
Nous le savons, nous parviendrons à l’égalité, car la société française y est majoritairement prête, tout comme une partie de votre famille politique, chers collègues de droite, divisée sur la question. Nous remporterons cette bataille culturelle.
Nous voterons donc pour l’allongement de la durée du congé de paternité et pour son caractère obligatoire.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et RDPI.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, je remercie tous ceux qui se sont exprimés. Je dois reconnaître que je buvais du petit-lait en vous écoutant !
L’allongement de la durée du congé de paternité figure parmi les recommandations du rapport des 1 000 jours, fruit du travail d’un comité de dix-huit experts.
Alors quand débute et quand se termine cette période des 1 000 jours ? Elle commence au quatrième mois de grossesse et s’étend jusqu’aux 2 ans de l’enfant, certains scientifiques la faisant démarrer et s’achever plus ou moins avant ou après.
Quoi qu’il en soit, la croissance la plus spectaculaire du cerveau humain a lieu à la fin de la grossesse et durant les deux premières années de la vie. C’est la période privilégiée pour apporter à l’enfant un sentiment d’attachement et de sécurité, pour favoriser son développement émotionnel et cognitif. Ces moments sont uniques. Pour les scientifiques, ils sont incontournables.
À ceux qui se demandent si le congé de paternité ne serait pas un gadget dans notre société, je rappelle que les neurosciences nous montrent le chemin depuis trente ans et prouvent combien il est important d’agir durant ces 1 000 premiers jours. Ces moments sont uniques, je le répète, et ne se renouvelleront pas.
À mon sens, la société doit être soutenante, elle doit aider les parents lors des premiers jours de la vie de l’enfant. L’importance de ces moments doit être prise en compte dans les politiques publiques. Les adultes que nous sommes aujourd’hui sont les enfants que nous étions hier. Plus un enfant a été élevé et éduqué dans l’amour, plus il est accompli à l’âge adulte. Le sentiment d’attachement et de sécurité est très important.
Vous le voyez, je suis complètement convaincue par l’allongement de la durée du congé de paternité, qui constitue, selon moi, une priorité de l’action publique, car il répond à la demande des nouvelles générations de parents. Écoutez-les : ils ont vraiment envie de passer ces moments avec leur bébé et de les partager.
Notre collègue l’a dit, il faut partager l’arrivée d’un enfant et ses conséquences, une naissance n’ayant rien d’anodin. La présence des deux parents auprès de l’enfant à un stade précoce permet un développement des systèmes affectif, émotionnel, relationnel et psychobiologique dès le plus jeune âge. Dans le rapport Cyrulnik, on parle d’« accordage affectif » : je partage entièrement le choix de ces mots.
On refuse de nombreux rapports dans cet hémicycle. Il existe pourtant des rapports qu’il faut lire et conserver. Lisez et conservez le travail de Boris Cyrulnik et de ses experts !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI.

Mon intervention sera plus brève. Je poserai simplement une question très pragmatique. Je soutiendrai l’article 35, il n’y a pas de débat sur ce point, mais je m’interroge sur le calendrier. Certes, on peut s’interroger de la même façon sur toutes les mesures : interviennent-elles trop tôt ou trop tard ?
Si je comprends l’intérêt de l’avancée qui nous est proposée, est-il pertinent de l’inscrire dans ce PLFSS, en pleine épidémie de covid, alors que la situation est tendue pour nos entreprises ? Le calendrier est-il bien opportun ?
J’aurai l’occasion de m’exprimer plus longuement lorsque je donnerai l’avis du Gouvernement sur les amendements qui ont été déposés sur cet article, mais je tiens d’ores et déjà à évoquer deux ou trois éléments, même si Mme la rapporteure a dit beaucoup de choses, avec beaucoup de conviction et d’émotion, ce dont je la remercie, comme tous ceux d’entre vous qui ont pris la parole pour soutenir cette réforme.
Monsieur Gontard, nous n’allons pas bouder notre plaisir : il s’agit d’une réforme historique, dont nous devons nous réjouir, comme Mme Schalck. Merci, madame Schalck, de cette première intervention qui restera, je pense, dans votre mémoire.
Cette réforme est historique, car ce congé n’avait pas été modifié depuis 2002, soit dix-huit ans.
Mais si, madame de La Gontrie, nous sommes selon moi sur le chemin d’une révolution culturelle, comme l’a dit Mme Meunier. Le caractère obligatoire de cette mesure, dont nous allons débattre et auquel certains d’entre vous sont opposés, contribue à faire de cette réforme une révolution culturelle.
Toutes les raisons justifiant l’allongement de ce congé de paternité ont été évoquées. Cette réforme se justifie avant toutes choses pour l’enfant lui-même, vous l’avez très bien dit, madame la rapporteure. Les neurosciences nous montrent qu’un tel congé est important pour la relation entre l’enfant et les parents, qu’il favorise le développement de l’enfant.
Cette mesure favorise aussi l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle permet un partage des tâches domestiques et familiales et encourage l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle est l’une des recommandations phares du rapport de Boris Cyrulnik et fait partie d’un ensemble de dispositifs que nous mettons en place durant les 1 000 premiers jours de l’enfant. Ce PLFSS comporte plusieurs de ces mesures, en plus de l’allongement du congé de paternité, mais nous y reviendrons.
J’ajoute, mesdames, messieurs les sénateurs, parce que nous n’aurons peut-être pas l’occasion d’insister sur ce point, que l’article 35 comporte également une avancée pour les parents adoptants : le Gouvernement a fait voter à l’Assemblée nationale un amendement visant à porter de dix à seize semaines la durée du congé d’adoption. Il s’agit là d’une véritable avancée pour ces parents, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de modernisation de l’adoption que je porte au sein du Gouvernement.
Vous le savez, nous sommes en train de bâtir des parcours 1 000 jours pour l’ensemble des parents, y compris pour ceux qui connaissent des situations de fragilité liées, par exemple, à l’arrivée d’un enfant prématuré, en situation de handicap ou au fait d’être eux-mêmes en situation de handicap. À cet égard, je rappelle que le 17 novembre prochain sera la journée mondiale de la prématurité. Toutes ces situations de fragilité posant des problèmes spécifiques, nous créons des parcours des 1 000 jours adaptés.
L’extension du congé d’adoption de dix à seize semaines prévue dans cet article est une première pierre. Il s’agit d’une avancée pour ceux de nos concitoyens qui sont engagés dans un parcours d’adoption.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 312 rectifié bis, présenté par Mme Puissat, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. Bonne, Savary, Meurant, Sol et Calvet, Mme Thomas, M. Grosperrin, Mme Deromedi, M. Dallier, Mmes Lassarade, Malet, Estrosi Sassone et Noël, MM. Milon et Brisson, Mme Gruny et MM. Babary, Savin, D. Laurent, Sautarel et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris, les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé sont fixés par décret.
La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Cet amendement tend à prévoir que, pour bénéficier du congé de paternité dans sa nouvelle forme, le salarié doit remplir des conditions en termes d’ancienneté et de contrat de travail. Les modalités seront fixées par décret.
J’ai bien conscience, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, que défendre un tel amendement, c’est nager à contre-courant. Cela étant, notre rôle n’est pas d’aller tous dans le même sens, il est aussi de faire état de certaines réalités du terrain.
Comme Philippe Mouiller, je m’interroge sur la temporalité de cette mesure. Vous avez dit, monsieur le secrétaire d’État, que cet article était attendu de tous. J’ignore si c’est vraiment le cas, mais ce qui est certain, c’est que personne ne vient me voir dans ma permanence pour me dire : « Madame la sénatrice, il est impératif de doubler la durée du congé de paternité et d’imposer quatre jours de congé supplémentaires après la naissance d’un enfant. »
Tous ceux qui ont travaillé dans le secteur de la protection de l’enfance sont très sensibles au soutien à la parentalité, mais, aujourd’hui, l’inquiétude est grande de savoir si nos systèmes sociaux vont tenir.
Le fait marquant de ce PLFSS, je suis désolée de le dire, ce n’est pas cet article, ce sont les 50 milliards d’euros de déficit. Les Français se demandent aujourd’hui si leurs retraites pourront être payées et si nos systèmes sociaux vont tenir.

Quant aux milieux économiques, ils se demandent si nos entreprises vont, elles aussi, pouvoir tenir. Certains chefs d’entreprise – vous les avez entendus comme moi – sont au bord du burn-out et se demandent comment ils pourront assurer l’économie de demain.
Cet article est certes le bienvenu, mais pas maintenant, car il va imposer de nouvelles contraintes aux entreprises. Or je ne suis pas certaine que les petites et moyennes entreprises, notamment, soient capables de les supporter.
Bravo ! sur des travées du groupe Les Républicains.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 594 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumas, MM. Houpert et Decool, Mmes Lavarde, Loisier et Deromedi, MM. Cambon et Calvet, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Thomas, MM. Bascher, Laménie, Wattebled et Boré, Mme Estrosi Sassone et MM. Cazabonne et Regnard.
L’amendement n° 618 rectifié quinquies est présenté par Mmes Deseyne, Lassarade et Borchio Fontimp, MM. Le Rudulier et Panunzi, Mmes Puissat et Belrhiti, MM. B. Fournier, Grosperrin, Cardoux, Segouin, Duplomb, Piednoir et Meurant, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme Chauvin, MM. Saury, Rapin, Mandelli et Savary, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Pointereau, Mme Delmont-Koropoulis, M. Chevrollier, Mme Schalck, M. Babary et Mme Noël.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans la limite d’un fractionnement en deux périodes de congés
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le nombre de fractionnements peut être augmenté avec l’accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou accord collectif le prévoit expressément.
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 594 rectifié.

Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter notre collègue Frédérique Puissat.
Il est nécessaire, à mon sens, que le législateur encadre les modalités de fractionnement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. En effet, des absences courtes et répétées sont source de désorganisation au sein des entreprises.
Certaines entreprises pourraient être confrontées à des difficultés d’aménagement des plannings si le congé était séquencé en de multiples absences de courte durée. Il est donc préférable d’aménager le congé en un fractionnement en deux blocs de périodes distinctes, en laissant la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de prévoir des règles spécifiques, le cas échéant par convention ou par accord collectif.
Cet amendement vise à faciliter et à sécuriser la mise en œuvre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant par les employeurs et par les salariés.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 618 rectifié quinquies.

Je ne reviens pas sur l’allongement de la durée du congé de paternité ni sur son intérêt. J’aurais pu tenir les mêmes propos que certains de mes collègues à ce sujet.
Par cet amendement, il s’agit simplement d’encadrer les modalités de mise en œuvre de ce congé.

J’ai bien noté, chers collègues, que vous n’étiez pas contre l’allongement de la durée du congé de paternité et que vous souhaitez simplement l’assortir de conditions.
J’émets un avis défavorable sur l’amendement 312 rectifié bis, qui vise à prévoir par décret des conditions d’ancienneté ou de nature du contrat de travail pour bénéficier du congé de paternité.
Le bénéfice du congé de paternité est aujourd’hui ouvert à tous les salariés. Je ne trouve donc pas opportun de créer ce type de discrimination à l’occasion de son allongement. De telles conditions risqueraient en effet de toucher les salariés les plus précaires, qui, à mon sens, ont autant le droit de bénéficier du dispositif que les autres, le besoin de s’occuper du nouveau-né étant le même pour tous. Elles risqueraient en outre de créer des différences de traitement peu compréhensibles pour les salariés.
J’émets également un avis défavorable sur les amendements identiques n° 594 rectifié et 618 rectifié quinquies. Ces amendements tendent à limiter le fractionnement à deux périodes seulement, sauf accord de l’employeur ou accord collectif plus favorable.
Cette limitation me paraît restreindre la liberté du salarié de prendre les jours facultatifs de congé selon ses besoins de famille. Je ne suis pas certaine que des absences courtes soient plus déstabilisatrices pour l’entreprise que des absences longues. L’inverse peut aussi être vrai, cela dépend de la situation et des activités de l’entreprise.
Je vous rappelle, en outre, que les possibilités de fractionnement seront fixées par décret ; le Gouvernement définira ces modalités en concertation avec les partenaires sociaux.
J’entends bien l’attention que vous portez aux petites et moyennes entreprises, mais si l’on impose des conditions, on ne parviendra jamais à augmenter le taux de recours, qui stagne à 67 % depuis 2003.
Il faut prendre en compte le fait que, aujourd’hui, certains pères ne s’autorisent pas à demander à leur patron de bénéficier d’un congé de paternité, alors que sa durée n’est que de onze jours.
J’ai pour ma part été chef d’une toute petite entreprise. La question est de savoir où placer le curseur entre travail et paternité. Je pense que le travail est très important, car il faut subvenir aux besoins de sa famille, mais les moments que l’on passe avec ses enfants sont uniques. On ne peut pas rattraper les moments perdus, alors que le travail, on peut toujours le faire plus tard.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et GEST.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 312 rectifié bis et demande le retrait des amendements n° 594 rectifié et 618 rectifié quinquies, qui portent sur le fractionnement.
Madame Puissat, si je vous suis bien, vous considérez que les liens d’attachement et le développement de l’enfant doivent être conditionnés pour partie au statut professionnel du père, à la nature de son contrat de travail, au fait qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée ? Du point de vue de l’enfant, cela n’a pas de sens !
Ainsi que Mme la rapporteure l’a indiqué, s’il était adopté, cet amendement créerait des situations de discrimination entre les salariés.
Dans les faits, aujourd’hui, le congé de paternité est pris par 67 % des pères : 80 % de ceux qui le prennent sont en CDI, ce taux chutant à 47 % pour les pères en CDD.
Pour instaurer un droit réel, une égalité entre tous les pères de ce pays, le congé doit être obligatoire. À cet égard, je reviendrai lors de l’examen d’un amendement suivant sur ces jeunes pères qui ne voudraient pas prendre leur congé dont a parlé la sénatrice Deseyne. Le caractère obligatoire est un instrument de lutte contre l’autocensure d’un certain nombre de pères aujourd’hui.
Vous dites que personne ne vient vous réclamer ce congé lors de vos permanences, madame Puissat. Pour ma part, j’ai rencontré depuis un an plus de mille parents, j’ai participé à des tables rondes, visité des services de néonatologie. Systématiquement, le congé de paternité et la question de la présence du père auprès de l’enfant et de la mère ont été évoqués alors même ce n’était pas le sujet.
À cet égard, permettez-moi de vous livrer une anecdote, en anticipation de nos discussions sur le caractère obligatoire de ce congé. J’ai visité à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart le service de néonatologie dirigé par la professeure Alexandra Benachi, gynécologue-obstétricienne, membre de la commission des 1 000 jours, dont je salue ici le travail. J’y ai rencontré le père d’un enfant né grand prématuré. Magasinier de profession, il m’a dit que lorsqu’il avait annoncé à son patron qu’il attendait un enfant, celui-ci lui avait répondu : « tu es gentil, mais ce n’est pas toi qui es enceinte ! », …
… sous-entendu : « tu ne peux pas prendre ton congé ». Je ne généralise pas, mais je suis désolé de devoir vous dire que ce genre de situation existe aujourd’hui dans les entreprises.
Monsieur le sénateur Mouiller, vous m’avez interrogé sur la temporalité. Le fait est que ce n’est jamais le bon moment. Vous verrez pourtant que, dans quelques années, quand vous aurez voté, ainsi que vous nous l’avez indiqué, cette avancée sociale majeure – qui en appelle d’autres, madame de La Gontrie, monsieur Gontard –, on ne se dira pas qu’elle n’aura pas été votée au bon moment. Tous les Français nous seront redevables.
Moi aussi, avant d’être député et, tout récemment, secrétaire d’État, j’ai été chef d’une entreprise de vingt-cinq, de quarante, puis de cent cinquante salariés. Lorsque j’ai créé ma propre boîte, nous étions deux au fond d’un garage.
Je puis vous dire, madame la sénatrice, que ces sujets sont des questions d’organisation et d’anticipation. Quand une femme est enceinte et prend son congé de maternité, l’entreprise s’organise. Pourquoi un congé de paternité plus long de deux semaines désorganiserait-il toute l’entreprise ? C’est un faux argument, et c’est l’ancien chef d’entreprise qui vous le dit. Je le répète : il s’agit d’une question d’organisation et d’anticipation, tous ceux qui ont été chefs d’entreprise sur ces travées le savent.
Le coût de cette mesure, lequel a fait l’objet de réflexions et de débats avec les partenaires sociaux, ne repose pas sur les entreprises, vous le savez. À l’inverse, madame la sénatrice, il ne me semble pas que le doublement de la durée du congé de paternité mettra à bas le système de protection sociale et la sécurité sociale de notre pays.
Certes, mais vous sembliez établir une corrélation entre la situation financière et la mesure que nous proposons.
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.
J’en viens aux questions de fractionnement du congé. Comme l’a dit Mme la rapporteure, le principe est fixé dans la loi, certaines modalités seront fixées par décret.
À cet égard, nous avons discuté de ces sujets, y compris du principe même de l’extension du congé de paternité, avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales. Avec la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Élisabeth Borne, nous avons rencontré les organisations syndicales et patronales, la première fois le 11 septembre, puis à plusieurs reprises depuis, au cours de quatre réunions.
Nous avons notamment discuté d’un certain nombre de sujets. Toutes les décisions ne sont pas encore arrêtées, certaines seront prises par voie réglementaire. Ainsi, le délai de prévenance de l’employeur ou le fractionnement de ce congé suscitent des avis très contradictoires.
Démultiplier le fractionnement permettra aux indépendants, par exemple, de recourir davantage à ce congé, alors qu’il est souvent difficile pour eux de le prendre, on le sait. Tel était d’ailleurs l’objet de l’amendement de M. Henno sur le congé prénatal. À l’inverse, trop fractionner peut poser des problèmes d’organisation pour une entreprise. Il faut trouver un équilibre, nous en discutons avec les partenaires sociaux.
La durée de la période pendant laquelle ce congé pourra être pris fait également l’objet de discussions. Aujourd’hui, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance. Faut-il modifier ce délai et permettre un peu de souplesse ? Nous en discutons également avec les partenaires sociaux.
Je me suis engagé à présenter devant l’Assemblée nationale en nouvelle lecture les décisions qui auront été prises avec les partenaires sociaux, afin que les parlementaires puissent avoir une vision globale du dispositif, voter en conscience sur le principe, tout en ayant connaissance des modalités d’application. Je réitère ici cet engagement : je partagerai avec vous les décisions prises avec les partenaires sociaux sur ces questions de mise en œuvre concrètes et opérationnelles.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait des amendements n° 594 rectifié et 618 rectifié quinquies, ces sujets faisant l’objet de discussion avec les partenaires sociaux.

Mes chers collègues, j’ai du mal à comprendre votre position sur le caractère obligatoire du congé de paternité. M. le secrétaire d’État ne l’a pas rappelé, mais ni le Mouvement des entreprises de France (Medef) ni la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ne sont opposés à ce congé de paternité : ils y sont favorables ! Ne soyez donc pas plus royalistes que le roi !
Ce congé répond vraiment à une demande de la société. Il permet au père, ou au deuxième parent, de s’impliquer lors des premiers jours de l’enfant, comme cela est dit dans le rapport Cyrulnik, dont les auteurs préconisent même d’aller au-delà de vingt-huit jours de congé, dont sept obligatoires. Il s’agit donc d’une première avancée dont nous devons nous réjouir et que je soutiens complètement.
On pourrait aussi considérer que l’arrivée d’un enfant ralentissant une carrière professionnelle, autant que ce soient les femmes qui en subissent les conséquences !
La réalité, c’est que durant les trois jours qui sont actuellement obligatoires, le père a tout juste le temps de ramener son épouse à la maison, de déclarer la naissance à la mairie, éventuellement de déposer une demande à la crèche, s’il en a le temps et si ce n’est pas le week-end, avant de reprendre son travail.
Les jours suivants, c’est la femme qui s’occupera du reste des démarches administratives, qui déclarera l’enfant à la sécurité sociale, à la caisse d’allocations familiales. La femme est ensuite vouée à s’occuper au cours des dix-huit années suivantes de toutes les démarches administratives concernant l’enfant. Pendant dix-huit ans, on considérera qu’il est plus pratique que ce soit elle qui l’emmène chez le médecin ou chez le dentiste puisqu’il est sur sa carte Vitale.
Le congé de sept jours doit permettre d’instaurer une égalité dans le couple, entre l’homme et la femme, pour les dix-huit années suivantes.
Je soutiens donc cet article et je vous demande, en responsabilité, mes chers collègues, de retirer vos amendements.

J’ai l’impression d’être à une tout autre époque. Nous sommes pourtant en 2020 !
Trop souvent, j’entends dire des hommes qu’ils sont irresponsables ; trop souvent, j’entends dire que certains pères ne s’occupent jamais de leurs enfants.
Nous avons aujourd’hui l’occasion de proposer aux pères de mieux s’occuper de leurs enfants, et beaucoup d’entre eux attendent cela. De nombreux enfants atteignent l’âge de 2 ou 3 ans sans beaucoup voir leur père : celui-ci part travailler à cinq heures du matin, il rentre tard, il n’a pas de temps pour ses enfants. Nous pouvons aujourd’hui offrir à l’enfant des moments précieux, dont pourra également profiter la mère. De sa naissance à son entrée en maternelle à l’âge de 3 ans, un enfant demande beaucoup d’attention et a besoin de ses deux parents.
Quand j’entends des discours incroyables pour notre temps, je dis non ! En arrivant le matin, je croise beaucoup de pères avec des poussettes, qui s’occupent de leurs enfants. Certes, cette mesure aura peut-être un coût pour la sécurité sociale, mais les pères travaillent et cotisent.
Notre société est décadente à certains moments parce que beaucoup d’enfants n’ont pas la chance d’avoir à leurs côtés un père pour les éduquer. Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement voient des parents vraiment défaillants, parce qu’ils sont seuls. La plupart du temps, il s’agit de mères.
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de changer les choses. Il faut qu’on prenne la mesure de la situation dans laquelle se trouve notre société et que l’on comprenne qu’il est nécessaire que les pères aient une vraie place auprès de leurs enfants et de leur femme.

Je tiens d’abord à rassurer M. le secrétaire d’État : je ne boude pas mon plaisir ! Ce congé constitue bien une belle et grande avancée, je n’ai aucune difficulté à le reconnaître. J’espère simplement qu’elle sera suivie d’autres progrès et que l’on ira beaucoup plus loin. C’est ce que j’ai voulu dire tout à l’heure. Nous avons encore du travail.
Ma collègue Frédérique Puissat, qui est comme moi de l’Isère, dit que personne n’est venu toquer à la porte de sa permanence pour lui demander un allongement de la durée du congé de paternité. Je n’ai pas les mêmes retours qu’elle. Je pense que ce congé répond à une réelle attente de la société, mais aussi des associations familiales que nous rencontrons tous. Il est nécessaire de répondre à cette aspiration de la société et de passer réellement à l’acte.
Une chose m’étonne dans ces amendements. On entend souvent parler de la famille sur les travées de la droite, mais l’intérêt de la famille s’arrête souvent là où commence celui de l’entreprise ! Je pense qu’il faut remettre l’intérêt de la famille et de l’enfant au centre. Tel est clairement l’objet de cet article.
Par ailleurs, le caractère obligatoire de la mesure me paraît indispensable. Ça aussi, c’est une réelle avancée. On a évoqué le taux de recours : six pères sur dix ne prennent pas leur congé parental !
J’ai moi aussi été chef d’une toute petite entreprise, de trois salariés. Je puis vous garantir que l’on arrive à s’organiser lors des congés maternité, et c’est heureux. Il n’y a pas de raison de ne pas y parvenir lors d’un congé paternité.

Je ne veux pas être dans la caricature. En tant que sénateurs, nous pouvons avoir des discussions posées, dans le respect de chacun.
Je tiens à revenir sur les propos de M. Iacovelli. Cet amendement a été travaillé avec la CPME et avec les chefs des petites et moyennes entreprises. Vous dites, cher collègue, que ce congé ne pose pas de difficulté ; pour ma part, je n’en suis pas certaine !
En revanche, monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos propos et je les respecte. Il est d’ailleurs important que nous nous respections les uns et les autres. J’y insiste, car j’ai lu quelques tweets sur nos amendements et j’ai été très étonnée de la violence des messages caricaturaux d’un certain nombre de parlementaires – plutôt des députés, pas des sénateurs.
J’entends que vous allez reprendre contact avec les organisations syndicales, le MEDEF et la CPME, monsieur le secrétaire d’État. Je retire donc mon amendement, mais j’aimerais que vous abordiez cet aspect de la question avec eux, comme ne manquera pas à mon avis de le demander la CPME, avec qui j’ai travaillé sur cet amendement. Je le dis très honnêtement : la temporalité n’est pas bonne.

L’amendement n° 312 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Je remercierai, pour commencer, Élisabeth Doineau de ses propos extrêmement touchants et sincères. C’est avec beaucoup de plaisir, j’en suis sûre, que je lirai Boris Cyrulnik. Elle est parfaitement dans son rôle de rapporteure pour la branche famille, qui lui convient très bien.
Néanmoins, je ne voterai pas l’article 35. Je suis très ennuyée : on fait comme si la société n’était composée que de salariés. Or notre société est traversée de très graves fractures, particulièrement en ce moment. Actuellement, il y a deux catégories de gens : ceux qui ont la chance d’être salariés et ceux qui n’ont pas la chance de l’être. On va agrandir encore ce fossé. Nous connaissons tous autour de nous des professionnels du secteur libéral ou des agriculteurs. Seraient-ils de mauvais parents parce qu’ils n’ont pas la possibilité de prendre des journées de congé ?
Je ne peux pas voter cet article, mais je souhaitais m’en expliquer.

Il ne faut pas faire de procès d’intentions. J’ai compris quel était le souci de Frédérique Puissat. Cependant, je voterai cet article.
J’ai une question à poser à M. le secrétaire d’État. J’ai été femme de militaire et ma fille est née alors que mon mari était en opérations extérieures au Kosovo. Il n’est revenu que trois mois après sa naissance. Dans une situation semblable, les militaires auront-ils droit à ce congé comme tous les pères, deux ou trois mois après la naissance ? La question ici porte non pas sur un fractionnement du congé, mais sur la possibilité de le prendre plusieurs mois après.
Je vous fais part de mon expérience. J’aurais été très heureuse que mon mari soit à mes côtés dans ce moment si précieux.

Je voterai quant à moi l’article 35, qui me paraît extrêmement important, mais je ne voterai sûrement pas les amendements visant à réduire la portée de cette avancée sociale. Je souhaite néanmoins revenir sur deux ou trois points.
Ce congé est en effet une attente forte de la société. En revanche, je préférerais que l’on dise qu’il participera au développement harmonieux de l’enfant plutôt que de dire qu’il le conditionnera. Mon père était mineur de fond et je ne l’ai pas beaucoup vu. Pour autant, je n’ai pas eu le sentiment d’avoir un développement disharmonieux. Il faut donc faire attention à ce que l’on dit et à la façon dont on le dit.
Par ailleurs, il ne suffit pas d’affirmer qu’il s’agit d’une avancée sociale majeure, ce que je veux bien croire, et je suis prêt à en défendre l’idée, il faut aussi, dans le même temps, faire en sorte qu’elle puisse être pérenne. À cette fin, il importe d’assurer l’avenir de la sécurité sociale. Or, pour l’instant, je ne vois dans le présent PLFSS, je l’ai dit lors de la discussion générale, que des milliards de déficits pour les années 2020 et 2021 et aucune solution susceptible de garantir la pérennité de cette mesure. Ce point m’inquiète un peu.
Enfin, je suis complètement d’accord pour parler de l’intérêt des familles, comme mon collègue de l’Isère, mais alors pourquoi cautionner la baisse du quotient familial et la suppression de l’allocation jeune enfant ?

J’allais dire à peu près la même chose qu’Alain Milon, exception faite de la fin de son intervention.
Je remercie Frédérique Puissat d’avoir retiré son amendement. Il était certes important de signaler le point que vous avez soulevé afin qu’il soit discuté lors des négociations, comme le secrétaire d’État s’y est engagé, mais il était aussi important que les discussions ne freinent pas cette véritable avancée.
Personnellement, je me place – et c’est ma petite différence avec Alain Milon – du côté de la famille et de l’enfant. Je me réjouis donc de cette avancée.
À tous ceux qui s’inquiètent des difficultés qui pourraient apparaître, par exemple pour les indépendants ou les miliaires, je pose la question : faut-il ne pas avancer parce qu’il faudrait régler des difficultés pour d’autres ? Réjouissons-nous d’abord de ce pas en avant, et faisons en sorte ensuite d’en faire bénéficier tout le monde. C’est un très bel article. Je remercie donc vivement ceux qui ont retiré leurs amendements.

Nous remercions tous Mme Puissat d’avoir retiré son amendement, ou en tout cas une grande partie de l’hémicycle. Elle s’étonnait de la violence des réactions qu’il avait suscitées, mais elles sont normales !
D’après les termes de son amendement, tout le monde n’aurait pas les mêmes droits dans les jours clés qui suivent la naissance d’un enfant, ces droits dépendant du niveau d’insertion économique du père. En situation de précarité, certains n’auraient pas les mêmes droits que les autres dans un moment aussi essentiel pour les parents et pour l’enfant ! Il est donc logique que cet amendement ait provoqué de telles réactions, dont vous semblez d’ailleurs avoir pris toute la mesure.
J’entends les remarques formulées sur les indépendants. Un des points essentiels de notre travail collectif sera d’aligner les droits sociaux des travailleurs indépendants, qui sont souvent des travailleurs précaires, sur les droits des salariés. Ce sera l’un de nos grands chantiers à l’avenir. Il va même falloir avancer vite, car beaucoup de travailleurs indépendants sont d’abord des travailleurs précaires.
Enfin, pour conclure, mais nous aurons tout le temps d’en rediscuter, si vous voulez rééquilibrer le budget de la sécurité sociale, nous pouvons vous faire plein de propositions de tranches supplémentaires : ne vous inquiétez pas, on peut y arriver !

J’indique à ma collègue Nadia Sollogoub que le congé de paternité est accessible aux indépendants, ainsi qu’aux salariés et aux non-salariés agricoles, à condition – c’est la seule différence – qu’ils se fassent remplacer. Certes, le statut n’est pas le même que celui d’un salarié, mais l’article s’applique bien à l’ensemble des travailleurs. Une ordonnance sera prise pour les agents publics. Sans doute faudra-t-il y inscrire les militaires, qui n’ont nulle raison d’être exclus du dispositif.

Il était important d’ouvrir le débat. J’ai parfaitement entendu vos réponses, monsieur le secrétaire d’État. Si je puis me permettre, je vous invite à poursuivre vos négociations avec les organisations syndicales.
Rassurez-vous, je voterai l’article 35. Mon amendement, que je retire, ne portait que sur les modalités de mise en œuvre du congé de paternité.

L’amendement n° 618 rectifié quinquies est retiré.
Madame Gruny, l’amendement n° 594 rectifié est-il maintenu ?

L’amendement n° 594 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1020, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir un fractionnement du congé au-delà du quatorzième jour. » ;
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

L’extension du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à vingt-huit jours est une mesure positive. Nous voterons cet article, même si nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas retenu l’ensemble des propositions du rapport sur les 1 000 premiers jours, notamment celle de ne pas limiter à vingt-huit jours la durée du congé de paternité.
Avec cet amendement, nous proposons une amélioration supplémentaire : il vise à rendre une partie du congé fractionnable au-delà d’une première période de quatorze jours calendaires. Ce fractionnement serait cautionné à un accord d’entreprise.
Le fractionnement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant permettrait ainsi d’offrir une plus grande souplesse d’organisation aux parents, tout en leur laissant la possibilité de s’impliquer plus activement à différents moments dans les semaines suivant la naissance.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez répondu à nos collègues députés que « l’idée du fractionnement est intéressante, mais fait actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux », ce que vous avez réaffirmé devant nous ce soir. Vous avez conclu ainsi vos propos devant l’Assemblée nationale : « d’ici à la nouvelle lecture du PLFSS, je reviendrai vers vous pour vous communiquer le résultat des négociations ». Nous souhaiterions a minima, à l’occasion de cet amendement, savoir où en sont ces négociations.

Cet amendement vise à prévoir la possibilité de fractionner le congé au-delà du quatorzième jour par accord d’entreprise ou de branche. Or l’article ne l’interdit pas, comme l’a d’ailleurs expliqué M. le secrétaire d’État. Les modalités de fractionnement seront fixées par décret, en concertation avec les partenaires sociaux.
Je cède maintenant la parole au Gouvernement pour répondre à votre question. Je précise au préalable que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
J’espère que Mme Puissat n’a pas eu le sentiment que je lui manquais de respect. Je respecte évidemment la position de chacun, mais il m’arrive parfois d’être fougueux dans mes argumentations.
Monsieur Milon, vous avez totalement raison. Il s’agissait d’un écart de langage : le congé paternité ne conditionne pas le bon développement de l’enfant, il y participe. Il importe, pour toutes les mesures d’accompagnement à la parentalité que nous proposons dans le cadre des 1 000 premiers jours, qu’il s’agisse du congé de paternité ou d’autres mesures, de se tenir systématiquement sur une ligne de crête par rapport aux parents et de ne pas les culpabiliser.
Vous savez parfaitement, monsieur Milon, car vous êtes médecin, que tout ce qui s’abîme facilement dans le cerveau d’un enfant à cet âge se répare tout aussi facilement. Rien n’est définitif, tout ne se joue pas au cours des 1 000 premiers jours, fort heureusement ! Je vous remercie donc de m’avoir repris, car nous ne voulons pas que les parents aient ce sentiment-là.
Je vous rassure, madame Guidez, un certain nombre d’adaptations seront prévues, notamment pour les militaires. Il ne saurait être question de demander à un militaire qui part en opérations militaires extérieures de poser ses sept jours. Tout cela fera l’objet d’adaptations, comme c’est souvent le cas pour les militaires, du moins je l’espère, car je ne maîtrise pas totalement cet aspect.
Madame Apourceau-Poly, je répète ce que j’ai déjà dit : ces sujets sont en cours de discussion. C’est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.
Où en sommes-nous ? Comme je l’ai indiqué, quatre rencontres au niveau technique et au niveau plus politique ont été organisées entre la ministre Élisabeth Borne, moi-même et les différents représentants syndicaux.
Sans m’avancer sur des décisions qui ne sont pas encore prises ni m’exprimer au nom d’autres personnes, je puis d’ores et déjà vous annoncer que nous sommes globalement d’accord sur le délai de prévenance. Idem pour le délai de prise de congé : il n’y a pas de demande particulière pour qu’il soit porté de quatre à six mois. Tous ces points, qui ne sont pas encore arbitrés, ne suscitent pas de crispations.
La vraie question, mais qui n’est pas non plus un sujet de tension, c’est celle du fractionnement, car il s’agit une fois de plus de répondre à différents objectifs. Se pose effectivement la question des indépendants. Le fait de pouvoir fractionner le congé ne résoudra pas toutes leurs difficultés, mais leur offrira du confort et de la souplesse. Ils pourront bénéficier de ce congé en plusieurs fois.
Nous avons aussi évoqué les problèmes d’organisation, car il ne faut pas, en effet, que la multiplicité des fractionnements désorganise l’entreprise.
Il sera obligatoire de prendre un congé de sept jours à la naissance de l’enfant, mais il pourra être intéressant pour le père de prendre le reste plus tard, par exemple au moment où la mère reprend son travail. On sait que cette période, qui correspond à l’entrée de l’enfant à la crèche, est un peu délicate. Il est important que le père puisse être présent dans ce moment d’adaptation.
Par ailleurs, un des gros sujets de réflexion sur la période des 1 000 jours, dont nous débattrons peut-être un jour, c’est la dépression post-partum, qui demeure aujourd’hui un tabou dans notre pays. Or elle touche 15 % à 20 % des femmes, probablement le double. On sait que les pics de dépression post-partum surviennent notamment à la cinquième puis à la douzième semaine.
Le congé paternité ne résoudra pas tout, car il s’agit d’un problème bien plus large – c’est tout l’objet de notre réflexion sur les 1 000 jours –, mais il peut constituer un élément de réponse.
C’est entre tous ces éléments-là que nous devons arbitrer. Nous reparlerons des discussions avec les partenaires sociaux lors de la nouvelle lecture du PLFSS.

À la lumière de ces précisions et de celles de la commission, je retire mon amendement.

L’amendement n° 1020 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 449 rectifié quinquies, présenté par Mme Deseyne, MM. Retailleau et Cambon, Mme Lassarade, MM. Boré, Le Rudulier et Panunzi, Mmes Puissat et Belrhiti, MM. B. Fournier et Grosperrin, Mmes Dumas et Deromedi, MM. Cardoux, Segouin et Duplomb, Mme Gruny, MM. Piednoir, Bascher et Meurant, Mmes Thomas et Lopez, MM. Bonhomme, Saury, Rapin et Mandelli, Mme Estrosi Sassone, M. Savary, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Pointereau, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Regnard et Chevrollier, Mme Chauvin et M. Babary, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Cet amendement vise à prévoir un assouplissement dans l’application du dispositif, nullement à remettre en cause l’allongement de la durée du congé de paternité. Notre objectif est que l’on respecte la liberté de choix des pères.
Je suis d’accord avec vous tous : l’enfant a besoin de ses deux parents, et ce dès les premiers jours de sa vie. Néanmoins, je pense que lever le caractère obligatoire de cette mesure ne réduira pas sa portée, bien au contraire. Si les pères peuvent choisir librement de prendre ce congé, ils le feront au moment le plus opportun pour eux, pour leur enfant et pour la mère de leur enfant.
De la même façon que l’on respecte la liberté des femmes dans leur choix d’accouchement – je fais référence à l’article 30 dont nous avons débattu –, je souhaite que l’on puisse donner aux pères le choix de prendre ce congé au moment où ils le souhaitent, dans la limite des quatre mois.
Quelques questions restent en suspens. Vous les avez abordées, monsieur le secrétaire d’État, comme certains de mes collègues. Quid des saisonniers, des artisans, des intermittents du spectacle, des militaires, par exemple, dont l’enfant naîtrait en pleine période d’activité professionnelle ?

Des réponses restent encore à apporter les concernant.
Cet amendement vise donc à assouplir le dispositif en levant le caractère obligatoire du congé paternité, sans pour autant remettre en cause son allongement.

L’amendement n° 602 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumas, MM. Houpert et Decool, Mmes Lavarde, Loisier et Deromedi, MM. Cambon et Calvet, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Thomas, MM. Bascher, Laménie et Boré, Mme Estrosi Sassone et MM. Cazabonne et Regnard, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après le mot :
familiaux
insérer les mots :
prévu à l’article L. 3142-1, à l’exception des 3° et 3° bis de ce même article,
La parole est à Mme Pascale Gruny.

Le PLFSS introduit une interdiction d’emploi du salarié à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Il prévoit, en outre, que cette interdiction d’emploi ne débute, le cas échéant, qu’à compter de l’issue de la période de congés payés ou de congé pour événements familiaux.
Or le congé de naissance et le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption font eux-mêmes partie des congés pour événements familiaux. Une lecture littérale de ce texte pourrait donc décaler l’interdiction d’emploi à l’issue du congé de naissance ou du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, ce qui est contraire à l’esprit du texte.
L’évocation imprécise de l’ensemble des congés pour événements familiaux dans cet alinéa place les salariés bénéficiaires et leurs employeurs dans une insécurité juridique quant à l’application de l’interdiction d’emploi.

L’amendement n° 449 rectifié quinquies vise à supprimer le caractère obligatoire du congé de naissance et des quatre premiers jours du congé de paternité.
Je sais que ce sujet fait débat, nous avons eu cette discussion en commission : on peut tout à fait plaider pour laisser la totale liberté de choix au père de prendre ou non son congé, comme vous l’avez souligné. Sauf que certains salariés aimeraient le prendre, mais n’osent pas le demander, compte tenu de la situation de l’entreprise, comme je l’ai expliqué. Le taux de recours à ce congé est de 67 %, mais quand on interroge ceux qui ne prennent pas leur congé de paternité, on s’aperçoit que jusqu’à 25 % d’entre eux ne le demandent pas par peur d’affronter leur patron. Il faut en tenir compte.
Rendre obligatoire une petite partie des jours – soit sept jours sur vingt-huit – me paraît donc utile afin que le recours à ce congé puisse être effectif, dans l’intérêt du jeune enfant. C’est d’ailleurs un désir exprimé par la plupart des jeunes parents aujourd’hui.
De surcroît, je ne pense pas que ce congé déstabilisera outre mesure les entreprises, qui doivent déjà gérer de nombreux autres congés, dont certains sont beaucoup plus longs. Je rappelle que 67 % des pères prennent déjà le congé de paternité. Comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, c’est une question d’organisation. Le salarié doit prévenir le chef d’entreprise au moins un mois à l’avance. Pourquoi imposerait-on plus d’obligations au père qu’à la mère qui demande son congé de maternité ? C’est ce qui me choque le plus ici. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 449 rectifié quinquies.
L’amendement n° 602 rectifié vise à préciser les conditions d’interdiction d’emploi. L’article 35 prévoit que l’interdiction d’emploi du salarié pendant le congé peut débuter après la prise d’un congé payé ou pour événement familial si le salarié se trouve dans cette situation au moment où intervient la naissance.
L’amendement vise à exclure de ces situations le congé de naissance et les trois jours de congé d’adoption. Or je précise que le congé d’adoption n’est pas concerné par le caractère obligatoire prévu dans le présent article. En outre, un salarié en congé d’adoption peut très bien être éligible à un congé de naissance au même moment – au titre d’un autre enfant, par exemple. Il ne me semble donc pas souhaitable d’exclure ces congés des situations permettant de différer l’interdiction d’emploi au titre du congé de naissance, car cela risque d’être trop restrictif. J’émets donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 602 rectifié.
Je suis défavorable, sensiblement pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer Mme la rapporteure, à l’amendement n° 602 rectifié.
Si nous insistons sur le caractère obligatoire du congé, je l’ai évoqué, c’est parce qu’il existe des phénomènes d’autocensure. La réalité est que, en fonction de votre situation professionnelle, vous ne prenez pas le congé de paternité de la même façon.
J’ai discuté avec nos homologues du Québec et du nord de l’Europe. Le Québec, la Suède, la Finlande ont une approche globalisée de tous les congés parentaux. C’est d’ailleurs intéressant, il faudra que l’on examine tout cela de plus près. Quand on discute avec eux du congé paternité, tous disent que c’est son caractère obligatoire qui a changé la donne : grâce à cela, les hommes l’ont pris davantage et le genre n’est plus devenu un biais dans les entreprises.
J’ai pris un petit-déjeuner un matin avec des papas suédois : ils m’ont dit que, en Suède, lorsqu’un chef d’entreprise reçoit deux CV, celui d’un homme et celui d’une femme, il n’y a plus de biais, car il sait que tous deux prendront leurs congés, quoi qu’il arrive. C’est ça l’égalité, c’est ainsi qu’on y arrivera !
Très sincèrement, j’espère que le monde de demain se rapprochera du monde idéal et que la question du caractère obligatoire de ce congé ne se posera même plus parce que les pères le prendront : ce sera devenu la norme.
Néanmoins, je pense que, aujourd’hui, le rôle de la loi – celle sur la parité a été évoquée tout à l’heure – est aussi d’accompagner la société dans ses évolutions. C’est également votre rôle en tant que législateur. Dans quelques années, les entreprises auront compris que la politique familiale d’une entreprise est un facteur d’attractivité pour les salariés. D’ailleurs, un certain nombre d’entreprises savent déjà que mettre en place des mesures pour la famille permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle est une façon d’attirer les meilleurs éléments.
Vous parlez de liberté, madame la sénatrice, et j’aurais dû commencer par là parce que c’était le début de votre argumentation. Selon vous, les jeunes pères devraient avoir la liberté de choisir. Je respecte totalement cette approche, mais qu’en pense la mère ? Qu’en pense l’enfant ?
Détrompez-vous, les jeunes pères auxquels vous vous référez – je ne veux pas non plus en faire un phénomène générationnel – appellent très majoritairement de leurs vœux – plus de neuf jeunes pères sur dix – cet allongement de la durée du congé de paternité. Selon une étude de la Fondation des femmes, sept hommes sur dix âgés de moins de 35 ans sont favorables à un congé obligatoire de six semaines. La grande majorité des Français, soit huit sur dix, sont également pour l’allongement de la durée du congé de paternité. Par ailleurs, environ 55 % des Français considèrent que le caractère obligatoire de la mesure est une bonne chose. Ce taux atteint même 65 % dans les catégories populaires.
Le caractère obligatoire de la mesure me paraît donc nécessaire. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 449 rectifié quinquies.

Je suis tout à fait ouverte aux discussions, mais je soutiendrai l’amendement n° 449 rectifié quinquies, et ce pour une raison bien simple : j’ai eu à connaître dans mon entourage professionnel proche de jeunes couples de moins de 30 ans ayant eu des bébés.
Il est arrivé à un couple, au moment où la maman devait reprendre son travail à l’issue de son congé maternité, de ne pas avoir de solution de garde, la nounou n’étant pas disponible. Le papa a alors décidé de prendre son congé de paternité pour s’occuper du bébé. Les parents étaient ravis. Le papa était magnifique à voir : il se sentait pleinement investi, car il s’occupait du bébé toute la journée. C’est dans de tels moments que se construit le lien dont on parlait.
Souvent, le papa a l’impression que s’il doit être présent les sept premiers jours avec la maman, c’est parce qu’il ne serait pas capable de s’occuper seul de son bébé. Il est donc très positif qu’il puisse s’en occuper seul et passer des moments privilégiés avec lui. C’est également positif pour les jeunes couples.
J’ai vu de jeunes papas s’épanouir en gardant leur bébé pendant les onze jours de congé auxquels ils avaient droit. Leur imposer un congé les sept premiers jours ne me convient donc pas.

Je ne voterai pas ces deux amendements, même si je comprends les arguments de mes collègues. Le caractère obligatoire du congé de paternité permettra – cela a été dit à plusieurs reprises – d’ouvrir la porte à des pères qui ne feraient pas cette démarche sans cela. Je salue aussi l’avancée que constitue le texte en matière d’adoption. Je voterai donc l’article.

Je ne voterai évidemment pas ces amendements, mais je cède à la tentation de contrarier un peu M. le secrétaire d’État !
Quand on fait des comparaisons avec d’autres pays, il faut les faire à tous les niveaux. Je ne conteste pas le fait que les populations d’Europe du Nord aient accepté de manière satisfaisante les mesures qui ont été mises en place dans leurs pays et que cela pourrait nous servir d’exemple en France.
Toutefois, il faudrait aussi considérer le taux de natalité de ces pays : il est à 1, 57 pour mille en Allemagne ; à 1, 73 au Danemark ; à 1, 41 en Finlande ; il atteint heureusement 1, 91 pour mille en Suède ; et il est à 2, 01, en France, où le congé de paternité n’existe pas, jusqu’à présent.
Madame la sénatrice Jacques, j’ai bien entendu ce que vous nous avez dit sur le cas concret que vous avez pris comme exemple.
Le dispositif que nous envisageons, à ce stade, rend justement cette situation possible. Les sept premiers jours du congé seront obligatoires au moment de la naissance, moment essentiel qui constitue en outre un fait générateur, du point de vue juridique. Ensuite, modulo les possibilités de fractionnement qu’il faudra peut-être ouvrir encore davantage, les vingt et un jours de congé qui restent pourront être pris plus tard, notamment – comme je le disais –, au moment où la mère reprend son travail et où l’enfant entre éventuellement dans une structure collective.
Enfin, monsieur Milon, j’ai simplement dit qu’il était intéressant de faire des comparaisons avec d’autres pays – et je sais que vous le pensez aussi – et non pas évidemment qu’il fallait dupliquer systématiquement les choses. J’espère ne pas devoir déduire de vos propos qu’il y aurait une corrélation absolue et parfaite entre l’existence d’un congé paternité, sa durée et le taux de natalité.
Pour en revenir au quotient familial et aux allocations que vous mentionniez, vous savez probablement que ces avantages fiscaux sont de moins en moins corrélés au taux de natalité, dont l’évolution dépend surtout de l’environnement global dans lequel l’enfant est accueilli. La durée du congé de paternité en fait partie.

J’ai cosigné l’amendement présenté par Chantal Deseyne, et je voudrais la remercier d’avoir introduit ce débat important, qui permettra de lever un certain nombre d’incertitudes.
Monsieur le secrétaire d’État, je dois dire que votre approche du sujet est relativement convaincante, mais celle de Chantal Deseyne ne l’est pas moins, qui prévoit un stade facultatif pour le congé paternité, de façon à lever les difficultés, notamment celles qui sont liées à la nécessité d’offrir un dispositif égal pour tous. Que le père soit en CDI ou en CDD, comme vous l’avez dit, qu’il soit militaire ou qu’il exerce une profession indépendante, il doit pouvoir prendre son congé, selon l’organisation de son travail et de sa famille.
La politique familiale est un sujet complexe et l’on ne peut pas lui redonner une place au sein de la société sans tenir compte des divergences d’approche.
Si l’on doit retenir du quinquennat l’inscription dans la loi de ces quelques jours supplémentaires de congé de paternité, sans aucune autre mesure pour construire une politique familiale qui rende les Français plus heureux, je ne pense pas que l’avancée sera aussi considérable que vous la présentez.
Attention, donc, à ne pas décevoir nos concitoyens, en leur présentant cette disposition comme une avancée majeure qui changera la société ! La politique familiale en sortira-t-elle changée ? Vous l’améliorerez, sans doute, sans vraiment la transformer.
Est-ce que les dispositions sur la cinquième branche changeront la vie des personnes âgées, pour peu qu’elles soient accompagnées des financements et des mesures territoriales nécessaires à leur mise en œuvre ? Je n’en suis pas entièrement convaincu, car il faudrait d’abord que le Gouvernement s’attache à faire en sorte que le dispositif corresponde aux préoccupations des gens.
Donc, les deux approches se défendent. Je suis plutôt favorable à un dispositif facultatif, dans un premier temps, puis éventuellement obligatoire, si l’on constate que les pères ne prennent pas suffisamment leur congé. Vous préférez le rendre obligatoire d’emblée, pour les inciter à prendre davantage ce congé. Les deux thèses se tiennent et je me rallierai à celle qui l’emportera.
La volonté partagée qui doit nous réunir, c’est de faire en sorte qu’il existe un congé paternité. En effet, le rôle du père est important et il faut l’étendre. C’est la raison pour laquelle, quel que soit le destin de cet amendement, nous voterons largement l’article 35.

Je mets aux voix l’amendement n° 449 rectifié quinquies.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et, l’autre, du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 602 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 896 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et Pantel et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès de toutes les familles au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au coût que représenterait l’égal accès des couples d’hommes à ces droits.
La parole est à M. Stéphane Artano.

Dans d’autres circonstances, j’aurais presque été gêné de présenter un amendement qui demande encore un rapport : je connais, en effet, la doctrine à ce sujet. Néanmoins, celui-ci vaut la peine qu’on s’y attarde.
L’article L. 1225-35 du code du travail ouvre le droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant au compagnon ou au partenaire de la mère, qui n’est pas le père biologique de l’enfant, dans le cadre d’un couple hétérosexuel, ainsi qu’à la compagne ou épouse de la mère, dans le cadre d’un couple homosexuel.
Le fait de réserver l’attribution du deuxième congé de paternité et d’accueil de l’enfant uniquement à la femme et à l’homme liés à la mère exclut donc directement de cet avantage l’homme qui vivrait maritalement avec le père, qui serait pacsé avec lui, ou qui serait son époux. Cela constitue, de notre point de vue, une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, qui heurte les valeurs humanistes que porte le groupe du RDSE.
Nous avions donc déposé un amendement qui tendait à modifier directement l’article L. 1225-35 du code du travail et à étendre le bénéfice du congé de paternité aux couples de même sexe masculin. Il a malheureusement été déclaré irrecevable. Cette modification aurait pourtant évité à la France le risque de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est pourquoi Maryse Carrère présente cet amendement de repli, qui vise à demander un rapport sur le caractère discriminatoire des dispositions de l’article L. 1225-35 du code du travail pour les couples d’hommes, et sur le coût que représenterait pour les finances publiques la mise en conformité de cette disposition avec, d’une part, les prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et avec, d’autre part, la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

La Défenseure des droits nous a effectivement alertés au sujet de cette discrimination. Cependant, l’amendement que Maryse Carrère et d’autres ont déposé est irrecevable.
De plus, vous savez que toute demande de rapport est malvenue, puisque la commission en a déjà refusé beaucoup, qui avaient sans doute autant d’intérêt que celui que vous proposez.
Par conséquent la commission émettra un avis défavorable sur votre amendement.
Pour autant, je partage votre préoccupation, tout en précisant que des dispositions différentes sont prévues pour les couples homosexuels qui adoptent.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas de modifier les conditions actuelles du bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ce congé peut être attribué aux parents qui justifient d’une pièce d’état civil attestant la filiation de l’enfant, ou bien le lien avec la mère, si le parent n’est pas le père de l’enfant.
De plus, les dispositions relatives au congé de paternité et d’accueil de l’enfant – il faut rappeler le nom complet du dispositif – ne visent pas à redéfinir les règles de filiation.
Enfin, la rapporteure a précisé à juste titre que dans le cas d’une adoption par des couples de même sexe, ce sont les règles du congé d’adoption qui s’appliquent. Si ce congé est partagé, il sera augmenté de la durée du congé de paternité. Le cas de figure que vous mentionnez est donc déjà pris en considération, un régime adapté est prévu.

J’avais déposé un amendement similaire qui a également été déclaré irrecevable. Il visait à remplacer le terme de « paternité » par celui de « parentalité » pour adapter le texte à la réalité diverse des familles. En effet, qu’on l’accepte ou pas, les familles sont diverses, et elles doivent toutes bénéficier des mêmes droits. Par conséquent, il est important que les dispositions de cet article s’appliquent aussi au deuxième parent, au même titre que pour les autres pères de famille.
Même si j’ai peu d’espoir que cette demande de rapport aboutisse, je soutiendrai à titre personnel l’amendement de Mme Carrère, car la reconnaissance de l’ensemble des familles est un enjeu fort de ce débat. Le fait que nous ayons un secrétaire d’État chargé de l’enfance et « des familles » a d’ailleurs toute son importance.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 936, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt d’étendre la durée obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à au moins la moitié de ce congé, ainsi que sur l’intérêt de rendre la durée totale des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant égale à neuf semaines, notamment au regard des considérations de santé publique pour les mères, d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et dans les foyers et d’intérêt pour l’enfant et son éducation.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Fidèles à la conviction que nous devons faire, dans ce pays, un grand pas en avant en matière de congé de paternité, nous saluons les premiers pas, non pas de l’enfant, mais ceux effectués dans l’article 35.
Cet amendement tend lui aussi à prévoir la remise d’un rapport, que la longueur du débat suffirait à justifier. Ce rapport étudiera la possibilité d’étendre la durée obligatoire du congé de parenté, pour protéger celui qui en bénéficie de toute pression ou mise en concurrence destinée à favoriser son retour précoce au travail.
Il portera également sur la possibilité d’étendre la durée totale du congé de naissance et du congé de paternité à neuf semaines, de manière à la rapprocher de celle du congé maternité post-natal, en conformité avec les recommandations du rapport sur les 1 000 premiers jours de l’enfant, que vous avez cité.
L’étude que nous demandons pourrait notamment évaluer l’impact que ces deux pistes auront sur le taux de non-recours au congé paternité.
En effet, l’extension du congé paternité et sa durée obligatoire constituent des arguments forts pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Un grand écart entre la durée obligatoire du congé maternité, à savoir huit semaines, dont six après l’accouchement, et celui du congé paternité, soit sept jours après la naissance de l’enfant, maintiendrait indirectement un message genré. Il reviendrait in fine aux mères d’assumer le premier accueil de l’enfant, car l’autre parent bénéficierait du caractère facultatif de l’obligation.
Or une telle répartition entraîne des conséquences lourdes, telles que l’épuisement maternel, la dépression post-partum, la discrimination professionnelle, ou encore l’inégalité d’accès au travail. Voilà pourquoi il est nécessaire de travailler le sujet, en adoptant les deux angles que nous proposons.
Par ailleurs, nous avions nous aussi déposé un amendement qui a été jugé irrecevable. Nous souhaitions qu’il soit inclusif, pour tenir compte de l’ensemble des compositions familiales. Il prévoyait donc un congé de « parenté » plutôt que de « paternité ». Il faudra régler, un jour, cette question de sémantique inclusive.

Vous connaissez le sort que nous réservons aux demandes de rapport. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Cependant, je me tourne vers M. le secrétaire d’État pour lui demander de travailler très sérieusement sur le congé parental, qui n’est pas du tout utilisé, sans doute parce que la rémunération des parents qui le prendraient n’est pas suffisante pour assurer le confort de la famille.
Par ailleurs, l’allongement de la durée du congé de paternité n’était que l’une des recommandations du rapport de Boris Cyrulnik. J’espère donc que nous n’en resterons pas là. Il faudrait en effet lancer un travail avec les départements sur la nouvelle dynamique à donner aux centres de protection maternelle et infantile (PMI). Les PMI ont déjà beaucoup travaillé sur la parentalité et l’accueil du jeune enfant, mais elles ont besoin d’un nouveau souffle. Certains les enterrent un peu vite, alors que ces centres ont toute leur utilité sur le terrain.
L’accueil du jeune enfant est un autre domaine dans lequel il faut œuvrer, car les différentes conventions d’objectifs et de gestion n’ont jamais été atteintes en nombre.
Il serait donc dommage de réduire le rapport de Boris Cyrulnik à une seule de ses recommandations.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Madame la rapporteure, je vous promets que nous allons travailler sur tous ces sujets, mais nous le faisons déjà un peu.
Sourires.
En effet, un certain nombre des dispositions qui figurent dans ce texte sont la mise en œuvre des recommandations du rapport Cyrulnik. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais ces mesures ne sont pas toutes formellement inscrites dans les lignes du texte que vous votez.
Grâce à ce PLFSS, nous mettons en place un « parcours 1 000 jours », qui s’articule autour de trois moments.
Le premier est l’entretien prénatal précoce, dont vous aviez voté le caractère obligatoire, mais qui n’est pris que par 28 % des femmes aujourd’hui. Or ce texte prévoit une enveloppe de trois millions d’euros pour les réseaux de santé périnatale, pour faire connaître l’entretien prénatal précoce aux femmes.
Le deuxième moment, il est important, est celui de la maternité. Nous allons créer immédiatement cent postes pour renforcer les staffs médicaux psychosociaux d’une centaine de maternités prioritaires, afin de mieux accompagner les femmes et de mieux articuler la coopération entre la maternité et les PMI.
Vous savez, par ailleurs, que dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance, je suis un grand promoteur des PMI. J’en veux pour preuve que grâce à la contractualisation que nous mettons en place avec les départements, l’État prévoit d’investir 100 millions d’euros dans les PMI, entre 2019 et 2022, soit l’équivalent des aides qu’elles ont perdues au cours des dix dernières années. Je vous renvoie au rapport de Michèle Peyron sur ce sujet.
Le troisième moment, c’est la dépression post-partum. Grâce à ce PLFSS, nous développons les visites à domicile post-partum, différentes du programme Prado. Nous créons aussi une dizaine d’unités mère-enfant et une vingtaine d’équipes mobiles pour prendre davantage en compte la psychiatrie périnatale et mieux accompagner les parents qui souffrent de problèmes psychiques, voire psychiatriques, le tout pour un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros. Telles sont les mesures que vous votez, même si elles restent parfois cachées dans l’épaisseur du trait de ce budget important.
Le rapport Cyrulnik mentionne le congé parental, en effet. L’extension du congé de paternité n’est qu’une première étape, et je suis convaincu, comme vous, que nous devrons mener une réflexion, dans un second temps, sur la refonte totale des projets familiaux, et notamment sur le congé parental. Vous l’avez très bien dit, les femmes ne le prennent que très peu, et quand elles le font, c’est de façon subie, au terme d’un arbitrage économique. Ce congé est très mal rémunéré et il est probablement trop long. Beaucoup de rapports le disent, dont celui de l’IGAS, en 2018, dans lequel figure une analyse assez clinique et juste de la situation.
(Exclamations amusées sur les travées du groupe SER) – camarades, ou anciens camarades, je ne sais plus !
Sourires.
Mes camarades socialistes le savent §–, la réforme du congé parental qui a été introduite sous le quinquennat précédent ne fonctionne pas. Seuls 16 000 hommes prennent aujourd’hui un congé parental.
Le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur l’amendement.
Cependant, j’ai déjà annoncé à l’Assemblée nationale que nous engagerions deux experts, issus notamment du monde de l’entreprise, pour engager une réflexion de long terme, qui s’inspirera de l’expérience plus ancienne des pays d’Europe du nord et qui intégrera la question des modes d’accueil. En effet, vous avez raison, la réforme du congé parental ne peut pas être pensée sans celle des modes d’accueil, les deux étant intimement liées. Nous aurons l’occasion d’en reparler au cours des mois à venir.
Quoi qu’il en soit, madame la rapporteure, je peux vous assurer que nous avons déjà engagé ce travail.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote sur l’article.

J’interviens au nom du groupe Les Républicains.
Monsieur le secrétaire d’État, depuis le début de l’examen de ce PLFSS, beaucoup de grandes réformes ont été annoncées. Nous les comprenons, mais nous avons le sentiment que leur élaboration n’est pas toujours complètement aboutie. C’est notamment le cas de cet article 35, nombre de points restant en suspens.
Plusieurs questions se posent sur la mise en œuvre de cette réforme, notamment pour les indépendants, les familles et les petites entreprises. Il n’y a pas que les grands groupes qui mènent des politiques familiales internes, c’est aussi le cas de PME ou d’artisans. Toutes ces questions restent donc en suspens.
Le groupe Les Républicains aurait souhaité amender cet article 35, notamment sur le caractère obligatoire du congé et la possibilité le fractionner. Nous n’avons pas été entendus – peut-être n’avions-nous pas les bons arguments –, mais, quoi qu’il en soit, notre groupe votera cet article 35.
Au-delà de ce vote, nous regrettons qu’une politique familiale plus globale, de plus grande dimension, ne puisse être portée par ce PLFSS. L’un des sujets importants pour nous est le quotient familial ; en effet – le sénateur Milon l’a dit –, cet article représente certes une avancée pour notre société, mais je crains qu’il ne suffise pas pour relancer la natalité en France, cet enjeu étant fondamental pour notre société.

Je me félicite de la qualité de nos débats ce soir sur cet article, à l’opposé de ce qui s’est passé en commission, où nous avons été passablement maltraités, méprisés. On nous a dit que nous étions irresponsables au motif que cet article constituait l’une des plus grandes avancées depuis l’instauration du droit de vote des femmes.
Je veux donc vous remercier de la qualité de vos réponses, monsieur le secrétaire d’État, et remercier les collègues qui ont déposé des amendements sur des points restant à préciser : les difficultés des petites entreprises et des indépendants, de même que le caractère obligatoire du congé de sept jours. Cette forme d’intrusion dans la vie des familles peut parfois choquer ; notre société devient de plus en plus intrusive, on le voit bien en ce moment.
J’ai fait part en discussion générale de mes inquiétudes. Nous avons envie de faire beaucoup de choses, or nous sommes dans une situation économique et sociale dramatique et nous allons au-devant d’énormes difficultés financières. Je pense qu’il y a des priorités et je ne sais pas si c’était le bon moment de décider d’une telle mesure. Je voterai néanmoins cet article 35.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’article.

Ne boudons pas notre plaisir ; cet article 35 est effectivement très important, il représente une avancée considérable dans la vie des familles, des enfants et des femmes. Le Sénat doit être conscient que, si cet article est adopté, il sera adopté conforme, aucun amendement n’ayant été adopté, il sera donc définitif. Nous apprécions la capacité du Sénat à jouer un rôle très actif pour le progrès de chacun.

Je mets aux voix l’article 35.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et, l’autre, du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés343Pour l’adoption341Contre 2Le Sénat a adopté.
Applaudissements.
Je serai très bref.
Je veux à mon tour vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, de nos échanges de ce soir ; ils étaient effectivement d’une très grande qualité.
Cet allongement de la durée du congé de paternité correspondait à un engagement fort du Président de la République et je suis fier et heureux d’avoir pu le porter à son terme et de passer ces moments avec vous.
À demain pour la suite de la discussion de ce PLFSS !
Applaudissements sur diverses travées.

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 230 amendements aujourd’hui ; il en reste 177.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 14 novembre 2020 :
À dix heures, quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (texte n° 101, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 14 novembre 2020, à une heure.
La liste des candidats désignés par la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. Laurent Lafon, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Max Brisson, Mmes Catherine Dumas, Claudine Lepage, Marie-Pierre Monier et M. Abdallah Hassani ;
Suppléants : M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Elsa Schalck, MM. Olivier Paccaud, Cédric Vial, Lucien Stanzione, Bernard Fialaire et Pierre Ouzoulias.