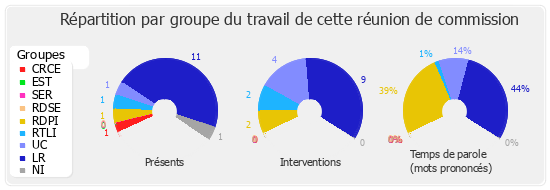Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du 16 novembre 2010 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'examen du rapport pour avis de MM. Pierre André et Thierry Repentin sur les crédits de la mission Ville et logement.

en remplacement de M. Pierre André, rapporteur pour avis. - M. Pierre André m'a prié d'être son porte-parole pour vous présenter les crédits du programme 147 « Politique de la ville » pour 2011, ce que je fais volontiers.
Aujourd'hui, ce sont au total plus de 8 millions de nos concitoyens qui vivent dans un quartier éligible à la politique de la ville. (...) C'est dire l'enjeu de cohésion nationale auquel solidairement, nous devons répondre pour réparer les erreurs du passé notamment en matière d'éducation, de formation, d'habitat, de peuplement et d'infrastructures », rappelaient Pierre André et le député Gérard Hamel en introduction du rapport qu'ils ont remis au Premier ministre en septembre 2009 en tant que parlementaires en mission.
Tout d'abord, retraçons l'évolution des crédits du programme 147 dans le projet de loi de finances pour 2011. Leur nette diminution - moins 13,4 % en autorisations d'engagement (AE) et moins 12 % en crédits de paiement (CP) - ne traduit pas un désengagement de l'État vis-à-vis des quartiers en difficulté (On le conteste à gauche.) De fait, cette diminution s'explique, en grande partie, par la baisse des compensations d'exonérations de charges sociales dans les zones franches urbaines consécutive à la réforme opérée dans la loi de finances pour 2009 et à la réforme de la taxe professionnelle. Ensuite, les dépenses fiscales rattachées au programme progressent de 5 % pour atteindre 470 millions d'euros en 2011. En outre, ce programme représente seulement 26 % des CP destinés à la politique de la ville. Dans leur totalité, ont rappelé les députés François Pupponi et François Goulard, ces derniers ont progressé de 90 % entre 2005 et 2009. Enfin, cette évolution ne remet pas en question les programmes lancés ces dernières années tels que le dispositif « adultes-relais » et les programmes de réussite éducative.
J'en viens au programme national de rénovation urbaine (PNRU). Lancé en 2003, ses objectifs pour la période 2004-2013 étaient ambitieux : 250 000 logements locatifs sociaux nouveaux, 400 000 logements locatifs sociaux réhabilités, 400 000 logements sociaux « résidentialisés » et 250 000 logements locatifs sociaux démolis. S'ils ne seront pas atteints, le bilan du PNRU reste néanmoins très positif. Au 1er octobre, plus de 380 conventions ont été signées. D'après l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), 490 quartiers seront rénovés en 2013, au bénéfice de 4 millions de nos concitoyens. De surcroît, le PNRU a eu un effet levier important : le montant total des investissements dépassera 40 milliards d'euros pour une subvention de l'ANRU de 12 milliards. Bref, le plan a remis en mouvement des territoires qui n'avaient plus de perspectives d'évolution.
Quid de l'après-2013 ? Le lancement d'un « PNRU II » s'impose. Toutefois, son financement devra être clarifié : « Action logement », qui a pris le relais de l'État depuis la loi de finances pour 2009, n'a pas les crédits suffisants pour 2012 et 2013. En outre, la politique de la ville ne se limite pas à la rénovation urbaine : « la rénovation urbaine, ce n'est pas seulement les murs ; c'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est la sécurité, ce sont les infrastructures de transport », a souligné le Premier ministre dans le Val-d'Oise la semaine dernière.
Enfin, dressons un bilan de la réforme de la politique de la ville lancée à la suite de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Le décret de mai 2009 a clarifié le pilotage national de la politique de la ville en distinguant les rôles du Conseil national des villes, du Comité interministériel des villes et du secrétariat général du CIV : au premier revient un rôle consultatif ; le deuxième est l'organe décisionnaire et le troisième l'instance de préparation et d'exécution. Si cette évolution est positive, comme l'a noté notre collègue Philippe Dallier dans un rapport de juin dernier, elle ne règle pas tout. La dimension interministérielle de la politique de la ville reste défaillante. En témoigne la mise en oeuvre de la « Dynamique espoir banlieues ». Pour plus d'efficacité, la politique de la ville doit relever d'un ministère de plein exercice rattaché directement au Premier ministre. Quant à la révision de la géographie prioritaire, annoncée par le Conseil interministériel des villes du 20 janvier 2009, elle a été repoussée par le Premier ministre à 2011. Cette décision, que Pierre André salue, laisse le temps au débat : l'enjeu est de passer d'une logique de zonage, dont le bilan est pour le moins contrasté, à une logique de contractualisation entre le préfet et le maire, pour la durée du mandat municipal. Pour une politique de la ville efficace, il faut concentrer les moyens de l'État sur les communes les plus en difficulté. Les recommandations formulées par Pierre André et Gérard Hamel dans leur rapport sont aujourd'hui largement partagées. Puisse 2011 être l'année du grand débat national que Pierre André appelle de ses voeux !
En conclusion, Pierre André propose à la commission d'émettre un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 147.

La participation de l'État au PNRU s'élève à 6 millions d'euros en 2011 tandis que le plan PNRU représente 42 milliards ! Autrement dit, la réhabilitation des quartiers pèsera sur les acteurs locaux. Pourtant, collectivités locales et organismes HLM avaient obtenu initialement du Gouvernement l'engagement que l'État investirait un euro pour chacun de leur euro dépensé.
Un « PNRU II » est nécessaire pour parachever la restauration des quartiers : rester au milieu du gué annihilerait les efforts consentis jusque-là. En revanche, nous ne pouvons pas approuver le financement actuel de ce plan. Les 6 millions d'euros de l'État couvriront seulement les frais de fonctionnement de l'ANRU si bien qu'il est prévu de ponctionner la trésorerie des organismes HLM de 260 millions pour financer les dettes de l'agence. La répartition de la charge est déséquilibrée ; personne ne peut nier ce constat.

Tout à fait d'accord : il n'y aura pas de « PNRU II » si l'on ne règle pas au préalable le problème du financement. Il faut tout remettre à plat - il est de notre devoir de le dire et de le répéter - pour bâtir ensemble une nouvelle politique de la ville car, nous sommes, maires de droite et de gauche, confrontés aux mêmes difficultés sur le terrain. La politique de la ville a connu des succès et des échecs, mais il faut de la durée pour traiter les problèmes, et un certain consensus, faute de quoi 6 millions de nos compatriotes vont voir leurs conditions de vie se dégrader encore plus.
En réalité, le programme 147 est une goutte d'eau dans l'océan face aux enjeux. Nous devons privilégier une vision globale des quartiers et de leur avenir en nous penchant sur les problèmes de logement, mais aussi sur ceux de l'emploi et de l'éducation. Une politique de la ville rénovée passe par un grand débat national et - j'insiste - par l'accord total des maires ou des présidents d'intercommunalité. Tout est à repenser.

Une participation de l'État de 6 millions d'euros sur un dixième de la population française, c'est bien peu ! Un débat national qui associera tous les acteurs, y compris ceux qui ne sont pas concernés, est indispensable. Un « PNRU II » ? Nous en avons évidemment besoin. Mais quid de son efficacité quand la RGPP, sous prétexte de rationalisation, réduit les moyens humains et matériels des services publics dans tout l'Hexagone, depuis l'éducation jusqu'à la sécurité ? Exemple éclairant : on vient d'annoncer aux directeurs-adjoints des écoles primaires qu'ils devront aller à Pôle emploi fin décembre... Pourtant, ce poste n'est pas de trop dans les quartiers difficiles ! Donc, vive le « PNRU II », mais à condition d'écarter la RGPP !

Pour ma part, je voudrais insister sur une notion essentielle pour la politique de la ville : la durée. Un « PNRU II » ne suffira pas. Seuls des efforts sur vingt à vingt-cinq ans portent leurs fruits. Prenons garde, par exemple, de ne pas remettre en cause les stratégies de longue durée lors des alternances dans les exécutifs locaux. A Amiens, après les efforts pour promouvoir l'accession sociale à la propriété, l'accent a été mis sur le renforcement du locatif en PLAI...
Autre point, la gouvernance de la politique de la ville doit s'appuyer sur la subsidiarité et un pilotage confié au président d'agglomération ou au maire de la ville...

via un accord-cadre global sur le projet afin que le « patron » du quartier puisse construire un dispositif englobant le logement, la police, l'éducation - bref, tout ce qui touche au quotidien des habitants. Les crédits, en définitive, représentent seulement 20 % de l'effort à fournir, la pointe de l'iceberg, le reste étant constitué du travail quotidien dans la durée et de l'évaluation. De nombreuses villes se sont battues pour obtenir des crédits sans traiter les locataires des quartiers comme des habitants à part entière : eux devaient payer la tonte de la pelouse entre les immeubles ou le ramassage des ordures, contrairement aux autres.
En un mot, les crédits ne font pas tout ; il faut un pilotage et une vision stratégique ! (M. Daniel Raoul acquiesce.)

Je me réjouis des propos équilibrés du rapporteur après les propos désobligeants, voire méprisants, que certains ont pu par le passé tenir à l'encontre de la politique de la ville. L'enjeu est énorme : l'échec de cette politique minerait nos fondements républicains. Si les crédits ne suffisent pas, toute action est impossible sans eux !
Pour moi, la réussite passe par la contractualisation, liée à une nouvelle phase de la décentralisation. Sans vouloir rouvrir le débat sur la réforme territoriale, nous n'avancerons pas si nous ne donnons pas des moyens considérables aux acteurs de terrain. A défaut, nous connaîtrons des pertes financières colossales et des erreurs d'investissement. Autre question majeure, celle des délais : pour les populations fragiles, « demain » ne signifie pas cinq ans, mais la minute qui suit. Des projets, bien qu'extrêmement bien conçus, ont été décrédibilisés par leur mise en oeuvre tardive... Pour avancer, nous devons défendre la contractualisation et la déconcentration des crédits pour une réelle prise en main au niveau local.
Enfin, la question de la gouvernance. Comme Jean-Jacques Mirassou, je veux insister sur l'application parfois stupide d'un ratio - la fermeture d'une classe à partir d'une diminution du nombre d'élèves, notamment - dont les effets sont dramatiques. Quelle que soit la situation locale, le couperet tombe avec la même brutalité....

Pour une politique de la ville réussie, ai-je oublié de dire tout à l'heure, il faut reconnaître les acteurs sociaux et associatifs qui y participent et provoquer ce déclic, qui a manqué jusqu'à présent, pour enclencher l'engagement citoyen, la participation de tous à la dynamique de rénovation. Aujourd'hui, les habitants considèrent, au mieux, la politique de la ville comme un pis-aller. Pour avoir soigné durant des années des patients dans le quartier du Mirail, je sais que, passées quelques années, plus personne ne distingue ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, y compris les policiers. Ne passons pas à côté de cette dimension psychologique !

Marc Daunis, dans le rapport au Premier ministre, Gérard Hamel et moi-même avons dénoncé une vision technocratique et centralisée de la politique de la ville selon laquelle tout doit être concentré sur les 50 quartiers les plus en difficulté, autrement dit l'Île-de-France et plus précisément la Seine-Saint-Denis. Tant que nous n'adopterons pas une autre vision, et quand bien même les crédits augmenteraient, rien ne changera. Et les villes moyennes connaîtront des difficultés encore plus grandes. (MM. Daunis et Mirassou acquiescent.) Daniel Dubois, vous avez raison, la politique de la ville nécessite du temps. Dans ma commune, il m'a fallu douze ans pour construire une piscine-patinoire alors que j'avais réuni tous les crédits nécessaires ! Mais combien de démarches administratives ... ! Et je pourrai multiplier les exemples...

La parole est maintenant à M. Thierry Repentin, sur les crédits de la partie logement de la mission « Ville et logement ».

Les crédits du volet « logement » de cette mission, qu'il me revient de rapporter, sont en légère augmentation de 0,7 % en autorisations d'engagement et de 1,6 % en crédits de paiement. Particularité de cette année : est rattaché à ce budget un article qui organise un véritable hold up sur les organismes HLM. J'en viens à penser, comme le déclarait M. Jérôme Bédier, président de l'Action Logement, - l'ex-« 1 % Logement » - dans un entretien à La Tribune le 8 novembre dernier, que « ce n'est pas à Bercy de gérer la politique du logement en France ».
Le volet « logement » de la mission est composée de trois programmes, à commencer par le programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ». Ses crédits, qui s'élèvent à 1,2 milliard d'euros, augmentent de 7,5 % en 2011 tant en AE qu'en CP. Nouveauté, ce programme comprend une action relative à l'aide alimentaire correspondant aux dispositions adoptées dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. On peut s'interroger sur l'opportunité de ce rattachement... La satisfaction de voir ces crédits augmentés est tempérée par l'insincérité de ce budget, soulignée par notre excellent collègue député, Etienne Pinte, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Les crédits inscrits pour 2011 restent, en effet, très inférieurs aux crédits consommés en 2009... Situation d'autant plus regrettable que les services de l'État et les associations ont besoin de visibilité quant aux financements.
Les crédits du programme 109 « Aide à l'accès au logement », destinés aux aides à la personne, accusent une baisse de 1,6 % pour s'établir à plus de 5 milliards d'euros. Décision budgétaire étonnante quand la crise va mécaniquement augmenter les demandes d'aides ! En outre, je regrette la suppression de la rétroactivité des aides au logement prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour une économie de 240 millions d'euros, cette mesure, « sans modification de comportement de la part des allocataires », « pénaliserait 20 % des bénéficiaires, dont plus de la moitié sont des étudiants et un quart des salariés », affirme Alain Vasselle dans son rapport.
Enfin, le programme 135 « Développement et amélioration de l'offre de logement » correspond au financement des aides à la pierre pour près de 500 millions d'euros en AE et 450 millions en CP en 2011. Seul levier budgétaire traduisant l'engagement du Gouvernement en matière de construction et de réhabilitation de logements sociaux, ce budget enregistre une baisse de 18 % en CP ! Cette évolution, particulièrement inquiétante, marque la première étape d'un désengagement de l'État que je déplore. De fait, les crédits de paiement du programme 135 vont passer de 518,4 à 386,9 millions d'euros de 2011 à 2013...
Ces éléments m'incitent à proposer un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission. D'autant plus que l'article 99 du projet de loi de finances pour 2011 rattaché aux crédits de la mission renforce le prélèvement sur les organismes HLM qui « n'investiraient pas suffisamment en faveur du développement et de la réhabilitation de leur parc de logements », pour reprendre les propos de Dominique Braye, rapporteur de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (MOLLE) ; prélèvement plus connu sous le nom de « taxe sur les dodus dormants ». L'article 99 prévoyait initialement d'assujettir les organismes HLM à la contribution sur les revenus locatifs. La recette supplémentaire estimée à 340 millions d'euros par an, devait alimenter un fonds, géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), destiné à financer les aides à la pierre et la rénovation urbaine. L'article 99 a été réécrit à l'Assemblée nationale, face à l'opposition du monde HLM et aux réserves de nombreux parlementaires et élus locaux. Notre commission des Finances a même adopté un amendement de suppression le 27 octobre dernier ! La nouvelle version de l'article 99 reste, à mes yeux, tout aussi contestable. Le ministre du logement a affirmé, devant les députés, que le nouveau dispositif concernerait seulement 70 % des organismes HLM. Imagine-t-on sérieusement que 70 % des organismes HLM disposent de « dodus dormants » ? Soutenir qu'il s'agit d'un dispositif de péréquation entre organismes HLM est abusif et trompeur, a fort bien dit Philippe Dallier. De fait, le produit du prélèvement financera la rénovation urbaine, via un fonds géré par la CGLLS dont les missions viennent subtilement d'être modifiées pour ce faire ! En réalité, l'objectif est de remédier aux difficultés de trésorerie de l'ANRU : 260 millions d'euros issus de ce prélèvement sont consacrés au financement de programmes de rénovation urbaine déjà engagés ! Les 80 millions restant, quant à eux, abonderont la ligne fongible pour compenser, en partie, la diminution des aides à la pierre. De surcroît, outre le prélèvement sur les « dodus dormants », l'État ponctionnera une partie de la cotisation versée par les organismes HLM à la CGLLS, caisse qui a pour fonction de venir en aide aux organismes HLM en difficulté. La fraction de la cotisation concernée sera même fixée par arrêté !
Les organismes HLM ne sont pas opposés à une certaine mutualisation de leurs moyens. A cet égard, notre commission a introduit, dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, deux articles afin de faciliter les avances et d'autoriser les prêts participatifs entre eux. Quelle sera leur portée si nous retirons aux bailleurs sociaux toutes leurs disponibilités budgétaires ? Après le recours à « Action Logement » et à l'ANRU pour financer la politique du logement, voici que l'on fait appel aux bailleurs sociaux et à la CGLLS. Belle illustration du désengagement de l'État ! « Le comblement du déficit de financement des opérations de rénovation urbaine ne doit pas être mis à la charge des bailleurs sociaux mais relève du budget général de l'État », a fort justement indiqué notre commission des Finances. Combler ainsi le déficit se solderait par l'arrêt de la mise en chantier de 80 000 logements et la suppression d'emplois dans le bâtiment. Je proposerai donc un amendement de suppression de cet article ainsi qu'un amendement visant à introduire un plafond de ressources dans le dispositif du prêt à taux zéro renforcé, le « PTZ+ », prévu à l'article 56 du projet de loi de finances pour 2011 sans exclure de présenter, la semaine prochaine, des sous-amendements au dispositif alternatif auquel notre commission des Finances réfléchit actuellement.
Pour terminer, l'article 98, également rattaché à la mission, vise à augmenter de 0,4 à 0,5 % la contribution patronale au Fonds national d'aide au logement (FNAL) assise sur la masse salariale ; autre manière de diminuer la contribution de l'État au FNAL. Notant que cette disposition concerne aussi les collectivités territoriales, je m'abstiendrai sur cet article.

D'après les organismes HLM de la région Languedoc-Roussillon, la ponction prévue à l'article 99 représentera pour eux 25 millions d'euros, soit 240 euros par famille. Elle signifiera 3 000 logements nouveaux en moins et la perte d'un millier d'emplois dans le bâtiment.
Les aides à la pierre s'élevaient à 800 millions en 2008. Quid de leur montant en 2010 et en 2011 ? Quelle sera la part de l'État dans leur financement en 2011 ?

Alors que le débat parlementaire sur la ponction n'est pas clos, cessons - je le dis en toute amitié - d'agiter des épouvantails. Quoi ! Un prélèvement de 340 millions d'euros signifierait 80 000 logements en moins ? D'après ces chiffres, les organismes pourraient construire bien plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Qu'attendent-ils ? Sur un problème aussi important, faisons preuve de bonne foi et essayons d'avancer.
Contrairement à ce qui a été affirmé, la ponction ne pèsera pas sur les familles car sa contrepartie est le gel de l'évolution des loyers. Je note, d'ailleurs, que les bailleurs sociaux ont augmenté les loyers ces dernières années, malgré les demandes du Gouvernement.
« Les organismes HLM ne sont pas opposés à une certaine mutualisation de leurs moyens », nous dit le président de l'Union sociale pour l'habitat. Dans ce cas, qu'il fasse des propositions plutôt que d'attendre le dispositif alternatif que proposera la commission des finances ! Pour un peu, on croirait que le budget du logement est en apesanteur. Oublier la grave crise financière qui touche l'Irlande et le Portugal est irresponsable. Si nous aimons notre pays, travaillons ensemble face à ce contexte difficile ! En 2013, le premier poste budgétaire sera le remboursement des intérêts de la dette : 55 milliards d'euros ! La majorité, quelle qu'elle soit en 2012, devra faire avec. Que n'avez-vous fait dans les années 2000 lorsque la croissance était au rendez-vous ? Seulement 38 000 logements sociaux construits, voilà qui explique la situation actuelle ! (Murmures à gauche) Les organismes HLM se sont organisés pour échapper à la taxe sur les dodus dormants, introduite dans la loi MOLLE que j'ai rapportée. Et pourtant, il est tout à fait moral, que dis-je républicain, que les organismes qui ont amorti leur parc participe à la solidarité nationale !
Monsieur le rapporteur, quel est le montant de la trésorerie des organismes HLM ? C'est à l'aune de ce chiffre que nous devons apprécier l'effort de 340 millions d'euros qui leur est demandé. Ensuite, quel est le niveau du soutien global de l'État au logement, aides fiscales comprises telles que la TVA à 5,5 % et les exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ?

Ce sont les collectivités territoriales qui financent les exonérations de la TFPB... ( M. Dominique Braye nuance.) Examinons ce budget avec réalisme plutôt qu'avec passion.
Faut-il réduire le budget du logement à l'heure où nous traversons une crise économique majeure ? L'équité serait de construire des logements sociaux pour répondre aux besoins. Le soutien à la croissance commande quant à lui de soutenir l'activité dans le bâtiment. Cela dit, placés devant des choix budgétaires complexes, faut-il recourir à la trésorerie des bailleurs sociaux ? La taxe sur les « dodus dormants », instituée dans la loi MOLLE, a rapporté 7 000 euros ! Pourquoi ? Parce que les organismes HLM ont tout fait pour éviter ce prélèvement.

Comment mutualiser ? Telle est la question. Faisons la transparence, une bonne fois pour toutes, sur les matelas financiers des bailleurs sociaux. Si j'étais opposé à l'injuste contribution sur les revenus locatifs (CRL) - les organismes HLM de la Somme, qui reçoivent 2,6 millions d'euros de l'État, auraient dû verser 5 millions d'euros à la mutualisation ! - je suivrai avec intérêt les propositions de mutualisation des moyens des organismes HLM !

Ce budget n'est pas en apesanteur, mais il n'est pas à la hauteur des besoins ! La Fondation Abbé Pierre vient de lancer l'opération « Carton rouge » pour les 3,5 millions de mal-logés, voilà la réalité ! Cessons de dire que l'on construit davantage de logements sociaux aujourd'hui quand seules les personnes qui touchent plus de trois SMIC peuvent prétendre au logement social intermédiaire. Pour compenser le désengagement de l'État, on prend l'argent sur le dos des bailleurs sociaux !

Je m'interroge sur les « dodus dormants ». De fait, j'observe une fâcheuse tendance, ces temps-ci, à faire main basse sur les ressources des organismes, telles les agences de l'eau, qui ont accumulé de la trésorerie grâce à une saine gestion...
Permettez-moi d'attirer votre attention sur le Fonds d'aide au relogement d'urgence, bien qu'il représente seulement 20 millions d'euros par rapport au 1,2 milliard consacré dans cette mission à l'hébergement d'urgence. Ce fonds, dont l'existence est prorogée à l'article 26 au projet de loi de finances, disposait au 1er août 2010 d'une enveloppe résiduelle de 18,6 millions. Pourquoi les collectivités n'y ont-elles pas fait appel ? Au rapporteur général de l'Assemblée nationale qui proposait de supprimer l'article, le Gouvernement a répondu que l'enveloppe servirait à dédommager et à reloger les victimes de la tempête Xynthia et des intempéries du Var. Monsieur le rapporteur, qu'en pensez-vous ?

Dans mon département des Alpes-Maritimes, seules trois communes - dont celle que je dirige - respectent leurs obligations au titre de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Le retard est tel que le contingent préfectoral est intégralement absorbé par le droit au logement opposable (DALO). Si les organismes ne construisent pas suffisamment, ce n'est pas par manque de volonté, mais uniquement parce que des maires s'y opposent. Dans ce contexte, l'aide à la pierre est divisée par deux en deux ans : comment s'attendre à ce que les constructions suivent ?
Avez-vous des informations, ensuite, sur le montant du surcoût foncier, que les collectivités prennent de plus en plus à leur charge ?
Comment se répartissent les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) entre les différents types de logements ?
L'Etat paraît se désengager de l'accession sociale à la propriété, alors que les ménages ont de plus en plus de mal à y recourir. Si le nombre d'accédants n'augmente pas et que les collectivités ne respectent pas leurs obligations de construire, ne risque-t-on pas tout simplement une paupérisation grave du parc social ?

Je vous confirme d'abord la baisse de l'effort de la nation pour l'aide à la pierre : nous sommes passés de 790 millions d'euros en 2008 à 630 millions en 2009, nous programmons 500 millions pour l'an prochain et la baisse se poursuivrait avec 450 millions en 2012 et environ 400 millions en 2013. Sachant que le nombre de logements construits augmente, ce qui est une très bonne chose, on comprend pourquoi la subvention par logement diminue : nous sommes passés, pour un prêt locatif à usage social (PLUS), de 2 000 à 800 euros en moyenne.

L'aide à la pierre diminue, mais elle est compensée : en dix ans, compte non tenu de la fiscalité, la part de l'Etat dans le financement des constructions a été diminuée par deux, tandis que celles des collectivités locales et des organismes HLM quintuplaient !

La part des organismes est passée de 2,5 % à 12 %, quand celle de l'Etat passait de 6 % à 3 %.
Quelle répercussion la ponction aura-t-elle sur la construction de logements sociaux et sur l'emploi dans le BTP ? Je prendrai comme référence le jaune budgétaire relatif à l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logement.

Votre mauvaise foi est indigne du débat sur une question aussi importante que le logement...

Dans ce « jaune », le ministère des finances estime que l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes HLM, représente une dépense fiscale de 700 millions d'euros. Sa suppression conduirait à une moindre construction de 59 000 logements sociaux. A cette aune, une ponction annuelle de 340 millions représente 28 500 logements par an, soit 85 000 en trois ans (M. Braye s'exclame). Voici la réponse du ministère des finances !

Je vous demandais la vôtre ! Une obligation m'oblige à quitter cette séance sans l'avoir entendue.

Les organismes HLM et les collectivités locales n'ont jamais autant investi dans la construction sociale que depuis trois ans, il faut leur rendre hommage !
Dominique Braye m'interroge sur nos propositions alternatives à la ponction proposée et je regrette notamment qu'il ne prenne pas la peine d'écouter mes réponses. Le mouvement HLM propose bien des alternatives : l'élargissement de l'assiette de la CRL aux locaux commerciaux à tous les mètres carrés loués dans notre pays, ce qui en diminuerait considérablement l'impact ; un allongement de la durée d'exonération de taxe sur le foncier bâti ; une augmentation de 0,17 point des droits de mutation, cette proposition étant acceptée dans la majorité elle-même puisque Charles de Courson l'a reprise à son compte à l'Assemblée nationale ; enfin, l'exclusion du bénéfice du « PTZ » pour les deux déciles les plus riches de la population, ce qui représenterait une économie de 400 millions. Vous le constaterez, nous ne manquons pas de propositions alternatives !
Certains pensent que la ponction introduira une péréquation entre organismes, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle servira majoritairement l'ANRU. La ponction ne créera donc aucun logement supplémentaire là où les besoins sont criants !
Notre collègue me somme de dire quelle est la trésorerie des organismes. Elle est de 6 milliards d'euros, qui servent aux dépenses d'entretien, de gros oeuvre, à des projets avec les collectivités locales, et qui, surtout, doivent être rapportés à la dette des organismes, laquelle dépasse les 100 milliards.
Je ne veux pas croire que les défenseurs de la ponction imaginent que les organismes auraient pu se rattraper sur les loyers. Les impayés de loyer de plus de trois mois ont augmenté de 30 % depuis la crise et les procédures de surendettement ont doublé : il est donc impossible d'augmenter les loyers ! Ce que vont faire les organismes, ce sera d'investir moins dans l'entretien, dans la présence humaine, et de construire moins de logements !
L'accession sociale à la propriété est déterminante pour les parcours résidentiels et pour la mixité sociale : c'est donc un vrai sujet et si la revalorisation du PTZ solvabilise utilement les classes moyennes, on peut regretter que les 400 millions que représente le coût du PTZ pour les deux déciles des Français les plus aisés, ne soient pas utilisés pour le logement social.
Ce qui menace, effectivement, c'est la paupérisation du parc social. Il faut savoir que 70 % des familles entrées dans le parc social l'an passé sont sous le plafond PLAI, soit un revenu inférieur à 840 euros mensuels. Ces ménages appellent des services plus coûteux pour les collectivités territoriales, et la paupérisation de la population compromet l'ensemble de la politique de la ville et de la rénovation urbaine.

Je regrette, Odette Herviaux, de ne pas pouvoir vous répondre sur l'article 26 du projet de loi de finances. Je partage votre avis, Odette Terrade : les crédits budgétaires destinés à la lutte contre l'habitat indigne sont réduits à la portion congrue.
L'article 55 de la loi SRU a permis le financement de 40 000 logements sociaux l'an passé sur des territoires où le logement social est peu implanté, c'est 30 % du nombre total de logements sociaux financés. La ponction de 340 millions d'euros représente 85 000 logements de moins en trois ans, soit quelque 3,4 milliards de travaux en moins pour le BTP, comme tenu de l'effet de levier de l'argent public. Le secteur a un effet contra-cyclique largement reconnu, le Président de la République s'en est lui-même félicité lorsque les organismes ont acheté quelque 30 000 logements en vente en état future d'achèvement (VEFA) que les promoteurs ne parvenaient pas à écouler sur le marché.

Chacun convient des besoins en logements et de l'utilité qu'il y a à en construire. Les prêts n'ont jamais été à des taux aussi avantageux, les compétences sont là, mais ce qui pose le plus de problème, c'est la disponibilité du foncier. Comme maire et président d'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), j'ai toujours encouragé la construction, mais là où 100 000 francs suffisaient il y a quarante ans pour une maison de cinq pièces sur 1 000 mètres carrés de terrain, il fallait déjà 100 000 euros il y a vingt ans et aujourd'hui, la même somme suffit à peine à acheter le terrain ! Et cette envolée des prix tient beaucoup au nombre et à la complexité des procédures à suivre afin de rendre un terrain constructible. Je ne comprends donc pas qu'on ne facilite pas les choses pour les communes : quand les familles ne parviennent pas à se loger, il faut trouver les moyens de construire plus, en facilitant les procédures d'urbanisme !

Combien de communes entrent-elles dans le champ de l'article 55 de la loi SRU ? Parmi elles, combien respectent leurs obligations ?

En s'interrogeant sur les moyens de libérer du foncier, Charles Revet déborde du strict champ de la loi de finances, mais je partage son avis : il faut examiner toutes les voies pour répondre aux besoins de logement dans notre pays.
L'article 55 de la loi SRU s'applique aux communes de plus de 3 500 habitants - 1 500 habitants en Île-de-France - qui font partie d'une agglomération d'au moins 50 000 habitants. La loi impose de parvenir à 20 % de logements sociaux avant 2020. En 2008, près de 800 communes visées par l'article 55 n'atteignaient pas ce taux. Une partie de ces communes respecte ou dépasse leur plan de rattrapage, une deuxième partie le fait avec moins de rigueur, et le reste s'y soustrait volontairement. La question se pose, dès lors, du trop faible montant de la contribution de solidarité, que les communes doivent acquitter lorsqu'elles ne respectent pas le plan de rattrapage : cette contribution est inférieure à la participation moyenne des communes à la construction de logements sociaux, sans compter le coût des services que les communes récalcitrantes s'évitent de mettre en place. Qui plus est, certaines équipes municipales ont fait du non-respect de cette obligation légale, un argument de campagne électorale...
L'article 55 de la loi SRU dispose qu'en cas de manquement à la loi, le préfet peut se substituer au maire pour la délivrance des permis de construire : cette disposition n'a jamais été appliquée, alors qu'elle aurait un effet certain !

J'ai une proposition : pourquoi ne pas attendre la position de la commission des Finances sur l'article 99, avant de nous prononcer nous-mêmes ? Il y aura probablement un débat, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, et nous pourrons y revenir la semaine prochaine.

Je vous propose effectivement de voter sur les crédits de la mission et de renvoyer le vote sur l'article 99.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission.
Le vote sur l'article 99 est réservé.
Article 98

L'article 98 propose d'augmenter de 0,4 % à 0,5 % de la masse salariale, la contribution des entreprises au fonds national d'aide au logement. Je vous propose de nous abstenir.
L'article 98 est adopté.
La commission examine ensuite le rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2011 de MM. Michel Houel et Daniel Raoul sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Nous allons examiner les crédits de la mission Enseignement supérieur et recherche (MIRES), consacrés à la recherche.

La crise nuit au développement de la recherche. En France, l'investissement global en recherche et développement (R&D) avoisine les 2 % du PIB : nous sommes loin des 2,8 % des Etats-Unis et de l'objectif de 3 % fixé par la stratégie de Lisbonne. En cause, un positionnement sectoriel inadapté, avec trop peu d'entreprises à fort potentiel technologique, mais aussi une trop faible intensité en R&D des entreprises de taille intermédiaire. A l'échelle européenne, les dépenses en R&D des grandes entreprises ont chuté de 2,6 % en 2009. Cela a incité la commissaire européenne à la recherche, à l'innovation et à la science à présenter, le 6 octobre, une nouvelle stratégie européenne intitulée « l'Union de l'innovation ». Ses orientations devraient être débattues lors du Conseil européen de décembre.
Ces chiffres sont inquiétants quand on les compare avec ceux de la Chine qui, avec 35 millions de scientifiques et techniciens, dont 1,36 million de chercheurs à temps plein, occupe les toutes premières places au monde.
Les crédits de la MIRES augmentent de 468 millions d'euros, pour s'établir à 25,2 milliards. Avec le crédit d'impôt recherche (CIR) - 4,95 milliards d'euros -, les 500 millions d'euros de crédits partenariat public-privé ainsi que les 3,6 milliards consacrés cette année aux investissements d'avenir, ce ne sont pas moins de 32,2 milliards qui seront consacrés au périmètre de la MIRES, en augmentation de presque 16 %.
Les crédits consacrés à la recherche, au sens strict, s'élèvent à 15,23 milliards d'euros, en hausse de 2,79 %. Cependant, les économies demandées aux établissements publics scientifiques et technologiques s'élèveront à 42,3 millions d'euros, auxquels s'ajoute pour ces établissements une mise en réserve de crédits demandée par le Premier ministre.
Il en résulte des contraintes budgétaires assez fortes pour certains grands organismes de recherche. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), par exemple, gagne 22,9 millions d'euros, mais son budget baisse en réalité de 10 millions et sa dotation de fonctionnement recule de 12 millions, une fois neutralisés les changements de périmètre, mesures d'économie et mises en réserve. J'ai été étonné de constater que les chercheurs de l'Inserm étaient dispersés dans une multitude de laboratoires d'autres organismes. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et IFP-Energies nouvelles connaissent également des budgets très tendus.
Si ce budget de crise comporte donc des « zones grises », il n'en faut pas moins retenir la tendance remarquable à la hausse, comme les trois précédentes années. Elle confirme la volonté du Président de la République de mettre la recherche et l'innovation au centre de notre projet de société. Le chef de l'Etat est en passe de tenir l'engagement d'augmenter de 9 milliards d'euros le budget consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche durant son mandat : nous passerions ainsi de 22,9 milliards d'euros en 2007 à 31,9 milliards en 2012.
Les « investissements d'avenir » font l'objet de deux programmes spécifiques, abondés par le collectif budgétaire pour 2010. Ils financent des projets importants : le réacteur de 4ème génération, des démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables, le développement des réseaux de télécommunication à très haut débit, la recherche pour mettre au point le véhicule du futur, des plateformes mutualisées d'innovation pour les pôles de compétitivité ou encore le complexe du plateau de Saclay.
Or, dans les 35 milliards débloqués, la MIRES entre pour 21,6 milliards : 6,9 milliards sont directement consommables, le solde, 15 milliards d'euros, est « non consomptible », selon le terme désormais consacré, c'est-à-dire que les bénéficiaires n'en recevront que les produits financiers.
Ces crédits devraient permettre de financer de grands projets structurants à raison de 10 milliards pour l'enseignement supérieur et la formation universitaire, 7,9 milliards pour la recherche et 500 millions pour le domaine spatial. La procédure se déroule en trois temps. D'abord la signature de conventions entre le commissariat général à l'investissement (CGI), présidé par M. René Ricol, et chacun des dix opérateurs : cette phase est achevée. Ensuite, des appels à projets : après une évaluation scientifique et économique des projets par un jury composé d'experts de niveau international, c'est le Premier ministre qui décide de les retenir ou non, sur proposition du CGI. Cette phase est en cours de réalisation : la première vague d'appels à projets a commencé en juin dernier et s'achèvera début 2011. Enfin, la dernière phase, celle de la réalisation des projets et du financement, a déjà commencé, avec l'octroi des premiers « prêts verts » et « aides à la réindustrialisation ».
Les effets attendus de ce grand emprunt sont doubles : un effet de levier de 20 à 25 milliards venant du secteur privé, des collectivités territoriales, de l'Europe et d'autres acteurs publics ; des retours sur investissement pour l'État, dont les modalités sont précisées par les conventions.
Pour la quatrième année consécutive, les crédits de la MIRES augmentent, et je vous propose d'émettre un avis favorable à leur adoption.

Depuis 2007, le Gouvernement répète que la recherche est une priorité nationale, qu'elle va bénéficier de 9 milliards d'euros de plus sur cinq ans. Nous avons entendu aussi les discours accompagnant la stratégie européenne de Lisbonne. Mais la réalité des chiffres est moins souriante : nous sommes très en retard dans le passage à la société de la connaissance ! Et quand on voit comment le Gouvernement exige des établissements de recherche qu'ils coupent dans leurs budgets de fonctionnement entre 2011 et 2013, on comprend vite que ces discours sur la recherche sont avant tout de la communication politique.
L'effort pour la recherche augmenterait de 412 millions d'euros en 2011 ? Il faut y inclure les 189 millions de dividendes d'Areva, les 145 millions imputables à un jeu d'écritures sur le CIR, ainsi que les crédits du plan cancer, qui sont transférés vers l'Inserm. La progression effective n'est alors plus que de 78 millions, soit une augmentation de 0,9 % à 1 %, ce qui n'est pas si mal comparé aux autres budgets soumis à un effet « rabot ». Et les responsables de laboratoires ne s'y trompent pas : une augmentation de crédits « non consomptibles », cela ne veut pas dire autant de crédits en plus pour la recherche, puisque seuls les intérêts sont mobilisables !
En réformant en 2008 son CIR, la France s'est dotée d'un des systèmes les plus favorables au monde. De nombreux rapports d'étude, y compris ceux de l'Inspection générale des finances (IGF) et de la Cour des comptes, sans oublier le rapport de notre collègue Christian Gaudin et celui de Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée nationale, ont souligné son rôle majeur dans l'attractivité de notre territoire, la deuxième au monde pour les investissements. Instauré par la gauche en 1983, le dispositif a été élargi depuis et les entreprises peuvent, depuis 2009, se voir restituer immédiatement leur créance. Le coût pour l'État a progressé en conséquence, passant de 457 millions en 2000 à 4,95 milliards cette année. Les PME sont sur-représentées, mais l'industrie demeure sous-représentée : elle ne recueille que 65 % du crédit d'impôt alors que les entreprises industrielles réalisent 88 % de la R&D.
Le CIR a un important effet levier, il représenterait 0,33 point de croissance supplémentaire et 18 000 à 25 000 chercheurs supplémentaires d'ici 2020, ce qui est essentiel face au phénomène du papy boom chez les chercheurs auquel les universités vont devoir faire face. Le CIR renforce l'attractivité de notre territoire : il explique pour partie notre deuxième place au monde pour les investissements étrangers.
Cependant, des améliorations doivent y être apportées. D'abord pour lutter contre les abus. On sait que l'optimisation fiscale conduit des grandes entreprises à ventiler leurs investissements par filiales pour accroître leur crédit d'impôt, sans aucun bénéfice pour la recherche. La commission des finances a prévu un amendement contre ces pratiques, et je vous proposerai de le soutenir. Autre forme d'abus, des sociétés de conseil se font rétribuer excessivement pour aider à monter les dossiers, jusqu'à 40 % de ce que représente le crédit d'impôt. Nos collègues députés ont adopté un amendement pour encadrer ces pratiques. Enfin, le CIR serait plus efficace s'il était davantage pérenne et lisible. Nos auditions ont mis en lumière la forte demande de stabilité du dispositif dans le temps. Il faudrait également faire coïncider notre guide du CIR avec le manuel de Frascati, qui constitue la référence méthodologique internationale pour les pays de l'OCDE.
Nous devons nous assurer encore que le CIR serve bien l'innovation technologique. Or, comparée aux 5 milliards d'euros de crédit d'impôt, l'aide à l'innovation pour les PME innovantes ne représente que 300 millions d'euros. Si l'idée d'un crédit d'impôt innovation paraît devoir être écartée, il faudrait conforter les aides directes à l'innovation, octroyées, notamment, par Oséo. Enfin, il me semblerait utile d'inciter davantage les PME à se regrouper pour mutualiser leur R&D ; j'ai préparé un amendement en ce sens.

Que représentent respectivement la recherche fondamentale et la recherche appliquée, à l'échelle européenne ? Quelles seraient, selon vous, les bonnes méthodes pour développer la recherche en France ?

La distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée est des plus difficiles à établir et elle n'a pas beaucoup de sens. Ainsi, c'est en faisant des recherches sur les isolants qu'on a avancé sur les semi-conducteurs : le progrès scientifique passe par des transgressions ... Il faut encourager les partenariats développés par les instituts de recherche avec des entreprises, à l'instar du label Carnot, décerné par l'Agence nationale de la recherche.

Il faut laisser du temps au temps. Aux Etats-Unis, les programmes de soutien aux chercheurs sont d'emblée établis pour six ans, ce qui profite pleinement à la recherche. Je déplore que les chercheurs de l'Inserm soient dispersés à ce point, sans capacité pour l'institut de maîtriser leurs travaux. On passe aujourd'hui des contrats de deux ans avec les jeunes chercheurs, mais ce n'est pas suffisant pour leur permettre de mener des travaux de long terme.

Le CIR joue un rôle important, nous l'avions vu avec les pôles de compétitivité : il renforce l'effet cluster et les partenariats territoriaux. Cependant, les chercheurs - je le sais, compte tenu de mes liens avec Sophia Antipolis - demandent que le système, qui fonctionne, soit plus lisible et plus stable : nous devons faire passer le message, avec force !
Ensuite, il n'est pas normal que de grandes banques ou de grandes compagnies d'assurance bénéficient d'une créance de CIR, pour des innovations qui relèvent du simple « bidouillage » informatique ! Nous devons examiner les choses de plus près. Il nous faut également trouver un système de caution, pour éviter que des innovations, aidées par le crédit d'impôt, se voient immédiatement délocalisées par le jeu des rachats d'entreprises.
Enfin, il faut éviter que des donneurs d'ordre ne puissent faire remonter le crédit d'impôt qu'ils ont sollicité au moyen de PME sous-traitantes, car c'est encore un détournement du dispositif.

Nous avions, lors de notre déplacement à Toulouse, constaté l'inquiétude d'Airbus Industries face aux risques de transferts de technologies liés au CIR. Un sous-traitant nous avait fait part de tracasseries administratives et fiscales liées à ce crédit d'impôt: il ne faudrait pas que l'avantage se retourne contre ceux qui en bénéficient !

Le CIR est une bonne mesure, qui compte pour l'attractivité de notre territoire. Cependant, il n'est pas sain que de grandes banques ou des assureurs côtés au CAC 40 en bénéficient : ce dispositif doit aller aux PME notamment, à celles qui prennent des risques et qui sont encore fragiles financièrement. Dans le Nord, j'ai l'exemple d'un ingénieur qui a investi sur une niche, dans le secteur textile, en faisant preuve d'un grand dynamisme : il faut le soutenir, la réindustrialisation de notre pays passe par là.

Le CIR doit être concentré sur les PME, il est anormal qu'il serve aux « caves à cigares ». Et il faut effectivement trouver une riposte juridique contre les délocalisations qui interviennent juste après que l'entreprise en a bénéficié.

On se félicite un peu vite des effets fédérateurs des pôles de compétitivité ; je préfèrerais qu'on attende quelques années, pour voir combien de PME resteront dans des projets coopératifs. Ce que j'en entends, c'est plutôt que les PME se trouvent vite exclues de ces pôles, qui se trouvent sous la mainmise des grands groupes.
Pour éviter le découpage des projets de R&D par tranches réparties entre filiales d'un même groupe, il est probable que nous présenterons un amendement, avec mes collègues du groupe socialiste, avec l'espoir que la commission des finances s'y ralliera.
Mon premier amendement, identique à l'un des amendements de la commission des finances, propose que le ministère de l'économie et des finances se voie transmettre un ensemble d'informations aujourd'hui transmises au seul ministère de la recherche et qui portent sur les entreprises bénéficiant du CIR.
Mon deuxième amendement, également identique à un amendement de cette même commission, prévoit que les entreprises déclarant plus de 100 millions d'euros de dépenses éligibles transmettent annuellement des informations à l'administration fiscale sur leurs programmes de R&D.
Enfin, mon troisième amendement portant article additionnel propose de bonifier de moitié le CIR des PME qui mutualisent leurs activités de R&D en recourant à un groupement d'employeurs.

En Seine-et-Marne, département où les grandes foires sont une tradition, j'ai eu, il y a quelques années, l'idée de réunir les chercheurs et entreprises à la pointe de la R&D, pour les inciter à se rapprocher. L'expérience s'est soldée par un échec, pour la simple raison que les entrepreneurs sont toujours réticents à partager leurs secrets de fabrication.

De fait, les pôles de compétitivité aussi ont démontré qu'il est bien plus facile de faire collaborer les entreprises sur une plateforme que de mutualiser la R&D. Cependant, votre amendement va dans le bon sens.

L'exercice est difficile. Pour autant, la survie de nos PME et le maintien de leur savoir-faire passent par cette voie. Des petites entreprises métallurgiques de la vallée de la Meuse se sont ainsi exclues de certains marchés par peur de s'associer. En revanche, lorsque des PME ont remporté quelques marchés, le glacis s'est dégelé peu à peu. Notre collègue Martial Bourquin, qui a conduit la mission sur la désindustrialisation, approuvera sans doute cette démarche.

Au reste, la compétition initiale cède le pas, ensuite, à une forme de coopération, appelée la « coopétition ».

L'amendement présente l'immense avantage de favoriser l'élément cluster et de ne pas se limiter aux mutualisations dans un même domaine. Le modèle d'avenir - il suffit, pour s'en convaincre, de penser aux pôles de compétitivité et aux districts italiens - est la plate-forme de coopération.

N'oublions pas que les PME-PMI, sous-capitalisées, n'ont souvent pas les moyens de dégager de la trésorerie pour financer des dépenses R&D qui ne se concluent pas forcément par un commercial. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur les projets collaboratifs en matière de logistique et d'ingénierie, où ne se pose pas le problème de la perte éventuelle de la propriété intellectuelle.
En revanche, Monsieur le Président, permettez-moi de rectifier l'amendement en remplaçant « les entreprises » par « les PME-PMI », afin que cette disposition ne profite pas, encore une fois, aux seuls grands groupes.
Les amendements sont adoptés.

Je reconnais l'effort de l'État en faveur de la recherche, même si par déformation professionnelle, je dirais : « peut mieux faire ». A titre personnel, je préconise donc l'abstention sur les crédits destinés à la recherche. En revanche, je ne peux qu'être défavorable à l'adoption des crédits de l'enseignement supérieur ainsi, par extension, qu'à l'ensemble des crédits de la mission.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission.
Puis, la commission procède à l'examen du rapport pour avis de M. François Patriat sur les crédits de la mission Participations financières de l'État.

Les crédits du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », que j'ai l'honneur de rapporter pour la troisième année, retracent toutes les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'État, à l'exclusion des opérations de gestion courante. Ce compte, expressément prévu par l'article 21 de la LOLF, a été institué par l'article 48 de la loi de finances initiale pour 2006. Tableau de bord des opérations patrimoniales de l'État actionnaire, il est complété par un rapport sur la politique menée par le Gouvernement en direction des entreprises qu'il contrôle.
L'examen de ces crédits intervient dans un contexte particulier. Tout d'abord, l'année 2010 a été marquée par la transformation de La Poste en une société anonyme depuis le 1er mars, en application de la loi du 9 février 2010, qui a suscité beaucoup de débats au sein de notre commission. La crise a par ailleurs impacté les résultats des entreprises au sein desquelles l'État détient des participations financières. Troisième point, le fonctionnement de l'Agence des participations de l'État a évolué avec la nomination d'un commissaire aux participations de l'État, le 3 août dernier, directement rattaché au ministre en charge de l'économie. Enfin, l'accent est mis aujourd'hui sur la politique industrielle pour soutenir la reprise économique, comme l'ont souligné les récents États généraux de l'industrie. Dans ce contexte, il convient d'être particulièrement attentif aux conclusions de la mission commune d'information relative à la désindustrialisation des territoires, présidée par notre collègue Martial Bourquin.
Je regrette que l'examen des crédits de ce compte passe trop souvent inaperçu alors même que les enjeux qu'ils recouvrent sont très importants. Ainsi, je vous remercie, monsieur le Président d'avoir organisé l'audition du nouveau commissaire aux participations de l'État, M. Jean-Dominique Comolli, devant la commission le 20 octobre dernier.
Une fois de plus, me voici contraint de souligner l'insuffisance des informations transmises au Parlement sur ce compte d'affectation spéciale. Pour la énième fois, les recettes sont affichées de façon forfaitaire au niveau notionnel de 5 milliards d'euros, soit le même chiffre, exercice budgétaire après exercice budgétaire, alors que les recettes réellement perçues n'ont généralement rien à voir avec ce chiffre. Ainsi, seuls 3,5 milliards ont été encaissés en 2009 alors que la loi de finances initiale pour 2009 prévoyait 5 milliards d'euros. Quant aux prévisions de dépenses, elles sont purement indicatives : 1 milliard d'euros pour le programme 731 relatif aux opérations en capital intéressant les participations financières de l'État et 4 milliards pour le programme 732 dédié au désendettement de l'État ou d'établissements publics de l'État, comme pour l'exercice précédent. Cette priorité accordée au désendettement de l'État, -80 % des crédits- ne me semble pas pertinente : cette contribution demeure dérisoire au vu du montant total de l'endettement et elle réduit les marges de manoeuvre consacrées aux investissements industriels. Par ailleurs, si les crédits inscrits sur le programme 731 prévoient l'augmentation du capital de La Poste pour lequel l'État doit contribuer à hauteur de 1,2 milliard d'euros, aucune indication n'est fournie, ni sur le calendrier, ni sur la manière dont cette libération progressive aura lieu.
Cette situation est loin d'être satisfaisante, d'autant que l'exercice 2010 a été marqué par la crise et l'absence de cession d'actifs. Au 21 septembre 2010, les recettes s'élevaient à 482 millions provenant pour la plus grande partie, de la réduction du capital de Giat Industries et du produit de la cession indirecte de Charbonnages de France. Les dépenses en 2010 s'élèvent à 314 millions d'euros au 21 septembre. Dépenses auxquelles se sont ajoutées des opérations exceptionnelles d'investissement comme le plan Campus, lequel a conduit l'État à doter l'Agence nationale de la recherche de 3,686 milliards, et les dépenses d'avenir prévues par le Grand emprunt pour un montant total de 2,39 milliards. Le chiffre d'affaires de l'ensemble combiné est passé de 147,9 milliards à 128,5 milliards d'euros. Les bénéfices des entreprises publiques ont considérablement diminué : ils sont passés de 23,75 milliards d'euros à 7,4 milliards entre 2008 et 2009. Enfin, les dividendes perçus par l'État au titre de 2009 ont baissé de 23,6 % en un an. Ces résultats auraient pu davantage être pris en compte.
Je m'interroge également aujourd'hui sur l'unité et la cohérence de la politique actionnariale de l'État. Les multiples acteurs intervenant dans ce domaine ne poursuivent-ils pas des buts, voire des intérêts, contradictoires ? L'objectif de valorisation patrimoniale de l'Agence des participations de l'État (APE) est-il conciliable avec celui de développement industriel et économique du Fonds stratégique d'investissement (FSI) ? Le débat sur la valorisation de La Poste a jeté la lumière sur ces divergences. L'orientation nouvelle de l'agence en faveur d'une stratégie industrielle plus marquée ne doit pas rester symbolique.
Quelques mots enfin sur le FSI, qui témoigne d'une véritable stratégie d'investissement industriel. Créé en décembre 2008, sous la forme d'une société anonyme détenue à 51 % par la Caisse des dépôts et à 49 % par l'État, il vise à apporter des fonds propres aux entreprises, afin d'accélérer leur développement, d'accompagner leur transformation dans des périodes de mutation ou de stabiliser leur actionnariat. Après deux ans d'existence, il a reçu 2,4 milliards d'euros. Au 31 juillet 2010, il avait réalisé 35 investissements directs pour un montant total de 1,4 milliard d'euros, principalement sous la forme d'augmentations de capital d'entreprises non cotées pouvant aller de quelques millions à plus de 200 millions d'euros pour le groupe Vallourec par exemple. 30 % de ces investissements sont intervenus dans le secteur de l'industrie. En outre, le FSI a diversifié ses modes d'intervention. Il est intervenu grâce à des fonds sectoriels dédiés à certains domaines d'activités ou catégoriel d'entreprises : le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles qui a reçu 200 millions d'euros du FSI, le Fonds Innobio dédié aux biotechnologies et le Fonds Bois, que je connais bien. Il a également mis en place un nouveau dispositif de financement en fonds propres destiné aux PME, doté d'un milliard d'euros, distribué sur le terrain par les antennes régionales de la Caisse des dépôts. Si le FSI participe de la définition d'une politique française industrielle solide, il a reçu seulement 2,4 milliards d'euros sur les 20 milliards prévus. De plus, il faudrait faire davantage en matière de responsabilité sociale des entreprises qu'une simple charte de bonnes pratiques. Enfin, le FSI est souvent trop peu visible dans les régions. En conclusion, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et en dépit de certaines améliorations, à titre personnel, je m'abstiendrai sur le vote de ces crédits.

Avant de donner la parole à Michel Teston, je veux annoncer que, lors d'une récente réunion réunissant la Caisse des dépôts, les deux rapporteurs, le président de l'Assemblée nationale et moi-même, nous avons eu confirmation que la Caisse tiendra son engagement d'apporter 1,5 milliard d'euros à La Poste, soit 26 % du capital de la nouvelle société anonyme, qu'elle versera à mesure des besoins. La participation de l'État, quant à elle, s'élèvera à 1,2 milliard d'euros.

Intervention fort opportune ! Il fallait modifier le statut de La Poste, nous a expliqué le Gouvernement, pour conforter le capital de l'entreprise. Et voici que nous n'avons aucune indication précise, dans le projet de loi de finances pour 2011, sur la libération des crédits par l'État ! Dans ces conditions, était-il aussi urgent de transformer La Poste en société anonyme ?

Qu'en est-il de la transparence des entreprises dans lesquelles l'État détient une participation financière ? Le Parlement devrait être régulièrement informé de leur situation, en fin ou en début d'année, et auditionner les représentants de l'État. Ce procédé nous aurait évité les déconvenues que nous avons rencontrées avec EADS.

Étant administrateur de la SNCF, je sais que beaucoup d'éléments nous échappent. Mieux vaudrait auditionner les responsables. En l'occurrence, Guillaume Pépy.

Les chiffres que donne ce rapport pour le FSI et le FMEA ne correspondent pas à ceux annoncés lors des Etats généraux de l'industrie : c'est inquiétant ! Comment expliquer leur faible abondement et leur faible consommation ? La mission commune d'information sur la désindustrialisation, que j'ai l'honneur de présider, a mis en évidence que, malgré les annonces, nous avons peu eu recours en France, au chômage partiel, contrairement à l'Allemagne : seulement 300 000 personnes contre 2 millions outre-Rhin ! Eux ont déployé des moyens très importants pour que toutes les unités de production soient au rendez-vous à l'heure de la reprise. Je regrette, en France, cet écart entre les décisions et les actes.

Dispose-t-on d'une vision analytique des baisses des bénéfices des entreprises publiques ?

J'indiquerai à Martial Bourquin que le recours aux mesures sur les heures chômées dépend aussi de la volonté des chefs d'entreprise. Mon département, les Ardennes, qui compte moins de 300 000 habitants, a consommé davantage de crédits destinés au chômage partiel que le Pas-de-Calais ! Les outils existent. C'est aux mentalités d'évoluer.

Lors d'une réunion en préfecture, j'ai appris qu'il y avait eu 70 000 heures chômées financées en 2009, et 780 000 heures en 2010 dans le Jura. Un bond considérable dû à la crise.

En Allemagne, la production manufacturière représente 30 % du PIB parce que les Allemands ont choisi de mettre, un temps, leur industrie sous perfusion. C'était la bonne stratégie !

Soit, mais la contrepartie a été le gel des salaires. Et l'Allemagne ne dispose pas des mêmes amortisseurs sociaux. La France a fait un bon choix en favorisant l'investissement.

Puisque nous sommes dans les comparaisons, rappelons que les syndicats allemands ont accepté une importante baisse de salaire. Résultat, 80 % de la production du groupe Audi est localisée en Allemagne alors que nos groupes ont dû délocaliser. Aujourd'hui, les syndicats allemands demandent la révision de cette politique de modération salariale.

Ce compte montre en tout cas que l'État est encore présent dans de nombreuses entreprises.

Dans certains secteurs, les entreprises ont mis leurs salariés au chômage partiel, dans d'autres l'emploi a disparu sans retour, du fait notamment de choix stratégiques erronés, on l'a vu avec Kodak, Hoover ou Thomson. La désindustrialisation prend bien des formes et dépend de nombreux facteurs.
On demande plus de transparence, mais l'État répond qu'il n'a pas à annoncer toutes ses décisions industrielles à l'avance, afin de ne pas compromettre ses choix stratégiques.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le rapporteur vous propose l'abstention.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission.