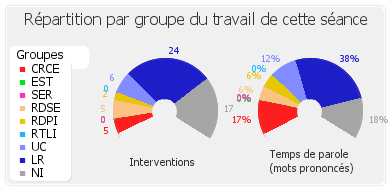Séance en hémicycle du 17 janvier 2013 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur les énergies renouvelables.
L’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.
Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sur France 3 et il importe que chacun des orateurs respecte son temps de parole.
La parole est à M. Michel Savin.

Madame la ministre, depuis le 8 octobre 2012, EDF n’est plus soumis à l’obligation d’achat de l’énergie produite par les installations hydrauliques.
Je rappelle qu’il existe plus de 2 000 centrales hydroélectriques en France métropolitaine, dont un grand nombre sont propriété communale. Par ailleurs, l’énergie hydraulique est, après le nucléaire, la deuxième source de production d’électricité de notre pays : elle représente, à elle seule, 13 % de l’énergie électrique produite en France.
Les propriétaires privés et publics d’installations hydrauliques ont aujourd’hui trois possibilités pour revendre leur production : soit souscrire un contrat H-97, soit souscrire un contrat H-07, soit la vendre sur le marché de l’énergie au tarif moyen de 0, 5 euro le kilowattheure.
Les termes des arrêtés fixant les conditions de souscription aux deux contrats précités obligent les exploitants à réaliser des travaux sur les centrales hydroélectriques sans tenir compte de l’état des équipements. De plus, ces mêmes arrêtés obligent les producteurs à réaliser ces travaux dans des délais très brefs.
Compte tenu des sommes élevées mises à leur charge et de ces contraintes de délais, beaucoup de petits producteurs s’interrogent sur les conditions économiques de la poursuite de leur activité. Certains d’entre eux risquent même d’être dans l’obligation d’arrêter leur production ou de vendre leur centrale. Il faut espérer que ce ne soit pas l’objectif visé.
Cette situation appelle de ma part deux remarques.
Tout d’abord, il est regrettable que l’on ne tienne pas compte de l’état des installations avant de mettre à la charge des producteurs un volume de travaux important, calculé uniquement sur la capacité de production des équipements.
De plus, il sera quasiment impossible de faire réaliser ces travaux dans des délais aussi courts par des entreprises peu nombreuses, qui ne pourront pas répondre à toutes les demandes en même temps, en dépit de la souplesse apportée par la direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, dans les conditions de signature du contrat H-07.
Lors de la séance du 11 octobre dernier, madame la ministre, vous avez appelé de vos vœux un « patriotisme écologique », afin de défendre les énergies renouvelables. Vous avez cité les filières solaire et éolienne, mais rien dans vos propos ne concernait l’énergie hydroélectrique.
Aujourd’hui, il nous faut défendre toutes les énergies renouvelables, y compris l’énergie hydraulique, car, vous le savez bien, elle mobilise moins de financements publics que le solaire et l’éolien. Il ne faudrait pas que ces arrêtés signent l’arrêt de mort d’un grand nombre de microcentrales.
Madame la ministre, au vu de cette situation, je souhaite vous poser deux questions.
Tout d’abord, pourquoi avoir décidé de mettre à la charge des exploitants de centrale hydroélectrique des montants de travaux calculés sur la capacité de production des équipements sans tenir compte de leur état ?

Mon cher collègue, je vous prie de conclure, car vous avez déjà largement dépassé votre temps de parole.

Je souhaiterais savoir, en outre, si le Gouvernement peut envisager une prolongation d’un an des deux contrats H-07 et H-97, afin d’accorder un délai supplémentaire aux exploitants, leur permettant de réunir les conditions exigées pour la signature de ces deux contrats.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la politique du Gouvernement consiste bien à soutenir le développement de toutes les énergies renouvelables.
Vous avez raison, monsieur le sénateur Michel Savin, de souligner la place de l’hydroélectricité, première source de production d’électricité renouvelable en France puisqu’elle en représente 80 %. Cette source d’énergie est aussi un outil indispensable de sécurisation du réseau électrique ; en effet, l’hydroélectricité représente environ deux tiers du parc de production de pointe et d’extrême pointe. Elle est en outre un outil de développement économique local, vous l’avez rappelé, avec 2 225 centrales au total en France, la majorité ayant une puissance installée inférieure à 12 mégawatts ; ces centrales sont réparties sur le territoire, notamment dans les territoires ruraux et en montagne.
Dès mon arrivée au ministère, en juin 2012, j’ai été interpellée par de nombreux élus sur l’urgence du renouvellement des contrats d’obligation d’achat des 1 080 petites centrales qui devaient arriver à échéance à partir du mois d’octobre 2012. La loi portant nouvelle organisation du marché de l’énergie, dite loi NOME, avait en effet prévu le renouvellement de ces contrats.
Après concertation avec les fédérations de producteurs d’hydroélectricité, j’ai signé, le 10 août dernier, un arrêté fixant un montant d’investissement en fonction de la taille des installations, ainsi qu’une période de huit ans pour l’étalement de ces investissements, dans un souci de mise à niveau des installations. Afin de ne pas pénaliser les centrales ayant déjà investi dans la période récente, l’arrêté prévoit des aménagements pour prendre en compte la situation particulière de chaque installation, ce qui n’avait pas été envisagé par le précédent gouvernement.
Les services de mon ministère ont ensuite travaillé, en liaison avec les opérateurs compétents, à la mise en œuvre rapide et effective de cet arrêté, afin d’assurer une transition sans heurt entre les anciens et les nouveaux contrats d’achat. J’ai donc approuvé le projet de contrat type, élaboré par EDF Obligation d’achat, ou EDF-OA, en collaboration avec la DGEC, qui avait été soumis à la consultation des fédérations de petits producteurs d’hydroélectricité au début du mois de septembre. Les petits producteurs peuvent donc désormais signer les nouveaux contrats d’achat.
Pour assurer la continuité entre les anciens contrats et les contrats « renouvelés », l’entrée en vigueur du nouveau contrat peut être antérieure à la date de sa signature. Le renouvellement des contrats peut ainsi avoir lieu sans rupture, conformément à l’intention du législateur. L’électricité produite entre la fin de l’ancien contrat d’achat et l’entrée en vigueur du nouveau contrat sera rachetée par EDF-OA à un tarif proche du prix de marché. Cette solution nous a semblé la meilleure pour garantir les intérêts des petits producteurs, tout en s’assurant que les exigences d’investissement sont bien prises en compte.

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que chacun doit respecter strictement son temps de parole ; sinon, tous les orateurs ne seront pas traités équitablement.
Monsieur Savin, je vais vous donner la parole pour la réplique mais, dans la mesure où vous avez largement dépassé le temps qui vous était imparti pour poser votre question, je ne doute pas que vous aurez à cœur d’être bref.

Je serai très bref, monsieur le président.
Madame la ministre, il est important d’accorder aux exploitants un délai supplémentaire, car il ne faudrait pas prendre le risque de mettre en péril toutes ces exploitations.

Madame la ministre, vous avez annoncé, le 7 janvier dernier, des mesures d’urgence pour la relance de la filière photovoltaïque française, afin d’atteindre un objectif annuel de développement de projets solaires pour une puissance d’au moins 1 000 mégawatts en France en 2013. Cet objectif est très ambitieux en comparaison du précédent, fixé à 500 mégawatts.
Sur le fond, je ne peux que souscrire à l’impulsion que vous souhaitez donner à la filière. La transition énergétique ne se fera que par le développement de tous les types d’énergie renouvelable : le solaire sous toutes ses formes, l’éolien, la biomasse, la géothermie, sans oublier l’hydraulique, dont il vient d’être question.
Avec ce plan, vous proposez notamment de revaloriser de 5 % le tarif d’achat pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kilowatts en intégration simplifiée au bâti, de bonifier les tarifs en fonction du lieu de fabrication des modules – jusqu’à 10 % si ces derniers sont d’origine européenne – et de lancer de nouveaux appels d’offres pour les grandes installations d’une puissance supérieure à 250 kilowatts.
À la fin du mois de septembre 2012, la puissance raccordée au réseau était de l’ordre de 4 000 mégawatts. Or l’actuel objectif de la programmation pluriannuelle des investissements – PPI – pour le photovoltaïque est de 5 400 mégawatts. Cette puissance sera vite atteinte, peut-être même dès l’année prochaine. Selon le code de l’énergie, l’autorité administrative ne peut lancer des procédures d’appel d’offres que si les capacités de production installées ne répondent pas encore aux objectifs de la PPI.
Pour progresser, il me semble donc important de sécuriser juridiquement les prochains appels d’offres. Aussi, madame la ministre, comment comptez-vous réviser, dans la PPI, l’objectif pour 2020 en matière de photovoltaïque ? Enfin, pouvez-vous nous préciser si ces mesures sont compatibles avec nos engagements européens et comment elles s’inscrivent dans l’objectif européen « 3 x 20 en 2020 » ?
Monsieur le sénateur, le Gouvernement a en effet pris des mesures d’urgence pour soutenir la filière photovoltaïque française, dans le contexte du débat national sur la transition énergétique dont résulteront un certain nombre de mesures destinées à nous permettre d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République, à savoir que la moitié de la production d’électricité soit obtenue à partir d’énergies renouvelables à l’horizon 2025.
Le débat national devra déboucher sur une loi de programmation qui permettra de réviser la PPI pour l’ensemble des énergies renouvelables, afin d’atteindre cet objectif et de donner aux entreprises le cadre stable, durable et prévisible dont elles ont besoin.
Dans ce cadre, sans attendre les résultats du débat et au regard de la situation de nos entreprises, nous avons pris trois mesures.
Tout d’abord, nous avons lancé un appel d’offres – parfaitement sécurisé sur le plan juridique, monsieur le sénateur – portant sur les technologies de pointe des grandes installations photovoltaïques, domaine dans lequel les entreprises françaises disposent d’une avance technologique.
Ensuite, nous avons relancé des appels d’offres automatiques pour les moyennes installations, avec un cahier des charges révisé qui intègre, notamment, le bilan carbone des panneaux photovoltaïques.
Enfin, nous avons prévu l’évolution des tarifs de rachat pour les petites installations : celles d’entre elles qui respectent un ou deux critères européens liés à la production ou à l’assemblage bénéficient d’un système de bonification.
Ces textes sont parfaitement conformes au code de l’énergie, qui prévoit des systèmes de primes au tarif de rachat lorsque cela correspond aux objectifs de la politique de l’énergie en matière soit de lutte contre l’effet de serre, soit de technologie et de compétitivité économique.
Tel est bien l’objectif des mesures prises par le Gouvernement : soutenir à la fois le développement de l’énergie photovoltaïque, qui est une énergie renouvelable, nos entreprises ainsi que les créations d’emploi dans cette filière, et ce sans attendre l’adoption de la prochaine loi de programmation, qui répondra à vos préoccupations en matière de programmation pluriannuelle des investissements.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre ; elle éclaire quelque peu ce dossier.
J’étais rapporteur, il y a trois ans, du paquet énergie-climat, qui s’est traduit par une directive européenne. Je veillerai donc tout particulièrement à ce que la politique française en ce domaine reste bien « dans les clous », de manière que notre pays soit crédible lorsqu’il s’agira de se doter, enfin, d’une véritable politique énergétique européenne.

Madame la ministre, l’arrêté du 17 novembre 2008, qui est le fondement juridique du tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne, souffre actuellement d’une insécurité juridique qui inquiète les professionnels. Le Conseil d’État, saisi par certaines associations d’un recours contre cet arrêté, se demande en effet si le dispositif ne correspond pas à une aide d’État, ce qui signifierait qu’il aurait dû être notifié à la Commission européenne.
Le Conseil d’État a donc suspendu sa décision au mois de mai 2012 et posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, dont la réponse risque de n’intervenir qu’après de longs mois. Dans cette attente, l’arrêté de novembre 2008 demeure certes en vigueur, mais, selon ce que m’ont indiqué les professionnels de la filière, cette incertitude juridique pèse sur leurs investissements, car les banques hésitent à les financer. Or un gel durable des investissements représenterait une menace directe sur cette filière et les emplois y afférents.
Madame la ministre, disposez-vous d’informations sur l’état de la procédure en cours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne et sur la date à laquelle elle pourrait rendre sa décision ? Pensez-vous qu’il serait possible d’anticiper sa réponse en prenant d’ores et déjà un nouvel arrêté afin de sécuriser le fondement juridique du tarif d’achat éolien et peut-être, au-delà, des autres tarifs d’achat ?
Je tiens à rappeler que l’énergie éolienne terrestre est l’une des plus compétitives des énergies renouvelables. Or, pour ce qui concerne la puissance installée, elle demeure en deçà des objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement. C’est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la proposition de loi présentée par le député François Brottes, examinée aujourd’hui même à l’Assemblée nationale, un certain nombre d’amendements visant à encourager le développement de l’énergie éolienne.
Je sais quelles sont les inquiétudes des acteurs de la filière. Ce sera le rôle de la Banque publique d’investissement, qui doit être la banque de la transition énergétique, de soutenir les entreprises du secteur des énergies renouvelables lorsque celles-ci rencontrent des problèmes de financement.
S’agissant du contentieux que vous avez évoqué, je rappelle que la France n’est pas le seul pays à soutenir le développement des énergies renouvelables. Bien d’autres le font, grâce à la mise en place d’un système d’obligation d’achat de l’électricité produite.
Ce système constitue-t-il ou non une aide d’État ? La question se pose depuis longtemps pour l’ensemble des énergies renouvelables. Tout comme dans d’autres domaines, cette question majeure pour l’ensemble de notre politique énergétique n’a pas été traitée par le précédent gouvernement, qui n’a jamais notifié ce dispositif à la Commission européenne ; nous avons pourtant de bonnes raisons de penser qu’elle l’aurait accepté.
Le Gouvernement ne commettra l’erreur de ne rien faire en attendant le retour de la question préjudicielle issue de l’arrêt du Conseil d’État. C’est pourquoi j’ai d’ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour faire expertiser complètement l’aspect juridique de notre dispositif et engager rapidement des discussions avec la Commission européenne sur ce sujet qui concerne l’ensemble de la politique de développement des énergies renouvelables, au-delà du cas de notre pays.
La filière éolienne a déjà beaucoup souffert de la politique menée au cours des dernières années. La France, j’y insiste, garantira la totalité de la sécurité juridique du tarif de rachat de l’énergie éolienne. Le Gouvernement a également proposé d’autres mesures, notamment celle prévue dans la proposition de loi actuellement en cours de discussion, en vue d’encourager le développement de cette énergie renouvelable.

Je vous remercie, madame la ministre, de sa réponse tout à fait précise.
Je me suis permis de vous interroger sur ce sujet, madame la ministre, parce que l’éolien est l’énergie renouvelable qui présente le plus fort potentiel de développement pour la production d’électricité. Or le nombre de nouvelles installations a diminué de manière frappante au cours des dernières années. La puissance installée en 2011 a été de 832 mégawatts, contre 1 256 l’année précédente, et la baisse s’est encore accentuée en 2012. Je tiens à souligner que ce n’est pas de votre fait, madame la ministre.
Je rappelle que le Grenelle de l’environnement avait fixé comme objectif une puissance installée de 19 000 mégawatts en 2020. Or nous n’avions atteint que 7 000 mégawatts à la mi-2012. Il faudrait donc installer 1 400 mégawatts nouveaux chaque année pour atteindre l’objectif, soit le double du rythme actuel. Il convient dès lors de lever un certain nombre d’obstacles. J’apprécie que vous agissiez en ce sens, madame la ministre, et vous en remercie.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France et la deuxième source de production électrique.
Cette source d’énergie est de loin la plus avantageuse. Elle ne produit pas de gaz à effet de serre, elle est disponible instantanément lors des périodes de pointe de consommation, elle est modulable et stockable. Elle est aussi garante de la sécurité du système électrique national et européen. De plus, cette production permet le stockage dans les barrages de milliards de mètres cubes d’eau, une gestion efficace des crues, la valorisation des voies navigables, l’optimisation des cours d’eau au service de l’activité économique des territoires.
Pourtant, ce patrimoine naturel et industriel historique est aujourd’hui mis en danger. En effet, les exploitations hydrauliques arrivent à échéance et ne bénéficieront plus du droit de préférence : la procédure de renouvellement ne se fera plus de gré à gré, mais devra être soumise à l’application de la « loi Sapin », et donc à une procédure d’appel d’offres européen, exposant de fait ces exploitations à une privatisation.
Le gouvernement de Nicolas Sarkozy, en regroupant certains ouvrages par vallées, afin d’anticiper la fin des concessions, et en définissant un cahier des charges qui oublie toute exigence sociale, avait fait le choix de déposséder la France de ce patrimoine industriel. Or cette procédure n’a pas été formellement abandonnée : d’où notre inquiétude.
Au-delà du volet social, qui est essentiel, nous nous soucions vivement des conséquences de cette procédure sur la « sûreté hydraulique, la gestion de l’eau, le multi-usage de l’eau », la « sûreté du système électrique français », le coût pour l’usager et le maintien de l’activité industrielle.
Vous avez marqué fermement, en octobre dernier, madame la ministre, et nous nous en réjouissons, votre opposition à la libéralisation des barrages hydroélectriques, et vous avez confié à notre collègue député François Brottes une mission visant à explorer de nouvelles pistes.
Pouvez-vous nous confirmer aujourd’hui que vous resterez ferme sur cette position ? Quelles solutions proposez-vous ? Vous inspirerez-vous, par exemple, des autres pays membres de l’Union européenne, comme l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie, qui ont su mettre en place des législations protectrices pour préserver leur opérateur historique ?
Vous raison, madame la sénatrice, de rappeler l’importance des grands barrages et des installations hydroélectriques, qui constituent effectivement un patrimoine énergétique français tout à fait stratégique.
Le précédent gouvernement, vous l’avez dit, s’était engagé à ce que 20 % des concessions d’électricité fassent l’objet d’un renouvellement d’ici à 2015, à la fois dans le cadre de la loi Sapin et d’un certain nombre d’obligations européennes, ce qui signifie que dix concessions hydroélectriques, d’une puissance cumulée de 5 300 mégawatts, auraient dû être renouvelées prochainement par l’État.
L’avenir de ces concessions est un enjeu majeur en termes de transition énergétique, de compétitivité économique et d’emploi. Ces installations se situent d’ailleurs souvent à proximité d’unités de production électro-intensives. Enfin, sur le plan environnemental, il convient de veiller à ce que la gestion des barrages et chutes ainsi que les investissements corrélatifs s’inscrivent dans la stratégie de continuité écologique.
Au moment de prendre des décisions qui engagent durablement l’avenir, j’ai souhaité que ce dossier soit entièrement réexaminé sur le fond. J’ai fait part de mes réticences à l’égard d’une logique de libéralisation et souhaité que l’État s’assure des conditions dans lesquelles la mise en concurrence pouvait s’opérer. Je ne méconnais naturellement pas les dispositions qui régissent le droit des concessions, que ce soit au niveau national ou communautaire. Mes services ont d’ailleurs des contacts suivis avec la Commission européenne sur ce sujet.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de la députée Marie-Noëlle Battistel, a engagé une réflexion de fond sur les différentes solutions qui s’offrent à nous ; elle devrait rendre son rapport à la mi-février. Pour ma part, j’effectuerai un déplacement dans les Alpes le 1er février prochain. Les conclusions de ces travaux seront présentées lors du débat national sur la transition énergétique, et c’est sur cette base que nous opérerons nos choix.

Je vous remercie, madame la ministre, de prendre ce dossier à cœur. Confier la production d’électricité d’origine hydraulique à des intérêts privés reviendrait en effet à mettre en question la stabilité de la production d’énergie électrique, dès lors que cette énergie d’origine hydraulique serait non plus à la disposition du gestionnaire de réseau, mais entre les mains d’industriels, voire de traders. Ce serait renoncer à la gestion coordonnée et anticipée des opérateurs historiques et condamner 6 500 salariés à un avenir incertain.
L’Isère est particulièrement concernée par ce problème. Comme vous l’avez rappelé, c’est d’ailleurs une députée de ce département, Marie-Noëlle Battistel, qui conduit la réflexion sur ce sujet. Ainsi, dans la vallée du Drac, les concessions de trois barrages sont parvenues à échéance et font l’objet d’un appel d’offres européen. Nous avons lancé, avec le Front de gauche, une pétition afin de les maintenir dans le giron public. Je me réjouis, madame la ministre, de pouvoir compter sur votre action et celle du Gouvernement dans ce combat.

Ces questions traduisent une inquiétude commune, que nous partageons avec les professionnels du secteur éolien.
Le 15 mai dernier, le Conseil d’État a rendu sa décision sur le recours du collectif anti-éolien « Vent de Colère » demandant l’annulation de l’arrêté tarifaire de novembre 2008 relatif au tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne. Il a choisi de ne pas statuer et de renvoyer cette question à la Cour de justice de l’Union européenne, qui doit rendre une décision à la fin de 2013.
Cette situation crée de l’incertitude, ce que les professionnels du secteur n’apprécient guère : ils souhaitent en effet connaître le tarif d’achat des prochaines années pour pouvoir calculer leurs investissements, et cette incertitude dans laquelle ils se trouvent se traduit par de l’inertie de leur part.
Je formule donc la même demande que mon collègue Roland Courteau : ne serait-il pas possible, madame la ministre, de déposer une nouvelle demande auprès des instances européennes ? L’Europe étant favorable aux énergies renouvelables, les tarifs d’achat seraient ainsi sécurisés, ce qui permettrait aux professionnels d’investir. Aujourd'hui, les banques comme les professionnels sont en attente. Nous nous faisons l’écho de la Fédération de l’énergie éolienne, qui regroupe 90 % des professionnels de l’éolien et qui espère une sécurisation des tarifs d’achat.
Madame la ministre, vous le savez, l’éolien est une énergie renouvelable, non polluante, produite en France – elle ne peut être importée – et susceptible de créer un secteur professionnel.

Aussi, madame la ministre, peut-on saisir la Commission européenne afin de mettre fin à l’incertitude ?
Monsieur le sénateur, il n’y a pas d’incertitude à entretenir sur les perspectives de développement de l’éolien terrestre en France, je tiens à le rappeler. Nous avons pris des engagements à l’échelle européenne et l’énergie éolienne terrestre est particulièrement compétitive parmi les énergies renouvelables.
Les schémas régionaux éoliens, les SRE, ayant été adoptés, il existe des perspectives d’implantation crédibles. Le Gouvernement est par ailleurs en train de prendre des mesures législatives afin, notamment, d’en finir avec un empilement de mesures qui ont été sources de contentieux avec le dispositif des ZDE – zones de développement éolien –, alors que la procédure des ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement – permet de s’assurer qu’il y a une étude d’impact, et une enquête publique, que les concertations locales ont donc été menées avant toute implantation de projets éoliens.
Nous sommes ainsi sur une trajectoire qui doit permettre de donner confiance non seulement aux entreprises mais également à ceux qui les financent, en particulier au secteur bancaire.
Je tiens à préciser que le contentieux que vous évoquiez concerne toutes les énergies renouvelables et pas seulement l’énergie éolienne puisqu’il porte sur l’ensemble des systèmes d’obligation et de tarif de rachat.
Le Gouvernement français garantira la sécurité juridique des systèmes de tarifs de rachat de l’ensemble des énergies renouvelables. Nous sommes en train de déterminer les modalités dans lesquelles nous garantirons cette sécurité juridique, en fonction des discussions que nous avons avec la Commission européenne et nos partenaires européens. C’est ce qui explique la prudence de mon expression. Néanmoins, je veux être particulièrement claire, rassurante et ferme sur le fait que la sécurité de nos dispositions sera garantie.

Malgré le plaisir que j’éprouve à m’exprimer devant cette assemblée, dont j’apprécie l’écoute, je serai bref puisque Mme la ministre m’a rassuré, comme elle avait rassuré mon collègue M. Courteau, sur le fait que les tarifs d’achat de l’éolien comme du solaire seraient garantis et qu’elle prenait toutes les dispositions pour sécuriser ce secteur créateur d’emplois.
Je me bornerai simplement à indiquer qu’il s’agit d’un secteur stratégique non seulement pour l’énergie et la défense de l’environnement, mais aussi pour le développement de filières industrielles. L’enjeu du renouvelable, c’est non seulement la production d’une énergie propre, l’indépendance énergétique, mais également le développement de filières importantes pour l’économie de notre pays. C’est pourquoi nous vous remercions, madame la ministre, de vos déclarations. Nous soutiendrons les objectifs et les ambitions que vous affichez !

M. Raymond Vall . Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, décidément, les grands esprits se rencontrent !
Sourires.

Le débat actuel sur la transition énergétique doit porter cette ambition et il nous faut, filière par filière, tout mettre en œuvre pour soutenir nos entreprises et relocaliser les emplois perdus au cours des dernières années. Bien sûr, madame la ministre, vous n’y êtes pour rien, mais les dispositions nécessaires n’ont pas été prises et tous les secteurs des énergies renouvelables sont maintenant en attente de mesures fortes de la part du Gouvernement.
J’insisterai particulièrement sur deux secteurs, le photovoltaïque et la géothermie.
J’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, la filière photovoltaïque est en difficulté : la plupart de nos entreprises sont en dépôt de bilan et risquent fort de disparaître. Nous avons besoin de la sécuriser par une politique tarifaire. Surtout, nous ne pouvons plus laisser sans réponses les entreprises qui participent à ces appels d’offres. Il me paraît juste que ces réponses leur soient données.
Je voudrais également attirer votre attention sur la géothermie, qui est, je vous le rappelle, une source d’énergie à caractère permanent. Elle est très peu employée en France, sauf à la marge pour le chauffage en région parisienne, et seule l’Alsace, à ma connaissance, compte une unité de production électrique. Que prévoyez-vous, madame la ministre, pour développer la production d’électricité géothermique ?
Ce que j’ai appelé le patriotisme écologique, monsieur Vall, c’est précisément l’idée selon laquelle chaque euro investi dans les énergies renouvelables, que les Français acquittent sur leur facture d’électricité à travers la contribution au service public de l’électricité, doit se traduire aussi par la création de valeur ajoutée, d’emplois et par le développement de filières industrielles.
Le précédent gouvernement a d’ailleurs laissé une dette considérable, de près de 5 milliards d'euros, dans les comptes d’EDF. Le Gouvernement a annoncé voilà quelques jours qu’il assumerait cette responsabilité, car le financement du développement des énergies renouvelables doit être pris en charge et sécurisé.
Lorsque nous opérons des choix technologiques en matière d’énergie renouvelable, nous devons intégrer le développement d’une filière industrielle amont ainsi que la nécessité de stabiliser les dispositifs réglementaires et tarifaires. Du fait de l’instabilité que nous avons connue ces dernières années en la matière, les emplois dans le domaine des énergies renouvelables sont passés de 105 600 en 2010 à 90 000 en 2012.
Nous voulons donner un coup d’arrêt à ces destructions d’emplois et recréer des emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Comme je l’indiquais, 10 000 emplois sont en jeu dans l’éolien. C’est, par ailleurs, le sens des mesures d’urgence pour le photovoltaïque, où des entreprises françaises en attente de commandes possèdent des technologies de pointe sur le haut rendement, le solaire à concentration, les trakers, qui doivent être au cœur de nos choix technologiques, notamment dans les appels d’offres.
La géothermie est une énergie renouvelable tout à fait stratégique, dont le potentiel considérable n’est pas exploité comme il pourrait l’être. J’ai donc demandé au Comité national de la géothermie de me présenter un ensemble de propositions, qui vont être livrées au Conseil national du débat sur la transition énergétique, afin qu’à l’issue de ce débat nous disposions d’un plan stratégique de développement de la géothermie. Il en sera de même pour la méthanisation, les énergies marines… En d’autres termes, énergie renouvelable par énergie renouvelable, nous rechercherons les potentiels et envisagerons les moyens de mettre en œuvre une stratégie efficace, incluant un volet de développement industriel.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, dont la dernière partie, en tout cas, est très satisfaisante.
Je vous rappelle cependant que les résultats des appels d’offres de juin et de septembre 2012 ont été reportés, ainsi que ceux de l’année 2013. Il me paraît inconcevable de faire attendre plus longtemps les entreprises concernées. Peut-être voudrez-vous bien me faire une réponse écrite sur ce point.

Madame le ministre, l’effacement est un enjeu éminemment écologique, qui s’inscrit au cœur de la transition énergétique, mais qui est d’abord une réponse aux besoins et à la sécurité du réseau en période de pointe. Or la situation de la France en période de pointe ne cesse de se dégrader, celle-ci devenant chaque année davantage importatrice nette, ses importations de compensation étant d’ailleurs constituées dans une proportion importante d’électricité allemande d’origine thermique.
Il y a dix ans, la France était exportatrice. Il y a cinq ans, les besoins français étaient équilibrés. Aujourd'hui, l’estimation des besoins de la période de pointe est de 7 gigawatts, avec une projection de croissance de 1 gigawatt par an. Cette situation est d’autant plus inacceptable que la France dispose des capacités d’effacement nécessaires, qui ne demandent qu’à être mobilisées et à croître, à condition d’être accompagnées, comme le prévoit le dispositif capacitaire mis en place à l’occasion de la loi NOME.
En 2013, alors que la France pourrait disposer de 2 à 3 gigawatts, le budget de RTE – Réseau de transport d’électricité – ne lui permettra pas de mobiliser une capacité supérieure à 700 mégawatts et sera épuisé jusqu’en 2016.
Lors du débat général sur la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, je m’étais félicité de votre réponse par laquelle vous apportiez votre soutien à l’effacement, en vous engageant du reste à signer rapidement le décret relatif au mécanisme de capacité.
Il semblerait qu’en s’abritant derrière l’article 7 la mise en place du dispositif capacitaire se trouve gelé jusqu’en 2016, ce qui ne ferait qu’accroître et fragiliser la situation de la France en période de pointe, alors qu’il faudrait tout faire pour permettre sa montée en puissance. Or, au même moment, vous avez signé le décret relatif à l’interruptibilité, qui sera entièrement financé par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE.
Nous savons tous que le dispositif d’interruptibilité, qui a été glissé dans la loi NOME, ne répond aucunement aux besoins d’effacement et qu’il constitue une « opportunité » visant d’autres fins que vous connaissez bien.
Si l’effacement en période de pointe répond à des besoins de capacité d’approvisionnement sur un modèle écologique, puisqu’il permet d’éviter la mise en service des centrales thermiques, il a de surcroît la vertu économique de permettre une rémunération des industries fortement consommatrices qui se voient bénéficier ainsi d’une ressource non négligeable.
Il est donc pour le moins surprenant que l’interruptibilité, qui n’apportera aucune réponse à l’effacement, puisse mobiliser malgré tout le financement du TURPE et qu’au même moment les capacités d’effacement de la France se trouvent réduites à néant, alors que des dizaines d’entreprises grosses consommatrices disposent d’une ressource dont la mobilisation répondrait à un besoin économique que le maintien de leur activité rend de plus en plus urgent.
Madame le ministre, conformément à vos engagements et à l’intérêt que vous avez manifesté pour l’effacement, quelles mesures entendez-vous prendre immédiatement pour permettre la mobilisation des capacités disponibles en France, nécessaires à la satisfaction des besoins du réseau ainsi qu’à de nombreux industriels pour lesquels cette capacité représente une ressource indispensable ?
Si vous me le permettez, monsieur Vial, avant de vous répondre, j’indiquerai simplement à M. Raymond Vall que les résultats de deux séries d’appels d’offres sur trois vont être publiés dans les prochains jours.
Monsieur Vial, vous avez raison d’indiquer que l’effacement est un enjeu absolument stratégique. De façon générale, les économies d’énergie doivent être au cœur de la transition énergétique. Nous avons un gisement d’économies d’énergie considérable et l’effacement fait partie des solutions qui doivent nous aider à résoudre le problème de la pointe électrique, qui a augmenté de 28 % en dix ans. Celle-ci augmente en effet en moyenne de 3 % par an, c’est-à-dire plus vite que la consommation.
À la fin de l’année 2012, j’ai effectivement pris deux dispositions importantes : la publication du mécanisme de capacité et l’arrêté sur l’interruptibilité. Il ne faut pas opposer ces deux mesures, dont les objectifs sont différents. L’interruptibilité est un dispositif de sécurité du réseau en cas de risque de black-out, avec la possibilité d’interrompre immédiatement, sans prévenir, la consommation importante d’un certain nombre d’industriels. Le mécanisme de capacité doit nous permettre de développer à grande échelle l’effacement, l’effacement diffus comme des effacements plus importants.
Je veux souligner que la proposition de loi visant à préparer la transition énergétique vers un système énergétique sobre, présentée par François Brottes, comporte plusieurs dispositions allant dans le sens que vous souhaitez. Elle permet d’abord la mise en place d’un cadre législatif pour l’effacement diffus. Elle comprend ensuite des dispositions législatives complémentaires sur le mécanisme de capacité. Enfin, j’ai déposé ce matin un amendement afin que RTE puisse organiser des appels d’offres sur l’effacement jusqu’en 2016, afin de permettre sa mise en œuvre sans attendre cette date, dans des conditions qui soient sûres en termes juridiques et tarifaires, ce qui, je pense, répond à votre préoccupation.

Je vous remercie, madame la ministre, de réaffirmer votre soutien à l’effacement, comme vous l’aviez d’ailleurs déjà fait.
Les mesures techniques sont effectivement extrêmement importantes. L’article 7 prend un peu en quelque sorte en otage la mise en œuvre du dispositif capacitaire. J’ai donc été très sensible au dépôt de votre amendement sur la proposition de loi de François Brottes visant à débloquer cette situation. J’en prends acte et je vous en remercie, en espérant que la mise en œuvre du dispositif que vous avez proposé permettra bien de mobiliser les capacités d’effacement, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parmi les sources d’énergie renouvelable, le bois-énergie constitue, en France, un potentiel important et partiellement inexploité.
Outre le fait qu’il peut se substituer à des énergies carbonées, ce potentiel, s’il était mobilisé de manière volontariste, pourrait dynamiser le développement économique de nos territoires : d’une part, en permettant la création de nombreux emplois non délocalisables sur les lieux de production et de transformation et, d’autre part, en entraînant la valorisation de l’ensemble des industries du bois.
Toutefois, la filière bois-énergie connaît certaines difficultés dans l’organisation efficace des circuits locaux d’approvisionnement nécessaires à son développement, mais également dans le développement de la demande, laquelle, bien que croissante, reste dépendante de l’évolution du prix de son principal concurrent, le fioul.
Dans ce contexte, la filière bois-énergie attend des mesures d’incitation de la demande, notamment en direction des collectivités locales, mais aussi de soutien à l’organisation locale de l’offre. Il faut toutefois veiller à ce que celle-ci ne soit pas totalement absorbée par de nouveaux opérateurs de grande dimension.
Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer les orientations que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour soutenir le développement de la filière bois-énergie ?
Monsieur le sénateur, la biomasse, qui représente près de 50 % de la production française totale, est la première filière d’énergie renouvelable de notre pays. Or elle bénéficie rarement de l’attention qu’elle mérite. C’est pourquoi, en tant que ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, je lui avais réservé mon premier déplacement : je voulais souligner l’importance de la biomasse, dont le potentiel est insuffisamment valorisé.
Je rappelle que cette ressource domestique n’est pas soumise à la fluctuation des cours internationaux des matières premières et que, par ailleurs, c’est une énergie propre, certaines avancées technologiques permettant de limiter les émissions atmosphériques liées à sa combustion.
Je rappelle également que la filière bois-énergie représente l’équivalent de 60 000 emplois, dont 36 000 dans les zones rurales, où se développent beaucoup aujourd’hui les projets de réseaux de chaleur et les chaufferies à plaquettes de bois, des plans de gestion durable de la ressource, notamment au travers de la plantation de haies.
C’est pourquoi nous avons décidé, lors de la conférence environnementale, d’assurer un financement pérenne du Fonds de soutien à la chaleur collective, dit « Fonds chaleur », lequel sera doté en 2013 de 220 millions d’euros. Je rappelle qu’un euro d’aide de ce fonds génère 3 euros d’investissements et 15 euros de vente de chaleur sur vingt ans.
Par ailleurs, Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et moi-même avons décidé de faire effectuer conjointement par nos ministères respectifs un travail sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière bois.
Aujourd’hui, un certain nombre de secteurs, notamment le bâtiment, importent trop de bois. La question qui est posée est la suivante : comment valoriser l’ensemble des produits, des sous-produits et des « sous-sous-produits » ? Le bois-énergie a évidemment un rôle décisif à jouer.
Telle est la raison pour laquelle nous avons confié une mission conjointe au Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, et au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, le CGEIET. Leurs conclusions nous seront rendues à la fin du mois d’avril prochain. Parallèlement, le Premier ministre a confié une mission à Jean-Yves Caullet, député de l’Yonne. Il rendra ses conclusions au mois de juin 2013.
Sur le fondement de ces travaux, nous mettrons en place, je l’ai dit, un plan stratégique pour le développement de la filière bois-énergie.
J’ajoute que nous avons intérêt à développer les petites ou moyennes installations plutôt que les très grosses centrales de biomasse, lesquelles posent ensuite des problèmes en termes de gestion durable des plans d’approvisionnement.

Pour assurer la transition énergétique, il est nécessaire de développer l’ensemble des dispositifs relatifs aux énergies renouvelables. C’est donc avec satisfaction que je prends acte de l’intention du Gouvernement d’agir en faveur de la filière bois-énergie, à l’instar de ce qu’il a récemment fait en prenant des mesures d’urgence en faveur de l’éolien en mer et de la filière photovoltaïque.
Cela étant, madame la ministre, je vous demande de veiller tout particulièrement au bon équilibre de l’exploitation des forêts locales, ainsi qu’à une bonne répartition entre les bois d’œuvre et d’ameublement et le bois-énergie.

Monsieur le président, c’est une bonne fortune, lors d’une séance de ce type, d’être le dernier à poser une question quand on a bénéficié d’une présidence vigilante ayant conduit la plupart des orateurs, y compris la ministre, à s’exprimer selon les termes superbement définis par Alphonse Daudet dans une nouvelle restée célèbre. J’ai donc un peu de temps pour exposer ma question.
Il me semble que l’énergie, dont vous avez la charge, madame la ministre, est aussi un enjeu essentiel pour le redressement économique de notre pays dans l’immédiat. Quand on parle d’énergies renouvelables, on a plutôt tendance à se projeter dans un avenir lointain. Or les décisions que vous prenez tous les jours, ainsi que les interventions des acteurs économiques, ont un effet immédiat sur les coûts de l’énergie que supporte aujourd’hui l’économie française. Elles se traduisent par du pouvoir d’achat pour les ménages et de la compétitivité pour les entreprises. Cela est vrai si l’impact est direct sur les prix de l’énergie, mais également si un système de subventions ou d’avantages fiscaux est mis en œuvre.
Vous me direz si je me trompe, madame la ministre, mais j’ai le sentiment que, s’agissant des énergies renouvelables, même si des analyses très stimulantes se font entendre, nous souffrons d’un certain déficit d’information sur les effets économiques et sur le coût des différentes mesures que nous instaurons et des initiatives qui sont prises sur le marché. Il en résulte des approximations et un risque d’abstraction.
Il me semble que le Gouvernement a un rôle particulier à jouer. Il lui revient, selon moi – c’est une suggestion –, de mettre à la disposition de toutes les parties intéressées un outil de transparence et de visibilité économique.
Pourriez-vous nous indiquer, madame la ministre, de quels outils d’analyse économique, voire économétrique, en tout cas d’objectivation, le Gouvernement dispose pour mesurer les impacts sur le coût de l’énergie des différents projets de développement en cours et des mises sur le marché.
De tels outils ne devraient pas nécessairement nous conduire à faire des choix radicaux en faveur d’une énergie aux dépens d’une autre, car il ne s’agit pas de remettre en question le mix énergétique, mais ils nous permettraient de retenir la solution la plus économique possible en cette période de redressement économique, un redressement en faveur duquel le Président de la République s’est résolument engagé. En plus d’offrir de la transparence sur ces questions, ils constitueraient un instrument pédagogique, ce qui est également important.
Monsieur le sénateur, le coût de l’énergie est un enjeu tant pour la compétitivité économique que pour les ménages. C’est un élément tout à fait déterminant du débat national sur la transition énergétique.
L’explosion de la précarité énergétique est un problème majeur, qui nous a dernièrement conduits à étendre les tarifs sociaux de l’énergie. Je rappelle que nous avons fait passer le seuil d’éligibilité aux tarifs sociaux pour une personne seule de 600 à 893 euros de revenus. Les mesures que nous avons prises représenteront, pour une famille se chauffant au gaz, un gain de pouvoir d’achat de 200 euros par an. C’est là une mesure socialement très importante.
Pour nos entreprises également, notamment pour notre industrie, la question du coût de l’énergie est tout à fait décisive.
Aujourd’hui, la moitié de l’énergie finale consommée en France est constituée d’hydrocarbures importés, lesquels pèsent 61, 4 milliards d’euros dans le déficit de notre balance commerciale. Notre dépendance au pétrole et la nécessité de préparer l’après-pétrole sont donc aussi des enjeux économiques tout à fait stratégiques pour notre pays.
Concernant les énergies renouvelables, nous ne reproduirons pas la méthode du Grenelle de l’environnement, qui n’était pas responsable puisqu’elle a consisté à financer à crédit leur développement sur la dette d’EDF, dette que nous nous sommes engagés, au début de la semaine dernière, à résorber.
Lorsque le Gouvernement a récemment annoncé des mesures en faveur du photovoltaïque, par exemple, il a clairement indiqué la charge qu’elles représenteraient, soit 1 à 2 euros sur la facture annuelle de chaque Français. C’est important d’avoir à l’esprit cette dimension.
Pour finir, je soulignerai deux points.
D’abord, quels que soient les moyens de production, et cela ne concerne pas seulement les énergies renouvelables, la nation va devoir investir en matière énergétique. C’est également vrai dans le nucléaire, secteur dans lequel des investissements de sûreté sont nécessaires. L’un des enjeux du débat national sur la transition énergétique sera de faire les bons choix, y compris en termes économiques et en termes d’investissements.
Ensuite se posera la question du financement. Nous devrons étudier tous les modes de financement possibles des énergies renouvelables.

Vous venez de démontrer brillamment que vous étiez très engagée dans la réflexion sur les impacts économiques du coût de l’énergie.
Permettez-moi cependant de vous inciter à aller plus loin dans le cadre du grand débat national sur la transition énergétique. Pourquoi ne pas suggérer aux partenaires de ce débat la mise en place d’une instance ouverte et pluraliste, laquelle serait un lieu de mise en forme aussi concertée et consensuelle que possible d’outils de mesure du coût pour l’économie française des différents choix énergétiques ?
Nous savons bien que ces choix devront se faire dans un contexte de concurrence et que, dans un tel contexte, chacun a toujours tendance à embellir la présentation du coût de son projet.
Notre pays compte une belle institution très peu connue : la Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation, laquelle a rendu des services considérables aux ministres des finances successifs, mais aussi aux parlementaires suivant plus particulièrement les questions financières.
L’équipe qui pilote le débat national sur la transition énergétique compte de bons économistes. Il me semble que la création d’une « commission des comptes énergétiques de la Nation », dont le rôle serait de servir de boussole et d’établir un tableau de bord du coût de nos mesures, serait d’intérêt public.

Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques consacrées aux énergies renouvelables.
Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants ; nous les reprendrons à seize heures quinze.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. Charles Guené.
Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral
Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (projet n° 166 rectifié, texte de la commission n° 252, rapport n° 250).
Je rappelle que, dans la discussion des articles, nous avons entamé l’examen de l’article 2, sur lequel un certain nombre d’orateurs se sont exprimés.

Je rappelle les termes de l’article 2 :
L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 191. – Chaque canton du département élit au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats. »
Sur cet article, je suis tout d’abord saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Doligé, Lefèvre, Cornu et Carle, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 130 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

Étant donné le nombre d’amendements restants, on ne peut qu’être inquiet quant à la suite de nos débats : quand s’achèveront-ils ? Je crois que des décisions doivent être prises.

À ce stade, je puis vous dire que la conférence des présidents se réunira aujourd’hui à dix-neuf heures. Nous en saurons un peu plus à l’issue de cette réunion.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Je crois que je vais faire gagner du temps au Sénat : lors des prises de parole sur l’article 2, il a été largement démontré que le binôme était une curiosité et qu’il posait de nombreux problèmes ; par conséquent, nous sommes hostiles à cet article et nous en proposons la suppression.

Mon intervention ne sera pas beaucoup plus longue que celle de Jean-Jacques Hyest, car, ainsi qu’il vient de le dire, ces deux amendements ont été largement défendus par anticipation.
Je tiens toutefois à féliciter M. le ministre – personne ne l’a fait jusqu’à présent – pour l’imagination dont il a fait preuve, avec ses services, en inventant ce mode de scrutin unique, qui n’est pas sans rappeler le « double mixte » du tennis. §
Au tennis, cependant, il importe que les deux partenaires soient solidaires jusqu’à la fin de la partie. Avec le double mixte politique, la solidarité n’existe que le temps de l’élection ! Après, c’est chacun pour soi !
En milieu rural, le conseiller général a du sens, tous ceux d’entre nous qui sont élus ruraux le savent. Nous craignons que la création de nouveaux cantons beaucoup plus grands, d’une manière générale, que les cantons actuels, ne revienne à éloigner le conseiller général des maires, des élus municipaux, des présidents d’association dont il est l’interlocuteur naturel pour tous les dossiers qui, à moment où un autre, impliquent le département.
Pour le milieu rural, donc, l’adoption de ce texte risque de constituer une régression.
Il y aura certes plus de conseillers généraux pour représenter les cantons urbains, cela ne fait aucun doute. Néanmoins, tous ceux d’entre nous qui sont ou ont été conseillers généraux savent parfaitement que l’interlocuteur principal du président ou du bureau du conseil général pour les dossiers urbains est le maire, et non pas le conseiller général.
Nous savons également que le canton ne signifie rien dans une ville ou une agglomération, où l’on change de canton en traversant la rue. La plupart des habitants des villes ignorent d’ailleurs qui est leur conseiller général.
Le nouveau mode de scrutin proposé par le présent projet de loi n’y changera rien : l’interlocuteur du président du conseil général sera toujours le maire et les conseillers généraux des cantons urbains resteront court-circuités. À la campagne, la régression sera évidente : le conseil général, qui est, comme la commune et à la différence de la région, une collectivité de proximité, se verra éloigné du terrain, des élus, de la population et des associations.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que demander la suppression de l’article 2.
Les sénateurs présents lors de l’examen du texte créant le conseiller territorial savent que j’avais voté pour. J’ai même été celui grâce à qui…

… la loi était passée au Sénat. J’ai donc envie de dire, en forme de boutade : vous avez aimé le conseiller territorial, vous allez adorer le conseiller départemental !
Nouveaux sourires.

M. Michel Delebarre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’ai tenté de suivre l’échange proposé à l’instant par un double parlementaire, qui n’était d’ailleurs pas mixte, mais j’émets un double avis défavorable sur ces amendements.
Nouveaux sourires.
Le Gouvernement, s’appuyant sur le vote de la majorité sénatoriale, a fait le choix de supprimer le conseiller territorial. Certains le regrettent, mais c’est le choix du Gouvernement et de sa majorité.
Un débat s’est ensuivi au sein de la majorité, portant sur le mode de scrutin permettant de préserver et de renforcer le département.
Nous avons écarté le scrutin départemental de liste à la proportionnelle en vertu de la nécessaire proximité avec les électeurs et de la non moins nécessaire représentation des territoires, entre autres raisons rappelées depuis deux jours.
Nous avons également écarté l’idée d’un scrutin mixte, proportionnel pour les départements urbains, majoritaire pour les départements ruraux. Le Sénat connaît particulièrement bien ce type de scrutin. Cependant, nous le savons, il présente des inconvénients politiques et encourt en outre la censure du Conseil constitutionnel.
J’ajoute que beaucoup – notamment ici, au Sénat – sont attachés au scrutin majoritaire, qui offre un lien direct avec les électeurs.
Monsieur Détraigne, vous me faites un grand honneur en faisant de moi l’inventeur du mode de scrutin proposé par ce texte. Hélas pour moi, ce n’est pas le cas ! Cette idée nous est venue du Sénat, et plus particulièrement de celles et ceux qui ont travaillé à la confection du rapport d’information de Michèle André, publié en 2010. Nous avons considéré que ce mode de scrutin avait l’avantage de garantir à la fois la parité et un lien plus direct avec les électeurs et les territoires.
Parallèlement, il importe de tenir compte des évolutions démographiques. C’est le message que nous tentons de vous faire entendre depuis que l’examen de ce texte a débuté. Un avis du Conseil d’État impose le respect du « tunnel » des 20 %. Tout à l’heure, j’ai indiqué que j’étais disposé à considérer les exceptions à ce principe, dont la stricte application pourrait s’avérer par trop brutale dans un certain nombre de territoires. Nombre d’entre vous, sur toutes les travées, se sont exprimés sur ce point, et je les ai écoutés avec la plus grande attention.
Je l’ai dit ce matin, le Gouvernement est disposé à accepter des avancées. Il considère en effet qu’il pourra défendre le texte avec d’autant plus de force devant l’Assemblée nationale qu’il aura reçu le soutien du Sénat. Or j’ai bien noté que nombre des présidents de conseil général qui siègent au sein de la Haute Assemblée étaient attachés à la proximité et défendaient ce mode de scrutin.
Encore une fois, j’entends bien les arguments sur la représentation des territoires. Le système que propose le Gouvernement permet justement de combiner celle-ci avec la parité. Si nous sommes d’accord sur ces deux idées, nous devons avancer ensemble pour trouver les voies du compromis, compromis auquel, sans arrière-pensée politique, je suis prêt, car il en va du rôle des départements dans notre République.
Évidemment, je ne suis donc pas favorable à l’adoption des amendements n° 4 rectifié bis et 130, même si je comprends certaines des préoccupations exprimées, mais je tenais à redire que le Gouvernement était ouvert à vos propositions.

En évoquant le risque éventuel d’une répartition machiste entre conseiller départemental et conseillère départementale, je n’ai fait que reprendre les craintes soulevées ici-même par la présidentede la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mme Brigitte Gonthier-Maurin. §Mes chers collègues, j’ai le texte de son intervention sous les yeux, mais je vous fais grâce de sa lecture !
Je voterai évidemment, comme l’essentiel des membres du groupe UDI-UC, les deux amendements de suppression de l’article 2. Nous avons déjà largement expliqué pourquoi. Comme Mme Isabelle Debré l’a très justement dit, on se sert de la parité pour mettre en place un scrutin « abracadabrantesque » !
J’aimerais également aborder la question des modes de scrutin, que M. le ministre vient d’évoquer.
Certains des arguments avancés sont pour le moins surprenants. Depuis le début de ce débat, on nous explique qu’il faut changer le mode de scrutin parce qu’il y a une disparité entre les cantons ; excusez-moi, mais cela n’a aucun sens ! Chacun reconnaît cette disparité – elle est manifeste, puisque le rapport entre canton peut aller jusqu’à plus de quarante – mais faut-il pour autant changer le mode de scrutin ? Ce qu’il faut faire, c’est redécouper les cantons. Cela, personne ne le conteste.
Pour garder le mode de scrutin actuel, auquel je nous crois tous, ou presque, fondamentalement attachés, tout en faisant progresser la parité, ce qui est effectivement une exigence constitutionnelle, mettons en place un système de pénalités. Contrairement à ce que M. le ministre déclarait ce matin, c’est tout à fait possible : si aucune pénalité n’est prévue par les textes aujourd'hui, rien n’empêche d’en instituer.
Nous aurions donc tout à fait pu envisager le maintien du scrutin uninominal à deux tours dans des cantons, qui auraient été redécoupés, à taille humaine et l’instauration de pénalités à l’encontre des partis politiques ne favorisant pas la parité.
M. le ministre a aussi balayé de manière un peu hâtive une autre proposition, celle du scrutin mixte : scrutin uninominal à deux tours dans les zones rurales, où il est indispensable parce dans ces zones le conseiller général correspond davantage à une réalité, à une identité, à une légitimité propre parce qu’il est connu ; éventuellement, scrutin de liste en zone urbaine, où le conseiller général est beaucoup moins connu.
D’ailleurs, contrairement à ce que semble affirmer M. le ministre, scrutin mixte ne signifie pas scrutin majoritaire pour certains départements et scrutin de liste pour les autres ; on peut très bien combiner les deux modes de scrutin au sein d’un même département selon que l’on se situe en zone urbaine ou en zone rurale.
Un tel dispositif serait, selon M. le ministre, inconstitutionnel. Pourtant, dans le cadre du rapport que j’ai rédigé en 2010 avec mon excellent collègue Pierre-Yves Collombat au nom de la délégation aux collectivités territoriales, j’ai été amené à auditionner un certain nombre de constitutionnalistes, dont plusieurs – je pense notamment à M. Jean-Claude Colliard – sont peu suspects de sympathie envers la droite. Tous nous ont indiqué qu’un tel mode de scrutin ne soulevait aucune difficulté de la sorte.
Par conséquent, le débat ne se limite pas à l’alternative à laquelle M. le ministre souhaite le réduire entre, d’une part, le scrutin proportionnel, que nous sommes une majorité à rejeter, et, d’autre part, le scrutin abracadabrantesque qu’on nous propose !

Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer qu’en cas d’adoption de ces amendements identiques, l’article 2 serait supprimé et le débat sur le mode de scrutin des élections départementales cesserait ?

Dans ces conditions, je souhaite m’adresser à M. Maurey, ainsi qu’aux membres de son groupe.
Mes chers collègues, vous avez indiqué qu’il y avait d’autres pistes. Mais si vos amendements de suppression sont adoptés, vous ne pourrez pas les mettre en débat et vous laisserez aux députés le soin de décider seuls du mode de scrutin applicable aux élections départementales.

Par conséquent, comme j’ai l’intention de proposer un autre mode de scrutin, je ne souhaite pas que la discussion s’arrête.
Je voterai donc contre ces deux amendements identiques, dont l’adoption priverait le Sénat d’une prérogative essentielle sur un sujet qui le concerne au plus haut point.

Par ailleurs, je trouve tout de même intéressant de mener la discussion jusqu’à son terme, position qui était au demeurant déjà la mienne s’agissant du projet de loi de finances pour 2013.
La seule critique que je ferai du dispositif, monsieur le ministre, c’est qu’il maintient le nombre de conseillers généraux. Or, dans un département comme le mien, quarante conseillers généraux pour 293 000 habitants, c’est encore dix de trop ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà clairement exprimé un certain nombre de réserves quant au système électoral proposé.
Cela étant, il faut faire preuve de cohérence. Quitte à mettre fin à la discussion, ce à quoi aboutirait de facto le rejet de l’article 2, il fallait adopter les motions de procédure !
M. le président de la commission des lois acquiesce.

Même si nous ne voterons vraisemblablement pas le texte in fine, il nous semble utile que le Sénat puisse débattre des articles suivants, puisque M. le ministre nous a indiqué qu’il était ouvert à certaines évolutions – à vrai dire, je n’ai pas encore très bien compris lesquelles, mais il nous l’expliquera sans doute.
Pour notre part, si nous ne remettons en cause ni la parité – nous la souhaitons –, ni la nécessité de redécouper les cantons, car les écarts qui existent sont inacceptables, nous considérons qu’il faut aller plus loin que la règle des plus ou moins 20 %. Nous proposons de la porter à plus ou moins 30 %, voire à un taux plus important, afin de nous donner de la marge.
En fait, monsieur le ministre, le véritable débat porte sur le nombre d’élus. C’est là que réside la difficulté.
Sous le précédent quinquennat, on nous a expliqué que les élus étaient trop nombreux et qu’ils coûtaient trop cher. Pourtant, il était – et il est toujours – possible de mettre en place un système qui, s’il tendait effectivement à augmenter un peu le nombre d’élus, permettait aussi de trouver plus facilement un consensus.
Nous ne voterons donc pas la suppression de l’article 2 pour que le débat puisse se poursuive. Nous aurons ainsi le plaisir d’entendre M. le ministre à propos des évolutions possibles, même si j’ai cru comprendre que la porte était fermée, …

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié bis et 130.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que les avis de la commission et du Gouvernement sont défavorables.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 81 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 312, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 191 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Dans chaque département est institué un canton unique. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Les Verts ont de la suite dans les idées. Comme vous le savez, nous sommes des partisans absolus de la proportionnelle. Or, pour qu’il y ait proportionnelle au sein du département, il faut que celui-ci constitue un canton unique.

L'amendement n° 210, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191 . – Les conseillers départementaux sont élus à la proportionnelle intégrale sur une seule circonscription électorale, à partir de listes de candidats comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Cet amendement ne surprendra personne.
L’article 2 du projet de loi pose le principe d’un binôme de candidats de sexe différent aux futures élections départementales.
Évidemment, le groupe CRC soutient la mise en place d’une réelle parité dans les assemblées départementales ; sur ce point, le projet de loi constitue une avancée importante.
Néanmoins, le respect de la parité, qui est une priorité constitutionnelle, ne doit pas se faire au mépris d’une autre exigence constitutionnelle, à savoir le pluralisme. Ma collègue Éliane Assassi l’a souligné dans la discussion générale, pour nous, le binôme républicain, c’est la parité et le pluralisme.
Nous savons tous que ces deux principes constitutionnels peuvent se concilier. Pourquoi alors ne pas mettre en place le seul mode de scrutin qui réponde à cette double exigence ? Nous l’avons déjà fait pour les autres élections locales, à savoir les municipales – nous allons d’ailleurs abaisser le seuil d’application du scrutin proportionnel – et les régionales. Il paraît même que le Gouvernement envisage une part de proportionnelle pour les élections législatives.
Pourquoi cet anachronisme démocratique pour les élections départementales, qui seraient alors les seules à ne pas prendre en compte l’exigence de pluralisme ?
Cet amendement, qui vise à mettre en œuvre pour l’élection des conseillers départementaux un scrutin de liste départementale, à parité et à la proportionnelle, permet de prendre en compte les deux principes démocratiques de parité et de diversité.
Cette proposition est d’autant plus d’actualité qu’avec le vote par binôme prévu dans le projet de loi le pluralisme va certainement encore régresser.
Le nouveau mode de scrutin, doublé d’un redécoupage cantonal dont nous connaissons tous les dangers, sera sans nul doute le vecteur d’un bipartisme renforcé, et donc d’un nouveau recul démocratique.
Pour revenir sur les échanges que nous avons eus ce matin, la proximité est nécessaire et doit se retrouver dans l’exercice du mandat.
Qu’il me soit permis de réagir à une réflexion : il y a aujourd’hui autant d’apparatchiks élus au scrutin proportionnel qu’au scrutin uninominal !
La ruralité, quant à elle, peut être mal défendue quand elle est la propriété d’un seul homme ou d’une seule femme. Au contraire, elle peut être fortement défendue quand avec les acteurs du monde rural les projets sont construits et portés jusqu’au bout. Avec la crise, le monde urbain et le monde rural sont frappés de la même façon. Cessons donc de les opposer en permanence !
Enfin, certains ont dénoncé la présence de plusieurs élus sur un même territoire. Qu’il me soit permis de leur rappeler qu’il en va aujourd’hui ainsi pour les sénateurs. Pourquoi la pluralité ne fonctionnerait-elle pas dans les circonscriptions départementales ?

L'amendement n° 309, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. - Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Avec votre accord, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 308.

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 308, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, qui est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. - Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

L’amendement n° 309 vise à instaurer un scrutin de liste classique pour les élections départementales.
Si vous craignez que ce scrutin de liste ne nuise à la proximité entre les conseillers départementaux et les électeurs, je vous propose un amendement de repli.
L’amendement n° 308, conformément à ce que propose Michel Delebarre dans son excellent rapport, prévoit des sections. Il y aurait quatre sections dans les départements, soit des méga-cantons. Le scrutin s’apparenterait à ce qui se pratique déjà pour les régionales, où les listes sont divisées en sous-listes par départements. La proximité serait ainsi préservée.
Pour que la parité soit respectée, il faudrait qu’au sein du scrutin à quatre sections il y ait deux hommes et deux femmes têtes de liste.
C’est une de nos nombreuses propositions en vue de la mise en place d’un scrutin proportionnel au niveau départemental.

L'amendement n° 229 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin et Chevènement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections correspondant aux intercommunalités ou regroupements d'intercommunalités du département. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Pour être élu au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25 % des inscrits.
« Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours.
« Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour.
« Les regroupements d'intercommunalités sont constitués lorsque la taille de celles-ci est inférieure au rapport entre la population départementale et le nombre de conseillers départementaux. La population de ces regroupements ne peut être inférieure de plus de 30 % à ce rapport.
« Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux lors de la promulgation de la loi n° … du … relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Des modifications mineures peuvent cependant y être apportées pour tenir compte de l'évolution de la population du département.
« Le nombre de sièges attribué aux sections du département tient compte de la population et de la taille des intercommunalités, afin de permettre une représentation équilibrée des territoires.
« À l'issue du premier ou du second tour de scrutin, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

La solution alternative que prévoit cet amendement me paraît crédible.
Elle satisfait aux mêmes impératifs, à la fois en termes de parité, d’expression du territoire et de proximité, que celle qui nous est proposée dans le projet de loi. De plus, elle permet une meilleure expression de la diversité.
Surtout, elle ne présente pas l’inconvénient du mode de scrutin envisagé par le Gouvernement, à savoir le caractère non-significatif des circonscriptions. On sait que si les cantons avaient une signification en milieu rural, ils n’en avaient pas en milieu urbain. Là, ils n’en auront plus nulle part !
De plus, cet amendement permet de maintenir une expression minimale des territoires ruraux. En effet, le principal reproche qu’un élu rural peut faire au scrutin majoritaire binominal est qu’il réduit considérablement le poids des territoires ruraux au sein du département.
Je propose d’instaurer un mode de scrutin à la proportionnelle, non sur la base départementale, qui est effectivement trop grande, mais sur la base de circonscriptions infra-départementales.
Sur ce point, on me cherche querelle : ce serait trop tôt, car les intercommunalités ne seraient pas achevées. Certes, mais elles sont très avancées ! Au mois de juin, les schémas seront terminés.
Nous pouvons nous appuyer sur ces découpages, ce qui ne signifie pas les reproduire : le Gouvernement reste maître de choisir les circonscriptions les plus significatives pour l’électeur, c'est-à-dire celles qui correspondent à une réalité.
Toutes choses inégales par ailleurs, c’est un peu le problème qui s’est posé autrefois aux révolutionnaires lorsqu’il a fallu découper les départements. Certains voulaient un découpage géométrique pour faire disparaître les divisions de l’Ancien Régime. D’autres, comme Mirabeau, préféraient qu’il soit tenu compte des réalités. Ces derniers ont obtenu gain de cause et, preuve que ce découpage n’était pas si mauvais, il a traversé les siècles.
C’est une solution de même type que je présente aujourd’hui. Le nombre de sièges serait modulé en fonction de l’importance de circonscriptions fondées sur les intercommunalités ou sur des regroupements d’intercommunalités, tenant en tout cas le plus possible compte des intercommunalités.
Cette solution me paraît susceptible de recueillir un grand nombre de suffrages. Elle n’est pas sans inconvénients, mais elle en présente moins que ce qui nous est proposé dans le projet de loi.

L'amendement n° 211, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191 . – Le conseil départemental est composé d’élus représentant chaque canton du département et d’élus issus de listes départementales, soutenues par les candidats se présentant au suffrage des électeurs dans chaque canton. Ces élus sur listes représentent 30 % de l’assemblée départementale.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Nous ne sommes pas des jusqu’au-boutistes, comme certains semblent le croire. Simplement, nous pensons que, faire de la politique, c’est proposer, défendre, entendre et, ensemble, trouver des solutions. Voilà pourquoi nous avons déposé ce deuxième amendement.
Je l’ai souligné, le scrutin majoritaire pose de sérieux problèmes de représentativité et de légitimité.
Les principaux partis sont surreprésentés, et rares sont les petits partis qui ont des élus. Ils ne peuvent souvent en avoir que par le biais d’accords électoraux avec plus gros qu’eux, ce qui renforce, en fait, le bipartisme.
Partisan d’un scrutin proportionnel intégral, qui semble plus respectueux des principes républicains de parité et de pluralisme, le groupe CRC présente cet amendement de repli, mais aussi de consensus, c'est-à-dire susceptible de conduire à une solution.
Notre amendement vise à introduire un scrutin mixte. Cette proposition a pour avantage d’assurer tout à la fois la représentation des territoires, la parité et le rééquilibrage de la représentation des diverses sensibilités politiques par un scrutin de liste à la proportionnelle pour 30 % des conseillers départementaux.
Par-delà nos différentes approches, il s’agit d’un signe qui marque la volonté de parvenir à un accord entre les différentes composantes de la majorité sénatoriale, qui ont rejeté unanimement le conseiller territorial prévu par l’ancienne majorité.
Si une majorité d’entre vous, mes chers collègues, votait cet amendement, nous pourrions utiliser le temps de la navette parlementaire pour affiner la proposition et construire un mode de scrutin, certes, inédit dans notre pays, mais qui s’apparenterait, d’une certaine façon, à ce qui se pratique parfois au-delà de nos frontières.
C’est dans cet espoir que nous soumettons cet amendement à votre vote.

L'amendement n° 119, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191 . – Les cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux sont de deux natures :
« - les cantons d'agglomération où les conseillers départementaux sont élus sur des listes à la proportionnelle au plus fort reste à deux tours ;
« - les cantons hors agglomération où les conseillers départementaux sont élus au scrutin uninominal à deux tours. »
La parole est à M. Éric Doligé.

Plusieurs solutions sont possibles, comme le prouvent les différentes propositions qui viennent d’être avancées. Au départ, nous avions le sentiment qu’il n’y avait que deux options : le scrutin proportionnel et le scrutin binominal.
À entendre nos collègues du groupe socialiste, que j’ai écoutés attentivement, nous avions le choix entre la peste et le choléra. C’était soit la guillotine, soit la pendaison ! Finalement, le scrutin binominal aurait été retenu pour éviter le scrutin à la proportionnelle, qui leur paraissait pire.
Ce matin, seule a été rappelée la position de M. Lebreton, président de l’Assemblée des départements de France, qu’Yves Daudigny a été chargé de nous faire connaître, mais je rappelle à mes collègues de la majorité, et notamment à M. Guillaume, que M. Kanner, président du conseil général du plus grand département de France, a souhaité, lors de récentes discussions au bureau de l’ADF, que les différences de positions puissent s’exprimer au sein de cette dernière…
Les positions ne sont donc ni aussi claires ni aussi unanimes que vous l’affirmez. En tout cas, il ne faut pas penser que l’opposition est d’accord avec la majorité sur ce sujet.

C’est la position d’une partie de l’ADF, pas de sa totalité !
En ce qui me concerne, j’ai toujours été clair par rapport à tous mes choix. Il n’en ira pas autrement ici.
D’autres solutions que celle qui est proposée dans le projet de loi sont possibles. Nous n’avons pas seulement le choix entre le scrutin proportionnel intégral et le scrutin binominal. Mme Cukierman vient d’ailleurs de faire une ouverture en proposant un scrutin mixte.
L’amendement n° 119 va également dans ce sens et j’ai eu le sentiment qu’un certain nombre de mes collègues étaient assez favorables au scrutin mixte.
Certes, on nous a objecté que ce ne serait pas constitutionnel, mais, tant que le Conseil constitutionnel ne se sera pas prononcé, nous n’en saurons rien. Même les experts que nous avons entendus sont partagés.
Par ailleurs, je rappelle que nous sommes élus au Sénat par le biais d’un scrutin mixte et que le Président de la République a annoncé souhaiter que 10 % des députés, donc cinquante-huit d’entre eux, soient élus à la proportionnelle, ce qui conduirait à un scrutin mixte de scrutin à la proportionnelle et de scrutin uninominal.

Mon amendement vise à maintenir la proximité tout en tendant vers la parité, qui est un objectif constitutionnel. L’idée est d’instaurer des cantons d’agglomération. Dans ces circonscriptions, qui sont bien déterminées, les conseillers départementaux seraient élus sur des listes « chabada », comme on les appelle, à la proportionnelle intégrale pour assurer la parité.
Dans les agglomérations, le scrutin à la proportionnelle intégrale permettrait d’assurer la parité et, dans les secteurs hors agglomération, on en resterait au système actuel, c'est-à-dire le scrutin uninominal à deux tours, ce qui garantirait une bonne représentation dans les cantons ruraux, comme aujourd’hui, la taille des cantons devant, bien sûr, être redéfinie.
Il y a toute une réflexion à mener. À la limite, si le tunnel n’était plus de plus ou moins 20 % mais de plus ou moins 30 %, voire de plus ou moins 40 %, on pourrait trouver des solutions permettant une représentation rurale au scrutin uninominal et une représentation des agglomérations à la proportionnelle. Cela pourrait répondre à plusieurs des préoccupations que nous exprimons tous.
Si le Sénat retenait cette solution, qui présente l’intérêt de lever certains blocages, il pourrait la retravailler d’ici à la deuxième lecture ; entre-temps, nous connaîtrions également l’avis de l’Assemblée nationale.

L'amendement n° 335 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard, Carle et Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Doublet et Houel, Mme Lamure et MM. Paul, Pillet, Trillard et D. Laurent, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. - Les communes du département membres d’un même établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants forment un canton élisant au moins deux membres du conseil départemental.
« Chaque autre canton du département élit un membre du conseil général. »
La parole est à M. Éric Doligé.

L'amendement n° 107, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 191. - Les électeurs de chaque canton du département élisent au scrutin binominal à deux tours au conseil départemental deux membres de sexe différent qui se présentent en binôme de candidats. »
La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Dans le cas où mon amendement n° 119 ne serait pas retenu, ce qui, bien sûr, m’étonnerait, car c’est le meilleur des systèmes
Sourires.

À la formule « chaque canton du département élit », je préfère « les électeurs de chaque canton du département élisent », car ce sont les électeurs qui élisent les conseillers départementaux, non les cantons. Je précise que, si vous m’accordiez cette précision, ce serait une très petite satisfaction, car ce n’est vraiment pas cet amendement que je souhaite voir retenu ! §

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, C. Bourquin, Chevènement et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
canton
par le mot :
section
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Husson et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
membres
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Adnot.

J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer la philosophie de cet amendement. Je ne jette pas l’opprobre sur le texte du Gouvernement, mais la solution que je préconise me paraît plus en harmonie avec ce que souhaitent les différents intervenants qui se sont exprimés aujourd’hui.
Je propose donc que l’on retienne la proportionnelle pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et que l’on en reste au système actuel dans les cantons hors agglomération. Ce qui s’entend pour les communautés d’agglomération s’entend, évidemment, pour les collectivités plus importantes, métropole et autres.
C’est également compatible avec le redécoupage des cantons, qui devrait tenir compte, non seulement des critères géographiques, mais également des critères démographiques. À cet égard, je proposerai tout à l’heure un amendement permettant, dans les territoires d’une densité inférieure à vingt habitants par kilomètre carré, de déroger à la règle instituée par le texte qui concerne les découpages.
Ma proposition, qui me semble en harmonie avec les attentes exprimées sur toutes les travées, mériterait que l’on s’y attarde un peu. Comme l’a très bien dit Éric Doligé, si cette porte était ouverte, la discussion pourrait être fructueuse.

L'amendement n° 51 rectifié ter, présenté par MM. J. Boyer, Détraigne, Roche et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
différent
insérer les mots :
issus de communes différentes, originaires d'une ancienne structure élective cantonale différente,
La parole est à M. Jean Boyer.

Cet amendement n’a pas pour objet de compléter une liste, peut-être un peu regrettable, d’involontaires oppositions avec telle ou telle structure.
Il vise à empêcher, compte tenu du fait que les territoires seront vastes, que deux conseillers soient issus de la même commune. Dans le monde rural, je le dis souvent, quand bien même nous avons des tailles différentes, nous sommes tous des petits. §
Mon amendement prévoit donc que les conseillers soient issus de communes différentes mais aussi de différents anciens cantons. C’est la garantie que la réalité du terrain sera prise en compte.

L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Détraigne, Mme N. Goulet, MM. Dubois, B. Fournier, Roche, Lasserre, Mercier et Namy et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
différent,
Insérer les mots :
électeurs de communes différentes, dans les cantons qui comprennent plusieurs communes,
La parole est à M. Pierre Jarlier.

Cet amendement a le même objet que celui de M. Boyer, bien qu’il diffère du sien dans sa rédaction puisque j’ai remplacé le mot « issus » par « électeurs » ; il me semble important que les futurs conseillers départementaux, à l’intérieur d’un même canton, soient issus et électeurs de deux communes différentes afin d’assurer une bonne représentation géographique.

L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Saugey et Carle, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui se présentent en binôme de candidats
par les mots :
issus de communes différentes lorsque le canton est composé de plusieurs communes
La parole est à M. Michel Savin.

Cet amendement, comme les deux précédents, vise à éviter la surreprésentation d’une commune au sein d’un canton.
En effet, si les deux conseillers départementaux sont issus tous les deux de la ville la plus peuplée du canton, il y a un risque que les communes les moins peuplées de ce canton ne soient plus représentées au sein de l’assemblée départementale, ce qui n’est pas conforme, monsieur le ministre, à votre volonté de préserver la diversité des territoires.

L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Buffet, Cardoux et Charon, Mmes Debré et Duchêne, Mlle Joissains, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lecerf, Lefèvre, Legendre, P. Leroy, Marini, Pierre, Retailleau, Carle, Hyest et Billard, Mme Deroche, MM. Ferrand, B. Fournier et Gournac, Mme Hummel, M. G. Larcher, Mmes Primas et Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
représentant chacun l'une des sections du canton
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Nous proposons que deux personnes soient élues en même temps, mais que chacune représente l’une des deux sections du canton. Les sections permettent d’avoir des cantons à taille humaine.
Cette idée, qui est celle de notre excellent collègue René-Paul Savary, président du conseil général de la Marne, me paraît intéressante, car elle permet d’éviter un des inconvénients des binômes.

L'amendement n° 310, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque département, 20 % des conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Cet amendement, qui reprend en partie une proposition de nos amis communistes, a pour objet d’instiller, comme a aussi proposé de le faire le Président de la République, une dose de proportionnelle dans un scrutin uninominal ou, en l’espèce, binominal. Ainsi, 20 % des conseillers départementaux seraient élus à la proportionnelle.

L’échange de vues auquel nous avons procédé ce matin laissait quelque peu augurer de la présentation des amendements à laquelle nous venons d’assister.
Selon sa logique propre, chacun de leurs auteurs a tenté de démontrer l’intérêt de la solution qu’il propose, et un certain nombre de ces propositions vont effectivement assez loin dans la réflexion. Ainsi, M. Collombat décrit au travers de ses amendements un mécanisme qui répond, selon lui, aux préoccupations exprimées par le ministre et Mme Cukierman a proposé des d’amendements de repli, au cas où sa proposition principale serait refusée.
Ce débat est intéressant, mais, étant chargé de rapporter la position de la commission, je ne peux, au hasard, accepté tel amendement et refusé tel autre. Je suis donc tenu d’émettre un avis défavorable sur tous ces amendements, à une seule exception près toutefois.
Je suis favorable à l’amendement n° 107, mais je suis un peu ennuyé puisque j’ai cru comprendre que son auteur ne se satisferait pas de cet avis… §Je déplore, monsieur Doligé, que ce ne soit pas celui que vous souhaitez voir adopté, mais la rédaction que vous proposez me paraît devoir être retenue.
Donc, au nom de la commission, je donne un avis favorable à l’amendement n° 107 et un avis défavorable à tous les autres.
Le rapporteur vient de dire des choses très justes. J’observe que, dès qu’il s’agit des modes de scrutin, chacun fait preuve d’une très grande imagination, et non pas seulement le Gouvernement, qui, encore une fois, n’a fait que puiser dans les réflexions du Sénat. Dans ce débat de qualité, chacun cherche évidemment la bonne voie.
Je précise d’emblée que les amendements qui prévoient d’instaurer un scrutin de liste à la proportionnelle pour l’ensemble du département ne peuvent recueillir l’accord du Gouvernement.
J’ajoute que je suis, comme le rapporteur, favorable à l’amendement n° 107.
Afin de ne pas répéter ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire depuis le début de la discussion, je m’arrêterai seulement sur le mode de scrutin mixte – la mixité est donc possible… (
D’ailleurs, contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure, le double mixte ne vaut pas uniquement pour un seul match au tennis ; en général, il dure tout un tournoi. Les grands champions de double mixte ont gagné plusieurs tournois, ce qui prouve que cela peut durer. Je vous trouve pessimiste sur la capacité d’un couple à résister – je me place sur le plan politique
Sourires.
Certains d’entre vous proposent un mode de scrutin combinant le recours au scrutin uninominal dans les zones hors agglomération urbaine et l’instauration d’un scrutin proportionnel dans les zones urbaines. Il permettrait d’assurer la représentation des territoires sur la base d’un nouveau découpage cantonal tenant compte des spécificités rurales, d’une part, et des spécificités urbaines, d’autre part, et favoriserait en même temps une meilleure représentation des sensibilités politiques grâce à la proportionnelle ainsi que la parité par le recours à une part de scrutin de liste.
Toutefois, essayant de rentrer dans la logique de cette proposition, je ferai d’abord observer que les cantons dits ruraux ne le sont pas tous complètement, notamment dans la grande couronne d’Île-de-France.
Il y a des agriculteurs, qui doivent évidemment être représentés, mais ils sont peu nombreux, car les exploitations s’étendent souvent sur beaucoup d’hectares, et il y a de petites communes.
Je fais mienne votre préoccupation, mais ce mode de scrutin serait particulièrement complexe parce qu’il exigerait la fixation par la loi d’un critère objectif permettant de répartir les sièges entre cantons d’agglomération et cantons hors agglomération. Il serait délicat à mettre en œuvre dans les départements essentiellement urbains ou, à l’inverse, dans ceux qui n’ont pas de zones urbaines. Certains départements sont totalement urbains, d’autres sont totalement ruraux, d’autres sont mixtes.
En termes de compréhension, sur le plan national, de ces questions, il y a là, me semble-t-il, une difficulté. La complexité n’est pas ce que le Gouvernement recherche : il a fait le choix d’un mode de scrutin lisible, simple, uniforme, quel que soit le département ou le canton considéré.
Enfin, le risque d’inconstitutionnalité du mode de scrutin proposé ne peut être écarté. C’est d’ailleurs, nous l’avons souligné, un argument que les uns et les autres peuvent se renvoyer.
Vous me dites qu’il faut attendre que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Il nous a parfois été fait le reproche – et ce reproche a par le passé été adressé à d’autres gouvernements – de ne pas avoir été suffisamment sensibles au risque d’inconstitutionnalité. J’essaie donc de ne pas prendre trop de risques en la matière !
Le suffrage des électeurs n'étant pas pris en compte de la même manière selon qu'ils votent dans une zone rurale ou dans une zone urbaine, il est possible d’estimer qu'il y a un risque de rupture de l'égalité des citoyens devant le suffrage.
Nous tenons, certes, monsieur Mézard, à ce que les territoires soient représentés, mais, malgré tout, avant de représenter des territoires, les élus représentent des électeurs. Même si ces deux aspects sont étroitement liés, ce sont les électeurs qui élisent les conseillers généraux et qui, demain, éliront les conseillers départementaux.
La rupture d’égalité constitue donc un véritable risque, raison pour laquelle, je l’ai dit, le Gouvernement est défavorable à tous ces amendements, à l’exception de l’amendement n° 107.

Ces amendements démontrent que la question du mode de scrutin, en particulier proportionnel, est essentielle.
Je ne peux pas laisser dire que les petits partis ne peuvent pas obtenir d'élus au scrutin majoritaire. Dans mon département, nombre de petits partis y sont parvenus ! Il suffit pour cela de présenter de bons candidats, et ceux-ci seront élus. Les candidats n'ont qu'à se présenter seuls. Nous sommes un certain nombre de non-inscrits ici ; nous nous sommes présentés seuls, y compris aux élections sénatoriales, et nous avons été élus.
Il est donc faux de dire que le pluralisme politique ne peut être obtenu que par la proportionnelle. Si les candidats ne sont pas très bons, il leur faut une étiquette politique, mais s’ils sont bons, ils n’ont pas nécessairement besoin d’un scrutin à la proportionnelle pour être élus. Or, dans les cantons, il y a beaucoup de bons candidats élus sans aucune étiquette politique.

Par ailleurs, il ne faudrait quand même pas instaurer la proportionnelle dans les villes et ne pas le faire dans les campagnes ! Le gouffre se creuserait encore plus entre les unes et les autres : il y aurait les rats des villes et les rats des champs…
Pourquoi devrait-on traiter différemment les villes et les campagnes ? Si l’on crée des cantons dans les campagnes, il n'y a pas de raison de ne pas en créer aussi dans les villes. Je ne vois pas pourquoi certains habitants auraient droit à un élu territorialisé, tandis que les autres seraient obligés de subir la proportionnelle, c'est-à-dire un système dans lequel, vous le savez bien, on doit voter pour un magma de candidats sans trop savoir à qui on a affaire.
Pour ma part, j’estime que la disposition du projet de loi qui vise à créer de grands cantons représentés chacun par deux personnes assure la territorialité des élus : une fois le système en place, chaque élu deviendra un interlocuteur pour la population et les municipalités.
Quand j’entends dire que si nous passons d’un à deux élus par canton ce sera la fin du monde, je crois rêver ! Ceux qui seront élus dans ce cadre comprendront très vite que, s'ils veulent être réélus, ils doivent s'occuper des habitants et des municipalités qu’ils représentent. Et cela se passera très bien !
Par ailleurs, c’est bien pour répondre à l’exigence de parité qu’il est prévu d’élire deux conseillers départementaux par canton. Il y aura toujours autant de conseillers, mais, je l’ai dit ce matin, lorsqu’il s’agit des cantonales, on pense non pas au nombre de conseillers mais au nombre d'hommes !
Effectivement, il y aura deux fois moins d'hommes dans les conseils départementaux que dans les conseils généraux, mais rappelez-vous, mes chers collègues, des débats au Sénat lors de l’instauration de la parité aux élections sénatoriales !

À l’époque aussi, certains sénateurs croyaient que ce serait la fin du monde !
Aujourd'hui, nous avons dans cette enceinte de charmantes collègues qui travaillent aussi bien que les hommes. Le système fonctionne remarquablement et chacun trouve que la parité est une réussite. Chacune avec sa sensibilité politique, les femmes apportent une vision des problèmes qui leur est propre. D’ailleurs, si nous faisions aujourd'hui un sondage ici, je crois qu’il n’y aurait plus un seul sénateur pour trouver anormale la présence des femmes au Sénat.

Pour les conseils généraux, il en ira de même !
Certains s’offusquent parce que le système risque de mettre en péril les situations acquises, parfois par copinage, ou, tout simplement, parce qu’ils craignent de ne pas être réélus. Personnellement, je trouve que c’est très bien : je l'ai dit ce matin, il faut du renouvellement. Je voterai donc l’article 2.

Monsieur le ministre, le risque d'inconstitutionnalité n’existe pas.
Les circonscriptions des sénateurs, qui sont sénateurs de la France, sont les départements, où ils sont élus soit à la proportionnelle, soit au scrutin majoritaire.

Si les conseillers départementaux pouvaient être élus dans une circonscription électorale soit à la proportionnelle soit au scrutin majoritaire, ce serait rigoureusement la même chose !
Je me suis enquis du risque d’inconstitutionnalité auprès de professeurs spécialistes du droit constitutionnel : ils m’ont garanti que, toutes choses étant égales par ailleurs, les deux systèmes étaient identiques.
Je le redis, je ne suis pas un opposant farouche du système qui nous est proposé, mais j’aimerais que les sénateurs se prononcent très librement sur cette question et que l’on voie qui est favorable à quoi.
Le mode de scrutin du Sénat n'a jamais été, et pour cause, présenté au Conseil constitutionnel, ce qui explique qu’il n’ait pas rendu d’avis sur la question.
J’ai moi aussi recueilli l’opinion d’éminents constitutionnalistes. Je ne doute pas que ceux que vous avez consultés le soient tout autant, mais il y a bien un risque parce qu’il n’y a jamais eu d’avis du Conseil constitutionnel. Or, là, il va être amené à se prononcer.
Par ailleurs, il existe une différence : le système applicable aux élections sénatoriales ne prévoit qu’un seul mode d'élection par département. L’élection des sénateurs se fait, selon les départements, soit à la proportionnelle soit au scrutin majoritaire ; il n’y a pas de système mixte dans une même circonscription électorale.
Avec le système que vous proposez, il y aurait deux scrutins électoraux dans la même circonscription électorale. C'est là qu’il y a un risque.
Quant à prévoir que les élections cantonales se fassent uniquement au scrutin proportionnel dans certains départements et uniquement au scrutin majoritaire dans d’autres, ce serait retomber dans la contradiction du fait qu’il y a des départements à la fois urbains et ruraux. L'égalité et la représentation des électeurs seraient alors mises à mal.

Monsieur le ministre, je remarque que vous ne m'avez pas répondu, non plus d’ailleurs que M. le rapporteur. Ma proposition est pourtant lisible ; elle l’est même, je le pense, beaucoup plus que la vôtre. Je propose un système sain et uniforme, qui ne comporte aucun risque d'inconstitutionnalité et qui ne nous oblige pas à régler le casse-tête de la distinction entre les secteurs ruraux et les autres.
Dans ce système, le mode de scrutin est uniforme, mais la répartition des sièges à pourvoir fait qu'il fonctionne comme un scrutin majoritaire dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est faible et comme un scrutin proportionnel dans celles où il est élevé. Si le mode de scrutin est bien le même partout, ses effets sont donc différents selon les secteurs.
J’aimerais maintenant revenir sur un autre aspect des choses qui n'a été qu’effleuré.
Je dois dire que ce gouvernement fait la même erreur que le précédent : séparer le problème institutionnel, c'est-à-dire les compétences et la fonction des diverses collectivités territoriales, du mode de désignation des élus. Or ces questions sont intimement liées.
Cette critique pouvait s'appliquer à la précédente réforme. La création du conseiller territorial avait en réalité pour but – c’est le grand dessein des modernisateurs… – de dissoudre le département dans la région, …

… mais, à l’arrivée, du fait du mode de scrutin choisi, le pouvoir aurait appartenu aux départements.

Reconnaissez, mon cher collègue, qu’il existe des systèmes plus cohérents !
Le conseil régional, c'est la réunion des conseils généraux élus sur une base cantonale. Pensez-vous que les candidats auraient pu être élus sur un projet régional ? Non ! Ils auraient été élus sur un projet départemental et même, s'ils avaient été malins, en faisant campagne contre la région ! Il y avait là une opposition complète entre l'objectif et le mode de scrutin.
Ici, avec le mode de scrutin retenu dans le projet de loi, il s’agit en principe de restaurer le département dans ses fonctions et sa « dignité », si je puis dire, mais le résultat sera en fait une « déterritorialisation » complète de la représentation.
On peut dire tout le mal que l'on voudra, et même plus encore, du mode de représentation actuel, mais il faut reconnaître que, au moins dans une partie des départements, il a une certaine signification.
Pour avoir cru, un peu trop vite, avoir trouvé la pierre philosophale, on est passé – je le regrette – à côté de la grande réforme qui aurait pu permettre d’articuler un renforcement de l'intercommunalité, une légitimation démocratique de celle-ci et une affirmation du rôle du département, qui doit nécessairement consister à assurer la solidarité territoriale et à veiller à l'aménagement du territoire ainsi qu’à la cohérence des services publics de proximité.
J'avais la faiblesse de penser que la piste de réflexion que je vous ai soumise permettait d’articuler les intercommunalités avec une expression au niveau départemental. Elle était aussi un moyen de redonner une jeunesse à l’institution départementale. Mais il ne faut pas être trop en avance sur son temps…

Ce débat a le mérite de démontrer qu’il existe des alternatives sérieuses au système qui nous est proposé. Certaines d'entre elles mériteraient d’être davantage étudiées, en particulier celles qui figurent dans les amendements de MM. Doligé et Pointereau.
Comme c’est souvent le cas dans les débats juridiques, on pourrait invoquer d’autres arguments que ceux d’ordre constitutionnel que vous avez cités, monsieur le ministre. Vous ne pouvez en particulier pas dire que le département est une circonscription pour l'élection des conseillers généraux. Il ne l'a jamais été, il ne le deviendrait pas dans le dispositif qui nous est soumis et il ne le serait pas non plus avec le système proposé dans les amendements n° 119 et 335 rectifié.
L’important est de se rapprocher de l'égalité de représentativité de chaque élu. On peut très bien le faire en tenant compte de la différence de situations entre les villes et les campagnes.
Il me semble que vous devriez accepter d’approfondir cette question, de même que la question de savoir où placer les limites entre la ville et la campagne, question évidemment complexe mais qui n’est pas impossible à résoudre.
Nous aurions donc intérêt à adopter l’un de ces deux amendements, quitte à ce que vous mettiez à profit les discussions à l’Assemblée nationale, puis celles que nous aurons de nouveau ici au Sénat, pour améliorer le dispositif que ces amendements prévoient. La coexistence entre un système proportionnel dans les villes, où le lien entre le conseiller général et ses électeurs est plus distendu qu’à la campagne, et d’un système où l’on maintiendrait une très forte territorialité de l’élu à la campagne n’est en rien choquante et me paraît tout à fait acceptable.

Je suis depuis ce matin plutôt convaincue, je l’ai dit, par ce mode de scrutin innovant.
Jusqu’au renouvellement de 2011, le conseil général de l’Orne – quarante conseillers généraux pour 293 000 habitants – comportait une seule femme… La perspective d’un changement est donc plutôt satisfaisante.
S’agissant par ailleurs des objections relatives à un possible « divorce » ou à d’éventuels dysfonctionnements au sein du ticket, je dois dire que, dans cette maison, il y a eu et il y a encore des dissonances entre personnes élues sur un même ticket et étant, de surcroît, du même parti !
M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.

Je ne donnerai pas de noms, mais je suis à la disposition de ceux et celles qui en voudraient…
Sourires.

Par ailleurs, je sous-amenderais volontiers l’amendement de M. Doligé pour viser « les électrices et les électeurs de chaque canton » et non plus les seuls électeurs…
M. le ministre s’esclaffe.

Je suis cohérent avec moi-même : si je vote contre cet article, ce n’est pas du fait de la sensibilité politique du Gouvernement qui le présente, car j’aurais également voté contre si ce dernier avait été d’une sensibilité politique différente.
Monsieur le ministre, dans le double mixte au tennis, puisque vous l’avez évoqué, aussi bien l’homme que la femme jouent. Et, dans une équipe du double mixte, il y a toujours deux joueurs – les deux suppléants – qui restent sur la touche.
Or, il y a quelques jours – trop tard pour déposer un amendement –, une autre forme de parité m’est venue à l’esprit : les trois premières années du mandat seraient effectuées par un premier élu, auquel le second élu succéderait les trois années suivantes. §

Pour être moi-même resté parfois au bord de la route et n’avoir été longtemps que spectateur, je sais qu’il y aurait là aussi une forme de parité. Monsieur le ministre, on dit parfois que le secret du bonheur est de savoir attendre, mais il y a des suppléants qui attendent vraiment beaucoup !

Quand j’étais plus jeune, on m’a appris ce qu’étaient le plus petit et le plus grand dénominateurs communs. En l’occurrence, je pense que l’on pourrait se mettre d’accord sur le plus petit dénominateur commun.
Je ne parle pas là de celui de mes amendements qui semble recueillir une certaine faveur, ce dont je me réjouis, mais je ne vais pas m’arrêter là. J’ai présenté un autre amendement qui me paraît pouvoir rassembler un certain nombre de suffrages puisque j’ai constaté que les écologistes, les communistes, Philippe Adnot et plusieurs de mes collègues de l’UMP avaient présenté des amendements tout de même assez proches. Il devrait être possible de nous retrouver sur un scrutin mixte – que le taux retenu soit de plus ou moins 20 % ou de plus ou moins 30 % – dans les agglomérations, qui souvent représentent de 20 % à 40 % de la population des départements, y compris ruraux.
Pour ma part, je n’ai pas l’ambition d’être l’auteur de l’amendement qui sera retenu par les uns et les autres. Pourquoi pas, par exemple, se mettre d’accord sur celui de Philippe Adnot ? Si nous parvenions à nous entendre sur un amendement de cette nature, nous pourrions progresser.
Cela serait d’autant plus utile que, malgré ce que vous avez pu en dire, monsieur le ministre, en matière de constitutionnalité, nous ne sommes sûrs de rien dans un certain nombre de domaines. Il vaudrait donc sans doute la peine d’approfondir la réflexion.
Je rappelle aussi qu’au fil des changements de majorité on a pu dans un même département passer d’un scrutin à la proportionnelle à un scrutin uninominal pour les élections sénatoriales. Pour les élections législatives, il va y avoir une proportionnelle nationale, à laquelle la proportionnelle départementale pourrait ressembler pour un nombre de sièges dont le pourcentage resterait à déterminer.
Il serait bon que tous ceux qui ont présenté des amendements visant à instaurer un scrutin mixte arrivent à se retrouver sur l’un de ces amendements. Je note au passage que l’on nous reprochait hier de ne pas faire de propositions ; on voit que ce n’est pas le cas.
Nos différentes propositions se rejoignent, sauf celle de notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui est différente mais qui est également intéressante, car elle permet elle aussi de pousser plus loin la réflexion et, ce faisant, d’aider à trouver une solution.
Bien évidemment, je prêcherai plutôt pour les solutions préconisées par Philippe Adnot ou par moi-même, mais elles ne sont pas très éloignées de celles qu’ont proposées dans leurs amendements de repli le groupe écologiste ou le groupe CRC.

Je suis gêné par cette discussion commune de seize amendements dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont assez différents !

Nous sommes en présence d’options très intéressantes, qui, par définition, puisqu’il s’agit d’amendements, remettent en cause le projet gouvernemental, en partie ou en totalité, et qui chacune mériterait une discussion beaucoup plus claire !
Par exemple, la proposition de notre collègue Pierre-Yves Collombat, sorte de compromis entre la proportionnelle et la territorialisation, justifierait en elle-même une discussion. L’arrondissement, en effet, correspond encore souvent à une réalité, mais ce n’est pas nécessairement le cas, et c’est un point que nous pourrions examiner.
Les systèmes mixtes que prévoient plusieurs de ces amendements font, de votre point de vue, monsieur le ministre, naître une inquiétude de nature constitutionnelle. Cela mériterait un débat spécifique !
Un autre amendement, dans lequel le principe du scrutin binominal de candidats de sexe différent est accepté, prévoit de localiser chacun des deux élus sur une section du canton, ce qui n’est pas complètement inintéressant, les électeurs ayant le droit de savoir qui parle en leur nom.
Dans un débat local, il n’est pas inutile qu’une seule voix, surtout si l’élection procède du scrutin majoritaire, exprime l’intérêt du territoire. Or, avec le système prévu dans le projet de loi, deux voix s’exprimeront pour un même territoire. Si ces deux voix peuvent s’entendre, elles peuvent aussi être discordantes. Reconnaissons que ce n’est pas un cadeau pour la démocratie !
Dès lors, je ne comprends pas pourquoi nous discutons dans la confusion, alors que chacune de ces séries de solutions mériterait en elle-même un débat suivi qui permette de regrouper les points de vue et d’avancer.

Monsieur le ministre, permettez-moi d’exprimer une inquiétude.
Je comprends bien votre démonstration, qui, sur le plan théorique, me paraît honnête : il faut de la parité, il faut de la proximité et, en somme, l’équation que vous avez trouvée permet d’atteindre ces objectifs.
Au fond, le seul problème, notamment au regard de notre pratique, c’est, comme vient de le dire Gérard Longuet, la présence de deux élus sur un même territoire.
Je reste profondément girondin ; je reste profondément décentralisateur. Pourtant, j’ai souvent été un déçu de la décentralisation : je l’ai été chaque fois que j’ai vu des rivalités locales l’emporter sur l’intérêt général.
Quand le comité départemental du tourisme est en compétition avec le comité régional du tourisme
Sourires.

Ce qui aide vraiment à la prise de décision sur un territoire, c’est la clarté. Or, si le scrutin que vous proposez a l’air clair, localement, il sera facteur de confusion. Je vous assure que le processus qu’il instaure entraînera, sur chaque dossier, une ambiguïté des responsabilités, d’autant que nous sommes là dans le monde politique, où, je le dis sans arrière-pensée et de manière très détendue, l’on connaît l’importance des ego, des rivalités et des coups bas.
Bien sûr, des gens s’entendront, des équipes se formeront, mais, au total, vous multipliez le nombre d’acteurs. Vous allez créer une cause de paralysie supplémentaire, ce qui, de mon point de vue, ne rend pas service aux territoires, qui sont déjà fragilisés par la crise et qui ont besoin de processus de décision clairs et de responsabilités assumées.

Sous une apparence de proximité, ces divers amendements sont tout de même extrêmement différents.

Certains ici veulent de la proportionnelle. D’autres, parce qu’il ne peut pas y avoir de scrutin majoritaire, veulent aussi de la proportionnelle mais seulement dans les secteurs très urbains.
Au passage, ce n’est pas très gentil pour nombre de nos collègues conseillers généraux en secteur urbain, parfaitement identifiés et qui font bien leur boulot !

Peut-être n’est-ce pas le cas partout, mais, dans mon département en tout cas, les conseillers généraux urbains font parfaitement leur travail !

Sauf peut-être aux inaugurations où tout le monde vient – le conseil régional, le conseil général, la communauté de communes, la commune… –, les électeurs identifient, c’est vrai, parfois mal les acteurs locaux et les périmètres. Pour autant, il ne faut pas aller trop loin dans les comparaisons.
Sur toutes les travées, nous avons d’ailleurs défendu le scrutin mixte. Ce n’est pas nouveau, mais on y avait toujours renoncé parce qu’il est compliqué de définir une agglomération et qu’il faut un nombre minimum d’élus à élire !
La proportionnelle, qu’elle soit par secteur ou partielle, c’est tout à fait autre chose ! Les propositions de nos collègues qui défendent l’introduction d’une dose de proportionnelle sont tout à fait estimables, mais, quand on commence par là, on aboutit vite – ne serait-ce que pour parvenir à la parité totale – à la proportionnelle intégrale.

Cela se vérifie souvent !
Monsieur le ministre, tout cela est intéressant, mais le projet du Gouvernement – bien qu’il soit issu d’une réflexion de la délégation au droit des femmes du Sénat – n’est pas satisfaisant.
Je regrette par ailleurs que vous n’ayez pas donné votre avis sur l’amendement n° 157 rectifié bis, qui, sans remettre en cause le principe du binôme, tend à créer des sections cantonales. Peut-être est-ce inintéressant, voire idiot, mais cela permettrait au moins d’identifier précisément, au sein du binôme, de quel secteur géographique chaque élu est ensuite responsable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 230 rectifié, 202 rectifié, 51 rectifié ter, 35 rectifié bis, 70 rectifié bis et 157 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons bien travaillé cet après-midi.
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.

Il nous faut encore affiner un certain nombre de dispositions de ce texte.
Aussi, au nom du groupe socialiste, je demande une suspension de séance d’une demi-heure. §

Il faudrait tout de même penser à demander leur avis aux autres groupes !
La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.