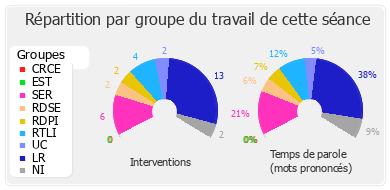Séance en hémicycle du 26 mars 2013 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Retrait de questions orales de l'ordre du jour
- Questions orales (voir le dossier)
- Situation des enfants français nés à madagascar dont la transcription de l'acte de naissance est refusée (voir le dossier)
- Projet d'implantation d'un centre de stockage de déchets ultimes sur le site de nonant-le-pin (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que la question orale n° 302 de M. Francis Grignon est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 9 avril 2013, et que la question orale n° 234 de M. Christian Cambon est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 23 avril 2013.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 322, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger.

Ma question s’adresse à Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l’étranger.
Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les difficultés que rencontrent les Français établis dans la circonscription consulaire de Tananarive, plus particulièrement ceux qui sont rattachés à la chancellerie détachée de Tamatave, pour faire transcrire les actes de naissance de leurs enfants sur les registres de l’état civil français.
Le refus des autorités consulaires est motivé par le non-respect, de la part des autorités locales, des règles de tenue de l’état civil fixées par les lois malgaches. En effet, à l’occasion de missions de vérification des registres locaux menées par les agents consulaires français, des irrégularités concernant les actes relatifs à des Français ont été constatées.
Je peux parfaitement comprendre que les impératifs de vérification sur place par les autorités consulaires, quasi systématique, provoquent des délais de traitement plus importants, voire, en cas d’irrégularité effectivement constatée, un refus provisoire de transcription. Toutefois, cette situation conduit de nombreux parents, dont la bonne foi est incontestable, au bord du désespoir et les condamne à une profonde injustice. Ces familles sont prises au piège et les enfants, bien que Français, ne peuvent obtenir de documents français et, ainsi, voyager hors de Madagascar : il leur faut un visa pour se rendre en France, ce qui, au regard des difficultés et délais pour son obtention, peut entraîner une séparation forcée de la famille.
Le ministre des affaires étrangères m’a indiqué il y a quelques mois que la solution la plus satisfaisante pour les familles consisterait à venir déclarer la naissance de leurs enfants à l’officier d’état civil consulaire à Tananarive, dans les trente jours prévus par les textes en vigueur. C’est en effet la meilleure chose à faire pour les naissances à venir.
Cependant, cette proposition ne règle pas le problème des enfants plus âgés dont les parents n’ont pu effectuer cette formalité, par méconnaissance des dysfonctionnements des services malgaches et des implications que cela aurait sur la transcription de l’acte de naissance malgache pour la reconnaissance de leur enfant.
Madame la ministre, pouvez-vous m’indiquer les solutions qui sont proposées à ces Français, parents d’enfants plus âgés, littéralement « pris au piège » ? Je souhaite également savoir si des dispositions adéquates sont prises par les services consulaires pour informer les futurs parents français de la nécessité pratique de déclarer la naissance de leurs enfants à l’officier d’état civil consulaire à Tananarive, dans les trente jours suivant la survenue de cet événement.
Madame la sénatrice, vous interrogez Mme Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, sur les difficultés que rencontrent les Français établis à Tananarive pour faire transcrire les actes de naissance de leurs enfants sur les registres de l’état civil français. Actuellement en déplacement aux États-Unis, Mme Conway-Mouret m’a chargée de vous répondre.
Madame la sénatrice, vous avez raison de le souligner : de nombreuses irrégularités sont constatées dans la tenue des registres de l’état civil à Madagascar, notamment dans la commune de Tamatave. Dans des administrations fragilisées et dépourvues de moyens, les actes d’état civil sont ajoutés, surchargés, non signés, voire recollés a posteriori dans des registres non reliés. Ils sont par conséquent non conformes à la loi locale et ne peuvent être transcrits en l’état, ainsi que le précise l'article 47 du code civil, compte tenu du défaut de force probante dont ils sont entachés.
Cet état de fait contraint le poste à vérifier in situ la quasi-totalité des actes établis localement qui lui sont présentés pour transcription, ce qui requiert une mise en œuvre particulièrement lourde en termes de moyens : véhicules, personnel, etc. Si l’on excepte les actes non conformes, seulement 15 % environ des actes vérifiés selon cette procédure sont authentiques. À titre d’exemple, en 2012, lors de la mission effectuée au mois de janvier dernier, sur 295 actes vérifiés, 46 étaient authentiques, 142 apocryphes, 43 non conformes et 12 introuvables.
Cette situation et les pratiques visant à créer une filiation fictive avec un parent français exigent la plus grande vigilance de la part de l’officier de l’état civil consulaire français.
Notre représentation diplomatique est intervenue à de nombreuses reprises auprès des autorités communales et judiciaires de Tamatave, pour essayer de remédier à cette situation et parvenir à des solutions acceptables par les usagers.
Par ailleurs, le poste a fortement encouragé nos compatriotes, notamment les futurs parents, à privilégier les actes dressés directement par les autorités consulaires dans les trente jours qui suivent la naissance de leur enfant. Cette information, qui figure sur le site internet du poste, a également été diffusée dans le réseau consulaire.
Une mission de l’état civil de Tananarive s’est rendue récemment à Tamatave pour y vérifier plus de 300 actes. À cette occasion, des familles dont les demandes de transcription avaient fait l’objet d’un refus ont été reçues pour être informées des voies de recours possibles.
Enfin, l’ambassadeur et le consul général se sont personnellement impliqués dans la résolution de cette situation complexe, notamment lors d’un déplacement à Tamatave le 25 février dernier. Des représentants des familles en difficulté ont été reçus en audience. Il a été décidé à cette occasion de mettre en place à la chancellerie détachée de Tamatave une cellule d’écoute, d’explication et de conseils pour guider nos compatriotes dans leurs démarches auprès du parquet.

Madame la ministre, je me félicite vivement de la prise en compte du problème par les autorités consulaires et de la réponse que vous apportez à ces familles victimes d’une carence administrative malgache. C’est un premier pas encourageant.
J’aurais cependant souhaité une proposition plus pragmatique, moins administrative, qui apporterait une réponse rapide à un problème précis, au cas par cas. Un recours administratif est une procédure longue et je ne peux m’empêcher de demander : quand ces enfants auront-ils leurs papiers ?

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, auteur de la question n° 203, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la ministre, le 10 mai 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 9 janvier 2009 du préfet des Hauts-de-Seine portant transfert à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre de biens appartenant à l’État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants, constitués de la résidence universitaire Vincent Fayo à Châtenay-Malabry et de la résidence universitaire Jean Zay à Antony, . Il a également annulé la délibération n° 09/93 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, en date du 9 octobre 2009, portant approbation du protocole d’accord relatif à la réhabilitation et au redéploiement des résidences universitaires Jean Zay à Antony et Vincent Fayo à Châtenay-Malabry.
Cette double décision vient annuler le transfert par l’État à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre de la résidence universitaire Jean Zay d’Antony et remettre ainsi en cause le projet de démantèlement de celle-ci porté par les élus de cette communauté d’agglomération et soutenu par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par ailleurs actuel conseiller général et ancien maire d’Antony.
La mise en œuvre de ce démantèlement a déjà conduit à la destruction de plus de 600 logements étudiants. Pourtant, madame la ministre, la demande en Île-de-France demeure très largement supérieure à l’offre. On ne dénombre en effet dans cette région que 3 logements pour 100 étudiants, quand la moyenne nationale, déjà faible, s’élève à 8 logements pour 100 étudiants.
S’il est donc essentiel de construire de nouveaux logements, il est tout aussi primordial de ne pas détruire ceux qui existent quand leur rénovation est possible.
Madame la ministre, ce transfert n’avait été permis que par le dépôt opportun en 2006 par un sénateur alto-séquanais d’un amendement modifiant l’article L. 822-1 du code l’éducation que l’on peut aisément qualifier de « sur-mesure » et assurément de « cavalier législatif ». Pour mémoire, lors de son examen par la Haute Assemblée, M. Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités territoriales, avait relevé que cet amendement s’inscrivait étrangement dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, avant de dire qu’il en comprenait les motivations et d’adresser ses salutations à Patrick Devedjian.
Cette nouvelle disposition législative n’a d’ailleurs été mise en œuvre qu’une seule fois pour le transfert de la résidence universitaire d’Antony. Heureusement, ce transfert a fait l’objet d’une annulation par la justice.
J’en suis convaincu, ce site peut et doit faire l’objet d’une rénovation. C’est une demande forte des étudiants, de l’association de défense, des élus et de la région d’Île-de-France. Madame la ministre, quel avenir envisagez-vous pour la résidence universitaire d’Antony, maintenant que, grâce à cette décision de justice, l’État a repris la main sur ce site ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie de cette question. Faciliter l’accès au logement pour nos étudiants constitue un facteur décisif de leur réussite et est au cœur des priorités du Gouvernement et de mon ministère. Cette problématique s’inscrit dans un contexte d’insuffisance notoire de logements étudiants. Le Président de la République s’est engagé en faveur de la construction de 40 000 logements au cours de son quinquennat, alors que seuls 20 000 logements ont été construits ces huit dernières années à la suite du plan Anciaux dont les objectifs n’ont été réalisés qu’à hauteur de 50 %.
À mon arrivée au Gouvernement, je me suis immédiatement saisie du dossier de la résidence d’Antony, après publication de la décision de justice que vous évoquez.
En juillet dernier, en concertation avec la région, j’ai missionné le recteur de Versailles et le préfet des Hauts-de-Seine pour trouver une solution rapide commune à toutes les parties intéressées. Cette négociation n’a malheureusement pas abouti. En même temps, l’article L. 822-1 du code de l’éducation rend obligatoire le transfert à titre gratuit d’une résidence étudiante dès lors que ce transfert est demandé par un établissement public de coopération intercommunale, ce qui est le cas.
Cette obligation a été confirmée par la justice en juillet dernier.
Je suis bien consciente de l’intérêt important qui se focalise sur cette résidence et je comprends tout à fait vos préoccupations. La priorité d’intérêt général m’impose toutefois de raisonner à une échelle plus large : l’offre de logements étudiants dans le sud des Hauts-de-Seine, qui accuse un déficit de l’ordre de 4 000 logements. L’objectif que je me suis fixé est d’arriver, avec les collectivités les plus concernées – de la commune à la région, en passant par le département et l’intercommunalité –, à un accord permettant de construire dans ce département 4 050 logements sur cinq ans, dont plus de 1 000 au titre des places perdues sur la résidence universitaire d’Antony.
Comme vous le savez, la négociation se poursuit pour parvenir à fixer un chiffre acceptable pour tous sur ce site, et je souhaite que l’on aboutisse rapidement à un accord surmontant les blocages actuels.
Mon souci, monsieur le sénateur, c’est que si l’État et les collectivités partenaires devaient se diriger vers un contentieux juridique à Antony, les principaux perdants seraient avant tout les étudiants, contraints de se loger à des coûts très élevés ou dans des endroits éloignés de leurs lieux d’études, pendant que la résidence continuerait de se dégrader, ainsi que vous l’avez-vous-même signalé.
Il faut savoir que le logement en Île-de-France peut représenter jusqu’à 70 % du budget d’un étudiant. On imagine alors ce qu’il reste pour satisfaire d’autres besoins comme l’accès aux soins ou à une alimentation correcte.
Il nous faut donc, en urgence, construire davantage de logements.
Je souhaite par conséquent que le débat autour de cette résidence aboutisse rapidement à une solution constructive. C’est la condition pour que soit préservé l’intérêt général, en premier lieu celui des étudiants, et que l’on sorte de l’impasse actuelle.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
J’ai bien noté la volonté du Président de la République d’amplifier l’effort de l’État en matière de logement étudiant, avec la construction programmée de 40 000 logements au cours de son quinquennat.
Nul doute que nous devons construire et réhabiliter davantage de logements.
Le dossier de la résidence d’Antony est certes complexe juridiquement. Je sais que vous avez engagé des négociations avec le conseil général et la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.
Je souhaiterais toutefois que les élus régionaux, les associations de défense de la résidence et les syndicats étudiants, tous partie prenante à ce dossier, soient associés à la négociation en cours, afin que les avis de l’ensemble des acteurs puissent être pris en compte.
Nous espérons qu’une solution consensuelle pourra être trouvée le plus rapidement possible, car il y a urgence à rénover cette cité, à permettre l’accueil d’étudiants et à poursuivre la construction de logements étudiants.

La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 272, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Je me permets à travers cette question d’attirer l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, en cas de vente de terrains aux droits démembrés.
En effet, le décret n° 2012-363 du 14 mars 2012, inséré à l’article R. 143-9 du code rural, ordonne à la personne chargée de dresser un acte d’aliénation de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien rural de le déclarer préalablement à la SAFER.
Il résulte de cette obligation une contestation de plus en plus fréquente, par la SAFER, des promesses de vente de biens démembrés, notamment en cas de ventes concomitantes d’usufruit et de nue-propriété, qui sont suspectées d’être des cessions déguisées de pleine propriété.
Cette démarche est source d’incertitude pour les parties, d’allongement de la durée de traitement des dossiers et, surtout, d’un surplus de contentieux devant les juridictions.
Au vu de ces difficultés, je demande à M. le ministre de bien vouloir expliciter les finalités du décret, ce qui permettra aux SAFER de clarifier l’approche qu’elles peuvent avoir de ce type de cessions.
Monsieur le sénateur, vous me posez une question technique extrêmement précise sur le décret du 14 mars 2012, qui fait suite à la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010.
Au-delà des problèmes juridiques qui peuvent se poser, ne perdons pas de vue l’objectif principal de cette disposition, qui vise à mesurer les changements de vocation des terres agricoles.
La loi de modernisation a visé à une meilleure analyse et à une meilleure maîtrise de la perte du foncier agricole, dénoncée de longue date au Sénat comme à l’Assemblée nationale : tous les dix ans, en effet, l’équivalent d’un département français est en effet « consommé » sur les terres agricoles.
Je reste attaché à cet objectif.
Sur le plan technique, afin que les SAFER puissent transmettre aux services de l’État les informations les plus exhaustives possible sur l’évolution du foncier agricole, le décret prévoit que les ventes séparées portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des biens seront déclarées aux SAFER, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Comme vous l’avez souligné, monsieur Laménie, en cas de contestations de ces déclarations, ce système peut fragiliser des contrats conclus entre personnes privées.
Toutefois, au-delà des perturbations que ces déclarations peuvent engendrer et qui ne remettent pas en cause les échanges pouvant intervenir, nous devons garder comme objectif principal – et j’affirme que le ministre de l’agriculture sera vigilant à cet égard dans la prochaine loi d’avenir – d’inverser la tendance actuelle à la consommation inconsidérée de l’espace agricole.
Nous avons besoin aujourd’hui de revenir à une politique de maîtrise du foncier et, surtout, d’éviter le gaspillage que l’on a connu durant de trop longues années.
Nous avons besoin de terres agricoles, et nous devons être vigilants. C’est la raison d’être de ce décret de mars 2012, qui me semble juste.
Cela ne nous empêche pas d’essayer d’améliorer les conditions d’échange des terres. Dans cette optique, n’hésitez pas, monsieur Laménie, à me faire remonter les problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Mais l’objectif prioritaire du Gouvernement, qui fait suite à ce décret, est de limiter la consommation d’espace agricole. Je voulais ce matin le réaffirmer au Sénat.

J’ai bien noté votre réponse, monsieur le ministre.
Voilà longtemps en effet que les gouvernements successifs se préoccupent du problème que vous avez évoqué. Ma question l’abordait sous l’angle technique et juridique, car les procédures ne sont pas exceptionnelles.
Je partage bien évidemment la nécessité de soutenir nos territoires ruraux et les terres dédiées à l’agriculture.
On peut aussi comprendre les contraintes en termes d’urbanisme, même si des gâchis peuvent exister.
Quoi qu’il en soit, je vous remercie de l’attention toute particulière que vous portez à cette question, monsieur le ministre.

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 320, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Président du groupe « élevage » au Sénat, je souhaitais attirer une nouvelle fois l’attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le problème des prédateurs.
Monsieur le ministre de l’agriculture, je connais votre attachement à ce problème. J’aurai du mal à prêcher un converti, et c’est bien Mme la ministre que j’aurais voulu convaincre s’agissant de ce problème particulier des attaques du loup, qui deviennent de plus en plus insupportables pour les éleveurs dans les zones de montagne. Bon nombre d’entre eux sont découragés, et des conséquences graves s’ensuivent, tel l’abandon de pans entiers d’alpages ou de pâturages, qui laissent place à la friche. D’après les chiffres communiqués par la fédération nationale ovine, le nombre de loups augmente de 27 % par an.
À l’heure où le plan loup 2013-2017 est en préparation, je me demande s’il est suffisamment ambitieux pour réduire de façon significative la présence de ce prédateur dans les territoires d’élevage. J’aimerais donc en connaître les objectifs.
Des mécontentements s’élèvent de tous nos massifs, de la Méditerranée aux Vosges en passant par les Pyrénées et même, désormais, le Massif Central, y compris la Lozère.
Tous les éleveurs se sentent trahis, sous prétexte de biodiversité ou de satisfaction accordée aux mouvements écologistes.

Mais si, monsieur Placé !
Plus de 1 415 attaques en 2011, contre 1 842 en 2012 ; plus de 4 900 têtes en 2011, contre 6 021 en 2012 ; des bêtes qui meurent dans d’atroces conditions… L’éleveur que je suis ne peut comprendre cela. Comment peut-on dans le même temps exiger le respect du bien-être animal dans les étables et les bergeries ?
Le précédent plan loup n’a permis aucune diminution des attaques sur les territoires concernés. Au contraire, ces attaques ne cessent de progresser, avec toutes les conséquences que cela engendre. Devant cet état de fait, les ministres de l’environnement successifs restent sourds et ne prennent pas de réelles décisions. Je m’interroge : faut-il attendre que des enfants soient attaqués pour que les éleveurs soient entendus ?
D’autres territoires subissent des attaques fréquentes de prédateurs comme le lynx, et rien n’est fait pour diminuer ses effectifs, son image étant même, au contraire, vantée.
Je souhaite donc poser deux questions.
Premièrement, j’aimerais obtenir des éléments précis sur le coût du maintien des prédateurs – personnels de gestion, identification, moyens de prévention, indemnités versées, etc –, estimé à 15 millions par an par le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée.
Deuxièmement, comme de nombreux parlementaires français et suisses, je demande au Gouvernement s’il envisage de solliciter la révision de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe et de la directive « habitat » Natura 2000, comme l’ont déjà souhaité d’autres pays. Le Gouvernement demandera-t-il la révision de cette convention dans un avenir très proche, avant que la colère des éleveurs ne gronde et ne s’étende aux populations de ces territoires ?
Monsieur le sénateur, cette question du loup fait l’objet de beaucoup d’attention de la part du Gouvernement.
Vous posiez la question de savoir si vous pourriez convaincre Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que j’ai l’honneur de remplacer ce matin. Je peux vous dire que le ministre de l’agriculture, qui est très attaché à la protection de l’élevage, en particulier l’élevage ovin, dans les zones de montagne, a travaillé en parfaite cohérence avec la ministre de l’écologie. C’est ensemble que nous avons préparé le plan loup.
Des éléments concrets publiés récemment ont fait évoluer les esprits de manière significative. Ainsi, tout le monde a compris que la pression qui s’exerce est aujourd’hui telle qu’il convient de prendre des décisions.
Vous avez évoqué le coût des mesures : 8, 5 millions d’euros environ sont actuellement affectés aux protections passives, au travers notamment du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER ; ensuite viennent les indemnisations, à hauteur de 2, 2 millions d’euros, versées par le ministère de l’environnement. Le coût total résultant de l’application de la convention de Berne avoisine 10 millions d’euros.
« Le Gouvernement souhaite-t-il une révision de la convention de Berne ? », avez-vous demandé, monsieur le sénateur. La réponse est non. Nous l’avons dit, nous ne reviendrons pas sur cette signature. Des progrès significatifs sont en train d’être accomplis, et je vais vous donner quelques éléments à cet égard.
Tout d’abord – c’est à la fois très intéressant et important –, la semaine dernière, dans le cadre de la préparation du fameux plan loup, les ONG et les éleveurs se sont mis d’accord pour doubler le nombre de prélèvements sur l’année, le faisant passer de douze à vingt-quatre.
De plus, lors de la préparation de ce plan, le ministère de l’agriculture et le ministère de l’environnement ont estimé nécessaire de changer de stratégie. Alors que nous avons longtemps adopté une stratégie de défense passive – à cet égard, j’évoquais tout à l'heure les 8 millions d’euros consacrés à la protection des troupeaux et, par exemple, le recours aux chiens –, nous passons maintenant à un système de défense beaucoup plus réactif et offensif, avec l’instauration d’un protocole de tir gradué et une organisation de terrain, associant aux louvetiers les chasseurs locaux plus à même, de par leur connaissance du terrain, de réagir rapidement.
Nous avons donc mis en place un système de gradation des tirs en fonction de la situation rencontrée : tir de défense systématique, qui permet d’effaroucher ; tir direct à canon rayé, en cas d’attaque préalable ; tir de défense renforcé, en cas d’attaques constatées et récurrentes, à partir de postes fixes. C’est d’ailleurs dans ce dernier cas de figure que l’on pourra mobiliser les chasseurs.
Vous savez combien il est toujours difficile de parvenir à un accord lors de négociations entre éleveurs, dont je défends les intérêts, et organisations non gouvernementales – vous avez évoqué les mouvements écologistes – sur les questions de biodiversité. Avec le ministère de l’environnement, nous avons justement fait en sorte de trouver cet accord afin d’avancer sur la question de la protection de l’élevage dans les zones de montagne, et d’y répondre.

Je remercie M. le ministre de sa réponse. Je retiens l’espérance d’en finir avec le système de défense passive d’hier et de parvenir à une solution réactive plus efficace.
Je voudrais rappeler le bilan de vingt ans d’action : 1 200 troupeaux protégés, 2 000 chiens de protection à l’œuvre, 1 000 emplois de bergers spécifiques pour la protection du loup. Or tout cela s’est soldé par un échec puisque, comme je l’ai dit tout à l'heure, le nombre de loups a augmenté de plus de 27 % chaque année. Je m’interroge d’ailleurs sur la pertinence de prélever seulement vingt-quatre loups : sur un effectif estimé de 250 à 300 bêtes, cela correspond à peine au taux de progression annuel.
De plus, au vu des difficultés budgétaires de l’État, des prélèvements supplémentaires sur les retraites, les salaires et les revenus, j’ai peur que nos concitoyens ne se demandent s’il s’agit bien d’une priorité. Le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée a récemment estimé à 60 000 euros le coût total des dépenses liées à un loup. Il faut bien prendre cet élément en compte pour aller plus loin dans la réflexion.
Vous avez rencontré les éleveurs et les éleveuses, monsieur le ministre, et vous savez combien ils peuvent être catastrophés – notamment ceux qui font de la sélection – après des attaques de leurs troupeaux. Ces attaques ne sont pas anodines ; elles ont des répercussions psychologiques. La mutualité sociale agricole a d’ailleurs dû mettre en place une cellule pour s’occuper de ce genre de traumatismes. Peut-être avez-vous un animal chez vous ? Il en va de même quand il s’agit de ses bêtes, dans sa bergerie ou son étable : nous les aimons et ne pouvons accepter qu’ils meurent dans des conditions aussi déplorables. Je voudrais terminer mon intervention sur ces mots, en ayant une pensée pour les éleveurs traumatisés par ces attaques qui se multiplient sans arrêt.
J’évoquerai un dernier point. Voilà quelques instants, monsieur le ministre, vous répondiez à mon collègue que nous avons besoin de terres agricoles. Je partage complètement votre avis. Rappelons que, durant les années quatre-vingt, 12 millions d’ovins se trouvaient dans notre pays ; aujourd’hui, ils ne sont plus que 7, 4 millions ! Il s’agit d’une diminution drastique ! Je suis effrayé de voir des pans entiers de nos alpages ne plus être pâturés. L’élevage ovin a connu des situations difficiles ces dernières années, encore accentuées par les attaques de prédateurs. C’est pourquoi, monsieur le ministre, comme je sais que vous êtes bien conscient de ces difficultés, j’aimerais que vous essayiez de convaincre aussi tous vos collègues du Gouvernement.
J’ai été un peu long, et je vous prie de bien vouloir m’en excuser, mais il s’agit d’un dossier que j’ai vraiment à cœur.

La parole est à M. Jean-Vincent Placé, auteur de la question n° 382, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le projet d’implantation d’un centre de stockage de déchets ultimes sur le site de Nonant-le-Pin, dans l’Orne.
Si je ne suis pas un élu de ce territoire, j’ai pour lui un attachement significatif : ma mère en est originaire, et j’ai eu l’occasion d’y gambader quand j’étais petit. §
Mon attention a été particulièrement appelée par ma collègue du groupe de l’UDI-UC, Nathalie Goulet, qui, elle, est élue de ce département. Nous nous sommes rendus sur le terrain et avons constaté la réalité des méfaits environnementaux que pourrait engendrer ce centre de stockage de déchets ultimes.
L’ensemble de la population s’est bien évidemment émue de ce projet, d’autant plus que ce site est au centre des haras historiques de notre beau pays. Comment ne pas comprendre que des éleveurs, présents sur ce territoire depuis des dizaines d’années, parfois même des centaines d’années, puissent se montrer extrêmement combattifs et opposés à cette idée tout à fait saugrenue d’implantation d’un centre de déchets ? J’ai l’occasion ici de relayer leur colère.
Ce site et la nature des déchets stockés font peser un vrai risque environnemental, notamment par le ruissellement des eaux, sans compter les désagréments du trafic routier engendré par l’infrastructure. Cette dernière, après de nombreuses péripéties, y compris judiciaires – mais je n’y reviens pas, allant directement à l’essentiel – doit ouvrir dès le mois de juin prochain. Questionné le 28 juin 2012, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie affirmait, le 25 octobre, que le préfet de l’Orne, saisi d’une mission, devait rendre un rapport d’ici à la mi-novembre 2012
La mobilisation s’accroît très fortement : le conseil régional de Basse-Normandie, réuni le 14 février en assemblée plénière, a voté à l’unanimité une motion demandant à l’entreprise Guy Dauphin Environnement, dite GDE, et au ministère de l’écologie de mettre en place une concertation et un moratoire avant que le préfet de l’Orne ne prenne – ou plutôt, ce que je souhaite, ne prenne pas – l’arrêté définitif d’autorisation d’ouverture.
Une mobilisation citoyenne, associative, politique, a permis à plusieurs idées de germer. C’est d’ailleurs tout l’intérêt des mobilisations. Un comité de soutien à la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO a ainsi vu le jour. Il s’agit de consacrer, par ce classement, le caractère exceptionnel des terres d’élevage équin qui entourent le haras national du Pin.
Je rappelle également que se tiendront l’année prochaine, sur ce site, les championnats du monde équestres. Nous sommes encore leaders mondiaux dans cette filière, mais que dirons nos partenaires étrangers en voyant que nous avons eu l’idée incroyable, à l’heure du Grenelle de l’environnement, d’installer un site de déchets ultimes toxiques dans un remarquable berceau vert de la Basse-Normandie, de l’Orne et de la France ? Cela nuira fortement, à mon avis, à l’image de notre pays à l’étranger ; nous n’en n’avons pas besoin.
Ma question est très simple, madame la ministre : quels sont les résultats de la mission demandée au préfet de l’Orne et qu’envisagez-vous de mettre en œuvre pour protéger ce site de Nonant-le-Pin contre les dangers environnementaux que représente l’implantation de ce centre de stockage de déchets ultimes ?
Monsieur le sénateur Jean-Vincent Placé, je vous prie de bien vouloir excuser Delphine Batho, qui n’a pu se libérer ce matin pour répondre à votre question.
Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vous a reçu personnellement, le 4 mars dernier, pour discuter de ce projet d’implantation d’un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Nonant-le Pin, dans l’Orne, à proximité de nombreux haras dont vous avez rappelé la remarquable notoriété.
Ce projet est fortement contesté, comme vous l’avez souligné, et le président de la région, Laurent Beauvais, a tenu à faire part à l’ensemble du Gouvernement de son opposition, au nom de son assemblée plénière qui a délibéré à l’unanimité.
Rappelons brièvement les faits. Ce projet de centre d’enfouissement de déchets industriels banals et de résidus de broyages automobiles a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter de l’entreprise Guy Dauphin Environnement, dite GDE, en septembre 2006.
Après un avis défavorable de l’enquête publique, le préfet de l’Orne a pris un arrêté de refus en janvier 2010. Le tribunal administratif de Caen a cependant annulé cet arrêté préfectoral en février 2011 et accordé l’autorisation d’exploiter au pétitionnaire. Force est de constater que le gouvernement d’alors n’a pas interjeté appel et que le préfet de l’Orne a pris un arrêté de prescriptions, le 12 juillet 2011. Il ne pouvait, à l’époque, faire autrement puisqu’il n’y avait pas appel de la décision.
Cette absence d’appel pèse lourd aujourd’hui. Elle éteint toute marge de manœuvre juridique pour l’État. Compte tenu des fortes inquiétudes soulevées par ce projet, Delphine Batho a demandé au préfet de l’Orne, en août 2012, de procéder à une expertise complète, à la fois juridique et technique.
Toutefois, l’État se trouve aujourd’hui dans une impasse juridique et doit appliquer la décision du tribunal administratif.
J’ajoute que les récentes requêtes tendant à la suspension de l’arrêté du 12 juillet 2011 ont également été rejetées par le tribunal administratif de Caen, le 14 février 2013. La mise en service de l’installation est donc prévue par l’exploitant au début du mois de juin prochain.
Nous partageons beaucoup de vos avis sur cette question. Comme vous le savez, le conseil régional de Basse-Normandie a demandé à GDE d’entamer une vraie concertation en vue d’un moratoire. Le fait d’interrompre la poursuite du chantier et de réaliser des études supplémentaires sur les risques mis en avant par les experts désignés par les associations permettrait peut-être à l’exploitant de se poser la question de l’opportunité de son installation sur ce site.
Nous espérons beaucoup que ces démarches aboutissent. Pour sa part, l’État s’assure de la stricte surveillance du chantier. Il ne dispose pas d’autre moyen d’action au regard de l’ensemble des prescriptions prévues pour ce type d’installation.
Le Gouvernement connaît votre mobilisation sur ce sujet, monsieur Placé, et a conscience de l’inquiétude de tous ceux qui sont attachés à l’excellence de la filière équine française et au rayonnement de ce patrimoine lors des Jeux équestres mondiaux de 2014.
Tels sont les éléments de réponse que nous sommes dans l’obligation de vous apporter, avec une certaine forme de déception et en regrettant que l’appel n’ait pas été interjeté par le gouvernement d’alors.
J’espère que le moratoire sera obtenu et que les études supplémentaires permettront à l’ensemble des acteurs, en particulier à celui qui a déposé cette demande de permis, de progresser positivement.

Merci, madame la ministre, de cette réponse très complète qui démontre l’attachement du Gouvernement aux préoccupations de défense de la nature et de l’environnement sur les sites remarquables de notre beau territoire français.
Vous avez rappelé les éléments politiques mais aussi les éléments de droit, en particulier de droit administratif, de ce dossier.
Vous avez surtout souligné, et je vous en remercie, la responsabilité du gouvernement précédent qui n’a pas interjeté appel dans une affaire particulièrement contestable, qui n’est pas allé jusqu’au bout des procédures.
Cela démontre – je le dis même si la séance du mardi matin n’est pas le lieu des polémiques – qu’il y a très loin de l’affichage en faveur de l’écologie à la réalité. Quel décalage entre le souci de l’environnement et la tranquillité d’une antichambre qui laisse s’éteindre les procédures administratives au profit des industriels ! Voilà une contradiction soulevée par un élément factuel.
Par ailleurs, je vous remercie d’indiquer que Delphine Batho, qui m’a reçu avec des habitants et des associations du territoire concerné, est particulièrement mobilisée. Je lui ai demandé que nous nous rendions très rapidement sur place, avec le président de région et le président du conseil général de l’Orne, afin d’avoir avec les dirigeants de GDE une discussion sérieuse, économique, témoignant de notre détermination. Nous souhaitons leur expliquer que, eu égard à la détérioration de l’image de leur entreprise, pourtant censée s’occuper de problématiques environnementales, un sursis à l’implantation du centre de stockage en cause, dans le cadre du fameux moratoire, pourrait, à ce stade du dossier, être une issue intelligente, à condition bien sûr que soit parallèlement étudié un nouveau projet sur un autre site pouvant satisfaire l’ensemble des parties. Telle est la proposition que j’ai formulée à Mme Batho, ainsi qu’aux présidents du conseil régional et du conseil général.
Je remercie le Gouvernement, particulièrement vous, madame Lebranchu, de l’intérêt qu’il a porté à cette question.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 280, adressée à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.

Madame la ministre, je veux attirer votre attention sur la décision du président du conseil général du Val-de-Marne de ne pas appliquer, depuis le mois de juillet 2012, l’article 105 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, qui prévoit le non-versement aux agents publics civils de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie. Cette disposition législative est pourtant entrée en vigueur au 1er janvier 2012 et précisée dans la circulaire d’application du 24 février 2012.
En effet, dans un souci de redressement des comptes de l’assurance maladie et d’égalité professionnelle entre la fonction publique et le secteur privé, secteur dans lequel un délai de carence de trois jours est imposé aux salariés, le gouvernement précédent avait mis en place la disposition pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Récemment, vous avez proposé la suppression de ce jour de carence, mesure qui, pour être effective, devra figurer dans une prochaine loi de finances, puisque seule une loi peut en abroger une autre. En attendant, les dispositions en vigueur me paraissent devoir être respectées. Par conséquent, le versement d’une indemnité de compensation me semble demeurer une infraction.
Dans votre réponse apportée à la question écrite de notre collègue Jacques Mézard, publiée au Journal officiel du 8 novembre 2012, vous avez clairement précisé que la journée de carence s’appliquait bien aux trois fonctions publiques et que les modalités d’application de cette disposition étaient précisées dans la circulaire du 24 février 2012.
En conséquence, madame la ministre, me confirmez-vous oui ou non que la non-application de la journée de carence demeure illégale jusqu’au vote et à l’entrée en vigueur de la future loi ? Si tel est le cas, quelles sont les sanctions applicables aux collectivités ?
Par ailleurs, le président du conseil général, notre collègue Christian Favier, nous a indiqué que, alors qu’il portait la pétition des fonctionnaires de sa collectivité à Matignon, des conseillers l’avaient informé que des collectivités proches du Premier ministre n’appliquaient pas l’article 105 de la loi susvisée. De ce fait, il se sentait autorisé à faire de même. J’aimerais donc connaître le nombre de collectivités actuellement dans la même situation que le conseil général du Val-de-Marne. Quelle mesure comptez-vous prendre dans le projet de loi qui aura pour objet d’abroger cet article 105 ?
Madame la sénatrice, pour justifier la création du jour de carence, le précédent gouvernement avait avancé les arguments simples suivants : les fonctionnaires sont avantagés par rapport aux salariés du secteur privé soumis à trois jours de carence ; l’absentéisme est plus important dans le secteur public que dans le secteur privé ; il est nécessaire de restaurer l’équité entre salariés et agents publics. Comme vous l’avez rappelé en posant votre question, l’objectif sous-jacent était, en fait, de réaliser des économies budgétaires puisque ce sont les administrations elles-mêmes, et non l’assurance maladie, qui assurent le versement du traitement des fonctionnaires pendant leurs arrêts pour maladie de ces derniers.
Le Gouvernement a décidé d’abroger ce dispositif dans la prochaine loi de finances. En effet, un an après la création de celui-ci, un premier bilan a été établi ; il démontre, d’une part, que le jour de carence n’a pas les effets que l’ancien gouvernement escomptait et, d’autre part, que de nombreuses craintes n’étaient pas fondées.
Ainsi, en termes d’équité, 77 % des salariés du secteur privé qui appartiennent à de grands groupes ne sont pas soumis à un jour de carence car ils sont couverts par des systèmes de prévoyance ou par des conventions de branche ou d’entreprise, tout comme 47 % des salariés des toutes petites entreprises, pour les mêmes raisons. En revanche, le jour de carence dans la fonction publique a concerné 100 % des agents publics dès le premier jour de leur arrêt maladie. Afin de corriger une iniquité, on en crée en réalité une nouvelle, et non des moindres.
Ensuite, l’absentéisme a été décrit comme un phénomène majeur. Or selon les chiffres fournis – j’ai d’ailleurs attendu d’en disposer avant de soumettre une proposition à M. le Premier ministre –, la proportion d’agents en arrêt de courte durée est passée de 1, 2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, de 0, 8 % à 0, 7 % dans la fonction publique hospitalière, tandis qu’elle est restée stable dans la fonction publique territoriale. Ces données montrent que les « récupérations » de journées travaillées redoutées n’ont pas eu lieu.
En revanche, dans le même temps, on note une durée plus longue des arrêts pour maladie. Le salarié qui justifie son jour de carence en produisant un certificat médical a tendance à suivre les préconisations de son médecin et à prendre les trois ou quatre jours d’arrêt maladie que celui-ci lui conseille. Nous sommes donc perdants de ce point de vue.
Toutes choses égales par ailleurs, puisque la mesure a rapporté 60 millions d’euros à l’État, alors que son produit avait été évalué à 120 millions d’euros, j’ai proposé que soit supprimé le jour de carence.
Je rappelle également qu’un certain nombre de collectivités territoriales sont en train de négocier des systèmes de prévoyance supplémentaires, qui vont coûter fort cher.
Comment vérifier que chaque collectivité locale soit en accord avec la loi ? À l’heure actuelle, aucun dispositif ne le permet. Je rappelle le principe de libre administration des collectivités locales. Il appartient donc à chaque citoyen ou à toute personne qui y a intérêt d’ester en justice en la matière.
Mais compte tenu de la grande difficulté à mettre en place le dispositif actuellement en vigueur, du coût qu’il représente pour les fonctions supports, notamment l’établissement de nouveaux logiciels de paye, je comprends qu’il ne soit pas forcément appliqué les prochains mois de son existence. Il revient à l’exécutif de chaque collectivité de décider ce qu’il doit faire.

Madame la ministre, comment voulez-vous que je me satisfasse de votre réponse ? Je vous ai posé une question précise : la non-application de la journée de carence est-elle légale ou pas ? Vous ne me répondez pas !

Vous avez justifié pendant une minute et demie l’abrogation du jour de carence, après l’avoir expliqué en long et en large dans les journaux. Je vous demande simplement : est-ce légal ou non ? Or vous ne me répondez pas ! Vous comprenez, dites-vous, que la disposition actuellement en vigueur ne soit pas appliquée, mais vous ne vous prononcez pas sur l’aspect juridique.

Vous êtes ministre. Vous devez pouvoir me répondre sur ce point ! Par conséquent, je m’étonne de votre réponse.
Par ailleurs, vous me dites que vous n’avez pas de remontées. Or, dans la circulaire d’application, il est bien précisé qu’un tableau des remontées statistiques serait réalisé, qu’un bilan chiffré du nombre de jours ayant fait l’objet d’une retenue devrait être produit tous les trimestres et que la direction générale des collectivités locales et la direction générale de l’organisation des soins feraient remonter toutes les informations. Est-ce à dire que les circulaires de l’État ne sont pas non plus appliquées ?
Par votre absence de réponse, vous montrez l’ambiguïté de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous refusez de nous dire que cela ne coûtera pas très cher. Or hier, comme par hasard, j’ai réussi à obtenir le coût de la mesure pour ma collectivité. En deux mois, cette dernière a enregistré 1 890 jours d’arrêt maladie pour un montant total de 128 000 euros, soit annuellement – j’ai fait le calcul – 768 000 euros, et ce alors que la loi s’appliquait. Alors que l’on demande aux collectivités locales de réaliser des économies, en l’espèce, en attendant le vote d’une prochaine loi, on n’essaie même pas d’appliquer les dispositions en vigueur !
Madame la ministre, je suis assez scandalisée par votre absence de réponse et par l’attitude du Gouvernement.

La parole est à M. Alain Houpert, auteur de la question n° 212, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la rétribution des heures de vie de classe, motif fréquent de désaccords entre les professeurs principaux et leur direction.
L’heure de vie de classe est intégrée à l’emploi du temps des élèves depuis la rentrée de 2002. L’organisation de cette heure incombe au professeur principal de la classe, à qui il revient de faire appel à divers intervenants pour l’animer, s’il le souhaite.
Une dizaine d’heures annuelles sont consacrées à la vie de classe, mais aucune rémunération spécifique n’est prévue. En effet, le décret n° 50-581 concernant les obligations réglementaires de service pose des principes clairs : toute heure au-delà des obligations réglementaires de service inscrite à l’emploi du temps est rémunérée en heure supplémentaire annuelle. Toute heure supplémentaire effectuée ponctuellement est payée en heure supplémentaire effective.
Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves a été instituée en 1993 ; elle n’a cependant pas vocation à rémunérer les heures de vie de classe créées par les arrêtés postérieurs du 14 janvier 2002 et du 6 juillet 2004. De plus, ces arrêtés prévoient que le professeur principal est chargé d’organiser l’heure de vie de classe, non de la faire. Si rien n’est effectivement indiqué sur leur rémunération, le fait qu’elles soient considérées comme supplément du service dû implique, de facto, qu’elles soient rétribuées en heures supplémentaires effectives.
Force est de constater qu’il existe un flou persistant autour de la rémunération des heures de vie de classe. Cette situation est d’autant plus anormale qu’elle cause de réelles disparités d’un établissement à l’autre.
Ce faisant, de telles disparités s’accroissent, au point de devenir intolérables avec la fiscalisation des heures supplémentaires.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer sur la manière dont le Gouvernement entend désormais rétribuer les heures de vie de classe ?
Monsieur le sénateur, intégrées à l’emploi du temps des élèves depuis la rentrée scolaire de 2002, les heures de vie de classe ont pour objet de permettre un échange au sein de la classe entre les élèves et les adultes sur toutes les questions liées à la vie scolaire, à l’éducation et à l’orientation.
Elles représentent environ, comme vous l’avez rappelé à juste raison, dix heures par an et sont placées sous la responsabilité du professeur principal.
Elles peuvent également être animées, vous le savez, par d’autres enseignants, mais toujours sur leur temps de travail.
Les heures de vie de classe, eu égard à leur objet, sont assez satisfaisantes.
Monsieur le sénateur, vous soulevez plus spécifiquement la question de la rémunération de ces heures consacrées à la vie de classe.
Ces heures, comme cela a toujours été le cas, relèvent des obligations de service des personnels concernés et ne donnent donc lieu à aucune rémunération supplémentaire.
L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, l’ISOE, instituée en 1993 et à laquelle vous avez fait référence, n’a donc pas pour vocation de rémunérer ces heures de classe. Mais l’attribution de la part modulable de l’ISOE peut reconnaître le travail particulier et l’investissement des professeurs principaux, qui assurent à la fois une tâche de coordination des élèves et apportent à ceux-ci un soutien dans la préparation de leur orientation.
Vous le savez, notre position est de conforter les moyens qui permettent une meilleure vie scolaire comme une meilleure orientation. Le Sénat aura l’occasion de débattre de ces questions à partir du 20 mai prochain, et la commission saisie plus prochainement.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune difficulté majeure concernant la rétribution des heures en cause. Si l’heure de vie de classe se déroule sur un temps de service normal, sa rémunération relève du traitement normal ; si elle s’effectue dans le cadre d’heures supplémentaires, elle sera rétribuée à ce titre.
Si, en raison de l’apparition de vraies difficultés – je n’en ai pour l’instant pas connaissance –, nous devions envisager des rétributions particulières, nous le ferions.
Par ailleurs, je ne vois pas de rapport entre cette question et la défiscalisation des heures supplémentaires, qui correspond à une autre préoccupation.

Monsieur le ministre, il me semble que cette question est légitime, et nous l’entendons souvent posée dans nos permanences. Tout travail mérite salaire, et l’absence de rémunération peut démotiver les enseignants, qui effectuent un travail noble. Comme le disait le sénateur Victor Hugo, « chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ».

La parole est à M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 294, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l’évolution du nombre de postes dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, en Dordogne.
En effet, 23 postes – soit la moitié des effectifs – ont été supprimés dans les écoles primaires en 2012, et aucune indication n’a été fournie pour les années à venir, du moins pour l’instant. Les syndicats d’enseignants et les associations de parents d’élèves se sont d'ailleurs mobilisés récemment sur ce sujet.
Le simple maintien du nombre de postes à son niveau actuel ne permet pas de répondre efficacement aux besoins des élèves les plus fragiles et les plus « en souffrance », comme on dit, dans l’école. Il ne permettra pas non plus de réduire les inégalités entre les élèves.
La situation est particulièrement préoccupante en Dordogne. Le dernier rapport relatif aux résultats de l’académie de Bordeaux, publié le 4 septembre 2012, relevait, certes, que le taux de réussite au baccalauréat général en Dordogne était à peu près identique au taux national, mais il indiquait également que, dans les filières technologiques et professionnelles, le taux de réussite dans ce département était inférieur à celui de la moyenne de la région Aquitaine depuis plusieurs années.
Mis en place en 1990, le dispositif RASED a fait la preuve de ses effets positifs sur la réussite des enfants dans le secondaire. Réduire les effectifs de ces réseaux revient donc – vous le savez, monsieur le ministre – à créer un important échec à long terme, notamment dans les filières d’apprentissage.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 31 671 enfants scolarisés en Dordogne à la rentrée 2012-2013, il ne reste plus qu’un enseignant RASED pour 1 319 élèves dans ce département, contre un pour 546 élèves à l'échelon national. Cet écart illustre parfaitement les difficultés que nous rencontrons. Je sais bien, monsieur le ministre, que vous avez créé un millier de postes de professeurs des écoles en juillet 2012 et que 104 postes ont été réaffectés aux RASED. Nous nous en félicitons, mais ce ne sont malheureusement pas des académies de notre secteur qui en ont bénéficié.
Les difficultés scolaires existent également dans les milieux ruraux, j’y insiste. Et pour ces futurs adultes en délicatesse avec l’école, l’insertion professionnelle est fortement problématique. Il importe que nos élèves en décrochage puissent bénéficier de nouveau d’un soutien pédagogique spécifique. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande quelles propositions concrètes vous comptez mettre en œuvre pour renforcer le dispositif RASED ou tout autre système d’aide spécialisée aux élèves en difficulté scolaire, en particulier en Dordogne.
Monsieur le sénateur, vous soulevez un problème qui nous préoccupe au premier chef : le traitement de la difficulté scolaire.
Nous avons affirmé que l’école était l’une de nos priorités, et nous avons déjà traduit cette assertion en actes, y compris du point de vue budgétaire, afin de nous donner les moyens, après la suppression de 77 000 postes en cinq ans, de traiter progressivement cette difficulté et de permettre à la France de retrouver de meilleures performances scolaires. C’est en effet notre avenir qui est en jeu : l’avenir de nos enfants, mais aussi, bien entendu, celui de notre pays.
Le Président de la République a souhaité inscrire cet engagement dans la durée, par le biais d’un projet de loi de programmation. Dès l’arrivée aux responsabilités de la nouvelle majorité, un collectif budgétaire exceptionnel a permis de créer un millier de postes supplémentaires dans l’enseignement primaire. Chaque académie gère ses postes de la manière qui lui semble la plus appropriée. Environ 10 % des postes ont été affectés à la reconstitution des RASED.
Notre action se poursuivra à l’avenir. Elle continuera à concerner en priorité les zones urbaines en difficulté, les zones rurales et les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Ces territoires doivent être les premiers à bénéficier des moyens supplémentaires que nous mettons en œuvre, par exemple pour l’accueil des enfants de moins de trois ans ou le dispositif « plus de maîtres que de classes » ; cinq postes ont d'ailleurs été attribués à votre département grâce à ce dispositif. Le souci d’aider les départements comme le vôtre anime toutes nos décisions.
Nous avons entamé une réflexion globale sur le traitement de la difficulté scolaire et l’organisation des RASED, qui, dans votre département, avaient été réorganisés au début de l’année 2012.
Nous voulons mieux articuler ces réseaux avec le traitement des difficultés dans les classes – tel est l’objet du dispositif « plus de maîtres que de classes » – et en dehors des classes. Des travaux sont en cours au ministère de l’éducation nationale, avec l’ensemble des organisations représentatives des personnels. Un rapport a été demandé à l’inspection générale de l’éducation nationale. Ce document nous permettra bientôt de définir les principes d’une organisation optimale du traitement de la difficulté scolaire, en nous appuyant sur les 7 000 postes programmés dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes ».
J’examinerai tout particulièrement les situations locales, comme j’ai eu l’occasion de l’annoncer à l’Assemblée nationale. Je n’ai pas pu me rendre dans votre département il y a une quinzaine de jours, comme je souhaitais le faire, mais ce n’est que partie remise. Je dois en effet vous dire que j’ai été quelque peu surpris par votre description de la situation lorsque je l’ai découverte, hier après-midi.

Monsieur le ministre, je me félicite de l’action que vous menez. Comme vous l’avez souligné, il est important que les postes qui seront créés cette année permettent, sinon de favoriser les zones rurales, du moins d’examiner plus particulièrement les problèmes auxquels elles sont confrontées.
En effet, il existe des difficultés, liées notamment à un travail moindre dans la famille ou à la fatigue supplémentaire causée par les déplacements, que ne rencontrent pas les enfants vivant en milieu urbain.
Je vous remercie de considérer particulièrement les problèmes qui existent en Dordogne. Je vous demande d’imposer, si cela est possible, des obligations de concertation aux inspecteurs d’académie et aux recteurs. En effet, je le remarque, notamment dans mon département, c’est par la concertation, qui fait quelque peu défaut actuellement, que nous permettrons aux parents d’élèves et aux enseignants, tout à fait demandeurs en la matière, de se rendre compte de la situation et des efforts qui seront réalisés.

La parole est à M. Jean-François Humbert, auteur de la question n° 329, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur les modalités concrètes de la réforme des rythmes scolaires applicable en 2013 ou en 2014. Je souhaite relayer les craintes exprimées par la grande majorité des maires du département du Doubs dans leurs réponses à un questionnaire relatif à la réforme des collectivités territoriales que je leur ai récemment adressé.
À la lecture de ces réponses, il apparaît clairement que les maires sont très inquiets quant aux conséquences de cette réforme sur la gestion de leur budget. Il en ressort que la majorité des communes rurales pensent ne pas être en mesure de mettre à disposition les activités péri-éducatives, culturelles, artistiques et sportives de qualité que la réforme promet, ni d’assumer cette nouvelle dépense.
En effet, le milieu rural se trouve doublement pénalisé, dans la mesure où il ne dispose pas toujours de structures sportives et culturelles pour accueillir les écoliers après le temps scolaire. C’est pourquoi, dans le département du Doubs, qui compte 594 communes, moins de 10 communes devraient a priori s’engager dans la réforme dès 2013. Hier, la ville de Besançon a ainsi annoncé qu’elle reportait à 2014 son application.
En somme, la mise en œuvre de cette réforme s’annonce bien difficile, et la majorité des maires souhaitent une compensation financière pérenne de l’État, et non une aide ponctuelle, pour assumer cette nouvelle charge.
Je vous rappelle que, juridiquement, la prise en charge des activités périscolaires ne relève pas des obligations des communes, alors que celles-ci assurent généralement un service de qualité aux enfants de leur territoire. Par conséquent, monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de rassurer les communes rurales en leur garantissant une prise en charge financière durable ?
Monsieur le sénateur, vous avez raison de le souligner, la modification des rythmes scolaires est une réforme difficile. J’imagine d'ailleurs que notre pays, s’il veut trouver la voie du redressement, devra réaliser bien des réformes difficiles. Il faudra faire preuve de volonté et fournir un certain nombre d’efforts.
Je viens de rappeler à Bernard Cazeau que le Gouvernement avait affirmé, dès la présentation de son premier collectif budgétaire, que l’école constituait l’une de ses priorités. Cette politique concerne non pas uniquement une partie de la France, mais bien tous les élèves, car il y va de l’intérêt du pays. Gouverner, c’est choisir, et nous avons fait ce choix.
Chacun le sait, la situation de nos élèves se détériore de manière terrible depuis quelques années. Cette dégradation a des causes, auxquelles il faut remédier. Tout le monde s’accorde à considérer nos rythmes scolaires comme l’une de ces causes. Des rapports parlementaires ont montré qu’il existait un consensus politique sur ce sujet. Mon prédécesseur avait d'ailleurs organisé une très longue consultation, qui avait débouché sur des recommandations : revenir à la semaine de quatre jours et demi et limiter les journées d’étude à cinq heures.
Or il arrive un moment où la France doit être capable de réaliser les réformes de structure dont elle a besoin. C’est ce que fait le Gouvernement, même si je conçois que cette mesure soit difficile à mettre en œuvre.
L’éducation nationale reprend trois heures le mercredi matin ; c’est l’essentiel. J’y insiste, nous n’avons pas transféré une seule heure aux collectivités territoriales : nous reprenons trois heures. Certaines communes accueillaient déjà les enfants le mercredi matin, d’autres ne le faisaient pas.
En revanche, pour la première fois dans l’histoire de notre République, nous avons créé un fonds, doté de 250 millions d'euros, pour aider les collectivités territoriales à assumer leurs activités périscolaires. Vous aurez noté que nous n’avons pas consenti le même geste en faveur des professeurs, qui devront pourtant travailler le mercredi matin et qui n’en sont pas toujours ravis.
Le Président de la République a souhaité que ce fonds permette de faire un geste particulier en direction des communes rurales. La première année, ces dernières bénéficieront donc de 90 euros par élève, soit 40 euros de plus que les autres communes, et nous envisageons d’allouer 45 euros par élève en 2014.
Monsieur le sénateur, vous me dites que la plupart des communes de votre département ne souhaitent pas bénéficier de ces aides. Nous le comprenons, car il leur faut peut-être du temps pour trouver les activités les mieux adaptées aux élèves. Nous partageons cette préoccupation, mais si nous voulons réussir cette réforme, dont personne ne conteste la nécessité pour les élèves – récemment encore, l’Académie de médecine a encouragé les élus que vous êtes à aller dans cette direction –, nous devons nous mettre en mouvement.
L’État, plus particulièrement le ministère de l’éducation nationale, assume ses responsabilités. Dès notre premier collectif budgétaire, nous avons créé des postes, dont certains dans votre département, monsieur le sénateur, et nous allons maintenant reprendre trois heures le mercredi matin, tout en aidant les collectivités locales, si elles le souhaitent, à définir progressivement leurs projets éducatifs de territoire. Pour celles qui ne peuvent pas appliquer la réforme en 2013, nous verrons en 2014. Puis, lorsque la réforme aura été mise en œuvre, nous déciderons si nous pérennisons les soutiens financiers. En tout cas, pour le moment, les aides existantes ne sont même pas toutes utilisées par les collectivités locales.

Monsieur le ministre, je n’ai pas remis en cause la réforme que vous défendez et je n’ai pas l’intention de le faire. Étant issu d’une famille d’enseignants, je considérais depuis très longtemps qu’il fallait en arriver là.
En revanche, je n’ai pas eu de réponse à la question que je vous ai posée : la modeste aide financière de l’État sera-t-elle pérenne ? Si elle n’est prévue que pour l’année scolaire 2013-2014, les communes se trouveront inévitablement ensuite devant le problème que j’ai évoqué. Je dis oui à la réforme, mais pas dans ces conditions, monsieur le ministre !

La parole est à M. Alain Fauconnier, auteur de la question n° 332, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, nous le savons tous, la France est multilingue, et ce malgré les nombreuses tentatives, dans un passé plus ou moins ancien, d’éradiquer les langues régionales, longtemps appelées « patois ». Cette attitude a assis notre réputation de pays « glottophage », pour reprendre l’amusante expression d’un écrivain contemporain.
Aujourd’hui encore, ces langues concernent 13 des 26 régions françaises, soit la moitié de notre territoire national. Que ce soit dans l’Hexagone ou dans les départements d’outre-mer, le français coexiste avec l’occitan, le breton, le provençal ou le créole. Elles sont encore parlées quotidiennement par de nombreux citoyens et sont inscrites dans la toponymie du territoire national comme dans l’histoire et la culture de notre nation. Depuis 2008, elles sont reconnues officiellement par la Constitution comme appartenant au patrimoine de la France.
Ces langues constituent bien souvent des vecteurs de solidarités transrégionales et transnationales. Jean Jaurès, voilà exactement un siècle, l’avait perçu, puisqu’il recommandait aux enseignants de les prendre en compte, à une époque où Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en 1904, était déjà considéré comme l’un de nos grands auteurs.
C’est bien l’intérêt éducatif de l’enseignement des langues de France qui doit être reconnu et valorisé par la loi. Ainsi, comme le soulignent nombre d’experts, le bilinguisme précoce paritaire français-langue régionale apporte des résultats tout à fait satisfaisants dans trois domaines principaux : la maîtrise de la langue nationale ; celle des disciplines scolaires comme les mathématiques ou les sciences ; celle, enfin, des langues étrangères. L’enseignement des langues régionales facilite donc un véritable plurilinguisme.
Par ailleurs, une meilleure reconnaissance de notre multilinguisme historique dans les écoles de France est aussi un bon argument pour conforter la légitimité de la politique de promotion du français dans le monde. Ce « gisement linguistique national » doit donc être de nouveau valorisé et utilisé.
Or, depuis la rentrée scolaire 2002, ces disciplines ont perdu une grande partie de leurs possibilités et moyens d’enseignement. Leur valorisation aux examens a été réduite. Pour 2013, malgré une augmentation de 35 % des recrutements dans l’éducation nationale, l’ensemble des CAPES de langues régionales, lesquels représentent 0, 1 % des effectifs de ces enseignants, n’a pas évolué.
Rappelons que, pour l’heure, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République n’évoque ni plurilinguisme ni langues régionales, si ce n’est en annexe, ce qui est éminemment regrettable.
Monsieur le ministre, je vous remercie de nous faire part des mesures que vous comptez prendre ou proposer pour encadrer la reconnaissance des langues de France et le développement de leur enseignement, notamment dans le projet de loi d’orientation.
Comment comptez-vous traduire concrètement cette légitime reconnaissance, en nombre de postes au CAPES et en moyens horaires, afin de rattraper le retard accumulé depuis bientôt dix ans et mettre en œuvre le changement attendu et annoncé ? Le devoir de mémoire est souvent invoqué, dans toutes sortes de domaines. Convenez qu’il s’applique parfaitement à ce sujet !
Monsieur le sénateur, je voudrais tout de même souligner la persistance de l’effort de l’État sur ce dossier.
Vous l’avez fort bien rappelé, c’est au plus haut niveau de l’ordre juridique interne que les langues régionales ont été consacrées. L’article 75-1 de la Constitution dispose, sans que personne ne songe à l’interroger, qu’elles appartiennent au patrimoine français.
À cet égard, une attention toute particulière est portée, de manière continue depuis un certain temps, à leur apprentissage. Ainsi, la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’école, dite « loi Jospin », et la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dite « loi Fillon », ont affirmé la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de suivre un enseignement dans une des langues régionales, dans les régions où celles-ci sont en usage. Dans ces territoires, la promotion et le développement des langues et cultures régionales sont encadrés par des conventions liant l’État et les collectivités territoriales, comme vous le savez.
J’ai déjà eu l’occasion de dire, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, que je souhaitais voir ce mode de collaboration avec les associations concernées, qui n’existe pas dans toutes les régions, mais qui a été couronné de succès, maintenant généralisé. En tout cas, l’État y est prêt.
Permettez-moi de donner quelques chiffres : cet engagement bénéficie à 272 000 élèves, répartis dans 13 académies et pratiquant onze langues régionales. Il faut savoir que, en deux ans, de 2009 à 2011, une augmentation de 24 % du nombre d’élèves concernés a été constatée.
Les moyens attribués, notamment les effectifs de professeurs, n’ont peut-être pas toujours suivi. Je me suis engagé à corriger cela, notamment en augmentant le nombre de postes offerts aux concours d’enseignants pour répondre à une demande réitérée.
Le débat parlementaire a déjà permis, à l’Assemblée nationale, d’enrichir notre texte du point de vue de la reconnaissance des langues régionales, en particulier s’agissant de la possibilité de les pratiquer dès le plus jeune âge. À ce sujet, monsieur le sénateur, vous avez eu raison de rappeler que les études dont nous disposons montrent que, même pour l’apprentissage du français, qui demeure constitutionnellement la seule langue de la République, le fait de pratiquer une langue régionale est bénéfique pour les élèves.
À l’occasion des débats qui se tiendront bientôt au Sénat, nous verrons si nous pouvons encore avancer, raisonnablement – en effet, bien des propositions qui m’ont été adressées étaient anticonstitutionnelles –, dans la voie de cette reconnaissance des langues régionales, que nous souhaitons accompagner.

Monsieur le ministre, je vous remercie de vos engagements. Sachez que nous serons quelques-uns au Sénat à tenter d’enrichir le texte sur la refondation de l’école.
Je voudrais simplement vous dire que, en 1988, avec Lionel Jospin, la ville de Saint-Affrique, dont je suis le maire, s’est engagée avec Albi dans le plurilinguisme, de la maternelle jusqu’au lycée. Nous disposons donc aujourd’hui d’un recul de vingt-cinq années et je reste très attaché à cette pratique, car je peux mesurer au quotidien, auprès des familles et des enfants, combien cette expérience a été un succès. Les jeunes concernés ont bien réussi, les familles se sont investies et une véritable dynamique s’est créée autour des écoles bilingues.
Cependant, je trouve que les choses se sont dégradées depuis une dizaine d’années, même si nous avons pu maintenir la qualité de l’enseignement grâce aux associations, au militantisme des maîtres et à l’engagement des parents. Aujourd’hui, tous sont en droit d’espérer que le changement sur lequel vous vous êtes quelque peu engagé aujourd’hui se concrétise rapidement, car ils sont épuisés par les coupes claires ayant affecté les moyens depuis des années.
Pour finir sur le problème des rythmes scolaires, qui a été évoqué précédemment, sachez que la ville de Saint-Affrique s’engagera à appliquer la réforme avec enthousiasme, en associant les parents, les enseignants et les associations. Enfin, monsieur le ministre, je vous remercie de tout ce que vous faites pour l’école.

La parole est à M. Robert Tropeano, auteur de la question n° 336, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur les conséquences de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans les communes, notamment en milieu rural.
Sans vouloir remettre en cause la nécessité de cette réforme, qui est très largement fondée, les élus s’inquiètent de son impact sur le budget de leur commune.
L’organisation d’activités périscolaires nécessite, tout d’abord, de répondre à plusieurs questions : quelles activités extrascolaires faut-il prévoir et avec quels intervenants ? Quelle organisation des transports scolaires, de la cantine et, enfin, quel coût cette modification entraînera-t-elle ?
Trouver des intervenants qui viendraient travailler une heure par jour sur quatre jours par semaine sera probablement plus difficile en milieu rural qu’en zone urbaine, où les temps et les coûts de déplacement ne sont pas les mêmes.
Si une telle démarche n’était pas engagée, le plus grand risque serait de voir se développer des garderies, qui ne répondraient en rien à l’ambition voulue par le Gouvernement pour son système éducatif.
C’est pourquoi, j’y insiste, il est indispensable d’apprécier et de prendre en compte la diversité des réalités territoriales et géographiques et d’adapter le soutien de l’État en fonction de celles-ci.
Le second point de ma question concerne le transfert de compétences vers les collectivités locales. Malgré la mise en place du fonds d’amorçage de 250 millions d’euros, uniquement pour la rentrée 2013, les élus restent cependant très réservés quant à une application de ces nouveaux rythmes scolaires dès cette échéance.
Une base forfaitaire de 50 euros par élève, augmentée de 40 euros pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale cible ou à la dotation de solidarité urbaine cible, sera accordée aux collectivités mettant en place la réforme dès la rentrée 2013. Pour l’application à la rentrée 2014, seules les communes éligibles à ces dotations percevront 45 euros par élève. Autant dire que très peu de communes seront concernées.
Par ailleurs, le Gouvernement ayant déjà annoncé la diminution des dotations aux collectivités à l’horizon 2014-2015, il est légitime que les élus se préoccupent de l’équilibre des finances de leur commune.
C’est la raison pour laquelle je souhaite que, au regard des premiers retours d’information de la part des élus et des services académiques dont vous disposez, vous puissiez nous informer des adaptations pérennes que vous envisagez de mettre en place pour aider et soutenir les élus locaux, afin que ce projet ambitieux, que je soutiens pleinement, soit une véritable réussite.
Monsieur le sénateur, la France s’est passionnée, ces dernières semaines, pour la question des rythmes scolaires et éducatifs. Je vois d’ailleurs comme un premier acquis de l’action du Gouvernement le fait que, partout dans le pays, on ait parlé des élèves et des enfants.
Il s’est noué des dialogues qui n’existaient pas entre les associations périscolaires, les collectivités locales, les parents, les professeurs, pour essayer de répondre à une question dont personne, dans la majorité comme dans l’opposition, ne nie l’intérêt essentiel pour les élèves.
Vous me dites qu’il y a des difficultés d’application. Je m’en suis rendu compte, même si je n’en doutais pas. Une telle perspective a d’ailleurs justifié, dans le passé, que tous ceux qui étaient convaincus de la nécessité de faire cette réforme ne l’aient pas faite. Il y a bien d’autres sujets comme cela en France, mais il arrive un moment où il faut agir !
J’installerai la semaine prochaine un comité de suivi, car, en réalité, ce que je constate sur le terrain, aujourd’hui, est très disparate. Par exemple, il faut savoir que le président de l’Association des maires ruraux de France appliquera la réforme dès cette année dans sa commune, à l’instar de ce qui se passera dans l’ensemble des communes du Tarn-et-Garonne, un département rural s’il en est, où j’étais récemment. J’ai pu faire le même constat dans le département de l’Aude.
Par ailleurs, vous aurez remarqué que, hormis Paris, Nantes et quelques autres, les grandes villes ont beaucoup de difficultés. Tel est le cas pour Lyon, Lille, soit des municipalités qui, politiquement, nous sont assez proches.
L’opposition entre le rural et l’urbain n’est donc pas si nette, de même que celle qui se fonde sur le critère de la richesse. J’ai noté, par exemple, que la ville la plus pauvre de France, Denain, appliquera la réforme en 2013 et se réjouit de la chance que l’État lui accorde au travers du fonds d’amorçage, considérant qu’elle n’a jamais eu autant de moyens pour ses enfants.
Je souhaite donc que cette passion bien française, qui s’est agitée ces derniers temps, se calme. Il faut examiner la question de façon rationnelle, parce que nous voulons tous réussir cette réforme, comme vous l’avez rappelé.
Il nous faut impliquer les différents ministères concernés – je tiens d’ailleurs à saluer Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, ici présente, qui est très engagée dans cette réforme – pour observer précisément ce qui se fait sur le terrain, d’autant que nous avons répondu à la demande qui nous avait été faite d’accorder la plus grande liberté possible.
Les associations d’élus nous ont demandé de les laisser construire le dispositif localement, sans trop de contraintes. Il s’agit d’une première, qui a pu poser quelques problèmes aux professeurs, lesquels sont concernés dans leur temps de travail. Le mot d’ordre a été : laissez-nous construire nos projets éducatifs !
Nous tirerons les conclusions de cette première démarche dans les mois qui viennent et continuerons d’accompagner, comme nous le faisons quotidiennement en mobilisant autant que nous le pouvons les services de l’éducation nationale, les élus qui s’engagent dans ce processus. Bien entendu, si le besoin de modifications se fait sentir, tant dans les modalités d’organisation que dans les moyens, nous aurons à en débattre collectivement. Le fonds d’amorçage est d’ores et déjà prévu dans le projet de loi ; le Sénat aura bientôt à en discuter.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans votre réponse la concertation que les élus ont pu engager avec les associations sportives et culturelles, ainsi qu’avec les parents d’élèves et les enseignants.
Or j’ai réussi à établir ce dialogue dans ma commune de Saint-Chinian, et je dois dire que tout s’est très bien passé. Les parents d’élèves et les associations sont prêts à nous aider afin que cette modification des rythmes scolaires puisse intervenir en 2013, sans attendre 2014.
En effet, si cette réforme est exigeante dans ses ambitions, sa mise en œuvre doit l’être également. Nous nous attacherons donc à ce qu’elle réussisse, avec l’aide de l’ensemble des associations, des parents d’élèves et des enseignants !

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 305, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au travers de cette intervention je soutiens l’idée d’une interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants mineurs.
Rappelons que le tabagisme fait aujourd’hui plus de cinq millions de victimes par an dans le monde : toutes les six secondes, une personne meurt du tabac. En France, il tue chaque année plus de 60 000 personnes, soit autant que l’alcool, les accidents de la route, le sida, les suicides, homicides et drogues illicites réunis – ce chiffre est effrayant !
La législation a déjà bien évolué, pour mieux protéger les mineurs, cible particulièrement sensible de la lutte anti-tabac. La loi du 31 juillet 2003 a mis plus particulièrement l’accent sur la protection des mineurs : elle interdit la vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans, ainsi que la vente de paquets de moins de vingt cigarettes, qui étaient plus facilement achetés par les mineurs ; elle prévoit aussi, dans le cadre de l’éducation à la santé, une sensibilisation obligatoire au risque tabagique dans les classes de l’enseignement primaire et secondaire. Autant de bonnes mesures !
Madame la ministre, je vous suggère aujourd’hui d’aller plus loin. En effet, dans la lutte contre le tabac, si l’on veut assurer efficacement la protection des mineurs, le véritable problème est la lutte contre le tabagisme passif auquel ceux-ci sont particulièrement exposés.
Les mesures de lutte contre le tabagisme visent notamment à protéger les non-fumeurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée de tabac. Cette dernière est très dangereuse, dans la mesure où il n’existe pas de seuil minimal d’exposition sans risque pour la santé, car il n’est pas nécessaire d’être exposé des années pour en subir les conséquences. Au bout de quelques minutes, et même à partir d’une faible exposition, le tabagisme passif représente un réel danger.
C’est pourquoi, dans le cadre d’une politique globale de prévention du tabagisme, l’exposition des mineurs au tabac, dans des endroits clos, tels que les voitures, nécessite une vigilance accrue.
Dans le monde, plusieurs États ont déjà franchi le pas de l’interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants mineurs. En Europe, une réflexion sur ce sujet est menée depuis plusieurs mois par l’Irlande, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. La Grèce a mis en œuvre cette interdiction depuis décembre 2010. Un rapport allant dans le même sens a également été approuvé par le Parlement européen en 2007.
Je souhaiterais donc, madame la ministre, que vous m’indiquiez l’état d’avancement des réflexions de votre ministère sur l’interdiction de fumer dans les voitures en présence d’enfants mineurs. Je pense en effet qu’une telle mesure de santé publique serait salutaire.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Marisol Touraine, la ministre des affaires sociales et de la santé, qui est retenue par d’autres obligations. Votre question porte sur l’interdiction éventuelle de fumer en voiture.
Vous avez rappelé, à juste raison, que le tabagisme était la première cause de mortalité évitable en France ; il entraîne le décès de 73 000 de nos concitoyens chaque année. Le tabagisme passif, celui du fœtus au cours de la grossesse ou celui des personnes côtoyant des fumeurs actifs, est source de morbidité et de mortalité dans des proportions importantes. Il augmente de manière significative les risques de cancer du poumon et de cardiopathie ischémique chez les adultes, de mort subite du nouveau-né et d’infection pulmonaire, d’asthme et d’otites chez les enfants. Chaque année, plus de mille décès sont attribués au tabagisme passif. Sa diminution doit donc rester une priorité.
Le décret du 15 novembre 2006 a sensiblement renforcé l’interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, les moyens de transport collectif et les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Cette mesure a entraîné un changement majeur de l’exposition passive au tabac en France, en particulier dans les lieux de loisirs et de travail. Toutefois, des améliorations restent possibles.
La protection des mineurs, et plus particulièrement des plus jeunes, contre le tabagisme passif doit être une priorité. D’une part, elle contribue à réduire les pathologies induites par l’exposition au tabac ; d’autre part, elle doit contribuer à rendre le tabac moins attractif pour les plus jeunes générations, en quelque sorte à le « dé-normaliser ».
L’article 8 de la convention-cadre de lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la santé et la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac suggèrent d’élaborer ou de renforcer des stratégies et des mesures visant à réduire l’exposition des enfants et des adolescents à la fumée de tabac secondaire.
Vous proposez de réfléchir à l’interdiction de fumer dans les voitures en présence d’un enfant mineur. Si cette solution est intéressante, elle peut se heurter au statut privé du véhicule, ce qui ferait douter de la faisabilité d’une telle mesure. D’autres pistes de réflexion doivent être explorées, et nous pensons, en particulier, à l’extension de l’interdiction de fumer dans tous les lieux collectifs où sont présents des mineurs, tels que les parcs publics, les jardins d’enfants et les plages.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, mais je tiens à souligner que la protection de l’enfance ne s’arrête pas à la porte du domicile privé ! Elle doit être garantie partout sur l’ensemble du territoire, que les lieux concernés soient publics ou privés. Je souhaitais donc savoir s’il était envisagé d’interdire de fumer en voiture, notamment dans l’intérêt de la protection des enfants.
Dans ma prime jeunesse, j’ai appris que ma liberté s’arrêtait là ou commençait celle des autres. Tel doit précisément être l’objet de notre préoccupation : les enfants ne peuvent pas se défendre directement et il appartient aux adultes de les protéger. J’insiste donc pour que votre ministère s’empare de ce dossier, dans le cadre de la protection de l’enfance, madame la ministre, afin de préserver effectivement la santé de nos enfants.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 331, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité attirer l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la teneur du projet de décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles.
Ce projet de décret ajoute, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, une section 4 portant sur les règles sanitaires applicables aux baignades artificielles.
Afin d’éviter le confinement et la stagnation de la masse d’eau et d’assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l’article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, l’exigence de « renouveler la totalité du volume de la zone de baignade en moins de douze heures au moins pendant la période d’ouverture au public, ce renouvellement étant permanent, et assuré par un apport d’eau neuve ».
Si le bien-fondé de cette nouvelle réglementation, qui apportera une amélioration de la sécurité sanitaire des baigneurs, n’est pas contestable, il est en revanche possible d’émettre quelques réserves sur la faisabilité du comptage des baigneurs, qui vise à limiter le nombre de ces derniers.
Le plus grave est que les baignades aménagées « maritimes », dont l’alimentation est soumise à un régime de marées macrotidales, sont dans l’impossibilité – j’y insiste – de respecter les prescriptions sur le renouvellement en « eau neuve » relatives à un système ouvert.
En effet, ces bassins, en raison de l’éloignement de la ressource en eau à marée basse, n’assurent l’apport en eau de mer qu’en période de marée haute. Cette contrainte n’est pas toujours compatible avec la période d’ouverture au public et elle est difficilement réalisable en moins de douze heures. En l’état, l’application de cette nouvelle réglementation reviendrait à condamner l’existence des baignades artificielles dites « à marées ».
En conséquence, dans le respect de cette volonté d’assurer le meilleur niveau de sécurité, il serait souhaitable de nuancer cette contrainte, en substituant un objectif de résultat à l’actuelle obligation de moyens. Cette disposition pourrait alors ouvrir aux baignades aménagées « maritimes » dont l’alimentation est soumise à un régime de marées macrotidales la possibilité de trouver des solutions compatibles avec leur spécificité.
Dans ces circonstances, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette approche. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, si ce projet de décret restera en l’état et quand il sera promulgué ?
Madame la sénatrice, vous interrogez la ministre des affaires sociales et de la santé sur la teneur du projet de décret relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignades artificielles. Votre question porte, notamment, sur le renouvellement de la totalité du volume des zones de baignade artificielles maritimes par un apport d’eau neuve. Ces zones de baignade, dites « à marée », sont en effet soumises au régime des marées.
Cette question fait ressortir deux enjeux importants : d’une part, il faut assurer à nos concitoyens l’accès à des lieux de loisirs tels que les baignades artificielles, et, d’autre part, il convient de répondre à des impératifs de sécurité sanitaire face aux risques identifiés pour les baignades artificielles.
Les baignades artificielles recevant du public ne correspondent ni à la définition d’une eau de baignade dite « naturelle » ni à celle qui est fixée pour une piscine par le code de la santé publique. Les règles techniques relatives aux eaux de baignades naturelles et celles qui sont relatives aux piscines ne s’appliquent donc pas à ce type d’installation.
Les ministères chargés de la santé et de l’écologie ont saisi l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour évaluer les risques sanitaires associés à ce type de baignades artificielles et définir les prescriptions techniques assurant la sécurité sanitaire des baigneurs.
L’expertise collective intitulée « Évaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles », publiée en 2009, a identifié divers dangers sanitaires qui peuvent être préoccupants pour les baigneurs, si aucune mesure n’est mise en œuvre. Il en va ainsi des risques infectieux liés à la présence de micro-organismes apportés par les baigneurs et des risques liés à l’environnement, tels qu’une prolifération de micro-algues et de cyanobactéries, une contamination chimique ou des eaux souillées par l’intrusion d’animaux.
Sur la base du rapport, un projet de décret, dont vous soulignez le bien-fondé pour améliorer la sécurité sanitaire des baigneurs, a été élaboré par les services du ministère des affaires sociales et de la santé. L’exigence de renouvellement de la totalité du volume de la zone de baignade en moins de douze heures, pendant la période d’ouverture au public, figure dans le projet de texte soumis à consultation.
Compte tenu des contraintes liées au mode d’approvisionnement en eau de certaines baignades artificielles en façade maritime, les services du ministère modifieront le projet de décret afin de prévoir un système de dérogation pour le renouvellement de l’eau des bassins à marée, sous réserve du respect des limites de qualité de l’eau fixées dans le projet de texte.

Je vous remercie de votre réponse très encourageante pour les collectivités locales, madame la ministre.
Nous comprenons tous qu’il faille respecter les exigences de sécurité en matière de santé. Toutefois, tel qu’il a été porté à notre connaissance, ce projet de décret est extrêmement contraignant.
Le bassin d’Arcachon comprend trois bassins de cette nature et ma ville envisage également d’en créer un. En ce qui me concerne, puisque je n’ai pas encore eu à définir les conditions de réalisation de ce bassin, je suis en mesure de prendre en compte les nouvelles contraintes. Il n’en reste pas moins que je m’intéresse aussi aux trois autres bassins qui, en l’état actuel du texte, seraient condamnés. En effet, respecter le niveau d’exigence que j’ai rappelé tout à l’heure suppose un travail de mise aux normes que les collectivités locales ne sont pas en mesure d’assumer.
Je peux vous parler de cette question en connaissance de cause, parce que j’ai demandé à un bureau d’études de réfléchir aux aménagements rendus nécessaires par cette nouvelle norme. Il ressort de ces travaux que, pour appliquer ce texte, il faudrait non pas un seul bassin, mais au moins deux : un véritable bassin de baignade et un bassin en alimentation d’eau, proche du premier !
Or, dans certains endroits, c’est absolument impossible. En ce qui concerne mon territoire, je sais pouvoir le faire, même si je n’ai pas encore choisi exactement le lieu ; je poursuis d'ailleurs ma réflexion avec les services de l’État, dans le cadre d’un comité de pilotage. Toutefois, les bassins de baignade qui existent aujourd’hui sont absolument incompatibles avec la nouvelle réglementation. Et je vous remercie, madame la ministre, de nous avoir ouvert, dans votre réponse, la porte de l’espérance.
Faute d’inflexion, en effet, il va falloir choisir : soit on cesse de demander aux collectivités ce type de dépenses inconsidérées, soit on prive les familles – nous sommes ici au cœur de votre compétence, madame la ministre, et je vous sais très attachée à ce sujet – et les enfants de bassins de baignades artificielles sur le littoral.
N’exagérons rien : il n'y a ni des morts ni des malades en nombre à déplorer dans ces bassins de baignade ! La presse n’en a pas encore parlé. Croyez-moi, s’il y avait eu le moindre problème à ce sujet, les médias s’en seraient emparés ! Il ne faut donc rien exagérer.
Pour ma part, je suis d’accord pour que l’on améliore encore les normes en matière de sécurité, mais il ne faut pas en demander trop aux collectivités, que la diminution des subventions et dotations met déjà aujourd'hui en difficulté.

La parole est à M. Jean-Claude Leroy, auteur de la question n° 334, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille.

Ma question s’adresse à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé. Elle porte sur l’avenir de la plate-forme de services de la caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, située à Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais.
Cette plate-forme téléphonique, inaugurée en février 2004, est à la disposition de l’ensemble des assurés du département, soit 1, 5 million de personnes.
Pensé comme un atout de développement de la qualité du service auprès de l’assuré, le système de plate-forme de services saint-polois occupe une position majeure. Lors de la mise en place de ce dispositif, celui qui était alors le président de la CPAM d’Arras indiquait, d’ailleurs, que le site de Saint-Pol revêtait un enjeu important en raison de sa situation centrale dans le département et de la qualité du service rendu à l’assuré.
Pourtant, un projet de départ de cette plate-forme de Saint-Pol et le transfert de cette activité sur le site arrageois ont été annoncés ; ce transfert est prévu pour le dernier trimestre de cette année.
Selon le directeur de la CPAM de l’Artois, cette décision serait motivée par le fait que la plate-forme de services du Pas-de-Calais ne répondrait plus aux contraintes de l’assurance maladie, notamment en termes de distance par rapport aux sites principaux.
Autrement dit, le transfert du site ternésien serait motivé par son éloignement des sites principaux d’Arras et de Lens, ce qui semble contradictoire avec les propos tenus il y a dix ans, lors de l’installation du site.
Ce projet suscite, vous vous en doutez, de nombreuses inquiétudes chez les élus locaux et les différents acteurs du territoire. La plate-forme de Saint-Pol emploie actuellement une cinquantaine de salariés, dont la majorité habite dans le territoire saint-polois. Si ce projet devait se concrétiser, la durée du trajet entre le domicile et le travail de ce personnel s’en trouverait obligatoirement allongée dans des proportions considérables.
Par ailleurs, la disparition de cette activité à Saint-Pol constituerait un nouveau coup porté à ce territoire rural déjà touché par la suppression de certains services administratifs ; il a notamment été confronté au départ de la direction départementale de l’équipement, la DDE, de l’antenne de la préfecture, ainsi qu’à la fermeture du tribunal d’instance.
Cette décision, qui pénalise un secteur rural, va ainsi à l’encontre des politiques d’aménagement du territoire. On constate qu’il y a malheureusement toujours un fossé entre les discours et la réalité des faits. Aménager un territoire, c’est assurer le maillage de ce territoire.
Or, aujourd’hui, quoi qu’on en dise, on concentre les activités au moment où les nouvelles technologies permettent de mieux les diffuser sur les territoires et, surtout, de les mettre en réseaux. C’est cela une authentique politique d’aménagement du territoire !
Aussi, je souhaiterais, madame la ministre, que vous nous fassiez connaître les actions que compte entreprendre votre ministère afin de maintenir la plate-forme de la CPAM à Saint-Pol-sur-Ternoise.
Monsieur le sénateur, vous interrogez la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir de la plate-forme de services de la caisse primaire d’assurance maladie à Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais.
Le service de réponse téléphonique aux assurés de la CPAM de l’Artois est organisé sur deux sites : Saint-Pol-sur-Ternoise et Arras. Le conseil de la CPAM a délibéré en faveur du transfert de la plate-forme téléphonique de Saint-Pol vers Arras, qui est prévu pour le dernier trimestre de l’année 2013.
Cette évolution vise à permettre le maintien de la qualité de services aux assurés, ainsi qu’à répondre aux problèmes rencontrés sur le site de Saint-Pol en termes de conditions de travail.
En effet, l’augmentation du nombre de télé-conseillers, qui résulte de l’augmentation du nombre d’appels téléphoniques et de la prise en charge par les plates-formes des réponses aux courriels des assurés, a conduit à des difficultés sur le site de Saint-Pol. Ce transfert permettra aux salariés de la plate-forme de Saint-Pol de revenir à un espace par agent et à un niveau sonore conformes aux objectifs de la caisse.
Par ailleurs, compte tenu de la disponibilité de l’espace nécessaire sur le site d’Arras, ce transfert contribuera à une meilleure mobilisation de l’immobilier de la caisse.
En termes de temps de transport, une analyse a été réalisée par la CPAM afin d’évaluer l’impact sur les salariés de la plate-forme. Le site de Saint-Pol comprend aujourd’hui 56 agents et cadres. Il apparaît que seuls 25 % d’entre eux résident dans le canton de Saint-Pol, les trois quarts vivant en dehors de ce dernier, sur l’ensemble du territoire de l’Artois. Des mesures d’accompagnement de cette mobilité seront définies en concertation avec les représentants du personnel.
Ce changement de localisation ne remet pas en cause la présence de la CPAM de l’Artois auprès des assurés de Saint-Pol-sur-Ternoise. Un lieu d’accueil doit, en effet, être maintenu sur le territoire de la commune, en lien entre la CPAM de l’Artois et la municipalité.
Enfin, les locaux libérés par la CPAM ont d’ores et déjà fait l’objet d’une offre de reprise, ce qui témoigne de projets d’activités économiques sur le territoire de la commune.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Je persiste néanmoins à déplorer cette décision, car elle concerne une plate-forme dont le degré avancé de déconcentration constituait, à mon sens, un véritable signal adressé il y a dix ans en termes d’aménagement du territoire. On ne peut que regretter qu’un territoire rural soit, une fois de plus, la victime de cette politique de concentration, qui ne se justifie pas au moment où se développent les nouvelles technologies, comme le télétravail.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, dans l’attente de l’arrivée de Mme la garde des sceaux.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures trente.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 338, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la garde des sceaux, je souhaite vous interroger sur le pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, créé au sein du tribunal de grande instance de Paris à la suite de l’adoption de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.
À l’époque des discussions autour de cette création, la commission des lois du Sénat avait, de manière tout à fait légitime, me semble-t-il, émis le souhait que ce nouveau pôle permette à la justice française de traiter avec la plus grande efficacité les dossiers relatifs à ce type de crimes et demandé aux ministères de la justice et de l’intérieur que lui soient attribués des moyens suffisants pour agir efficacement, qu’il s’agisse des effectifs de magistrats et d’enquêteurs ou des moyens matériels indispensables pour mener les enquêtes dans les pays où ces crimes ont été commis.
Plus d’un an après l’adoption et la promulgation de cette loi, les associations qui militent pour que les responsables de ces crimes, notamment ceux qui ont été perpétrés au Rwanda en 1994, soient déférés devant la justice, regrettent que la situation n’ait pas évolué et que les magistrats chargés d’intervenir et de poursuivre les auteurs de ces crimes manquent de moyens et de temps.
Je souhaite donc que vous nous indiquiez, madame la ministre, ce qui a été fait pour la mise en place de ce pôle, mais également ce que vous entendez faire pour qu’il trouve sa pleine efficacité et pour que les magistrats qui lui sont affectés puissent agir avec toute l’efficacité requise. Il y va, me semble-t-il, de la crédibilité de l’État français auprès des victimes de ces crimes et de leurs familles.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, il faudra que je m’habitue à la célérité du Sénat ; l’expérience montre qu’il prend souvent de l’avance lors des séances consacrées aux questions orales...
Sourires.
Je vous remercie pour votre question, monsieur le sénateur, car elle renvoie à un sujet d’une extrême importance, et qui est cher au Sénat. Lors d’un débat récent organisé sur l’initiative du président de la commission des lois, M. Jean-Pierre Sueur, votre assemblée a en effet examiné et adopté sa proposition de loi visant à élargir la compétence territoriale des tribunaux français pour leur permettre de poursuivre et de juger des auteurs de génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger.
Vous savez, monsieur Détraigne, pour suivre ces travaux de près, que ladite proposition de loi visait à faire sauter quatre verrous limitant, dans le cadre du statut de la Cour pénale internationale, la compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement trois d’entre eux : l’exigence de résidence habituelle sur le territoire français, la double incrimination, l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale.
Ces trois verrous ont été levés. Reste le quatrième : le monopole pour engager l’action publique dont dispose le ministère public qui, rappelons-le, peut toutefois être saisi par tout citoyen.
La compétence française était déjà établie par la loi du 9 août 2010. La loi du 13 décembre 2011, que vous avez citée, a créé un pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes contre l’humanité, génocides, crimes et délits de guerre, mis en place le 1er janvier 2012 au sein du tribunal de grande instance de Paris.
Actuellement, quelque 33 procédures d’instruction sont suivies par le pôle spécialisé, dont 27 concernent le génocide commis au Rwanda en 1994. Enfin, s’ajoutent à ces procédures 9 enquêtes préliminaires concernant d’autres pays et confiées à la section de recherche de Paris.
Les procédures suivies pour crimes contre l’humanité et génocides commis à l’étranger, complexes et volumineuses, nécessitent du temps, ainsi que des effectifs et des moyens importants. Par exemple, les demandes d’entraide adressées au Rwanda imposent des déplacements d’une quinzaine de jours en moyenne, requérant une semaine de préparation.
Vous avez raison, monsieur le sénateur, il convient de veiller au niveau des effectifs et des moyens afin de garantir l’opérationnalité du pôle spécialisé.
Ce pôle, initialement composé d’un magistrat du parquet et d’un juge d’instruction, nous l’avons renforcé. Il comprend désormais deux magistrats du parquet, trois magistrats instructeurs, quatre assistants spécialisés issus des juridictions pénales internationales, dont un sociologue, étant précisé que deux autres assistants spécialisés devraient être recrutés au cours de l’année 2013.
Je vous propose que nous procédions à une évaluation de l’application de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur d’ici à la fin de l’année. Nous verrons bien si, en l’absence des trois verrous que je viens de citer, une masse de procédures vient s’ajouter, ou non, aux 33 informations judiciaires et aux 9 enquêtes préliminaires en cours.
Connaissant votre intérêt de longue date pour ces questions et votre compétence en la matière, je vous invite, monsieur le sénateur, à participer à cette évaluation.

Je vous remercie de ces précisions, madame la ministre.
Il ne vous a pas échappé que les événements du Rwanda se sont produits il y a près de vingt ans. Or plus le temps passe et plus les familles et les associations, souvent créées par des parents de victimes, désespèrent de connaître la vérité et de voir sanctionnés les responsables de ces crimes, qui continuent à vivre en toute impunité.
Vous l’avez dit, vous êtes consciente de la nécessité de renforcer les moyens de ce pôle. Il faut également veiller, me semble-t-il, à ce que les moyens qu’on lui affectera soient spécialement dédiés à ses missions. J’ai en effet entendu dire que certains des magistrats chargés de ces questions n’étaient pas entièrement déchargés de leurs autres dossiers, que je qualifierai de « métropolitains ».
Il est donc important, non seulement de mener à bien cette évaluation, mais aussi de donner à ce pôle les moyens de réussir et ainsi, parce que la justice française aura fait ce qu’elle devait faire, d’apaiser les familles.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 242, adressée à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.

Madame la ministre, ma question concerne la présence de l’État et des services publics dans nos territoires.
Je précise pour commencer que j’ai toujours défendu les services publics en milieu rural, quels que soient les projets des différents gouvernements. Ainsi, je n’ai pas soutenu le gouvernement qui avait décidé de supprimer des tribunaux d’instance ou encore des classes dans les écoles. Je suis donc très à l’aise pour intervenir aujourd'hui.
Voilà quelques mois, le nouveau pouvoir a formulé des promesses sur le maintien des services publics. Malgré tout, nous nous trouvons dans une situation d’indécision, qui préoccupe tous les élus. La présence de l’État dans les territoires ruraux semble menacée. Je pense en particulier à l’avenir des sous-préfectures, à propos duquel j’ai lu, dans le journal Le Monde daté du 19 mars dernier, un article qui m’a rendu très inquiet.
Par exemple, en ce moment, dans mon département de la Vienne, les sous-préfectures de Montmorillon et de Châtellerault subissent une restructuration, voire un rabotage de leurs missions.
La sous-préfecture de Montmorillon vient d’être dépossédée de ses services dédiés au permis de conduire – commissions médicales, rétention de permis… –, sans concertation naturellement. Selon ce qui m’a été indiqué à la préfecture de région, il est même envisagé de lui retirer des compétences dans le domaine de la pêche. Toutes ces missions font l’objet d’une recentralisation au niveau de la préfecture.
Ce faisant, on fragilise un peu plus les territoires, et je crains que l’on ne revienne sans le dire à une logique comptable comparable à la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Madame la ministre, l’intérêt des sous-préfectures n’est plus à prouver : bien souvent, elles sont le dernier lieu de contact entre l’État, les élus et les citoyens.
Dès lors, quel est l’intérêt de tout recentraliser à l'échelon des préfectures et des capitales départementales ? D'ailleurs, je rappelle que c’est exactement la même logique qui a inspiré la réforme des tribunaux d’instance, que l’opposition d’alors avait critiquée… Je me souviens même que l’actuel Président de la République avait quitté la préfecture, où la ministre s’était déplacée pour évoquer cette question ! Du reste, je note que ces tribunaux n’ont toujours pas été rétablis.
Ne serait-il pas préférable de déconcentrer certaines missions essentielles pour le fonctionnement de la ruralité ? A-t-on oublié le rapport Patriat sur les sous-préfectures ?
Les élus ruraux, inquiets de la réforme des cantons, ont un sentiment d’abandon. Cette situation est difficilement acceptable pour des populations touchées par des difficultés importantes.
Madame la ministre, je sais l’intérêt que vous portez à la ruralité. Pouvez-vous rassurer les personnels, les élus et les habitants qui s’inquiètent et nous dire quels sont les projets du Gouvernement pour les sous-préfectures ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question.
Vous mettez l’accent sur un point qui continue de préoccuper tous les membres du Gouvernement, en particulier s’agissant des zones rurales. Comme vous, j’ai le sentiment que ces dernières se sentent abandonnées et ont l’impression d’être victimes une certaine indécision.
Au problème que vous évoquez, le Gouvernement essaie d’apporter deux types de solutions. Les premières concernent les sous-préfectures ; les secondes, les services publics de façon plus générale.
S’agissant des sous-préfectures, elles constituent un échelon indispensable : c’est un lieu de solidarité et de cohésion sociale. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
C'est la raison pour laquelle le ministre de l’intérieur – au nom duquel je réponds sur ce point, les sous-préfets relevant de son autorité – a mis en place une commission d’évaluation qui, de façon tout à fait impartiale, s’est déplacée dans nos sous-préfectures pour se rendre compte des missions qui sont aujourd'hui les leurs et des améliorations devant être apportées aux conditions de travail de leurs agents.
Bien évidemment, il n’est pas question aujourd'hui de revenir à un dispositif « à la mode RGPP ». Il est question de mettre en place des structures qui répondent aux attentes de nos citoyens et leur apportent les meilleures réponses possibles.
Ce travail d’évaluation est en cours. Après restitution, il sera soumis aux élus pour négociation, conformément à la méthode du Gouvernement, qui privilégie l’écoute et la concertation.
Je peux vous assurer qu’il ne s’agit en rien de recentraliser pour recentraliser, à l'échelon régional. Notre volonté est d’apporter un meilleur service, tout en maîtrisant les dépenses.
S’agissant plus globalement de la réflexion sur les services que l’on doit aux citoyens et de la réforme de l’action publique, elles relèvent d’un domaine partagé entre le ministre de l’intérieur, M. Manuel Valls, et la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, Mme Marylise Lebranchu. Elles relèvent également de la compétence de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Ensemble, nous essayons d’étudier les modalités les plus à même d’apporter des services cohérents répondant aux besoins de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire.
Monsieur le sénateur, soyez assuré que nous recherchons des solutions efficaces et durables et que nous mettons tout en œuvre pour que le meilleur service soit rendu aux concitoyens sur nos territoires fragilisés.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Oui, dans les territoires ruraux, nous sommes inquiets. Quand nous voyons que d’autres services, comme les gendarmeries ou les perceptions, disparaissent, nous avons l’impression que les suppressions continuent de plus belle.
J’ai pris bonne note de l’évaluation en cours. Je souhaite que la concertation que vous avez évoquée ait lieu, que l’on tienne bien compte des facteurs spécifiques de la ruralité et que l’on ne supprime pas les sous-préfectures, qui jouent un rôle majeur dans le dispositif français.

La parole est à M. Didier Guillaume, auteur de la question n° 346, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la ministre, j’ai souhaité interpeller le ministre de l’intérieur à propos d’un problème qui inquiète un grand nombre d’élus locaux, notamment les maires, ainsi que, sans doute, une grande partie des parlementaires de la Haute Assemblée : les chiffres de la délinquance en zone gendarmerie pour 2012.
Le 18 janvier 2013, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a présenté le bilan annuel de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie. Pour la première fois, les chiffres de la police et de la gendarmerie ont été présentés séparément, ce qui a permis de constater une hausse de certains indicateurs en zone gendarmerie, c’est-à-dire dans les territoires périurbains et ruraux. Ainsi, une augmentation globale des cambriolages et des atteintes aux personnes a pu être mise en évidence dans ces zones.
Dans mon département de la Drôme, les actes de délinquance ont stagné en 2012, sur l’ensemble du territoire. On peut s’en réjouir, et je tiens d'ailleurs à saluer ici l’ensemble des forces de l’ordre, de la police comme de la gendarmerie, qui accomplissent un travail remarquable.
Cependant, si l’on examine dans le détail les relevés des services de l’État, certains indicateurs semblent beaucoup plus préoccupants. Ainsi, pour l’année 2012, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont progressé de 18, 24 % en zone gendarmerie, contre 2, 5 % en zone police. Les violences à dépositaire de l’autorité publique ont quant à elles connu une hausse de 5, 41 %, alors que, en zone police, leur nombre restait stable. Si l’on descend encore plus dans le détail, les statistiques nous révèlent une hausse des cambriolages dans les communes proches de l’autoroute A7.
Ces chiffres bruts nous enjoignent de nous interroger sur la réalité des faits. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser si ces hausses révèlent un phénomène de fond, l’apparition d’une nouvelle forme de délinquance, ou si, au contraire, ces augmentations proviennent de la mise en place d’un nouvel outil statistique de récolement des faits de délinquance en France ?
Vous le savez, je partage l’analyse de Manuel Valls sur la nécessaire modernisation de l’organisation territoriale des services de sécurité. De la même façon, nous pouvons nous accorder sur le bien-fondé des renforts apportés aux territoires les plus touchés par la création des zones prioritaires de sécurité.
Toutefois, cette réorganisation ne peut se faire au détriment des zones rurales. Nous ne devons pas sous-estimer l’intelligence des délinquants, qui savent qu’il vaut mieux commettre un méfait dans un endroit paisible que sous une caméra de vidéosurveillance.
Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l’interprétation qu’il convient de faire des chiffres de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ? Dans l’hypothèse où ils traduiraient l’apparition d’un nouveau phénomène, pouvez-vous nous préciser les mesures qui seront mises en place pour endiguer celui-ci ?
Je le répète, les petites communes de notre territoire sont inquiètes !
Monsieur le sénateur, votre question fait écho à celle à laquelle je viens de répondre, s'agissant de nos zones rurales.
Je vous prie d’excuser l’absence du ministre de l’intérieur, auditionné en ce moment même par la mission d’information de l’Assemblée nationale relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences. M. Manuel Valls m’a chargée de vous communiquer sa réponse, qui, je l’espère, vous rassurera.
À titre liminaire, je reviendrai sur les chiffres nationaux de la délinquance, pour insister sur le travail approfondi mené en commun par le ministère de l’intérieur et l’Office national de la délinquance et des réponses pénales. Cette collaboration a permis d’aboutir, en 2013, à la rénovation des indicateurs, désormais plus pertinents et de nature à permettre un réel suivi de l’efficacité des services. Il était grandement nécessaire de réviser ces instruments, qui ne traduisaient pas la réalité vécue sur les territoires.
S’agissant en particulier de votre département de la Drôme, sur lequel vous avez interrogé le ministre de l’intérieur, la comparaison des années 2011 et 2012 fait apparaître une hausse des atteintes aux biens limitée à 0, 8 %, représentant soixante-douze faits supplémentaires, dont six cambriolages. J’entends bien que le nombre de faits ne paraît pas important. Néanmoins, il représente une véritable augmentation.
L’action conduite localement par la gendarmerie pour lutter contre la délinquance repose sur une étude préalable de la géographie et de la typologie des faits constatés. Répressifs et préventifs, les dispositifs retenus visent à dissuader les malfaiteurs d’agir en toute impunité dans les zones concernées. En particulier, des opérations de contrôle des territoires et des axes de communication sont régulièrement menées. À ce sujet, vous avez justement évoqué les accès par l’autoroute.
En partenariat avec de nombreux autres acteurs, au premier rang desquels se trouvent les maires, des actions de prévention ont été développées. Il s’agit des opérations « tranquillité vacances », « tranquillité seniors » et du dispositif « participation citoyenne », très important dans certaines communes drômoises. Avec l’appui des spécialistes « référents sûreté » de la gendarmerie, les élus peuvent explorer de nouvelles modalités de sécurisation de leurs territoires, avec la prévention technique de la malveillance ou la mise en place de systèmes de vidéosurveillance.
Des directives ont également été diffusées aux enquêteurs pour mieux orienter leurs actes d’investigation : systématisation des opérations de police technique et scientifique, enquêtes de voisinage, renforcement de la surveillance des sites de revente d’occasion, réalisation de cartographies partagées… Autant de modes d’action qui ont dynamisé la lutte contre les cambriolages, en contribuant à la résolution d’affaires de façon significative. Les cellules anti-cambriolages ont complété le dispositif de lutte contre ce délit, en permettant des échanges plus fréquents et plus nourris entre les enquêteurs de la gendarmerie et de la police.
Sur la période 2011-2012, cette adaptation des modes opératoires dans la Drôme a également porté ses fruits sur d’autres phénomènes délictuels. Elle s’est traduite par une augmentation de 1, 4 % des infractions relevées par l’action des services et par la progression de 31, 9 % du taux de résolution en matière d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, soit tout de même 268 auteurs supplémentaires interpellés.
Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait observer que la population augmente plus rapidement dans la Drôme que dans les autres départements de la région Rhône-Alpes. Cette hausse est constatée sur l’ensemble des cantons et concerne 84 % des communes, pour l’essentiel celles qui se trouvent dans les espaces ruraux, ce qui n’est pas sans conséquence sur le nombre de faits constatés dans les zones placées sous la responsabilité de la gendarmerie. On le voit, l’évolution des statistiques résulte d’une accumulation de phénomènes.
Soucieuse d’adapter son dispositif territorial aux évolutions de la délinquance, et malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint, la gendarmerie nationale conduit dans la Drôme une réflexion sur différentes opérations de réorganisation qui permettraient de mieux appréhender les particularités de la délinquance locale.
Monsieur le sénateur, telle est la réponse que le ministre de l’intérieur m’a chargée d’apporter à la question que vous avez posée, qui, il est vrai, mérite une attention particulière.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse très intéressante, que vous m’avez apportée au nom du ministre de l’intérieur.
Toutefois, je veux insister sur un phénomène qui se développe aujourd'hui : celui de la délinquance en zone rurale, qui, évidemment, est sans commune mesure avec ce qui peut exister dans la vallée du Rhône ou en ville, mais dont il faut se préoccuper avant que les choses ne dégénèrent.
Aujourd'hui, la prévention, la collaboration avec les villes ou encore la présence de caméras de vidéosurveillance font qu’il est plus compliqué de commettre des méfaits en zone urbaine, ce qui incite les délinquants à aller un peu plus loin, en zone rurale, là où c’est plus facile.
Je soutiens évidemment la politique du Gouvernement. Le ministre de l’intérieur conduit une authentique politique de sécurité, au service des citoyens. Je voulais simplement attirer l’attention sur l’avenir des zones rurales, qui paraissent aujourd'hui un peu plus protégées que les autres, même si ce n’est pas toujours vrai, afin qu’elles ne soient pas, demain, handicapées par des transferts d’effectifs.
Je ferai partie de ceux qui, dans le département, accompagneront l’évolution de l’organisation des services de sécurité, parce qu’ils sont indispensables. Toutefois, prenons garde à ne pas nous tromper de prisme, au risque, demain, de ne pas avoir vu la délinquance se déplacer.
Enfin, je veux saluer de nouveau les forces de l’ordre – police et gendarmerie – qui, partout en France et en particulier dans la Drôme, accomplissent un travail remarquable.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, auteur de la question n° 323, transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Antoine Vitez a dit : « Une mise en scène n'est jamais neutre. Toujours, il s'agit d'un choix ».
En ces temps difficiles, notre choix doit être celui de la solidarité, pour développer les activités sociales et de santé et continuer la lutte contre les inégalités. Ce sujet peut paraître secondaire alors que des millions de nos concitoyens n'ont plus d'emploi. Pourtant, la solidarité est plus que jamais nécessaire, car nombreux sont ceux qui diffèrent la souscription d’une mutuelle de santé ou leur départ en vacances.
Face au recul constant de l'accès aux soins médicaux et à la baisse continue du pouvoir d'achat des ménages, tout le monde a besoin de cette garantie complémentaire pour l’accès à la santé, mais aussi au repos personnel et au dépaysement.
Composante des garanties collectives, qu'elles soient statutaires ou conventionnelles, les activités sociales et la santé des salariés des industries électriques et gazières constituent un élément indiscutable de progrès social et économique, en termes d'accès aux vacances, à la culture et à la santé. J’en veux pour preuve que 400 000 personnes partent chaque année dans un des centres de vacances qui leur sont ainsi proposés, ou que 339 000 contrats d'assurance complémentaires soient souscrits.
Toutefois, le secteur de l'énergie subit l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz à la concurrence, avec, en particulier, des dizaines d'entreprises qui ne participeraient pas au fonds du 1 % prélevé sur les recettes des ventes d'électricité et de gaz.
Selon un rapport de la Cour des Comptes, le manque à gagner serait de l'ordre de 180 millions d'euros en cinq ans pour les bénéficiaires de ce fonds que sont les CMCAS, les caisses de mutuelle complémentaires et d'action sociale, et la CCAS, la caisse centrale d’activités sociales.
Pourtant, le prélèvement de 1 % actuel est un droit lié à la création de richesse par le travail des salariés. Il constitue un élément du salaire social différé, au même titre que les autres prestations sociales. Le fonds ainsi constitué est une propriété collective des salariés, dont tous doivent pouvoir bénéficier sur une base solidaire.
Malgré cela, les associations patronales n'ont de cesse de remettre en cause le financement des œuvres sociales et de santé dans les entreprises, en proposant, par exemple, une assiette de financement basée sur la masse salariale plutôt que sur la création de richesses, comme c’est actuellement le cas dans la branche professionnelle.
Or ce changement de financement porterait un coup fatal à la pérennité des activités sociales et, au-delà, aux acquis sociaux des salariés concernés.
La précédente majorité présidentielle avait apporté des garanties en ce sens aux organisations patronales et s'était engagée « à éclaircir et réguler le financement des activités sociales et de santé des entreprises ». Ces propos ne sauraient être encore d'actualité.
Madame la ministre, en la matière, quels choix de mise en scène allez-vous effectuer en concertation avec les représentants syndicaux des salariés ? Celui de la destruction des acquis ou celui du maintien, de la sécurisation et du développement de l'accès des pensionnés et de leurs familles aux activités sociales et aux prestations de santé ?
Monsieur le sénateur, Delphine Batho, qui n’a pu se rendre disponible, m’a chargée d’apporter des éléments de réponse à votre question, qui s’inscrit dans la problématique de la solidarité, et d’essayer de vous dire ce que seront les choix du Gouvernement, qui seront des choix politiques et non pas simplement de mise en scène.
Vous le savez, la Caisse centrale d'activité sociale est le fruit de l'histoire. Elle trouve son origine dans le statut des personnels des industries électriques et gazières issu de la loi de 1946. Elle gère les œuvres sociales des agents et des retraités du secteur, soit plus de 600 000 ayants droit. Il s’agit donc non pas d’un comité d'entreprise de droit commun, mais d’un comité de branche, dont la dimension doit être prise en compte.
Cette caisse est financée par un prélèvement de 1 % sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Cette assiette de financement, vous l’avez relevé, est devenue fragile depuis la fin du monopole de l'opérateur historique. En effet, l'introduction de la concurrence dans le secteur de l'énergie a entraîné la séparation des activités de production, de distribution et de fourniture, ainsi que l'arrivée de nouveaux opérateurs alternatifs.
Ces évolutions rendent le calcul de plus en plus difficile : certains opérateurs sont soumis au prélèvement alors qu'ils n'ont pas d'agents sous statut, tandis que d'autres ne le sont pas alors qu'ils ont des agents sous statut. Le constat de l'essoufflement de cette assiette est donc partagé.
En 2010, à la suite de plusieurs rapports de la Cour des comptes, dont la presse s'était fait l'écho, le ministre alors en charge de l'énergie, M. Jean-Louis Borloo, a demandé aux employeurs d'engager une réforme pour faire évoluer la façon dont était géré le prélèvement de 1 % sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur.
Il avait fixé trois axes à cette réforme. Le premier était le mode de calcul du prélèvement – en d'autres termes, son assiette. Le deuxième axe avait trait à la gouvernance des œuvres sociales qui sont alimentées par ce prélèvement. Le dernier axe concernait les modalités de contrôle et la transparence du système.
En avril 2012, le ministre alors en charge de l'énergie, M. Besson, avait demandé aux employeurs chargés de mener la concertation, conformément à leur rôle, de lui en remettre un bilan assorti d'un relevé de positions final au mois de décembre 2012.
Comme vous l’imaginez, l'actuel gouvernement a considéré que, sur un sujet aussi important pour les agents, une concertation réduite à six mois – un délai que vous avez dénoncé –, qui touche au statut des industries électriques et gazières, n'était pas suffisante. Il a donc fait savoir qu'il n'accepterait pas que des conclusions clôturant la concertation lui soient remises par les employeurs dès le mois de décembre 2012.
Il faut du temps pour s’approprier un sujet difficile sur lequel nous avons bien l'intention d'avancer, mais seulement conformément à la méthode générale fixée par le Premier ministre, c'est-à-dire en respectant le rôle de chacun – celui des employeurs et des organisations syndicales, d'un côté, et celui des pouvoirs publics, de l'autre, et en donnant à la concertation le temps et le cadrage dont elle a besoin pour se dérouler dans de bonnes conditions.
Delphine Batho a fait savoir que, au cours de ces discussions, chacun devrait assumer ses responsabilités dans l'intérêt général. Les organisations syndicales et les employeurs seront tous reçus. Ce n’est qu’à l'issue de ces discussions, qui prendront le temps nécessaire, dans un cadrage redéfini, que des conclusions pourront être apportées, avec pour objectif la pérennisation des œuvres sociales de la branche des industries électriques et gazières.

Madame la ministre, j’ai bien compris que la concertation se développerait et que vous prendriez votre temps. L’essentiel est que nous allions dans la bonne direction et que le progrès social, ainsi que la justice sociale, inspirent la décision finale.
J’ai reçu des délégations syndicales sur le sujet. Elles ne demandent pas une réponse pour demain matin ! Ce qui est important pour elles, ce qui leur tient à cœur, c’est la pérennisation des œuvres sociales qui ont été mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946.
Il faut donc être très vigilant sur la position adoptée, et ces délégations espèrent que celle du Gouvernement sera différente de celle de la précédente majorité.

La parole est à Mme Laurence Rossignol, auteur de la question n° 293, adressée à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Madame la ministre, en France, le marché des salles de remise en forme est en constant développement. L'activité dégage plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et, aujourd'hui, entre 12 et 13 millions de Français pratiquent fitness, musculation ou gymnastique d'entretien.
L'offre de biens et de services sportifs s'est fortement accrue ces dernières années et l'appellation de « salle de remise en forme » recouvre des activités diversifiées, proposées par des organismes très différents.
Un peu partout en France apparaissent des salles de sport low cost. Leur point fort est, en toute logique, de proposer un tarif d'abonnement deux à trois fois moins élevé que celui des clubs classiques et des associations.
Pour parvenir à proposer de tels tarifs, des économies sont réalisées sur les services proposés. Ainsi, le personnel encadrant est réduit au minimum, quand il n’est pas inexistant. Ces entreprises commerciales mettent à la disposition de leurs clients des équipements sans que leurs activités soient surveillées ou encadrées. Les cours se font avec des coachs virtuels ; des écrans géants diffusent des vidéos de cours, si bien que les clients ne sont aucunement encadrés par de véritables coachs.
Les structures associatives et affiliées à une fédération doivent aujourd’hui affronter une offre concurrentielle avec l’apparition de ces salles low cost, qui ne sont pas soumises à la même réglementation en matière d’encadrement des pratiques.
Les conséquences sont lourdes pour les clubs associatifs, qui subissent ainsi une concurrence peu loyale et même faussée. Au fur et à mesure que s'ouvrent des salles low cost, les clubs environnants perdent des adhérents et connaissent des difficultés financières grandissantes, comme j’ai pu le constater dans plusieurs villes de mon département. Rappelons ici que la masse salariale d'une salle de remise en forme peut constituer jusqu'à 50 % de ses charges.
L'encadrement des activités physiques et sportives est réglementé afin de garantir la sécurité de ceux qui les pratiquent. Ainsi, pour tout acte d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou de présence considérée comme un encadrement des utilisateurs, la personne dispensant cette prestation doit justifier de diplômes spécifiques.
Or les salles de remise en forme low cost ne mettent pas en place d'encadrement sportif spécifique. Certes, le sport doit être à la portée de tous. Néanmoins, il faut également que sa pratique s’effectue dans des conditions optimales de confort et de sécurité.
En conséquence, je souhaiterais connaître, madame la ministre, votre position sur le sujet et savoir si vous envisagez de rendre obligatoire la présence de personnel d'encadrement diplômé dans les salles de remise en forme low cost, de telle sorte qu’il soit mis fin à cette concurrence déloyale à l’égard des clubs de sport.
Madame la sénatrice, je vous prie d’excuser Mme Fourneyron, ministre des sports, qui se trouve à Annecy pour l'ouverture des Jeux mondiaux militaires. Je vais m’efforcer de vous transmettre les termes de sa réponse qui, je le crois, répondront à vos attentes.
L'évolution des salles de remise en forme vers la mise à disposition de matériel sans encadrement est une tendance récente, qui soulève effectivement les problèmes que vous avez indiqués.
Vous l’avez rappelé, la France a fait le choix de réglementer l'encadrement des activités physiques. Pour garantir la sécurité des usagers, tout professionnel de l'encadrement de ces activités doit être titulaire d'une qualification reconnue par le ministère chargé des sports.
Le développement de la pratique d'activités physiques dans les salles de remise en forme, que le Gouvernement salue, conduit des entreprises à ouvrir ces nouvelles salles, économiquement plus accessibles mais dépourvues d'encadrement.
Dans ce cadre, le client sait dans quel type de salle il se trouve et la réglementation de l'encadrement ne s'applique pas, puisqu'il n'y a pas d'encadrement à proprement parler.
Ces salles doivent toutefois répondre à des exigences réglementaires en termes d'hygiène et de sécurité, ainsi qu’à certaines dispositions du code de la consommation, en particulier l’article L. 221-1 relatif à l'exigence de sécurité qui incombe à tout professionnel proposant un produit ou un service.
Par ailleurs, un travail a été effectué pour améliorer la qualité des installations et une norme AFNOR concernant les salles de remise en forme à usage public a été définie en 2011 pour traiter des exigences de conception et de fonctionnement de ces salles.
Bien qu’elle repose sur le volontariat, cette norme constitue une référence pour le juge en cas de litige concernant l'obligation générale de sécurité, si bien qu’elle devrait donc s’imposer dans les salles.
Il faut aussi s'interroger sur l'application de l'obligation de surveillance permanente des établissements recevant du public de cinquième catégorie pour les salles de remise en forme. La question sera traitée.
Une autre question, juridiquement délicate, concerne la nature de l’encadrement virtuel, souvent des conseils d'utilisation transmis par écran ou conseils interactifs, via un logiciel. Cet encadrement relève-t-il de l'obligation de qualification comme tout encadrement effectué en présence physique de l’encadrant ?
Ces questions juridiques trouveront des réponses dans le cadre de la modification du code du sport, qui est programmée pour la fin de l'année 2013. Ce sera l’un des objectifs de ce travail législatif, auquel vous participerez, madame la sénatrice, que d'apporter des réponses aux questions d'actualité que pose le sport, pour préserver l'équilibre entre les différents acteurs de la pratique sportive – fédérations, entreprises, ligues professionnelles –, dans le respect de l'unicité du sport et de l'intégrité physique et morale de ses adeptes.

Madame la ministre, je vous remercie de ces éléments de réponse que vous a transmis le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et je suis satisfaite que celui-ci se pose des questions.
Vous avez fort bien décrit la situation actuelle, qui aboutit cependant à la fragilisation du mouvement sportif et associatif. Tout ne peut être mis sur le même plan, tout ne se vaut pas ! Les collectivités territoriales soutiennent des clubs sportifs associatifs, qui jouent un rôle utile non seulement dans l’accès à la pratique sportive, mais également dans le développement du lien social, la prise en charge des enfants et l’encadrement, ce que ne font pas les salles de sport low cost.
J’ai bien compris que nous discuterions de ces sujets dans le cadre d’une future loi sur le sport. En effet, nous ne pouvons pas à la fois soutenir le mouvement sportif et associatif et, dans le même temps, fragiliser celui-ci par le développement d’activités low cost qui, quel que soit le domaine abordé, ont toujours le même effet de déstructuration du tissu social et de perte de qualité de la prestation offerte.
J’espère donc que nous pourrons, par ce projet de loi, renforcer le rôle des associations sportives, mais également celui des clubs de sport professionnels, qui exigent, pour eux-mêmes et pour leurs pratiquants, une haute qualité sportive, ainsi qu’un haut niveau de sécurité.

La parole est à Mme Colette Mélot, auteur de la question n° 341, transmise à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le défaut de jalonnement directionnel vers la commune de Melun, ville-préfecture du département de la Seine-et-Marne, premier département d’Île-de-France en superficie.
En effet, au fil des années, on ne peut que déplorer la disparition progressive de jalonnement de la commune de Melun sur les routes nationales et les axes autoroutiers, et ce au bénéfice d’autres agglomérations, notamment de Sénart, seule indiquée à la sortie de l’autoroute A4 en direction de la Francilienne en provenance de Paris ou bien après la sortie de l’autoroute A6 en direction de l’autoroute A5.
Il est à noter que la ville préfecture de Seine-et-Marne n’est jalonnée que dans un périmètre de vingt kilomètres autour de Melun. Cette situation handicape Melun et son agglomération, qui, je le rappelle, est la première de Seine-et-Marne et la sixième d’Île-de-France par sa population – plus de 110 000 habitants.
Il est donc regrettable et fort dommageable que ce territoire, qui est un important pôle d’activité économique, universitaire, touristique et le siège de l’École des officiers de la gendarmerie nationale, ne soit pas signalé, voire mieux signalé bien au-delà du périmètre actuel.
Aussi, j’aimerais que vous puissiez m’éclairer, madame la ministre, sur les mesures qu’envisage de prendre le Gouvernement pour pallier cette situation, qui pourraient être simples, peu coûteuses et qui permettraient de mettre un terme à cette discrimination dont est victime la préfecture du département de Seine-et-Marne et toute son agglomération.
Madame la sénatrice, veuillez excuser l’absence de Frédéric Cuvillier, ministre des transports, de la mer et de la pêche, qui assiste en cette fin de matinée à Orly – j’aurais d'ailleurs pu être à ses côtés ! – au lancement de la nouvelle compagnie aérienne, « HOP ! ».
En matière de signalisation routière sur le réseau national, il s’agit de concilier deux principes : d’une part, l’équité de traitement de toutes les localités éligibles à un jalonnement vert – c’est le cas du secteur que vous évoquez ; d’autre part, la limitation du nombre de mentions possibles pour préserver la lisibilité par l’usager en tenant compte de ses possibilités de lecture dans un véhicule en déplacement, en termes de sécurité.
Ces deux principes régissent le schéma directeur actuel appliqué sur l’ensemble du territoire par les services de l’État, ainsi que les règles de signalisation en découlant.
Ainsi, pour ce qui concerne votre territoire, les éléments suivants m’ont été communiqués. Dans le schéma directeur national de signalisation d’Île-de-France, la mention était jusqu’à 1997 « Melun-Sénart » et concernait les deux agglomérations, ville nouvelle et préfecture. Au changement de nom en 1997, la mention « Melun-Sénart » est devenue « Sénart ». Depuis lors, et à l’occasion des travaux de modernisation du réseau, l’État met en conformité les panneaux de signalisation directionnelle avec le schéma directeur national de signalisation d’Île-de-France approuvé en décembre 2002, qui actait ce changement de dénomination de la ville nouvelle.
Aujourd’hui, les villes de Melun et de Sénart sont classées au même niveau d’importance pour leur jalonnement, compte tenu du statut de chef-lieu de département de Melun. Ainsi, par l’autoroute A4 en venant de Paris, puis par la Francilienne jusqu’à l’autoroute A5b, c’est Sénart rencontrée la première qui est signalée. En revanche, en venant des autoroutes A5 et A6, c’est Melun, rencontrée la première, qui est indiquée.
Les principes d’équité de traitement des localités et de limitation du nombre de mentions possibles pour plus de lisibilité, madame la sénatrice, paraissent, au cas particulier, parfaitement respectés.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir rappelé les règles concernant le jalonnement directionnel sur le plan national. Vous avez rappelé l’histoire des agglomérations de mon département ; je sais bien que la mention « Melun-Sénart », qui prévalait jusqu’en 1997, a disparu, laissant place à deux agglomérations distinctes.
Je comprends que l’on indique la première des agglomérations à la sortie de l’autoroute, mais il me semble tout de même fort dommage de ne pas mieux indiquer Melun – ou Sénart, d’ailleurs, sur d’autres voies –, afin d’éviter la confusion liée à la proximité des deux agglomérations.
Sur l’autoroute A4, par exemple – c’est un itinéraire que je connais bien –, Melun et Sénart sont annoncées, puis simplement Sénart sur la Francilienne. Cette signalisation est conforme aux règles, certes, mais les personnes qui ne connaissent pas la région peuvent penser qu’elles se ne trouvent plus sur la route menant à Melun. Des efforts pourraient donc être engagés sur ce point, d’autant plus que l’agglomération d’Évry, située dans le département voisin de l’Essonne, est indiquée, me semble-t-il.
Madame la ministre, je voulais vous faire part de cette situation, qui inquiète les habitants, mais surtout les entreprises et tous ceux qui font vivre l’agglomération melunaise. Je remercie le Gouvernement de s’être penché sur cette question et j’espère qu’une amélioration pourra être apportée.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.