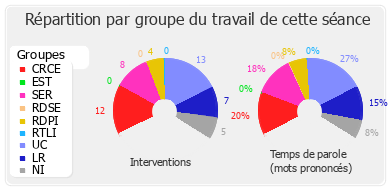Séance en hémicycle du 23 juillet 2013 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Charles Guené.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (proposition n° 755, texte de la commission n° 781, rapport n° 780).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la proposition de loi.

auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour parler de la si belle ville de Paris, dont tous les Français sont fiers à juste titre, et plus particulièrement de ses élections municipales.
Il n’aura échappé à personne que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mai 2013, a considéré que le tableau répartissant le nombre de conseillers de Paris par arrondissement, qui avait été inclus dans la loi du 17 mai 2013 que vous aviez défendue devant notre assemblée, monsieur le ministre, était contraire à la Constitution. Quelles en sont les raisons ?
Aux termes de la loi du 31 décembre 1982, chaque arrondissement dispose d’au moins trois conseillers de Paris. Le projet de loi que vous nous aviez présenté, qui est devenu la loi, répartissait de manière proportionnelle les autres sièges de conseiller. Or le Conseil constitutionnel a considéré que le résultat aboutissait à des écarts considérables eu égard à la nécessité de représenter justement la population. Dès lors, il n’y a pas d’autre solution – c’est le sens de la proposition de loi que j’ai l’honneur de présenter – que de prendre en compte tout simplement le rapport à la population de manière à éviter toute répartition qui soit « manifestement disproportionnée », pour reprendre l’expression employée par le Conseil constitutionnel.
Le principe de l’égalité devant le suffrage est désormais déterminant – il l’est même depuis plusieurs années – pour le Conseil constitutionnel. Nous avons donc fait en sorte qu’il y ait une nouvelle répartition, mais il n’était alors plus possible de conserver trois conseillers de Paris par arrondissement.
Nous avons toutefois pris en compte le fait qu’il pouvait y avoir certains écarts. Ainsi, pour le IIe arrondissement, un écart de moins 16 % par rapport à la moyenne a abouti au fait qu’il y ait deux sièges ; pour le IIIe arrondissement, un écart de moins 14 % a abouti à l’attribution de trois sièges ; en revanche, pour le Ier arrondissement, il n’y aura qu’un siège, car allouer deux sièges aggraverait l’écart de représentativité qui passerait de plus 25 % à plus de 37 % : il y aurait donc une disproportion.
Je précise que la proposition de loi a pour effet de supprimer les dispositions prévoyant d’élire le maire d’arrondissement et au moins un des adjoints au maire d’arrondissement parmi les membres du conseil de Paris. En effet, pour les raisons que je viens d’expliquer, il était strictement impossible de mettre en œuvre ces dispositions dans le Ier arrondissement, lesquelles contraignaient très fortement le choix pour ces désignations dans le IVe et l’un des deux autres arrondissements dont j’ai parlé. Par conséquent, il est proposé que le maire d’arrondissement ainsi que l’adjoint ou les adjoints soient choisis parmi les membres du conseil d’arrondissement, chaque membre du conseil d’arrondissement pouvant être maire ou adjoint au titre de l’arrondissement.
Tel est l’objet de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter.
Diverses considérations ne vous ont sans doute pas échappé, mes chers collègues, notamment le fait, plusieurs fois évoqué par Mme Catherine Troendle et par M. Jean-Jacques Hyest, qu’il était étrange que je présente une telle proposition de loi alors qu’un autre texte traitant du même sujet avait été déposé par mon ami Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Une erreur de procédure s’est en effet produite, sur laquelle nous nous sommes expliqués, monsieur Charon : il y a eu omission de l’engagement de la procédure accélérée. Je préfère le préciser dès le début du débat, …

… car, comme je l’ai dit récemment à M. Hyest, que celui qui n’a jamais péché nous jette la première pierre, monsieur Valls !

Il y a donc eu là un très léger accident de parcours que nous avons réparé puisque je me suis immédiatement porté au secours de M. Manuel Valls…

allusion que ceux qui ont des oreilles entendront.
Voilà pour le premier point.
J’ajoute, monsieur Charon – ce sera le deuxième point sur lequel je souhaite insister –, qu’on pourrait tirer de cette affaire une autre observation, à savoir qu’avant de saisir le Conseil constitutionnel il est parfois utile de prendre quelques réflexions, de tourner sa langue un certain nombre de fois dans sa bouche, puisque ceux qui ont fait ce recours ne s’attendaient sans doute pas à un tel résultat, du moins si j’en crois les déclarations de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. C’est une leçon à tirer de cette petite affaire.
Il est une dernière considération sur laquelle je veux finir.
Le Conseil constitutionnel, de manière constante, considère que, par rapport aux règles électorales, le premier impératif, c’est l’égalité des suffrages, donc l’égalité entre les citoyens telle qu’elle est inscrite dans la Constitution de la République française. J’insiste sur ce point, parce que c’est exactement ce qui justifie la décision du Conseil constitutionnel et donc la présente proposition de loi.
Reste que cet argument est général. Lorsque, dans certaines publications, il nous est expliqué que le nouveau mode électoral qui a été prévu pour les départements porte atteinte à la ruralité, cela n’a aucun sens. En réalité, quel qu’ait été le gouvernement, de gauche, de droite ou du centre, …

… il aurait été, monsieur Mercier, placé devant le même impératif, à savoir que, pour tout découpage ou redécoupage, qu’il s’agisse des législatives, des régionales, des cantonales ou, comme ici, d’arrondissements, ce qui s’impose absolument, c’est l’égalité des suffrages et la prise en compte de ce principe. Cela s’impose à nous tous et, de ce fait, cette simple considération devrait permettre d’éviter un certain nombre de faux procès.
Il est important de prendre en compte les territoires, et nous y sommes tous très attachés. Nous sommes attachés à Paris comme à l’ensemble de nos secteurs ruraux. Nous voulons qu’ils soient pris en considération, particulièrement au Sénat. Cependant, la règle qui s’impose à nous est de prendre d’abord en compte la population, avec certes des nuances, des possibilités d’adaptation, en respectant l’écart de plus ou moins 20 %. Cela justifie les propositions qui vous sont faites pour les trois arrondissements de Paris considérés, en particulier le Ier arrondissement.
Voilà, mes chers collègues, le sens de cette proposition de loi, qui devrait à mon sens susciter un large accord : elle est en effet la traduction exacte et sincère de la position du Conseil constitutionnel, qui est la plus haute autorité de la République et dont les décisions s’imposent à tous et à toutes les autorités de l’État, passées, présentes et futures.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste . – M. Michel Mercier applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a rappelé Jean-Pierre Sueur, le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Cette décision s’applique à tous !
Cet article 30 procédait à une nouvelle répartition des sièges de conseiller de Paris, répartition qui n’avait jamais été modifiée depuis 1982. La réforme visait donc à tenir compte des évolutions démographiques. Par un curieux paradoxe, elle a été sanctionnée. C’était pourtant la première fois qu’un ministre de l’intérieur proposait de corriger les injustices suscitées par l’évolution de la population parisienne. Je rappelle d'ailleurs que j’avais, à deux reprises au Sénat, soulevé cette question devant les prédécesseurs de Manuel Valls, qui avaient botté en touche.
La répartition des 163 sièges de conseiller de Paris reposait jusqu’à présent sur le principe de l’attribution minimale de trois sièges à chaque secteur afin de permettre la pleine application du mode de scrutin municipal proportionnel assorti d’une prime majoritaire. Pour tenir compte de la population, les 103 sièges restants étaient ensuite répartis selon la règle de la plus forte moyenne.
Entre 1982 et 2012, la population de la capitale a augmenté de 57 862 habitants, inégalement répartis entre les arrondissements. Je rappelle que le mode de calcul utilisé pour la mise en application du tableau découlant de la loi du 31 décembre 1982 reposait sur le recensement de 1979.
Pour respecter l’exigence constitutionnelle du principe de l’égalité du suffrage, le Gouvernement a proposé d’actualiser le tableau, à effectif constant naturellement, selon la méthode de 1982. Les correctifs découlaient, d’une part, des évolutions démographiques contrastées des différents arrondissements et, d’autre part, de la règle des trois sièges au minimum, que personne ne contestait. Pour le reste, la méthode suivie a visé à réduire les écarts à la moyenne.
Les trois arrondissements qui ont connu l’évolution la plus marquée – le Xe, le XIXe et le XXe – avaient bénéficié chacun d’un siège supplémentaire. En revanche, les arrondissements qui avaient vu leur population décroître significativement – le VIIe, le XVIe et le XVIIe – en avaient perdu un.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution non seulement le tableau réformé, mais aussi le tableau en vigueur. Il a jugé que, dans les Ier, IIe et IVe arrondissements, le maintien des trois sièges minimum aboutissait à s'éloigner par trop du quotient électoral moyen.
Si le Conseil constitutionnel convient du bien-fondé d’« une représentation minimale de chaque secteur au conseil de Paris », il estime que « le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population » de chacun de ces arrondissements « s’écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».
Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise les tempéraments admissibles : « s’il ne s’ensuit pas » du respect de l’égalité devant le suffrage « que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population […] ni qu’il ne puisse être tenu compte d’autres impératifs d’intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».
Le Conseil constitutionnel a ensuite appliqué sa jurisprudence dite « néo-calédonienne », qui lui permet de vérifier la régularité « au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée […] à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». C'est ainsi qu’il a censuré le tableau actuel de répartition des sièges de conseiller de Paris.
Dès lors, nous nous trouvions face à une situation surprenante puisqu'il n’y avait plus de règles pour répartir les sièges au conseil de Paris pour les élections municipales de 2014.
La proposition de loi déposée par Jean-Pierre Sueur, que nous examinons ce soir, tend donc à réorganiser la répartition des sièges de conseiller de Paris. Cette répartition, basée sur la population arrêtée au 1er janvier 2013, vise à respecter le principe de l’égalité du suffrage sans bouleverser, juste avant le renouvellement de mars prochain, le régime électoral de la capitale. Elle s’inscrit dans le découpage de la capitale en vingt secteurs correspondant chacun à un arrondissement. À effectif global constant, l’attribution d’un minimum de trois sièges à chaque arrondissement a été abandonnée.
Si la répartition des sièges s’effectue toujours à la proportionnelle à la plus forte moyenne, l'apport de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur réside dans son application à l’ensemble des 163 sièges.
Une première étape a consisté à attribuer à chaque secteur le nombre de sièges correspondant à sa population sur la base du quotient électoral. Huit sièges restaient alors à répartir à la plus forte moyenne, mais il est apparu nécessaire de corriger les excès découlant de cette méthode pour tempérer les écarts de représentation qui en résultaient : les IIe et IIIe arrondissements présentaient en effet un écart de plus 67, 4 % et de plus 29, 4 %. Le correctif a consisté à attribuer à chacun de ces deux secteurs un siège supplémentaire afin de ramener cet écart à respectivement moins 16, 4 % et à moins 13, 7 %, par le transfert du siège supplémentaire bénéficiant aux XIIe et XXe arrondissements par application de la règle de la plus forte moyenne, sans aggraver les écarts pour ces deux arrondissements.
La nouvelle répartition entraîne la création de dix nouveaux sièges de conseiller d’arrondissement, dont l’effectif est le double du nombre de conseillers de Paris élus dans la circonscription, sans qu’il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante. Ces nouveaux sièges résultent mécaniquement de l’augmentation du nombre de conseillers de Paris dans les Xe, XVe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements – minorée par la diminution de treize à douze du nombre de conseillers du XVIIe arrondissement.
La réforme du tableau a un impact sur la désignation des exécutifs d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. En effet, actuellement, le maire d’arrondissement ainsi que l’un au moins de ses adjoints doivent être choisis parmi les membres du conseil municipal. Cette double règle devient inapplicable dans le Ier arrondissement, qui ne sera désormais représenté au conseil de Paris que par un siège. Elle devient aussi difficilement applicable dans les IIe et IVe arrondissements, qui ne sont plus représentés que par deux conseillers de Paris. C’est pourquoi l’article 2 de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur propose de la supprimer : dorénavant, le maire et l’ensemble des adjoints d’arrondissement pourront être choisis parmi les conseillers d’arrondissement.
Mes chers collègues, si vous adoptez la proposition de loi et que l’Assemblée nationale en fait de même, cette modification s'appliquera aussi à Lyon et à Marseille.
Les modifications soumises au Sénat découlent nécessairement, dans le calendrier très contraint du législateur, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel. À huit mois du scrutin municipal, il était inenvisageable de refondre le régime électoral parisien, fût-ce par un redécoupage de la carte des secteurs.
Le dispositif proposé permettra également de conserver le parallélisme entre les régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille, cela naturellement sans augmenter le nombre des conseillers de Paris – ce qui ne semblait pas très opportun. Dans ce contexte, les dispositions proposées résultent mécaniquement de l’application des règles constitutionnelles.
Si l’écart de représentation du premier des vingt arrondissements s’établit encore au-delà du fameux écart de 20 %, il y est cependant ramené de moins 42, 6 % dans le tableau censuré à plus 25, 7 % en recourant aux limites possibles de la réforme avec l’attribution d’un seul siège au sein du conseil de Paris. Pour les dix-neuf autres arrondissements, les écarts au quotient moyen oscillent entre moins 16, 43 % et plus 10, 66 %.
La modification des modalités d’élection des maires et adjoints d’arrondissement ne devrait pas affecter le fonctionnement de leurs conseils.
Cette proposition de loi, si elle est adoptée – ce soir au Sénat et dans les prochains jours à l’Assemblée nationale –, ne s'appliquera pas avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars prochain.
La commission des lois, qui a adopté les trois articles de la proposition de loi sans modification, vous propose, à la majorité de ses membres, d'adopter ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois – cher Jean-Pierre Sueur –, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, nous sommes réunis ce soir pour débattre d’un texte très simple, mais qui a connu quelques péripéties.
La décision du Conseil Constitutionnel du 16 mai 2013, qui a validé – je le rappelle au passage – l’essentiel de la loi créant le scrutin binominal majoritaire pour les élections départementales, nous oblige à fixer le nombre et la répartition par arrondissement des 163 sièges de conseiller de Paris.
Pour ce faire et pour aller vite, une proposition de loi du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait été déposée, débattue et adoptée le 10 juillet dernier. Je ne dévoile aucun secret d’État – le président Sueur l'a révélé avec malice – en vous disant que c'est à la suite d'un oubli, d'une erreur, que nous avons été conduits à modifier ce dispositif.
Le décret d’ordre du jour de la session extraordinaire a été modifié, et nous examinons aujourd’hui une nouvelle proposition de loi, strictement identique à la première, déposée cette fois-ci par le président de la commission des lois du Sénat, que je remercie très chaleureusement au nom du Gouvernement, de la République et de l’État.
Sourires.
La procédure accélérée est bien déclarée, et l’Assemblée nationale doit normalement examiner à son tour – et à nouveau – ce texte dans quarante-huit heures.
Revenons maintenant, d'un mot, sur le contenu de ce texte.
Lorsque je vous ai présenté la légère modification qui figurait dans le texte de loi sur les scrutins départementaux, communaux et intercommunaux, le Gouvernement pensait réellement que cette actualisation ne posait pas de problème constitutionnel, précisément parce que nous respections le plancher de trois conseillers par arrondissement figurant dans la loi de 1982, qui, à l’époque, avait été validée par le Conseil Constitutionnel. Cependant, nous le savons, le Conseil constitutionnel de 2013 n’est pas le Conseil constitutionnel de 1982. Il a considérablement densifié sa jurisprudence. Il a en particulier souligné de plus en plus nettement son rôle de gardien de l’égalité du suffrage et donc accru sa vigilance en matière d’égalité de représentation dans toutes les circonscriptions. Il y avait d’ailleurs une leçon à tirer – nous l'avons fait – sur le texte concernant le scrutin cantonal. Cette jurisprudence est désormais une boussole en matière de scrutin.
Dans sa décision du 16 mai dernier, le Conseil Constitutionnel nous a dit que le projet de loi n’allait pas assez loin. Sa censure de l’article consacré à Paris incite donc – et oblige même – à renforcer l’égalité de représentation des Parisiens, arrondissement par arrondissement.
Le Conseil constitutionnel a considéré, dans cette décision, qu’en conservant un nombre minimal de trois conseillers de Paris par arrondissement, le législateur avait maintenu dans les Ier, IIe et IVe arrondissements un rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l’arrondissement qui s’écartait de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qualifiée de « manifestement disproportionnée ».
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a ainsi pour objet d’établir un nouveau tableau qui soit conforme au principe d’égalité, sans augmenter le nombre global de conseillers de Paris et sans modifier la composition des conseils d’arrondissement, fixée au minimum à dix conseillers d’arrondissement par l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement.
Compte tenu de la proximité des élections municipales – M. Madec l’a rappelé –, ce nouveau tableau permettra de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel tout en évitant de bouleverser le régime électoral parisien. Il permettra également de conserver le parallélisme entre les régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille, sans augmenter le nombre de conseillers de Paris.
Le choix a été fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire une répartition des sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle utilisée pour la répartition des conseillers municipaux à Lyon, comme à Marseille.
Pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, le nouveau tableau ne pouvait pas toutefois s’en tenir strictement à la méthode mathématique. En effet, dans les trois premiers arrondissements, l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne permet pas de respecter ce que nous appelons le bornage démographique, notion mise en exergue par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence relative au principe d’égalité devant le suffrage. Ainsi, avec une application mathématique stricte, le Ier arrondissement présente un écart à la moyenne de 26 %, le IIe arrondissement de 67 % et le IIIe arrondissement de 29 %.
Comme vous le savez, il fallait dès lors appliquer un correctif dans ces arrondissements pour se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le respect des écarts manifestes à la moyenne. Un tel correctif à la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avait d’ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel lui-même, dans sa décision de juillet 1987 relative à la répartition des sièges au conseil municipal de Marseille. Le président et le rapporteur de la commission des lois en ont déjà bien expliqué le principe. Je ne ferai donc que reprendre, en grande partie, leur propos.
Un siège supplémentaire est attribué aux IIe et IIIe arrondissements, qui obtiennent respectivement, dès lors, deux et trois sièges. Cette nouvelle attribution permet donc de respecter l'égalité démographique puisque l’écart à la moyenne est ramené à moins 16 % dans le IIe arrondissement et à moins 14 % dans le IIIe arrondissement.
Pour maintenir le nombre actuel de conseillers de Paris, les deux sièges réalloués sont retirés aux derniers arrondissements bénéficiaires dans la répartition à la plus forte moyenne, soit le XIIe et le XXe arrondissements.
En revanche, le nombre de sièges du Ier arrondissement n’est pas modifié, car la réattribution d’un siège – qui serait alors prélevé dans le XVe arrondissement – aggraverait sa représentativité, qui passerait de plus 26 % à moins 37 %.
Au total, à moins d’un an de la prochaine élection des conseillers de Paris, le présent texte permettra ainsi de tenir compte de l’évolution démographique intervenue depuis la loi de 1982 relative à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dans le respect des équilibres démographiques et sans modifier l’organisation administrative de la commune de Paris.
Nous aurions pu faire un choix plus radical, et il y a peut-être, par ailleurs, d'autres idées. Nous aurions pu réunir en un seul et même arrondissement les Ier, IIe, IVe et, éventuellement, IIIe arrondissements. Sans doute, ce choix aurait-il été constitutionnellement sûr, mais il aurait bouleversé le cadre auquel les Parisiens sont désormais habitués et il aurait supprimé trois ou quatre mairies d’arrondissement. À quelques mois des élections municipales, nous ne pouvions faire un tel choix et devions respecter ce qu’est Paris aujourd'hui – on verra bien si, demain, d'autres idées émergent en ce domaine.
Le Gouvernement a fait un choix plus équilibré qui correspondait – cela ne fait pour moi aucun doute – à l'attente des Parisiens : le maintien des arrondissements, conjugué avec l’adaptation démographique. Certes, un arrondissement, le Ier, s’écarte de l’écart à la moyenne – plus ou moins 20 % – auquel est attaché le Conseil constitutionnel. Cependant – c’est un point important –, nous considérons qu’il y a un motif d’intérêt général à assurer la représentation de chaque arrondissement et la lisibilité du scrutin dans un cadre habituel pour les électeurs, dès lors que l’écart à la moyenne n’excède pas 26 % et que l’exception se limite à un seul arrondissement.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, le sens du texte que nous examinons aujourd’hui. Je crois que le bon sens, la stabilité des règles électorales, la juste représentation des électeurs et des arrondissements plaident pour une adoption rapide de cette proposition de loi, dans cet esprit de consensus, j’ose l’espérer, que l’on retrouve si régulièrement au Sénat, notamment lorsque je me trouve parmi vous.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste . – M. Michel Mercier applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme cela vient d’être rappelé, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 mai 2013, censuré la nouvelle répartition des conseillers de Paris prévue par la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Le groupe UMP, associé à l’UDI, avait effectivement saisi le Conseil constitutionnel au motif que la répartition proposée par le Gouvernement ne respectait pas la règle élémentaire de la démocratie représentative : un homme, une voix. Il s’avérait que trois arrondissements dits « de droite » – le VIIe, le XVIe et le XVIIe – étaient pénalisés au profit d’arrondissements dits « de gauche ».
Nous avons été entendus sur ce point, comme l’a expliqué Jean-Pierre Sueur, …
Sourires.

Le Conseil constitutionnel est allé encore plus loin, en déclarant contraire à la Constitution l’actuel tableau de répartition des conseillers de Paris annexé au code électoral. Ce chamboulement, certes imprévu, nous apporte néanmoins un enseignement fondamental sur l’organisation électorale dans la capitale.
Dès lors, il fallait trouver une solution qui permette d’organiser le prochain scrutin dans le respect des institutions et de la démocratie. Plusieurs choix étaient envisageables. Malheureusement, celui qui nous est présenté aujourd’hui ne me semble pas le plus adapté à la situation parisienne.
Nous avons tous fait tourner nos ordinateurs pour calculer toutes les répartitions possibles. J’ai dénombré au moins quatre systèmes respectant purement la démographie qui auraient pu être utilisés. Chacun aurait donné une répartition différente. Ainsi, même en se retranchant derrière l’argument de la démographie, il y a nécessairement de la partialité. Nous pourrions, par exemple, retenir le cas du XVIIe arrondissement, qui, dans les deux dernières propositions, gagne des habitants, mais perd un élu... C’est la raison pour laquelle, à l’époque où Matignon s’occupait du problème, j’avais rencontré le Premier ministre pour lui proposer une intervention a minima. Je l’avais trouvé très réceptif !
M. le ministre s’esclaffe.

Étant donné qu’aucun tableau ne peut être incontestable, et à moins de huit mois de l’élection municipale, il m’avait semblé juste de toucher le moins possible au dispositif avant d’envisager, pour l’élection suivante, une refonte plus importante du système, sur des bases que j’aimerais évoquer avec vous aujourd’hui.
Avec cette intervention a minima, plutôt que de revoir toute la grille de répartition, on aurait pu se contenter d’enlever des sièges là où cela permettait d’entrer dans le tunnel des 20 % et de n’en ajouter que là où c’était arithmétiquement nécessaire pour qu’un arrondissement plus peuplé ne puisse pas avoir moins de sièges. Ce système minimaliste aurait limité les pertes aux Ier, IIe, IVe et VIIe arrondissements et aurait donné un siège supplémentaire au XIXe arrondissement.
Vous auriez dû saisir cette proposition, qui avait le mérite de changer le moins de choses possible pour 2014 tout en se conformant rigoureusement aux recommandations du Conseil constitutionnel. Au lieu de cela, vous avez persévéré dans l’arbitraire !
Mes chers collègues, les héritages électoraux ont souvent du sens, et il faut alors les respecter. En revanche, certains dispositifs sont hérités d’un autre âge et peuvent se trouver en décalage complet avec la réalité d’un territoire et de sa représentation. Il me semble que c’est bien le cas de l’élection du maire de Paris. Je vous rappelle que les électeurs parisiens sont les seuls, avec ceux de Lyon et de Marseille, à élire leur maire au suffrage universel indirect à deux degrés. À l’heure du Grand Paris, cette particularité électorale est devenue une inégalité démocratique.
Nous avons aujourd’hui l’occasion, non seulement de rebattre les cartes de l’organisation électorale parisienne, mais aussi de les redistribuer de façon équitable, généreuse et moderne. Toutes les voix des Parisiennes et des Parisiens se valent !
Le découpage par arrondissement, qui doit bien entendu permettre l’élection d’un maire et d’un conseil d’arrondissement, ne doit pas être une entrave à l’élection du maire de la capitale et du conseil de Paris, celle-ci devant se faire dans la transparence du suffrage universel direct. Je défends cette idée depuis plusieurs années maintenant, et je crois que la décision du Conseil constitutionnel devrait être l’occasion de mener cette réforme incontournable de la carte électorale parisienne.
L’une des raisons de l’amélioration de la situation parisienne est la mobilité toujours croissante des Parisiens. Cette mobilité, qui est une chance pour notre capitale en termes de brassage, de diversité sociale et générationnelle, ne doit pas être figée dans sa représentation élective. Cette rigidité tout à fait artificielle entraîne d’ailleurs des ajustements réguliers quand les mouvements de population rendent les distorsions trop importantes.
Mes chers collègues, nous savons tous qu’au gré des majorités ces ajustements sont souvent l’occasion de bricolages servant les uns et desservant les autres. Nous avons aujourd’hui la possibilité d’en finir avec ces calculs, qui nuisent à la vie politique et brouillent la lisibilité de l’organisation électorale parisienne.
Pourquoi valider un tableau qui sera mécaniquement caduc dès l’année prochaine quand nous pouvons offrir aux Parisiennes et aux Parisiens d’élire directement leur maire et, ainsi, de s’aligner avec toutes les grandes capitales du monde ?
Pourquoi s’entêter dans un système déclenchant systématiquement querelles et désaccords quand nous pourrions faire reposer la capitale sur les bases solides du suffrage universel direct ?
Pourquoi persister dans un système alambiqué quand l’heure est à la « transparence de la vie politique » ?
Dois-je rappeler, mes chers collègues de la majorité, que le système auquel vous vous accrochez aujourd’hui, cette incongruité électorale, devrais-je dire, a permis à Bertrand Delanoë d’être élu avec 49 % des suffrages en 2001 ? Avec moins de voix que la droite, la gauche a obtenu 21 sièges d’avance au conseil de Paris !

Ce n’était d’ailleurs pas une nouveauté : Gaston Defferre, l’homme qui a inventé la loi PLM, avait déjà bénéficié de cette entourloupe électorale en 1983, quand il fut réélu à la mairie de Marseille alors que Jean-Claude Gaudin avait obtenu plus de suffrages que lui sur l’ensemble de la commune.

Et je ne parle pas de Lyon, monsieur Mercier !
J’ai particulièrement étudié l’exposé des motifs justifiant les vases communicants opérés sur le tableau, qui est à lui seul le meilleur plaidoyer pour un changement radical du système. Je le dis sans aucune ironie – j’admire la virtuosité du président Sueur ainsi que celle du président Urvoas –, mais vous conviendrez avec moi que les calculs de pondération virent parfois à la contorsion. Je ne vous le reproche pas d’ailleurs, car c’est tout simplement inhérent à la forme même de la sectorisation du corps électoral du conseil de Paris. C’est pourquoi je regrette que vous n’ayez pas profité de cette belle occasion donnée par le Conseil constitutionnel pour tourner la page des rafistolages et offrir à Paris une élection sans calculs ni détours. Cela aurait également été l’occasion de libérer la capitale des logiques politiciennes, qui sont malheureusement encouragées par l’organisation par arrondissement.
Sans cela, nous savons toutes et tous que nous devrons à nouveau occuper cet hémicycle à l’occasion de la prochaine révision du tableau, pour batailler sur des « plus un » par-ci et des « moins un » par-là... Je ne suis pas certain que la Haute Assemblée se grandisse avec ces calculs d’épicier !
L’expression de la démocratie que constitue l’élection au suffrage universel mérite plus de clarté et de générosité. C’est pourquoi je ne voterai pas ce texte, qui reste un bricolage de plus à l’heure où nous devrions faire preuve d’audace, d’innovation et de simplicité.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi, dont l’élaboration a été provoquée par la censure du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier, vise à apporter les corrections nécessaires pour assurer une meilleure représentation des Parisiens lors des prochaines élections municipales.
Pour notre part, vous le savez, nous sommes favorables à tout ce qui permet de nous rapprocher d’une représentation de chaque électeur à égalité. Ce n’était plus le cas à Paris où l’évolution démographique, conjuguée à une répartition figée et ancienne du nombre de conseillers de Paris par arrondissement, avait abouti à des distorsions grandissantes du rapport entre le nombre d’élus et le nombre d’électeurs. Les tendances démographiques se sont en effet nettement modifiées dans la capitale depuis maintenant plus d’une décennie.
Je veux ouvrir une parenthèse à ce propos, en rappelant que la capitale s’est vidée de ses habitants dès le milieu des années cinquante. Cette évolution a été accélérée par la gestion de la droite. Celle-ci a favorisé de nombreux programmes immobiliers de transformation d’appartements en bureaux, ce qui a contribué de manière importante à cette baisse, particulièrement rapide dans les années soixante et soixante-dix. Ainsi, la population parisienne est passée de 2 790 000 habitants en 1962 à 2 299 000 habitants en 1975, soit une chute de près de 500 000 habitants.

Les classes populaires ont été chassées vers la périphérie, avec les conséquences que l’on connaît.
Cette baisse de la population a été ininterrompue jusqu’en 2006, la population parisienne étant à peine supérieure, aux alentours des années 2000, à 2 000 000 d’habitants.
Depuis 2006, donc, cette tendance s’est inversée et cette évolution est surtout due aux quartiers populaires de la ville, les arrondissements centraux et les VIIe, VIIIe et XVIe arrondissements continuant à perdre des habitants.
La gestion de gauche de la ville, depuis deux mandats, n’est évidemment pas pour rien dans ce regain démographique, qui, je l’espère, se poursuivra grâce à l’amplification de la lutte contre la spéculation immobilière et à la multiplication des logements sociaux pourvus de suffisamment d’équipements publics et culturels de qualité, afin d’éviter la paupérisation en cours dans de nombreuses autres grandes villes du monde.
Pour tenir compte de ces changements démographiques, aux répercussions évidemment importantes dans la vie des Parisiens, les parlementaires communistes ont proposé, dès les années 2000, une modification de la répartition des conseillers de Paris, qui n’avait pas changé depuis 1982.
Nicole Borvo Cohen-Seat, qui m’a précédé au Sénat, avait, le 10 janvier 2002, au cours du débat concernant le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, présenté un amendement en vue de faire évoluer cette répartition pour respecter la réalité de la population et prendre en compte les recensements connus. Elle s’était alors heurtée non seulement au refus catégorique de la majorité de droite du Sénat, mais aussi au refus du ministre de l’intérieur de l’époque, M. Daniel Vaillant.
Quatre ans plus tard, elle déposait une proposition de loi allant dans le même sens, sans rencontrer plus de succès, et, par la suite, d’autres parlementaires dont vous faites effectivement partie, monsieur le rapporteur, ont également exprimé cette exigence.
Je me réjouis donc que, aujourd’hui, nous nous retrouvions ensemble, à gauche, pour soutenir cette proposition de loi. En effet, le groupe CRC a toutes les raisons d’appuyer ce texte, qui tient compte des évolutions démographiques et tend à améliorer les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.
En remettant en cause l’intégralité du tableau des conseillers de Paris et la règle, qu’il avait validée en 1982, de représentation minimale de trois conseillers de Paris par arrondissement, ce dernier a imposé l’adoption rapide d’une nouvelle disposition législative avant les prochaines échéances municipales. Cette modification va permettre de garantir un plus grand respect de l’égalité devant le suffrage, parfaitement compatible avec le cadre historique des arrondissements.
Si l’injonction législative n’est pas notre tasse de thé, les dispositions ici proposées représentent une réelle amélioration, qui aurait déjà dû intervenir.
La proposition de loi tend aussi à mettre fin à l’obligation faite aux maires d’arrondissement d’être également membres du conseil municipal. Cette disposition est rendue nécessaire par l’adoption du nouveau tableau, mais elle pourrait aussi trouver son utilité en cas de décès ou de démission des maires d’arrondissement élus initialement.
À l’inverse de ce qu’ils recherchaient, vous l’avez suggéré, monsieur Charon, c’est la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires de droite qui a conduit à la décision rendue, nous invitant à respecter mieux encore le principe d’égalité devant le suffrage.
Se retrouvant aujourd'hui dans la position de l’arroseur arrosé, au lieu de prendre acte tranquillement de ce nouvel état de fait, la droite s’acharne à présent dans une fuite en avant en proposant de « bonapartiser » la fonction de maire de Paris, méconnaissant au passage l’attachement des Parisiens à leur maire d’arrondissement, sauf peut-être la mairie du VIIe arrondissement, à propos de laquelle je me souviens que la droite s’est beaucoup battue. C’est d’autant plus cocasse que jusqu’en 1975 la droite avait privé les Parisiens d’un maire ! Les arguments de la droite sont donc bien politiciens.
Pour notre part, ce qui nous intéresse, c’est que le présent texte participe à une amélioration très nette du système électoral parisien. Nous allons donc le voter, parce que nous pensons qu’il atteint un point d’équilibre satisfaisant.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Soyons honnêtes, je ne pense pas que vous ayez imaginé, monsieur le ministre, lorsque vous avez décidé d’introduire une modification de la répartition des conseillers de Paris dans votre projet de loi instaurant le binôme départemental paritaire, que le Conseil constitutionnel censurerait l’ensemble du tableau de répartition desdits conseillers. Vous auriez dû intégrer également le cas de Lyon, comme je vous l’avais suggéré, l’écart à la moyenne entre le Ier et le IIIe arrondissement de Lyon variant du simple au double.
Sans doute, à l’époque, certains ont-ils cru bon de se saisir de cette opportunité pour tenter de donner à la majorité parisienne sortante un petit coup de pouce. Vous savez très bien que la majorité peut basculer à quelques voix près, et M. Delanoë vous a poussé à sortir ce texte. Deux conseillers par-ci, un conseiller par-là, le tout dans un article discret noyé dans un projet de loi consacré précisément à presque toutes les collectivités, sauf Paris, Lyon et Marseille…
J’imagine que vous pensiez qu’au pire le Conseil constitutionnel censurerait un article de votre projet de loi, sauf que le Conseil ne s’est pas arrêté là : c’est bien l’ensemble du tableau qu’il a censuré, rendant ainsi momentanément impossible l’organisation des élections municipales dans la capitale.
En fait, cette censure était prévisible, y compris dans son étendue. Le principe de l’égalité du suffrage est interprété strictement par le Conseil et sa jurisprudence en la matière n’est pas nouvelle. Le précédent gouvernement en avait d’ailleurs, lui aussi, fait les frais. Nous sommes donc dans la nécessité de remplacer ce tableau de répartition.
La nature même de la décision du Conseil, en censurant l’intégralité du tableau datant de 1982, nous invitait, malgré la proximité des échéances électorales, à une réflexion bien plus ambitieuse que le texte qui nous est aujourd’hui soumis. En l’espèce, je suis navré, mais il s’agit d’un sparadrap sur une jambe de bois !
Notre rapporteur – toujours amical pour le ministre et le Gouvernement – nous explique qu’à huit mois du scrutin municipal il est « inenvisageable de refondre le régime électoral parisien » et « il apparaissait donc inconcevable de réformer en profondeur le mode de scrutin parisien ».
Nous ne partageons pas cette analyse, d’autant que si nous sommes aujourd’hui dans cette situation, c’est exclusivement la faute du Gouvernement et de ceux qui ont cru bon de voter en faveur de cette loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
On ne saurait venir reprocher au Conseil d’avoir accompli sa mission. C’est bien le caractère arbitraire de cette répartition que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel. Celle-ci ne correspondait à aucun critère démographique avéré et laissait subsister des écarts disproportionnés : d’un arrondissement à l’autre, cela a été dit, le nombre d’habitants représentés par un conseiller de Paris pouvait aller du simple au triple, l’écart maximal par rapport à la moyenne étant de 57 %. C’est vous qui avez voulu arranger à votre main la répartition des conseillers. Vous avez mis le doigt dans le pot de confiture et vous vous êtes fait prendre !

Le système instauré par la loi PLM de 1982, vous le savez très bien, est stupide. Gaston Defferre, qui était un bon ministre de l’intérieur – très malin, comme tous les ministres de l’intérieur, de droite comme de gauche –, s’est rendu compte qu’il allait être battu. Il a donc imaginé un texte spécifique, d’abord pour la seule ville de Marseille – Defferre pouvait faire tout ce qu’il voulait ! – avant d’ajouter celles de Lyon et de Paris ! C’est ainsi que l’on a adopté cette loi stupide.
Vous avez entendu ce qu’a dit notre collègue Charon. M. Defferre a été réélu, minoritaire en voix mais majoritaire au conseil municipal ; c’est également arrivé à Lyon en 2001, m’a-t-on dit, ainsi qu’à Paris où M. Delanoë était minoritaire en voix mais majoritaire au sein des conseillers de Paris. C’est, je le répète, un système stupide, sans compter la répartition des pouvoirs entre les mairies d’arrondissement et la mairie centrale – je le vis depuis 1983…
Vous n’êtes pas les seuls responsables, d'ailleurs ; la droite et le centre sont également fautifs : nous aurions dû modifier ce texte depuis très longtemps. On ne peut pas continuer à appliquer un texte complètement idiot ; c’est un problème que le Sénat devrait prendre en compte.
Il est vain d’essayer de bricoler ce système comme vous le faites avec ce texte. La preuve en est que vous n’arrivez même pas à respecter pleinement les critères posés par le Conseil constitutionnel puisque l’écart de représentation du premier des vingt arrondissements s’établit encore au-delà de 20 % de la moyenne parisienne. Notre rapporteur, toujours bon ami du ministre, est fier de nous annoncer qu’il est ramené de moins 42, 6 % dans le tableau censuré à plus 25, 7 %.

Certes, mais la répartition proposée aurait dû également tenir compte de l’impact de projets d’urbanisme majeurs tels que la ZAC des Batignolles dans le XVIIe arrondissement…

… ou encore l’opération Laennec dans le VIIe arrondissement, arrondissement dont je suis élu, qui vont accueillir énormément d’habitants. Je pense aussi à la restructuration du site de l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN, projet datant de 1986 qui va enfin voir le jour. Il n’en a pas été tenu compte. À titre d’exemple, un conseiller a été supprimé dans le VIIe arrondissement. Le texte n’intègre donc pas ces évolutions.
Je passe sur l’aberration totale consistant à appliquer un scrutin proportionnel lorsque deux sièges, voire un seul, sont en jeu. Un amendement défendu à l’époque par le groupe socialiste visait d'ailleurs, en 1982, à passer de deux à trois…
Tout cela n’est pas satisfaisant ; ce n’est pas un travail législatif sérieux ! Vous êtes dans l’obligation de faire adopter une nouvelle répartition par la représentation nationale, mais « obligation » ne signifie pas « précipitation », et cela aurait pu se faire de manière plus sereine et surtout plus visionnaire, avec un consensus général.
Y aurait-il une solution alternative, un moyen de contourner ces difficultés ? Quitte à modifier le système électoral à Paris, on aurait pu le changer complètement et permettre aux Parisiens et aux Parisiennes d’élire directement leur conseil municipal puis leur maire, comme c’est le cas dans la quasi-totalité des villes de France !
Nous observons un paradoxe incroyable : les maires d’arrondissement, qui n’ont aucun pouvoir, sont élus par tous les électeurs du territoire qu’ils administreront à l’échelle inframunicipale de l’arrondissement, alors que le puissant maire de Paris, qui détient tous les pouvoirs, gère près de 8 milliards d’euros de budget, dispose de nombreux adjoints, n’est pas élu par l’ensemble des électeurs parisiens.
Savez-vous que seuls 20 147 Parisiens ont voté pour Jacques Chirac en 1983, sur la liste du Ve arrondissement ?

Les autres électeurs, comme moi-même dans le VIIe arrondissement, étaient des votants virtuels ! C’est stupide ! M. Delanoë a été élu pour la première fois, en 2001, dans le XVIIIe arrondissement, par 28 722 voix, alors qu’il y a eu 313 075 votants pour les listes de gauche.
Les maires de Paris sont élus par une toute petite proportion de la population parisienne, et ce depuis je ne sais combien d’années, et l’on n’y touche pas, monsieur le ministre ? Il faudra bien poser le problème de cette élection en quelque sorte virtuelle. Vous n’avez pas voulu vous y atteler aujourd'hui parce que vous voulez aller vite et craignez d’approfondir les choses, mais il faudra bien le régler un jour : le maire de Paris, d’une puissance terrible, n’est élu que par très peu de voix !

Pour finir, je ne peux m’empêcher de dire quelques mots des conditions d’examen de cette proposition de loi.
Le 13 juin 2013, le président Urvoas a déposé une proposition de loi relative à l’élection des conseillers de Paris, qui a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et examinée en séance publique le mercredi 10 juillet 2013. Puis, après la transmission du texte au Sénat, on nous annonce soudainement qu’on passe d’une proposition de loi « Urvoas » à une proposition de loi « Sueur ». Pourquoi ce changement ?
Vous nous avez expliqué que le délai entre le dépôt de la proposition de loi et la discussion en séance prévu par la Constitution n’avait pas été respecté, pas plus que celui entre la transmission de la proposition de loi et la discussion en séance dans la deuxième assemblée. Évidemment, si le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée, il n’y aurait pas eu de difficulté, mais cela n’a pas été fait : le Gouvernement a tout simplement oublié de le faire ! En commission, le président Sueur a été honnête et a admis cet oubli – vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le ministre –, mais il a aussi minimisé sa portée. Depuis le début, la proposition de loi « Urvoas » ne respectait pas les délais imposés par l’article 42, alinéa 3, de la Constitution dans le cas d’un examen selon la procédure normale. Cela n’a pas empêché l’Assemblée nationale d’aller au bout de la lecture sans sourciller…
Franchement, un tel amateurisme est vraiment déplorable pour au moins deux raisons. La première, c’est que l’on parle d’un sujet important puisque ce texte comble un vide juridique qui rend en l’état impossible l’élection municipale à Paris, vide juridique apparu, je le rappelle, à l’issue de la décision du Conseil constitutionnel. La deuxième raison, c’est que l’on parle ici de choses simples, basiques, à savoir le respect de délais constitutionnels, dont le non-respect vous a déjà valu, c’est un comble, une censure du Conseil constitutionnel !
Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? L’urgence dans laquelle on contraint le Parlement à légiférer depuis plusieurs mois est telle – c’est encore plus vrai pour la commission des lois – que le Gouvernement n’a même plus le temps d’engager l’urgence ! En effet, si le Gouvernement n’avait pas « oublié » d’engager la procédure accélérée, nous n’en serions pas là.
En définitive, cette proposition de loi, plutôt que de proposer une réforme ambitieuse à la hauteur des enjeux, s’inscrit dans une démarche purement tactique à huit mois des élections municipales de Paris, au détriment de l’intérêt général des Parisiens. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UDI-UC votera unanimement contre ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai transparent et bref.

Le RDSE votera ces nouvelles modalités d’élection des conseillers de Paris, avant-dernière étape, ce soir, d’un parcours à surprises.
Surprise, en effet, que la nouveauté de la procédure utilisée : la présentation de la même proposition de loi par deux auteurs différents, à quelques semaines d’intervalle, successivement à l’Assemblée nationale et au Sénat. Je constate qu’il y a des erreurs fertiles : Christophe Colomb, parti à la recherche des Indes, a trouvé l’Amérique…
Surprise que d’avoir eu besoin du Conseil constitutionnel pour réaliser que ce qui avait été tenu pour inacceptable pour les découpages cantonaux – des écarts démographiques de plus de 20 % par rapport à la moyenne départementale – devait l’être aussi s’agissant de Paris, élection municipale mais aussi départementale.

Ainsi, la loi du 17 mai 2013 retenait-elle un écart à la moyenne de 57 % pour le Ier arrondissement, de 45 % pour le IIe et de 31 % pour le IVe. Je constate que ladite loi a pris moins de gants s’agissant d’assurer une représentation minimale des territoires ruraux, dont la spécificité saute pourtant plus aux yeux que celle du Ier arrondissement de Paris par rapport aux autres arrondissements.
Pourquoi, après tout, puisqu’on était parti pour diviser par deux les cantons de France, ne pas tout simplement réunir le Ier et le IIe arrondissement en un seul ?

Cette hypothèse avait d'ailleurs été envisagée, puis écartée, si j’ai bien compris, pour répondre à l’attente des Parisiens : heureux Parisiens dont on tient compte des états d’âme !
Surprise, enfin, qu’il ait fallu trente ans pour réaliser cette mise à jour alors même qu’aucune spécificité d’arrondissement, tel le Ier, ne le justifiait.
Les propositions qui nous sont faites aujourd’hui sont donc tellement frappées au coin du bon sens qu’on se demande pourquoi elles ont mis autant de temps à germer.
C’est pourquoi, comme je l’ai dit, le RDSE votera dans sa très grande majorité ce texte, y compris ses implications quant au nombre de conseillers d’arrondissement ou au mode de désignation des maires d’arrondissement. On peut penser que cela donnera à ces derniers plus de poids démocratique, ce qui n’est pas pour nous déplaire, bien au contraire.
Voilà, j’ai dit l’essentiel. J’ai promis d’être bref et transparent : je fus transparent et bref !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC et de l'UMP . – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 1859, Paris est composé de vingt arrondissements, produits de la disparition des anciens villages dont les traces subsistent, quoi qu’on en dise, dans leur sociologie, malgré les transformations urbaines.
Ils sont démocratiquement représentés par un certain nombre d’élus, selon une équation dont la résolution est digne du théorème de Fermat – pardon, du Conseil constitutionnel !
Sourires.

La solution de cette équation doit se trouver dans N, ou plutôt dans H, ensemble des entiers humains, puisque nous sommes incapables de diviser un élu en deux – nous nous divisons suffisamment entre nous par ailleurs...
Nouveaux sourires.

Cette équation, digne du prix Abel, peut s’écrire au minimum avec deux constantes : un nombre de postes de conseillers de Paris fixe, à savoir 163, et une règle d’arrondis intangible, ainsi que trois paramètres : vingt arrondissements ayant des écarts de population importants, l’impossibilité d’une attribution préalable de trois conseillers dans chaque arrondissement et des conseillers toujours entiers.
Même sans être sorti de Polytechnique, il semble évident que, quelle que soit la méthode de calcul, certains arrondissements seront favorisés et d’autres défavorisés, sauf à accepter de ne pas résoudre cette équation dans H, mais dans R privé de Q, l’ensemble des irrationnels, …

… plus précisément des nombres irrationnels, car les élections, bien entendu, sont toujours rationnelles.
Si l’on prend l’exemple du XVe arrondissement, selon l’emplacement des parenthèses – non électorales, cette fois –, on pourrait avoir dix-sept ou dix-huit conseillers, soit une différence de 5 à 6 %, ce qui représente un bras plus ou moins long.
Tout est différent pour les quatre premiers arrondissements, nettement moins peuplés : le nombre de conseillers peut y passer du simple au double, c’est-à-dire d’un à deux, soit un homme entier ou une femme entière, ce qui fait une différence notable. En considérant l’écart à la moyenne, disproportionné dans les petits arrondissements, nous dressons un constat objectif. En outre, il convient de souligner que ces arrondissements de moins de trois conseillers n’auront, de fait, aucune possibilité de représentation de l’opposition, ce qui est fort peu démocratique.
Un correctif pourrait être appliqué en attribuant une constante d’un conseiller pour les IIe et IIIe arrondissements. Mais dans ce cas, à nombre de conseillers de Paris intangible, il serait nécessaire de supprimer ces deux postes dans d’autres arrondissements. Ce seraient les arrondissements servis en dernier dans la procédure d’attribution à la plus forte moyenne qui perdraient un conseiller, en l’occurrence les XIIe et XXe arrondissements. On ne toucherait évidemment pas au Ier arrondissement, car celui-ci serait plus favorisé avec l’ajout d’un conseiller que défavorisé par son absence.
Dans la vie courante, nous avons l’habitude d’arrondir les résultats des opérations non électorales à l’unité la plus proche, inférieure ou supérieure. Cela nous donne une autre possibilité de correctif : si l’on applique cette méthode de simple calcul d’arrondi à notre problème électoral, il se trouverait – miracle ! – que la population actuelle de Paris permettrait de compenser les arrondis négatifs par les arrondis positifs.
Bien entendu, cette présentation tend vers les mêmes résultats que les corrections effectuées dans cette proposition de loi. Elle a toutefois deux mérites : tout d’abord, celui de constituer un calcul strict, sans considération des arrondissements, excluant ainsi les soupçons de calculs politiciens, …

… et ensuite, celui de faire en sorte que les écarts à la moyenne des deux arrondissements en jeu – les XIIe et XVe arrondissements – soient moindres, certes de peu, mais tout de même, donc plus justes.
Il faut noter que la répartition proposée entraînera des difficultés pour les petits arrondissements, c’est-à-dire les Ier, IIe et IVe arrondissements : le préalable du nombre de conseillers d’arrondissements et de maires adjoints étant une constante, comme je l’ai posé en préalable, si vous vous en souvenez, cela entraîne une perte d’un adjoint et de deux ou trois conseillers d’arrondissement, alors que le travail qui leur incombe est toujours fixe. Le résultat revient donc soit à une surcharge de travail pour les autres, soit à l’abandon de certains domaines.
De même, le refus de toucher à une coutume intangible, qui devient ainsi la seconde constante de l’équation, est encore plus à la source de nos problèmes : je veux parler de la plus forte moyenne, clef de répartition historique tant à Paris qu’à Lyon et Marseille. Il faudra un jour reprendre ce paramètre pour que les inconnues s’y retrouvent. Bien qu’il soit plus juste mathématiquement, ce nouveau mode de calcul ne l’est pas totalement.
À l’heure de la mondialisation, de l’européanisation, de la recherche de partage des équipements communs, en particulier dans les quatre premiers arrondissements de Paris, ces querelles de représentation, dont on a du mal à distinguer les véritables enjeux pour les Parisiens, ressemblent quelque peu à des querelles de clocher, sinon de minaret...
Toutefois, le vrai problème, c’est que tout changement dans la répartition des élus à la veille d’une élection – on vient encore de l’entendre – est interprété par les uns ou par les autres comme un calcul destiné à récupérer plus de sièges que ne le permet le mode de répartition en vigueur.
Il semble donc indispensable de remettre à plat cette question une fois les prochaines élections passées, lorsque les esprits seront moins échauffés. Il conviendra, notamment, de reprendre les constantes applicables.
En attendant, même si cette proposition de loi emprunte plus aux comptes d’apothicaire qu’aux contes de fées, les écologistes voteront ce texte, solution approximative à la quadrature du cercle vertueux de la démographie élective.
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe CRC . – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir tardivement pour tenir compte de la décision rendue le 16 mai dernier par le Conseil constitutionnel, qui a censuré l’article 30 de la loi relative aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral.
Le tableau n° 2 annexé au code électoral qui fixe la répartition par secteurs des conseillers de Paris a été censuré dans son intégralité, aussi bien dans sa version déférée que dans sa version initiale, introduite par la loi dite « PLM » de 1982. M. Charon, malicieusement, a fait remarquer que le Conseil constitutionnel était sans doute allé plus loin que ne l’aurait souhaité l’opposition : c’est ce que l’on appelle « l’effet boomerang » ! En effet, chers collègues de l’opposition, vous vous seriez sûrement satisfaits du maintien du tableau de la loi PLM.

Vous aimez beaucoup le Conseil constitutionnel en ce moment ! Cela n’a pourtant pas toujours été le cas.

Las, aujourd’hui, nous sommes amenés à le modifier plus profondément. Et il y a urgence, …

… car les municipales de mars 2014 approchent. À huit mois de cette échéance, il nous fallait réagir rapidement, en gardant à l’esprit l’objectif du Gouvernement d’assurer l’égalité devant le suffrage.
L’article censuré proposait une nouvelle organisation pour les sièges des conseillers de Paris, dont la répartition n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis bientôt trente et un ans. Le Gouvernement, dans sa grande sagesse, avait donc souhaité, à l’occasion de ce projet de loi, prendre en compte les nombreuses et importantes évolutions démographiques intervenues depuis 1982 dans la capitale.
Je crois devoir insister sur ce point, mes chers collègues : la question qui se pose est toujours celle de savoir comment assurer l’égalité des citoyens devant le suffrage. Tous les textes relatifs au mode de scrutin récemment soumis à l’examen du Sénat visaient cet objectif, notamment le projet de loi relatif aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral.
Le redécoupage des cantons induit par l’introduction du scrutin binominal va en effet permettre de réduire les écarts de population très importants existant entre des territoires dont les frontières, souvent, n’ont pas évolué depuis plus de deux siècles. À cet égard, le record était détenu par le département de l’Hérault, dans lequel le rapport des conseillers généraux pouvait aller d’un à quarante-quatre suivant le canton où se déroulait l’élection.
Le même objectif a prévalu pour l’élaboration du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, dont j’avais eu l’honneur d’être désigné rapporteur par la commission des lois : afin d’assurer une meilleure représentation des zones urbaines au sein de la Haute Assemblée, nous avons abaissé de 1 000 à 800 le seuil déclenchant la désignation d’un délégué supplémentaire dans les villes de plus de 30 000 habitants.
Pour mémoire, actuellement, plus des deux tiers des délégués des conseils municipaux représentent des communes de moins de 10 000 habitants, alors que celles-ci ne regroupent que la moitié de la population.
Vous constaterez, à travers ces exemples, que la volonté du Gouvernement et des parlementaires socialistes est bien de favoriser l’égalité des citoyens devant le suffrage. Cet objectif se trouve au cœur de l’ensemble des réformes proposées.
Face à ces modifications, l’opposition s’est empressée de parler de « tripatouillage » électoral. Dans une lettre d’information, un sénateur de l’opposition, M. Jean-Léonce Dupont, est même allé jusqu’à parler de « choc de tripatouillage » ! Nous n’avons pourtant eu de cesse de défendre dans l’hémicycle cette nécessaire égalité devant le suffrage, face à une opposition qui faisait mine d’ignorer l’existence d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point.
Les socialistes ne nient pas l’importance d’offrir une représentation suffisante et une voix pour se faire entendre à chacun de nos territoires, bien au contraire. Cette préoccupation est autant la vôtre que la nôtre, chers collègues, mais il faut trouver un équilibre permettant de tenir compte des territoires comme des populations. Et cet équilibre, le Conseil constitutionnel l’a énoncé dans sa jurisprudence.
Que vous ayez saisi les juges et que ces derniers, au regard de vos motivations, vous aient largement désavoués doit nous conduire à nous interroger sur l’opportunité de saisir la haute juridiction et, ensuite, de tenir compte de ses jugements. Les choses sont maintenant claires : des écarts importants dans la représentation des citoyens ne sont plus tolérés. Le Conseil constitutionnel a souhaité réaffirmer sa jurisprudence, se posant désormais en gardien de l’égalité devant le suffrage dans toutes les circonscriptions.
Vous nous aviez reproché d’aller trop loin dans notre réforme, qui visait à réduire ces écarts, souvent devenus parfaitement excessifs. Or votre saisine a conduit le Conseil constitutionnel à affirmer que nous n’avions pas été assez loin !
C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui cette nouvelle modification du mode d’élection des conseillers de Paris, qui vise à tirer les conséquences de la décision du 16 mai dernier, sans toutefois apporter de modifications aux autres paramètres du scrutin. En effet, tout le monde convient qu’il faut maintenir le nombre de conseillers de Paris à 163, ainsi que leur élection par arrondissements.
Le seuil de trois conseillers par arrondissement vient donc à disparaître, et l’élection s’effectuera désormais à la proportionnelle dans tous les arrondissements, avec un mécanisme de correction démographique.
Mes chers collègues, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale, qui impose le principe de l’égalité démographique, est de plus en plus exigeante. L’opposition vient de l’apprendre à ses dépens : si nous pouvons être amenés à regretter le caractère contraignant de ce principe, encore faudrait-il ne pas formuler de recours conduisant le Conseil constitutionnel à le rappeler dans toute sa rigueur.
J’ai bien entendu les arguments avancés par l’UMP et les centristes visant à modifier complètement l’élection des membres du conseil de Paris. Sans doute faut-il rappeler que le Conseil constitutionnel n’a jamais demandé la suppression du vote par arrondissements…

… et qu’il a censuré seulement la représentation minimale de trois conseillers de Paris par arrondissement, qu’il avait, certes, validée en 1982. Sa décision ne remet pas en cause l’existence des arrondissements, ni des sections électorales.
De même, il est faux de dire que les électeurs parisiens sont les seuls à ne pas élire directement leur maire. Dans toutes les communes de France, les électeurs votent pour des conseillers municipaux qui, ensuite, élisent le maire au sein du conseil municipal. Il est vrai qu’à Paris, Lyon et Marseille la taille des communes a conduit à un système électoral permettant d’élire simultanément les élus au conseil municipal et au conseil d’arrondissement ensuite chargés des compétences de proximité.
Vous proposez de ne supprimer ce vote par arrondissement que pour Paris. Pourquoi cette ville et non Lyon et Marseille ? Y aurait-il dans la loi PLM deux sous-groupes, la capitale et celui qui est formé par Lyon et Marseille ? Pourquoi n’avez-vous pas engagé une telle réforme durant les dix années au cours desquelles vous disposiez d’une majorité à l’Assemblée nationale ?

Bernard Debré, éminent député parisien, avait d’ailleurs déposé une proposition de loi allant dans le sens de vos amendements actuels le 18 juillet 2007. Pourquoi vouloir aujourd’hui changer en profondeur la règle du jeu électoral, à quelques mois seulement des élections municipales ?
Vous avez parlé de tripatouillage et de manipulation. Pour ma part, j’ai envie de vous renvoyer à votre miroir : les amendements que vous défendez, messieurs Charon et Pozzo di Borgo, ne sont en fait qu’une ficelle politicienne, un signe de fébrilité.
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Vous êtes aujourd’hui en difficulté à Paris. Vous sentez bien que l’élection municipale qui s’annonce va complètement échapper à la droite, à l’UMP comme aux centristes.

Dès lors, vous nous proposez de revoir complètement le mode de scrutin.
Vous éprouvez des difficultés dans de nombreux arrondissements parisiens. §Pour les contourner, vous proposez la suppression des arrondissements de Paris, rien de moins ! La ficelle est un peu grosse, mes chers collègues.
Voilà trente et un ans que ce système électoral existe. Il faudra peut-être songer à le changer un jour, mais, à huit mois des élections municipales, il suffit de le corriger. C’est le sens de cette proposition de loi, qui vise à tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Élaborer un nouveau mode de scrutin, taillé sur mesure pour une candidate en difficulté à Paris et qui a bien du mal à réussir son parachutage de l’Essonne vers la capitale
M. Pierre Charon s’exclame.

Le groupe socialiste votera donc cette excellente proposition de loi déposée par le président de la commission des lois, …
Sourires sur les travées de l'UMP.
Je tenais à remercier les orateurs de la majorité du soutien qu’ils ont apporté à ce texte.
Monsieur Laurent, vous souhaitiez cette actualisation depuis longtemps : elle arrive enfin. Les éléments démographiques méritaient également d’être rappelés. Je vous remercie de votre soutien.
Je salue également M. Collombat. J’apprécie tout particulièrement, en présence de Jacques Mézard, la valeur de l’appui que nous apporte le groupe du RDSE.
Nouveaux sourires.
Madame Lipietz, je vous remercie de la pédagogie dont vous avez fait preuve pour expliquer les dispositions du texte.
Je remercie aussi M. Kaltenbach, qui a rappelé, au nom du groupe socialiste, le processus qui a mené à ce texte. En tant que rapporteur du projet de loi sur les élections locales, vous en connaissez parfaitement l’origine, monsieur le sénateur.
Quant à vous, monsieur Charon, je vous remercie de la franchise de vos propos sur la décision du Conseil constitutionnel. J’ai également adopté un langage de vérité, tout comme Jean-Pierre Sueur. Toutefois, ne parlez pas d’« arbitraire », puisque l’élection se fera bien selon un mode de scrutin municipal proportionnel, et dans la transparence.
Vous pouvez très bien être attaché à l’idée de circonscription unique – cela se discute. Mais alors, pourquoi les gouvernements en place entre 2002 et 2012 ne l’ont-ils jamais proposée ?
De plus, reconnaissons-le, bouleverser totalement un système auquel les Parisiens sont attachés et qu’ils connaissent depuis un certain temps à quelques mois seulement des élections municipales serait prendre un autre risque, à mon sens beaucoup plus élevé.
J’en viens à votre intervention, monsieur Pozzo di Borgo. De grâce, ne vous affligez pas trop ! Ne vous fustigez pas vous-même !
Ce système que vous qualifiez de « stupide » vous a tout de même permis d’être élu pendant un certain temps, sans que vous jugiez bon de le changer.
Je vous rassure, monsieur Pozzo di Borgo, monsieur Charon, ce système n’est pas stupide. L’organisation de la capitale en arrondissements est même logique.
Vous avez rappelé que Bertrand Delanoë avait été élu sans majorité en 2001.
Vous oubliez simplement de dire qu’il a, par la suite, bénéficié d’une majorité.
Je pourrais également vous renvoyer à un exemple d’une autre nature. Le président des États-Unis n’est pas élu au suffrage direct : son élection passe par celle des grands électeurs. Il peut même être élu avec une minorité de voix et une majorité de grands électeurs.
En France, le maire – j’ai exercé cette fonction – n’est pas non plus élu au suffrage direct. Il est, de fait, désigné par le conseil municipal, même si, je le reconnais, rares sont les cas où ce dernier n’a pas choisi comme maire le candidat tête de liste.
M. Manuel Valls, ministre. Il en va de même à Paris. Les électeurs votent par arrondissement, mais il y a bien une tête de liste.
M. Yves Pozzo di Borgo proteste.
Ce système est aussi le fruit d’une particularité. Paris est une très grande ville, avec ses arrondissements du centre, de l’ouest, ou encore les quartiers populaires de l’est. Cette diversité est bien réelle. On peut toujours réfléchir à un autre système, mais taxer celui qui existe de « stupide » n’a pas beaucoup de sens. Nous avons seulement profité de la censure du Conseil constitutionnel pour l’ajuster.
Nous n’avions, depuis le début, qu’un seul souhait : préserver l’élection de trois conseillers de Paris par arrondissement. Nous aurions peut-être dû nous y prendre autrement et commencer par le texte qui vous est présenté ce soir. C’est par ces méandres relativement sinueux, et finalement si parisiens, que nous arrivons à ce résultat.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
(Non modifié)
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
Désignation des secteurs
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges
1er secteur
1er
2e secteur
2e
3e secteur
3e
4e secteur
4e
5e secteur
5e
6e secteur
6e
7e secteur
7e
8e secteur
8e
9e secteur
9e
10e secteur
10e
11e secteur
11e
12e secteur
12e
13e secteur
13e
14e secteur
14e
15e secteur
15e
16e secteur
16e
17e secteur
17e
18e secteur
18e
19e secteur
19e
20e secteur
20e
Total

J’anticipe les débats, nécessairement brefs, qui vont avoir lieu sur les amendements déposés et sur la controverse qu’ils ont fait naître, dont nous avons eu un aperçu dans la discussion générale. Mon intervention se propose de défendre l’article 1er et, plus globalement, la présente proposition de loi. À mon sens, en effet, celle-ci est absolument nécessaire.
Disons-le, les réactions de l’opposition ne sont ni tout à fait justes ni parfaitement franches. L’ajustement proposé s’explique par les évolutions démographiques, ainsi que par une volonté de maintenir les équilibres voulus par le législateur dès 1982, aussi bien pour ce qui a trait à la représentation des arrondissements que pour le recours à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Cet ajustement, donc, est le fruit de la nécessité.
Cette nécessité, d’ailleurs, est non seulement technique, mais aussi démocratique. Il s’agit de perpétuer un principe simple, même quand l’organisation territoriale est complexe : « Un homme – ou une femme –, une voix ». Cette voix doit peser du même poids, quel que soit l’endroit où cet homme – ou cette femme – habite à Paris.
Il était nécessaire de bouger. Cette modification n’aurait donc pas dû porter à polémique. S’il n’y avait pas eu d’arrière-pensées politiques, un consensus presque total aurait pu se dégager au Sénat. Je constate, d’ailleurs, que personne n’a remis en cause ce même système pour Lyon et Marseille, ni soutenu qu’il était « absurde ». Les mots désagréables prononcés ce soir n’ont pas été entendus pour ce qui concerne ces villes.
Le Conseil constitutionnel a sanctionné une partie du précédent projet de loi sur le sujet. Vous ne pouvez pas, sur cette base, faire le procès du Gouvernement ou de la majorité. M. le ministre l’a rappelé, l’idée était de préserver l’élection de trois conseillers de Paris par arrondissement – c’est le cas depuis 1982 –, y compris dans les plus petits d’entre eux, parmi lesquels figure, d’ailleurs, le Ier arrondissement, détenu depuis longtemps par M. Legaret. Il a donc fallu introduire une légère correction pour ces territoires.
Ce souci n’est pas nouveau : on le voit aussi à l’œuvre, par exemple, pour les élections sénatoriales, où l’on tente de concilier les exigences démographiques avec l’exigence de représentation des territoires, même quand ils ont peu d’habitants. Cette intention était louable ; vous auriez pu l’applaudir. Ne l’avez-vous pas toujours fait, d’ailleurs ? Cette situation existe depuis 1982, et vous n’avez rien changé, alors que vous avez été plusieurs fois au pouvoir.
Vous vous saisissez donc de ce sujet parce que les élections ont lieu dans un an. Vous considérez qu’il faut faire de Paris une sorte de grande circonscription, au sein de laquelle une vaste bagarre éclaterait, menée par celle qui devait sauver la droite, essentiellement, d’ailleurs, grâce à sa notoriété ; elle ne peut pas, en effet, faire valoir pour ce faire son implantation et sa connaissance des dossiers parisiens…
Votre volonté est donc d’adapter la circonscription au profil de votre candidate. Toutefois, ce n’est pas comme cela que cela se passe, chers collègues ! À Paris, il y a des forces politiques, des associations, dont l’histoire se confond avec celle des arrondissements. Elles ont, même dans la capitale, un rapport de proximité avec les habitants. On croit que le sort de la ville se joue dans les journaux. Non, il se décide dans les cages d’escalier, sur les marchés, dans la vie quotidienne. La bataille, mes chers collègues, ne se gagne pas avec des parachutes !
Le système de la circonscription unique est la seule chose que vous nous opposez. De grâce, un peu de sérieux ! Imaginez un système dans lequel, pour cinquante élus, les quarante premiers de liste seraient tous habitants du XVIe arrondissement, par exemple. Quelle belle représentation de Paris ! Elle serait, selon vous, fort démocratique. L’exemple vaudrait aussi avec des habitants du XXe arrondissement, où j’habite, mais ce n’est pas le système que je propose, alors même que j’en connais d’avance le résultat. La représentation de l’ensemble des arrondissements doit donc toujours être possible.
M. le ministre a raison, toutes les villes de France élisent leur maire via leur conseil municipal. Cela paraîtrait incongru de ne pas élire celui qui était premier de liste. Donc, cela n’arrive pas.

À Paris, il paraîtrait complètement déplacé d’élire une autre personne que la tête de liste, qui a mené la bataille électorale, qui est de la même tendance politique et qui peut avoir une majorité derrière lui. Ce serait un hold-up démocratique que personne n’oserait faire, pas plus à Paris qu’ailleurs.
La cause est donc entendue : des raisons uniquement politiciennes, s’expliquant par la proximité des élections, vous poussent à entretenir ce débat. Toutefois, le procès en charcutage ne tient pas.

M. David Assouline. Quand vous étiez au pouvoir, quand vous dirigiez la ville de Paris comme le pays, vous avez toujours validé le système de la proportionnelle et de la représentation des arrondissements. Aucun d’entre vous ne s’est élevé pour dire qu’il n’était ni démocratique ni représentatif.
Mme s Bariza Khiari et Mme Hélène Lipietz, ainsi que M. Philippe Kaltenbach applaudissent.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par M. Charon.
L’amendement n° 3 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 261 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;
2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé ;
3° Après l’article L. 272-1, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris
« Art. L. 272 -1 -1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.
« Art. L. 272 -1 -2. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir de sièges de membres du conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d’arrondissement.
« Art. L. 272 -1 -3. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 272-1-2.
« Art. L. 272 -1 -4. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. » ;
4° Les articles L. 272-2 à L. 272-6 deviennent la section 2 intitulée « Dispositions applicables à Lyon et à Marseille » ;
5° À l’article L. 272-3, aux première et seconde phrases de l’article L. 272-5, par deux fois au premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2511-8, il est inséré un article L. 2511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511 -8 -1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d’arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris annexé au présent code. » ;
2° Après l’annexe I, est insérée une annexe II ainsi rédigée :
« Annexe II
« Tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris
Arrondissement
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
Total
3° Après l’article L. 2511-25-1, il est inséré un article L. 2511-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511 -25 -2. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.
« Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement.
« L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.
« Les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »
La parole est à M. Pierre Charon, pour présenter l'amendement n° 1.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 3.

Cet amendement a été défendu.
Je tiens simplement à dire quelques mots à M. Laurent. Dans cet hémicycle, cher collègue, vous êtes le représentant de la Commune de Paris. Ce sont les Versaillais qui l’ont supprimée. Pourtant, la loi de 1975, qui donne un maire à Paris, a été adoptée grâce à la droite versaillaise et à Valéry Giscard d’Estaing.
Depuis lors, cependant, le maire n’est toujours pas élu par les habitants de Paris. M. Assouline prétend qu’il s’agit d’un scrutin de liste, comme dans toutes les autres villes. Les habitants d’une commune comme Montpellier ou Colmar se prononcent pour une liste, en tête de laquelle figure le nom de celui qui sera leur maire, même si, formellement, ce sont les conseillers municipaux qui élisent ce dernier. Il n’empêche, l’électeur de Colmar ou de Montpellier aura bien voté pour son maire.
À Paris, en revanche, tel n’est pas le cas. Monsieur Laurent, vous êtes le représentant de la Commune de Paris et du courant de pensée qui s’en inspire. Vous devriez donc soutenir le présent amendement, qui tend à rendre aux Parisiens la possibilité d’élire leur maire !
M. Pierre Charon applaudit.

Comme je l’ai indiqué à la tribune, et comme l’a fort bien rappelé M. le ministre, on ne bouleverse pas un système électoral à huit mois du scrutin. En outre, ce sont de faux arguments qui sont mis en avant : aucune commune de France n’élit son maire au suffrage universel.
J’ai été candidat tête de liste d’arrondissement à Paris à quatre reprises. J’ai la modestie de penser que le candidat affiché à la mairie de Paris issu de mon camp politique a apporté sa notoriété à cette liste et que les jeux étaient faits d’avance.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. Manuel Valls, ministre. Monsieur Pozzo di Borgo, quand on est centriste et que l’on se revendique de ce courant de pensée, on a, vous avez raison, deux références : la première est Valéry Giscard d’Estaing, certes. Toutefois, la seconde est Jean-Claude Gaudin
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC.
Il était auparavant à l’UDF, et il a joué un rôle très important car, en 1987, en tant que maire de Marseille, il a présidé, avec, j’imagine, une certaine influence sur le gouvernement de l’époque, au redécoupage de cette ville. Or il ne lui est pas venu à l’idée d’anticiper ce projet de très grande qualité que vous présentez avec conviction.
M. Assouline le rappelait, trois villes sont organisées ainsi, certaines avec des arrondissements, d’autres avec des secteurs. On peut en débattre, mais elles présentent toutes cette spécificité.
Je ne dis pas que l’on ne pourra pas un jour reprendre à nouveau ce débat devant l’Assemblée ou le Sénat. Toutefois, à quelques mois des élections municipales, il faut s’en tenir à ces éléments démographiques et ne pas fustiger le système. Vous ne ferez croire à personne que les Parisiens, les Marseillais ou les Lyonnais ne savent pas pour quel conseil municipal ils votent. Cela a forcément des conséquences sur le vote dans chaque arrondissement, d'ailleurs. Nous le voyons bien, aujourd'hui, dans la préparation des élections municipales de Paris.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Chers collègues de l’opposition, je suis surprise par ces amendements identiques : d’un côté, vous nous reprochez de vouloir modifier les règles du jeu, alors que nous ne faisons qu’adapter le mode de scrutin à la démographie parisienne, qui a bien changé en quelques décennies ; de l’autre, vous proposez un amendement qui, pour le coup, tend à opérer une réelle mutation des conditions d’élection du conseil de Paris.
À moins d’un an des élections, vous voulez changer en profondeur les règles du jeu. La Parisienne que je suis tient cependant à s’inscrire en faux par rapport à ce qui constitue une négation des arrondissements. Le système actuel, vous le jugez complexe aujourd’hui, mais vous ne teniez pas le même discours hier ou avant-hier. On peut s’interroger !
Les Parisiens, je le rappelle, sont attachés à leur arrondissement et à sa juste représentation. Il me semble donc problématique de vouloir remettre en question le mode de scrutin, tel que vous le souhaitez, à si brève échéance des élections.
Néanmoins, je comprends bien, chers collègues, que vous relayez une revendication de la candidate maire de Longjumeau, parachutée à Paris, qui souhaiterait se faire élire sur ses trois initiales, sur sa notoriété, comme l’a dit David Assouline, comme une marque finalement !

Or Paris est une ville complexe, qu’il faut bien connaître et dont il est nécessaire de saisir la spécificité. Les Parisiens revendiquent avant tout la proximité et souhaitent voter pour ceux qu’ils connaissent et s’occupent d’eux.

Le mode de scrutin actuel n’est pas récent, puisqu’il a même permis l’alternance en 2001. La victoire ne repose nullement sur une arithmétique quelconque, mais se fonde sur l’adéquation entre un candidat, un projet et une aspiration populaire.
On prend le scrutin tel qu’il est et l’on fait en sorte de convaincre les Parisiens de soutenir le mouvement. C’est ce qui s’est passé en 2001 et lors du scrutin suivant. Aussi, chers collègues, ne venez pas mettre un échec possible sur le compte d’un mode de scrutin qui est suffisamment ancien pour avoir fait la preuve de son efficacité et de sa pertinence. Les Parisiens ne comprendraient pas que l’on change profondément les règles du jeu en cours de partie. Ce sont les mêmes. Simplement, elles prennent mieux en compte la démographie de la capitale, ce qui n’est que justice.
En conséquence, le groupe socialiste ne votera pas les amendements visant à créer une circonscription unique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Nous allons voter contre ces amendements identiques, mais je ferai deux remarques au préalable.
Tout d’abord, prétendre que le maire de Paris n’est pas élu par les Parisiens n’a pas beaucoup de sens.

Je n’évoquerai même pas les autres communes. Parlons seulement du système parisien : chaque Parisien qui vote aux élections municipales en soutenant sa liste d’arrondissement sait parfaitement pour qui il se prononce.
Je connais bien Paris, une ville où je suis né et où je vis depuis toujours. Prétendre que ses habitants ne savent pas qu’ils auront à choisir, lors de la prochaine élection, entre Anne Hidalgo et d’autres candidats est parfaitement ridicule. Aucun Parisien, aucune Parisienne ne peut prendre au sérieux un tel argument.
Par ailleurs, monsieur Pozzo di Borgo, vous évoquez la Commune de Paris qui, effectivement, m’est chère. À la suite de cet épisode, vous avez raison, les Parisiens ont été punis par la droite versaillaise et ses héritiers, puisqu’il n’y a plus eu de maire de Paris durant quasiment un siècle, et ce afin de faire payer à la population de la ville ses traditions progressistes et révolutionnaires.
Je vous suis reconnaissant d’avoir évoqué cette tradition, puisque l’une des originalités de Paris est précisément que les communistes, qui en sont les héritiers, y disposent d’une représentation importante, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup de capitales du monde. C’est donc un élément qui m’importe beaucoup.
Toutefois, vous semblez mal connaître la tradition communarde, car, s’il est une chose qui lui est bien étrangère, c’est l’obsession de la personnalisation.

Je rappellerai une seule des mesures auxquelles tenaient les Communards, à savoir la révocabilité des élus, qui est l’exact contraire de la personnalisation actuelle de la vie politique.
En ce qui concerne Paris, nous avons toujours allié deux conceptions d’un même mouvement : nous sommes attachés à la fois à l’unicité de cette commune et au développement de la démocratie de proximité. La ville repose sur ces deux piliers. Elle est en même temps une grande capitale – de ce point de vue, nous tenons à son unicité – et une commune proche de la vie de ses habitants, grâce aux mairies d’arrondissement auxquelles les Parisiens sont extrêmement attachés – je le répète, car vous semblez l’ignorer.
À l’époque de la Commune, on parlait plus de quartiers que d’arrondissements, et ils comptaient beaucoup. C’était le cas de Belleville et de Ménilmontant, pour ne parler que de ceux que je connais le mieux, puisque ce sont les miens. Toutefois, nous pourrions en évoquer bien d’autres, dans le XIIIe ou le XVIIIe arrondissement. Peut-être que cela ne se voit pas de loin, mais les Parisiens sont profondément attachés à la vie de village qui existe dans leurs quartiers.
Si nous voulons garder Paris et développer son âme dans ce qu’elle a de meilleur, nous devons donc préserver l’unité de la ville tout en maintenant cet enracinement de proximité dans les quartiers. Par conséquent, si nous devions, à l’avenir, penser des évolutions – nous pouvons en effet imaginer faire évoluer la vie démocratique parisienne –, plutôt que d’aller dans le sens que vous souhaitez, je proposerai de renforcer encore le pouvoir des maires d’arrondissement.

En effet, vous avez dit une chose vraie, mon cher collègue : le maire de Paris a beaucoup de pouvoir, les maires d’arrondissement en ont peu.

M. Pierre Laurent. Un meilleur équilibre ne nuirait pas à l’unité de la ville. Au contraire, il permettrait de développer la vie démocratique et la proximité avec les Parisiens.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC . – Mme Bariza Khiari applaudit également.

Naturellement, je soutiendrai ces amendements identiques, en toute solidarité, et bien que je sois de province. À cet égard, il est positif qu’il y ait dans cet hémicycle un certain nombre de collègues de province, car il est toujours intéressant de relativiser.
On dit que la ville de Paris est la plus belle capitale du monde, et les vocations ne manquent pas pour faire partie du conseil de Paris, ce qui se comprend et qui est tout à fait légitime. Pour les collègues qui représentent de petites communes, la situation est très différente. D’un territoire à l’autre, on passe d’un extrême à l’autre.
Dans leurs interventions, certains de nos collègues ont évoqué la récente loi sur le binôme des conseillers départementaux.

J’en profite donc pour dire que, même si je respecte le vote démocratique, je ne suis pas convaincu de la pertinence de ce binôme. Quant au redécoupage des cantons qui sera fait, nous verrons comment les choses se passeront.
Je soutiendrai les amendements identiques de nos collègues, par solidarité, car je pense que les charcutages – le terme a été évoqué – ne datent pas d’aujourd’hui. Ils ont existé de tout temps. Pour toutes les réformes électorales, qu’elles aient été faites par la droite ou par la gauche, il y a toujours eu des calculs. Sont-ils légitimes ? On peut penser que nous sommes tous calculateurs à un moment ou un autre.
À chacun son interprétation, mais, ensuite, laissons jouer la démocratie. Du reste, les futurs conseillers de Paris auront à servir l’intérêt général.
Je soutiendrai les amendements identiques de mes deux collègues.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « parmi les membres du conseil municipal » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.


La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 4.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 2 est adopté.
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Ce texte sera voté ce soir sans trop de difficultés. Toutefois, je veux le souligner, si cette proposition de loi vise Paris, son objet ne se résume pas à cette ville. Je suis très heureux que nos collègues du groupe CRC votent ce mode de scrutin, puisque c’est probablement celui qui, demain, s’appliquera dans les métropoles. C’est donc une conversion, certes tardive, mais bien réelle, en faveur des métropoles de demain !

Monsieur Mercier, vous convenez donc que les maires des communes deviendront des maires d’arrondissement des métropoles. C’est bien de le reconnaître !

Naturellement, ma chère collègue, c’est ainsi que cela se terminera. Il faut le dire !

On peut toujours, il est vrai, critiquer ce mode de scrutin et craindre que, au moment du découpage et de l’attribution des sièges par arrondissement, il n’y ait quelque machination. Le découpage électoral est un sport national en France. Nous nous y complaisons et nous essayons tous d’être les meilleurs en la matière.

Permettez-moi d'ailleurs de dire ce que je veux, cher collègue.
Il est vrai que les Parisiens, comme les Lyonnais et les Marseillais, n’élisent pas tous leur maire. Mes chers collègues, puisque vous en êtes au choix des candidats, je vous conseille de faire comme les Lyonnais il y a quelques années : pour que tout le monde vote pour lui, Louis Pradel, qui est resté maire pendant près de vingt ans, avait investi ses listes d’arrondissement sous une étiquette reprenant les initiales de son nom : « Pour la Réalisation Active des Espérances Lyonnaises ». Avec les noms d’Hidalgo ou de Kosciusko-Morizet, c’est moins facile, je le reconnais !
Sourires.

Plus sérieusement, je retiendrai du débat sur le texte qui nous est soumis ce soir, l’affirmation très claire par le Conseil constitutionnel de règles nouvelles auxquelles il faut nous habituer. Ce soir, nous œuvrons pour Paris. Nous aurons l’occasion de faire de même demain, peut-être pour Marseille ou Lyon, en tout cas pour les métropoles. C’est une conception du droit qui doit entrer dans nos mœurs.
Nous devons bien être conscients des nouvelles règles du jeu : l’idée de la souveraineté absolue du Parlement en matière électorale a disparu. C’est le Conseil constitutionnel qui nous impose aujourd'hui d’adopter des dispositions pour garantir le respect de principes établis par lui. Certes, il n’est jamais facile pour des parlementaires d’admettre la perte de leur pouvoir de légiférer à leur guise. Toutefois, cette réalité ne date pas d’aujourd’hui.

Ce que l’on appelle « l’État de droit » progresse chaque jour ; il n’y a plus de parlementarisme absolu. On peut s’en réjouir ou le déplorer, mais, en tout état de cause, nous avons ce soir une illustration très concrète de la situation nouvelle de notre mode de production du droit.
En adoptant la présente proposition de loi, nous entérinons une position que le Conseil constitutionnel a exprimée avec beaucoup de force. Et ce qui vaut aujourd'hui pour le tableau des conseillers de Paris vaudra, demain, pour tous les découpages électoraux. Ce sera tout de même une sacrée nouveauté dans notre pays !

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’excellente proposition de loi que nous nous apprêtons à adopter ce soir répond à une décision du Conseil constitutionnel ayant invalidé non seulement le nouveau tableau de répartition des conseillers de Paris que la majorité proposait d’instituer, mais également la version qui figurait dans le code électoral depuis 1982, annulée pour cause de violation du principe d’égalité devant le suffrage.
Chers collègues de l’opposition, vous vous lamentez ce soir d’une invalidation que vous avez pourtant souhaitée et dont vous vous réjouissiez il n’y a pas si longtemps… Vous auriez tout de même dû vous douter qu’elle rendrait indispensables un nouveau texte et une nouvelle répartition.
Nous ne pouvons visiblement plus échapper longtemps à la réalité démographique. Nous sommes confrontés à la nécessité d’émettre rapidement de nouvelles propositions. Notre objectif n’est pas de réaliser un quelconque tripatouillage ou d’affaiblir électoralement l’opposition ; il s’agit simplement de nous conformer, notre collègue Michel Mercier vient de le rappeler, aux décisions du Conseil constitutionnel.
Je le signale d’ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré le tableau de répartition de 1982 en ciblant notamment les Ier, IIe et IVe arrondissements, qui, sauf erreur de ma part, sont tenus par l’opposition pour l’un d’entre eux et par la majorité pour les deux autres. Dans ces conditions, je ne vois pas bien comment l’opposition pourrait arguer d’une volonté délibérée de lui nuire. Nous sommes a priori concernés également pour deux arrondissements. Votre volonté de créer une circonscription unique me paraît un signe de fébrilité, chers collègues.
Certes, le Ier arrondissement de Paris perdra deux conseillers. Néanmoins, comme il n’est peuplé que de 17 000 habitants, il me semble difficile de légitimer le maintien de ces deux élus. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel ne l’accepterait pas ; nous avions souhaité conserver les trois conseillers d’arrondissement dans le précédent tableau et il nous l’a interdit, considérant que nous n’allions pas assez loin dans l’adaptation aux nouvelles réalités démographiques de Paris en conservant une représentation minimale par arrondissement. Dont acte.
Dès lors, le nouveau tableau prend en compte les évolutions démographiques de Paris, les nouvelles structures de la population, et il en tire les conséquences en termes de répartition du nombre de conseillers. Pour preuve, c’est bien la méthode de calcul de 1982 qui a été employée pour aboutir au tableau actuel. La majorité ne change donc pas les règles du jeu ; elle se contente de les faire appliquer réellement.
L’organisation administrative et politique de Paris est maintenue par un texte clair, transparent et conforme au principe d’égalité devant le suffrage : il n'y a pas d’augmentation du nombre global de conseillers de Paris et pas de modification de la composition des conseils d’arrondissement, ni de leur fonctionnement.
En conséquence, le groupe socialiste votera cette proposition de loi.

J’ai déjà indiqué que nous voterions ce texte. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec ce qu’a affirmé Michel Mercier à la fin de son intervention.
En tant que vieux républicain, j’estime qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de faire la loi, de même qu’il n’appartient pas à la Cour de comptes de dicter la politique économique et financière de la France. Cette instance vérifie l’exactitude des comptes, et le Conseil contrôle la conformité des lois à la Constitution. Point !
Que constatons-nous ? Traditionnellement, pour établir les découpages électoraux, on tient compte de deux critères de représentation : la spécificité des territoires et la démographie. À Paris, il n’y en a qu’un qui est valable. Encore une fois, le Ier arrondissement, par rapport aux autres arrondissements, ce n’est pas la Lozère par rapport à l’Hérault ! À Paris, il n’y a pas de spécificité du Ier, du IIe, du IIIe ou du VIIIe arrondissement. Par conséquent, appliquer à Paris le critère démographique, et seulement celui-ci, n’a rien d’extraordinaire ! Ce qui est surprenant, c’est qu’on ne l’ait pas fait auparavant.
Toutefois, en conclure, comme le font certains, que, pour le Conseil constitutionnel, il n’y aurait de toute éternité qu’un seul critère valable, c’est aller vite en besogne. À mon sens, si le Conseil a dit cela, il est sorti de son rôle.
Certes, je sais bien que la « démocratie » moderne consiste à remplacer les institutions élues, et singulièrement le Parlement, par des autorités nommées… Vous m’en excuserez, ce n’est pas ma tasse de thé. Encore une fois, en tant que vieux républicain, je ne suis pas de cette tradition. (

Tout à l’heure, ma remarque a semblé vexer M. Laurent.
Le problème est qu’il y a vingt arrondissements à Paris depuis 1983 et que la plupart des Parisiens s’adressent en premier lieu à leur maire d’arrondissement. Ce n’est pas comme dans les villes de province.
Prenons l’exemple du VIIe arrondissement, dont la population est comparable à celle de Colmar ou de Cannes. À Colmar, les habitants sont informés tous les jours dans les Dernières nouvelles d’Alsace de l’actualité municipale, de la vie associative locale ou des décès. Et c’est pareil à Cannes, avec Nice-Matin.
Or vous n’avez rien de tel dans les arrondissements parisiens, qui ont pourtant aussi une actualité municipale, des associations, des mariages, des décès… Ailleurs, le journal offre, en quelque sorte, une photographie de la vie locale ; chez nous, ce n’est pas le cas.
Il est vrai que les Parisiens s’adressent d’abord à leur maire d’arrondissement. C’est pour cela que j’ai employé l’adjectif « stupide » ; je ne stigmatisais pas des personnes en particulier, ni même le système en tant que tel. Convenez-en, il est un peu stupide d’être obligé de s’adresser à quelqu’un qui n’a aucun pouvoir. Lorsqu’un maire d’arrondissement est interpellé, il répond presque toujours : « Désolé, cela relève de la compétence de la mairie centrale. » Combien de fois l’avez-vous fait vous-même, monsieur Madec, vous qui avez été maire d’arrondissement ? Dans cette fonction, vous n’avez pas le pouvoir ! C’est un problème majeur à Paris.
Aussi, notre proposition de faire élire le maire de Paris au suffrage universel direct n’est en rien contradictoire avec la volonté qui est la nôtre de renforcer les pouvoirs des maires d’arrondissement. C’est à ces derniers, bien plus qu’au maire central, que les Parisiens s’adressent d’abord. Or le maire d’arrondissement n’a pas aujourd’hui compétence pour régler les problèmes qui lui sont soumis, ou alors seulement à la marge, par exemple pour l’attribution de places en crèche ou l’inscription dans les écoles primaires.
Mes chers collègues, vous qui êtes pour la plupart maires de communes de province ou de banlieue avez des pouvoirs dont les maires d’arrondissement ne disposent pas. Je le répète, c’est cela que je voulais signifier tout à l’heure en employant l’adjectif « stupide ». Il faudra bien que cela change un jour ou l’autre : on ne peut pas se satisfaire d’un système qui ne permet pas de prendre en compte la vie des Parisiens, et encore moins de répondre à leurs besoins.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.
La proposition de loi est adoptée.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 24 juillet 2013
À quatorze heures trente :
1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé (n° 172, 2012-2013) ;
Rapport de M. Yves Daudigny, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 775, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 776, 2012 2013).
À vingt et une heures trente :
2. Suite éventuelle de l’ordre du jour de l’après-midi.
3. Nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 (n° 799, 2012-2013) ;
Rapport de M. François Marc, fait au nom de la commission des finances (n° 800, 2012 2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.