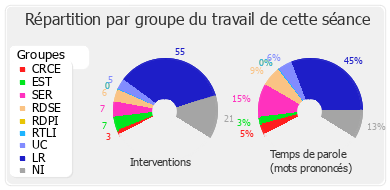Séance en hémicycle du 10 avril 2014 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer, dans la tribune d’honneur du Sénat, une délégation de quatre sénateurs du groupe d’amitié Jordanie-France du Sénat du Royaume Hachémite de Jordanie, conduite par son président, son excellence le docteur Chabib Ammari. §(Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
La délégation est en France pour une visite d’étude jusqu’au 15 avril, centrée sur l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables ainsi que le développement des échanges culturels et universitaires franco-jordaniens.
Elle se rendra également à Toulon, à Aix et à Marseille pour visiter le pôle de compétitivité « Cap Énergies » et le nouveau musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Accueillie au Sénat par notre collègue Mme Christiane Kammermann, présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Jordanie, la délégation a prévu ce matin une réunion de travail sur la transition énergétique avec nos collègues de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et rencontrera notre collègue Bruno Sido, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le Sénat français entretient d’excellentes relations de confiance et d’amitié avec le Sénat jordanien, nourries d’échanges sur le conflit syrien qui nous préoccupe tous, la paix au Moyen-Orient et le développement de nos partenariats économiques dans le domaine de l’eau et de l’énergie.
Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat jordanien une cordiale bienvenue, ainsi qu’un excellent et fructueux séjour. §

J’ai reçu avis de la démission de Mme Sophie Primas, comme membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et de celle de M. Michel Doublet, comme membre de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
J’informe le Sénat que le groupe Union pour un Mouvement Populaire a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger :
- à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en remplacement de Mme Sophie Primas, démissionnaire ;
- à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en remplacement de M. Michel Doublet, démissionnaire.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 279, texte de la commission n° 387 rectifié, rapport n° 386, avis n° 344 et 373).
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Monsieur le ministre, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui était attendu, car il est la pierre angulaire de la démarche « produisons autrement » que vous mettez en place depuis votre arrivée aux responsabilités. L’ambition de ce texte est, vous l’avez dit, de relever le défi de la compétitivité de notre agriculture et de notre filière bois tout en engageant la France sur la voie de la transition écologique. Ce ne sont pas des objectifs contradictoires, bien au contraire ; c’est là tout l’enjeu de votre projet d’agroécologie.
Ce projet de loi intervient également à la suite de la récente réforme de la politique agricole commune dans laquelle la France a beaucoup œuvré pour maintenir les crédits destinés à l’agriculture française, soutenir l’élevage et les petites exploitations qui sont les plus créatrices d’emploi, et encourager l’installation de jeunes agriculteurs : autant d’objectifs qui sont également portés par ce projet de loi.
Il était devenu indispensable et urgent de mieux prendre en compte les réalités économiques et de mener pleinement le combat pour la compétitivité de notre agriculture.
Le constat est là : nous héritons de dix ans d’inaction en la matière. En dix ans, notre pays est passé de la deuxième à la cinquième place mondiale en matière d’exportation agricole et agroalimentaire. Et que dire de l’état de nos filières et du nombre d’exploitations qui n’a cessé de diminuer ? On enregistre une baisse de 20 % à 25 %, selon les régions, entre deux recensements généraux de l’agriculture.
Le rapport de la mission d’information sur la filière viande que j’ai eu l’honneur de présider l’année dernière, rapport adopté à l’unanimité, a démontré que l’élevage français a perdu en dix ans de 15 % à 25 % de ses productions selon les secteurs. C’est un déclin très préoccupant et même dramatique dans les zones à forte production animale telles que la Bretagne. Pour chacune des filières, les chiffres sont inquiétants : 2 millions de porcs en moins ont été produits depuis le début des années deux mille, 44 % des poulets consommés sont importés, contre 8 % en 1990, et l’on constate en vingt ans une baisse de 20 % des effectifs du troupeau bovin et de 31 % du troupeau ovin.
La mission d’information a constaté que ces difficultés proviennent principalement d’un déficit de compétitivité de tous les maillons de la filière et d’une course au prix bas, encouragée par la grande distribution, qui écrase les marges de l’ensemble des acteurs de la production et de la transformation.
Cette situation dégradée que vous avez trouvée à votre arrivée démontre le peu d’efficacité des deux lois agricoles adoptées en 2006 et en 2010.
Notre pays doit réussir à conforter son excellence agricole et agroalimentaire dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel. Le présent texte ouvre des perspectives pour de nouveaux modèles de production plus diversifiés et une intégration optimale de l’écologie au service de l’agriculture et de la forêt.
Dans ce nouveau modèle de production, il faut également garder une exigence élevée de qualité, de garantie de sécurité sanitaire pour rassurer les consommateurs mais aussi pour prendre en compte leurs attentes plus sociétales. C’est l’enjeu du titre III de ce projet de loi qui vise à progresser en matière de santé végétale, de santé animale et de garanties de sécurité sanitaire de l’alimentation.
Le texte comporte des avancées en matière de lutte contre le développement du phénomène d’antibiorésistance. La logique de prévention s’impose : fixer un objectif ambitieux concernant les antibiotiques critiques constitue une bonne approche, mais il faut être vigilant à ne pas provoquer un effet destructeur sur le maillage des vétérinaires dont nous savons l’importance pour nos territoires ruraux.
Le texte introduit également des exigences plus fortes en matière de pesticides. Il promeut les méthodes alternatives, et notamment le biocontrôle. Je plaide néanmoins pour une accélération de la mise en place des solutions alternatives, car il y a urgence. En outre, il faut faire comprendre que cette démarche économe en intrants n’est pas celle de la contrainte mais a plutôt pour objectif d’améliorer l’efficacité et la performance économique. Je laisserai à Nicole Bonnefoy, rapporteur en 2012 de la mission commune d’information sur les pesticides, le soin d’en parler plus longuement.
J’en viens au titre V, qui traite des dispositions relatives à la forêt.
Ces dispositions permettent de donner à ce texte une véritable reconnaissance. À cet égard, je m’associe à ce qui a déjà été dit par M. le rapporteur Philippe Leroy sur l’importance de la forêt et la nécessité de développer une politique « forêts-bois » ambitieuse qui réponde aux attentes des professionnels. D’ailleurs, le texte s’inscrit déjà dans la continuité d’un ensemble de dispositifs mis en place par le Gouvernement en faveur de la filière, avec la création du comité stratégique de la filière bois, ou avec les mesures prises en lois de finances. Les dispositions de ce texte vont dans le bon sens et permettront de continuer à progresser.
Avant de les détailler, j’interviendrai brièvement pour rappeler la place de la forêt dans l’espace français, mais aussi son poids économique, avec plus de 400 000 emplois dont l’essentiel en zones rurales et 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Dans un contexte économique difficile, marqué également par la raréfaction des ressources fossiles, il devient essentiel d’optimiser la valorisation complète de cette ressource renouvelable en fonction de ses différentes utilisations : le bois d’œuvre, le bois d’industrie, le bois énergie ou biomasse forestière.
Toutefois, l’usage optimisé de cette ressource implique une hiérarchie des usages et repose pour une large part sur la capacité des acteurs économiques à créer les conditions d’une complémentarité entre les différentes utilisations du bois et à éviter les conflits d’usage.
Le bois énergie représente 65 % des énergies renouvelables produites actuellement en France, essentiellement par la valorisation des sous-produits de la filière bois ; mais encore faudrait-il s’assurer, lorsqu’un projet industriel est envisagé, que ses besoins en approvisionnement n’engendrent pas une surexploitation directe ou indirecte des ressources sylvicoles locales, régionales, voire nationales, et éviter les déséquilibres en tenant compte aussi des autres besoins d’approvisionnement de structures locales de moindre dimension.
Dans le même temps, nous connaissons bien le constat de l’insuffisante organisation de la filière bois, qui repose sur des petites entreprises, souvent fragiles, et les difficultés de la mobilisation de la ressource bois dans notre pays.
L’industrie de transformation du bois s’est affaiblie.
Le secteur de la scierie française, par exemple, est en recul sur les exportations de sciage qui, entre 2005 et 2012, ont baissé de près de 43 %. Le nombre de scieries a fortement diminué et la production de sciages a baissé de 10 % entre 2002 et 2011. Nous exportons des bois bruts et importons des bois travaillés, transformés, incorporant beaucoup de valeur ajoutée. Les chiffres de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la DGPAAT, relèvent que le déficit de la balance commerciale en meuble, principal responsable du déficit de la filière bois, a augmenté de 200 millions d’euros entre 2009 et 2010.
C’est bien notre paradoxe : nous avons l’une des meilleures ressources forestières d’Europe – la troisième forêt européenne –, et pourtant nous affichons un déficit record dans notre balance commerciale.
Notre forêt n’est pas suffisamment mise en valeur localement ; en témoignent les exportations de grumes vers la Chine. Or c’est ce potentiel économique qui doit être valorisé sur place.
L’aspect économique est donc un enjeu majeur. Dans ce cadre, l’instauration, dans la loi, du fonds stratégique de la forêt et du bois constitue une avancée fondamentale, car un tel organisme est le fondement de toute politique forestière.
La disparition du fonds forestier national, voilà plus de dix ans, a eu de graves conséquences amplifiées par les tempêtes successives qui ont découragé bon nombre de propriétaires forestiers de replanter.
Toutefois, monsieur le ministre, permettez-moi d’ajouter que, au-delà de la création du fonds stratégique, l’enjeu sera d’assurer la pérennité de ce dernier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a adopté la proposition du rapporteur de créer un compte d’affectation spéciale décrivant les recettes du fonds. Vous nous dites que ce n’est pas acceptable. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point.
La forêt, outre son potentiel économique, contribue activement à la préservation des équilibres écologiques, des écosystèmes et de la biodiversité, puisqu’elle stocke le carbone, purifie l’eau, enrichit les sols et offre des habitats propices à la faune et à la flore. Enfin, elle abrite une grande diversité d’activités, touristiques, cynégétiques, sportives, scientifiques, etc.
Le présent texte reconnaît pleinement cette multifonctionnalité des forêts, notamment de leurs fonctions d’intérêt général, et ouvre ainsi la possibilité de rémunération de ces aménités environnementales.
La reconnaissance par la loi est importante. Elle émet notamment un signal fort en direction de nos concitoyens, qui n’ont pas toujours conscience des atouts considérables que recèle la forêt, par la diversité de ses fonctions.
De surcroît, ce projet de loi réorganise la gouvernance dans ce domaine. En particulier, le programme national de la forêt et du bois, décliné à l’échelle régionale, permettra de partager des constats et de définir des priorités.
Chacun sait que la forêt française est très morcelée. L’objectif du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier est précisément de permettre le rassemblement de tous les professionnels concernés.
Monsieur le ministre, votre projet de loi va dans le bon sens. Il s’appuie sur une PAC réorientée et plus juste. Les membres du groupe socialiste le défendront et vous soutiendront avec conviction et détermination. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à remercier MM. les rapporteurs du travail qu’ils ont accompli : M. Didier Guillaume, M. Philippe Leroy et particulièrement M. Pierre Camani, qui n’a pas toujours eu la tâche facile, sans oublier Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
À mon tour, je m’associe aux marques de satisfaction exprimées hier quant à la reconduction de notre ministre de l’agriculture. Son propos liminaire a montré le niveau auquel il a placé sa mission, …

… qui est importante pour notre pays.
Ce projet de loi, qui compte vingt-neuf articles, doit nous permettre de concilier dans le domaine de l’agriculture les performances économiques, environnementales et sociétales. M. le ministre l’a souligné, en déclarant avec beaucoup de conviction que nous devions adapter l’agriculture française aux enjeux de demain ; nous avons beaucoup parlé du domaine de l’environnement à cet égard, mais il faut également conforter la filière agricole, qui représente un secteur stratégique pour la France et dont la contribution est très importante dans le domaine de l’emploi.
Je tiens à citer le département du Gers, …
Magnifique département !

… considéré comme l’un des plus agricoles de France : l’agriculture y représente 12 % des actifs.
Il faut également prendre en compte l’agroalimentaire. Dans cette région Midi-Pyrénées, que l’on connaît et reconnaît pour l’aéronautique, c’est le secteur agroalimentaire qui constitue le premier employeur. C’est dire combien nous sommes sensibles au présent texte.
Monsieur le ministre, avec ce projet de loi, vous encouragez des orientations de long terme, en proposant des nouveaux dispositifs ou des aménagements des outils existants. J’en évoquerai quelques-uns.
Le titre II porte une attention très nourrie à la préservation des terres agricoles et au contrôle des structures. Nos collègues députés ont enrichi les prérogatives des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, afin de freiner véritablement la déprise agricole. Personnellement, je partage cette volonté, d’autant plus que l’article 13 du projet de loi initial a bien clarifié les missions des SAFER tout en harmonisant le cadre de leur gouvernance. Cet instrument fondamental d’aménagement foncier se trouve ainsi renforcé, et son fonctionnement ouvert.
À la fin de ce même titre II, l’Assemblée nationale a introduit le répertoire des actifs agricoles. C’est une excellente mesure, très attendue par les organisations agricoles. Néanmoins, si la rédaction adoptée est relativement souple, elle n’intègre pas clairement les pluriactifs. J’ai donc déposé, avec plusieurs de mes collègues du RDSE, un amendement tendant à pallier cette lacune. Je sais que les rapporteurs sont très à l’écoute sur ce sujet. Nous devrions, je l’espère, parvenir à trouver le bon compromis.
En ma qualité de président de la commission du développement durable, je souhaite naturellement évoquer le volet environnemental, au titre duquel Pierre Camani a apporté une contribution très appréciée. Ce texte intègre, pour la première fois, l’agroécologie dans le domaine de la loi.
Sans doute la question des baux environnementaux fera-t-elle débat. Pour ma part, je souhaite qu’un équilibre soit trouvé entre le nécessaire encouragement à de nouvelles pratiques agricoles et le souci de ne pas bloquer la conclusion des baux. Ce point renvoie d’ailleurs à la question plus générale du statut du fermage, qui, à mon sens, mériterait certainement un large toilettage législatif.
Concernant les risques sanitaires, le transfert à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes focalise bien sûr beaucoup de discussions.

Il est certain que l’organisation actuelle n’est pas suffisamment réactive. Il était donc urgent de remédier à cette faiblesse. Ce projet de loi s’y attèle, et le droit de veto du ministre, proposé par la commission, répond à ceux qui s’inquiétaient du regroupement de l’évaluation et de la gestion des risques.
Enfin, je dirai un mot de la forêt. Bien sûr, j’ai beaucoup apprécié l’intervention que Philippe Leroy a consacrée à ce sujet, et je me félicite de l’important travail de planification opéré via ce projet de loi.
Mes chers collègues, vous connaissez mon attachement aux circuits courts et à la valorisation des produits agricoles locaux. Ce qui est valable pour la production agricole l’est aussi pour la production forestière. Il n’est plus acceptable que la France, qui possède la troisième forêt d’Europe, continue à importer massivement du bois ou des produits transformés à l’extérieur à partir de son propre bois. C’est pourquoi j’approuve les dispositions du présent texte qui permettront de mieux tirer profit du potentiel économique offert par notre forêt, tout en veillant au respect de l’apport vital de cette dernière à l’environnement. Je songe en particulier à son rôle pour le stockage du CO2, qui nécessite une politique active de reboisement, proposée via le présent texte.
Nous aurons l’occasion de débattre plus longuement de ces différents volets. Les sénateurs du RDSE apporteront leur contribution à travers les amendements qu’ils défendront dans cet hémicycle. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’avenir de notre agriculture est une question de fond. Cela a déjà été dit hier, l’agriculture française fait vivre des milliers d’hommes, en nourrit des millions d’autres, et la seule sphère agricole et agroalimentaire représente, pour notre pays, 12, 5 milliards d’euros d’excédent net à l’exportation.
J’attire votre attention sur le fait que, avec le verdissement de la PAC, le renforcement de l’agroécologie et le durcissement de l’encadrement administratif et des normes qui vont avec, nous risquons d’obtenir le contraire de ce que nous souhaitons.
Nous voulons des mesures qui permettent réellement aux entreprises agricoles et agroalimentaires de retrouver de la compétitivité et de la croissance pour faire face à nos concurrents européens, sans oublier, bien sûr, la protection de notre environnement.
Aurons-nous réellement les moyens, avec ce projet de loi, d’inverser la courbe déclinante sur laquelle se trouve notre agriculture depuis une quinzaine d’années ?

J’aimerais le croire. En tout cas, c’est une question vitale, notamment pour la filière élevage, qui me préoccupe particulièrement. Vous le savez, tous les chiffres la concernant sont en baisse : en vingt ans, diminution de 11 % du cheptel bovin, de 30 % du cheptel ovin, baisse de l’abattage des volailles… On observe un tel phénomène dans tous les domaines.
Le revenu annuel moyen d’un éleveur de viande bovine est de 15 000 euros, et les jeunes délaissent massivement le secteur de l’élevage pour se tourner vers des productions plus rentables, et surtout moins exigeantes en termes de présence. Or nos éleveurs doivent avoir des revenus suffisants pour vivre ! Aujourd’hui, 50 % des éleveurs bovins et 54 % des éleveurs ovins ont plus de cinquante ans : avec ce niveau de revenus et la pénibilité du travail, il est urgent d’agir pour favoriser l’installation des jeunes exploitants, entre autres via une simplification administrative.
La mise en œuvre, par l’article 14, d’un contrat de génération adapté à ce secteur va dans le bon sens, mais reste sans doute insuffisante.
J’ajoute, en cet instant, qu’il ne faut pas oublier tous les crédits nécessaires à la construction et à la modernisation des bâtiments d’élevage. Ces chantiers sont indispensables pour garantir aux éleveurs de meilleures conditions de vie.
Ce dont les éleveurs ont besoin, c’est de mesures concrètes améliorant réellement la compétitivité des entreprises comme, par exemple, l’alignement des contraintes sanitaires et environnementales françaises sur la réglementation européenne. J’ai déposé un amendement en ce sens.
Nos viandes présentent déjà les garanties les plus élevées au monde sur les plans sanitaire – on peut s’en réjouir –, environnemental et du bien-être animal. Il n’y a pas besoin d’en ajouter encore ! Nous ne pouvons plus subir toutes ces distorsions de concurrence. Il faut les réduire pour permettre aux agriculteurs de se battre à armes égales avec leurs concurrents allemands, italiens ou espagnols, sans parler d’un problème que vous connaissez bien, monsieur le ministre : celui de la main-d’œuvre employée en Allemagne, avec des salaires bien inférieurs à ceux de notre pays.
S’ajoute l’exonération de l’écotaxe poids lourds. Pour l’heure, celle-ci est suspendue, mais non supprimée. Elle reste une menace pour les éleveurs.
En outre, comment pourrons-nous bénéficier des allégements de charges ? Il n’en est question nulle part dans ce projet de loi !
Parmi les nombreux problèmes que rencontrent les éleveurs, je citerai encore trois exemples.
Premièrement, je pense au problème récurrent de la grande distribution qui, dans sa course au « toujours moins cher », fait le jeu de nos concurrents et écrase les prix de nos producteurs.
Deuxièmement, je songe aux prédateurs. Mis à part quelques collègues venant comme moi de régions de montagne, je me suis senti bien seul, pendant plusieurs années, à dénoncer dans cette enceinte la passivité des autorités face au loup et aux dégâts causés aux troupeaux ovins, qui provoquent un immense découragement chez les éleveurs. Pastoralisme et présence du loup sont incompatibles. C’est ce que je répète depuis dix ans ! Quand on pense que, au cours de l’année 2013, 6 767 ovins ou jeunes bovins ont été massacrés par les loups, on se demande où est le bien-être animal ! Il ne faut pas non plus négliger les traumatismes que les éleveurs ont pu subir.

… et recueillera, je le crois, l’unanimité. J’en profite pour remercier la commission du travail accompli en la matière.
Concernant les prédateurs, je ne peux manquer d’évoquer, pour ma région, le problème du lynx.

Ce dernier prend un essor qui devient lui aussi inquiétant. S’y ajoute, pour tous ceux qui ont des étangs, la question des cormorans, qui infligent de 250 à 550 euros de pertes à l’hectare.
Troisièmement, nos éleveurs doivent faire face à la pullulation des campagnols, surtout en zone de montagne, que ce soit dans le Jura, dans les Alpes ou dans le Massif central. Il s’agit là d’une véritable calamité dans les zones herbagères d’altitude. Les conséquences sont désastreuses : pertes de fourrages, problèmes sanitaires touchant les animaux et les hommes. Les pertes économiques peuvent atteindre de 10 000 à 25 000 euros par exploitation en Franche-Comté. Au cours de nos discussions, je défendrai un amendement tendant à accorder une déduction fiscale pour compenser les pertes de récoltes dues aux campagnols.
Pour conclure, je dirai quelques mots de la filière « bois ». M. le ministre l’a indiqué, elle représente un potentiel très important pour notre économie. Cette filière est tout à fait cruciale pour mon département, boisé à 45 %. Dans l’ensemble, elle a largement besoin d’être mieux valorisée, car des milliers d’emplois sont à la clef. Ce constat est admis sur toutes les travées de cet hémicycle.
Comme nombre de mes collègues, je me réjouis de la mise en place d’un fonds stratégique pour soutenir les investissements de ce secteur, à condition, bien sûr, qu’il soit suffisamment abondé. Ces crédits sont indispensables pour que puisse être envisagée la modernisation des exploitations et des coupes de bois, ainsi que l’amélioration des indispensables dessertes de nos massifs.
Une meilleure exploitation passe aussi par une diminution du morcellement forestier. J’insiste pour que, en cas de vente de parcelles de moins de quatre hectares, le droit de préférence soit réellement appliqué au profit d’un propriétaire riverain, ou, à défaut, de la commune si elle est acheteuse.
Je souhaite enfin que nous nous penchions, au cours de nos débats, sur le cas de nos territoires largement boisés, couverts de forêts à 70 %, voire à 80 %. Leurs habitants demandent que l’on y diminue les étendues forestières.
Notre agriculture, dans sa richesse et sa diversité, fait vivre notre tissu rural. Notre ruralité a besoin d’être soutenue et encouragée. Il faut des allégements plutôt que des contraintes. Je souhaite que les amendements déposés à cette fin soient votés. Ils vont du reste dans le sens des belles déclarations faites par les membres du Gouvernement qui, chaque année, se succèdent dans les allées du salon de l’agriculture !
Monsieur le ministre, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce projet de loi, comme nos rapporteurs. C’est pourquoi, après le travail parlementaire, ce texte doit réellement mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour l’avenir de notre agriculture, afin que la France produise plus et qu’elle produise mieux. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon propos, vous n’en serez pas surpris, portera sur l’enseignement agricole. Je dispose de quatre minutes de temps de parole et j’ai pourtant tellement de choses à vous dire, monsieur le ministre…
Les travaux préparatoires au présent projet de loi laissaient de bons espoirs, notamment pour l’enseignement agricole. Comme vous l’avez indiqué à l’occasion de la rentrée scolaire de 2013-2014, cet enseignement a une petite place en nombre d’élèves, mais un grand rôle à jouer car de nombreux atouts à faire valoir.
En effet, le Gouvernement affiche l’ambition de faire de la France le leader en matière d’agroécologie. Il s’agit de mettre tout en œuvre pour produire au mieux, en relevant un double défi : répondre à la demande mondiale en matière d’alimentation et respecter les écosystèmes, dans le cadre d’un développement durable reposant sur une moindre utilisation d’intrants, de pesticides, sur la préservation de la ressource en eau, sur la lutte contre le gaspillage du foncier, etc. Une prise de conscience des acteurs agricoles et de nombreuses évolutions techniques se sont accentuées au cours des dernières années, notamment depuis le Grenelle de l’environnement.
Ainsi, l’enseignement agricole, qui prépare les professionnels de l’agriculture, du monde rural et paysager de demain, devait retrouver toute sa place dans ce projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
L’Observatoire national de l’enseignement agricole, l’ONEA, présidé par l’ancien ministre Henri Nallet, a remis en 2013 un rapport intitulé L’enseignement agricole face aux défis de l’agriculture à l’horizon 2025. Ici, ont été imaginées et mises en forme de nombreuses idées et préconisations permettant d’inscrire la formation des futurs acteurs du monde rural dans une agriculture du XXIe siècle.
J’en espérais beaucoup… Pourtant, je ne retrouve pas dans ce projet de loi la quintessence de ce rapport très fourni ! Où sont les transcriptions des sept recommandations de l’ONEA : faciliter et valoriser l’implication des professionnels ; refonder le schéma prévisionnel national des formations ; prendre en compte les dynamiques de déconcentration et de décentralisation ; donner la priorité à la formation des enseignants, des formateurs et des cadres ; assurer la réussite de tous ; bâtir la maison des savoirs ; reconstruire la relation entre enseignements technique et supérieur ?
Ce rapport aurait pu être une source dense d’inspiration. Malheureusement, le projet de loi est passé à côté. Nous ne retrouvons pas d’avancées vers les cinq missions dévolues à l’enseignement agricole, qui constituent un atout essentiel pour l’agriculture du futur. Il manque également l’articulation de l’autonomie des établissements avec un pilotage et un cadrage national. Or l’enseignement agricole, qui présente un modèle de coopération entre un système productif et un système éducatif, mériterait une plus forte prise en compte et une implication des professionnels de l’agriculture et de leurs organismes.
En définitive, et je regrette vraiment de devoir faire ce constat, nous sommes face à un texte sans ambition, annonçant le rendez-vous manqué de l’enseignement agricole.

Tout ce qui devait permettre l’évolution de cette formation, afin d’être en parfaite harmonie avec les enjeux d’une nouvelle « révolution agricole », a été écarté.
Une nouvelle organisation ancrée dans les régions et les territoires, orientée vers des spécialisations et des voies d’excellence, impliquant tous les acteurs de la filière dans un même acte partenarial, n’a pas su être mise en œuvre dans ce travail législatif.
Un moment particulier, un texte spécifique prenant en considération la réalité des territoires et des acteurs aurait été perçu comme un signe encourageant, voire gratifiant, pour l’ensemble des établissements et des professionnels de cette formation. Mais seuls deux articles font référence à l’enseignement agricole, et cela, surtout, dans sa partie production.
Cette absence témoigne d’une conception idéologique de l’agriculture. Soumise aux exigences environnementales et adossée aux besoins en nourriture mondiale et en compétitivité internationale de la filière agricole, celle-ci souffrira de ne pas avoir formé les professionnels en devenir à ces questions agronomiques.
La recherche et les résultats techniques évoluent et continueront d’évoluer. Notre agriculture, qui fut la première d’Europe, requiert des techniciens, des ruraux préparés aux performances agricoles et agroalimentaires de demain. L’avenir économique de cette filière risque de se trouver fragilisé face à des concurrents européens et internationaux rompus à ces innovations et grignotant à nouveau des parts de marché.
C’est pourquoi, dans un but constructif et sans dogmatisme partisan, j’ai déposé plusieurs amendements aux articles 26 et 27, dont les principaux ont pour objet de répondre aux défis suivants.
Le premier objectif est de garantir un cadrage national des formations, tout en assurant une certaine autonomie aux régions, directement en lien avec les spécificités des formations et des débouchés professionnels de leurs territoires.
Le second objectif concerne l’association plus étroite que le monde éducatif agricole doit trouver avec les acteurs professionnels. Les échanges d’expérience et de connaissance des uns et des autres permettront un essor plus réactif et adapté aux contraintes réelles.
J’aurai l’occasion d’expliquer en détail mes propositions lors de la discussion des amendements précédemment évoqués.
Sachez, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que ces idées sont le fruit d’un travail de terrain de treize ans. C’est vous dire si ces propositions correspondent sincèrement aux attentes et aux réalités des structures de base, et pourraient constituer des avancées pour le développement et la structuration de l’enseignement agricole. De toute évidence, produire autrement implique de former autrement ! §
M. Didier Guillaume, rapporteur, applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quatre ans de cela, nous étions réunis ici pour examiner une loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ne comportant aucun article dédié spécifiquement aux outre-mer. Bien sûr, le dernier titre renvoyait toutes les dispositions concernant l’outre-mer à des ordonnances ultérieures et à une grande loi spécifique… qui n’aura jamais vu le jour !
Aujourd’hui, les choses ont changé, et c’est tant mieux ! Même si seuls quatre articles sont consacrés aux questions ultramarines, alors que nous pouvions espérer une loi qui leur serait dédiée, conformément aux orientations arrêtées par François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, dans le document intitulé Mes 30 engagements pour les outre-mers, nous sommes heureux d’avoir enfin l’occasion de participer aux débats sur un sujet aussi primordial pour nos territoires.
L’agriculture est l’un des trois piliers socio-économiques de nos régions, avec le tourisme et le secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP. Elle structure notre marché de l’emploi, influe sur notre écosystème et jalonne notre paysage.
Notre organisation actuelle garde des traces de l’histoire des relations entre la France et ses colonies. Les « îles à sucre », comme on les dénommait jadis, étaient spécialisées pour alimenter la métropole en produits tropicaux. La structure foncière a certes évolué depuis, mais insuffisamment à mon avis.
En outre, notre organisation est confrontée à des difficultés structurelles persistantes, liées aux caractéristiques de nos territoires. Il s’agit de la forte concentration des productions autour des filières traditionnelles – canne, sucre, rhum et banane –, de la petite taille des exploitations, de l’exposition à des risques naturels dévastateurs, de la dépendance aux approvisionnements extérieurs et de l’importance des surcoûts – intrants et engrais sont en effet très chers – et, enfin, de la très grande part de l’exportation au détriment des productions vivrières.
Ces spécificités ont toute une série d’effets défavorables, fragilisant les exploitants et empêchant le développement d’une agriculture moderne. L’État, les collectivités territoriales et l’Union européenne doivent continuer à préserver ce secteur, dans des territoires caractérisés par des taux de chômage très largement supérieurs à ceux qui sont enregistrés dans l’Hexagone.
L’enjeu aujourd’hui est de trouver notre place dans la carte de la mondialisation, tout en renforçant l’agriculture vivrière pour tenir compte des besoins propres de nos territoires.
Certaines orientations ont déjà été prises en ce sens. La diversification des activités agricoles participe à ce renouvellement et répond à la nécessité d’atteindre un niveau d’autosuffisance alimentaire. Des avancées notables ont été réalisées en matière d’élevage, en particulier de volaille, ou de productions à forte valeur ajoutée, comme les plantes aromatiques ou l’horticulture.
L’action de l’État doit également favoriser le soutien à certaines filières prometteuses, mais restant, pour le moment, secondaires. C’est le cas par exemple de la bagasse, résidu de la canne à sucre, qui a les mérites de produire de l’énergie renouvelable.
Les potentiels ultramarins, notamment dans le domaine de la biodiversité, sont aussi tout à fait remarquables, et nos territoires sont souvent pionniers dans des secteurs innovants, encore bien trop peu exploités.
Malgré ces pistes alternatives, les agricultures ultramarines font face à une situation d’urgence, directement induite par leur organisation. Les filières agricoles demeurent en effet cruellement sous-organisées – sauf à la Réunion – et la multiplicité des interlocuteurs ne permet pas de répondre de manière adaptée aux demandes du marché.
La structuration doit passer par la constitution d’interprofessions, formant une chaîne intégrée de la production jusqu’à la commercialisation. Pour y contribuer, j’ai déposé un amendement visant à imposer au préfet l’ouverture de négociations entre les organisations de producteurs pour constituer des coopératives professionnelles, mesures qui, aujourd'hui, ne sont qu’incitatives. Structurer les filières permettrait également de valoriser les démarches de qualité des productions agricoles ultramarines et de faire connaître leurs performances en matière sanitaire et environnementale.
La situation du foncier agricole est aussi inquiétante dans les outre-mer. Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt présente un certain nombre d’avancées sur le sujet, notamment par le renforcement des pouvoirs d’intervention des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, ou par l’alignement des conditions de reprise des terrains sur les normes en vigueur dans l’Hexagone.
Néanmoins, je tiens à préciser que la surface agricole utile diminue de façon préoccupante dans nos départements, du fait d’une très forte pression foncière ayant une incidence directe sur les chances d’installation des jeunes agriculteurs. Il y a là, monsieur le ministre, un véritable sujet : si nous entendons relever les défis de l’agriculture ultramarine, il convient de mettre en place un véritable dispositif d’aide aux générations et, en premier lieu, de permettre l’accès des jeunes exploitants à des prêts bonifiés.
Aux difficultés structurelles que je viens d’évoquer, s’ajoutent de forts différentiels de compétitivité dans notre environnement régional. En outre, les effets pervers des accords commerciaux que l’Union européenne a passés avec les pays appartenant à cette zone constituent une menace supplémentaire pour nos productions locales.
Les dispositifs de compensation, qui, par définition, interviennent a posteriori, ne suffiront pas à sauvegarder ces filières en l’absence de dispositif régulateur en amont, permettant d’atténuer les effets dévastateurs de la concurrence de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales. Si nous laissons nos marchés locaux être inondés de produits à moindre coût issus de pays voisins, que deviendra notre agriculture ? Ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui sont ici mis en jeu !
Dans son combat contre la vie chère, le Gouvernement devrait considérer ces situations spécifiques dans lesquelles la grande distribution, de manière subtile, propose des produits dits « locaux » qui, en réalité, proviennent de la zone caribéenne voisine. C’est là tout l’effet pervers des accords commerciaux entre l’Union européenne et les pays d’Amérique latine ou de la zone Caraïbe, et cela engendre une concurrence déloyale, mettant en difficulté la production martiniquaise. Ces accords créaient déjà des difficultés structurelles au niveau des productions traditionnelles, telles que la banane ou le rhum, et nous voilà maintenant atteints sur nos propres marchés, sur nos produits vivriers.
Si l’adoption du texte dont nous commençons l’examen aujourd’hui permettra, j’en suis certain, des avancées en matière de développement économique agricole, nombre de mesures devront encore être adoptées par voie d’ordonnance ou relèveront du niveau réglementaire. Espérons que ces prochaines étapes soient l’occasion d’une réflexion répondant, de manière plus complète, à la situation d’urgence à laquelle font face nos agricultures ultramarines !
Je regrette également que la question des produits phytosanitaires n’ait pas été abordée sous l’angle spécifique des outre-mer. Alors que les Antilles françaises ont subi les conséquences dramatiques de l’utilisation massive du chlordécone, produit qui, en plus de tout, s’est révélé inadapté à nos réalités environnementales, je souhaite que le Gouvernement prenne ici l’engagement d’entamer un processus de coopération régionale, avec, par exemple, le Brésil pour la zone Atlantique ou l’Afrique du Sud pour la zone de l’océan Indien, dans le but de développer une recherche-développement en matière agronomique adaptée aux spécificités locales.
Dans les années à venir, le Gouvernement devra continuer à accompagner les outre-mer, avec une juste vision des réalités les définissant. Comme vous l’avez justement mentionné, monsieur le ministre, la prise en compte des contraintes et des spécificités de nos territoires, notamment par les instances européennes, est l’un des défis que l’État français devra relever pour permettre aux outre-mer de trouver leur place dans la compétition internationale et de développer leurs atouts.
Dans une économie mondialisée, dont la France accepte les règles, tout doit être fait pour sauvegarder et propulser l’agriculture ultramarine, ainsi que le modèle social et environnemental qui est le sien, et ainsi répondre aux besoins des populations. §

Monsieur le président, mes chers collègues, je m’associe à tous les compliments qui ont été formulés envers la commission et ses rapporteurs ainsi qu’aux félicitations qui ont été adressées à M. le ministre pour sa reconduction à la tête du ministère de l’agriculture.

En effet !
Monsieur le ministre, nous examinons un texte ambitieux destiné à renforcer la performance de l’agriculture, un secteur essentiel à la fois à la croissance et à l’équilibre territorial de notre pays.
Dans le projet de loi modifié par la commission des affaires économiques, cette performance est placée sous le signe d’un triple défi : économique, environnemental et social. Il s’agit – vous l’avez dit, monsieur le ministre – de garantir la viabilité des exploitations agricoles, de prémunir ces dernières contre la volatilité des marchés et les risques climatiques et, en outre, de contrôler le foncier rural.
L’aval de la production est aussi une préoccupation forte que nous retrouvons dans plusieurs articles du texte. L’impératif alimentaire, dans sa dimension tant nationale qu’internationale, est également une préoccupation importante. J’en suis plus que convaincu : les enjeux de l’alimentation, en termes sanitaires, mais aussi en matière d’innovation, obligent à encourager, d’une part, la vigilance pour ce qui concerne la santé, et, d’autre part, l’investissement, s’agissant de la recherche.
Pour réaliser tous ces objectifs, plusieurs dispositions nous sont proposées. Certaines tendent à mieux structurer ou à renforcer des outils existants, d’autres introduisent de nouvelles formes de coopération, dans la perspective de mieux mobiliser et valoriser la production agricole ou forestière. Je pense à ce sujet, en particulier, à la véritable nouveauté de ce texte : le groupement d’intérêt économique et environnemental, le GIEE, instauré à l’article 3. Ainsi que cela a été dit, il s’agit de mettre en place un cadre juridique souple destiné à faire converger des démarches agroécologiques.
Cette initiative est intéressante sur le principe comme dans sa mise en œuvre. Le groupement devrait recueillir l’adhésion de nombreux agriculteurs qui ont déjà un sens aigu de l’entraide. À travers les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole, les CUMA, ou les groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, les exploitants savent déjà s’associer intelligemment pour optimiser leur fonctionnement ou leur développement.
Le GIEE et le GIEEF, pour la forêt, sont orientés vers l’agroécologie, ce qui est nécessaire compte tenu des impératifs environnementaux. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, qui commande le verdissement des aides directes.
Comme vous le savez, mes chers collègues, les droits à paiement sont de plus en plus conditionnés même si les États membres disposent d’une certaine flexibilité à l’intérieur de leur enveloppe PAC. La prise en compte du réchauffement climatique est donc une obligation, mais, comme le dit l’adage, « point trop n’en faut » ! S’il est important d’orienter les pratiques agricoles dans le bon sens, il n’est pas souhaitable de le faire à marche forcée, au risque de fragiliser certains équilibres économiques.
Il nous faut donc, monsieur le ministre, rester vigilants sur ce point. C’est pourquoi je suis un peu réservé quant à la généralisation poussée du bail environnemental. Nous aurons l’occasion d’en discuter durant les débats.
S’agissant de l’important volet consacré au renforcement de la maîtrise du foncier et de la protection des terres agricoles, je ne suis pas surpris, monsieur le ministre, que vous ayez placé l’objectif très haut. C’est une bonne chose. Parmi les principaux leviers d’intervention, vous avez naturellement porté votre attention sur les SAFER et le contrôle des structures.
Concernant les SAFER, l’Assemblée nationale a ouvert encore un peu plus leur droit de préemption. Cette très forte prérogative de puissance publique est parfois – je tiens à le souligner – difficile à concilier avec le respect de la propriété privée rurale. L’extension des moyens des SAFER ne pose pas de problème en soi, pourvu que l’opérateur reste centré sur ses missions originelles.
Or l’agriculture a évolué dans son organisation, sans qu’aient été redéfinis dans le même temps le rôle et les prérogatives des SAFER. C’est pourquoi, avec plusieurs de mes collègues de la commission des finances, nous avons émis des recommandations dans un récent rapport sur les outils fonciers. Nous avons suggéré, par exemple, de « recentrer les compétences des SAFER sur leur cœur de métier et encadrer davantage les pouvoirs coercitifs dont elles disposent. ».
Il ne s’agit pas de jeter le soupçon sur les SAFER. En effet, que resterait-il aujourd’hui de surface agricole sans leurs interventions ? Toutefois, l’augmentation de leurs pouvoirs doit s’accompagner d’une certaine transparence quant à leur fonctionnement. Cela correspond d’ailleurs à une des recommandations de la Cour des comptes sur ce sujet. Je suis heureux de constater, monsieur le ministre, que vous avez retenu plusieurs de nos propositions dans ce projet de loi. Je ne citerai que la rationalisation de la gouvernance des SAFER, judicieusement améliorée.
Je dirai un mot concernant le contrôle des structures : je ne suis pas partisan des mesures qui rendraient trop complexe l’élaboration des documents d’urbanisme pour les élus locaux. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la discussion des amendements. §
Monsieur le ministre, je partage l’économie générale du texte qui consiste à donner, pour l’avenir, les moyens à tous les acteurs du monde rural de faire plus en faisant mieux. Nous espérons convaincre la Haute Assemblée d’approuver plusieurs amendements, afin de pouvoir voter avec plus de conviction et de sérénité cet excellent projet de loi ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crains que ce projet de loi, malgré ses ambitions affichées, ne réponde ni aux difficultés que traverse notre agriculture ni aux inquiétudes et aux attentes des agriculteurs et de la filière de transformation.

L’article premier déroule, sur le mode d’un inventaire à la Prévert, une succession d’objectifs pleins de bons sentiments, plus louables et consensuels les uns que les autres, …

… mais dont on ne voit aucune traduction juridique opérationnelle dans le corps du projet de loi.
Le Premier ministre émettait ici même, hier, le souhait d’une loi moins bavarde. Je crains que ce texte ne soit pas à la hauteur de ce vœu !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il le sera si l’on ne vote pas trop d’amendements !
Sourires

Assigner autant de finalités à la politique agricole et de l’alimentation, n’est-ce pas prendre le risque d’en faire un outil au service de causes contradictoires et bien éloignées du sujet, alors que, plus que jamais, on attendait l’affirmation de quelques principes et leur traduction concrète ?
Je ne vois également rien dans ce texte qui aille dans le sens du « choc de simplification » annoncé par le Président de la République. Bien au contraire, je découvre au fil des articles de nouvelles procédures, de nouvelles normes et de nouvelles contraintes, comme à l’article 20, ou à l’article 3, qui crée les groupements d’intérêt économique et environnemental. Aucune étude d’impact n’a d’ailleurs pu évaluer les conséquences de la création de ces nouvelles structures.
Aux articles 4 et suivants, l’obligation de déclaration sur les engrais azotés, l’obligation de déclaration préalable trois ans avant le départ en retraite et toutes les obligations accompagnant le bail environnemental imposent des contraintes supplémentaires pesantes pour les agriculteurs.
En somme, je ne trouve dans ce projet qu’un encadrement administratif plus strict et une complexification des démarches, alors que la simplification de l’exercice de leur activité ou de leur installation est une revendication récurrente des agriculteurs.
Dans le même ordre d’idée, l’extension des prérogatives des SAFER, dont vous faites des instruments d’intervention généraliste bien au-delà de leur objectif initial d’amélioration des structures, est porteuse de confusion. Vous vous inquiétez de voir se mettre en place des montages ou des procédures juridiques ayant pour effet de les contourner ; mais peut-être devriez-vous vous interroger sur les raisons qui conduisent les agriculteurs eux-mêmes à cela !
Dans notre droit, la règle est la liberté du commerce et des échanges, et la préemption doit demeurer l’exception, justifiée par l’intérêt général. Les nouvelles attributions que vous conférez aux SAFER ne manqueront pas de mettre en concurrence ces dernières avec les établissements publics fonciers régionaux, mais pourront également se retourner contre les agriculteurs eux-mêmes, pour qui le foncier représente souvent le fruit d’une épargne construite par le travail de toute une vie et dont ils peuvent souhaiter disposer à leur guise au moment de la retraite.
Je ne vois pas davantage de mesures qui pourraient, dans l’esprit du pacte de responsabilité, apporter une réponse aux questions de compétitivité des entreprises agricoles et agroalimentaires. La filière agricole est sans doute celle qui s’est mobilisée le plus pour réaliser des investissements motivés par des considérations ou des contraintes environnementales, certes souhaitables, mais sans effet sur l’amélioration de la rentabilité des entreprises. Je ne vois rien dans le texte qui participe d’un engagement à ne plus imposer aux agriculteurs et à la filière des contraintes supérieures à celles de nos partenaires européens.
Concernant ce chapitre de l’écologie, notre commission a su, fort heureusement, rééquilibrer le texte initial en rappelant que le développement durable reposait sur un triptyque, les éléments environnementaux, économiques, et sociaux devant être considérés à parts égales.
Je crains que la promotion des circuits courts et de l’agriculture biologique ne nous dispense de répondre à une question, toujours esquivée pour ne pas fâcher certains lobbies, et pourtant essentielle : celle du potentiel de production.

Si aucune évolution ni aucune diversification ne doivent être écartées, toutes les exploitations n’ont pas vocation à se restructurer vers les circuits courts et l’agriculture biologique, ne serait-ce que parce qu’il n’existe pas de marché correspondant, et qu’il faudrait alors renoncer à nos exportations.
S’agissant du potentiel de production, je ne connais pas d’agriculteur qui n’ait le souci de la préservation de son outil de travail, qu’est la terre, ni de son cadre de vie, qu’est son environnement.
Dois-je rappeler que la fermeture d’un abattoir en Bretagne a plusieurs causes, dont la première est une moindre compétitivité, due aux charges et à l’excès de réglementation qui pèsent sur l’entreprise, mais qu’elle s’explique aussi par la diminution du nombre d’animaux à abattre ? Depuis dix ans, le pouvoir régional n’a eu de cesse de conditionner ses aides à la diminution du potentiel de production, sans pour autant l’avouer. Pourtant, les faits sont là !
Le résultat ? Passer de vingt-cinq millions à vingt-deux millions de têtes de porcs ne peut qu’emporter des conséquences en aval ! Notre industrie agroalimentaire, qui s’est développée à proximité des lieux de productions et qui, à ce titre, a souvent été considérée comme non délocalisable, ne peut qu’être affectée par cette évolution. Je déplore que ceux qui s’émeuvent le plus du chômage dans l’industrie agroalimentaire, soient souvent les plus virulents à exiger la diminution du potentiel de production.
Monsieur le ministre, j’ai participé aux réunions que vous avez organisées avec les parlementaires bretons avant que n’éclatent les crises que l’on sait. Je vous ai entendu dire que le maintien du potentiel de production et la réduction des normes étaient les conditions de la survie de bon nombre d’exploitations et des industries agroalimentaires. Je vous ai entendu, avec le Premier ministre d’alors, dire au SPACE de Rennes, le salon des productions animales, que de nouveaux textes, concernant notamment les zones d’excédent structurel, ou ZES, sortiraient rapidement. Je vous ai entendu, lors de la rédaction de ce qui a été appelé le pacte d’avenir pour la Bretagne – un pacte de plus ! –, affirmer que des initiatives seraient engagées pour permettre à nos exploitations de continuer à produire et à nos entreprises de rester performantes.
Dans le texte que vous nous présentez, je ne vois en rien la traduction de toutes ces promesses. Dans le mot « pacte », il y a aussi le mot « acte » ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous entamons la discussion de ce qui sera certainement la grande loi du quinquennat, portant sur l’agriculture et sa modernisation.
Il nous faut donc saisir cette occasion – en gardant à l’esprit qu’elle sera peut-être la seule avant longtemps – pour mieux protéger la santé des agriculteurs et des riverains d’exploitations, les consommateurs et leur alimentation, l’environnement et la santé animale, des méfaits graves et avérés des pesticides.
En octobre 2012, la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, dont j’ai demandé la création et dont j’ai été la rapporteur, rendait ses conclusions, approuvées sur ces travées à l’unanimité. Au terme de sept mois de travail et d’une centaine d’auditions, ce rapport dressait un tableau assez alarmant de la situation sanitaire liée aux pesticides en France.
Ce rapport, parmi ses constats majeurs, établissait que les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont encore sous-évalués ; que le suivi des produits pesticides après leur mise sur le marché n’est qu’imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels ; que les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques qu’ils font peser sur leurs utilisateurs comme sur le reste de la population ; que les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles ne prennent pas suffisamment en compte la problématique de santé.
Dès lors, je me réjouis que le projet de loi prenne la mesure de ces constats graves, en retenant notamment, sur certains points, les recommandations de la mission d’information. Je veux remercier le ministre et son cabinet pour la disponibilité et l’écoute dont ils ont constamment fait preuve durant les mois de travail de la mission parlementaire comme par la suite.
Venons-en à ces mesures. Outil précieux pour la collecte des données de terrain, le dispositif de phyto-pharmacovigilance, dont la création a été recommandée par la mission, permettra de surveiller avec précision les effets en situation réelle des produits phytopharmaceutiques.
Complémentaire, la mise en place d’un suivi post-AMM, que réclamait également la mission commune d’information, permettra d’en finir avec une anomalie sanitaire, certains produits, une fois autorisés sur dossier, ne faisant l’objet d’aucun contrôle pendant des années.
Bien que ce principe soit imparfaitement consacré, le projet de loi a également le mérite d’affirmer que la vente de pesticides doit être accompagnée de conseils d’utilisation et de précaution délivrés par des professionnels formés.
Corrélativement à ces mesures d’encadrement et de réglementation, les dispositions destinées à favoriser l’essor des méthodes alternatives en encourageant le développement des produits de bio-contrôle ne sont pas oubliées dans le projet de loi.
Ce train de mesures, que je n’ai pas le temps d’examiner plus en détail, permettra d’engager un véritable basculement vers la lutte intégrée et la réduction de la consommation de produits phytosanitaires.
De manière plus générale, nous faisons, avec ce projet de loi, le pari de l’agroécologie : preuve que la prise en compte des problématiques de santé et d’environnement, loin de s’y opposer, est bien complémentaire du souci de moderniser l’agriculture de notre pays et d’apporter des solutions aux besoins économiques de nos agriculteurs.
Les sénateurs du groupe socialiste enrichiront le projet de loi en défendant plusieurs amendements portant sur des questions importantes. Je pense en particulier à la définition des sanctions en cas de fraude ou de trafic illégal de produits pesticides et à la possibilité d’introduire des distances de sécurité entre des habitations et les zones d’utilisation de produits phytosanitaires. Je pense aussi à la prise en compte des adjuvants dans les décisions d’AMM de l’ANSES et au renforcement des pouvoirs de contrôle et d’information du Parlement à l’égard de cette agence.
Concernant l’ANSES, j’espère bien que, au moment de la refonte de ses prérogatives, le ministre pourra nous donner des garanties sur les moyens qui lui seront accordés, en particulier sur la levée des plafonds d’emplois. Ce point est crucial et fondamental pour la réussite des missions que nous souhaitons lui confier.
Toutefois, je tiens à exprimer deux regrets.
En premier lieu, j’estime que la restriction de la publicité qui semble se dessiner à ce stade de la discussion est insuffisante. En effet, l’enjeu central d’une politique visant à réduire les risques liés aux pesticides reste celui de la diminution des volumes consommés, un résultat qu’on est aujourd’hui bien loin d’obtenir. Or ce changement de paradigme ne pourra pas se produire si nous continuons de laisser les pesticides être présentés aux agriculteurs comme des produits miracles.
En second lieu, je constate que le projet de loi comporte peu d’avancées en ce qui concerne le dépistage, la reconnaissance et la compensation des maladies professionnelles. Mes chers collègues, nous ne devons pas abandonner cet objectif fondamental : j’espère qu’il sera mieux pris en compte lors de la suite de l’examen du projet de loi, mais aussi dans les prochains textes relatifs à la santé.
Enfin, je profite de ma présence à la tribune pour exhorter le ministre à porter au niveau européen une voix de la France qui soit ambitieuse, comme il a su si bien le faire dans d’autres dossiers. Je pense en particulier à la stratégie sur les perturbateurs endocriniens, qui, en dépit des blocages de la Commission européenne, doit impérativement être relancée.
De même, il serait important de plaider pour la création d’un fonds de recherche public et indépendant dans le domaine de la santé ; ce fonds devrait être financé par les industriels et disposer de moyens suffisants pour réaliser des études d’envergure indépendantes sur les risques sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés.

Mme Nicole Bonnefoy. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si j’appelle à amplifier l’orientation prise, je ne minimise pas l’ampleur des avancées que nous allons opérer. Aussi suis-je heureuse de constater que le travail de notre mission commune d’information porte ses fruits. C’est pourquoi je voterai le projet de loi avec enthousiasme !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – c’est ainsi qu’il s’intitule ! – dont nous allons débattre dans les heures et les jours qui viennent appelle de ma part quelques commentaires. À cet égard, permettez-moi de souligner deux points essentiels.
D’abord, il faut reconnaître que le champ est devenu un espace social, selon l’expression de M. Babusiaux, ancien directeur du Conseil national de l’alimentation.
En d’autres termes, l’agriculture, désormais, est aussi productrice de biens publics : les paysages, l’eau, l’air. Pour autant, cette réalité sociétale ne doit pas nous faire oublier que la mission première de l’agriculture reste de produire et donc de nourrir les hommes.
Ensuite, nous ne pouvons pas parler de politique agricole sans replacer l’agriculture française dans son contexte européen, ni, parallèlement, sans considérer la politique que mènent les États-Unis, déterminée par le Farm Bill, adopté par le Congrès le 4 février dernier. De ce double point de vue, que constate-t-on ?
L’Europe consacrera 385 milliards d’euros à la PAC au cours de la période 2014-2020, soit 55 milliards d’euros par an, quand les États-Unis affecteront à leur agriculture 956, 4 milliards de dollars, soit un peu moins de 700 milliards d’euros, en dix ans, c’est-à-dire 70 milliards d’euros par an.
L’Europe, et donc la France, a globalement découplé ses aides à la production, tandis que les États-Unis font l’inverse.
On constate également que l’Europe ne garantit pas véritablement le revenu de ses agriculteurs, alors que les États-Unis le font, au risque d’être en délicatesse, voire en contradiction, avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Nous n’ignorons pas que les crédits d’intervention sont passés, en un quart de siècle, de près de 80 % à 5 % des crédits de la PAC. En d’autres termes, gouvernement après gouvernement – toutes sensibilités politiques confondues –, les fonds publics diminuent, laissant les agriculteurs de plus en plus soumis aux fluctuations et aux règles du marché.
Si, en tant que libéral, cette situation ne me heurte pas fondamentalement, je m’inquiète toutefois des disparités entre les deux côtés de l’Atlantique : demain, les farmers américains, dotés d’une garantie de revenu assez forte, seront mieux armés que les agriculteurs français pour aborder l’avenir.
Permettez-moi, monsieur le ministre, d’ajouter un autre motif d’inquiétude : notre incapacité, gouvernement après gouvernement, là encore, à assurer autant que faire se peut un minimum d’équité dans le partage de la valeur ajoutée, de l’amont à l’aval. J’irai même plus loin : la stratégie politique des prix bas menée par le leader de la grande distribution française est dangereuse à moyen et long terme pour les consommateurs eux-mêmes ; à court et moyen terme, elle est dévastatrice pour nos outils de transformation, dont la restructuration, la modernisation et l’agrandissement sont sans cesse reportés, faute de marges financières suffisantes.
Notre collègue Dominique de Legge ayant exposé ce problème il y a quelques instants, je me contenterai de vous rappeler que, en l’espace de six mois, la grande distribution a accepté, en Allemagne, trois augmentations successives du prix des matières premières laitières, alors qu’aucune évolution n’est intervenue en France. §En d’autres termes, la grande distribution française sera comptable, demain, de la non-modernisation et de la non-restructuration de nos outils de transformation.
Monsieur le ministre, vous êtes trop averti des problématiques agricoles pour ignorer que les drames bretons, qui sont loin d’être résolus, tiennent essentiellement à ce problème, qui risque de gagner l’ensemble du territoire national, notamment dans la filière de la viande blanche et dans la filière laitière.
Ce projet de loi d’avenir, avec les GIEE, le bail environnemental et la modification fondamentale du rôle de l’ANSES, constitue, à mes yeux, un rendez-vous manqué ; je le regrette, et les agriculteurs français plus encore.
Monsieur le ministre, je vous invite à ne pas manquer un autre rendez-vous : celui qui est programmé à mi-parcours de la PAC, en 2016. Plus qu’un rendez-vous de mi-parcours, il faudra sans doute en faire un rendez-vous destiné à accompagner et à encourager davantage les agriculteurs en matière de productivité et de compétitivité.

En effet, le temps économique est beaucoup plus rapide que le temps politique. Que l’on adopte pour sept ans une stratégie aussi différente de celle de notre principal concurrent m’inquiète, et ce d’autant plus que nous sommes dans un monde de compétition. Loin d’opposer nos agriculteurs – M. le rapporteur Didier Guillaume a très clairement souligné la nécessité de préserver nos produits sous signe de qualité –, il convient de conforter et de développer plus encore qu’aujourd’hui la productivité, la compétitivité et la capacité d’exportation de l’agriculture et de l’agroalimentaire français, sources d’emplois dans nos territoires.
Monsieur le ministre, vous l’avez deviné : votre projet de loi manque de souffle. Il me laisse sans voix : j’en suis désolé, vous n’aurez pas la mienne !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur le titre IV du projet de loi, qui regroupe les articles 26 à 27 ter.
Ces dispositions consacrées à l’enseignement agricole sont centrales, puisque notre système d’enseignement et de recherche devra s’affirmer comme le pilier de la transition agroécologique portée par ce projet de loi, au service d’un double objectif : performance économique et écologique.
Le titre IV traite de trois enjeux majeurs : l’agroécologie, la promotion sociale par l’enseignement agricole, ainsi que les dimensions européenne et internationale.
D’abord, il faut favoriser l’agroécologie, en formant à produire autrement. Pour ce faire, nous avons besoin d’une meilleure articulation des missions des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et de leurs exploitations avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. Il convient aussi de prévoir l’obligation d’inscrire la coopération internationale dans le projet d’établissement.
Ensuite, il convient de renforcer l’enseignement agricole comme outil innovant de promotion sociale, dans la logique de la refondation de l’école. Cette politique passe par l’acquisition progressive des diplômes, l’alignement des bourses sur le droit commun et l’ouverture des écoles d’ingénieurs aux bacheliers professionnels par la création d’une voie d’accès spécifique, ainsi que par le développement de la mobilité internationale.
Enfin, nous devons développer les coopérations thématiques renforcées sur la base du volontariat des acteurs, consolider la capacité d’expertise et accroître la visibilité internationale de notre enseignement supérieur agricole et de la recherche dans ce domaine.
Tel est l’objectif de la création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, l’IAV2F.

En effet, monsieur le rapporteur, car il permettra d’approfondir la coopération entre les acteurs de la recherche et de la formation agronomiques et vétérinaires, entamée via l’actuel établissement public de coopération scientifique, Agreenium.
La création de ce nouvel institut répondra, avec la mise en œuvre des orientations stratégiques nationales, à une double exigence : atteindre la masse critique nécessaire au rayonnement international, tout en conciliant le maintien de l’identité de chaque établissement et de sa politique de site.
Le groupe socialiste a mené de nombreuses auditions sur ce sujet ; il a notamment entendu des représentants des écoles vétérinaires, des écoles agronomiques et des syndicats. Nous avons constaté qu’il existait un large consensus sur la nécessité d’accroître le travail en commun des différents acteurs et sur la mission de pilotage stratégique qui doit être confiée à l’institut.
Nous avons également entendu la demande de clarification sur la structuration et la gouvernance de l’institut, avec, cependant, un impératif : il ne faut pas confondre gouvernance et coopération thématique. Nous n’avons pas besoin d’une grosse structure administrative : l’IAV2F doit être, avant tout, une structure fédérative, de coordination opérationnelle, capable de développer une dynamique de projets.
En devenant un établissement public à caractère administratif, l’IAV2F bénéficiera d’une véritable autonomie juridique, administrative et financière, qui lui permettra de mener à bien ses missions ; un directeur nommé par décret sera placé à sa tête et un conseil d’administration déterminera sa politique.
Monsieur le ministre, nous avons déposé plusieurs amendements à l’article 27 tendant, notamment, à mettre en place deux structures chargées d’épauler le conseil d’administration de l’IAV2F et d’alléger sa composition et ses missions : le conseil d’orientation stratégique et le conseil des membres. L’adjonction de ces deux instances permettra d’assurer la représentativité de toutes les composantes et de tous les membres de l’institut, tout en garantissant un fonctionnement opérationnel.
Nous proposons que le conseil d’orientation stratégique soit composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères. Quant au conseil des membres, il réunirait un représentant au moins de chacun des membres de l’IAV2F. Associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, il sera également consulté par celui-ci préalablement à l’adoption du programme de travail et du budget de l’institut.
Comme vous l’avez affirmé à plusieurs reprises, monsieur le ministre, l’enseignement agricole est l’un des outils fondamentaux pour faire progresser l’agroécologie. Le titre IV du projet de loi est porteur d’une ambition forte pour l’enseignement agricole, qui doit être la matrice d’anticipation de nouveaux modèles de production et de nouvelles pratiques pour les futurs chefs d’exploitation.

Il permet, par ailleurs, à chacun de s’approprier les objectifs de participation au service public numérique, ainsi que d’accéder aux aides à la mobilité internationale.
La création de I’IAV2F participe, enfin, à assurer la structuration verticale de l’enseignement agricole, des débuts de la formation jusqu’aux plus hauts niveaux de l’enseignement et de la recherche.
C’est une belle ambition qui est portée par votre projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, monsieur le ministre. Nous la soutenons avec enthousiasme. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi a été préparé avec sérieux par les services du ministère de l’agriculture, et examiné de manière approfondie par les rapporteurs et les différentes commissions du Sénat, qui se sont prononcées. Néanmoins, c’est un projet dont on peut dire qu’il porte mal son nom.

Il s’agit plutôt d’un texte portant diverses mesures d’ordre agricole et sylvicole.

Certaines de ses dispositions, sans être révolutionnaires, ni même à la hauteur des enjeux de la production agricole dans notre pays, sont positives et bénéfiques. D’autres, parce qu’elles sont inspirées par une approche assez punitive de l’écologie, devront être, de notre point de vue, si ce n’est être amendées, du moins, le plus souvent malheureusement, rejetées.
Il est vrai que la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche…

… n’a été votée que depuis quelques années. L’exercice consistant à vouloir refonder la politique agricole de notre pays était, en réalité, du fait de l’ampleur de ce texte, hors de portée.
Avant tout, je veux souligner que l’avenir de l’agriculture dépend d’abord des agriculteurs eux-mêmes !

Je suis heureux de constater que le mot « compétitivité » n’est plus aujourd'hui à proscrire quand il est question de politique agricole. Au contraire, l’ensemble des agriculteurs de notre pays se reconnaissent dans cet objectif, et ils ont raison. Si la politique agricole commune reste essentielle pour le développement des exploitations, les recettes qu’elle apporte à l’agriculture représentent, il faut s’en souvenir, 11 % du total des recettes d’exploitation. Par conséquent, l’essentiel pour nos agriculteurs est la manière dont leur activité sera confortée grâce à la formation, l’innovation, la modernisation des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs.
À cet égard, les évolutions structurelles qu’a connues notre agriculture depuis une vingtaine d’années doivent se poursuivre même si beaucoup d’entre elles soulèvent des questions aujourd'hui sans réponse. Le nombre total des exploitations a diminué fortement en vingt ans, puisque la baisse est de 50 %. Les exploitations de grande taille représentent désormais un tiers des exploitations ; elles doivent coexister avec des structures familiales plus modestes, elles aussi appelées à se transformer et à grandir.
En dix ans, le nombre de jeunes de moins de quarante ans qui se sont installés est passé de 34 % à 23 %. La moyenne d’âge des agriculteurs est de cinquante ans, ce qui entraînera de profondes modifications pour nos exploitations dans les dix ou quinze ans à venir. En cinquante ans, la France a perdu près de 20 % de sa surface agricole utile. Notre agriculture doit donc relever un grand nombre de défis. Or je ne trouve pas dans le projet de loi de réponse majeure à l’ensemble de ces questions.

Certes, il est possible que ce texte contienne quelques améliorations – nous aurons l’occasion d’en discuter –, mais aucune des dispositions prévues n’est ambitieuse au point de lui valoir l’appellation qui est la sienne, une loi d’avenir !
S’agissant de la formation, un certain nombre de points concrets auraient pu être abordés. La sécurité au travail crée aujourd'hui des difficultés : les apprentis ne peuvent plus monter sur un escabeau ? §La rémunération des stagiaires dissuadera également beaucoup de nos agriculteurs.
Par ailleurs, le projet de loi ne prend pas en compte les maisons familiales rurales, …

En matière d’environnement, aucune mesure n’est prévue pour accompagner financièrement les agriculteurs dans leurs investissements pour le stockage des effluents, par exemple.
De plus, rien n’est envisagé pour l’entretien des cours d’eau et l’autorisation de nouvelles retenues d’eau. Et si je constate, heureusement, que l’ANSES sera dotée des pleins pouvoirs s’agissant des autorisations de mise sur le marché des pesticides, il n’en ira pas de même s’agissant de la question essentielle des semences OGM, sujet à propos duquel la politisation des décisions vient de nouveau d’être démontrée, alors que le principe de décision reposant sur l’expertise devrait être appliqué.
Enfin, je me réjouis que notre rapporteur Philippe Leroy…

… ait amorcé des discussions pour rapprocher chasseurs et sylviculteurs, tout en reconnaissant qu’ils sont déjà proches en réalité. Néanmoins, l’inquiétude des chasseurs sur un certain nombre de dispositions relatives à la gestion de la forêt française doit être entendue. C’est aujourd'hui un impératif majeur.
Voilà, en quelques mots, l’essentiel des remarques que je voulais formuler, mêlant à la fois les questions concrètes aux réponses ambitieuses que nous devons apporter aux grands enjeux qui se posent pour l’avenir de notre agriculture.
J’aurais voulu évoquer la filière équine, malmenée par les dispositions malheureusement prises en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

M. Philippe Bas. Nous ne pouvons pas laisser cette filière sans réponse, car elle est aujourd'hui en difficulté !
Applaudissements sur les travées de l'UMP . – M. Daniel Dubois applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, n’en déplaise à certains orateurs précédents, …

… j’ai, pour ma part, la conviction que le texte dont nous discutons aujourd’hui porte une vision nouvelle pour notre agriculture, qui se veut en cohérence avec notre modèle de société en pleine évolution.
C’est ce contexte particulier que j’ai délibérément choisi d’aborder. Il renvoie, en toute logique, aux problématiques des jeunes agriculteurs, de leur formation, de leur installation et de leurs modes de fonctionnement. Bref, vous l’aurez compris, mes chers collègues, à mes yeux, ce texte fait délibérément le pari de l’avenir ! §L’intitulé de ce projet de loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » n’est donc ni fortuit ni le fruit du hasard, n’en déplaise, je le répète, aux sceptiques qui se trouvent à droite de l’hémicycle…

Hier soir, l’un des vôtres, chers collègues de l’opposition, n’a pas hésité à déclarer qu’un certain nombre de lois déjà anciennes étaient magnifiques, tout en reconnaissant dans la même phrase que la situation de notre agriculture était catastrophique ! Choisissez mieux vos arguments !

Quoi qu’il en soit, tout le monde partage le même constat : confrontée à la mondialisation, l’agriculture française a perdu des parts de marché. Elle doit donc renforcer sa compétitivité. Dans le même temps, elle peut et doit valoriser les espaces ruraux, qui ont besoin d’un tissu d’exploitations vivant, où les agriculteurs bénéficient enfin de bonnes conditions de travail et de vie. Ces derniers le méritent, car ils sont, tout le monde s’accordera à le reconnaître, la clef du dynamisme d’un secteur économique stratégique pour notre pays.
Dans ce texte, monsieur le ministre, vous mettez en avant un nouveau concept qui vous tient particulièrement à cœur – on le comprend –, car il est, selon moi, puissamment novateur : je veux parler de l’agroécologie.
Votre ambition est d’ouvrir la voie d’une agriculture conjuguant performance économique et écologique de façon complémentaire et sans ambiguïté entre les deux termes.
Je peux comprendre les doutes ou les hésitations du monde agricole qui ont été exprimés hier soir par notre collègue Alain Bertrand, car les agriculteurs voient toujours arriver avec un peu de crainte un nouveau concept. Néanmoins, j’ai tout de même la faiblesse de penser que l’agroécologie permettra de réconcilier l’agriculture avec les acteurs à l’autre bout de la chaîne, à savoir les consommateurs. Nous ne pourrons pas faire l’économie de cette réflexion.
La création des groupements d’intérêt économique et environnemental symbolise parfaitement, en tant qu’outils, cette approche intégrée. Ils ont d’ailleurs été renforcés dans leur dimension sociale par notre rapporteur Didier Guillaume.
Le souci concernant le quotidien des agriculteurs apparaît nettement dans un texte qui favorise par définition – il y est question d’avenir ! – l’installation des jeunes.
Je veux citer, par exemple, l’extension jusqu’à trente ans du contrat de génération pour l’agriculture, qui constitue une initiative précieuse, afin de répondre au problème préoccupant de la baisse de la population agricole évoqué par les uns et par les autres. En effet, le taux de remplacement de l’ancienne génération est bloqué à un peu plus de 60 %, alors que le nombre total d’exploitations agricoles est passé de 660 000 à 490 000 entre 2000 et 2010.
L’autre défi que vous entendez relever, monsieur le ministre, concerne la formation des jeunes agriculteurs, mais aussi la recherche et l’innovation, afin de faire face aux enjeux du XXIe siècle. C’est ce que vise à garantir la création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, qui permettra la valorisation de l’excellence française dans ces domaines.
Je me félicite, enfin, qu’une demande ancienne ait été satisfaite, puisque le texte entend donner un nouveau cadre et un nouveau départ à l’enseignement agricole, qui restera fort légitimement – c’est fondamental ! – dans le giron du ministère de l’agriculture. Les passerelles pour les jeunes entre les bacs professionnels et l’enseignement supérieur constituent, par ailleurs, une précieuse avancée.
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que je voulais dire en quelques minutes. Je suis persuadé que le débat qui s’ouvre, parce qu’il est passionnant, confortera l’enthousiasme des uns et nivellera peut-être le scepticisme des autres. Pour ce qui nous concerne – est-il besoin de le préciser ? –, nous apporterons un soutien sans faille à ce projet de loi ! §

Comme mes collègues UMP ont eu l’occasion de l’évoquer largement avant moi, ce texte contient beaucoup de déclarations d’intention, mais est décevant sur les vrais sujets. Il manque surtout d’ambition, d’audace et de concret.
Il ne prévoit rien sur la compétitivité de notre agriculture, rien sur l’innovation et la recherche, rien sur la baisse des charges et la réduction des normes qui pèsent sur notre agriculture ! Je me demande, d’ailleurs, en quoi ce texte est un projet de loi d’avenir §…

… quand j’entends parler d’agriculture vivrière comme autrefois, de limitation des surfaces, sans se préoccuper des zones intermédiaires, ou quand j’entends dire que, même avec 150 hectares, un agriculteur doit travailler seul sur l’exploitation et que son épouse doit avoir un emploi à l’extérieur pour que le ménage puisse s’en sortir !

Certes, nous devons dépasser les oppositions systématiques entre les différentes filières de l’agriculture – le bio et le conventionnel, l’élevage et les céréales, les circuits courts et les circuits longs, l’agriculture de montagne et les grandes cultures – et promouvoir une approche faisant de notre diversité une richesse, un facteur d’excellence, en recherchant le meilleur pour chaque filière, sans les opposer les unes aux autres.
La seule question que nous devons nous poser aujourd’hui est la suivante : voulons-nous continuer à avoir une agriculture dynamique, exportatrice, qualitative, qui puisse enrichir la balance commerciale française, ou voulons-nous continuer à perdre des parts de marché ?
Voilà trois ans, nous étions le premier producteur-exportateur européen et le troisième producteur-exportateur mondial. Nous sommes aujourd’hui respectivement en deuxième et en cinquième positions.
Une dimension fait défaut à ce projet de loi : celle de la stratégie que nous souhaitons mettre en place pour la « ferme France » et pour chacune de ses filières.
On a l’impression, avec ce texte, que, sans l’agroécologie, point de salut ; qu’il suffit d’ajouter partout le « e » du mot environnemental – bail environnemental, groupement d’intérêt économique et environnemental – pour faire croire que cela va régler tous les problèmes. C’est finalement un projet de loi rédactionnelle, de sigles, un repli sur soi, un projet de loi « small is beautiful ».

C’est un projet de loi dénué de bon sens. Ce que veulent les agriculteurs, c’est que vous veilliez à ce que toutes les normes environnementales adoptées en France correspondent strictement aux textes européens, ni plus ni moins, sans chercher à les anticiper, ni à les durcir sur le plan national.
Je prendrai un seul exemple, récent, tiré de mon département du Cher, celui d’agriculteurs qui ne peuvent même plus entretenir leurs cours d’eau, leurs fossés, après cet hiver humide, pour assainir leurs champs sous peine de voir débarquer les agents de la police de l’eau, l’ONEMA, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, colts à la ceinture, …

… pour les sanctionner, en leur délivrant des amendes exorbitantes, comme de vulgaires malfrats.

Les agriculteurs ne supportent plus d’être des suspects permanents aux yeux de certaines administrations.
Vous en rajoutez encore une couche avec ce texte : alors qu’ils tiennent un carnet d’épandage d’engrais et de produits phytosanitaires, vous demandez aux organismes stockeurs de vous indiquer les quantités vendues de ces engrais par bassins versants au cas où les agriculteurs tricheraient.

Concernant les groupements d’intérêt économique et environnemental, grâce aux efforts des agriculteurs, la pratique de l’agriculture raisonnée progresse d’année en année, avec l’arrivée des GPS, des cartographies des sols, où les dosages des engrais et des produits phytosanitaires sont réalisés à la bonne dose là où il faut, sans les excès d’autrefois.
Ces agriculteurs, vous l’avez dit, monsieur le ministre, sont déjà organisés avec les CUMA, les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les GIE, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’employeurs, pour mener des projets, mutualiser des moyens, acheter au meilleur prix, et n’ont pas attendu qu’on ajoute un « e » pour plaire à nos amis écologistes.

Pourquoi créer ce nouvel instrument qu’est le GIEE, avec une définition beaucoup trop floue pour être efficace ?
L’installation des jeunes devrait être le point essentiel de ce projet de loi, car, aujourd’hui, on le voit bien, cette installation est toujours aussi complexe et difficile sur le plan financier, que ce soit dans le cadre familial ou en dehors.
Dans ce texte, on ne voit pas véritablement de volonté politique pour encourager l’installation de nos jeunes.

Rien sur la simplification des dossiers, véritable parcours du combattant pour nos jeunes ! Et j’en parle en connaissance de cause, puisque je suis en train d’installer un jeune en ce moment.
Les aides sont insuffisantes au regard des investissements lourds nécessaires pour reprendre une exploitation, avec un retour sur investissement au bout de douze à quinze ans au minimum. Les taux d’emprunt des prêts jeunes agriculteurs sont finalement les mêmes que ceux du marché.
S’agissant de l’accès au foncier, je ne suis pas sûr que ce soit en donnant des pouvoirs exorbitants aux sociétés d’aménagement foncier que vous allez donner envie aux propriétaires de favoriser l’installation des jeunes, au contraire !
Les SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ont certes joué un rôle très important depuis leur création, en 1961, par Edgar Pisani, alors ministre de l’agriculture, jusqu’à ce jour. Elles ont permis d’aider au remembrement et à l’aménagement foncier des exploitations, à leur restructuration, ainsi qu’à l’aménagement du territoire dans le cadre de grandes infrastructures routières et ferroviaires.
Aujourd’hui, elles jouent toujours un rôle très important pour les collectivités locales lors de l’aménagement des zones d’activité, mais il faut qu’elles restent dans le cadre de leurs missions régaliennes. De grâce, elles n’ont pas vocation à devenir des offices fonciers tout-puissants, à l’image de ce qu’on a pu voir dans certains pays, où tout serait contrôlé et fiché, où tous les transferts de parts sociales de sociétés et de biens familiaux devraient passer sous leurs fourches caudines.
Tout en étant attaché à une agriculture familiale et à taille humaine, je considère qu’il faut, au contraire, lever un certain nombre de difficultés, en améliorant le revenu du foncier, en facilitant la mise en place de groupements fonciers agricoles privés moins contraignants et plus avantageux fiscalement, et ainsi faciliter l’accès des jeunes au foncier.
Tels sont les éléments de réflexion que je voulais vous livrer, monsieur le ministre. Ce qu’attendent les agriculteurs, c’est que vous vous battiez davantage pour porter la voix de la France au sein de l’Europe, …

M. Rémy Pointereau. … que vous soyez plus combatif devant l’Organisation mondiale du commerce pour préserver les intérêts de la France.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

L’agriculture ne doit pas être la variable d’ajustement des négociations internationales.

C’est là que se joue l’avenir de l’agriculture française ; ce n’est pas dans ce projet de loi, que je ne voterai pas, à moins que nos amendements ne soient largement retenus.

M. Rémy Pointereau. Donnez aux agriculteurs les moyens de se battre à armes égales avec leurs concurrents !
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Sourires.
Mêmes mouvements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, certains d’entre vous se sont dits sceptiques, perplexes et même pessimistes.
À ceux-là, je rappellerai les propos du philosophe Alain : « Le pessimisme est d’humeur, »…
M. Didier Guillaume, rapporteur, et M. Joël Labbé applaudissent.

M. Roland Courteau. Notre collègue Jean-Jacques Mirassou cite d’ailleurs très souvent ce propos.
Sourires.

Je dirai donc à mes chers collègues pessimistes du moment que ce texte nous donne les moyens d’être optimistes pour l’avenir de notre agriculture.
Il est en effet vrai que ce projet et de loi, comme l’a rappelé l’un de nos collègues, ajouté aux nouvelles orientations de la PAC que vous avez initiées, monsieur le ministre – et je vous en félicite, car ce n’était pas acquis –, apporte une vision et définit un cap.
Ce texte fixe notamment une véritable priorité : la mutation de nos modèles de production vers l’agroécologie.
J’apprécie d’autant plus que la dimension écologique est, en effet, un élément de compétitivité, qui, de surcroît, va rendre ses lettres de noblesse à l’agriculture.
M. Joël Labbé applaudit.

Je note que, pour la première fois, un ministre de l’agriculture fait de l’agroécologie un objectif majeur de sa politique.
J’apprécie, monsieur le ministre, que vous ayez voulu que cette agroécologie ne s’impose pas d’en haut, mais vienne du terrain, de la base et des projets collectifs.
Je pense à la création des groupements d’intérêt économique et environnemental, qui est l’une des principales innovations de ce projet. En offrant un cadre souple et institutionnel aux exploitants qui s’engagent collectivement, ils permettront de reconnaître et d’encourager les innovations, afin de concilier performance environnementale et performance économique, tout en mutualisant les risques et en luttant contre le phénomène d’isolement qui touche les agriculteurs.
J’apprécie donc que vous engagiez l’agriculture française dans une transition permettant son développement, sa compétitivité, tout en respectant l’environnement.
Transition ! Le mot est lâché. Je note sur ce point que le texte qui nous est soumis, à la suite de l’adoption d’un amendement de Delphine Batho à l’Assemblée nationale, conforté utilement par la commission, engage l’agriculture dans la transition énergétique.
Certes, l’agriculture n’a pas pour vocation de produire de l’énergie. Aussi, en matière de méthanisation, nous devrons éviter certaines dérives telles que la ferme dite « des mille vaches ».
M. Daniel Dubois s’exclame.

Cela étant précisé, s’il y a en effet la possibilité de valoriser certains sous-produits, dans une logique d’économie circulaire, et s’il y a la possibilité, par la production d’énergie, d’apporter un complément de revenus, alors oui, n’en privons pas l’agriculture française !
Mes chers collègues, l’agriculture et l’alimentation, c’est l’image de la France. Mais l’image de la France dans le monde, ce sont aussi le vin et la viticulture §; le vin qui assure le rayonnement de notre pays dans le monde.
Sourires.

Le vin, c’est la France, c’est notre histoire. Le vin, produit millénaire, est d’une certaine manière l’identité de la France. Il fait partie du repas gastronomique français, lequel a été inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité.
Nouveaux sourires.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et aussi avec modération !
Mêmes mouvements.

N’oublions pas, par ailleurs, que l’école française d’œnologie rayonne, elle aussi, dans le monde entier.
Voilà pourtant un produit trop souvent maltraité, voire diabolisé. C’est pourquoi je remercie le rapporteur Didier Guillaume, ainsi que la commission des affaires économiques, d’avoir adopté à l’unanimité notre amendement visant à reconnaître que le vin, produit de la vigne, …
Sourires.

… et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.
Cet amendement faisait suite à une proposition de loi que j’avais déposée en avril 2011 avec mes collègues Jean-Jacques Mirassou, …
Sourires.

… Claude Bérit-Débat et Marcel Rainaud et réactivée en octobre dernier.
À la suite d’une erreur de dactylographie, le qualificatif « protégé », qui concernait ce patrimoine culturel, gastronomique et paysager, a disparu de l’amendement que j’avais déposé en commission en février. Je propose donc, par voie d’amendement, de réintroduire ce mot dans le texte.
Avant de conclure, je voudrais faire une remarque, monsieur le ministre, à propos de l’élevage.
J’apprécierais que l’on prenne en compte les exploitations de petite taille, au cheptel très restreint. Ces exploitations de moins de dix vaches allaitantes maintiennent la vie des hommes sur certains territoires difficiles, et il existe un indéniable risque de les voir disparaître si elles demeurent exclues du versement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Bien évidemment, je soutiendrai ce texte, qui impulse une nouvelle dynamique et de nouveaux moyens de développement à l’agriculture. Il y a là véritablement une rupture, c'est-à-dire une rupture pour une très grande mutation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le ministre, permettez au Vendéen que je suis d’adresser ses félicitations au Sarthois que vous êtes d’avoir été reconduit dans ses fonctions.
Je salue également le président de la commission des affaires économiques et les rapporteurs, qui ont fait un travail important, ainsi que l’ensemble de mes collègues.
Je veux dire à mon ami Roland Courteau qu’un pessimiste, comme dirait quelqu’un, c’est aussi un optimiste qui a un peu d’expérience.
En un peu moins de quinze ans, nous en sommes à la quatrième loi prétendant offrir un horizon à l’agriculture. C’est beaucoup.

Ce peut être un signe négatif ou … positif et rassurant si l’on considère que cela témoigne de l’importance qu’on accorde à l’agriculture française : l’agriculture, ce sont à la fois des racines et l’avenir.
Ce peut être aussi un signe inquiétant parce que la bougeotte législative, c’est de l’instabilité. C’est en même temps le symptôme d’un mal français que l’on connaît bien : à force de modifier les textes, on change perpétuellement un environnement qui, par ailleurs, dans la compétition mondiale, ne cesse de bouger.
Pourquoi ce projet de loi, et quels effets en attend-on ? Monsieur le ministre, si votre objectif est d’aider les agriculteurs à relever les défis de la modernité du XXIe siècle, je doute que le texte que vous nous soumettez ne parvienne à surmonter trois des plus grandes contradictions dans lesquelles nos agriculteurs se débattent au quotidien.
La première contradiction, c’est que jamais il n’y a eu autant de concurrence, de dumping social, fiscal et environnemental à l’extérieur, avec une Europe toujours plus ouverte aux quatre vents, une passoire, disent certains. À l’intérieur, jamais nous n’aurons eu autant de contraintes, d’obligations, de normes imposées aux agriculteurs. C’est un dilemme d’incompatibilités pour les agriculteurs. Il faudra bien sûr réviser ce logiciel d’une ultraconcurrence.
De ce point de vue, c’est fondamental, vous devrez, me semble-t-il, informer le Parlement des discussions qui se déroulent actuellement – elles sont importantes pour notre agriculture – entre les États-Unis et l’Europe sur l’accord de libre-échange.
M. le ministre acquiesce.

D’un côté, à l’extérieur, toujours plus d’ouverture, toujours plus de concurrence, et, de l’autre, à l’intérieur, toujours plus de tracasseries administratives.
J’ai du respect pour vous, monsieur le ministre, pour le travail que vous faites, pour votre tempérament, mais, je suis désolé de vous le dire, ce texte ajoute de la complexité à la complexité
M. le ministre fait un signe de dénégation.

… telles que l’étatisation de la politique d’installation, la transmission des données, les nouvelles obligations déclaratives pour les engrais azotés, etc. Moins de simplicité, plus de complexité : voilà la première contradiction.
Deuxième contradiction, jamais, dans le monde, le niveau des risques n’aura été aussi élevé ; jamais les outils de régulation n’auront autant manqué pour faire face à une telle situation.
On ne peut pas parler d’avenir de l’agriculture, mes chers collègues, sans regarder lucidement ce qu’est le monde. Or le monde qui s’offre à nous présente deux grandes mutations : le réchauffement climatique et la mondialisation.
Lisez les conclusions de l’Organisation météorologique mondiale, qui fait référence depuis 1850 : parmi les quatorze années les plus chaudes, treize appartiennent au XXIe siècle, qui n’a que quatorze ans ! En Vendée, nous en savons quelque chose avec la tempête Xynthia ! Les risques naturels et sanitaires se sont donc amplifiés.
J’en viens à la mondialisation : elle engendre une plus grande interdépendance et amplifie les événements, avec ce que l’on appelle l’effet papillon. La sécheresse en Australie, l’actualité en Ukraine ou aux États-Unis ont des effets dans le quotidien de tous nos territoires.
Qu’y a-t-il en face ? Moins de moyens de régulation ! Les outils dont s’était dotée jadis la politique européenne ont quasiment tous été abandonnés. Quel régime assurantiel pour les agriculteurs ? Le Farm Bill, Jean Bizet l’évoquait, c’est encore plus d’argent américain pour moins d’aides directes, mais plus de soutien assurantiel.
Chez nous, en Europe, le régime assurantiel est lié au stockage de l’eau, qui a permis la grande révolution néolithique. Il y aura des années de plus en plus sèches. Vous le savez très bien, pour ce qui concerne les retenues collinaires, qui sont pourtant la meilleure des assurances récoltes, les agriculteurs rencontrent d’immenses difficultés. Ce texte ne leur apporte aucune réponse.
Troisième contradiction, jamais la France n’aura autant dégringolé dans les palmarès internationaux.

Ma chère collègue, tout cela, ce n’est ni la gauche ni la droite ! Tout cela, c’est l’agriculture, c’est la France.

Vous avez supprimé les allégements de charges pour les travailleurs agricoles, …

M. Bruno Retailleau. … ainsi que la TVA sociale, qui était une membrane protectrice.
M. Gérard Larcher applaudit.

Vous avez évoqué le discours de politique générale de Manuel Valls. Toutefois, permettez-moi de vous l’indiquer, les Allemands, en instaurant un SMIC, auront sans doute fait beaucoup plus pour la compétitivité de l’agriculture française …

Bien sûr, nous sommes rassurés, il y a l’arme atomique, votre botte secrète, à savoir le GIEE. Nous verrons ce que cela donne !
Pour conclure, je veux souligner que les agriculteurs veulent, bien sûr, concilier développement et environnement. Citez-moi une seule profession qui, en quelques années, ait fait autant d’efforts ! Didier Guillaume l’a très bien dit, et je lui en rends hommage. Mais les agriculteurs ne veulent plus être pointés du doigt ; ils en ont assez d’être traités comme des boucs émissaires ; ils veulent participer à la prospérité de la France, retrouver une fierté, celle de leur beau métier. Si tel est le cas, vous verrez que des vocations naîtront et que nous parviendrons alors à relever le grand défi de l’installation de nos jeunes. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord rendre hommage au travail réalisé sur ce texte par M. le ministre, ainsi que par M. le rapporteur Didier Guillaume et l’équipe 100 % féminine des chefs de file, Bernadette Bourzai et Renée Nicoux. Qu’ils en soient tous remerciés.
Dernière intervenante dans la discussion générale, j’ai choisi, monsieur le ministre, de m’intéresser, en quelques mots, à un angle particulier de ce projet de loi, qui me tient tout particulièrement à cœur. Comme son nom l’indique, ce texte est tourné vers l’avenir, notamment vers l’avenir de la jeunesse, celui des jeunes agriculteurs. Nous le savons bien, c’est une priorité affirmée, depuis deux ans, par le Président de la République que l’on retrouve donc ici. Elle transparaît nettement dans le travail qui a été mené, et je m’étonne que ce point n’ait pas été davantage souligné.
Tout d’abord, il s’agit des profondes modifications apportées à la formation et à l’enseignement agricole, orientés vers les objectifs de performance écologique et économique, ce qui n’est, je le rappelle, absolument pas incompatible, contrairement à ce que j’ai pu entendre dans les rangs de la droite, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
L’acquisition progressive des diplômes par un dispositif de validation des compétences ou encore l’alignement des conditions générales d’attribution des bourses sur le régime de l’enseignement général constituent des mesures fortes, qui auront un impact direct et rapide sur le quotidien des futurs agriculteurs.
Pour aller encore plus loin, le texte prévoit la remise d’un rapport destiné à permettre le développement, nécessaire, des formations biqualifiantes dans l’enseignement agricole, notamment en zone de montagne.
De nouvelles missions, plus larges et plus étendues, seront également attribuées à l’enseignement agricole : je veux parler du développement durable et de la coopération scientifique, pour ne citer que ces deux exemples.
La création d’un institut agronomique vétérinaire et forestier de France est également prévue, et je vous en remercie, monsieur le ministre. Il ne s’agit pas d’un « non-sens scientifique ou d’une menace pour les établissements d’enseignement et de recherche », comme j’ai pu l’entendre lors des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale. Bien au contraire, une telle mesure vise à permettre une meilleure coopération entre les acteurs de la recherche et de la formation. C’est fondamental pour favoriser la transmission d’un savoir le plus complet possible aux étudiants. En réalité, dans un monde économique et environnemental sans cesse en évolution, cet institut viendra actualiser l’enseignement agricole, pour prendre en compte l’ensemble des évolutions et avancer en matière de recherche et d’innovation.
Ce texte s’engage énergiquement en faveur de nos jeunes agriculteurs. Cet aspect est encore un peu plus perceptible si l’on considère la vraie politique d’installation qu’il vise à mettre en place.
Pour apporter une touche d’optimisme, qui dénotera sans doute avec ce que j’ai entendu, j’évoquerai mon département, les Pyrénées-Atlantiques, …

… aujourd’hui le premier en nombre d’installations de jeunes agriculteurs, avec 139 installations en 2013, soit une augmentation de 30 %, ce qui constitue une première en France. Avec 52 % d’installations en zone de montagne, ce sont des jeunes de plus en plus formés – certains ont même eu des parcours professionnels auparavant – qui s’installent, à un âge moyen de 29 ans. À noter, 30 % d’entre eux sont des femmes, et un quart des nouveaux venus ont une formation post-bac. Il convient, je crois, de saluer une telle évolution. Par ailleurs, sur ces 139 installations, 69 ont intégré la volonté de participer aux circuits courts de distribution des produits agricoles.
Monsieur le ministre, vous le savez, les parcours, les expériences, les profils, sont aujourd’hui très divers. Même si 70 % des porteurs de projets sont issus du milieu agricole, cette proportion n’a cessé de diminuer depuis une dizaine d’années. Tout l’enjeu était donc de parvenir à créer un cadre juridique susceptible d’accueillir tous ces profils différents. Des réponses concrètes ont donc été apportées et les parcours simplifiés, contrairement à ce que j’ai pu entendre.
Je pense à l’accès au foncier, qui reste, on le sait bien, l’une des premières difficultés lors d’une installation, et à la mise en place du dispositif d’installation progressive ou de couverture sociale pour toute personne encore en stage ou en formation, mais dont l’objectif est de s’installer.
Il s’agit également, comme l’a souligné mon collègue Jean-Jacques Mirassou, de l’extension du contrat de génération jusqu’à trente ans, afin de faciliter la transmission. Tout cela constitue des avancées majeures.
D’un point de vue peut-être plus technique mais tout aussi important, ce projet de loi place l’installation au cœur des objectifs de clarification du contrôle des structures. La consolidation des exploitations est bien sûr d’un intérêt crucial, mais lutter plus efficacement contre les contournements de la réglementation, c’est d’abord et avant tout permettre à des jeunes de s’installer plus facilement.
Toujours dans le souci constant de s’adresser aux jeunes générations, ce texte vise à supprimer purement et simplement le critère unique de la surface minimum d’installation, qui constituait une contrainte importante dans certains départements, pour intégrer la notion, plus juste, de temps de travail. Une telle mesure était demandée de longue date par les jeunes agriculteurs, mais c’est bien notre majorité – et vous-même, monsieur le ministre – qui la met en œuvre.
Un projet de loi comme celui-ci, tourné vers les jeunes, l’agroécologie, la compétitivité et la modernisation de notre agriculture, est en réalité, je tiens à le dire, un beau texte ambitieux.
Ma conviction est que, dans les moments économiques difficiles comme ceux que nous traversons actuellement, les territoires ruraux, et le domaine agricole en particulier, ont tant de choses à nous apporter. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont 30, 5 millions d’euros en un an qui ont été investis dans des entreprises qui ne se délocaliseront pas, comme se plaisent à me le rappeler les jeunes agriculteurs que je côtoie sur le terrain. À ce jour, ils font de plus en plus le choix de la qualité, s’inscrivant dans des démarches de reconnaissance en AOP. Vous le savez, le Pays basque en revendique l’une des plus belles reconnues en Europe et en Asie, celle du piment d’Espelette.
En conclusion, permettez-moi de saluer la décision très importante de renforcer le droit d’opposition de l’INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité, sur le dépôt de marques commerciales.
L’agriculture est une vraie filière d’avenir, mais c’est surtout et avant tout une filière à laquelle les Françaises et les Français sont profondément attachés. Je suis convaincue que, par ce projet de loi, vous les aiderez. C’est la raison pour laquelle nous serons derrière vous et voterons ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC . – M. Yvon Collin applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d’abord saluer la qualité de l’ensemble des interventions et, bien sûr, chercher à répondre d’abord à ceux qui émettent des critiques sur ce projet de loi.
Tout d’abord, je l’ai déjà dit à l’un d’entre vous, la politique agricole commune a été négociée en 2003, sous la présidence de Jacques Chirac, qui fut un grand ministre de l’agriculture.
M. Bruno Sido applaudit.
Le découplage des aides a été décidé à cette date. Si, depuis 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les différents ministres de l’agriculture ont négocié, ce fut justement pour éviter un découplage à 100 % des aides.
J’ai bien compris que le projet d’origine de la Commission européenne tendait à ne plus lier l’aide à la production. Ce choix stratégique très libéral consiste à confier l’arbitrage concernant les productions aux agriculteurs, en fonction de leurs avantages spécifiques, dans la mesure où les aides à l’hectare seront partout les mêmes. Tel était le projet initial. À l’échelle de l’Europe se dessinait ainsi une spécialisation des pays et des régions en fonction des avantages comparatifs des uns et des autres.
Si vous n’avez pas tout cela en tête, mesdames, messieurs les sénateurs, nous ne pourrons pas discuter aujourd’hui des arguments que vous avez quelquefois avancés et qui sont d’ailleurs contradictoires, puisque vous êtes très tentés par la logique libérale.
La politique agricole commune décidée en 2003 avait pour objectif de découpler totalement les aides. Qu’ai-je fait ? Sur quoi me suis-je battu ? Justement pour empêcher un découplage à 100 %, pour coupler de nouveau certaines aides, en particulier en matière d’élevage, en y ajoutant même, avec, d’ailleurs, l’appui du Parlement européen, des aides couplées, afin de développer l’autonomie fourragère de l’Europe. Il s’agit des deux points concernant les protéines végétales.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Sur ce sujet, idéologiquement et politiquement, si vous voulez être cohérents, il y a un choix à faire entre la logique de découplage décidée en 2003 et celle que j’ai négociée et qui vise à remettre en place un couplage des aides pour équilibrer les productions et éviter la disparition de certaines productions, en particulier de l’élevage. C’est une question politique qu’il vous faut trancher ! Pour ma part, c’est ce que j’ai fait !
Applaudissements
Par ailleurs, vous avez largement évoqué le renouvellement des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs. Or vous avez voté – ceux d’entre vous qui étaient là ! –, en 2006, une loi extrêmement libérale sur l’installation des jeunes agriculteurs, qui revenait sur le pouvoir accordé aux SAFER. Qui demande aujourd'hui à reconsidérer cette loi ?
Les socialistes, sûrement, les écologistes, aussi, les communistes, bien entendu, et les radicaux ! Surtout, ce sont les professionnels et les jeunes agriculteurs qui y sont le plus opposés !
Qui vient nous voir pour renforcer encore plus le rôle et la place des SAFER ? Le président de la fédération nationale des SAFER ! Et vous nous dites aujourd'hui, notamment M. Pointereau, que nous mettons en cause la liberté d’installation et la propriété.
Allez donc discuter directement avec les représentants professionnels des SAFER ! Comment peut-on considérer qu’en libéralisant l’accès au foncier, on permettra aux jeunes de s’installer ? Où avez-vous vu cela, monsieur Pointereau ? Regardez la réalité en face et allez, vous aussi, discuter avec les responsables des SAFER et les professionnels de l’agriculture. Ils vous diront que l’enjeu de l’installation est majeur et que nous avons mis en place tous les éléments permettant de la favoriser. Si nous renforçons le rôle des SAFER, c’est justement parce que nous voulons éviter les agrandissements excessifs et favoriser l’installation des jeunes. Tel est l’objet de ce projet de loi, vous ne pouvez pas dire le contraire ! Sinon, il vous faut l’assumer clairement.
Monsieur Retailleau, vous avez ensuite parlé – et c’était très intéressant – des contraintes et des contradictions.
Aujourd’hui, l’enjeu – et je reprends là ce qui a déjà été dit sur ce projet de loi par Joël Labbé et d’autres –, c’est de savoir si l’on est capable de passer à un autre modèle, aussi productif que le modèle actuel mais, en même temps, performant sur le plan environnemental.
Je ne comprends pas certaines réactions : lorsque je présente ce projet de loi, qu’on organise des réunions « Produisons autrement », lorsque, à l’UNESCO, 450 enseignants viennent pour enseigner autrement, on engage un processus qui n’est ni technocratique ni politique. C’est une décision qui s’appuie sur des réalités de terrain, sur des exemples qui prouvent que, en changeant les modèles de production, on réduit de manière très significative le recours aux phytosanitaires, aux herbicides. Ces exemples montrent qu’en même temps on est capable de développer de la biodiversité, de la matière organique dans les sols en obtenant des rendements aussi élevés, voire plus élevés qu’avec un modèle de production conventionnel.
Pourquoi ne voulez-vous pas regarder cela objectivement, rationnellement ?
Je serai dans le rêve et vous dans une réalité, bien sûr ! Celle d’un conservatisme qui refuse de regarder les possibilités du progrès !
Je vous le dis objectivement. Venez voir les exploitations qui ont réussi ! Et il y en a d’ailleurs en Vendée, monsieur Retailleau.
Quand vous voulez, monsieur le sénateur !
Techniquement, par exemple, sur la conservation des sols, on peut aujourd'hui se passer de labour – labourage, pâturage, les deux mamelles de la France ! C’est une vraie question, mais on peut s’en passer parce qu’on dispose de macro-organismes qui peuvent travailler à notre place. Vous le savez ? Non ! Vous voulez le regarder objectivement ? Non !
Pourtant, la couverture des sols et les rotations existent aujourd'hui. Alors, au nom de quoi refuseriez-vous cette idée du progrès ?
Comment faisons-nous pour diffuser ces pratiques qui sont à la fois productives et de nature à préserver l’environnement. Pourquoi ne voulez-vous pas regarder cela de manière objective ? L’agroécologie, c’est cela ! À partir de démarches pionnières, on favorise le développement de bonnes pratiques, en donnant aux agriculteurs la capacité de réussir la double performance économique et environnementale.
Je sais que, sur vos travées, les esprits progressent, sauf chez certains.
Et j’accepte le débat. Mais il faudrait que vous soyez techniquement plus solides et capables de me prouver que je rêve et que, vous, vous êtes dans la réalité.
Moi, je vous le dis, je suis dans la réalité de demain, celle qui va apparaître. Vous la regarderez ou vous ne la regarderez pas. Mais les choses sont partout en train de bouger.
Vous avez soulevé la question des phytosanitaires. À cet égard, j’évoquerai l’industrie du biocontrôle. Le 22 avril prochain, une grande réunion aura lieu au ministère de l’agriculture avec un grand nombre de PME, créatrices d’emplois, et surtout exportatrices. Le pire, c’est que nos industries, nos PME d’où sont issus les produits du biocontrôle – il en existe une dans la Sarthe, il y en a partout en Bretagne – sont en train d’exporter en Europe et à l’étranger : au Canada, en Pologne, au Japon. Un accord entre Goëmar et un industriel japonais vient d'ailleurs d’être conclu.
Derrière cela, il y a une innovation qui consiste à apporter des substituts et des alternatives à l’utilisation des phytosanitaires chimiques. Vous ne voulez pas considérer cet état de fait ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cela ne compte pas ?
Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.
Vous avez critiqué ce projet de loi, acceptez que je vous réponde. Je vous réponds précisément, je ne vous raconte pas d’histoires ! Êtes-vous d’accord avec le développement de l’industrie du biocontrôle ?...
Si vous êtes d’accord avec cette idée, admettez alors qu’il y aura moins de phytosanitaires chimiques !
Cela peut-il être rationnellement intégré dans votre discours ? Voilà l’effort que je vous demande.
Ah, c’est du baratin ? Voulez-vous que je vous emmène voir les entreprises ?...
Moi, je continuerai à développer cette idée. Vous ne voulez pas évoluer sur ce sujet !
Mais si, parce que la loi soulève ces questions et prévoit une organisation.
Vous critiquez le GIEE en disant que ce n’est rien. À l’époque des CUMA, y a-t-il eu une loi ?
Et a-t-on critiqué le fait que les CUMA permettaient aux agriculteurs de s’organiser collectivement ? Non ! Cela fait soixante ans qu’elles existent.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le GIEE est justement volontaire, et c’est cela que vous critiquez. Là encore, soyez cohérents ! Si vous voulez du normatif et du législatif pour imposer une organisation aux agriculteurs, ne venez pas dire ensuite que c’est une norme supplémentaire ! C’est justement volontaire. Soyez cohérents ! Si vous voulez critiquer, il vous faut de la cohérence. Or vous n’en n’avez pas aujourd’hui ; en tout cas, pas dans les propos que j’ai entendus.
Applaudissements
Je réponds rationnellement, je ne suis pas dans l’excès.
Vous avez ensuite évoqué d’autres sujets. Je vous répondrai en particulier sur la question de la compétitivité, qui est un vrai sujet.
C’est un sujet de loi de finances, qui, comme je l’ai dit hier, porte sur l’ensemble des questions relatives à l’industrie et à l’agriculture. Cette question ne date pas d’aujourd’hui.
Car si nous avons perdu de la compétitivité, chacun en porte largement la responsabilité. Nous sommes au pouvoir depuis vingt-deux mois. Si les pertes de parts de marché, en particulier dans agriculture, sont intervenues et si la baisse de la production que vous dénoncez a eu lieu, cela s’est produit au cours des dix dernières années. Ce n’était pas nous qui étions au pouvoir !
Je ne parle même pas de Nicolas Sarkozy. Vous l’avez constaté, j’ai même parlé en bien de Jacques Chirac, …
… en précisant que c’était un grand ministre de l’agriculture.
Je suis donc tout à fait capable de porter des jugements. Mais la perte de compétitivité, objectivement, c’est votre responsabilité, car cela date de dix ou douze ans, bien avant notre arrivée.
Aujourd’hui, que fait le Gouvernement ? Avec le pacte de responsabilité, il s’agit justement de redonner de la compétitivité grâce à plus de 30 milliards d’euros de baisses de charges dont bénéficiera aussi l’agriculture, en particulier les coopératives qui n’ont pas profité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Je terminerai sur la question de l’azote, qui a été évoquée.
Je voudrais, là aussi, que vous alliez voir des professionnels en Bretagne. La déclaration de l’azote minéral, c’est le projet de l’azote total. Lorsqu’il existe un excédent d’azote organique, comme c’est le cas en Bretagne, l’objectif est d’essayer d’utiliser cet excédent à la place de l’azote minéral.
Cela s’appelle l’azote total.
Vous n’avez pas cessé de répéter que c’était une norme supplémentaire. Au contraire, c’est justement une opportunité pour traiter les excédents d’azote organique et éviter en même temps d’acheter et d’importer de l’azote minéral.
La seule contrainte fixée concerne les coopératives ou les vendeurs d’azote, et non pas les agriculteurs, qui devront déclarer ce qu’ils vendaient en azote minéral pour voir la substitution entre l’utilisation de l’azote minéral grâce à la méthanisation et la diminution de l’azote minéral. L’objectif est de mieux utiliser l’azote et d’éviter, comme cela se passe aujourd’hui, qu’une partie de l’azote épandue ne se retrouve dans les rivières, avec les conséquences que l’on sait en termes de pollution.
Tel est l’objectif de cette mesure. Aucune contrainte supplémentaire n’a été introduite par rapport aux normes européennes depuis mon arrivée à ce ministère.
Tout l’enjeu de ce débat est de changer la logique qui prévaut actuellement. Telle est la mutation à laquelle nous incite ce projet de loi, et je crois qu’ici, au Sénat, il y aura une large majorité pour engager l’agriculture vers cette grande mutation et ce bel avenir. §

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :
« Livre préliminaire
« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE MARITIME
« Art. L. 1 . – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa triple dimension européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi, le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;
« 1° bis De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales fondées sur le respect des principes de la souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable ;
« 2° De soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de l’agriculture et d’autonomie et de responsabilité individuelle de l’exploitant. Elle vise à améliorer la qualité de vie des agriculteurs ;
« 3° De contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
« 3° bis De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;
« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable ;
« 4° bis De prendre en compte les situations spécifiques à chaque région. Elle valorise en particulier les services écosystémiques ;
« 4° ter (nouveau) De rechercher des équilibres sociaux justes et équitables ;
« 5° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France, en encourageant la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;
« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques au sens de l’article L. 641-13 ;
« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie dans le secteur agricole, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par une valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;
« 7° De développer l’aide alimentaire ;
« 8° De lutter contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement et en cohérence avec les politiques de développement et de solidarité internationale française et communautaire.
« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.
« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise :
« 1° L’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles ;
« 2° Le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie végétale ;
« 3° Les actions de recherche et développement ;
« 4° L’organisation collective des acteurs ;
« 5° Le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 6° Les actions contributives réalisées par l’agriculture et la sylviculture en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ;
« 7° L’équilibre des relations commerciales ;
« 8° La protection des terres agricoles.
« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agricole et les pratiques agronomiques permettant d’associer la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s’appuient sur les pratiques de l’agro-écologie, dont le mode de production biologique fait partie.
« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique tout en diminuant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.
« L’État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.
« L’État veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.
« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.
« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales et les acteurs locaux à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les notions de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.
« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.
« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation, définis au présent livre, et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs dans une relation partenariale ou contractuelle, conciliant des objectifs de développement de l’agriculture sur les territoires et de qualité de l’alimentation répondant aux attentes des consommateurs.
« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le Conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. –
Non modifié
« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;
« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles en adéquation avec les enjeux que ces derniers représentent en matière d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité ou de gestion foncière ;
« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;
« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.
« Dans le cadre de cette politique, l’État protège et valorise les terres agricoles, facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.
« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.
« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs.
« Art. L. 2 . –
Non modifié
I bis. –
Non modifié
« 3° bis Maintenir et développer les secteurs de l’élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l’aménagement et au développement des territoires ; ».
II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’État veille :
« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;
« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;
« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;
« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;
« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;
« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales ;
« 7° Au développement des territoires. » ;
c §(nouveau)) Au second alinéa, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « La politique forestière a pour objet » et la troisième phrase est supprimée.
III. –
Non modifié
IV
La parole est à M. Charles Revet, sur l'article.

Je m’interrogeais sur l’opportunité de m’exprimer à ce stade du débat, mais ce que vous venez de nous dire, monsieur le ministre, m’a conforté dans ma volonté. Il m’apparaît en effet nécessaire de se demander ce qui est du ressort de la loi et ce qui ne l’est pas.
Vous nous avez dit que les deux tiers des mesures devraient probablement relever de la gestion propre des agriculteurs, des organismes professionnels et autres, et qu’on ne devrait pas tout mettre dans la loi.
Pourtant, ce projet de loi comporte 151 pages et 40 articles. Qui plus est, l’article 37 – c’est désormais une habitude dans pratiquement tous les textes ! – autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance. Je ne sais pas si cela fera plaisir à notre collègue Serge Larcher, mais, honnêtement, c’est choquant pour le Parlement !
Dans un texte où l’on s’efforce de clarifier, de suggérer, d’imposer dans certains cas, un certain nombre de dispositions, il est choquant que soit donné au Gouvernement le soin de légiférer par ordonnance. Je sais bien que cet article vise l’outre-mer, mais, même si cela va peut-être faire plaisir à notre collègue Serge Larcher, ce n’est pas normal.

Qu’on nous le demande d’une manière particulière parce qu’un problème doit être traité en urgence, soit. Mais une telle disposition me choque dans un texte où, normalement, on devrait tout considérer.
Par ailleurs, est-il vraiment indispensable de prévoir à l’article 1er soixante-deux alinéas pour rappeler les missions de l’agriculture ? La loi est un cadre dans lequel on travaille. Y faire figurer autant de dispositions comporte certains risques, monsieur le ministre. Plus vous en mettez, plus vous ouvrez des possibilités de recours. Le juge pourra se fonder sur tel ou tel alinéa de l’article 1er pour sanctionner le non-respect de la loi. On devrait donc se poser cette question, monsieur le ministre.
Je pensais que la pêche n’était plus de votre responsabilité, sauf peut-être au travers de l’agroalimentaire.
M. le ministre acquiesce.

L’alinéa 46 de l’article 1er du présent projet de loi dispose : « La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »
Cela paraît logique, mais je ne pense pas qu’il soit forcément nécessaire de faire figurer ces dispositions dans la loi. Mais, dans la LMAP, nous avions, sur mon initiative, indiqué qu’il était souhaitable – et nous avions donné des délais – d’établir un schéma le long du littoral pour déterminer les zones à protéger réellement – et il y en a ! –, les zones où on peut développer des activités économiques, l’aquaculture notamment, ainsi que celles qu’il faut peut-être préserver avec une destination future.

Monsieur le ministre, à ma connaissance, cela n’a jamais été fait, même si une date avait été fixée.
Monsieur le sénateur, on est toujours pris dans un dilemme s’agissant de débats qui concernent un secteur comme l’agriculture.
À la limite, le Gouvernement, le ministre de l’agriculture, pourrait définir à certains articles – c’est le cas en particulier de cet article 1er – les grands objectifs de la loi. Le débat démocratique impose que les sénateurs, les députés, c'est-à-dire les assemblées parlementaires, participent à des débats d’orientation, qui sont quand même importants. Mais, après tout, on pourrait dire que c’est le Gouvernement, l’exécutif, qui décide de l’orientation.
Oui, mais si l’article 1er existe sous cette forme, c’est aussi parce que des débats d’orientation ont eu lieu. Certaines dispositions ont été modifiées, ou vont l’être, notamment par le Sénat. Cela intervient dans un esprit démocratique.
En même temps, vous le soulignez vous-même, pourquoi faire des lois avec des articles qui, en définitive, définissent plutôt des orientations que des mesures législatives ? C’est une vraie question, un vrai dilemme, car la représentation nationale a, elle aussi, son mot à dire sur ce que sont les débats d’orientation. Donc, là, on a du mal à trouver l’équilibre, je suis assez d’accord avec vous.
Toujours est-il que j’ai veillé, avec tous ceux qui ont travaillé sur ce texte au sein de mon cabinet, à faire court : trente-neuf articles.
Je suis d’accord, c’est peut-être encore trop. Mais on a cherché à être dans cet esprit d’équilibre. Donc, c’est un vrai dilemme.
Sur la question du schéma, j’ai bien noté vos remarques. Cela doit relever de la compétence du ministère de l’environnement et de l’écologie, j’en discuterai pour savoir où on en est.
En effet, nous le savons tous, derrière l’agriculture, il y a l’aquaculture, la conchyliculture… La production d’algues représente même un enjeu majeur pour l’avenir, …
… car les algues contiennent des matières actives, des protéines qui pourraient servir pour l’alimentation animale.
Voilà une nouveauté qui va arriver ! On ne s’en rend pas compte, mais derrière tout cela il y a d’énormes potentialités.
Sur cette question, il faudra préciser les choses. Je poserai la question à Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, afin que nous puissions aller jusqu’au bout.
Enfin, s’il est fait référence à la pêche à l’article 1er, c'est parce que cette loi modifiera des articles du code rural et de la pêche maritime.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.

La séance est reprise.
L'amendement n° 593, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après le mot :
dimension
insérer le mot :
internationale,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ….° Dans le cadre la politique agricole définie par le Gouvernement, de promouvoir au niveau international et européen la spécificité du secteur agricole au regard des enjeux en termes d’indépendance alimentaire de tous les peuples et de dénoncer les processus de standardisation, d’homogénéisation des pratiques de production, et des dispositifs de marchandisation de l’agriculture ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.

L’alinéa 4 de l’article 1er du projet de loi souligne la triple dimension de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, laquelle a vocation à être déployée aux niveaux territorial, national et européen.
Par cet amendement, nous voulons introduire à ces différents échelons la dimension internationale de l’agriculture, qui s’impose de fait – d’ailleurs pas toujours avec bonheur ! – aux politiques européenne et nationale.
Nous souhaitons en effet que la France puisse porter une politique qui défende la spécificité du secteur agricole au regard tant des enjeux humains que de ceux qui sont liés à l’indépendance alimentaire.
Avec la mondialisation des marchés et des capitaux, la politique agricole ne peut plus être simplement définie à l’échelon national ou communautaire : elle est de fait internationalisée, avec les pressions et les contraintes que cela peut induire. Dans les cas, notamment, de l’application des brevets sur les semences ou de la politique d’appropriation terrienne appliquée par certains pays, la dimension internationale ne peut pas être négligée. Il est du devoir du législateur de la prendre en compte, afin que nulle situation ne soit hors du droit.
Il nous apparaît nécessaire que la mention internationale figure dans le projet de loi, de manière à protéger le secteur agricole français contre l’hyper-marchandisation des terres et la standardisation des moyens de production.
Actuellement, nos politiques sont fortement conditionnées par celles qui sont menées à l’Organisation mondiale du commerce ou à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que par celles qui sont discutées dans le cadre des accords de partenariats bilatéraux, comme celui du traité transatlantique. Malgré les propos supposés rassurants de l’ancien ministre chargé des affaires européennes, Thierry Repentin, interrogé à ce sujet lors d’un débat de la commission des affaires européennes au Sénat, on peut craindre que ce traité ne fasse qu’introduire encore plus de libéralisme dans notre secteur agricole et nos services publics.
La suppression des droits de douane, censée renforcer les capacités exportatrices des États-Unis et de l’Union européenne, organisera un véritable dumping économique et environnemental au détriment des pays du Sud. Le secteur agricole sera définitivement livré à la loi de l’offre et de la demande, même pour ce qui est des normes. Dans un tel cadre, quid de la sécurité et de la souveraineté alimentaires ? Que vont devenir l’agroécologie, la relocalisation des activités agricoles, les circuits courts et l’agriculture paysanne ?
Il est temps de définir une véritable législation internationale des droits des paysans. Parce que l’agriculture mondialisée est un fait, nous proposons, par cet amendement, de l’intégrer dans le projet de loi de manière à anticiper les dérives et abus qui sont le lot quotidien des agriculteurs.

Il s’agit d’un amendement d’intention intéressant, qui tend à ajouter une dimension internationale aux politiques agricoles.
Le projet de loi indique que les objectifs de la politique agricole s’inscrivent dans une dimension qui est à la fois européenne, nationale et territoriale. Définir dans la loi un tel cadre se justifie, car il existe au niveau européen une très forte intégration des politiques agricoles au travers de la PAC.
Rien de tel n’existe au niveau international, même si la coordination progresse légèrement.
Autant il est nécessaire de préciser le cadre de la politique agricole nationale et territoriale, autant il serait curieux de fixer dans la loi nationale des objectifs pour la politique de l’agriculture à l’échelon international, dont nous n’avons pas les moyens d’assurer le respect. Tel n’est pas le rôle de cette loi.
Je note aussi que la dimension internationale de la politique agricole est déjà précisée à l’alinéa 17 de l’article 1er.
Aussi, même si je comprends votre intention, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement d’appel, qui ne peut être intégré dans ce texte ; à défaut, je serai obligé de donner un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 590, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
l’accès
insérer le mot :
quotidien
La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Le Cam, votre amendement, que vous avez bien défendu
Sourires.

Cependant, en évoquant « l’accès à une alimentation sûre et saine », sans en indiquer toutes les dimensions, l’alinéa 5 préserve une approche large, qui est la plus pertinente lorsqu’il s’agit de définir les objectifs d’une politique publique.
Comme le précédent, cet amendement est un amendement d’appel. Je ne pense pas que l’on puisse inscrire cette disposition dans la loi. Aussi, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L'amendement n° 590 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 152 est présenté par Mme Blandin, MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 457 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après le mot :
paysages
insérer les mots :
, le respect du bien-être animal
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 152.

À l’heure où les électeurs attendent aussi de nous du sens et de la transparence sur les objectifs des politiques publiques, il est remarquable que le projet de loi mentionne les objectifs poursuivis par la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.
Monsieur le ministre, vous tenez, d’une part, à la compétitivité et, de l’autre, à l’agroécologie. Il existe des espaces où ces deux ambitions sont compatibles.
Tout à l'heure, j’écoutais M. Retailleau nous parler de mondialisation et de compétitivité, et nous dire qu’il fallait être à la hauteur. Certes, mais on ne peut pas l’être à tout prix !
Je pense aux enfants du Costa Rica grâce auxquels nous pouvons trouver des ananas à cinquante centimes dans les hypermarchés. Or deux ans de déambulation dans les rangées d’ananas traités aux phytosanitaires suffisent pour que ces enfants n’aient plus de peau sur les jambes ! La compétitivité ne doit donc pas être une religion.

Elle se construit dans le respect du social, de l’environnement et de l’économie.
Notre amendement vise à mentionner dès le 1° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime que l’article 1er vise à créer « le respect du bien-être animal ».
Depuis des millions d’années pour l’espèce humaine et quelques centaines de milliers d’années pour l’homo sapiens, les traces des foyers révèlent la consommation de viande – bien sûr en moindre quantité que de nos jours ! –, en particulier aux États-Unis et en Europe. Oui, nous sommes omnivores ! Si chacun devait aujourd'hui élever et, surtout, tuer ce qu’il mange, gageons que la consommation serait moindre et, en outre, que moins de protéines finiraient dans les déchets jetés à la poubelle.
Aux côtés de ceux qui ont fait le choix d’être végétariens, …

… ceux qui mangent de tout n’en sont pas moins soucieux d’être assurés que les animaux qu’ils consomment sont correctement traités.
Finir en saucisson ou en escalope n’est pas un destin enviable
Rires.

Le 3° peut donner l’impression que l’amendement des écologistes est déjà satisfait en ce qu’il dispose que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation a pour finalité de « veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux ».
Toutefois, cette juxtaposition entraîne une interprétation sanitaire du bien-être. S’il est louable de veiller à ce que les animaux, comme les végétaux, ne soient pas malades, la prévention ou l’éradication des maladies diffère du respect de leur bien-être, au sens de notre amendement. Faire figurer cette précision au 1° renvoie davantage à des notions d’espace, de support, de mobilité, toutes choses auxquelles les éleveurs avisés savent veiller.
M. Joël Labbé applaudit.

Si chacun prend autant de temps pour défendre ces amendements, on ne va pas s’en sortir !

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 457 rectifié.

Plus sérieusement, cet amendement est tout à fait cohérent, puisque l’alimentation issue de l’élevage – produits carnés et laitiers, poissons, etc. – est un secteur sensible, régulièrement touché par des crises sanitaires – il y en a eu quelques-unes cette année. D’ailleurs, le groupe UDI-UC a été à l’origine de la création d’une mission commune d’information à la suite de l’affaire des lasagnes à la viande de cheval. Quand les crises sanitaires liées à l’élevage et à la viande se multiplient, les conditions de l’élevage et le respect du bien-être animal doivent être des préoccupations majeures.
C'est la raison pour laquelle, sur la base d’arguments certes moins pertinents, moins philosophiques et moins frappants que ceux de ma collègue Marie-Christine Blandin, Chantal Jouanno souhaite insérer, après le mot « paysages », « le respect du bien-être animal ».

Il ne nous revient ni de trancher les débats philosophiques ni de débattre du bien-fondé du végétarisme.
Mes chères collègues, vos amendements identiques sont intéressants, mais ils sont déjà satisfaits : l’ajout que vous proposez est redondant avec l’alinéa 8 de l’article 1er. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir les retirer.
Je veux juste signaler que c’est la première fois qu’il est fait référence à la notion de bien-être animal dans une loi agricole.
Le Gouvernement considère donc, lui aussi, que les deux amendements identiques sont satisfaits.

Si je suis sensible à l’humour avec lequel ces amendements identiques ont été présentés, j’estime qu’il ne faut pas laisser passer la notion de bien-être animal – M. le ministre vient de préciser qu’elle figure dans une loi pour la première fois – sans attirer l’attention de nos collègues sur ce qu’elle recouvre.
Sachez, mes chers collègues, que ce n’est pas par hasard qu’elle apparaît dans le paysage médiatique français : elle procède d’une théorie directement inspirée de certains groupuscules anglo-saxons, nés aux États-Unis. Ces groupuscules, que l’on qualifie de « végétaliens », dénient à l’homme tout droit à la consommation d’êtres vivants, qu’il s’agisse des animaux que l’on élève, du gibier susceptible d’être chassé ou, même, des végétaux, puisqu’ils partent du principe que les plantes peuvent souffrir.
Avec une telle extension, nous sommes sur une pente extrêmement dangereuse ! Le bien-être animal relève de la seule subjectivité. En effet, comment peut-on définir d’une manière objective ce qu’est le bien-être animal ? Comment peut-on interroger un animal pour savoir s’il se sent bien ou non ? Cette dérive est grave.
Nous allons discuter tout à l’heure du problème de la prédation par le loup des troupeaux d’ovins. On pourrait aussi parler des grands carnivores africains, qui attaquent les gazelles et les antilopes. Comment préserver le bien-être animal dans le contexte, tout à fait naturel, de la prédation entre animaux ? C’est la loi de la nature.
Cette approche philosophique tend à exclure la présence même de l’espèce humaine au sein des équilibres naturels. Or l’homme est un carnivore…

… et, comme tel, il doit se nourrir de ces équilibres.
Pour ma part, je veux simplement opposer à cette démarche purement subjective, qui confine à la sensiblerie, le code pénal, lequel prévoit la notion de « mauvais traitements envers un animal ». Ainsi, les articles R.653-1, R.654-1, R.655-1, 521-1, pour ne citer que ceux-là, prévoient, de manière tout à fait objective, ces cas de mauvais traitements et infligent à leurs auteurs des sanctions extrêmement lourdes.
Vous avez sans doute entendu parler de ce récent fait divers, parfaitement scandaleux : quelqu’un s’était amusé à jouer à la balle au prisonnier avec un chat, qu’il lançait contre un mur.

La simple application du code pénal a permis aux tribunaux de sanctionner très fortement, à juste titre, l’auteur. N’en rajoutons donc pas. Ne cédons pas à la pression médiatique. Il faut un peu raison garder dans ce pays !
Madame Goulet, l’homme et la femme font partie de la nature !
Sourires.

Mes chers collègues, nous avons plus de 700 amendements à examiner. Je vous demande donc de faire preuve de concision !
La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Monsieur le président, je serai très bref, car l’intervention de M. Cardoux recoupe largement ce que je comptais dire. Permettez-moi simplement d’ajouter deux éléments.
Premièrement, les éleveurs ont fait beaucoup d’efforts au cours de ces dernières décennies pour le bien-être animal. Les règlements me semblent appliqués. N’en rajoutons pas trop !
Deuxièmement, je ne comprends pas comment les auteurs de tels amendements, qui se disent sensibles au bien-être animal, ne se mobilisent pas en faveur de la diminution de la population de loups, qui, en 2013, ont égorgé et fait souffrir durant des nuits et des jours 6 768 petits agneaux et autres brebis sur notre territoire. Chers collègues, comment pouvez-vous ne pas vous élever contre cette souffrance, alors que, année après année, les loups dévorent de plus en plus d’agneaux et traumatisent les éleveurs ?
C’est pourquoi je ne voterai bien évidemment pas ces amendements identiques !

Oui, monsieur le président.
Je ne veux pas allonger inutilement les débats, mais je veux dire à mon collègue qu’il ne m’a pas écoutée.
Monsieur Cardoux, j’ai inscrit l’histoire de l’humanité dans son caractère omnivore, et non carnivore ! Vous poussez le bouchon un peu loin…
Au demeurant, je ne m’inspire pas du tout des groupuscules que vous avez évoqués.
Pour ma part, je vous ai écouté, et j’ai noté que votre propos comportait une part d’incohérence
M. Bruno Sido s’exclame.

Je vais le retirer, monsieur le président.
J’ai bien écouté ce qu’a dit le rapporteur. Même si j’ai présenté mon amendement avec une note d’humour, monsieur Cardoux – il faut dire que je rentre de vacances !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 591, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
la compétitivité
par les mots :
l’efficacité économique, environnementale, sociale
La parole est à M. Gérard Le Cam.

L’alinéa 7 de l’article 1er du projet de loi prévoit, au titre des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime, le fait de « soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation ».
Notre amendement tend à substituer le mot « efficacité » au mot « compétitivité ».
Nous sommes bien entendu d’accord sur la nécessité de mettre en œuvre une politique agricole garantissant des revenus décents et, par conséquent, développant l'emploi. Il est sans aucun doute essentiel de revoir le partage de la valeur ajoutée au sein des filières agricoles.
En 2013, le revenu de la « ferme France » a baissé de près de 4 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Certes, au final, la diminution du nombre d'agriculteurs – de 2 % à 4 % par an – a relativisé l'ampleur de la chute du revenu, puisqu'il est divisé entre moins d'actifs.
Si nous partageons ce constat, nous ne pensons pas, en revanche, que la compétitivité soit la clef. En effet, l’un des éléments récurrents de cette compétitivité, comme vous l'avez écrit, monsieur le ministre, dans la réponse à une question écrite d'un député UMP en juillet dernier, est la baisse du coût du travail.
Pour notre part, nous estimons que cette rhétorique et la politique qu'elle recouvre doivent être abandonnées, car elles font du travail la variable d'ajustement.
Aujourd'hui, les pays européens cherchent à être compétitifs dans la production agricole en permettant aux producteurs de rémunérer des saisonniers étrangers détachés, originaires de pays à très bas niveaux de salaires et de protection sociale – entre trois et six euros de l'heure, sans aucunes charges sociales.
La compétitivité se résume à produire moins cher que son voisin ; elle est destructrice d'emploi, de revenu et de salaire. C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer ce terme et de le remplacer par l'expression « efficacité économique, environnementale et sociale ».

Nous avons intégré dans le texte, via un amendement que j’avais présenté, la triple performance économique, sociale et environnementale. Elle est indispensable. Pour autant, je ne peux pas, monsieur Le Cam, partager vos motivations. La compétitivité, ce n’est pas un gros mot !

La compétitivité est indispensable dans l'économie en général et dans l’économie agricole en particulier. C'est grâce à la compétitivité que nous nous en sortirons et, en supprimant ce mot, vous affaiblissez la part économique de l'agriculture.
Tout en partageant votre analyse sur l’efficacité sociale, environnementale et économique, je reste, cependant, très opposé à cette suppression, qui affaiblirait, je le répète, l’ensemble du texte et donc l’économie agricole, ce que nous ne saurions envisager au moment où l’agriculture souffre, où elle a besoin de gagner des parts de marché.
Non, la compétitivité, ce n’est pas un gros mot. Tout dépend de la façon dont elle est mise en place. La compétitivité, c'est la base du développement économique de notre agriculture. §
Je partage les arguments de M. le rapporteur. J’ajouterai un mot : on est dans une économie de marché.
Sur un marché, on trouve une offre, et les acheteurs arbitrent en fonction de la qualité, de la quantité et des prix. Ainsi, dans certains secteurs de production, des pays exportent, tandis que nous importons ou que nous perdons des parts de marché.
Il faut tenir compte de cette idée toute simple : dans une économie de marché, il existe nécessairement un élément de comparaison, et donc de compétitivité. Il faut l’assumer et, comme l’a dit le rapporteur, il faut, en même temps, assumer le fait que nous ayons derrière un projet économique, environnemental et social.

Je voudrais remercier notre collègue Gérard Le Cam d’avoir déposé son amendement : on aborde ainsi la question de la compétitivité, ce qui, d’une certaine façon, est rassurant. De même, je remercie M. le rapporteur et M. le ministre d’avoir – enfin ! – parlé de compétitivité dans ce texte.
Finalement, cher Gérard Le Cam, j’observe que vous voulez que l’on parle d’agroécologie : au travers de votre amendement, vous donnez en effet la définition du développement durable. On ne parle que de cela dans ce texte ! Il est donc rassurant de parler un peu de compétitivité. Que M. le ministre et M. le rapporteur reconnaissent que notre agriculture a besoin de compétitivité parce qu'elle est en concurrence avec les autres économies et les autres agricultures mondialisées, oui, cela me rassure un petit peu !

Quand notre collègue Gérard Le Cam parle d’efficacité économique, sociale et environnementale, c'est bien pour améliorer en particulier la qualité économique de nos productions. En tant qu’écologiste, je préfère aussi le terme d’« efficacité » à celui de « compétitivité ».
En effet, la compétitivité à tout crin tire toujours tout vers le bas ; c’est ce que l’on vit aujourd'hui péniblement. C’est pourquoi, je le répète, je préfère l’efficacité économique, environnementale et sociale.

Avec la compétitivité de notre agriculture, nous nous situons au cœur du débat. Nous l’avons tous dit à droite, nous sommes dans une agriculture et une économie mondialisées. Or, si la « ferme France » ne sait pas produire à un fort niveau de compétitivité des produits abordables pour les consommateurs, ces produits viendront d’ailleurs.
C'est ce qui se passe depuis des années dans la grande distribution, où nous ne pouvons plus acheter certains produits provenant de notre pays. Ces produits, il a fallu aller les chercher ailleurs, en Europe, voire dans des contrées bien plus lointaines.
La compétitivité n’est donc pas un gros mot. Il faut que l’on sache, en France, trouver des modèles qui respectent l’environnement – j’en suis parfaitement d’accord ! – et nos normes sociales, mais qui permettent aussi de produire pas cher, sans quoi d’autres pays le feront et inonderont notre marché. §

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Cet amendement a l’intérêt de provoquer un débat : nous sommes en train de parler de choix de société.
Pour commencer, je veux dire qu’il est possible de sortir d’une économie de marché. On peut décider d’engager un mouvement en ce sens.
Au-delà de cette observation, c'est surtout votre intervention, monsieur le ministre, qui me fait réagir : vous dites que, derrière le mot « compétitivité », il y a un projet environnemental et un projet social. Mais ce que propose Gérard Le Cam, avec notre groupe, c'est précisément d’inverser le processus, c’est-à-dire de placer le moteur social au cœur de l’efficacité économique et d’une certaine compétitivité.
Chers collègues de l'UPM, vous avez dit à l’instant qu’il fallait produire pas cher. Mais c’est la fuite en avant : d’autres pays produiront toujours moins cher que nous, mais à quel coût social ? Nous devrons bien, un jour, nous confronter à cette question.

Pour soutenir la position du rapporteur et pour dire qu’il n’y a pas, d’un côté, l’économique et, de l’autre, le social, je mentionnerai simplement un fait que l’on vient d’apprendre il y a quelques heures : pour la première fois, en France – c'est du jamais vu –, la production agroalimentaire a baissé d’un peu plus de 2 % en volume, en 2013, ce qui a entraîné un fléchissement de la balance extérieure de 6 % ou 7 %, ainsi qu’une explosion du nombre des défaillances d’entreprises.
Nous sommes tous pour l’emploi, nous voulons tous réduire le chômage ! Alors évitons de tomber dans des faux débats – la compétitivité est bien sûr au cœur du problème pour essayer de lutter contre le chômage – pour que, demain, la France puisse offrir plus d’emplois.

C'est à tort, me semble-t-il, que les tenants de deux théories s'affrontent ici. Nous devrions faire consensus sur ce sujet.
Le Premier ministre, ici même et à l’Assemblée nationale, l’a très bien dit dans son discours de politique générale : si l’on oppose le social et l’économique, la compétitivité et la productivité, on ne s'en sortira pas.

Monsieur Le Cam, madame Gonthier-Maurin, par une décision unanime, j’y insiste, la commission a introduit dans le projet de loi la triple performance économique, sociale et environnementale.

C'est une avancée dont nous nous félicitons, et je remercie tous les membres de la commission, qui l’ont acceptée. Nous sommes conscients de cela depuis des années.
Mais si l’on se dit que la compétitivité est un gros mot, qu’elle est opposée à cette triple performance, alors je crois vraiment que l’on ne s'en sortira pas. Il nous revient à nous, femmes et hommes de gauche, de nous dire que la compétitivité, ce n’est pas du dumping, c’est aller non pas vers le bas, mais vers le haut, en tenant compte du travail des salariés dans l’industrie et, évidemment, dans l’agriculture. Tel est notre objectif, et c’est bien, me semble-t-il, la politique que veut conduire le Gouvernement. En tout cas, c’est la position que défend notre groupe et que je veux défendre en tant que rapporteur.
Oui, la compétitivité est indispensable si l’on veut s'en sortir, et on lui adjoint la triple performance économique, sociale et environnementale. Nous devons tous pouvoir nous retrouver sur cette base, y compris vous, mes chers collègues, qui craignez que la compétitivité ne soit un handicap. Nous disons, au contraire, que cela n’en est pas un, que c'est un avantage, une façon d’aborder l'économie réelle, tout en l’assortissant de garanties.
J’entends ce que vous dites au travers de votre amendement, mais, encore une fois, je le répète, c’est sur ce point que nous devons avancer. Il nous faut nous retrouver sur cette nouvelle façon d’appréhender la France : la compétitivité, avec des garanties !
M. le président de la commission applaudit.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 166 rectifié est présenté par Mme Blandin, MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 458 rectifié ter est présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux
par les mots :
garantir le respect du bien-être et de veiller à la santé des animaux, des végétaux
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.

Nous présentons ici un amendement de précision.
Votre texte, monsieur le ministre, coordonne le bien-être et la santé des animaux et des végétaux, ce dont nous nous félicitons, mais vous utilisez le terme « veiller », alors que nous préférons, pour ce qui est du bien-être animal, le mot « garantir ».
En effet, même si des soins attentifs ne peuvent donner l'assurance que telle ou telle culture ne sera pas contaminée par un champignon ou un parasite, les animaux d'élevage, eux, sont complètement dépendants, pour ce qui concerne leur bien-être, du sort qui leur est fait. Ce sont les conditions dans lesquelles ils grandissent qui leur occasionneront ou non de la souffrance.
Aussi souhaitons-nous que figure dans ce texte le mot « garantir ».
Tout à l'heure, notre collègue Jean-Noël Cardoux a cité des articles du code pénal qui, déjà, veillent à la bientraitance. Mais ils ne sont pas respectés ! Je citerai la coupe des queues des cochons et l’apport de matériel manipulable ou de paille dans les espaces où ces derniers vivent. Voilà des obligations qui ne sont pas respectées. C’est pourquoi les précisions apportées par l'amendement ne sont pas négligeables.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 458 rectifié ter.

L’amendement n° 458 rectifié ter est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 166 rectifié ?

Madame Blandin, cet amendement va plus loin que celui que vous avez présenté tout à l'heure, puisque vous voulez remplacer le terme « veiller » par celui de « garantir ». Mais cela n’est pas possible.
En effet, il en résulterait une obligation de résultat et non de moyens. Or, dans les règles européennes et dans le texte, c'est une obligation de moyens et non de résultat qui s'impose. Là encore, il s’agit d’un point d’équilibre.
Pour la première fois, le ministre l’a souligné précédemment, le bien-être animal est inscrit dans une loi. Commençons ainsi ! Veiller au bien-être animal correspond à l’équilibre que nous devons avoir. Garantir le bien-être animal est, à mon sens, contradictoire avec les textes européens.
De plus, je ne pense pas, ma chère collègue, que nous pourrons trouver une majorité dans notre assemblée pour approuver votre formulation. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, pour en rester à la formule d’équilibre, inscrite à l’alinéa 8, présentée par le ministre.

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président, non pas parce qu'il n’y a pas de majorité pour l’adopter
Sourires.

L'amendement n° 166 rectifié est retiré.
L'amendement n° 351 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
, en encourageant la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts
II. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’encourager la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;
La parole est à M. Gérard César.

Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
Nous estimons, avec mes collègues, que le mot « encourager » est plus fort que le mot « encourageant ».
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 116, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° De permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité ;
La parole est à M. Joël Labbé.

La notion de développement de l'aide alimentaire est gênante en ce qu'elle admet implicitement qu'il est normal que des personnes pauvres y aient recours. Sans jouer sur les mots, parler de développement implique qu’il y en ait de plus en plus, ce qui n’est ici, je le sais bien, le souhait de personne.
Conformément aux divers traités internationaux garantissant le droit à l'alimentation dont la France est signataire, je préfère la notion d’« accessibilité pour tous à une alimentation de qualité ».
Je rappelle ici la définition onusienne du droit à l’alimentation : « Le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer ».
La France a donc obligation de respecter, de protéger ce droit et de lui donner effet. C'est la raison pour laquelle nous préférons permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité plutôt que de développer l’aide alimentaire.

Je ne saurais être totalement opposé à cet amendement, qui participe toutefois d’un autre raisonnement. L’aide alimentaire ne figure plus aujourd'hui dans la politique agricole commune ; elle fait partie des programmes de cohésion européens. Il est cependant important de signifier que l’aide alimentaire est quelque chose d’essentiel.
La rédaction actuelle de l’alinéa 16 mentionnant comme finalité le développement de l’aide alimentaire me satisfait. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Labbé. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
Il est vrai qu’inscrire comme finalité le développement de l’aide alimentaire pourrait laisser sous-entendre qu’il s’agit d’augmenter l’aide alimentaire, alors que l’objectif politique est de lutter contre la faim dans le monde. Or, pour ce faire, nous disposons de deux outils : développer la production agricole partout dans le monde et, lorsqu’une crise le nécessite, développer l’aide alimentaire.
Dans ces conditions, si l’amendement pouvait être rectifié en tenant compte de ces deux éléments, j’y serais tout à fait favorable.

Il convient en effet de conserver ces deux éléments. Vous pourriez donc ajouter dans votre amendement, monsieur Labbé, la finalité prévue à l’actuel alinéa 16 de sorte que, comme dirait ma grand-mère, une chatte y retrouve ses petits.
La rédaction serait la suivante : « De permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité et de développer l’aide alimentaire ».

Je comprends la nuance exprimée par M. le ministre et par M. le rapporteur. Cette nouvelle rédaction me convient, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.

Il s’agit donc de l'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° De permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité et de développer l'aide alimentaire ;
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’amendement n° 116 rectifié.

Nous sommes tous favorables à l’aide alimentaire. Pour reprendre les propos du ministre, cela rejoint le problème de la production, de la compétitivité. On parviendra à éradiquer la faim dans le monde en produisant plus. Lorsque le ministre est venu au monde, un agriculteur français nourrissait vingt Français. Aujourd’hui, il en nourrit cent cinquante. Il a fallu 10 000 ans à l’humanité pour atteindre un milliard d’individus en 1800 ; nous serons neuf milliards dans quelques décennies.
L’aide alimentaire, oui ! Mais vous voyez bien la contradiction dans laquelle vous vous enfermez, mon cher collègue. Vous refusez dans le même temps d’élargir, par la compétitivité, la production agricole. N’oublions pas que, à côté de l’aide alimentaire, il faut impérativement, dans tous les pays, développer la production. L’aide – je ne vais pas citer Mao Tsé-toung – n’est qu’un ersatz.
Pour répondre aux interrogations que suscite cet amendement, je vous invite à relire l’alinéa 17, qui définit l’aide alimentaire : « […] lutter contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement et en cohérence avec les politiques de développement et de solidarité internationale française et communautaire. »
Absolument ! Il est vrai que ces deux alinéas se juxtaposent, alors que l’objectif est de lutter contre la faim. Je vais donc revoir tout cela afin d’être plus précis.

Comme notre amendement a retenu l’attention de M. le ministre et de M. le rapporteur et dans la mesure où il sera pris en compte au cours de la navette, je peux le retirer.

L’amendement n° 116 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 407 rectifié, présenté par MM. Bizet, Houel, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Après le mot :
production
insérer les mots :
, de la commercialisation
La parole est à M. Jean Bizet.

Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de cohérence : il vise à identifier les opérateurs de commercialisation, qu’ils soient publics ou privés, présents économiquement dans toutes les filières, ce qui permettrait de garantir leur représentation dans l’ensemble des instances des filières agricoles et agroalimentaires.

L'amendement n° 592, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts
La parole est à M. Gérard Le Cam.

Après avoir tenté de mettre un peu d’humanité dans ce monde de brutes qu’est la loi du marché, je vais défendre les circuits courts.
Comme le souligne le rapporteur, s’il est important de définir dans la loi les buts des politiques publiques et de la politique agricole, nous souhaitons qu’il soit apporté une précision quant aux actions que l’État doit favoriser pour atteindre ces objectifs. En effet, depuis plusieurs années déjà, de nombreuses réflexions ont été menées pour favoriser le développement des circuits courts : le plan Barnier de 2009, le Grenelle de l’environnement, le programme national nutrition santé, la loi de modernisation agricole, qui tous laissaient présager un avenir au développement des circuits courts en France.
Aujourd’hui, plus qu’un objectif, le développement des circuits courts doit être considéré comme un outil de valorisation de notre agriculture, un outil de réalisation d’une véritable politique alimentaire de qualité qui s’inscrit dans un objectif écologique. Les rapports cités rappellent tous que les circuits courts valorisent les productions, permettent le développement durable des territoires, facilitent une réelle gouvernance alimentaire. Les circuits courts permettent également la réalisation d’économies en limitant le nombre d’intermédiaires lors de la commercialisation des produits et créent de l’emploi ; nous avons maintes fois souligné tous ces bienfaits.
Pour nous, inscrire cet élément à l’alinéa 20 de l’article 1er, c’est aussi revaloriser le modèle d’une agriculture familiale et paysanne – il ne s’agit pas seulement de gagner des marchés à l’export – et permettre un premier pas vers une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein des filières agricoles. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Ces deux amendements similaires concernant la commercialisation montrent bien que nous ne sommes pas là pour opposer les types d’agriculture, les différents circuits. Il faut favoriser les circuits courts là où nous en avons besoin et les circuits longs ainsi que l’exportation dans d’autres secteurs.
Monsieur Bizet, je suis favorable à votre amendement, mais je vous invite à le retirer au profit de celui de M. Le Cam, qui est plus complet. Ce dernier pourrait cependant être légèrement modifié selon la rédaction suivante : « ainsi que de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts ». Nous pourrions ainsi adopter à l’unanimité ce nouvel amendement plus large que les deux amendements initialement en discussion commune.

Je suis d’accord sur le principe, monsieur le rapporteur. L’amendement de M. Le Cam ajoute la problématique des circuits courts, à laquelle nous ne pouvons être opposés. La situation devrait se reproduire, me semble-t-il, pour les amendements n° 408 rectifié et 409 rectifié.

L'amendement n° 407 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 592 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts
La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote sur l’amendement n° 592 rectifié.

L’amendement de M. Le Cam relève du bon sens. Consommer de la viande produite à vingt, trente ou quarante kilomètres de chez soi permet une traçabilité totale contrairement à la viande produite à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, en Argentine ou d’ailleurs, et valorise les productions agricoles du secteur.
S'agissant des circuits courts, il faudrait que les collectivités, dans le cadre des marchés publics, puissent avoir plus de souplesse en matière de référence qualitative. On valoriserait ainsi indiscutablement les productions de notre pays, on éviterait les transports, notamment par bateau, et on offrirait une garantie aux consommateurs. Que demander de mieux ?
Mes chers collègues, j’avais prévu, mais j’y reviendrai, de plaider pour les circuits courts. C’est le bon sens ! Si l’on ne peut pas faire des miracles dans notre société, on peut améliorer certains circuits commerciaux, dont les circuits courts. Dans ces conditions, inutile de vous dire que je soutiens pleinement votre amendement, monsieur Le Cam.

Pour compléter les propos de notre collègue sur l’ancrage territorial, s’il en était besoin, je ferai un petit commentaire qui aurait également pu valoir pour l’amendement n° 351 rectifié présenté par Gérard César, au sujet duquel nous avons déjà évoqué l’encouragement des circuits courts au regard du renforcement de nos capacités exportatrices. Ce sont deux débouchés différents, mais ô combien complémentaires !
Monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur l’organisation des circuits courts. Je m’efforce d’organiser de tels circuits en matière de restauration collective afin que la viande d’Argonne, produite localement, puisse se retrouver dans l’assiette des collégiens. À cet égard, il faut revoir un certain nombre de dispositifs, la référence locale n’étant pas prise en compte dans le cadre des appels d’offres. C’est antinomique avec ce que nous proposons aujourd'hui !
Il convient de faire évoluer ces mécanismes en comité interministériel afin que nous puissions mettre en pratique ces propositions législatives. Permettez-moi de souligner qu’il est particulièrement compliqué de faire évoluer les mentalités et d’appliquer les dispositions que nous souhaitons instaurer.
Nous vous remercions de prendre en compte les circuits courts, monsieur le ministre. Cependant, la loi ne me semble pas encore suffisamment précise en la matière. Je pense que nous aurons l’occasion d’améliorer les choses. En tout cas, c’est bien volontiers que je soutiens cet amendement.

Monsieur Savary, mon cher collègue président de conseil général, nous venons de régler l’aspect législatif concernant les appels d’offres et les circuits courts, notamment dans la restauration collective.
Trois grands réseaux se sont mis en marche : celui des chambres d’agriculture, qui ont beaucoup travaillé ; celui de la Fédération nationale d’agriculture biologique, qui a bien avancé ; celui des conseils généraux, enfin, qui se sont organisés.
Dans mon département, nous avons créé la plateforme « agrilocal.fr », validée par Bercy ainsi que par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Une trentaine de départements y ont adhéré. Désormais, grâce à ce portail, dans beaucoup de départements, et pour la première fois, les agriculteurs ont accès à la commande publique. Je puis vous assurer que ce système fonctionne dès lors qu’il est mis en place. Il faut en faire la promotion.
J’aurais aimé qu’un tel système soit inscrit dans la loi, monsieur le ministre, mais je vois bien que ce n’était pas possible. Nous avons cependant besoin, en tant que sénatrices et sénateurs, présidents d’exécutifs locaux, départementaux et régionaux, de promouvoir de tels dispositifs. C’est la garantie de permettre à nos agriculteurs l’accès à la commande publique et, accessoirement, des revenus légèrement supérieurs ; c’est également le moyen d’assurer la traçabilité, de faire en sorte que, dans un collège ou une école, on sache d’où proviennent la purée et le poulet qui se trouvent dans les assiettes. Dans la restauration collective, on doit aussi pouvoir savoir que l’on mange les pommes de terre de M. Untel ! Ce n’est pas uniquement de la bricole, c’est quelque chose de très important.
Circuit court, accès de proximité, traçabilité, qualité des produits, haute valeur nutritionnelle, je pense que nous allons dans le bon sens et qu’il faut poursuivre ce mouvement.
Ce débat d’orientation est très important, car il permet à chacun de participer aux grands objectifs de l’agriculture.
S’agissant des circuits courts, trois plateformes – celle développée par les chambres d’agriculture, celle d’Agrilocal, déjà présente dans une trentaine de départements, ainsi que le réseau coordonné par la Fédération nationale d’agriculture biologique – ont été validées par le ministère de l’agriculture. Quel est l’enjeu ? Il s’agit de réussir à faire correspondre une demande locale à une offre locale.
M. René-Paul Savary acquiesce.
Souvent, si la demande locale va chercher ailleurs, c’est parce qu’elle ne connaît pas l’offre locale ; l’offre locale ne sait pas non plus trouver la demande locale, car personne ne vient la chercher. Nous avons tout mis en œuvre pour parvenir à une solution : la loi affirme la défense des circuits courts et les instruments sont en place. Maintenant que tout a été validé par le ministère, nous devons nous atteler à développer le dispositif.

Je voudrais dire à M. le ministre que c’est au cours de l’appel d’offres que le problème se pose, le critère de production locale ne pouvant être retenu au moment de la prise de décision.
La plateforme est sans doute un instrument formidable qu’il faut déployer, mais la DGCCRF refuse de prendre en compte le critère de production locale dont pourrait bénéficier une offre par rapport à une autre ; il est très compliqué de contourner cette difficulté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 408 rectifié, présenté par MM. Bizet, Houel, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après les mots :
filières de production
insérer les mots :
, de commercialisation
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 117, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
dans la mesure où ce développement ne remet pas en cause la capacité de notre pays à couvrir ses besoins alimentaires par sa capacité productive
La parole est à M. Joël Labbé.

Il s’agit ici d’anticiper les effets pervers du développement de nouvelles activités en mentionnant la priorité donnée au respect de la vocation nourricière de la production agricole, laquelle doit en priorité couvrir les besoins alimentaires de notre population, conformément aux principes de la souveraineté alimentaire que j’évoquais hier.
Les impacts négatifs du développement des agrocarburants dits de première génération en termes de changement d’affectation des sols doivent nous alerter sur tout risque similaire associé au développement des biomatériaux et bioénergies. On ne peut voir dans ces développements que complémentarité avec l’alimentation ou intégration dans une économie circulaire.

En métropole – ce n’est pas le cas outre-mer –, nous sommes globalement autosuffisants. Cet amendement n’ajoute donc pas grand-chose à l’alinéa 21.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Oui, monsieur le président.
Monsieur le rapporteur, je conteste le fait que nous soyons en situation de souveraineté alimentaire totale. J’ai évoqué hier les millions d’hectares annexés en Amérique du sud pour l’alimentation de nos élevages.
La volonté du ministre est d’aller vers l’autosuffisance en matière de protéines végétale, c’est-à-dire en matière de production alimentaire pour animaux. Notre amendement va dans ce sens, vers une véritable souveraineté alimentaire nationale.
L’objectif de la souveraineté alimentaire, est-ce l’autosuffisance alimentaire pour chacun ? À l’échelle de la France ou à celle de l’Europe ?
Est-ce un objectif pour chaque pays africain ou pour toute l’Afrique ?
Notre état d’esprit consiste à dire qu’il ne faut pas déstructurer les agricultures locales au nom du grand marché international. Comme l’a dit un jour Edgard Pisani – et j’en suis convaincu –, nous aurons besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde.
Le risque serait donc ici de tellement développer les énergies renouvelables à base de production agricole et forestière que l’on remettrait en cause nos capacités de production alimentaire. Or en développant le plan EMAA sur la méthanisation, par exemple, nous avons bien pris soin de dire que le carbone nécessaire au fonctionnement des méthaniseurs ne devait pas remettre en cause la production alimentaire.
Par cet amendement, vous mélangez le concept de souveraineté alimentaire – espace toujours difficile à définir – avec la question des énergies renouvelables. Or je pense que nous avons intérêt à développer les énergies renouvelables en agriculture via la méthanisation.
M. Stéphane Le Foll, ministre. À cet égard, un rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, laisse entendre que si l’on s’organisait mieux, l’agriculture et les matières organiques produites par les grandes collectivités pourraient nous permettre d’atteindre 40 % de notre consommation actuelle de gaz. Vous rendez-vous compte ? Nous débattons de la crise gazière en Ukraine, de l’extraction du gaz de schiste à 1 500 mètres de profondeur, alors que nous devrions commencer par nous attaquer au gaz directement disponible !
Mmes Maryvonne Blondin et Sophie Primas applaudissent.
Le Gouvernement ne peut accepter cet amendement, qui mélange deux concepts.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de ce que vous avez dit. Arrêtons ce combat entre la transformation de la biomasse ou des matières agricoles et l’alimentation. On voit quelles difficultés peut engendrer le principe de précaution dorénavant inscrit dans notre Constitution. Nous devons également l’assortir d’un principe d’innovation.
On ne peut refuser l’innovation et vivre sur un modèle archaïque. Nous devons avancer ! Si l’on veut trouver des débouchés, notamment dans les carburants de deuxième ou troisième génération, encore faut-il valider le processus des carburants de première génération !
Certes, aujourd’hui, les recherches portent sur des produits alimentaires, mais demain elles porteront sur l’ensemble de la biomasse. Des recherches tout à fait extraordinaires sont menées sur la fétuque, sur le miscanthus, sur la transformation des bois et, demain sur celle des déchets. Transformer les déchets en énergie, voilà qui va dans le sens du développement durable ! Nous n’allons tout de même pas nous passer de l’ensemble de cette recherche, tout à fait respectable sur le plan économique comme sur celui du développement durable.
C’est la raison pour laquelle je suis satisfait que M. le ministre refuse cet amendement ; j’invite l’ensemble de mes collègues à faire de même. Son adoption ne serait pas un signe encourageant pour notre jeunesse, à un moment où l’on veut à la fois respecter l’environnement et mettre en œuvre des techniques nouvelles. Nous sommes au XXIe siècle !

Nous sommes en plein dialogue de sourds. Relisez tranquillement le texte de cet amendement, vous constaterez qu’il s’agit de se prémunir contre d’éventuelles dérives. Il n’est en rien archaïque et ne s’oppose pas à la recherche et au développement.
Écrire « dans la mesure où ce développement ne remet pas en cause la capacité de notre pays à couvrir ses besoins alimentaires par sa capacité productive » ça ne mange pas de pain, ça va beaucoup mieux en le disant et ça ne dérange personne ! Il s’agit simplement de garantir le destin nourricier de notre terre nourricière.

J’ajouterai simplement au brillant exposé de M. Savary qu’il serait dommage de se priver de l’utilisation des sous-produits de l’agriculture alors que nous cherchons à améliorer la compétitivité de chaque exploitation agricole. Je suis tout à fait en ligne avec vous sur ce sujet, mon cher collègue, comme avec M. le ministre.
L'amendement n'est pas adopté.

Le Gouvernement et la commission souhaitent que la discussion sur le volet outre-mer ne soit pas tronquée et que nos collègues ultramarins puissent être présents lors du débat. Aussi, en application de l’alinéa 6 de l’article 44 du règlement du Sénat, je demande l’examen par priorité du titre VI ce soir, à la reprise de nos travaux.
Par ailleurs, je rappelle aux membres de la commission des affaires économiques que nous nous réunirons à quatorze heures pour examiner la suite des amendements.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un Mouvement Populaire a présenté une candidature pour la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et une candidature pour la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées, et je proclame :
– Mme Sophie Primas, membre de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en remplacement de M. Michel Doublet, démissionnaire ;
– M. Michel Doublet, membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en remplacement de Mme Sophie Primas, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.