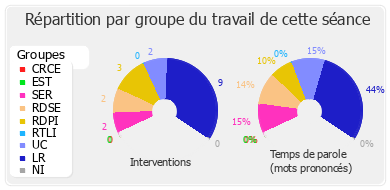Séance en hémicycle du 31 mars 2009 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Dépôt de rapports du gouvernement
- Questions orales (voir le dossier)
- Répartition des coûts de renforcement du réseau de distribution d'électricité publique (voir le dossier)
- Relations entre collectivités territoriales et associations de protection de l'environnement (voir le dossier)
- Syndicat mixte privé de subvention pour travaux consécutifs à une catastrophe naturelle (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les deux rapports sur la mise en application de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire et de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.
Ils seront transmis respectivement à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale et à la commission des affaires économiques et seront disponibles au bureau de la distribution.

La parole est à M. Gérard Miquel, auteur de la question n° 467, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit que les collectivités auprès desquelles un fonctionnaire de l’État est détaché sont redevables, envers le Trésor public, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.
Le taux de cette contribution employeur est fixé par décret en Conseil d’État. Au 1er janvier 1992, il était de 33 % du traitement brut de l’agent. Il est passé à 39, 5 % au 15 mars 2007, puis à 50 % au 1er janvier 2008, pour atteindre 60, 14 % au 1er janvier 2009.
Le quasi-doublement, en moins de trois ans, du taux de la contribution pour pension civile réclamée par l’État pour ses agents détachés aux collectivités locales est difficilement justifiable.
On relève par ailleurs que la même contribution retraite pour les fonctionnaires territoriaux, versée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, s’élève à 27, 30 %. Ainsi, un fonctionnaire de l’État détaché vers une collectivité locale induira une charge de retraite deux fois plus élevée que celle qui est due pour un fonctionnaire territorial.
Pour un agent en milieu de carrière, le surcoût annuel est évalué à 4 800 euros pour un agent de catégorie C, à 6 000 euros pour un agent de catégorie B et à 7 200 euros pour un agent de catégorie A.
À la suite des transferts de personnels de l’État vers les départements et les régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, près du quart des agents de l’État a opté pour un détachement sans limitation de durée vers une collectivité locale. Ce sont donc plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires de l’État qui sont concernés par la présente question.
Pour le conseil général du Lot, petit département de 176 000 habitants, qui accueille 102 agents en détachement, le surcoût annuel est évalué à 580 000 euros.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles sont les justifications de ces fortes revalorisations et quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour corriger le taux de cette contribution ? En effet, cette contribution alourdit les difficultés budgétaires des collectivités locales et entrave la mobilité entre les trois fonctions publiques alors que le Gouvernement affiche sa volonté de promouvoir cette mobilité. Un projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a, je le rappelle, été adopté en première lecture au Sénat, le 29 avril 2008.
Monsieur le sénateur, votre question, très importante, sera sans doute évoquée dans d’autres instances. J’y apporterai donc une réponse assez longue.
Cette question s’articule en deux volets distincts : d’une part, l’évolution des taux de cotisation employeur des fonctionnaires pour chacun des régimes de retraite de la fonction publique et, d’autre part, le financement des cotisations employeurs pour les agents détachés.
En premier lieu, le niveau et l’évolution différenciée des taux de cotisation à la charge des employeurs selon le statut des fonctionnaires qu’ils emploient sont liés à leur régime de rattachement et s’expliquent par les niveaux de maturité différents de ces régimes.
Les trois fonctions publiques françaises en matière de retraite sont, vous le savez, couvertes par deux régimes : le régime des fonctionnaires de l’État, régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite, et le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Ces deux régimes de retraite offrent à leurs assurés les mêmes prestations. Cependant, la relative jeunesse du régime de la CNRACL explique un rapport démographique particulièrement favorable. Les chiffres communiqués par le Conseil d’orientation des retraites, le COR, indiquent un rapport de 2, 5 actifs pour un retraité en 2006, à comparer à 1, 4 actif pour un retraité pour les fonctionnaires et pour le régime général de la sécurité sociale.
Au fur et à mesure que le régime de retraite des agents des collectivités locales parviendra à maturité, son rapport démographique se dégradera, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le taux de cotisation nécessaire à son équilibre.
Toutefois, la CNRACL bénéficie encore d’un niveau de taux de cotisation très favorable. Ainsi, pour le même taux de retenue pour pension à la charge des fonctionnaires et pour les mêmes garanties, le taux de cotisation de l’État employeur atteint 60, 14 % en 2009 pour les fonctionnaires civils, à comparer avec le taux de cotisation employeur à la CNRACL, qui est de 27, 3 % depuis le 1er janvier 2005.
Le régime des fonctionnaires de l’État, parvenu à maturité, est confronté à des flux de départs à la retraite très importants, qui représentent une charge supplémentaire considérable, de l’ordre de plus de 2 milliards d’euros par an. Il s’ensuit que le taux de cotisation employeur qui équilibre le compte d’affectation spéciale « Pensions », chargé de financer les pensions des fonctionnaires de l’État, doit progresser d’année en année pour faire face à cette hausse importante.
Il est ainsi tout à fait logique que les revalorisations des taux entre régimes diffèrent et que le taux du régime des fonctionnaires d’État connaisse une forte augmentation.
En second lieu, vous mentionnez le cas des fonctionnaires de l’État transférés aux collectivités locales, ayant opté pour un détachement de la fonction publique d’État sans limitation de durée.
Le taux de la contribution pour pensions employeur versée par les organismes dotés de l’autonomie financière employant des fonctionnaires civils ou des militaires, que ce soit en propre ou en détachement, n’avait pas évolué entre 1992 et 2007.
Or, la contribution versée par l’État pour assurer l’équilibre du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite n’a cessé, et ne cesse, d’augmenter. Aussi, il a été décidé de mettre fin de façon progressive à ce décalage. Depuis 2009, la contribution employeur est acquittée selon un taux unique pour l’acquisition de droits à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l’ensemble des fonctionnaires civils de l’État, quel que soit leur employeur.
La mutualisation des charges est donc désormais assurée à l’identique pour chacun des employeurs, comme c’est la règle dans tous les régimes de retraite.
Monsieur le sénateur, vous soulignez la contrainte que fait peser cette différence de taux sur la mobilité des fonctionnaires. Cette différence est inhérente à l’existence de deux régimes distincts. De ce fait, un taux de cotisation unique pour l’ensemble des trois fonctions publiques ne peut être envisageable que sur le très long terme, lorsque les rapports démographiques des deux régimes se seront rapprochés.
Monsieur Miquel, j’ai conscience d’avoir été un peu long, mais je tenais à répondre à votre question de manière exhaustive.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse longue et détaillée, mais qui ne me rassure pas.
Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, que le Sénat a adopté, est très intéressant.

J’ai recruté de nombreux fonctionnaires de l’État dans mon département et je m’en félicite, car ce sont des personnels de qualité. Désormais, je ne peux plus le faire, car le surcoût est devenu insupportable.
Passer en trois ans de 33 % à 60 %, vous en conviendrez avec moi, monsieur le secrétaire d’État, n’est pas acceptable et ne facilite pas l’instauration d’un climat de confiance entre l’État et les collectivités.
Monsieur Miquel, ce projet de loi, qui a été adopté en première lecture au Sénat l’an dernier, à la fin du mois d’avril, est en cours d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, son examen ayant été retardé en raison de la discussion de textes urgents.
Monsieur le sénateur, je retiendrai votre argument car, si nous voulons une vraie mobilité, y compris entre les fonctions publiques, nous devons apporter une solution à ce genre de problème.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 439, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation.

Monsieur le secrétaire d’État, cette question a déjà été posée, et je vous prie de m’en excuser. Mais il existe un temps de latence très long entre le dépôt d’une question et son inscription à l’ordre du jour, si bien que, entre-temps, elle a déjà reçu une réponse. Cela dit, nous, élus, sommes harcelés par les employés des postes, qui se préoccupent de leur avenir et des précisions de votre part seront bien utiles.
Monsieur le secrétaire d’État, La Poste fait, depuis plusieurs mois, l’objet d’un vaste débat sur l’évolution de son statut et des moyens nécessaires à son développement, en particulier en zone rurale et en zone urbaine sensible. On compte 17 000 points de contact, dont 9 700 situés en zone rurale dans des communes de moins de 2 000 habitants. Sur ces 9 700 points de contact, la moitié est gérée par La Poste, l’autre partie étant constituée d’agences communales ou de « points poste » chez des commerçants.
Les élus locaux, qui excluent tout transfert de compétences aux collectivités territoriales, manifestent des inquiétudes. Ils souhaitent, au contraire, que les missions de La Poste soient élargies à la prestation de services d’intérêt général de proximité, aujourd’hui inexistants, alors qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des citoyens.
Le Président Sarkozy a annoncé, au mois de décembre, le changement de statut de l’entreprise publique. La Poste abandonnerait le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial pour celui de société anonyme. L’entreprise ne serait pas privatisée pour autant, puisqu’elle ne serait ouverte qu’à des capitaux publics, notamment ceux de la Caisse des dépôts et consignations. Le Président de la République a « promis » que rien ne serait modifié et que « l’intégralité des grandes missions de service public de La Poste » serait préservée. Cependant, on peut craindre qu’une porte ne s’entrouvre vers une possible privatisation.
Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’État, que vous puissiez apporter quelques précisions sur ces divers points et sur l’avenir de La Poste, en particulier en zone rurale.
Monsieur le sénateur, La Poste doit faire face à deux défis historiques sur son marché : d’abord, la concurrence des médias électroniques, qui affectent les volumes de courrier – moins 3, 5 % en tendance 2008 –, ensuite, l’ouverture totale des marchés postaux prévue le 1er janvier 2011.
La question est finalement simple : le groupe pourra-t-il à la fois être performant sur le marché concurrentiel et maintenir ses missions de service public, qui sont réputées pour leur qualité ? À question simple, réponse simple. La Poste pourra le faire à condition de s’en donner les moyens, à condition qu’on lui en donne les moyens.
La commission de réflexion, présidée par M. François Ailleret, chargée d’examiner les différentes options envisageables pour le développement de l’entreprise, a remis son rapport au Gouvernement à la mi-décembre 2008.
Mon collègue Luc Chatel a reçu le 19 décembre 2008 le président de La Poste, les organisations syndicales de La Poste, les représentants des maires et des maires ruraux de France, ainsi que les parlementaires qui ont participé aux travaux de la commission.
Le Président de la République, vous l’avez rappelé, a pris la décision de modifier la forme juridique de La Poste pour en faire une société anonyme à capitaux 100 % publics et lui permettre d’assurer son développement via une augmentation de capital souscrite par l’État et par la Caisse des dépôts et consignations.
Le Gouvernement a affirmé avec force le principe du maintien intégral des missions de service public, à savoir le tarif unique du timbre, la mission de service universel, la distribution des envois postaux tous les jours ouvrables, la mission d’aménagement du territoire, l’accessibilité bancaire ainsi que la distribution de la presse. Les droits et statuts des postiers seront, quant à eux, intégralement préservés.
S’agissant en particulier de la mission d’aménagement du territoire, la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales fixe des règles précises pour permettre à La Poste d’assurer la couverture du territoire en services postaux de proximité. Aux termes de ces dispositions, « sauf circonstances exceptionnelles, plus de 10 % de la population du département ne peut se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile des plus proches points de contact de La Poste ». Cette règle d’accessibilité est aujourd’hui vérifiée dans la quasi-totalité des départements.
Ces dispositions font l’objet de précisions complémentaires, d’une part, dans le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale, d’autre part, dans le contrat de service public signé en juillet 2008.
La Poste répond ainsi aux exigences du service public en adaptant ses points de contact à l’évolution des modes de vie des clients, sur la base de conventions de partenariat avec les collectivités locales sous la forme d’agences postales communales, les APC, ou bien en partenariat avec les commerçants sous la forme de relais poste commerçants, les RPC.
Ces partenariats représentent des formes de présence postale qui sont particulièrement adaptées aux besoins et aux attentes des habitants, notamment en termes d’amplitude horaire et d’offre de services. Ils concourent ainsi au maintien de la présence postale en milieu rural. Une enquête effectuée par La Poste montre que 90 % des clients et 87 % des élus bénéficiant d’un point de contact en partenariat s’en déclarent satisfaits.
Le projet de loi transposant la directive européenne d’ouverture à la concurrence du marché postal et portant changement de statut de La Poste devrait être présenté avant l’été 2009.
Ce changement de statut est nécessaire pour que puissent être apportés à La Poste les moyens financiers de son ambition, et parce que cela donnera à La Poste la capacité de saisir les opportunités stratégiques qui se présenteront.
J’espère, monsieur le sénateur, avoir répondu à votre question.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse qui m’a semblé complète et détaillée, même si je n’ai pas les mêmes statistiques que vous sur le partenariat.
L’installation de « points poste » chez les commerçants, me semble contestable notamment sur le plan de la confidentialité et ne satisfait pas du tout les usagers.
Je remarque que le Gouvernement a reculé, puisque, à l’origine, M. Sarkozy voulait ouvrir le capital aux entreprises privées ; aujourd’hui, on veut faire de La Poste une société anonyme aux capitaux 100 % publics.
Cela implique, vous l’avez rappelé et je vous en remercie, que l’unité du groupe – courrier, colis, banque, présence postale, prix unique du timbre, droits et statuts des postiers – doit être maintenue.
Malgré tout, monsieur le secrétaire d’État, les ambiguïtés ne sont pas dissipées pour autant. Une fois levé le verrou du statut d’établissement public, tout devient possible. On a vu, avec GDF, comment on passe de l’ouverture du capital à l’entrée de capitaux privés, puis à la privatisation. Des interrogations sur les missions et les moyens de La Poste demeurent aussi.
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’avez pas levé les craintes que peuvent nourrir les employés et les élus de zones rurales sur l’avenir de La Poste.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai, auteur de la question n° 442, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi.

Monsieur le président, ma question s’adressait à M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi, mais je remercie M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique d’être présent pour y répondre.
L’importance du rôle et de l’action de l’AFPA en matière d’orientation et de formation professionnelles est reconnue depuis 1949. Sa vocation était alors de former des chômeurs non qualifiés ou peu qualifiés. Aujourd’hui, alors que les ruptures dans les parcours professionnels sont fréquentes, les 11 000 salariés de l’AFPA savent répondre aux besoins de formation tout au long de la vie que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à attendre.
Dans leur esprit, l’AFPA remplit des missions de service public. Son statut est aujourd’hui remis en cause et les inquiétudes sont nombreuses concernant son avenir, aussi bien chez les personnes qui y travaillent qu’auprès du public.
La loi de décentralisation de 2004 a prévu le transfert du financement de l’AFPA aux régions et, depuis le 1er janvier 2009, les régions doivent passer un appel d’offres pour désigner un prestataire de formations. Autrement dit, dans chaque région, l’AFPA sera soumise à la concurrence. Il s’agit d’un choix du Gouvernement.
À une question écrite de ma collègue Jacqueline Alquier, le secrétaire d’État à l’emploi répondait le 19 mars dernier : « L’État a clairement rappelé que la formation professionnelle est une activité économique pour laquelle la passation de marchés publics doit être le mode principal d’intervention, complété à titre subsidiaire, par l’octroi limité de subventions. »
Le Gouvernement dit s’appuyer sur des arguments juridiques pour soumettre l’AFPA à la logique du marché et a découpé l’AFPA, pour rattacher les personnels de son pôle d’orientation au « Pôle emploi », issu de la fusion ANPE-ASSEDIC, privant ainsi l’AFPA d’une de ses spécificités essentielles.
De fait, la concurrence menace tout ce qu’apportait l’AFPA à nos concitoyens et ce pour quoi elle était reconnue. En effet, l’AFPA est un tout qui constitue un réseau cohérent aussi bien par le lien qui existe entre l’orientation proposée et la réponse en termes de formation que par la diversité des formations proposées bien réparties sur tout le territoire national. C’est ce qui me préoccupe.
Le Gouvernement dit être attaché au caractère national de l’AFPA. Comment celui-ci sera-t-il maintenu concrètement si l’AFPA est écartée dans telle ou telle région ? Et comment l’AFPA ne serait-elle pas écartée dans telle ou telle région où elle propose des formations qui excèdent les besoins propres de la région qui devra les financer ?
Ainsi, dans le Limousin, 380 personnels de l’AFPA, dont je puis attester la qualité professionnelle, travaillent au service de 8 000 stagiaires par an. Tous ces stagiaires ne viennent pas du Limousin.
Dans mon département, la Corrèze, deux centres sur trois ont un recrutement interrégional, voire national : celui d’Égletons, surtout dans les domaines des transports, des travaux publics avec option cabinet de géomètres, et celui de Brive dans les domaines du tourisme et des services. Le centre voisin de Guéret, en Creuse, est très généraliste, mais 40 % de ses stagiaires viennent d’autres régions, car il a une capacité de réponse rapide. Ces centres, implantés pendant les années où l’aménagement du territoire national avait encore un sens, répondent à des besoins nationaux.
Or le financement de l’État, qui ne tient plus qu’à un fil et qui devrait disparaître définitivement à la fin de l’année, est indispensable à ces centres. Ce financement jouait un rôle péréquateur qui méritait d’être maintenu. Je crains que l’aménagement du territoire ne souffre beaucoup du changement de statut de l’AFPA et que les compensations qui seront demandées par les régions ne donnent naissance à des « usines à gaz » coûteuses avant même de pouvoir être utiles.
Ma question est simple : alors que nos concitoyens sont victimes de la crise qui affecte lourdement l’emploi et que des territoires ont besoin de développer des activités, ou au moins de les maintenir, comment l’État compte-t-il utiliser le formidable outil que constitue l’AFPA grâce à son expérience de service public construite et accumulée en matière d’orientation professionnelle et d’accès à la formation depuis soixante ans, s’il ne lui assure pas les financements indispensables ?
Madame le sénateur, je vous remercie de votre question très précise sur le rôle que l’AFPA est amenée à jouer, au moment où le Président de la République et le Gouvernement engagent une réforme importante de la formation professionnelle. Je sais que vous partagez notre attachement à un service public de qualité.
L’AFPA est un acteur essentiel de la formation professionnelle en France du fait de son rayonnement national. C’est pourquoi le Gouvernement entend préserver une AFPA nationale quand certains présidents de région veulent créer vingt-deux AFPA régionales. C’est un point structurant pour les salariés de l’AFPA de préserver leurs missions au sein d’une association gérée nationalement par l’État, les régions et les partenaires sociaux. C’est également un gage de pérennité dans le temps.
Le Gouvernement est évidemment sensible aux inquiétudes des salariés de l’AFPA, mais aussi des parlementaires, sur son devenir, en cette période où de nombreuses évolutions juridiques et institutionnelles la concernent.
Dans un contexte tendu pour les finances publiques, Laurent Wauquiez s’est battu afin que les moyens financiers alloués par l’État à l’AFPA en 2009 soient identiques à ceux alloués en 2008 à champ d’intervention comparable, et ils le sont effectivement. Le Gouvernement a par ailleurs été très attentif à ce que les régions reçoivent de l’État la compensation financière appropriée pour assurer, y compris en termes de fonctionnement des hébergements, l’organisation et le financement des stages de l’AFPA au profit des demandeurs d’emploi, quelle que soit leur origine géographique. D’ailleurs, aucun président de région n’a fait part de remarques particulières sur le niveau de la compensation financière attribuée aux régions dans le cadre de la décentralisation.
Le Gouvernement a conscience que l’avenir de l’AFPA suscite des interrogations du fait de la décentralisation complète de la formation des demandeurs d’emploi, effective depuis le 1er janvier 2009, et d’une soumission plus directe aux règles de la concurrence, comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans un avis en date du 18 juin 2008. C’est pourquoi Laurent Wauquiez a apporté le 14 janvier dernier des réponses précises aux questions que la gouvernance de l’AFPA s’est posées sur les orientations stratégiques de l’institution et son positionnement.
En parallèle, le Gouvernement a eu des échanges réguliers avec l’Association des régions de France et les partenaires sociaux afin de préciser le cadre juridique et financier dans lequel doit se construire le plan stratégique de l’AFPA pour les cinq prochaines années. Comme Christine Lagarde vous l’avait indiqué au début de l’année 2008, la formation professionnelle est une activité économique pour laquelle la passation de marchés publics doit être le mode principal d’intervention. L’État a fait sien cet état de droit en organisant dès 2009 un marché de formation au profit des publics fragiles relevant de sa responsabilité : les détenus, les militaires en reconversion professionnelle, les travailleurs handicapés, les résidents d’outre-mer, les Français de l’étranger. L’État met sur la table 92 millions d’euros par an, dont près de 18 millions d’euros au titre du Fonds social européen. Compte tenu de son savoir-faire, l’AFPA dispose de nombreux atouts pour être en mesure de répondre à cet appel d’offres.
L’AFPA de demain doit reposer sur des bases économiques, financières et juridiques solides, ce qui suppose de réfléchir de manière approfondie à un schéma d’ensemble incluant les problématiques d’amélioration de la productivité, d’utilisation du patrimoine et de repositionnement des services d’orientation professionnelle. Le Gouvernement accompagnera l’AFPA dans le cadre d’une convention d’objectifs, de moyens et de performance pour les années 2009-2013, que Laurent Wauquiez signera prochainement avec son président et son directeur général. Ce nouveau contrat permettra à l’AFPA de conduire les nécessaires évolutions imposées par les règles communautaires et nationales.
Le Gouvernement appelle les personnels de l’AFPA à faire de ce bel outil, qui fêtera ses soixante ans cette année, un opérateur national de référence en matière de formation professionnelle, alors qu’il viendra bientôt devant vous engager la réforme de la formation professionnelle.

Je remercie M. Santini de sa réponse, mais je doute qu’elle dissipe les craintes qui s’expriment sur le terrain, tout particulièrement dans la ville où je réside. Soumettre le marché de la formation professionnelle aux règles de la concurrence me paraît en complète contradiction avec le maintien de situations, comme celles que je vous ai citées, dans lesquelles les régions concernées ont manifestement un appareil de formation surdimensionné par rapport à leurs besoins réels, mais veulent malgré tout conserver ces centres, puisqu’il s’agit là de lieux très importants pour l’emploi, notamment l’emploi qualifié.
Je m’interroge aussi sur l’avenir du patrimoine de l’AFPA. Je sais que des négociations se sont tenues avec les régions en vue de son éventuelle reprise. Pour l’avoir constaté dans ma ville, je sais qu’il peut se caractériser par un certain vieillissement, pour ne pas dire une certaine vétusté.
Si ce patrimoine était transféré directement à l’AFPA elle-même, il constituerait, à mon avis, une charge lourde pour le fonctionnement de ses centres. Je m’interroge dès lors sur leur capacité à être compétitifs sur un marché de la formation professionnelle que nous savons très concurrentiel. Comme je le constate au centre d’Égletons, les formations proposées nécessitent non pas seulement du papier et un crayon mais, souvent, des engins qu’il faut renouveler et un outillage performant. Il s’agit de former convenablement à des métiers de plus en plus exigeants. J’espère donc que nous saurons trouver un juste équilibre, notamment dans la loi relative à la formation professionnelle, entre la qualité de la formation professionnelle et notre souci de l’aménagement du territoire.
M. le secrétaire d’État opine.

La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 459, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention et celle du Gouvernement sur l’absence de bien-fondé de la prise en charge par les collectivités des coûts de renforcement du réseau de distribution d’électricité publique.
En effet, à compter du 1er janvier 2009, un nouveau système de financement des raccordements au réseau de distribution électrique est appliqué, pour toute opération d’urbanisme autorisée. Cela résulte de la mise en cohérence de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public d’électricité, avec la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, ainsi qu’avec les mesures réglementaires d’application nécessaires.
Le système forfaitaire du « ticket » est abandonné. Il est remplacé par une facturation qui met à la charge des collectivités des frais intégrés auparavant dans ce forfait.
Un raccordement comprend au moins deux éléments : le branchement privé, à la charge du pétitionnaire, et l’extension du réseau public, à la charge de la collectivité. Un troisième élément peut intervenir : le renforcement, c’est-à-dire la mise en place ou l’adaptation d’ouvrages pour faire face à une augmentation de la puissance demandée.
Un renforcement coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros. Aujourd’hui, dans le nouveau système de financement des raccordements, le coût des renforcements est mis à la charge des collectivités, en application du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007. C’est cette disposition qui pose problème, car il ressort des articles 4, 18 et 23-1 de la loi du 10 février 2000 que le législateur a nettement distingué, pour les raccordements électriques, le coût de l’extension du coût des renforcements. Le coût des renforcements est normalement intégré dans le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, payé par chaque abonné à travers sa facture.
Concrètement, cela aboutit à faire supporter des dépenses considérables aux collectivités, en facturant une deuxième fois ce qui est déjà intégré dans le TURPE. Non seulement cette situation suscite un très important contentieux, le pétitionnaire-contribuable payant deux fois une seule prestation, mais en outre elle conduit à transférer une charge supplémentaire, et non fondée, sur des budgets de collectivités locales déjà soumis à rude épreuve, certaines d’entre elles étant réellement dans l’impossibilité d’intégrer et de supporter ces coûts.
En conséquence, je souhaite, madame la secrétaire d’État, connaître les mesures que vous envisagez de prendre pour modifier le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et le rendre conforme à la loi.
Monsieur le sénateur, les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques et, plus particulièrement, leur mode de financement ont récemment été mis en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme.
Ces nouvelles dispositions, qui doivent s’appliquer aux autorisations d’urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient la prise en charge financière de 60 % des travaux d’extension par la collectivité qui délivre l’autorisation d’urbanisme, les 40 % restants devant donc être pris en charge par les tarifs d’utilisation des réseaux et, ainsi, mutualisés entre les consommateurs au niveau national.
Compte tenu des conséquences financières, potentiellement lourdes, pour les collectivités, il avait été souhaité de définir précisément la consistance d’une opération d’extension du réseau électrique. Tel est l’objet du décret du 28 août 2007, dont vous demandez la modification.
Vous signalez une divergence d’appréciation, de la part des collectivités, sur la qualification des travaux d’extension dont certains pourraient plutôt être considérés comme des travaux de renforcement, et donc pris en charge par les tarifs d’utilisation des réseaux. La frontière séparant travaux d’extension et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la commission de régulation de l’énergie, gardienne des tarifs de transport et de distribution.
Cette question a été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l’énergie le 20 janvier dernier. Le ministre d’État Jean-Louis Borloo a demandé à son président, le député Jean-Claude Lenoir, de constituer un groupe de travail précisément dédié à ce sujet. Sa première réunion a eu lieu le 11 mars dernier.
Nous attendons les conclusions de ce groupe de travail pour prendre une décision.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de l’attention que vous avez accordée aux inquiétudes dont je vous ai fait part.
Les renforcements représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros par permis de construire pouvant être accordé par une mairie. Les petites communes rurales n’auront plus les moyens d’avoir des terrains constructibles et donc ne se développeront plus. C’est pourquoi je me suis permis de vous poser cette question aux conséquences importantes.
J’attends beaucoup du groupe de travail mis en place. J’espère qu’il pourra très rapidement vous faire des propositions acceptables par les communes rurales.

La parole est à M. Jean Bizet, auteur de la question n° 462, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

J’aimerais attirer votre attention, madame la secrétaire d’État, sur les relations qu’entretiennent les collectivités territoriales avec les associations de protection de l’environnement.
Le deuxième alinéa de l’article 43 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit un régime nouveau de droits et obligations pour les associations et fondations œuvrant pour l’environnement, à condition qu’elles remplissent des critères, notamment, de représentativité, de gouvernance, de transparence financière, ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité.
La reconnaissance, au travers de la définition de ce nouveau régime, du rôle des associations de protection de l’environnement est importante. Bien entendu, il n’est pas question d’une remise en cause.
Il convient toutefois de constater que beaucoup d’élus locaux en charge de l’urbanisme sont fréquemment confrontés à des situations conflictuelles avec ces associations. Cela est particulièrement vrai dans le département de la Manche, où l’application de la loi littoral donne lieu à un contentieux important, parfois amplifié par des recours abusifs. Cette insécurité juridique préjudiciable au développement a d’ailleurs été clairement mentionnée dans le rapport d’information n° 421 relatif à l’application de la loi littoral, fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des lois du Sénat.
C’est d’autant plus vrai que l’usage de la procédure pour requête abusive est très rare. Le juge considère bien souvent que le bénéficiaire d’une autorisation de construire peut la mettre en œuvre, puisque les recours en annulation n’ont pas de caractère suspensif.
Par conséquent, pour éviter un tel contentieux, les élus finissent par s’appuyer sur l’expertise technique de ces associations, moyennant, fréquemment, des frais importants. Aussi conviendrait-il de mieux encadrer les prestations fournies par ces associations ainsi que les montants financiers demandés.
Je souhaite donc, madame la secrétaire d’État, connaître les dispositions que vous entendez prendre pour apaiser les relations entre les collectivités territoriales et les associations de protection de l’environnement.
Monsieur le sénateur, vous soulignez une question effectivement importante : la reconnaissance du rôle des associations qui ont œuvré dans le domaine du Grenelle de l’environnement. Un préalable incontournable a été posé aux nouvelles missions que nous souhaitons leur confier, à savoir les critères de représentativité, d’autant plus importants que les acteurs concernés seront amenés à siéger au sein des instances disposant d’une compétence consultative dans le domaine du développement durable.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, vous l’avez rappelé, prévoit de préciser la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux et d’intégrer à ce titre les conclusions de la mission parlementaire confiée au député Bertrand Pancher dans le cadre du comité opérationnel n° 24.
Néanmoins, il est certain que la redéfinition des critères de représentativité ne remet pas en cause, a priori, le droit de recours dont disposent ces associations, notamment les associations agréées.
Par ailleurs, vous avez évoqué les difficultés rencontrées par les communes du département de la Manche dans l’application de la loi littoral. Ce constat doit nous inciter, pour les procédures d’information et de consultation, à travailler le plus en amont possible avec les associations et avec le public, comme d’ailleurs vous le faites.
J’en viens à la question des prestations sollicitées. Les règles de la commande publique et le régime juridique des subventions doivent permettre d’encadrer d’un point de vue financier et comptable les relations entre les collectivités et les associations. J’ajoute que l’expertise juridique et technique des services de l’État peut être apportée aux collectivités dans ces domaines.
C’est ainsi que nous souhaitons améliorer la sécurité juridique de vos interventions, sécurité dont nous comprenons bien la nécessité, et c’est ainsi que nous voulons œuvrer à l’avenir, dans le cadre du projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, j’ai pris bonne note de votre réponse, que, vous n’en serez pas surprise, je trouve encore trop timide.
Il est assez logique que, dans le département de la Manche, qui compte 375 kilomètres de côtes, nous nous sentions très concernés par la loi littoral. Or, croyez-moi, certaines associations – que je ne nommerai pas – se livrent à un véritable travail d’intimidation à l’égard des élus locaux et font indéniablement de ces recours abusifs leur fonds de commerce. C’est absolument inacceptable. Je suis tout à fait conscient de leur expertise, mais je ne peux pas non plus accepter que, dans certains grands quotidiens du grand ouest de la France, elles avouent que leurs « actions mettent en lumière les carences des services de l’État ». Là aussi, c’est littéralement inadmissible.
Je connais la pertinence et la qualité des actions des services de l’État, et je suis résolument choqué par ce type de propos. Ces associations, si je reconnais leurs droits, ne doivent pas, de leur côté, méconnaître les obligations qui sont les leurs. Je souhaite que l’on aille plus loin dans l’encadrement des prestations qu’elles exigent des collectivités locales.

La parole est à M. Simon Sutour, auteur de la question n° 468, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Ma question s’adresse à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et je note avec intérêt que c’est vous, madame la secrétaire d’État chargée de l’écologie, qui allez me faire part de la réponse du Gouvernement.
Depuis de nombreuses années, le projet de 2 x 2 voies dans le Gard rhodanien reste un enjeu majeur du développement économique du département du Gard et de la région Languedoc-Roussillon. La mobilisation de l’ensemble des élus et des partenaires institutionnels et économiques a permis de lancer le 13 avril 1999 la déclaration d’utilité publique, ou DUP.
Au-delà du projet lui-même, la DUP doit permettre l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des infrastructures routières. Or l’État a semblé ne pas retenir ce projet comme prioritaire, et le retrait du projet du contrat de plan État-région 2008-2013 a malheureusement confirmé ces craintes. Pourtant, ce territoire connaît une augmentation démographique régulière depuis plus de quarante ans, et l’ensemble des acteurs locaux a réalisé des efforts très importants pour les reconversions industrielles.
Aujourd’hui, les acquisitions foncières ne sont pas terminées alors que la déclaration d’utilité publique expire dans treize jours exactement. Il aura fallu que le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon annoncent leur participation financière – 6, 3 millions d’euros chacun ! – à l’achat des derniers terrains, qui n’est pourtant pas de leur compétence, pour que l’État apporte enfin sa contribution. Je souhaiterais, madame la secrétaire d’État, que vous confirmiez cette information, et plus particulièrement l’envoi des arrêtés de cessibilité.
Pour autant, après l’acquisition des derniers terrains, la phase de travaux doit être lancée rapidement. Là encore, l’État doit assumer ses obligations et donner des garanties sur le financement intégral des travaux, qui s’élèverait à près de 200 millions d’euros.
En effet, il ne serait pas acceptable que le poumon industriel de cette région continue d’être asphyxié par des infrastructures routières obsolètes. D’ailleurs, tous les élus, toutes tendances confondues, se sont mobilisés pour faire part de leur stupéfaction devant la position de l’État sur ce dossier.
C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir préciser clairement les engagements de l’État sur la réalisation rapide des dernières acquisitions foncières et la garantie du financement des travaux qui suivront.
Monsieur le sénateur, vous portez un grand intérêt à l’aménagement de la Rhodanienne. Il est en effet important d’accompagner le développement du Gard rhodanien, qui constitue le poumon industriel de la région Languedoc-Roussillon. Cependant, les fonctions remplies par les routes nationales 86 et 580 ne correspondent pas à celles qui sont assignées principalement au réseau routier national ; ne supportant qu’une part très faible de trafic de transit à l’échelle nationale, ces routes ont une vocation essentiellement locale.
Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent malheureusement pas d’investir massivement sur cet itinéraire dans les cinq années à venir. Néanmoins, afin de ne pas freiner le développement économique, l’État a décidé de profiter de la déclaration d’utilité publique – qui, vous l’avez rappelé, arrive à échéance le 13 avril 2009 – pour mener à leur terme les acquisitions de terrains nécessaires.
Le Gouvernement confirme donc que les financements nécessaires à l’acquisition de la totalité des terrains seront bien inscrits au programme de développement et de modernisation des itinéraires Languedoc-Roussillon et que la contribution de l’État sera portée à un tiers des crédits, le solde devant être apporté par le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon, conformément aux engagements pris.

Madame la secrétaire d’État, votre réponse était sinon laconique, du moins plutôt brève !
Vous l’avez souligné, la déclaration d’utilité publique arrive à échéance le 13 avril prochain, puisqu’elle a été prise le 13 avril 1999. Sous la pression du département du Gard et de la région Languedoc-Roussillon – qui ont accepté, alors que ce n’est pas de leur compétence, de mettre chacun 6, 3 millions d’euros dans la balance –, l’État consent à son tour à accorder 6, 3 millions d’euros pour que ces acquisitions se réalisent et que le bénéfice de la DUP ne soit pas perdu.
J’aurais aimé, madame la secrétaire d’État, que vous vous montriez plus précise sur les arrêtés de cessibilité, étant entendu qu’ils doivent partir d’ici au 13 avril.
Vous avez indiqué que les crédits seraient inscrits ; c’est une confirmation importante.
En revanche, je suis quelque peu déçu que l’on ne modifie pas, par exemple par un avenant, le contrat de plan État-région 2008-2013 pour mettre enfin les travaux en route – c’est le cas de le dire, s’agissant d’une 2 x 2 voies !
Sourires

L’ensemble des élus gardois, toutes tendances confondues, parlementaires comme élus locaux, va poursuivre son action. En cette période de plan de relance – un député de la circonscription a même été nommé en mission auprès du ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance ! –, nous allons, tous ensemble, coordonner nos efforts pour que le Gouvernement inscrive les crédits nécessaires et qu’après l’acquisition des terrains commencent enfin les travaux, qui sont particulièrement indispensables.

La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 461, adressée à M. le secrétaire d’État chargé des transports.

Ma question s’adressait à M. le secrétaire d’État chargé des transports, mais je suis très heureux que Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie me réponde, d’autant qu’elle connaît bien notre département !
Ma question concerne les problèmes ferroviaires en Normandie, plus particulièrement sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre.
Les retards de plus en plus fréquents – quand ce ne sont pas des annulations pures et simples – posent de graves problèmes aux familles, dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle, de même qu’aux employeurs. Ma collègue Catherine Morin-Desailly me racontait que le train Rouen-Paris qu’elle avait pris la semaine dernière avait eu une heure de retard et qu’un chef d’entreprise voyageant dans le même train n’avait pu prendre son avion à Roissy. On voit bien les conséquences de tels retards !
Les causes sont connues : elles tiennent à la fois à l’engorgement des lignes à l’arrivée en Île-de-France et aux travaux de rénovation qui ont enfin lieu, mais qui sont programmés sur dix ans, ce qui est excessivement long.
La durée de ces travaux doit être raccourcie et le projet EOLE à l’ouest, qui comporte la création d’une nouvelle gare en Île-de-France destinée à désengorger le trafic, doit être mis en place. Ces points importants ont été évoqués lors de la rencontre qui a eu lieu entre les parlementaires du département et M. Pepy, le président de la SNCF.
Par ailleurs ont été mis en place depuis le mois de décembre de nouveaux horaires qui ne sont pas conciliables avec les contraintes qui peuvent peser sur certains usagers. Ainsi, à Vernon, les heures des trains pour Paris ne sont plus compatibles avec l’heure d’ouverture des crèches !
Le dernier sujet extrêmement important est celui des tarifs. Dès que l’on quitte l’Île-de-France, on se heurte à un « mur tarifaire ». Lorsque l’on prend le train à Bueil, à Évreux ou à Vernon, le prix de l’abonnement est supérieur de plus de 200 % à celui qui se serait appliqué au départ de la plus proche gare d’Île-de-France. J’ai eu l’occasion d’évoquer ce sujet lors de la discussion ici même du projet de loi relatif à la régulation des transports ferroviaires, au cours de laquelle la Haute Assemblée a adopté à l’unanimité, contre l’avis du Gouvernement d’ailleurs, un amendement que j’avais cosigné et qui visait à fixer le principe selon lequel la nouvelle autorité de régulation ferroviaire pourrait émettre un avis sur l’équité des politiques tarifaires. Il me paraît effectivement nécessaire qu’à l’avenir ce mur tarifaire disparaisse.
Enfin, toujours à propos des tarifs, il semblerait que la SNCF ait décidé à partir du 1er avril, c’est-à-dire très prochainement, de supprimer la dégressivité sur les abonnements ; celle-ci consistait en un abattement de 30 % à partir de la deuxième année et de 50 % à partir de la troisième année. Si tel était le cas, ce serait tout à fait préoccupant puisque, vous le savez, madame la secrétaire d’État, le coût des transports pèse de plus en plus dans le budget des familles.
Ma question est donc très simple : quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour que les usagers normands soient normalement traités ?
Monsieur le sénateur, vous souhaitez que les opérations de rénovation de la ligne Paris-Le Havre soient accélérées. Je connais effectivement bien cette ligne.
Ce programme de rénovation doit être précédé sur certaines sections, notamment entre Mantes et Rouen, de la mise en place « d’installations permanentes de contresens » destinées à éviter les perturbations du trafic durant les travaux. Ces travaux d’installations permanentes doivent démarrer en avril, si le calendrier est bien respecté.
Par ailleurs, l’amélioration de ces dessertes fait actuellement l’objet de réflexions dans le cadre du plan global d’amélioration de la desserte de la Basse-Normandie. Dominique Bussereau le présentera aux élus de cette région dans les tout prochains jours.
Les points de blocage qui obèrent le bon fonctionnement des dessertes se situent principalement sur le tronc commun, entre Mantes et Paris-Saint-Lazare. Pour y remédier, des aménagements à moyen terme, en Île-de-France, sont actuellement à l’étude afin d’apporter plus de robustesse à la ligne. À plus long terme, la fiabilisation des dessertes supposera une séparation entre les circulations rapides et les circulations lentes.
Le projet EOLE, que vous avez cité, est mentionné explicitement à l’article 13 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. Son prolongement à la Défense, puis vers le Mantois, permettrait de libérer des capacités en gare de Paris-Saint-Lazare au bénéfice des liaisons normandes. C’est une question que nous étudions très sérieusement.
S’agissant du problème des horaires, la régularité s’améliore progressivement depuis la fin du mouvement de décembre dernier.
Dans le cadre du service de 2009, l’offre de trains circulant sur l’axe Paris-Vernon-Rouen connaît un accroissement significatif avec dix-neuf trains supplémentaires par semaine, soit 14 % d’augmentation.
Concernant la fréquence des trains aux heures de pointe entre la gare de Paris-Saint-Lazare et les deux principales gares du département de l’Eure – Vernon et Évreux –, les voyageurs bénéficient aujourd'hui aux heures de pointe d’un train toutes les dix-huit minutes sur la ligne Vernon-Paris, d’un train toutes les vingt-cinq minutes pour le retour Paris-Vernon et d’un train toutes les trente-six minutes pour le retour jusqu’à Évreux.
Quant aux tarifs des abonnements, les écarts entre l’Île-de-France et les régions limitrophes, qui sont non négligeables, résultent de la coexistence de deux systèmes tarifaires différents. Dans certaines régions, les conseils régionaux ont mis en place des tarifications spécifiques pour limiter ces effets de seuil. Il appartient aux autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs de décider de l’opportunité ou non d’une telle mesure tarifaire visant à faciliter les déplacements interrégionaux vers l’Île-de-France.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. J’aurais bien sûr préféré quelques annonces plus fortes concernant notamment le projet EOLE vers l’ouest. Si l’étude du projet est une bonne chose, la réalisation de ce dernier en serait une meilleure encore !
Je formulerai les mêmes observations sur les délais de modernisation de la ligne. Le président de la SNCF nous avait indiqué que la modernisation s’étalerait sur dix ans, mais qu’il était techniquement possible de raccourcir les délais. Il s’agit là aussi, me semble-t-il, d’un problème de crédits ; ces investissements lourds, outre les améliorations qu’ils permettraient d’apporter aux usagers, contribueraient utilement à la relance souhaitée par le Gouvernement.
Enfin, s’agissant des tarifs, il est vrai que la Haute-Normandie, contrairement à d’autres régions, n’a pas souhaité que ce « mur tarifaire » soit adouci par un barème plus progressif. J’espère qu’il en ira différemment à l’avenir.
La base juridique de ce système relève, selon M. le secrétaire d’État aux transports, d’une loi qui date de plusieurs dizaines d’années. Il est donc nécessaire que le législateur se saisisse de cette question, car le périmètre tarifaire actuel ne correspond plus ni au bassin de vie ni au bassin d’emploi ; mais cela n’exonère en rien – vous avez raison de le souligner, madame la secrétaire d’État – la responsabilité de la région, qui a compétence en la matière.

La parole est à M. Bernard Fournier, en remplacement de M. Alain Fouché, auteur de la question n° 460, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique.

Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remplace au pied levé notre collègue Alain Fouché, retenu dans la Vienne à l’occasion de la visite du Président de la République dans ce département.
Le problème en matière de télévision numérique terrestre, ou TNT, auquel est confronté le département de la Vienne se pose également dans de nombreux autres départements français, notamment dans des communes rurales ou montagnardes.

La couverture hertzienne pour la télévision numérique terrestre se met progressivement en place dans le département de la Vienne. Avec les émetteurs de la Vienne et ceux des départements limitrophes, la couverture théorique atteint pour l’instant 80 % de la population. En 2009, quatre émetteurs supplémentaires seront mis en service dans ce département et, par décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 16 décembre 2008, six émetteurs supplémentaires ont été intégrés au plan de diffusion de la TNT.
Le taux de couverture théorique de la Vienne atteindrait maintenant 97 %. Aujourd’hui, ce sont près de 98 % des habitants de la Vienne qui reçoivent la télévision. Or, en l’état des projections effectuées par Télédiffusion de France, il apparaît que de nombreux habitants pourraient ne plus rien recevoir dès le troisième trimestre 2010. À cette échéance, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, prévoit en effet le basculement de la Vienne vers la TNT et l’extinction de la télévision analogique.
Parallèlement, l’article 80 de la récente loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements qui en font la demande peuvent se voir assigner, par le CSA, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de la TNT. Cette disposition conduirait les collectivités candidates, dont ce n’est pas la compétence, à se substituer aux distributeurs, notamment France Télévisions, pour apporter ce service aux citoyens des zones rurales les moins bien desservies.
À défaut, nos concitoyens des zones rurales seraient exposés à des coûts d’équipement importants sans avoir nécessairement les moyens financiers d’y faire face.
Dans le programme d’actions du groupement d’intérêt public France Télé numérique, le secrétaire d’État à l’économie numérique a prévu certaines aides en faveur des personnes sensibles et des ménages à faibles revenus, aides qui semblent toutefois essentiellement destinées aux foyers déjà couverts par la TNT hertzienne.
Madame le secrétaire d’État, je vous remercie donc de bien vouloir nous préciser les dispositions prévues pour soutenir nos concitoyens des zones rurales qui n’auraient pas accès à la TNT hertzienne et qui devraient avoir recours au satellite.
Monsieur le sénateur, la télévision numérique terrestre, lancée en France voilà quatre ans, rencontre un très vif succès, puisque désormais deux foyers sur trois la reçoivent quel que soit le support.
Le déploiement de la TNT se poursuit à un rythme extrêmement soutenu. Selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la TNT couvrait près de 87 % de la population à la fin de l’année 2008, et une quarantaine de nouveaux émetteurs ont déjà été mis en place depuis le début de cette année.
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a introduit plusieurs dispositions visant à accompagner l’extension de la couverture du territoire par la TNT. La loi impose ainsi une couverture numérique de 95 % de la population aux chaînes historiques gratuites. Elle a introduit en outre un dispositif incitatif pour les nouveaux services de la TNT. Ce dispositif a pleinement porté ses fruits : l’ensemble des chaînes de la TNT se sont en effet engagées à couvrir également au minimum 95 % de la population, en contrepartie d’une prorogation de cinq ans de leurs autorisations.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que l’extension de la couverture de la TNT dans tous les départements est un objectif majeur du Gouvernement, objectif qui a guidé l’élaboration du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, lequel, approuvé par le Premier ministre le 22 décembre dernier, fixe le cadre du passage à la télévision tout numérique.
Ainsi, le CSA a publié le 23 décembre 2008 la liste des zones qui seront couvertes par la TNT avant l’extinction de la diffusion analogique. Dans ce cadre, le CSA a notamment retenu dix émetteurs à convertir au numérique dans la Vienne, dont quatre prévus pour le mois de juillet 2009 en plus des trois déjà en service.
Pour les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT au terme du processus, il existe plusieurs solutions alternatives ; en particulier, une offre gratuite par satellite disponible sur tout le territoire permettra de recevoir l’ensemble des chaînes nationales en clair, sans aucun abonnement ni frais de location.
Enfin, un fonds prévu par la loi du 5 mars 2007 viendra en aide aux foyers les plus démunis pour leur permettre de s’équiper afin de recevoir les chaînes de la TNT : équipement en adaptateur TNT dans les zones couvertes, équipement de réception par satellite dans les zones non couvertes par la TNT. Le montant des aides sera bien sûr adapté à la dépense à consentir ; l’aide accordée aux foyers résidant dans des zones non couvertes par la TNT tiendra compte du surcoût représenté par l’achat d’un équipement de réception de la télévision par satellite par rapport à l’acquisition d’un simple adaptateur TNT.

Madame le secrétaire d’État, je vous remercie de votre qualité d’écoute et des bonnes nouvelles que vous nous apportez, notamment en ce qui concerne les zones rurales ou montagnardes. Nous sommes très sensibles à cette démarche et à cette attitude du Gouvernement.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, auteur de la question n° 494, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question concerne le mode de scrutin de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse.
Je ferai un bref rappel. En février 2007, le Sénat a adopté une proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin pour l’élection des membres de l’Assemblée de Corse par un rehaussement des seuils. En décembre 2008, Mme Alliot-Marie a indiqué qu’elle attendait bien entendu l’avis de l’Assemblée de Corse. En effet, la loi du 22 janvier 2002, dite « loi Jospin », a étendu aux propositions de loi la nécessité de consulter l’Assemblée de Corse, disposition qui s’appliquait auparavant aux seuls projets de loi.
Je rappelle que si nous connaissons les modalités de consultation pour les projets de loi, il n’en va pas de même s’agissant des propositions de loi, faute de jurisprudence.
Par ailleurs, la proposition n° 19 du rapport du comité Balladur préconise de rehausser les seuils valables pour l’élection à l’Assemblée de Corse, s’inspirant au demeurant de la proposition de loi votée par le Sénat.
Cette proposition, qui a été adoptée à l’unanimité, est d’application immédiate, puisque le rapport du comité Balladur précise que tant que le mode de scrutin de l’Assemblée de Corse reste distinct des autres modes de scrutin, il faut passer immédiatement à l’action, c’est-à-dire le modifier. Il ajoute – c’est la phrase essentielle, et j’y insiste, monsieur le secrétaire d’État – qu’aucun motif d’intérêt général, selon la formule du Conseil constitutionnel, ne justifie que le mode de scrutin ne permette pas de donner une majorité à l’Assemblée de Corse comme dans toutes les autres régions françaises.
Voilà où nous en sommes aujourd’hui. S’inspirant de ces éléments, l’Assemblée de Corse a voté, voilà quinze jours, une proposition de résolution tendant à modifier le mode de scrutin.
Quel est maintenant le débat ?
Il s’agit de savoir si l’Assemblée de Corse a été saisie juridiquement, dans les conditions requises, puisqu’elle n’a pas été consultée ; c’est en quelque sorte proprio motu qu’elle s’est emparée de ce problème.
La loi du 22 janvier 2002 prévoit deux hypothèses : ou bien l’Assemblée de Corse donne un avis parce qu’elle est consultée – cela n’a pas été formellement le cas –, ou bien elle peut toujours, en vertu de ce même texte, donner un avis parce qu’elle a toujours la possibilité de formuler des propositions de modification de nature législative s’agissant de son mode d’organisation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui !
Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État : que compte faire le Gouvernement ? Faudra-t-il attendre encore longtemps un minimum de lucidité de la part des services ministériels pour les décider à nous sortir enfin de la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons depuis quinze ou vingt ans ? L’Assemblée de Corse ne va tout de même pas ressembler à la Knesset – un parti peut y obtenir un siège avec 2 % des suffrages exprimés ! –, avec les difficultés que cette situation entraîne ! Je le répète, l’Assemblée de Corse doit enfin avoir un mode de scrutin lui permettant de gouverner dans des conditions normales ; des modifications ont déjà eu lieu dans les années quatre-vingt-dix pour régler toute une série de problèmes liés à l’absence de majorité dans d’autres régions !
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de Mme Alliot-Marie, auditionnée en ce moment même par la commission des lois du Sénat.
Vous avez interrogé le Gouvernement sur la modification du mode de scrutin de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse. Comme Mme le ministre vous l’a déjà indiqué à l’occasion d’une question d’actualité au Gouvernement posée sur le même sujet le 11 décembre dernier, deux conditions nous semblaient nécessaires pour donner suite à votre proposition de loi visant à assurer une majorité stable à l’Assemblée de Corse, tout en garantissant la représentation des oppositions.
D’une part, il s’agit de connaître les conclusions du comité pour la réforme des collectivités locales. Ainsi que vous l’avez souligné, celles-ci rejoignent votre argumentaire sur ce point.
D’autre part, il s’agit de parvenir à un consensus au sein de l’Assemblée de Corse. Or une motion relative à cette proposition a été adoptée le 16 mars dernier par vingt-neuf voix contre deux, vingt élus n’ayant cependant pas pris part au vote puisqu’ils ont quitté l’assemblée pour manifester leur opposition.
Tout en notant l’existence d’une majorité, il me semble difficile, dans ces conditions, de conclure à un véritable consensus.
En tout état de cause, et conformément au code général des collectivités territoriales, cet avis doit désormais être transmis au président de l’Assemblée nationale, cette dernière ne s’étant pas encore prononcée sur votre proposition de loi.
Par ailleurs, il convient de signaler que toute modification du régime électoral de l’assemblée de Corse – la sixième depuis 1982 – ne peut intervenir moins d’un an avant le renouvellement de cette dernière, conformément à la tradition républicaine.
Il appartiendra donc au Parlement, en coordination avec le Gouvernement, d’estimer si cette réforme présente un caractère d’urgence ou si elle doit plutôt s’inscrire dans le cadre des évolutions plus profondes de l’organisation territoriale nationale qui sont aujourd’hui envisagées dans le cadre des conclusions du comité Balladur.
Je serai très clair, monsieur le sénateur. Compte tenu des difficultés récurrentes de fonctionnement que l’Assemblée de Corse a connues dans le passé, le Gouvernement estime qu’une modification des modalités de fonctionnement paraît urgente – et j’emploie cet adjectif à dessein. Il se mobilisera donc pour faire inscrire votre proposition de loi à l’ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale selon les nouvelles règles en vigueur et sera très attentif à ce qu’il en adviendra.

Monsieur le secrétaire d'État, je prends acte de vos propos.
Je reconnais que la gestion d’un tel dossier est difficile pour le Gouvernement. Toutefois, si ce n’est pas lui qui prend une initiative très forte, nous ne sortirons pas de cette situation.
Si le mode de scrutin de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse ne devait pas être modifié, le désordre règnerait de nouveau. Au passage, j’oublie la déontologie républicaine, car on ne va pas tenir une comptabilité notariale pour savoir si l’on dépasse de quinze jours le délai d’un an !
Monsieur le secrétaire d'État, comme le sait très bien l’expert de ces questions que vous êtes, plus une assiette électorale est étroite, plus il faut relever les seuils. En effet, avec une assiette de 150 000 électeurs, il suffit de 3 000 voix pour obtenir 2 % des suffrages exprimées ! Il va de soi que la situation n’est pas comparable à celle des régions PACA, Aquitaine ou d’Île-de-France.
Je vous supplie donc de prendre cette affaire en mains, afin de faire disparaître les désordres actuels.

La parole est à M. Jean-Claude Frécon, auteur de la question n° 466, transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le président, ma question concerne le financement des travaux réalisés dans le Massif central – une région que M. le secrétaire d’État connaît bien – à la suite des dégâts causés par les crues du début du mois de novembre 2008.
La situation est différente selon la nature du maître d’ouvrage. L’État apporte en effet une participation financière si c’est une commune ou une communauté de communes qui est maître d’ouvrage, mais non si c’est un syndicat mixte. Pour quelles raisons ?
En tant que représentant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, vous connaissez la réponse d’ordre général, monsieur le secrétaire d'État : un syndicat mixte n’a pas la qualité de collectivité locale.
Toutefois, les rivières, qui sont la cause principale de ces crues, ne recoupent pas forcément les limites d’une commune – même jamais ! –, ni celles d’une communauté de communes – pas souvent ! –, car le bassin versant de la rivière se trouve fréquemment sur plusieurs communautés de communes. Or, lorsque celles-ci veulent s’associer entre elles, elles ne peuvent le faire que sous la forme d’un syndicat mixte, la forme du syndicat intercommunal leur étant interdite pour une question de droit, ce que nous comprenons fort bien.
L’État a donc demandé, par l’intermédiaire des préfectures, aux communautés de communes existantes, qui avaient auparavant compétence pour engager les travaux consécutifs aux dégâts des crues, de se constituer en syndicat mixte ; dans le même temps, il argue du fait qu’un syndicat mixte ne peut bénéficier de subventions ! Les élus locaux considèrent donc – et moi aussi – qu’ils sont floués !
Une double question se pose à mon avis : une question de procédure et une question de fond.
Concernant la procédure, que faire pour ces collectivités locales regroupées en syndicat de rivière, souvent sous forme de syndicat mixte, afin de mieux gérer toutes les questions relatives à la rivière ? On comprend bien la procédure légale les contraignant à se transformer en syndicat mixte. Elles pourraient certes adhérer à une communauté de communes ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est beaucoup plus large, mais cela poserait alors de sérieux problèmes.
Vous le savez bien, autant en zone de montagne l’entité d’une vallée se défend tout à fait comme contexte économique et environnemental, autant en zone de moyenne montagne, comme la nôtre, avec une partie montagne, une partie basse montagne et une partie plaine associées dans un même syndicat mixte, on a l’obligation de respecter les collectivités qui existent d’ores et déjà.
Concernant la question de fond, je tiens à dire que les crues font surtout des dégâts dans les communes de plaine, lesquelles sont toutes associées au sein d’un syndicat mixte.
Le texte de ma question mentionne le syndicat mixte du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy, mais j’ai aussi reçu dernièrement une lettre du président du syndicat interdépartemental mixte à la carte pour l’aménagement de la Coise et du Furan, qui regroupe de surcroît des communes de deux départements voisins, la Loire et le Rhône. À ce niveau, il serait difficile de résoudre le problème en créant une même entité, communauté de communes ou communauté d’agglomération. Pourtant la question se pose. Le président de ce syndicat mixte m’écrit ceci : « N’est-il pas urgent que l’État révise sa position sur l’éligibilité des structures porteuses des travaux postérieurs aux crues en prenant plus en compte la structure porteuse de la compétence rivière que le type de son statut ? »
Monsieur le secrétaire d'État, il faudrait faire évoluer la position de l’État pour prendre en compte à la fois la compétence du syndicat mixte en matière de gestion de la rivière et les conséquences des débordements éventuels de ces rivières, qui doivent être traités de la même façon sur tout le territoire, et ce quelle que soit la structure porteuse.
Monsieur le sénateur, vous avez interrogé M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui vous prie d’excuser son absence, sur le refus par l’État de la prise en considération de travaux consécutifs à la crue de novembre 2008 effectués par un syndicat mixte dans votre département. Comme vous l’avez souligné, de nombreux autres départements, notamment en montagne ou en moyenne montagne, sont aussi concernés. La réponse que je vous ferai vous donnera, je l’espère, satisfaction.
Je le rappelle, de violentes intempéries ont touché le département de la Loire, ainsi que plusieurs autres départements limitrophes, les 1er et 2 novembre 2008, causant d’importants dégâts aux biens des collectivités territoriales notamment.
Compte tenu de l’ampleur des dégâts subis par les collectivités territoriales, je vous confirme aujourd'hui qu’il est envisagé de mettre en œuvre la procédure de solidarité nationale. Des crédits exceptionnels seront ainsi ouverts, afin de soutenir financièrement la remise en état du patrimoine non assurable.
Une circulaire du 20 février 2004 précise effectivement que la maîtrise d’ouvrage pour les travaux doit être assurée par une collectivité locale ou un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Cette règle exclut par voie de conséquence une maîtrise d’ouvrage assurée par un syndicat mixte, dont l’importance n’est plus à prouver dans la gestion de ces sites.
Je partage tout à fait votre analyse sur le fait que cette restriction n’est pas pleinement justifiée, car, s’agissant de la restauration des abords d’un cours d’eau, c’est la plupart du temps un syndicat mixte qui est maître d’ouvrage.
À la lumière des conclusions de la mission interministérielle en cours sur la dernière tempête de janvier 2009, il vous sera proposé dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les semaines à venir, une modification de la circulaire, afin de permettre la maîtrise d’ouvrage par un syndicat mixte.

Je tiens tout d’abord à vous remercier, monsieur le secrétaire d'État, de cette bonne nouvelle, ou plutôt de ce début de bonne nouvelle. En effet, votre réponse appelle de ma part une autre question : la nouvelle circulaire aura-t-elle un effet rétroactif sur les dégâts causés par la crue des 1er et 2 novembre 2008 ? Les syndicats mixtes concernés par ces dégâts pourront-ils bénéficier de cette nouvelle solidarité ?

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 379, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

Je souhaite appeler l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés induites par l’application de l’article L. 620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères.
En effet, il est fréquent que des personnes âgées vendent leur bien en viager afin de bénéficier des arrérages de rente et de subvenir ainsi à leurs besoins ou de compléter leurs revenus.
Malheureusement, des difficultés apparaissent lorsque les crédirentiers vendent à des commerçants qui tombent en faillite.
En cas de faillite du commerçant, l’article L. 620-1 du code de commerce a en effet pour conséquence de priver le crédirentier de ses arrérages et de tout espoir de paiement ultérieur, puisque l’arrêt des poursuites individuelles interdit la mise en recouvrement de l’arriéré et que la force résolutoire ne peut s’exercer. Cette situation est catastrophique pour ces crédirentiers impayés qui attendaient bien souvent de cette vente un complément de ressources indispensable à leur revenu.
Plusieurs parlementaires ont eu l’occasion d’interpeller le Gouvernement, accompagnant en cela l’Association nationale pour la défense des intérêts des rentiers viagers, l’ANDIRV, qui souhaite la révision de cet article pour que des dispositions particulières règlent ce type de situation.
Afin de protéger les personnes âgées, l’ANDIRV propose notamment de compléter l’article L. 622-23 du code de commerce en introduisant un privilège spécial au profit de ces crédirentiers, tout comme il existe déjà d’autres privilèges spéciaux. Il est donc indispensable que les clauses de garantie de l’acte, le privilège du vendeur et la clause résolutoire ne jouissent d’aucune exception.
Cette question se pose depuis longtemps. En 2002, interpellé sur ce sujet, M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, avait confirmé qu’en application de l’article L. 621-40 du code de commerce les recours du vendeur d’un bien immobilier contre l’acquéreur qui ne paie plus la rente viagère stipulée lors de la vente sont suspendus lorsque ce dernier est placé en redressement ou en liquidation judiciaires.
Il reconnaissait que, si cette règle concernait tous les créanciers sans exception, les conséquences de son application étaient particulièrement graves lorsque la rente viagère revêtait un caractère alimentaire pour le créancier.
Aussi le ministre de la justice de l’époque affirmait-il porter un grand intérêt à ce sujet et entendait-il mettre à l’étude les axes de réforme permettant de pallier les inconvénients de cette situation.
Monsieur le secrétaire d’État, l’avenir des retraites est aujourd’hui un sujet de préoccupation particulièrement sensible pour nombre de nos concitoyens, notamment les personnes âgées, et le viager est considéré par beaucoup comme un mode de revenus complémentaires. Il est donc urgent d’agir pour rendre sûr à 100 % le paiement ponctuel des arrérages.
De plus, la crise économique fait malheureusement craindre de nombreuses faillites et, par voie de conséquence, les risques très importants du viager.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et savoir si une telle réforme pourrait être envisagée dans les meilleurs délais.
Monsieur le sénateur, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, actuellement en déplacement en province, vous prie de bien vouloir excuser son absence.
Vous l’avez interrogée sur les difficultés rencontrées par le bénéficiaire d’une rente viagère lorsque la personne qui doit verser cette rente fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Vous rappelez notamment que l’ouverture de cette procédure interrompt le versement de la rente et prive ainsi la personne d’un revenu qui peut lui être nécessaire pour assurer sa subsistance.
Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce sujet. Le ministère de la justice partage votre préoccupation de voir améliorer la protection des personnes qui ont de faibles ressources et sont totalement dépendantes des revenus apportés par le viager.
Pour autant, les mesures à prendre pour atteindre cet objectif ne sont pas évidentes. Il est en effet difficile de renforcer l’efficacité du privilège de celui qui a vendu un immeuble sous forme de viager.
Si l’on met de côté la priorité accordée au paiement de certaines charges de copropriété, ce privilège est déjà au premier rang des privilèges immobiliers spéciaux. De plus, il ne produit ses effets que lorsque les opérations de vente et de répartition ont été réalisées, ce qui, vous en conviendrez, prend souvent un certain temps.
Monsieur le sénateur, l’annulation de la vente pose également des problèmes. Elle oblige en principe le bénéficiaire de la rente à rembourser les sommes qu’il a déjà perçues, ce qu’il ne peut généralement pas assumer. C’est pourquoi il paraît nécessaire au ministère de la justice d’explorer parallèlement un certain nombre d’autres pistes.
Ainsi, il pourrait être envisagé de rendre obligatoire la souscription d’une garantie financière par l’acquéreur du bien en viager, si ce dernier agit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
Une autre solution possible consisterait à prévoir que la personne qui acquiert le bien au cours d’une procédure collective se voit en même temps transférer l’obligation de verser la rente viagère.
Monsieur le sénateur, les services de la Chancellerie s’engagent à étudier ces diverses possibilités dans les meilleurs délais, de façon à assurer une meilleure protection des personnes qui dépendent du versement d’une rente viagère.

Monsieur le secrétaire d’État je vous remercie de cette réponse très complète.
Nous ne méconnaissons pas les difficultés techniques et juridiques qu’il faut surmonter pour régler ce problème. Néanmoins, l’ouverture faite par le Gouvernement, avec notamment la possibilité de souscrire une garantie financière, devrait, si les textes suivent et permettent de fonder cette solution, rassurer les nombreuses personnes âgées qui, dans nos communes, sont très inquiètes.
En effet, le problème des retraites se pose de manière accrue, et la rente viagère est un mode de revenu qui, hélas ! se multiplie, puisque c’est une possibilité pour les personnes âgées de se procurer de nouvelles ressources. Mais encore faut-il que ces personnes soient assurées que la cession de leur bien leur permettra effectivement de bénéficier de la rente viagère !

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, auteur de la question n° 465, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaitais attirer l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un ancien dossier concernant la construction de logements destinés aux surveillants de la maison d’arrêt d’Osny, dans le Val-d’Oise.
En 1999, le ministère de la justice s’est engagé sur un projet de construction de logements destinés aux surveillants de cette maison d’arrêt. Ces logements auraient dû être livrés dans les deux ans. Or non seulement rien n’est sorti de terre, mais ce dossier semble avoir disparu des préoccupations de l’administration, tant celle-ci reste muette sur le sujet.
Il est vrai que, à la suite d’une gestion plus qu’approximative du projet, le ministère de la justice s’est rendu compte, dès 2000, qu’il ne pouvait assumer lui-même la construction de ces logements. Oubliant de prévenir les principaux intéressés de cette impossibilité de financer en direct un tel projet, il a attendu 2005 pour avancer une solution en vue de sortir de l’impasse ! À cette date, le ministère de la justice a en effet annoncé la mise à disposition du terrain situé à l’entrée de la maison d’arrêt et le versement d’une subvention destinée à l’office d’HLM concerné. L’administration pénitentiaire a alors également confirmé que l’étude de faisabilité avait été achevée. Ses conclusions étant positives, il ne restait plus qu’à saisir l’office d’HLM de logements des fonctionnaires pour lancer l’appel d’offres et pour superviser la construction.
À la suite d’une question orale posée le 20 décembre 2005 par un député du Val-d’Oise, M. Axel Poniatowski, l’État a réaffirmé sa volonté de voir ce dossier se concrétiser, a précisé qu’il avait bien l’intention de verser la part de subvention lui incombant et a annoncé que le montage du projet serait définitivement arrêté début 2006.
Or il semblerait que ce dossier soit bloqué parce que RLF, Résidences Le logement des fonctionnaires, est en attente d’une avance de 26 000 euros par logement réservé pour le ministère de la justice.
Nous sommes aujourd’hui en 2009 et, de tous ces engagements, il ne semble plus rien rester.
Pourtant, la question du logement des surveillants de prison de la maison d’arrêt du Val-d’Oise reste cruciale. En effet, ces fonctionnaires, souvent débutants et originaires de province, n’ont pas les moyens de trouver un logement décent en région parisienne. Ils ne peuvent pas plus être logés dans le parc social, étant donné les difficultés quotidiennes que représente le fait d’habiter dans les mêmes quartiers que les familles des détenus qu’ils encadrent.
Toutefois, les surveillants de prison pourraient accéder à des logements locatifs intermédiaires, mais le ministère de la justice n’a fait aucune réservation sur les programmes PLI dans le Val-d’Oise.
Au vu de ces difficultés, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous expliquer où en sont les engagements que l’État a solennellement pris devant les parlementaires en 2005 ? Quelles sont les raisons d’un tel manquement et, surtout, quand les dispositions nécessaires seront-elles prises pour que la réalisation de ces logements puisse commencer ?
Ai-je besoin de vous rappeler que les surveillants de prison exercent un métier extrêmement difficile sur tous les plans ? De plus, dans le cas d’Osny, il s’agit de fonctionnaires très jeunes, dont c’est souvent le premier poste. Voilà autant de raisons justifiant vraiment que ce dossier avance maintenant au plus vite.
Madame la sénatrice, vous avez interrogé Mme le garde des sceaux sur les difficultés rencontrées pour se loger par les personnels de la maison d’arrêt d’Osny, située dans votre département, et plus précisément sur le projet de construction de logements envisagé à leur intention. Mme Rachida Dati, actuellement en déplacement en province, vous prie de bien vouloir excuser son absence.
Ainsi que vous le rappelez, le ministère a retenu en 2005, pour ce dossier, le dispositif dans lequel il s’est engagé depuis plusieurs années et qui consiste à confier à des bailleurs sociaux la construction et la gestion de logements sociaux sur des emprises foncières non utilisées dont il est propriétaire.
En contrepartie de la gratuité du terrain, ces bailleurs se sont engagés, par bail emphytéotique d’une durée maximale de cinquante ans, à réserver l’essentiel des logements ainsi construits à des agents de l’administration du ministère de la justice, le terrain et l’immeuble revenant de plein droit, à l’échéance du bail, au ministère de la justice.
Or, en demandant le versement d’une subvention – vous avez parlé d’ « avance », mais, pour ma part, je préfère le mot « subvention » – de 26 000 euros par logement construit en plus de la mise à disposition à titre gratuit du terrain, l’opérateur avec lequel les négociations sont en cours, à savoir la Résidence Le logement des fonctionnaires, met à la charge du ministère un surcoût rendant le projet trop onéreux.
Compte tenu de l’urgence, il va cependant sans dire qu’il serait préférable de ne pas avoir à relancer une procédure complète auprès d’un nouvel opérateur. Par conséquent, Mme le garde des sceaux a demandé à ses services de vérifier très rapidement si la position de l’opérateur était négociable ou s’il était nécessaire de s’orienter vers un autre partenaire.
L’objectif est que le lancement de la construction de ces logements puisse, quel que soit le dispositif retenu, être engagé dans l’année.
Bien entendu, et afin de permettre aux agents intéressés d’attendre que les logements dont la construction est projetée soient enfin disponibles, des démarches sont en cours pour procéder, en fonction des besoins, à des réservations auprès de bailleurs sociaux de votre département.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
On peut comprendre que RLF qualifie d’« avance » la somme de 26 000 euros, puisque cette société doit construire, payer les entreprises, etc. Les réservataires versent donc une avance qui est loin de couvrir le coût total des logements, ce qui n’est pas extraordinaire.
Cependant, j’entends parler pour la première fois du fait que la mise à disposition du terrain n’était apparemment pas compatible avec le versement d’une subvention destinée à la construction de ces logements. Le personnel concerné, qui suit ce dossier de très près, de même que la direction, n’a pas connaissance de cela. Au demeurant, je ne comprends pas bien pour quelles raisons il a été décidé de ne pas verser un centime en plus de la mise à disposition du terrain !
Monsieur le secrétaire d’État, si je suis sensible à votre réponse et à votre double engagement – vous efforcer de démarrer tout de même ce projet de construction et négocier, pour l’immédiat, avec d’autres offices d’HLM des réservations de logements sur le secteur géographique concerné du Val-d’Oise –, je crains qu’aucune solution concrète ne soit proposée aux personnels, ce qui serait, selon moi, tout à fait regrettable.
Monsieur le secrétaire d’État, si vous alliez visiter cette prison et vous entretenir avec l’ensemble des personnels, de la direction aux surveillants, vous verriez à quel point ils méritent qu’on soit plus sensible aux conditions de vie qui sont les leurs le soir, lorsqu’ils quittent la prison dans laquelle ils sont eux-mêmes enfermés durant leur temps de travail.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, auteur de la question n° 464, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question traite des difficultés rencontrées par les éleveurs de chevaux de trait.
En effet, dans le cœur des Bretons et, plus généralement, des Français, le cheval de trait garde une place toute particulière. Comme le postier, il fait partie de notre patrimoine régional. À ce titre, on le valorise à travers des concours pour la préservation de la race.
Nous devons en effet au cheval de trait une partie de notre prospérité économique au cours du siècle précédent, particulièrement dans le domaine agricole, avant que l’avènement du tracteur et la révolution technique et technologique des mécanismes agricoles ne le relèguent, dans nos campagnes, au second rang des moyens de traction. Le cheval de trait est aujourd’hui essentiellement utilisé dans le domaine du tourisme, du sport et du loisir.
Nos éleveurs nous présentent pourtant de magnifiques spécimens, qu’ils soignent avec passion. Dans nos régions, des hommes et des femmes continuent d’agir et de travailler non par simple souci de rentabilité, mais parce qu’ils aiment ce qu’ils font. Grâce à eux, nous portons aujourd’hui un autre regard sur l’espèce chevaline et nous redécouvrons que cet animal est indispensable aux travaux, puisqu’il permet l’entretien et l’exploitation du bocage, des zones humides et des zones sensibles, inaccessibles aux engins motorisés sous peine de destruction d’un milieu à préserver. Le cheval respecte les sols fragiles et humides : il ne les tasse pas ; il est silencieux et respecte la faune.
C’est au moment où l’État se désengage massivement de ses responsabilités dans l’ensemble de la filière équine, abandonnant ses haras, pourtant lieux d’excellence pour les différentes races sur le plan génétique et la connaissance de cet animal, que le cheval se révèle l’un des éléments forts, si ce n’est central, de la mise en œuvre de politiques soucieuses de la nature et conformes au Grenelle de l’environnement.
Le cheval retrouve son heure de gloire, mais les éleveurs sont désespérés. Ils n’ont plus les moyens de poursuivre un élevage qui coûte cher, qui n’est pas soutenu et qui ne bénéficie que d’une faible reconnaissance. Les éleveurs français, particulièrement bretons, ont réussi à transmettre leur passion au-delà de nos frontières. Ils ont pu développer des marchés vers l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil et le Japon, transformant leur savoir-faire en atout économique, mais leur manque de moyens les empêche de répondre à la demande. À terme, cette situation risque d’entraîner la disparition de nombreux élevages et, de fait, d’une partie de notre patrimoine vivant, à l’échelle régionale et nationale.
Aussi la filière du cheval de trait demande-t-elle son intégration dans le paysage de la politique agricole commune. Reconnue comme une filière agricole en juillet 2004 par la France, cette production ne peut cependant prétendre à aucun soutien européen. Son intégration dans la PAC lui permettrait d’accéder à un soutien de l’Europe dans les domaines où elle intervient fortement, à savoir l’environnement, l’aménagement du territoire et le maintien d’un véritable tissu rural. Il convient d’encourager la démarche de mixité du pâturage dans un souci de gestion économique et écologique des espaces, pour la protection de la biodiversité et des ressources en eau. Le cheval constitue un élément dynamique de la politique de protection des espaces. Sa reconnaissance dans le cadre de la PAC permettrait d’obtenir un statut agricole, et donc d’aider réellement les éleveurs. Ce serait par conséquent un véritable atout pour le développement durable des territoires ruraux. Je souhaiterais donc connaître, monsieur le ministre, les dispositions que vous comptez prendre au niveau européen pour que l’apport du cheval de trait, particulièrement du cheval breton, soit reconnu dans toutes ses dimensions.
Monsieur le sénateur, la situation du cheval de trait, notamment du cheval breton, est un sujet auquel je m’intéresse particulièrement depuis maintenant deux ans. Les productions animales à l’herbe, notamment le cheval de trait, sont l’une de mes priorités.
Tout d’abord, je tiens à vous confirmer que je partage votre analyse sur la contribution du cheval de trait, avec d’autres productions animales, au maintien de la biodiversité, à l’entretien de l’espace rural et, d’une manière générale, à la dynamique de nos territoires.
Au-delà des intentions affichées, j’ai annoncé le 23 février dernier, au nom du Gouvernement, une réorientation significative des aides, dans le cadre du budget européen pour l’économie agricole, à hauteur de 1, 4 milliard d’euros, soit 18 % de ce que reçoit la ferme France au titre des aides directes payables à la fin de l’année 2010. Chacun en conviendra, il s’agit d’une réforme difficile.
Le Président de la République, pour accompagner cette réforme, a confirmé hier l’ensemble des décisions que nous avons prises, notamment le soutien des productions animales à l’herbe ou le sauvetage d’une filière qui était en voie de disparition, à savoir l’élevage ovin. Il m’a demandé de mobiliser un montant de 170 millions d’euros, qui sont disponibles sur le budget communautaire, augmenté d’un supplément provenant du budget national, pour accompagner les exploitations spécialisées en céréales, notamment dans les zones intermédiaires. L’effort de solidarité qui est demandé aux uns et aux autres pour une politique agricole plus juste, plus équitable et plus durable est, me semble-t-il, acceptable.
Nous avons décidé que cette réorientation serait au service de quatre objectifs : l’emploi, l’agriculture durable, l’élevage à l’herbe et la gestion des risques.
L’instauration d’un nouveau mode de soutien à l’élevage à l’herbe constitue une orientation forte que le Président de la République a annoncée dès septembre 2007. Les surfaces herbagères, qui couvrent plus de 45 % de notre territoire, sont un véritable atout pour notre pays.
La création d’un tel soutien répond à une logique économique de maintien de notre potentiel de productions animales à partir de systèmes à l’herbe : 700 millions d’euros seront ainsi mobilisés au sein du premier pilier, auxquels s’ajoutent les crédits de la PHAE, la prime herbagère agroenvironnementale, issus du deuxième pilier. Au total, le soutien des productions animales à l’herbe atteindra presque un milliard d’euros.
Cette décision engage une prise en compte économique, dans la durée, de ce mode de production herbager. Elle permet de combler ce que certains avaient appelé le « trou de l’herbe ».
Ce soutien économique sera ouvert à toutes les surfaces ayant un seuil de chargement supérieur à 0, 5 unité de gros bétail, par hectare. L’aide sera au taux maximum pour un seuil de chargement de 0, 8 unité de gros bétail par hectare et pour les cinquante premiers hectares. Les montants unitaires, ainsi que les critères, seront définis dans les prochaines semaines par un groupe de travail que j’ai mis en place. Monsieur Fichet, je peux d’ores et déjà vous affirmer que les surfaces valorisées par les chevaux seront prises en compte. Il s’agit donc d’une orientation nouvelle et significative, qui s’inscrit dans la durée.
Par ailleurs, mes services, en lien avec les organisations professionnelles, et en particulier France Trait, poursuivent un travail important concernant la rénovation des encouragements à la filière. Vous avez d’ailleurs légitimement évoqué la « reconnaissance » de cette filière.
L’objectif est, dans un contexte budgétaire contraint, d’aller vers une plus grande pertinence et efficacité. Cet exercice, d’ailleurs conduit dans la plus grande concertation, doit donner aux associations nationales de race et à leurs fédérations les moyens d’une plus grande autonomie, ce qui leur permettra d’assumer pleinement leurs responsabilités.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je connais effectivement votre attachement à la production animale du cheval de trait.
Je tenais à souligner le désespoir des éleveurs bretons et, plus généralement, français, qui sont aujourd’hui peu reconnus. J’espère que des éléments de réponse pourront leur être apportés par le biais du soutien à l’élevage à l’herbe. Cependant, leur demande me semble dépasser ce cadre. En effet, ces productions coûtent cher et rapportent peu, sinon rien. Elles dépendent donc uniquement de l’implication de personnes passionnées.
Monsieur le ministre, je compte bien évidemment sur vous pour défendre au niveau européen les revendications des éleveurs de chevaux de trait, afin que ces derniers acquièrent un véritable statut dans l’espace agricole européen.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, auteur de la question n° 455, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le ministre, je tiens tout d’abord à exprimer mon vif regret quant à l’absence de Mme Pécresse, tant ce sujet requiert, à mon sens, toute son attention.
Je souhaite en effet l’alerter sur le manque de moyens alloués à l’université Paris X-Nanterre, lequel, de surcroît, fait peser une incertitude sur l’ouverture de l’institut universitaire de technologie de Gennevilliers, prévue pour la rentrée prochaine.
Pour 2009, la dotation globale de fonctionnement de cette université est certes en augmentation de 7, 5 % par rapport à 2008. Cette hausse atteint 11, 3 % si on y inclut les moyens alloués à la mise en sécurité et à l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées, rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005. Le décret du 18 mai 2006 fixe d’ailleurs au 31 décembre 2010 le délai limite pour rendre accessibles au public des parties ouvertes des établissements d’enseignement supérieur appartenant à l’État.
Ces chiffres nous placent cependant en deçà des 15 % de hausse annoncés en décembre dernier par Mme la ministre. De plus, sur les 7, 5 % d’augmentation de la dotation globale de fonctionnement, 6, 2 % – soit, tout de même, la quasi-totalité – avaient déjà été annoncés au titre du plan 2008-2012 « Réussir en licence », censé permettre aux universités de mettre en place des mesures nouvelles pour favoriser la réussite des étudiants.
Cerise sur le gâteau, l’augmentation restante de 1, 3 % est conditionnée à la suppression définitive de huit postes en 2009. Ces suppressions de poste devront se poursuivre en 2010 et en 2011, selon un calendrier fixé par le ministère. Ces éléments permettent donc de tempérer fortement l’optimisme ministériel !
Une telle situation inquiète très fortement non seulement les personnels de l’université, mais aussi les élus locaux, qui se demandent comment l’université pourra maintenir ses activités actuelles, développer de nouveaux projets, comme l’y incite la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, et, enfin, assurer aux élèves les moyens garantissant leur réussite, notamment en licence.
Comment l’université pourra-t-elle en effet mener à bien toutes ces missions si plus de 80 % des moyens alloués sont destinés au seul plan « Réussir en licence » ?
Cette situation fait également naître une grande inquiétude sur l’ouverture de l’IUT de Gennevilliers, qui sera rattaché à l’université Paris X-Nanterre. En effet, à ce jour, l’université ne bénéficie pas de dotations spécifiques, en crédits ou en personnels, pour cet IUT, alors qu’elle sera cependant chargée de financer les personnels non enseignants de cette structure.
Ma question est donc simple : l’État compte-t-il prendre ses responsabilités et garantir un financement permettant à ce pôle universitaire d’ouvrir ses portes dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine ?
Madame la sénatrice, en l’absence de Mme Pécresse, retenue ce matin par un autre engagement et dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence, c’est le ministre de l’agriculture qui aura l’honneur de répondre à votre question. Sachez que, à titre personnel, je m’intéresse tout particulièrement à l’avenir des universités françaises et de la recherche.
Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche aurait souhaité vous rappeler elle-même tout l’engagement de l’État en faveur de l’université Paris X et, par là même, actualiser ou préciser, pour la bonne information de la Haute Assemblée, les chiffres ou les données dont vous disposez.
En effet, à l’instar de toutes les universités françaises, l’université de Nanterre dispose en 2009 de moyens inédits. Ses crédits de fonctionnement augmentent de 2 millions d’euros, soit, comme vous l’avez vous-même rappelé, madame la sénatrice, de 7, 5 %. Cette hausse, égale à dix-neuf fois l’inflation, est trois fois supérieure à celle de 2008 et seize fois supérieure à celle de 2007. Dans le contexte actuel, peu de secteurs peuvent se prévaloir de telles augmentations.
Il faut y ajouter 2 millions d’euros pour la mise en sécurité de la bibliothèque universitaire et des amphithéâtres de cet établissement, au lieu de 300 000 euros l’année dernière.
Au total, l’ensemble de ses moyens s’accroîtront de 14 %, ce qui représente une augmentation inédite pour cette université qui, par ailleurs, disposera encore de moyens supplémentaires aux termes du contrat qu’elle négocie cette année.
Vous avez également évoqué les emplois de cette université, madame la sénatrice : cet établissement a effectivement restitué huit postes cette année, ce qui représente le non-renouvellement de 0, 5 % de ses effectifs. Ces emplois vont, pour six d’entre eux, être redéployés vers des universités ayant vu leurs effectifs d’étudiants augmenter fortement ces dernières années, ce qui n’est pas le cas de Paris X. Ces non-renouvellements sont par ailleurs accompagnés financièrement, le ministère de l’enseignement supérieur ayant donné à l’université les moyens de requalifier certains de ses emplois.
Pour l’avenir, plusieurs éléments devraient vous rassurer.
Tout d’abord, le Premier ministre a annoncé qu’en 2010 et en 2011 les universités verront les suppressions d’emplois gelées.
Par ailleurs, et c’est un point auquel vous serez sensible, l’institut universitaire de Gennevilliers ouvrira en septembre 2010. Je sais que vous portez la plus grande attention aux conditions d’ouverture de cet IUT. Naturellement, dès la prochaine rentrée, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche mettra à disposition de cette nouvelle structure les moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement.
Soyez donc assurée, madame la sénatrice, que l’université de Nanterre bénéficie, comme l’ensemble des universités, des moyens destinés à faire émerger des universités autonomes et puissantes, à renforcer l’attractivité des carrières, à mettre la réussite des étudiants au premier plan et, enfin, à créer les campus de demain.

Je vous ai écouté avec attention, monsieur le ministre, mais le Gouvernement est coutumier des effets d’annonce. Ma question portait principalement sur les personnels non enseignants de l’université pour lesquels, à ma connaissance, les crédits alloués sont insuffisants.
J’insiste sur l’importance de la création de l’IUT de Gennevilliers pour l’offre universitaire globale dans le nord des Hauts-de-Seine. Cet institut répond à un véritable besoin de formation, notamment dans les domaines de la gestion administrative et commerciale et des carrières sociales. C’est peu de dire que les candidatures se bousculent aux portes de cet établissement qui, à terme, pourrait accueillir 900 étudiants. La commune de Gennevilliers a déjà investi 5 millions d’euros, et le conseil général des Hauts-de-Seine pas moins de 38 millions d’euros ; nous serons donc particulièrement vigilants sur les conditions d’ouverture de ce site.

La parole est à M. Michel Boutant, auteur de la question n° 470, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Je souhaite attirer votre attention, monsieur le secrétaire d’État, ainsi que celle de votre ministre de tutelle, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, sur les difficultés financières que rencontre depuis plusieurs mois l’hôpital de Cognac.
Ma collègue député Marie-Line Reynaud a déjà alerté Mme Bachelot-Narquin à ce sujet voilà quelques semaines, mais la situation ne s’est guère arrangée depuis, ce qui m’amène à poser à mon tour une question.
C’est tout d’abord la réalisation des nouveaux locaux de l’hôpital, pourtant prévue de longue date, qui est menacée. Ceux-ci devaient voir le jour à côté de la clinique privée dès 2005, afin de constituer un grand pôle de santé, mais les études géologiques ont mis en évidence dans le sous-sol la présence de failles extrêmement importantes, qui renchérissent le montant des travaux de plus de 2 millions d’euros. Le directeur de l’hôpital a dû interrompre les travaux dans l’attente de nouvelles sources de financement. Le chantier est stoppé depuis six mois, ce qui place les entreprises attributaires du marché de construction dans une grande difficulté, à un moment où la situation générale de notre pays est préoccupante, notamment pour les entreprises du secteur du BTP.
Devant l’incapacité de l’État à mobiliser les ressources nécessaires au financement de ces travaux, les collectivités locales vont devoir se mobiliser, et la communauté de communes de Cognac, accompagnée le cas échéant des communautés de communes de Jarnac, de Grande-Champagne et du Rouillacais, devrait apporter une participation au financement des travaux. Ce sera un signal très fort envoyé à l’État, qui aurait dû apporter les financements nécessaires depuis déjà quatre ans ! Malheureusement, ce geste ne suffira ni à combler le surcoût de la construction dû aux failles ni à résorber le déficit chronique de l’hôpital de Cognac.
Je me permets de vous rappeler brièvement les faits, monsieur le secrétaire d’État : le 27 juillet 2001, le conseil d’administration du centre hospitalier de Cognac, présidé par l’ancien maire de la ville, a décidé la fermeture du service de chirurgie et la cession de cette activité à une clinique privée, sur proposition de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes. Cette décision, à laquelle s’ajoutent les nouvelles règles de financement des hôpitaux, en particulier la tarification à l’acte, a abouti à un déficit considérable des comptes de l’hôpital, soit 1, 2 million d’euros en 2008.
L’aide exceptionnelle de 545 000 euros attribuée par l’Agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes n’a permis que de diminuer le déficit, et non de le résorber. Surtout, elle ne résout pas le problème d’un déficit devenu chronique, lequel fait peser des menaces sérieuses sur le maintien de plusieurs services, dont la maternité, pourtant labellisée « amie des bébés », et le service de réanimation.
Chacun redoute aujourd’hui que les 80 000 usagers potentiels de l’ouest de la Charente et de l’est de la Charente-Maritime qui souhaitent avoir recours à l’hôpital public n’aient bientôt d’autre choix que d’aller se faire soigner dans les hôpitaux d’Angoulême, de Bordeaux ou de Poitiers, situés à plusieurs dizaines de kilomètres.
Devant l’évidente nécessité d’une intervention financière de l’État, tant pour trouver une solution au déficit chronique que pour permettre le redémarrage des travaux de construction du nouvel hôpital, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement entend effectivement mettre en œuvre cette double intervention et, si oui, dans quels délais.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu interroger Roselyne Bachelot-Narquin sur la situation de l’hôpital de Cognac. Cet établissement rencontre en effet des difficultés de deux ordres : d’une part un déséquilibre financier, d’autre part des incertitudes liées à la construction du nouvel hôpital.
Le centre hospitalier de Cognac fait l’objet de toute l’attention de Mme Bachelot-Narquin, qui s’est appliquée à permettre l’achèvement des travaux pour rendre possible la constitution du grand pôle de santé, améliorer la situation financière et, ainsi, garantir la proximité des activités de l’hôpital.
L’exercice 2008 fait apparaître un déficit de 1 million d’euros. Eu égard à ces difficultés, l’Agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes a attribué une aide exceptionnelle de 545 000 euros, laquelle a permis de réduire de moitié le déficit de l’établissement.
Afin de rétablir durablement la situation, la direction du centre hospitalier de Cognac a travaillé à des mesures de réorganisation dont l’ambition est de garantir la pérennité des activités actuelles.
Les orientations suivantes ont été arrêtées : une économie sur le coût des travaux de 2, 4 millions d’euros, rendue possible par la suppression d’un demi-étage et l’abandon de la construction de l’unité de restauration, sans incidence sur le projet médical de l’établissement ; une réorganisation plus pertinente des locaux ; la concession de la restauration à la commune, qui a la capacité d’absorber ce surcoût ; enfin, un engagement de la communauté de communes à apporter un fonds de concours de 240 000 euros.
Parallèlement, une renégociation du contrat de retour à l’équilibre est en cours, qui vise à intégrer une organisation du bloc opératoire sur trois jours au lieu de cinq, avec maintien d’une astreinte pour les césariennes. Cette nouvelle organisation, cohérente avec le niveau d’activité du bloc opératoire, permettra de dégager une économie de 250 000 euros par an.
Par ailleurs, un audit sur l’organisation et le temps de travail vient d’être lancé. Il permettra, grâce à un examen analytique des charges, d’identifier les voies d’optimisation et d’efficience.
Au total, l’objectif est un retour à l’équilibre en 2010, avec un déficit prévisionnel ramené en 2009 à environ 400 000 euros.
L’ensemble de ces mesures permettront de réduire le niveau d’endettement de l’hôpital sans remettre en cause le projet médical de l’établissement. En particulier, le maintien de la maternité fait pleinement partie de ce projet.
Vous le voyez, Roselyne Bachelot-Narquin a engagé les mesures nécessaires pour mener les travaux à leur terme, réduire le déficit du centre hospitalier de Cognac et assurer la pérennité de l’offre de soins pour la population.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Cette dernière manque toutefois de précision s’agissant des 2 millions d’euros de surcoût liés à la configuration du sous-sol au-dessus duquel l’hôpital doit être édifié. Si, localement, les communautés de communes sont en train de s’engager financièrement, la question de la contribution de l’État reste posée.
Pour ce qui est du fonctionnement futur de l’hôpital, j’ai pris bonne note, monsieur le secrétaire d’État, des décisions que vous avez annoncées quant à la restauration et à la maternité. Il subsiste néanmoins un point d’interrogation sur la réanimation.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 463, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Monsieur le secrétaire d’État, la problématique de l’accès aux soins pour les patients préoccupe les élus, les professionnels de la santé et les citoyens de la Dordogne, département essentiellement rural – le troisième par sa superficie sur le territoire hexagonal – qui ne compte que quarante-trois habitants au kilomètre carré.
Or, comme vous le savez, les médecins généralistes, qui constituent un rouage essentiel de notre système de santé en milieu rural, éprouvent aujourd’hui un malaise grandissant.
C’est dans ce contexte que l’État a décidé de procéder à une coupe claire dans les secteurs de garde : alors que la Dordogne en compte aujourd’hui quarante-six, il n’en resterait que dix-huit à partir du mois d’avril 2009 !
Cela obligera les patients à recourir de manière croissante aux secours d’urgence, avec tous les inconvénients que cela implique dans les zones éloignées des centres urbains. Cela aura aussi pour conséquence de rendre le fonctionnement de ces secours encore plus difficile qu’il ne l’est déjà.
On ajoute ainsi un problème au problème : en réduisant le nombre de secteurs de garde, on rend l’accès aux soins plus difficile pour les patients et on complique le fonctionnement des secours d’urgence, alors même que l’on constate d’ores et déjà des cas de démission de médecins généralistes dans les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.
Aujourd’hui, 408 généralistes sur 426 participent aux permanences de soins. Réduire le nombre de secteurs de garde diminuerait donc, c’est vrai, le nombre de gardes à effectuer pour les médecins. Mais, contrairement à ce qui peut se passer en milieu urbain, cette réduction mettrait ces derniers, en milieu rural, dans des situations très compliquées en cas d’urgences simultanées sur le même secteur.
De surcroît, 12 % de ces généralistes ont soixante ans, voire davantage. Il faut donc encourager les vocations : si cela passe effectivement par l’amélioration des conditions de travail des médecins, cela ne doit pas se faire au détriment des patients périgourdins. Nos citoyens ne doivent en aucun cas être la variable d’ajustement des politiques de santé inadaptées qui sont menées en France !
Le projet de réforme n’apporte malheureusement pas de réponses satisfaisantes à cette situation. Au contraire, il privilégie encore une fois la rentabilité plutôt que la solidarité.
Lorsque la présence d’un service public important comme celui de la santé est menacée, cela a des conséquences graves pour les territoires en termes d’attractivité et de maintien de la population.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles mesures comptez-vous prendre pour inciter réellement les médecins généralistes à continuer à travailler dans des zones rurales, autrement qu’en leur promettant moins d’heures de garde ?
Comptez-vous développer véritablement les maisons de santé dans lesquelles des médecins généralistes, ainsi que d’autres professionnels de la santé, pourraient s’installer ? Surtout, de quels moyens dispose l’État pour les mettre en place, sans chercher une nouvelle fois à se décharger sur le dos des collectivités territoriales ?
En Dordogne, vous le savez, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans représentent 25 % de la population totale et plus du tiers dans les communes les plus rurales, soit quinze points de plus que la moyenne nationale. Notre département a donc besoin de tous ses médecins. J’espère par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, que votre volonté de rationaliser l’accès aux soins ne transformera pas la Dordogne en un désert médical.
Monsieur le sénateur, la situation de la démographie médicale en Dordogne vous préoccupe et vous souhaitez savoir quelles mesures seront mises en œuvre pour améliorer l’accès aux soins dans ce département.
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, a parfaitement conscience du fait que la plupart des départements, notamment celui de la Dordogne, seront prochainement confrontés à une baisse du nombre de médecins installés. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, elle agit pour améliorer sur l’ensemble du territoire l’organisation de l’offre de soins de premier recours, notamment la permanence des soins.
Ainsi, à l’avenant 27 de la convention médicale, il est proposé aux préfets et aux comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires d’améliorer l’organisation de la permanence des soins en généralisant la régulation médicale, en créant des maisons médicales de garde et en limitant le nombre de secteurs de permanence sur l’ensemble du territoire.
Pour accompagner les acteurs départementaux dans cet exercice, Roselyne Bachelot-Narquin a créé une mission nationale d’appui à cette réorganisation. La Dordogne a été entendue, et la mission d’appui a formulé un avis afin d’optimiser le dispositif de permanence des soins et de garantir un égal accès aux soins à la population.
Sur les 426 généralistes en activité que compte la Dordogne, 408 d’entre eux participent à la permanence des soins, dont 12 % ont plus de soixante ans. Il est donc indispensable que ce département réduise rapidement le nombre de ses secteurs de garde, comme le font la plupart des autres départements, afin d’améliorer la garantie d’accès aux soins de nos concitoyens.
La mission d’appui a aussi encouragé ce département à mettre en œuvre rapidement les projets de maison médicale de garde afin de rassembler les différents acteurs de la permanence des soins.
Je tiens à rappeler l’ambition première du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires », qui consiste justement, comme vous le souhaitez, monsieur le sénateur, à garantir à tous nos concitoyens, où qu’ils se trouvent sur le territoire, un égal accès aux soins, tout en consolidant le modèle libéral sur lequel est fondé notre système de santé.
Ce projet de loi comporte une série de mesures opérationnelles telles que le développement rapide de la filière universitaire de médecine générale, la définition du nombre de médecins à former dans chaque région pour chacune des spécialités, la création des bourses garantissant la présence de médecins dans les zones les plus en difficulté, la généralisation des coopérations entre professionnels de santé, le développement des maisons et des pôles de santé, la définition de schéma régional d’organisation sanitaire pour le secteur ambulatoire, et, enfin, l’assouplissement des modalités d’organisation et de financement de la permanence des soins.
L’organisation et le financement de la permanence des soins étaient placés auparavant sous la responsabilité de multiples acteurs : le préfet de département, l’assurance maladie, le conseil départemental de l’ordre des médecins, la mission régionale de santé.
Désormais, la permanence des soins sera entièrement confiée à l’agence régionale de santé. Cette dernière disposera d’une marge de manœuvre lui permettant d’adapter la rémunération des professionnels de santé en fonction de l’organisation retenue et de la charge de travail que la garde représente. Une complémentarité pourra être recherchée avec les établissements de santé, notamment en nuit profonde.
Par ailleurs, l’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels en lien avec les centres « 15 » entrera dans le champ couvert par le régime de responsabilité administrative s’appliquant aux agents de l’établissement.
Je suis certain, monsieur le sénateur, que ces mesures seront encore enrichies des réflexions de la Haute Assemblée et que le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » fournira un cadre modernisé pour les professionnels de santé en améliorant l’accès de nos concitoyens à des soins de qualité.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, mais, si vous me permettez cette remarque aux connotations sportives, je trouve que vous bottez quelque peu en touche !
Sourires

La Dordogne, qui compte actuellement 48 points de garde, verra ce chiffre passer à 18. Cela ne soulèvera pas trop de difficultés en milieu urbain, notamment dans les trois villes-centres que compte le département ; il n’en sera en revanche pas de même en milieu rural ! Ainsi, dans le nord du département, on ne comptera plus qu’un seul secteur de garde, contre 8 ou 9 actuellement. Ma collègue députée Colette Langlade a déjà interrogé le Gouvernement à ce sujet. Concrètement, il faudra désormais, pour rejoindre un secteur de garde, parcourir de trente à quarante kilomètres sur des routes certes agréables d’un point de vue touristique, mais difficiles, ce qui n’ira pas sans soulever des problèmes, surtout en nuit profonde.
Je souhaiterais donc que Mme la préfète révise sa copie et fasse passer le nombre de points de garde de 18 à 30, par exemple, afin que le milieu rural soit mieux pris en compte.
Par ailleurs, vous décrivez le dispositif médical. Mais quel est l’engagement de l’État en la matière ? Aujourd’hui, nous n’avons pas véritablement de réponse.
Enfin, je peux vous assurer que les membres de la Haute Assemblée, sur quelque travée qu’ils siègent, s’attacheront à améliorer le projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires », que nous examinerons au cours du mois de mai et qui revêt une grande importance non seulement pour les patients, mais également pour l’attractivité des territoires. La disparition des cabinets médicaux et des écoles conduirait en effet à une désertification totale de nos territoires et à la fin de l’attractivité de ces derniers. Or les 400 000 habitants de la Dordogne tiennent à vivre et à travailler au pays.

Tandis que la France rurale voit ses médecins disparaître, un numerus clausus est imposé à Grasse et à Marseille aux étudiants en médecine, compte tenu du nombre important de médecins en provenance d’autres régions… Nous ne doutons pas que Mme Bachelot-Narquin saura réparer au plus vite cette injustice.
J’en profite d’ailleurs pour saluer le conseil municipal de Grasse et son sénateur-maire, présents dans les tribunes.

La parole est à M. René Teulade, auteur de la question n° 469, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Dans la continuité de la question précédente, je souhaite attirer l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur un projet qui nous concerne tous, celui de la suppression de 44 tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui fait d’ailleurs suite à d’autres suppressions. Cette mesure touche des populations particulièrement fragiles, celles et ceux que nous appelons « les accidentés de la vie », et je ne doute pas, monsieur le secrétaire d'État, que vous serez très sensible à cette question.
Dans une circulaire datée du 9 janvier dernier, M. le ministre des affaires sociales et Mme le garde des sceaux préconisent le regroupement des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui traitent moins de 550 dossiers par an. Autant nous admettons que des adaptations sont nécessaires, autant nous considérons, à l’instar de nombreuses associations, que la réforme des tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peut être engagée sur le fondement de ce seul critère.
Après la réforme de la carte judiciaire, qui a entraîné la fermeture, sans aucune concertation, de certains tribunaux d’instance et de grande instance, voilà que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont victimes de la révision générale des politiques publiques.
Pour le département de la Corrèze, par exemple, le Gouvernement préconise la suppression du tribunal de Tulle pour transférer son activité à Limoges, chef-lieu de région. En se fondant sur le seul nombre des affaires traitées, le Gouvernement fait preuve d’une absence totale de vision en matière d’aménagement du territoire.
De plus, pour rendre une justice de qualité, les magistrats n’ont pas besoin de traiter des affaires en nombre.
Monsieur le secrétaire d'État, vous n’ignorez pas que les justiciables ayant recours aux tribunaux des affaires de sécurité sociale sont souvent des victimes d’un accident du travail ou des personnes handicapées en conflit avec les organismes sociaux. Le regroupement des tribunaux éloignera encore une fois la justice des justiciables. Si votre projet est mené à terme, un requérant pourra mettre plus de deux heures trente pour se rendre devant la juridiction !
Déjà, les délais de traitement de certains dossiers peuvent atteindre parfois deux ans, voire plus. Qu’en sera-t-il lorsque les tribunaux seront regroupés ? De plus, que vont devenir les personnels des tribunaux actuels, dans une période ô combien difficile ! où nous devons tous nous montrer solidaires ?
Dans la circulaire précitée, il est demandé aux préfets de région et aux présidents de cour d’appel de faire connaître leurs observations avant le 28 février. Ce délai a été prorogé jusqu’au 3 avril. Dans beaucoup de régions, les associations de justiciables devraient participer aux concertations. C’est une bonne chose.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser quelles sont les intentions du Gouvernement en matière de refonte de l’organisation des tribunaux des affaires de sécurité sociale ? Nous souhaitons que celui-ci prenne en compte l’intérêt des justiciables et qu’il écoute avec la plus grande attention l’avis des associations qui les représentent. Ces dernières nous ont fait part de leur inquiétude, qui est également la nôtre et celle de tous ceux qui connaissent la vulnérabilité de ces personnes envers lesquelles la solidarité nationale doit plus particulièrement s’exercer.
Monsieur le sénateur, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, ou TASS, actuellement au nombre de 115, sont chargés de régler les litiges d’application de la législation de la sécurité sociale. Chacun de ces TASS est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté de deux assesseurs élus et d’un secrétariat composé d’agents administratifs. Les TASS constituent à ce titre une juridiction sociale.
Afin d’obtenir une meilleure affectation des moyens de la justice et d’améliorer la qualité du service public rendu aux justiciables, un avant-projet de réforme, élaboré conjointement par les ministères de la justice, du travail et de l’agriculture à partir du mois d’octobre 2008, envisage de rassembler, au sein de TASS de taille plus importante, ceux qui sont saisis de moins de 550 requêtes nouvelles en moyenne annuelle. L’activité de ces TASS, dont le nombre est actuellement estimé à 44, représente 12 % de l’activité globale de cette juridiction.
Ce regroupement ne serait envisagé qu’au moment où, grâce à la récente simplification des procédures administratives, la diminution du nombre de requêtes émanant d’institutions publiques réduirait sensiblement la charge de travail des TASS, avec un effet positif sur les délais de jugement.
Concernant les personnels, l’avant-projet prévoit que les agents des administrations sociales qui assurent en partie le secrétariat des TASS et qui pourraient être concernés par cette réorganisation seraient affectés aux directions régionales ou départementales du secteur social, sans mobilité géographique obligatoire.
Afin de vérifier l’adéquation des propositions envisagées au regard des réalités locales, notamment en matière d’accessibilité pour les justiciables, cet avant-projet fait actuellement l’objet d’une large consultation locale, menée par les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel, d’une part, et par les préfets de région, d’autre part.
Dans le même esprit, la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés a été reçue le 27 février dernier par les directions des ministères concernés.
Afin que la consultation soit la plus large et la plus complète possible, il a été décidé de prolonger la période de concertation jusqu’au 3 avril prochain. À cette fin, il a notamment été demandé aux préfets de région de porter une attention spécifique à la consultation des parlementaires et des élus locaux.
Rien n’a donc été décidé, car le Gouvernement souhaite que la concertation soit approfondie. C’est en fonction des résultats de cette dernière que la décision sera prise de conduire la réforme envisagée ou d’échafauder de nouvelles hypothèses.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous sais gré de m’avoir confirmé que les organisations représentant en particulier les accidentés de la vie, personnes particulièrement vulnérables, seront consultées. Vous nous dites que le débat aura lieu. Je n’ai aucune raison d’en douter, mais je demande simplement qu’il se poursuive. Je souhaite surtout que le critère de l’accès aux tribunaux soit davantage pris en considération, et que l’on ne se limite pas à apprécier uniquement le nombre d’affaires traitées, même s’il ne peut être totalement ignoré.
Il conviendrait aussi que des précisions soient apportées sur la réforme de la carte judiciaire.
En particulier, on annonce la création de cités judiciaires : quand et comment ces cités fonctionneront-elles ? Quelles juridictions regrouperont-elles ?
J’insiste à nouveau sur le fait que, pour les personnes à mobilité réduite de mon département, notamment celles qui doivent utiliser des véhicules spécialisés pour se déplacer, l’aller-retour à Limoges peut prendre jusqu’à cinq heures et donc relever de la quasi-impossibilité. Or, dans ces affaires de sécurité sociale, la procédure est orale et il est indispensable que le requérant puisse se faire entendre.
Nous sommes donc très attachés à ce que la consultation se poursuive.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 445, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question a également trait aux personnes vulnérables, et cela au premier degré puisqu’elle porte sur le respect des engagements de l’État quant à l’intégration dans la vie scolaire des enfants ayant besoin d’un accompagnement.
Je souhaite ainsi attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la situation des nombreux AVS, les auxiliaires de vie scolaire, recrutés en contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Du fait des rigidités de ce type de contrat, il est en effet impossible de prolonger l’activité des AVS auprès des enfants qu’ils accompagnent, même lorsque ces professionnels ont donné satisfaction et que le terme de leur contrat intervient au cours de l’année scolaire.
Or les équipes pédagogiques constatent que l’accompagnement par une même personne tout au long de l’année favorise, au-delà des rapports affectifs qui se nouent, l’insertion et la participation dans la classe de l’élève. Aussi, tous plaident, dans l’intérêt des enfants, en faveur de la continuité de l’accompagnement.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, dont j’ai été le rapporteur, prévoit la mise en place au 1er janvier 2010 d’un contrat unique d’insertion, en remplacement des différents contrats aidés. Le régime juridique sera plus souple, en particulier s’agissant de la durée, de la prolongation ou du renouvellement.
Les difficultés rencontrées par les établissements scolaires pour recruter des AVS et les inconvénients qui en résultent pour les enfants concernés justifieraient, me semble-t-il, que, par exception, cette disposition s’applique dès la rentrée de 2009 aux AVS embauchés en contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Je remercie le ministre de l’éducation nationale de l’intérêt qu’il voudra bien porter à cette question dont le but est tant de permettre à des enfants déjà très éprouvés par la maladie ou le handicap de continuer à apprendre et à évoluer dans un environnement stable que d’apporter aux personnels la reconnaissance de leur travail.
Madame la sénatrice, le Gouvernement partage avec vous l’ambition de la qualité du service rendu aux élèves et aux familles par les auxiliaires de vie scolaire.
C’est pourquoi le recrutement, l’accompagnement et la formation de ces personnels ont fait l’objet d’instructions précises prévoyant notamment la signature de conventions régionales tripartites avec le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et l’Agence nationale pour l’emploi.
Dans toute la mesure du possible, la durée de référence fixée des contrats doit couvrir l’année scolaire.
Le ministère de l’éducation nationale ne verrait pas d’obstacle à utiliser de manière plus précoce, ainsi que vous le suggérez, madame la sénatrice, le contrat unique d’insertion, pour autant que la loi le permette.
Le ministère de l’emploi et le haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse seront saisis pour examiner les différentes solutions envisageables à cette fin.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de cette réponse qui me paraît tout à fait adaptée à la question que j’ai posée.
J’espère donc que les conventions tripartites seront rapidement signées et que les différents ministères concernés pourront s’entendre afin que, dès la rentrée de 2009, les enfants puissent avoir l’assurance d’être accompagnés tout au long de leur année scolaire. Je crois d’ailleurs savoir que M. Hirsch est favorable à cette solution.

M. le président. Il s’agit là, monsieur le secrétaire d’État, de questions qui intéressent bien entendu tous les élus locaux, à Versailles comme à Marseille !
Sourires

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.