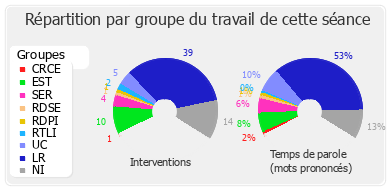Séance en hémicycle du 12 février 2015 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.
Huissiers, veuillez faire entrer M. le Premier président de la Cour des comptes.
M. le Premier président de la Cour des comptes est introduit dans l’hémicycle selon le cérémonial d’usage.

Monsieur le Premier président, c’est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans cet hémicycle pour la remise du rapport annuel de la Cour des comptes.
Le Sénat et la Cour des comptes entretiennent des liens anciens, étroits et notablement renforcés par la révision constitutionnelle de 2008 qui a développé le rôle de votre juridiction, notamment en matière d’assistance au Parlement.
Le Sénat lui-même avait souhaité, à cette occasion, introduire le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques. Aujourd’hui, nous nous félicitons tous, au sein de cette assemblée, de pouvoir bénéficier de votre expertise pour nos travaux de contrôle de l’action du Gouvernement, de l’exécution des lois de finances, de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l’évaluation des politiques publiques.
Monsieur le Premier président, je tiens tout d’abord à vous remercier personnellement pour votre présence et vos nombreuses interventions devant nos commissions par lesquelles vous et vos collègues venez régulièrement rendre compte des travaux de la Cour.
Je sais que vos anciennes fonctions, notamment celle de président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, vous rendent particulièrement sensible aux préoccupations du Parlement. Vous le démontrez à travers les rapports prévus par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, dont vous avez été – chacun le sait – l’instigateur avec notre ancien collègue Alain Lambert, et les nombreux rapports publics thématiques que la Cour produit chaque année.
Vous avez également à cœur de répondre aux nombreuses demandes d’assistance qui émanent notamment de notre commission des finances ou de notre commission des affaires sociales. Ces dernières ont ainsi pu bénéficier, cette année encore, de votre concours et de votre expertise pour l’exercice de leur fonction de contrôle – une fonction essentielle au Sénat, comme je le rappelais hier soir en conférence des présidents §Je pense, s’agissant de la commission des finances, aux rapports portant sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur les contrats de projet État-région ou sur l’Agence nationale de la rénovation urbaine ; concernant la commission des affaires sociales, je pense aux rapports portant sur les maternités, sur les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé ou sur l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La conférence des présidents a d’ailleurs décidé hier soir qu’un débat sur les maternités serait organisé en séance publique lors d’une prochaine semaine de contrôle.
Les observations, constats et préconisations qui émanent de vos travaux nous sont très utiles pour remplir notre rôle de parlementaire, pour mieux légiférer et mieux contrôler. L’examen minutieux des crédits et de la gestion des services publics auquel la Cour procède régulièrement, ainsi que le regard acéré qu’elle porte sur l’efficacité des politiques publiques et qui fait apparaître parfois un certain décalage entre les objectifs souhaités et les résultats obtenus, constituent une source d’informations précieuses tant pour le citoyen que pour les parlementaires chargés d’élaborer la loi.
Cette collaboration me semble aujourd’hui d’autant plus cruciale que la situation des finances publiques demeure préoccupante. Je suis convaincu que nous devons progresser vers une réduction des dépenses publiques – les comparaisons avec d’autres pays de la zone euro sont éloquentes – et, dans le même temps, engager les réformes structurelles vigoureuses devant permettre de créer la croissance dont notre pays a tant besoin.
Il n’est ni concevable ni souhaitable que le déficit public français reste durablement deux fois plus élevé que la moyenne de la zone euro, ce que j’évoquais jeudi dernier avec le président Juncker à Bruxelles. Par ses travaux, la Cour des comptes peut contribuer à cette ambition.
La remise du rapport annuel de la Cour est toujours attendue : bien sûr, pour son analyse de la situation générale des finances publiques et son éclairage sur l’action publique, mais également pour l’analyse des suites données par les administrations, collectivités et autres organismes publics contrôlés aux observations et recommandations formulées dans le passé. La représentation nationale est attentive aux suites et progrès qui résultent de vos travaux.
C’est donc avec intérêt et attention, monsieur le Premier président, que nous allons dès à présent vous écouter présenter le rapport annuel de la Cour des comptes, avant d’entendre Mme la présidente de la commission des finances et M. le président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le Premier président, vous avez la parole.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président, j’ai l’honneur de vous remettre le rapport public annuel de la Cour des comptes.
M. le Premier président remet à M. le président du Sénat le rapport annuel de la Cour des comptes.
Monsieur le président, je voudrais tout d’abord vous remercier de vos propos bienveillants à mon endroit et à celui de la Cour. C’est toujours avec grand plaisir que je me rends devant le Sénat pour rapporter les travaux qui sont les nôtres.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, même s’il ne s’agit plus de la seule publication de la Cour, le rapport public annuel reste la publication la plus emblématique de sa mission d’information des décideurs publics que vous êtes et des citoyens.
Les thématiques abordées dans plusieurs de ses chapitres traduisent le souci de couvrir des problématiques et des enjeux proches du quotidien de nos concitoyens : la qualité des services effectivement rendus, les performances réelles, mesurées à l’aune des objectifs des politiques publiques et de la dépense effectuée.
Mais avant d’évoquer les observations et recommandations du rapport public annuel 2015, je veux revenir rapidement sur la contribution des juridictions financières aux efforts de modernisation des services publics.
Profondément attachées au principe de séparation des pouvoirs, les juridictions financières sont au service de la République, dans le respect des textes fondamentaux qui régissent leur mission. Elles apportent une contribution indépendante, grâce à une programmation libre de leurs travaux et à la publicité donnée à leurs observations. Elles veulent, de manière constructive, répondre à vos demandes d’enquête et soutenir, dans leurs démarches, celles et ceux qui ont pour objectif d’améliorer l’action publique.
En 2014, la Cour des comptes a rendu publics soixante-trois travaux. Au-delà des six rapports annuels sur les finances publiques, elle a réalisé, en 2014, dix-sept enquêtes à la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat, et a été auditionnée une cinquantaine de fois. Cette mission d’assistance au Parlement, la Cour y est très attachée – vous l’avez rappelé, monsieur le président. Elle s’efforce d’être utile à la représentation nationale. Je vous ai également adressé vingt-cinq référés, qui ont été communiqués aux membres du Gouvernement, et cinq rapports particuliers concernant des entreprises publiques.
Les juridictions financières veillent à exercer leur mission avec un haut niveau d’exigence éthique et professionnelle. Comme le législateur l’avait demandé en votant, fin 2011, une disposition expresse en ce sens, j’ai arrêté en décembre dernier le recueil des normes que les équipes de contrôle doivent respecter, conformément aux règles nationales et internationales en vigueur. Ce recueil comporte en annexe notre charte de déontologie. Ces documents sont accessibles sur le site internet de la Cour et peuvent être consultés par tous : élus, agents publics, citoyens.
Les juridictions financières, si elles sont plus souvent conduites à souligner les dysfonctionnements, savent aussi reconnaître les efforts consentis pour améliorer l’action publique, de même que l’utilité de cette action publique. Le rapport met ainsi l’accent sur le suivi des recommandations et développe deux situations en progrès, grâce à des dispositions législatives récemment votées.
La Cour est, à ce titre, revenue sur la gestion des avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence et sur le recours au chômage partiel. Dans les deux cas, le législateur a largement repris à son compte les propositions formulées par la juridiction. La Cour continuera d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositifs, qui doivent être complétés au niveau réglementaire.
Ces propos préliminaires achevés, j’en viens aux messages portés cette année par le rapport de la Cour.
Premièrement, un décalage est trop souvent observé – vous avez dit « parfois », monsieur le président, nous nous permettons de dire « trop souvent »
Sourires.
Deuxièmement, certains services publics doivent être gérés avec un niveau d’exigence plus élevé.
Troisièmement, des marges d’économies et d’efficience existent et peuvent être mobilisées en faveur non seulement du redressement de nos comptes publics, mais aussi de politiques publiques mieux ciblées, plus adaptées aux besoins et aux attentes de la société.
Nous accumulons les déficits depuis près de quarante ans – depuis 1974 sans discontinuer, s’agissant du budget de l’État. Le chômage demeure à des niveaux inquiétants. La part de nos dépenses publiques dans le PIB est parmi les plus élevées sans que les résultats soient à la hauteur. Dans ce contexte, l’effort devrait être plus résolu en faveur d’une gestion plus rigoureuse des finances et des services publics, et davantage tourné vers la recherche d’efficacité.
Or, cette année encore, la Cour observe à de nombreuses reprises un décalage entre les engagements pris, les objectifs affichés, les moyens qui leur sont consacrés et les résultats obtenus. C’est le premier message de la Cour.
La confiance dont jouit notre pays dans les instances politiques, économiques et financières, aux niveaux européen et international, est étroitement liée à la crédibilité de sa politique budgétaire. L’actualité récente montre que les débats de politique économique sont nourris quant à l’approche à retenir, dans un contexte encore difficile et alors que les dettes publiques de plusieurs États européens, dont le nôtre, continuent de se creuser.
Bien sûr, le rôle de la Cour des comptes n’est pas de trancher ces débats ; il n’est pas de se substituer aux pouvoirs politiques dans la prise de décision qui leur appartient, les choix à retenir ou les engagements à prendre vis-à-vis de nos partenaires. En revanche, le rôle de la Cour est bien d’informer sur la situation et les perspectives des finances publiques, et sur le respect des engagements pris.
La Cour fonde ainsi son appréciation sur une réalité observable : les lois votées par les parlementaires, les hypothèses du Gouvernement, les résultats des lois de finances, ainsi que la statistique publique nationale et européenne. Comme chaque année, dans un chapitre de son rapport public annuel, la Cour livre à nos concitoyens et à vous-mêmes son regard sur la situation des finances publiques.
Deux grandes observations s’en dégagent cette année : d’une part, le mouvement de réduction des déficits s’est interrompu en 2014 ; d’autre part, la capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine en 2015.
Le chapitre consacré aux finances publiques met en évidence le dérapage des prévisions successives de déficit public pour 2013 et 2014. Le mois dernier, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour, j’ai salué l’opération « vérité » de septembre 2014, par laquelle le Gouvernement a – tardivement, selon nous – reconnu la réalité de l’ampleur des déficits.
Les résultats de 2014 devraient être meilleurs que la prévision de 4, 4 % inscrite dans la loi de finances de décembre 2014. Mais quand bien même ils se rapprocheraient de 4, 1 %, par exemple, cela resterait encore bien supérieur aux 3, 6 % prévus initialement. En tout état de cause, ces résultats ne marqueraient pas une amélioration par rapport à 2013 – le déficit fut alors de 4, 1 % –, au contraire de ce qui se passe dans pratiquement tous les autres pays de l’Union européenne dont le déficit dépasse 3 %.
Malgré un objectif de réduction du déficit limité par rapport à celui qui était prévu initialement en 2014, la capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine pour 2015. La Cour identifie en effet plusieurs risques, en dépenses comme en recettes, liés notamment aux perspectives de baisse de l’inflation.
Un premier risque pèse sur la réalisation des 21 milliards d’euros d’économies annoncées en avril 2014. Ces économies sont conçues, pour leur très grande part, je le rappelle, non pas comme une diminution de la dépense publique, mais comme un effort de ralentissement par rapport à son évolution tendancielle.
Un second risque pèse sur le montant des recettes fiscales attendues pour 2015. Le risque ne se situe pas, comme les autres années, sur la croissance ou les hypothèses d’élasticité des recettes fiscales, mais là encore sur l’inflation prévue. Les lois financières s’appuient sur une hypothèse de 0, 9 %, hypothèse largement supérieure aux dernières prévisions. La Commission européenne envisage même une inflation voisine de 0 % pour la France.
Les pouvoirs publics doivent se pencher sans tarder sur les enjeux que soulève la période actuelle de très faible inflation, à laquelle – il faut le reconnaître – nous n’étions pas habitués. Cette très faible inflation remet en cause les perspectives d’équilibre des finances publiques et le cadre budgétaire triennal sur lequel reposent notamment le budget de l’État et l’ONDAM, l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie.
Si les risques identifiés se concrétisent, le retour sous le seuil de 3 % du produit intérieur brut en 2017 serait probablement compromis. À cet horizon, la dette publique pourrait approcher, voire dépasser, 100 %, et l’équilibre structurel des comptes publics serait encore repoussé au-delà de 2019. Attention à ne pas se laisser abuser par le très faible niveau des taux d’intérêt auxquels l’État se finance actuellement : la dette supplémentaire que nous continuons d’accumuler va devoir être financée et refinancée pendant de nombreuses années. En tout état de cause, elle ne le sera sans doute pas éternellement aux taux exceptionnellement bas que nous connaissons aujourd’hui. Ces déficits et cette dette supplémentaire pèseront lourdement sur les générations futures et sur les marges de manœuvre des gouvernements dans l’avenir.
Nous sommes donc confrontés actuellement à une situation paradoxale : la dette augmente, mais sa charge diminue. Prenons garde : cela peut ne pas durer.
Le rééquilibrage durable de nos finances publiques dépend bien sûr des choix de politique économique susceptibles de renforcer le potentiel de croissance de l’économie. Il implique aussi de faire des choix clairs pour une organisation plus performante des services publics, ainsi qu’une meilleure répartition des compétences et des moyens.
L’ensemble de ces choix – j’ai déjà eu l’occasion de le souligner – ne s’imposent pas au nom d’une contrainte, subie ou importée ; ils s’imposent, si j’ose dire, de l’intérieur, si nous voulons préserver la souveraineté de notre pays, c’est-à-dire précisément sa capacité à faire des choix. Les politiques de rabot ne peuvent pas tenir lieu de stratégie de redressement des comptes publics ni surtout d’horizon pour les services publics de demain.
Dans le rapport public de cette année, la Cour s’interroge à plusieurs occasions sur la cohérence de l’action de tel ou tel organisme public avec les objectifs visés. Parfois même, elle met en doute la conduite de l’action publique, au regard des objectifs qu’elle est censée remplir. Ce sont en effet les résultats atteints par une politique publique qui garantissent sa crédibilité. Nos concitoyens exigent, à juste titre puisqu’ils y contribuent financièrement, que l’action publique débouche sur des résultats tangibles et concrets, dans leur vie de tous les jours. C’est encore loin d’être le cas, au regard des crédits consacrés.
De nombreux sujets de ce rapport touchent à la vie quotidienne des habitants, que ce soient les transports, l’eau, l’électricité, l’emploi, le sport ou la vie étudiante. Je ne les citerai évidemment pas tous, mais je veux évoquer devant vous les exemples les plus saisissants.
Prenons d’abord le cas des agences de l’eau. Principaux financeurs de la politique de l’eau en France, ces agences collectent des taxes, ou redevances, dans le respect théorique du principe « pollueur-payeur ». En réalité, ces redevances en sont largement déconnectées, et ceux qui polluent le plus ne sont pas ceux qui paient le plus.
Mon deuxième exemple porte sur le bilan de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence. Il est, dans les faits, contrasté, plusieurs dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont vous débattez en ce moment, allant dans le sens des préconisations de la Cour sur ce sujet.
La gestion des trains Intercités offre un exemple d’atermoiement entre volonté affichée de réforme et indécision persistante et préjudiciable au service public. La Cour appelle les pouvoirs publics à sortir de l’impasse, pour offrir à ces lignes un horizon pérenne.
Dans un contexte économique difficile, des signes de défiance à l’égard du secteur public sont perceptibles. C’est pourquoi, dans son deuxième message, la Cour veut insister sur l’impératif de rigueur et d’exigence qui s’impose aux agents et aux services publics.
La Cour a voulu rendre publics des cas et des situations qui appellent plus de rigueur et de retenue dans l’usage des deniers publics ou dans les comportements, sans préjudice des irrégularités qu’elle pourra constater et qui pourraient être sanctionnées par ailleurs.
Dans son rapport, la Cour évoque d’abord la mise en place dans le secteur public d’un dispositif importé du secteur privé, qui peut se justifier dans un secteur concurrentiel : l’attribution gratuite d’actions aux salariés de CDC Entreprises, filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et consignations.
C’est un cas de dérive choquant, …
… qui révèle plusieurs dysfonctionnements. Au regard du caractère tout à fait anormal de l’ensemble de cette situation, la Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie par le procureur général.
Par ailleurs, la Cour a procédé à un contrôle de suivi sur le Conseil économique, social et environnemental. Elle s’est à nouveau intéressée à la gestion budgétaire et comptable de l’institution, à sa gestion du personnel et au régime spécial de retraite des anciens conseillers.
L’exigence de rigueur concerne aussi les collectivités territoriales. Après examen de plusieurs contrats de partenariats signés par des collectivités territoriales depuis 2004, la Cour recense les conditions qui devraient à l’avenir être réunies si l’on veut recourir à ce mode dérogatoire de gestion des services publics.
La Cour s’est également penchée sur les compléments de rémunération dont bénéficient les fonctionnaires d’État outre-mer. Une réforme de ce système à bout de souffle est souhaitable.
Des marges importantes d’économies, d’efficacité et d’efficience existent, et doivent être davantage mobilisées : c’est le troisième et dernier message de la Cour.
Le maillage des services publics doit mieux répondre aux besoins et aux attentes. Ainsi, la révision du réseau et des missions des œuvres universitaires et scolaires apparaît indispensable, au regard à la fois de l’offre territoriale, des choix d’investissements, de la simplicité, de l’efficacité et du ciblage de son action.
Un service public de qualité passe parfois aussi par une refonte des cartes administratives. La gestion des services d’eau et d’assainissement l’illustre parfaitement. La France compte 31 000 services d’eau et d’assainissement, dont 22 000 gérés en régie. Symboles d’une gestion communale de proximité, près de 92 % des régies concernent un territoire de moins de 3 500 habitants. Dans ce cas comme dans d’autres, proximité ne rime pas nécessairement avec efficacité ou qualité de l’action publique. En l’espèce, trop de proximité peut même parfois tuer l’efficacité.
La conduite d’une réforme territoriale d’ampleur n’est pas une tâche impossible. L’État en a d’ailleurs fait la preuve en procédant à la refonte de la carte judiciaire. La Cour considère que cette réforme, même si elle n’a pas donné tous les résultats escomptés, est globalement positive.
En ce qui concerne en revanche le réseau des sous-préfectures, le ministère de l’intérieur se positionne entre le statu quo et l’expérimentation. Or les services publics de demain doivent être orientés vers les besoins de demain, qui ne coïncident pas forcément avec le maillage administratif du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Une refonte expérimentale de la carte des arrondissements d’Alsace et de Moselle vient d’entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Le ministre de l’intérieur a annoncé la poursuite de l’expérimentation dans cinq régions. La Cour y sera attentive.
Les recommandations de la Cour portant sur le maillage territorial des services publics ont aussi pour objectif une réduction des inégalités d’accès, lorsque la répartition des moyens et des infrastructures n’est pas assez liée aux besoins. Le chapitre du rapport sur la prise en charge des soins palliatifs, toujours très incomplète et caractérisée par de fortes inégalités territoriales, en offre une illustration.
Dans des travaux récents portant notamment sur les finances locales ou sur la grande vitesse ferroviaire, la Cour a eu l’occasion d’appeler les pouvoirs publics à adopter une attitude plus réaliste et plus rationnelle, y compris en ce qui concerne les investissements publics.
Le rapport public annuel 2015 met en évidence de nouvelles situations où les décisions d’investissement ne sont pas satisfaisantes du point de vue de la gestion publique. Tous ces exemples rappellent qu’un investissement n’est pas vertueux par principe : il est vertueux s’il est produit avec le souci de l’utilité, de l’efficacité et de l’efficience, s’il améliore réellement le service rendu et si les dépenses de fonctionnement qu’il entraîne ont été correctement anticipées.
La refonte du circuit de paie des agents de l’État offre un contre-exemple calamiteux d’investissement. Entre 2008 et 2013, 346 millions d’euros ont été dépensés au titre de ce programme, pratiquement en pure perte. Cet échec n’est pas rassurant, au regard des enjeux soulevés par la modernisation des processus de paie. La Cour s’inquiète d’ailleurs des difficultés récurrentes que rencontrent les grands projets informatiques menés par l’État.
Ce qui est vrai pour l’action de l’État l’est également pour l’action locale. Je cite fréquemment le cas des deux gares construites à quelques dizaines de kilomètres d’écart sur la LGV Est – TGV Lorraine et Meuse-TGV – sans interconnexion avec le réseau de transport régional.
Le cas des aéroports de Dole et de Dijon, distants de moins de cinquante kilomètres à peine, est à bien des égards comparable. Leur bilan financier est choquant, ce qui amène la Cour à recommander la fin du soutien public aux deux équipements.
Sans pour autant être placées au même niveau que les investissements que je viens de mentionner, d’autres situations appellent la vigilance des pouvoirs publics. Par exemple, alors que les contraintes budgétaires s’accentuent chaque année davantage, les offres proposées en matière de transports publics urbains de voyageurs continuent de s’étoffer, sans toujours la coordination ni la mutualisation des efforts nécessaires.
Un autre exemple est fourni par des stations de ski des Pyrénées. Il est souhaitable que les collectivités territoriales acceptent de restructurer les stations et de repenser, dans un certain nombre de situations, leur modèle économique.
En conclusion, comme elle l’a toujours fait, la Cour appelle les pouvoirs publics à s’engager résolument en faveur du redressement des comptes publics et d’une action publique plus exigeante, plus rigoureuse, mais surtout plus efficace et plus efficiente.
C’est possible ; c’est même, selon nous, nécessaire. Nous essayons de le démontrer : des marges de manœuvre existent. Des réformes sont attendues par nos concitoyens, qui savent pertinemment que la qualité des services publics ne se confond pas toujours avec l’augmentation de la dépense publique.
Je veux rappeler en ce lieu l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, » – vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs – « la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi […] ». Le consentement à l’impôt est le fondement de notre démocratie. C’est à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il appartient de convaincre nos concitoyens de la nécessité de consentir à l’impôt.
Pour cela, nulle meilleure méthode que d’arrêter des priorités, de prendre les décisions qui en découlent et de veiller à la mise en œuvre effective de ces décisions, alors que, trop souvent, une fois la loi votée ou la décision prise, le regard peut se détourner de l’évaluation effective du résultat. Je reconnais néanmoins qu’il existe au Sénat une culture de contrôle et d’évaluation plus ancienne qu’ailleurs.
Chacun, dans le rôle qui est le sien, peut contribuer aux réformes qui s’imposent. Par son rapport public annuel et, plus généralement, par ses travaux, la Cour s’efforce pour sa part de contribuer à ce qu’une attention plus grande soit portée aux résultats. Veiller à l’article XIV de notre Déclaration de 1789, c’est accorder, à l’avenir, plus d’importance à la performance, à l’efficacité réelle de l’action publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE, de l’UDI-UC et de l’UMP.)

Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.
La parole est à Mme la présidente de la commission des finances.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, une fois par an, le contrôle des finances publiques fait la une de toute la presse écrite et audiovisuelle. Ce grand moment d’exposition médiatique, c’est le dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.
Que nous enseigne l’intérêt suscité par cette publication ?
Il montre d’abord que la Cour des comptes atteint le but qui lui est assigné par l’article 47-2 de la Constitution : « Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens ».
J’y vois ensuite une invitation pour nous, parlementaires, et en particulier pour les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, à ne pas relâcher nos efforts en matière de contrôle de l’action du Gouvernement. Nos concitoyens nous attendent sur ce terrain.
Le contrôle tel qu’il est effectué par la Cour des comptes n’a pas la même finalité que le contrôle parlementaire. L’un contrôle le bon emploi de l’argent public ou l’efficience des politiques publiques. Nous évaluons quant à nous la pertinence des choix politiques.
Nos travaux sont donc complémentaires et souvent convergents. L’insertion dans le rapport public annuel consacrée à l’opérateur national de paye fait écho aux auditions sur ce thème que notre commission a organisées en mai dernier. Philippe Adnot pourra nourrir les travaux qu’il a engagés depuis l’année dernière sur le maintien des droits des étudiants boursiers des développements du rapport de la Cour sur l’indispensable modernisation du réseau des œuvres sociales et universitaires.
Enfin, j’observe que, dans sa réponse, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage indique qu’il a, en quelque sorte, répondu par avance à certaines observations de la Cour des comptes en engageant des réformes inspirées des conclusions de la commission d’enquête du Sénat sur la lutte contre le dopage, dont le président était Jean-François Humbert et le rapporteur Jean-Jacques Lozach.
Ayant rédigé l’année dernière un rapport d’information dans lequel je rappelais la nécessité de préserver le sous-préfet comme « porte d’entrée » du réseau des services de l’État, j’ai lu avec attention vos développements sur le réseau des sous-préfectures.
J’ai également bien noté l’insertion consacrée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui pourra constituer une lecture utile dans certains départements.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement, et, cette année encore, l’assistance que portera la Cour des comptes au titre de l’article 58-2 de la loi organique relative aux lois de finances s’annonce très utile.
La commission des finances a rendu public hier son programme de contrôle pour l’année 2015, et, comme chaque année, plusieurs rapporteurs pourront appuyer leurs travaux sur des enquêtes demandées à la Cour des comptes.
Antoine Lefèvre a présenté le mois dernier un rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse qu’il a préparé à partir d’une enquête de la Cour des comptes. Nous organiserons bientôt deux auditions à partir d’enquêtes remises par la Cour, auditions qui donneront lieu à des rapports d’information d’Alain Houpert et Yannick Botrel sur la filière-bois et d’Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier sur le recours par l’État aux consultants extérieurs.
Plus tard dans l’année, des enquêtes de la Cour des comptes bénéficieront aux travaux de Francis Delattre sur le fonds CMU, de Philippe Adnot sur l’autonomie financière des universités, ou encore de François Marc sur le Crédit immobilier de France. Le rapporteur général tirera également profit d’enquêtes sur la fonction publique tandis que les travaux du groupe de travail que nous venons de constituer sur le logement, en vue de préparer les prochains débats budgétaires, seront complétés par une enquête sur les aides personnelles au logement, qui sera remise à Philippe Dallier d’ici à la mi-juillet.
Pour achever cette énumération, j’indique que, en 2016, ce sont les travaux de Marc Laménie sur la Journée défense et citoyenneté qui seront éclairés par les résultats d’une enquête réalisée par la Cour des comptes.
Si la Cour des comptes nous prête assistance en réalisant des enquêtes à notre demande, nous nourrissons nos travaux des différentes publications issues de la Cour tout au long de l’année. En mai dernier, nous avions organisé des auditions consacrées à la rénovation thermique des logements privés, en partant de constatations présentées dans un référé consacré à la gestion de l’Agence nationale de l’habitat. Cette audition a pu enrichir les travaux de notre rapporteur général sur la réforme de l’éco-prêt à taux zéro, dans le projet de loi de finances pour 2015. Le rapporteur pour avis de la commission des finances sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, Jean-François Husson, s’y est aussi référé lorsqu’il nous a présenté son analyse du nouveau fonds de garantie pour la rénovation énergétique.
La commission des finances a également organisé une audition pour suite à donner au référé relatif à l’École nationale supérieure des beaux-arts qui était particulièrement critique.
Si Didier Migaud est l’une des personnalités les plus fréquemment entendues chaque année par la commission des finances, c’est parce que la Cour des comptes joue un rôle croissant dans la gouvernance des finances publiques. Nos rendez-vous institutionnels sont de plus en plus fréquents et nos travaux sont désormais très imbriqués.
En outre, la Cour des comptes devient aussi une actrice à part entière du cycle budgétaire. Elle certifie les comptes de l’État. À travers le Haut Conseil des finances publiques, dont la moitié des membres sont issus de la Cour des comptes – à parité, grâce à l’adoption par le Sénat, en octobre 2012, d’un amendement de notre collègue André Gattolin – et dont le secrétariat est également assuré par elle, la Cour des comptes joue un rôle dans le déclenchement du nouveau mécanisme de correction automatique. Elle apprécie la situation des finances publiques en amont du débat d’orientation des finances publiques, et l’insertion liminaire du rapport public annuel sur les finances publiques constitue généralement un avant-goût des thématiques qui y sont développées.
La Cour des comptes est une vigie exigeante en matière de maîtrise des comptes publics et elle est dans son rôle lorsqu’elle insiste sur les « risques » entourant la trajectoire des finances publiques définie par le Gouvernement ainsi que sur la nécessité de renforcer la maîtrise des dépenses publiques. Ses conseils sont précieux, et il est important pour la crédibilité de notre pays dans la zone euro que des voix indépendantes s’expriment sur les finances publiques.
Pour autant, il me paraît raisonnable, dans le respect des règles budgétaires européennes, d’adapter le rythme de réduction des déficits aux évolutions de la conjoncture, pour ne pas risquer d’amplifier la crise
M. Martial Bourquin et M. Jacques Chiron acquiescent.

Ce choix de politique économique me semble le plus opportun et le plus crédible, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’une remise en cause de l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
Tous les rapporteurs spéciaux et pour avis le constatent, tous les ministères le ressentent, toutes les données d’exécution le montrent : les dépenses de l’État sont désormais tenues, les économies sont tangibles et les dépenses nouvelles sont compensées par des annulations ailleurs. Notre effort structurel porte depuis 2014 presque exclusivement sur les dépenses.
Au total, je veux donc retenir la grande convergence de nos préoccupations et la priorité que nous accordons à la maîtrise des dépenses publiques.
Et, au terme de cette intervention, je forme le vœu que notre coopération, dans les enceintes institutionnelles comme dans nos contacts informels, se poursuive cette année dans les mêmes excellents termes que les années précédentes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l’UDI-UC et de l’UMP.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer le travail considérable dont témoigne le rapport public annuel que vient de nous présenter M. le Premier président, et en souligner le grand intérêt, une fois encore, pour le Parlement.
Permettez plus spécifiquement au président de la commission des affaires sociales de se féliciter de la contribution que la Cour des comptes apporte, à travers de multiples travaux, à l’évaluation de notre système de protection sociale.
L’implication croissante de la Cour dans ce domaine constitue le corollaire indispensable de la responsabilité exercée par le Parlement depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale en 1996, responsabilité pleinement justifiée dès lors que les finances sociales représentent, je le rappelle, près de la moitié des comptes publics de notre pays.
Certes, la situation des comptes sociaux peut paraître relativement moins dégradée que celle du budget de l’État, mais nous partageons le point de vue exprimé à de nombreuses reprises par le Premier président de la Cour des comptes selon lequel il est profondément anormal de financer par le déficit et l’endettement des dépenses courantes de prestations sociales. Il y va tout simplement de la viabilité d’un modèle social auquel nos concitoyens sont légitimement attachés.
S’agissant de l’examen d’ensemble des finances publiques en 2014, la commission des affaires sociales partage très largement les appréciations portées par la Cour.
Comme la Cour, elle considère que la révision des prévisions liée à la dégradation de l’environnement macroéconomique a été tardive, dans les textes financiers de fin d’année, alors que le Parlement aurait pu en être saisi dès l’été. De même, alors que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, a été revu à la baisse dans la loi de financement rectificative de l’été, aucune alerte n’a été émise sur le dynamisme des dépenses d’indemnités journalières ou de médicaments, notamment pour le traitement de l’hépatite C, que nous avons constaté en fin d’année.
Nous partageons aussi plusieurs interrogations de la Cour sur les perspectives de l’exécution 2015. Sans doute l’évolution du prix du pétrole et du cours de l’euro fournit-elle à notre pays un ballon d’oxygène bienvenu qui permettra peut-être de tenir les prévisions de croissance.
Mais comme le souligne le rapport public annuel, les prévisions d’économies en dépenses, qui reposaient principalement sur la non-revalorisation de prestations, n’ont pas été revues à la baisse malgré une inflation prévisionnelle divisée par deux.
Nous nous interrogeons plus fortement encore sur les économies attendues des régimes à gestion paritaire, Unédic et retraites complémentaires, en l’absence de toute disposition concrète.
De la même manière, si le Gouvernement a intégré les moindres dépenses liées au report de la mise en œuvre de la loi sur le vieillissement, qu’en sera-t-il pour le décalage de la loi santé, à laquelle était conditionnée une bonne part des 3, 2 milliards d’euros d’économies dans le champ de l’ONDAM ?
C’est pourquoi la commission des affaires sociales, rejoignant en cela les préconisations de la Cour, souhaite renforcer son contrôle sur l’exécution des lois de financement. Plus que jamais, il lui semble que l’enjeu pour le Parlement réside bien dans la réalité des dépenses exécutées, plus que dans les économies virtuelles annoncées. Nous y consacrerons plusieurs auditions, le mois prochain, dès que seront connus les premiers résultats de la clôture des comptes 2014 du régime général.
Le rapport public annuel 2015 de la Cour des comptes traite également plusieurs points particuliers touchant au domaine social.
Il s’intéresse au dispositif du chômage partiel. La Cour avait souligné voilà deux ans son impact limité, alors que l’Allemagne a su en faire un instrument efficace de préservation de l’emploi en période de ralentissement économique. Elle appelle à juste titre à évaluer l’efficacité des mesures incitatives votées en 2013 par le Parlement en vue de développer le nouveau dispositif d’activité partielle.
Dans le suivi de ses recommandations, la Cour revient également sur un sujet particulièrement important et d’actualité, à savoir l’accès aux soins palliatifs. C’est en effet l’un des rares points de consensus, dans le débat sur la fin de vie, que d’assurer à tous ceux qui souhaitent l’arrêt des soins curatifs une prise en charge adaptée leur procurant la meilleure qualité de vie possible.
La Cour note que le plan de développement des soins palliatifs a atteint ses objectifs en termes de nombre d’équipes et de nombre de lits. Mais elle souligne ce que nous constatons tous sur le terrain, à savoir que ces efforts sont encore insuffisants par rapport aux besoins. Insuffisance du développement des réseaux, participation des professionnels en ville encore trop faible, malgré l’implication des infirmières, et importantes inégalités territoriales se conjuguent pour que l’offre demeure très inférieure aux besoins.
La Cour note que nous ne connaissons pas encore l’ampleur exacte de ces besoins, faute d’études suffisamment précises. En fait, c’est d’une véritable culture palliative que manque notre pays, par comparaison notamment avec les pays anglo-saxons.
La Cour préconise notamment de mieux adapter les soins palliatifs aux maladies chroniques, d’offrir un accompagnement aux familles et de développer l’offre palliative dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Ces recommandations, parfois anciennes, se heurtent clairement à des problèmes de financement. J’espère que nous pourrons trouver des solutions à ces difficultés, avec la Cour et le Gouvernement.
Au-delà des éléments figurant dans le rapport qui nous est remis ce matin, je voudrais souligner l’ampleur des travaux réalisés par la Cour dans le sens d’une meilleure évaluation de nos politiques sociales.
Je pense évidemment au rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, qui, par son ampleur, s’apparente en quelque sorte à un second rapport public annuel entièrement consacré à la sécurité sociale.
Je pense à la certification des comptes du régime général, mais aussi aux nombreux rapports thématiques ou référés, qui constituent pour nous une source extrêmement précieuse, en termes d’analyses documentées et de propositions.
Je mentionnerai par exemple le très récent rapport sur les régimes de retraites complémentaires que la Cour est venue présenter le mois dernier devant notre mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS. Il s’agissait là d’une première : jusqu’à présent, la Cour n’avait pas eu l’occasion d’effectuer une analyse d’ensemble de ces régimes à gestion paritaire, dont la situation financière est préoccupante et dont les résultats sont pleinement intégrés aux comptes publics notifiés aux instances européennes. C’est donc un enjeu très important, pour nos concitoyens et pour nos finances publiques, que la Cour nous a permis de mieux appréhender.
Enfin, je voudrais rappeler que la commission des affaires sociales sollicite la Cour, comme le lui permet l’article LO. 132-3-1 du code des juridictions financières, pour des enquêtes sur des sujets qui lui semblent mériter une analyse indépendante et approfondie.
La Cour nous a ainsi rendu à l’été 2014 un important rapport dressant le bilan des relations établies, par le biais des conventions, entre l’assurance maladie et les différentes professions libérales de santé. Cette question est au cœur de l’équilibre délicat entre une large couverture des soins de santé par l’assurance obligatoire et le maintien d’une organisation libérale de la santé qui caractérise le système français. L’enquête a été pour notre commission riche d’enseignements sur de très nombreux points, que je ne développerai pas. Je citerai néanmoins l’une des recommandations, que nous partageons, visant à informer chaque année le Parlement des objectifs et des résultats de la politique conventionnelle.
Je souhaite également mentionner l’enquête sur la situation des maternités en France ; M. le président du Sénat y a fait référence. Demandée par l’ancienne présidente de la commission des affaires sociales, notre collègue Annie David, cette enquête nous a été remise voilà quelques semaines. Au-delà des échos schématiques, et très souvent inexacts, qui ont été donnés par la presse, elle analyse de manière objective la situation de ce secteur essentiel de notre système hospitalier. Les difficultés de recrutement, un financement inadapté, une certaine passivité face à des indicateurs de périnatalité insuffisants, une organisation manquant encore de cohérence… autant de constats qui appellent pour la Cour une politique active des pouvoirs publics. Nous avons jugé l’enjeu suffisamment important pour organiser le 4 mars prochain un débat en séance publique avec le Gouvernement sur la base de cette enquête.
Voilà qui m’amène à me féliciter que le rapport public annuel comporte sous forme synthétique une analyse du suivi des recommandations de la Cour. Cela nous permet de mesurer les progrès qui ont été accomplis, mais également les obstacles qui surviennent ou les marges qui subsistent sur la voie d’une gestion plus efficace de nos politiques sociales et des financements très importants qui leur sont consacrés.
C’est un élément qui conforte le concours que la Cour des comptes nous apporte dans l’exercice de nos fonctions législatives et de contrôle. Je ne doute pas que ce concours demeurera extrêmement utile dans les mois et les années à venir, à un moment où notre pays doit plus que jamais redresser ses comptes publics.
Applaudissements.

Nous en avons terminé avec la présentation de ce rapport.
Huissiers, veuillez reconduire M. le Premier président de la Cour des comptes.
M. le Premier président de la Cour des comptes est reconduit selon le cérémonial d’usage.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures vingt, est reprise à dix heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (projet n° 16, texte de la commission n° 264 rectifié, rapport n° 263, tomes I et II, avis n° 236, 237 et 244).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Titre II
Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois
Au sein du titre II, nous poursuivons l’examen de l’article 3 B, dont je rappelle les termes :
(Non modifié)
Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l’examen de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Revet, P. Leroy, Bizet, Portelli, Trillard et Houel et Mme Hummel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an
La parole est à M. Charles Revet.

Cet amendement est simple. Il tend à compléter l’article 3 B en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an.
Classer les logements en partant des plus gros consommateurs énergétiques est une idée pertinente, mais il faut, en outre, viser une performance énergétique possible après rénovation énergétique ; 150 kilowattheures par mètre carré et par an doivent être accessibles à condition de procéder à des travaux pertinents.

L'amendement n° 588 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Di Folco, MM. Calvet, Houel, Magras, P. Leroy et César et Mme Primas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Cet amendement est quasiment identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Charles Revet.

Sur ces deux amendements, qui ne sont pas tout à fait identiques puisque le second est un peu moins sévère que le premier, la commission avait émis un avis défavorable.
J’ai un peu peur des deux décisions qui ont été prises hier soir. Nous avons notamment décidé d’obliger la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures avant 2020. Par ailleurs, nous avons rendu obligatoire l’accélération des travaux pour tous les logements locatifs du parc privé. Or si les propriétaires ne veulent pas réaliser les travaux, madame la ministre, nul ne pourra les y obliger puisque aucune sanction n’est prévue. Je le précise car ces deux mesures sont encore un peu plus sévères et contraignantes.
L’objectif du Gouvernement est ambitieux. Nous sommes en train d’adopter des conditions encore plus strictes. Madame la ministre, ce qui va fonctionner, ce n’est pas le bâton, c’est la carotte. Tout dépendra des moyens financiers que vous accorderez pour inciter les Français à rénover les bâtiments. Vous prévoyez des contraintes sans aucune sanction. Si demain les propriétaires bailleurs privés ne veulent pas réaliser les travaux avant 2020, puisque la date est passée de 2030 à 2020, que se passera-t-il ? Il ne se passera rien et on aura encore plus de difficulté à atteindre les 500 000 logements rénovés. Idem pour ce qui est de baisser le plafond de 2030 à 2020.
Je veux bien que l’on continue à voter des mesures de plus en plus contraignantes, ces deux mesures le sont ; mais attention à ne pas adopter un comportement « plus rénovateur thermique que moi, tu meurs » ! Aussi, mes chers collègues, je vous suggère de retirer ces deux amendements. Le risque est grand de prendre ici des décisions qui n’auront aucune espèce d’effet, ce qui pourrait vous empêcher, madame la ministre, d’atteindre votre objectif. Selon moi, il convient d’adopter une attitude inverse. Ouvrez complètement le dispositif. N’obligez pas, mais permettez à ceux qui veulent rénover de faire les travaux, qu’ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. Ne mettez pas des freins et des barrières supplémentaires. Cela ne fera que vous compliquer la tâche. Mes chers collègues, ces amendements sont une contrainte supplémentaire. Ils ne sont pas illogiques ; il s’agit de prévoir une mesure très forte, mais on n’y arrivera pas et vous le savez. C’est la raison pour laquelle, je le répète, je vous suggère de les retirer.
M. le rapporteur revient sur l’amendement voté hier. Je rappelle que nous sommes confrontés à une urgence climatique. On ne peut pas, sur la scène internationale, dire qu’il a urgence par rapport au dérèglement climatique, puisque des centaines de millions de personnes seront menacées à l’échelle planétaire, et prévoir dix ans pour opérer la transition énergétique. L’amendement défendu hier par tous les groupes, qu’il s’agisse de l’UMP, du groupe socialiste, du groupe écologiste ou de l’UDI-UC, visant à ramener de dix ans – c’est très long dix ans, ce n’est pas une transition énergétique ! – à cinq ans la réalisation des travaux, me semble tout à fait raisonnable. Je suis d’accord avec vous : nous devons faire en sorte de prévoir un accompagnement technique et financier.
Cet accompagnement existe. Il faut s’en saisir et entrer de plain-pied dans la transition énergétique. Plus le processus sera accéléré, plus les entreprises du bâtiment pourront programmer des investissements et créer les emplois nécessaires, et plus le coût des travaux baissera. En effet, si de telles opérations restent marginales, leur coût demeurera élevé. Plus leur nombre sera important, et plus il sera intéressant de doubler les fenêtres, d’isoler les combles, etc. D’ailleurs, beaucoup de régions, de départements, de communes mettent déjà en place des financements pour aider les particuliers à s’engager dans la transition énergétique. C’est du gagnant-gagnant. C’est gagnant pour la facture énergétique des citoyens, mais c’est surtout gagnant pour les entreprises, qui attendent vraiment avec impatience ces travaux. Si l’on disait aux entreprises que les particuliers ont dix ans pour rénover, cela manquerait de crédibilité.
Je me réjouis donc de l’amendement voté hier. Cinq ans, c’est déjà bien assez pour prendre la décision, engager et réaliser les travaux, payer les entreprises. Le crédit d’impôt de la transition énergétique est prévu pour cette année. Je ne sais pas s’il sera reconduit l’année prochaine. C’est au Parlement d’en décider et au Gouvernement de faire les arbitrages. Aujourd'hui, on donne aux familles le signal qu’il faut s’engager très rapidement dans la mise en place des travaux de rénovation en saisissant l’opportunité du crédit d’impôt qui allège la facture de 30 %.
Les amendements présentés vont dans le bon sens. Comment pourrais-je m’y opposer en tant que ministre chargée de l’écologie, d’autant qu’ils ont été déposés par des groupes politiques différents ? Cela signifie que ces derniers sont eux aussi en train de réfléchir à un modèle énergétique offensif, et je m’en félicite. Il est de ma responsabilité politique d’écouter le Sénat, de soutenir ces amendements et d’accompagner le changement, même s’il a des difficultés d’arbitrages interministériels, des pesanteurs, des résistances, bureaucratiques ou autres, qui rendent les avancées difficiles.
Faut-il néanmoins aller jusqu’à apporter une telle précision dans le texte ? Ce n’est pas évident. Je propose de sous-amender l’amendement de Mme Lamure. Certes, la performance énergétique visée ici est exigeante, mais comment pourrais-je être défavorable puisque je soutiens la construction de logements à énergie positive, notamment pour ce qui concerne les administrations et les bâtiments publics.
Nous devons tout de suite opter pour la haute technologie. En effet, si nous restons dans l’entre-deux, les entreprises du bâtiment se demanderont si ça vaut le coup d’investir immédiatement en faveur de la performance énergétique des bâtiments et de miser sur les matériaux, sur l’efficacité énergétique des fenêtres, sur la récupération de chaleur. Disons-leur oui, vous avez intérêt à anticiper puisque les normes seront de plus en plus exigeantes en la matière. Plus nous resterons dans les entre-deux, plus les choses traîneront, moins les investissements seront performants et moins les entreprises seront incitées à investir.
Voilà pourquoi je suis favorable à l’accélération de la transition énergétique, surtout si elle est proposée par le Sénat. Je suis favorable à ces amendements, car ma responsabilité de ministre de l’écologie est d’accompagner le mouvement afin d’être en phase avec les discours sur l’urgence climatique. Il convient néanmoins de préciser qu’un décret fixera le plus rapidement possible le niveau de cette performance énergétique.

Madame le ministre, nous sommes tous d’accord pour développer une politique qui minimise la consommation énergétique des logements. Dieu sait qu’il y a du travail, d’autant que les logements locatifs construits il y a cinquante ou soixante ans sont de vraies passoires et consomment énormément d’énergie. Nous sommes tous favorables aux logements à résultat positif. Vous avez d’ailleurs évoqué hier les coûts comparés, qui sont extrêmement importants.
Cela étant, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 588 rectifié. J’ai bien entendu les propos de M. le rapporteur : nous ne devons pas être trop contraignants. La proposition de ma collègue Mme Lamure est plus complète que la mienne.

L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Je souhaite indiquer que mon amendement est assorti d’une condition très importante
M. Charles Revet opine.

Aussi, je propose de ne pas sous-amender cet amendement et de l’adopter en l’état.

Monsieur Revet, madame Lamure, je vous remercie de votre entente. Des deux amendements, celui qui a été présenté par Élisabeth Lamure est préférable en raison du petit membre de phrase « si le calcul économique le permet ».

Quoi qu’il en soit, entre les deux propositions, je préfère bien sûr celle qu’a présentée Mme Lamure.

Madame la ministre, souhaitez-vous finalement déposer un sous-amendement ?
Non, madame la présidente. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 588 rectifié.

J’ai du mal à comprendre le raisonnement de M. le rapporteur. Tout à l’heure, il a émis un avis négatif en argumentant que rien ne contraignait les propriétaires à réaliser les travaux. J’avais cru qu’il exprimait un certain regret et qu’il s’inscrivait bien dans la démarche d’une dynamique positive en faveur de la rénovation des bâtiments. Or là, il avance un argument inverse en déplorant le coût de la mesure.
Monsieur le rapporteur, quel que soit le moment où les travaux seront réalisés, ils auront un coût ! Cet argument n’est pas du tout compatible avec le précédent. Par ailleurs, que les travaux soient réalisés maintenant ou plus tard, ça coûtera cher ! Le problème c’est de savoir qui paie, quelles sont les aides et quelles sont les différentes modalités. Le coût sera à court terme, mais il y aura des économies à long terme : c’est le principe.
Votre dernier argument, à mon avis, n’est pas cohérent avec l’explication plutôt sensée que vous aviez avancée dans un premier temps.
L'amendement est adopté.
L'article 3 B est adopté.

L'amendement n° 719, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3 B Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
La parole est à M. Ronan Dantec.

Nous sommes encore dans la dynamique d’hier soir, et j’ai du mal à me recaler par rapport aux clivages politiques habituels qui prévalent dans cette assemblée.
J’ai bien entendu M. le rapporteur expliquer que la stratégie du bâton ne fonctionnait pas et que seule la carotte comptait, donc l’esprit soixante-huitard soufflait ce matin sur notre assemblée et se traduisait dans les propos de notre rapporteur. Néanmoins, j’ai tendance à penser que la carotte et le bâton vont ensemble…

… et que c’est ainsi que cela fonctionne le mieux.
L’amendement qui vous est proposé, et cela répond en partie aux objections formulées par M. le rapporteur, prévoit à quel moment s’impose la contrainte, autrement dit le bâton.
Or la mutation est le moment clé pour réaliser la rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels. C’est de surcroît le moment où le secteur bancaire intervient, notamment en termes de prêt relais. Par conséquent, s’il est un moment où l’on peut trouver les financements, prévoir une obligation légale, c’est bien celui de la mutation.
L’amendement que je vous présente vient compléter les dispositions que nous avons adoptées hier, y compris, comme l’a souligné Mme la ministre, l’obligation de rénovation du parc locatif en 2020, en prévoyant qu’à partir de 2030, autrement dit à une date extrêmement raisonnable – si certains proposent d’avancer l’échéance à 2020, je les suivrai -, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
De façon toujours aussi modérée, mais nous sommes prêts à durcir le texte, cet amendement prévoit un calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050, ce qui nous permet de tenir l’objectif de 2050 inscrit dans la loi.
Il s’agit donc d’un amendement de complément du dispositif existant, extrêmement modéré dans sa mise en application.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, l’obligation supplémentaire prévue par cet amendement n’est pas bénigne !
MM. Ronan Dantec et Jean Desessard sourient.

Si vous devez vendre pour des raisons personnelles, chômage, départ en maison de retraite, le couperet tombe ! Aux termes de cet amendement, dès que l’on vend, on doit obligatoirement réaliser des travaux de rénovation.

Vous êtes dans votre logique, monsieur Dantec, mais c’en est fini de la liberté !

Comment ça, c’est la loi ? En France, on fait ce que l’on veut de son logement ! Il ne faut pas qu’une mesure législative condamne demain le Français à vendre lorsqu’il n’a pas les moyens de réaliser un certain nombre de travaux.
La commission a, bien sûr, émis un avis défavorable sur cet amendement. Avec cette inflation d’obligations supplémentaires, vous êtes parfaitement dans votre logique ; je ne suis pas surpris que vous proposiez cet amendement, qui est, de mon point de vue, liberticide.
Mme Vivette Lopez et M. Daniel Chasseing applaudissent.
Ce débat est intéressant. Vous souligniez hier, monsieur le rapporteur, que l’Allemagne réussissait à rénover 720 000 logements par an. Or, justement, il existe des règles très contraignantes outre-Rhin et la rénovation des logements est obligatoire au moment des mutations. Depuis très longtemps, l’Allemagne a fait ce pari, afin d’envoyer un signal fort.
Comme vous le disiez très justement, monsieur le sénateur, le projet de loi ne prévoit pas de contrainte. La société tout entière doit s’engager dans cette transition énergétique et considérer que les travaux d’isolation des logements constituent une chance : une chance pour créer des activités, une chance pour la croissance verte, une chance pour que les entreprises du bâtiment et les artisans aient du travail, une chance pour que les gens n’hésitent plus.
En outre, l’objectif, fixé à 2030, est tout de même très lointain, et relié à l’amendement que vous venez d’adopter. Les gens se diront qu’ils auront jusqu’en 2030 pour rénover leur logement et pourront ainsi décider de réaliser cette année les doubles vitrages, l’année prochaine les combles, l’année suivante l’isolation des façades, etc.
De toute façon, ces travaux valoriseront leur bien. Dans quelques années, un logement qui ne sera pas bien isolé aura perdu beaucoup de sa valeur.
M. Jean Desessard applaudit.
… à le vendre dans de meilleures conditions. Depuis que l’affichage de la performance énergétique est obligatoire dans les documents notariés, les gens y sont de plus en plus attentifs. Ils prennent en compte les factures d’énergie qu’ils sont obligés de payer tous les trimestres…
… et constatent combien l’investissement dans l’isolation énergétique est important.
Il est d’autant plus crucial d’accélérer le mouvement que des efforts considérables sont déployés par les collectivités territoriales pour implanter des lieux d’information sur les travaux d’économie d’énergie, de même que par les artisans pour se former aux travaux d’isolation d’énergie. Si nous accompagnons ce mouvement, les acteurs économiques seront poussés à investir et les particuliers à placer leurs économies dans les travaux d’isolation d’énergie, valorisant ainsi leur patrimoine immobilier, qui sera vendu dans de meilleures conditions.
Il s’agit non pas d’une contrainte, monsieur le rapporteur, mais d’un signal fort. Les gens doivent avoir envie de s’engager dans cette transition, sans qu’on les menace de quoi que ce soit. S’ils n’ont pas les moyens financiers, ils ne feront pas les travaux. L’idée, c’est qu’ils se saisissent très rapidement du crédit d’impôt, des prêts à taux zéro, des sociétés de tiers-financement et que la multiplication des commandes fasse baisser le prix des travaux d’isolation et augmente leur performance. Nous réussirons ainsi à baisser les consommations énergétiques. C’est un processus gagnant pour les citoyens qui vont réaliser des économies d’énergie, pour les territoires qui vont créer des emplois dans les filières du bâtiment et pour la planète dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’urgence climatique doit s’accompagner de l’accélération de la transition énergétique ; c’est de cette façon que nous serons les plus efficaces en termes de création d’activités et d’emplois.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. Jean Desessard applaudit.

Au travers de cet amendement, nous votons un objectif, fixé à 2030, ce qui laisse un certain temps pour trouver les moyens nécessaires à sa réalisation. Les pouvoirs publics doivent avoir conscience qu’une telle décision suppose la création de nouveaux outils de financement.
À cet égard, il importe que les plates-formes énergétiques aillent vers les gens et non l’inverse ; je déposerai d'ailleurs un amendement en ce sens. Les personnes âgées, par exemple, ne sont pas informées, ont peur que ce soit trop cher, etc. Même si elles ont effectué régulièrement des travaux parce qu’elles en avaient les moyens ou ont fait appel à un tiers financeur, à soixante-dix ou à quatre-vingts ans, au moment de la mutation, si leur logement n’est pas aux normes, les banques ne leur prêtent plus et les sociétés de tiers financeur ne peuvent plus agir.
Il faut donc trouver un système de prêt qui permette de déduire l’argent investi au moment de la revente. Un montage financier, technique, juridique doit être créé, un outil spécifique admettant que le montant de la réalisation des travaux soit déduit du prix au moment de la mutation. Pour l’heure, ces outils sont à peu près inexistants.
Pour autant, se fixer des objectifs à l’horizon de 2030, c’est aussi se donner l’obligation de trouver les moyens. Nous avons eu un débat du même ordre pendant des lustres s'agissant du droit au logement opposable : fallait-il instaurer un tel droit sans savoir comment loger tout le monde ou fallait-il l’instaurer pour s’imposer de loger tout le monde ? Manifestement, prévoir une obligation n’implique pas toujours d’y mettre les moyens.
En tout cas, madame la ministre, j’espère que la nation se donnera les moyens de faire entrer les propositions de notre collègue Dantec dans les faits sans que ce soit une pénalité pour les plus faibles.
M. Didier Guillaume applaudit.

Je rejoins complètement le propos de Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous le savons, il convient de mettre au point un outil financier opérationnel, et ce bien avant 2030 puisque celui-ci servira dans d’autres domaines. La facilité d’accès au crédit, notamment par le tiers-financement, est un point clé pour une loi efficace.
Je remercie le rapporteur, M. Ladislas Poniatowski, d’avoir clairement remis la droite à droite et la gauche à gauche. Le mot « liberticide » me semble devoir être réservé aux situations qui le nécessitent vraiment, mon cher collègue.

Néanmoins, c’est un vrai discours libéral qu’a tenu le rapporteur, et il est clair aujourd’hui que l’état de la planète provient du libéralisme, de l’incapacité à introduire de la régulation. Il est faux de penser que les choses s’arrangeront spontanément, par la « carotte », par la seule incitation, que nous retrouverons ainsi une trajectoire inférieure à deux degrés. Il faut des règles. Mme la ministre a rappelé le cas de l’Allemagne, qui sert parfois d’exemple même au rapporteur en matière de réhabilitation et de rénovation du parc de logements, qui a atteint ses objectifs grâce à des règles contraignantes.
De surcroît, cette disposition est en cohérence avec celle que nous avons adoptée hier. Nous avons adressé un premier signal en 2020 sur la rénovation du parc locatif privé ; nous en donnons un second en 2030 pour un certain nombre d’entreprises. Un vrai schéma cohérent d’engagement, de création de filières et de formations est ainsi créé. Étape par étape, nous instaurons de la cohérence dans la loi.
Enfin, en termes de liberté, sans employer des mots trop forts, je souligne que les logements qui sont des passoires thermiques connaîtront de plus en plus une décote. Si nous ne prévoyons pas d’obligation, ce sont donc les plus modestes qui se retrouveront dans de tels logements : soit ils ne pourront pas se chauffer, soit ils se retrouveront en situation de précarité financière énergétique et d’endettement.
La mesure que nous proposons est tout à fait raisonnable et rationnelle. Nous pourrions tous la voter, en gardant à l’esprit la remarque formulée par Mme Lienemann à propos de l’accompagnement bancaire qu’il reste à trouver. Nous avons le temps d’y parvenir.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voulais effectivement attirer votre attention sur la remarque formulée par Mme Marie-Noëlle Lienemann : à partir d’un certain âge, il n’est plus possible d’obtenir de crédits.
Je connais, dans mon département, des agriculteurs touchant 700 euros de retraite par mois
M. Alain Gournac opine.

Vous avez indiqué, madame la ministre, que ces mesures étaient bénéfiques pour l’artisanat et pour l’économie. Il faut favoriser la rénovation énergétique. L’enjeu majeur de la transition énergétique, c’est l’isolation des bâtiments ; nous en sommes d’accord. Cependant, on ne peut imposer une obligation si les gens n’ont pas les moyens de la mettre en œuvre. Il faut les inciter, mais il n’est pas possible de les obliger à agir.

Monsieur le rapporteur, n’y voyez rien de personnel, mais je vais une nouvelle fois faire des remarques sur vos observations, en lien avec les options que vous défendez.
Cet amendement, vous l’avez vous-même souligné, monsieur le rapporteur, n’a rien de contraignant, sauf à partir de 2030. Nous avons donc le temps de nous y préparer, qu’il s’agisse des moyens à mettre en œuvre, des crédits à apporter, des modulations techniques. Votre analyse m’a semblé très intéressante.
La question se pose de savoir si votre discours relève de la bonne intention ou si vous avez une réelle volonté en matière de rénovation thermique. J’avais compris que nous étions tous d’accord, à gauche comme à droite, dans cet hémicycle et à l’Assemblée nationale, sur la rénovation thermique - nous avions eu, bien sûr, des débats sur le nucléaire, mais je n’y reviendrai pas.
Vous ne pouvez pas renoncer au motif que cela coûte cher ! De toute façon, à court terme, cela va coûter cher. Même si des économies seront réalisées sur trente, quarante, cinquante ans, il y a bien un moment où il faudra avancer l’argent. Si vous reculez devant l’obstacle, nous n’y arriverons jamais.
Un discours d’intentions, c’est dire qu’il faut le faire, mais s’arrêter à la moindre difficulté. Il faut tout de même prévoir des conditions. Ce n’est nullement « liberticide », monsieur le rapporteur !
Les particuliers ont la possibilité de s’organiser d’ici à 2030 ! Ils peuvent ainsi engager des travaux avant une mutation. Mais si vous ne fixez pas d’objectif, rien ne se fera jamais. Cela revient à tenir un discours plein de bonnes intentions sans prévoir d’acte de mise en œuvre.
Mme la ministre a décrit tous les avantages du dispositif. J’en ajouterai deux autres.
Monsieur le rapporteur, nous avons participé ensemble à une mission commune d’information sur l’électricité. Nous voulons tous l’indépendance énergétique pour notre pays. Or moins il y aura de consommation, plus cette indépendance sera grande.
Nous savons qu’il est difficile de gérer les écarts de consommation. Plus la rénovation thermique sera mise en place rapidement, plus les écarts seront réduits. En revanche, plus vous mettrez du temps à l’instaurer, plus les écarts seront importants. En effet, c’est au même moment que l’on consomme, dans l’année, par jour et en termes d’horaires. Cela signifie que l’on devra construire des centrales thermiques. Autrement dit, il faudra bien les payer ! Le coût de l’électricité sera plus cher pour le consommateur, et l’État devra lui aussi payer.
Vous nous dites que notre proposition représente un investissement coûteux, mais elle est économique à long terme. Ce que vous ne faites pas maintenant parce que cela coûterait cher pour le particulier, finira par coûter cher à l’État ou aux entreprises et donc, finalement, au consommateur ! Vous ne faites absolument pas d’économie !

Je ne vais pas répéter les propos qui ont été largement exposés sur toutes les travées. Nous sommes tous d’accord : la rénovation thermique des bâtiments et de l’habitat privé ancien est une nécessité, et l’un des éléments qui permettra d’atteindre les objectifs que nous visons collectivement.
Monsieur Dantec, nous ne pouvons que partager les objectifs inscrits dans l’amendement que vous portez. Mais, comme l’a dit Marie-Noëlle Lienemann qui parle d’expérience, et tous les élus locaux le savent, il faut se demander quels sont les ménages qui ont le plus de difficultés à accompagner la rénovation thermique de leur logement. Qui sont les ménages propriétaires occupants en situation de surendettement pour des consommations d’énergie trop élevées parce qu’ils vivent dans de l’habitat dégradé ?
Ce sont les ménages les plus modestes. Ce sont donc eux qui auront le plus de mal, le jour où ils voudront céder leur logement ou faire les travaux, à être suffisamment solvables pour mener à bien leur projet.
Le programme « Habiter mieux » regroupe les outils mis en place par l’Anah pour que tous les petits propriétaires occupants, qui sont retraités, qui sont des personnes vivant tant en milieu rural qu’en milieu urbain, soient accompagnés dans cette solvabilisation. Or, on le sait, nous arrivons au bout du dispositif et les moyens s’épuisent.

Aujourd’hui, se pose donc la question de ce que vont devenir ces ménages modestes, voire très modestes. Il faut trouver les modalités d’accompagnement de l’objectif visé.
Pour ma part, je proposerais bien à Mme la ministre, à M. le rapporteur et surtout à M. Dantec, qui en est l’auteur, de rectifier cet amendement pour ajouter les mots « sous réserve des outils financiers qui permettront d’atteindre cet objectif ». §Comme l’a dit à juste titre Marie-Noëlle Lienemann, imaginez le cas d’une personne retraitée, propriétaire d’une petite maison, qui doit partir en maison de retraite parce qu’elle est atteinte d’une maladie neurodégénérative. Elle devrait alors vendre son logement, mais, comme elle a une toute petite retraite, elle n’a pas les moyens de faire les travaux : il lui serait impossible de vendre son logement !
On le voit bien, il y a des limites à cet exercice. Il faut accompagner les ménages les plus modestes, qui sont pénalisés. Je suis d’accord à 100 % avec l’objectif de cet amendement, que je voterai si M. Dantec accepte d’y faire figurer la garantie sur le financement. Cette question reviendra à plusieurs reprises dans le débat.
Les ambitions vertueuses doivent s’accompagner de mesures en faveur des personnes les plus fragiles. Les objectifs et les visées en matière environnementale creusent le fossé entre ceux qui peuvent accompagner cette évolution et les autres.
On ne doit jamais perdre de vue que tout ce qui touche à la solidarité, à l’environnement et à l’écologie doit être pensé collectivement et de façon cohérente, car si l’on ne prévoit pas d’outils d’accompagnement, on créera un véritable fossé entre ceux qui ont les moyens de s’adapter à la transition énergétique et ceux qui ne les ont pas.

À ce moment du débat, je souhaiterais évoquer la situation des locataires qui ont de faibles revenus. Ma réflexion porte sur l’amendement dont nous discutons, mais également sur les deux précédents.
Ceux d’entre nous qui siègent au CCAS de leur commune peuvent constater que vivre, surtout en zone rurale, dans une maison de bric et de broc ou mal rénovée, véritable passoire à chaleur, chauffée avec des radiateurs de style « grille-pain », coûte cher au propriétaire – je vous l’accorde –, mais surtout au locataire.
Pour vivre dans ce type de logement, les locataires engloutissent beaucoup d’argent, parfois des sommes vraiment astronomiques au regard de leur revenu moyen. Et plus le logement loué est dévalorisé parce qu’il n’a pas été rénové, plus le coût du chauffage et de l’électricité est important.
Quand on dit que cela coûte cher, c'est d’abord pour les locataires de ces logements. Comme ils ne peuvent souvent pas payer leurs factures d’électricité, ce sont ensuite les CCAS qui, par des accords, prennent le relais. Au final, cela coûte cher aussi à la collectivité, et d’une autre manière.

Mme Odette Herviaux. Il faut donc, bien sûr, évoquer la situation des propriétaires qui ne roulent pas sur l’or et prendre les précautions nécessaires, mais ne pas oublier que, globalement, les locataires sont les premiers à subir le contrecoup de l’absence de mise aux normes et de réfection de ces logements.
M. Didier Guillaume applaudit.

Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je considère que ce débat est assez surréaliste !
J’approuve tout à fait les conclusions de notre rapporteur. Nous nous inscrivons dans une démarche libérale, que bien entendu M. Dantec n’a pas souhaité suivre.

; allons-nous maintenant également administrer la vie et les choix des Français ? Considérons-nous comme normal que dans quelques années, si l’on poursuit une telle dérive, chacun d’entre nous doive avoir son petit livret, dans sa vie individuelle de tous les jours, pour savoir ce qu’il a le droit de faire ou de ne pas faire ?

Imposer de telles choses – je reviendrai sur la question du délai à l’occasion de l’examen d’un texte sur l’énergie – me paraît assez surréaliste. Je suis peut-être « à côté de la plaque », mais je tenais à le dire.
Par ailleurs, nous sommes en train de légiférer pour 2030. Or, 2030, c’est dans quinze ans, c’est presque une génération. Pouvons-nous nous arroger le droit de prendre de telles décisions pour les léguer aux générations futures ? §Nous allons déjà leur léguer collectivement des déficits budgétaires considérables, que l’on a chiffrés de manière individuelle par Français et qui seront extrêmement lourds !
Allons-nous ajouter à ces charges collectives, que le gouvernement alors en fonction devra bien assumer, des charges individuelles résultant de tels textes ? J’avoue que je suis assez sidéré qu’on puisse l’imaginer.
Enfin, madame la ministre, bien entendu ces travaux, en 2030, seront réalisés par des entreprises et des artisans. Mais croyez-vous que, actuellement, les artisans, vu la situation qu’ils connaissent en termes de besoin de travail, seront sensibles à l’argument selon lequel on leur donnera du travail en 2030 ? Les artisans, à l’heure actuelle, sont confrontés à des difficultés importantes et c'est maintenant qu’il faut leur apporter des solutions, ce n’est pas en 2030 !
J’ai simplement voulu exprimer ce que je ressentais à l’occasion de ce débat et, bien évidemment, vous l’aurez compris, je ne voterai absolument pas cet amendement.

M. Philippe Dallier. Pour ma part, je ne me placerai pas sur le terrain des libertés individuelles. L’objectif, nous le partageons tous. Cependant, je ne veux plus voter d’amendement ou de texte qui promettent, à terme, monts et merveilles sans savoir si nous sommes capables d’y parvenir et comment nous allons procéder.
Mme Valérie Létard s’exclame.

Nous sommes en 2015. Rappelez-vous, mes chers collègues : en 2005, il y a dix ans, nous avons voté, à l’unanimité, je crois, ici, au Sénat et à l’Assemblée nationale la fameuse « loi handicap ». Je ne me souviens plus exactement comment cela s’est passé, mais il me semble que nous l’avons fait sans évaluation des coûts pour les collectivités locales. Et nous avons laissé croire à nos concitoyens que nous allions mettre à niveau tous les bâtiments publics. Pour ma commune de 22 000 habitants, il fallait trouver 15 millions d’euros. Nous avons été incapables de le faire, même si, avec de la bonne volonté, nous avons fait des choses.
Dix ans plus tard, nous avons rendez-vous avec les Français et nous, parlementaires, sommes bien obligés de leur expliquer que, une fois de plus, nous avons voté une loi généreuse, mais que nous sommes désolés de ne pas avoir été capables de la mettre en œuvre.
Le DALO, le droit au logement opposable, n’est-ce pas un peu la même chose ? Bien évidemment, il faut un toit pour chacun, pour chaque famille. Et nous avons voté le DALO en sachant toutes les difficultés que nous aurions pour le mettre en œuvre.

Oui, vous avez raison, madame Lienemann. La loi handicap et le DALO, c’était nous ; je ne dis pas le contraire. Mais nous avons tous voté ces deux lois !
Aujourd’hui, quelques années plus tard, nous sommes confrontés à la réalité : nous n’avons pas été capables de mettre en œuvre le DALO. Dans les zones non tendues, il n’y a pas de problème ; mais, dans les zones tendues, on aboutit à des situations complètement absurdes. Les particuliers font condamner l’État par le tribunal administratif, ce qui ne signifie rien puisqu’on prend dans une poche de l’État pour mettre dans une autre. Que croyez-vous que les Français en pensent ? C'est la véritable question qu’il faut se poser.
Si je partage bien évidemment l’objectif de cet amendement, je ne peux plus voter de textes qui fixent de grandes ambitions sans dire comment les atteindre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – Mme Annick Billon applaudit également.

J’irai dans le sens de mes deux collègues précédents : l’idée est bonne, mais il faut bien en mesurer les conséquences.
Là où les particuliers n’auront pas les moyens de faire les travaux nécessaires, nous allons avoir des friches urbaines ou rurales, alors même qu’il y a de plus en plus de personnes mal logées dans notre pays. L’idée n’est pas détaillée de façon suffisamment précise pour arrêter la date de 2030.
Pour ma part, je ne peux pas voter un tel amendement, qui va engendrer des conséquences terribles que l’on n’a pas forcément mesurées. C’est une bonne idée, mais cela reste au stade de la bonne idée.

Je partage beaucoup de points de vue qui ont été exprimés, notamment par les Verts pour ce qui est des objectifs, mais également et surtout par Mme Létard, sur la question des moyens, et par M. Dallier, s’agissant des promesses faites, mais qui ne sont pas tenues, ce qui est politiquement dangereux.
Nous pouvons réussir si nous prenons des engagements fermes et clairs. Dans cette affaire, il faut de l’enthousiasme. Nous sommes à un moment de grande crise dans lequel il faut se fixer des objectifs ambitieux et dégager les moyens nécessaires, car cela permettra de créer de nombreux emplois.
Nous sommes capables de faire une grande œuvre sur la question du logement, tant en créant de nouveaux logements de qualité qu’en rénovant d’anciens logements, ce qui est plus difficile. Si l’État se porte garant, si tous ensemble nous élaborons un document précis assorti de garanties, nous pouvons redonner un peu d’espoir à nos concitoyens.
(M. Ronan Dantec opine.) C'est très grave ! Ce projet peut nous permettre d’inverser la tendance. Prenons des engagements fermes et clairs. Allons-y, car c’est une grande affaire !
Mme Cécile Cukierman applaudit.

Aujourd’hui, non seulement la situation est complexe, mais nous n’arrivons plus à donner de l’espoir aux gens. §

Selon moi, cet amendement se heurte à la réalité du quotidien. En effet, en plus des personnes âgées, déjà citées par notre collègue Mme Lienemann, il y aura les héritiers, qui auront du mal à se mettre d’accord sur les modalités de financement de la rénovation de l’appartement ou de la maison.
Il y aura aussi les divorcés – ils sont nombreux –, qui, vu qu’ils ne s’entendent plus sur tout – généralement, ils ne s’entendent plus sur rien §, auront certainement les plus grandes difficultés à se mettre d’accord sur les conditions de financement de la rénovation d’un logement qu’ils comptent vendre.
Telles sont les réalités du terrain.
Par conséquent, à partir de 2030, chaque année des dizaines de milliers de personnes ne pourront pas appliquer la loi.
(M. Ronan Dantec s’exclame.) Pourquoi vouloir obliger les propriétaires à des travaux qu’ils ne seront pas en mesure de réaliser
M. Jean Desessard s’exclame.

Au demeurant, consacrer cette obligation me paraît inutile, pour une raison toute simple : comme Mme la ministre l’a fort bien dit, le marché de l’immobilier se traduira par des décotes très élevées pour tous les logements qui ne seront pas mis aux normes en matière d’isolation. §, d’autant qu’il y aura ensuite la sanction toute naturelle du marché ?
Le bon sens invite à ne pas s’engager dans cette voie. Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement.

Monsieur Dantec, si vous en êtes d’accord, je veux retenir la suggestion de Valérie Létard.
Je propose, pour ce faire, que nous reprenions la formulation de l’amendement précédemment présenté par Élisabeth Lamure. Le premier alinéa de l’amendement de M. Dantec pourrait être ainsi rédigé : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, si le calcul économique le permet. »
Cette modification a minima permettrait d’atténuer la brutalité de la mesure, sans rien changer aux autres dispositions de l’amendement, qui visent à confier à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le calendrier progressif d’application de cette obligation, calendrier qui laisse quand même un certain laps de temps pour cette application, puisqu’il est étalé jusqu’en 2050.
En faisant cette proposition, Valérie Létard a parlé des personnes susceptibles de devoir quitter les logements concernés, notamment les personnes âgées. Toutefois, d’autres personnes, obligées de vendre leur bien en urgence, seront pénalisées : des salariés mutés, des chômeurs… Les cas de figure sont multiples. Nous les connaissons tous bien, grâce à nos bureaux d’aide sociale.
Mes chers collègues, la proposition que je pourrais formuler laisse du temps, tout en atténuant la mesure. Elle est simple !
Je me rallie à la solution de compromis que vient de proposer M. le rapporteur.
Je me félicite de l’esprit de coconstruction dans lequel nous travaillons. Nous essayons tous d’être utiles à notre pays.
À cet égard, je pense qu’il faut, surtout, « positiver le discours ». En effet, si l’on commence par dresser la liste des obstacles ou des inconvénients, on ne s’engagera pas dans la transition énergétique…
… et il en découlera des difficultés sur le plan économique.
Plus les indicateurs sont clairs, plus le cadre est stabilisé pour les entreprises. C’est très important.
Cela étant, il faut fixer des échéances raisonnables – 2030 me semble en être une. Je dirai même qu’elle protège les propriétaires, en leur donnant une perspective – on sait très bien que, plus le temps passe, plus un logement mal isolé perd de sa valeur.
Fixer un objectif clair et prévoir, dans le même temps, les moyens financiers de l’accompagnement – à l’instar de ce que proposent les auteurs de l’amendement – obligera l’État à consacrer, tous les ans, les moyens nécessaires à l’Agence nationale de l’habitat, l’Anah.
En tant qu’élus locaux, vous savez que celle-ci est très efficace. Elle permet aux familles et aux personnes seules ayant des revenus modestes d’accéder aux travaux d’économie d’énergie au meilleur coût, les fait bénéficier d’un accompagnement ainsi que d’un contrôle sur les prix pratiqués par les entreprises. Cela a permis de rénover plusieurs dizaines de milliers de logements sur le territoire.
À cet égard, prévoir un accompagnement financier mettra l’État devant ses responsabilités, chaque année, au moment du vote du budget de l’Anah. Cela permet de fixer un objectif dont l’horizon – 2030 – est assez lointain pour protéger les propriétaires et, grâce à la proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, de faire face aux situations d’urgence que celui-ci a évoquées et que l’on pourra effectivement prendre en considération.
Je trouve que c’est un bon compromis. Il faut avancer par étapes, mais, en même temps, avancer avec détermination et clarté pour que le mouvement de la société aille bien dans le sens des économies d’énergie.
Au bout du compte, cette solution protège les consommateurs et les propriétaires, qui verront ainsi leurs biens revalorisés.

Monsieur Ronan Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement ou préférez-vous qu’un sous-amendement soit déposé ?

Compte tenu de ce que vient de dire Mme la ministre et des échanges que nous avons eus avec Mmes Létard et Lienemann, je rectifie mon amendement afin d’ajouter à la fin du premier alinéa les mots : « sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats ». Cela répond à mon avis totalement à la question.
Cela mettra aussi devant leurs responsabilités l’État, ainsi que Mme la ministre vient de l’indiquer – j’avoue que je n’espérais même pas une phrase aussi claire de la part de l’État –, mais également les collectivités et l’ensemble des autres acteurs qui ont vocation à accompagner les travaux de rénovation des logements.

Je suis donc saisie d’un amendement n° 719 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l'article 3 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons pris acte, avec beaucoup d’intérêt, des propos que Mme la ministre vient de tenir sur la recherche d’un compromis. On voit bien que, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous sommes tous attachés à ce que des efforts importants soient consentis en faveur de la rénovation des logements.
Nous connaissons les situations qui ont été décrites. De fait, dans nos communes, des bâtiments qui ne sont plus habités deviennent de vraies friches en cœur de bourg. Tout cela, bien entendu, doit être corrigé.
En même temps, nous avons bien entendu que certains ménages – il a notamment été question de personnes âgées – ne sont pas en mesure de participer au financement, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
J’avais préparé mon discours avant que M. Dantec rectifie son amendement.
En fait, il faut distinguer deux points : d’une part, les possibilités des propriétaires ou des locataires – c'est de cette situation que tient compte la proposition du rapporteur, qui, s’inspirant de l’amendement précédent, suggère d’ajouter « si le calcul économique le permet » – et, d’autre part, les outils, notamment financiers, qu’il faut mettre en place.
En effet, le vrai problème, madame la ministre, c’est, d’abord, que les outils sont un peu disparates. Quelqu'un qui veut rénover son logement doit s’adresser à plusieurs guichets. De ce point de vue, l’Allemagne est un exemple intéressant : les procédures y sont beaucoup plus simples.
Surtout, il faut mettre en place des moyens financiers. De ce point de vue, l’Anah n’est pas en mesure aujourd'hui d’apporter des réponses aux personnes qui s’adressent à elles. Elle n’a pas assez d’argent. Cependant, nous avons bien entendu que le Gouvernement entendait bien lui donner les moyens nécessaires à ces rénovations. C’est un point très important.
J’en viens maintenant à la proposition de notre collègue Ronan Dantec. Elle ne recoupe pas tout à fait celle du rapporteur.

Si celle-ci demeure pertinente, je dois dire que la proposition de M. Dantec, qui consiste à prévoir la mise en place des outils financiers adéquats pour favoriser la rénovation des bâtiments, nous convient également.
Il me semble que les deux propositions permettent, ensemble, de couvrir l’intégralité des préoccupations qui ont été exprimées. Je me permets de le souligner !

Monsieur le président de la commission, aux termes du second alinéa de l’amendement, « un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050. » Autrement dit, la question du calcul économique devra déjà figurer dans le décret !
Votre préoccupation est donc satisfaite par l’amendement, extrêmement modéré pour ce qui concerne le calendrier couvert par le décret.
Il n'y a donc absolument pas besoin d’en alourdir la rédaction.

Je suis circonspect sur les modalités.
En effet, il est un autre problème, qui n’a pas encore été soulevé : celui du niveau de performance énergétique.
Pour avoir beaucoup d’expérience dans ce domaine, je peux vous dire que, selon le cabinet que vous choisissez, la performance énergétique peut varier dans des proportions assez considérables ! Certains vont être obligés de faire des travaux à partir de 2030, quand d’autres verront ces travaux repoussés jusqu’à 2050.
La situation est très compliquée.
Madame la ministre, il faudrait que nous puissions avoir des précisions sur les termes du décret qui sera pris en Conseil d'État. Peut-on en savoir plus dès aujourd'hui ? Quand ce décret paraîtra-t-il ? Rapidement ou dans quelques années ? L’imprécision est vraiment problématique. Nous sommes tous d’accord sur l’intention, qui est parfaitement louable, mais, en l’état actuel de la rédaction de l’amendement, il ne me semble pas pertinent d’obérer l’avenir à ce point.
M. Alain Gournac applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je pense que l’amendement de M. Dantec vise à faire la chasse aux passoires énergétiques dans le secteur privé.
Il faut savoir que, dans les centres-villes, beaucoup de logements sont des passoires énergétiques – les audits que nous réalisons le montrent.
Souvent, les personnes qui louent ces logements sont peu fortunées. Or elles se retrouvent avec des notes de chauffage et parfois des charges plus importantes que le loyer !
Mme Valérie Létard opine.

L’amendement de M. Dantec a le mérite de lutter contre ce phénomène.
Dès lors que sa rédaction vient d’être rectifiée de manière à en conditionner l’application à la « mise à disposition des outils financiers adéquats », en quoi serait-il gênant que le Parlement le vote ?
Son adoption permettrait la mise aux normes des logements concernés et la création de nombreux emplois dans le secteur du bâtiment. Nous montrerions aussi que nous sommes à l’écoute de nos concitoyens, qui ont parfois des surprises terribles au bout de quelques mois, surtout dans les départements comme le mien, où l’hiver peut être assez froid. Au reste, le dispositif retient l’horizon de 2030 !
Je pense vraiment que l’on ne devrait pas perdre trop de temps sur de telles questions, d’autant que Ronan Dantec a accepté de rectifier son amendement. Votons-le pour faire disparaître les passoires énergétiques de nos centres-villes !

Je voudrais saluer l’effort des uns et des autres pour rechercher un consensus.
Cependant, nous sommes en train d’écrire la loi, or celle-ci est normative et non déclarative ; elle n’expose pas des intentions.
M. Ronan Dantec s’exclame.

Que veut dire sur le plan juridique cette notion de « calcul économique » ? Qui va l’apprécier ?

Laissez-moi m’exprimer ! Monsieur Dantec, nous vous avons écouté ! Ayez la gentillesse de respecter ceux qui tentent de comprendre !
De même, comment doit-on comprendre la notion de « réserve » dans la formulation « sous réserve de la mise à disposition d’outils financiers adéquats » ? Qui appréciera cette adéquation ? Je voudrais le savoir ! En effet, le Gouvernement va bien évidemment affirmer que ces outils financiers sont adéquats, tandis que ceux qui devront faire des travaux considéreront que ces moyens sont insuffisants !
(Sourires sur les travées de l'UMP.) Ce matin, nous ne parlons plus d’« horizon », mais de loi « déclarative », de « réserve », d’« intention »… J’entendais à l’instant notre excellent collègue Bourquin demander : « Qu’y a-t-il de gênant à voter cet amendement puisqu’on renvoie la question à 2030 ? »
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Hier, une nouvelle notion intéressante était apparue : « à l’horizon… ». §

C’est précisément parce qu’on renvoie à demain, parce qu’on n’a pas le courage de s’engager aujourd’hui, que je ne suis pas du tout d’accord avec cette façon d’écrire la loi. Vous m’excuserez de penser en juriste sur cette question, mais, encore une fois, la loi est normative, tandis que ce que nous sommes en train d’écrire n’est pas une loi, mais un salmigondis ! Nous essayons de nous donner bonne conscience à cet instant, …

M. Dominique de Legge. … laissant à nos successeurs le soin de régler demain les difficultés, comme l’a si bien dit tout à l’heure M. Dallier ! De grâce, revenons à l’essentiel et essayons d’écrire quelque chose de simple !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Si nous voulons atteindre les objectifs louables que nous nous fixons, nous devons faciliter les transactions. Or c’est là que se pose, à mes yeux, le principal problème : un certain nombre de propriétaires sont des personnes âgées, qui parfois vendent leur bien pour rejoindre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EPHAD. Aujourd'hui, lorsqu’on souhaite vendre un bien, on est obligé de faire procéder à un certain nombre de diagnostics concernant notamment la performance énergétique, les termites, le plomb et l’amiante.
Il faut mettre en place un système qui permette de contrôler et d’évaluer assez précisément les travaux à réaliser dans un bâtiment. Ainsi, au moment de la transaction, le vendeur ne sera pas obligé de faire les travaux, mais, au contraire, l’acheteur saura qu’il a l’obligation d’y procéder, en bénéficiant d’un système d’aide approprié et lisible. Une telle disposition faciliterait grandement les transactions et nous permettrait d’atteindre les objectifs que nous nous fixons.

Je m’exprimerai de manière très succincte. J’adhère tout à fait à ce qui a été exprimé à l’instant par mes collègues de l’Ille-et-Vilaine et du Lot. Cela étant, la rédaction du texte suscite l’incertitude et est trop vague. Selon moi, il n’est pas acceptable en l’état.
Comme Dominique de LeggeC’est d’autant plus vrai que vous précisez que ces travaux devront être réalisés à l’occasion d’une mutation ; par conséquent, la question se posera de savoir si c’est le vendeur ou l’acheteur qui doit les faire. En outre, ajouter « sous réserve de la mise à disposition d’outils financiers adéquats » ne fait qu’augmenter la confusion. En effet, on ne sait pas du tout de quels outils financiers il s’agira, et de toute façon, vous trouverez toujours un propriétaire ou un acheteur pour considérer que les outils financiers ne lui permettent pas, au vu de sa capacité financière, de réaliser des travaux. Du reste, la question la plus importante sera de savoir quel sera le retour sur investissement des travaux d’économie d’énergie réalisés, car ce retour pourra rendre ces travaux acceptables et supportables pour qui les aura payés.
Selon moi, la sagesse voudrait que l’on reporte cette question à plus tard et que l’on ne vote pas une telle disposition, qui, comme l’a dit Dominique de Legge, n’a pas de caractère normatif.

Quant à moi, je remarque qu’il y a en France quatre millions de ménages, soit huit millions de personnes, qui sont dans une situation de précarité énergétique. Il y a des millions de logements passoires. Des familles souffrent du froid.
Je me souviens d’une famille monoparentale : une femme célibataire vivant du RSA avec quatre enfants à charge…

Et le père, que fait-il ? À moins qu’il ne s’agisse d’une immaculée conception…

Cette femme dépensait des sommes folles pour chauffer l’appartement de sa famille.

Elle vivait, comme vous l’avez deviné, dans ce que l’on appelle un logement passoire, et le propriétaire persistait à ne pas vouloir réaliser de travaux de rénovation thermique !

M. Roland Courteau. Nous connaissons des centaines, des milliers de situations comme celle-ci. Faut-il continuer de ne rien faire face à ces situations-là ?
Mme Sophie Primas s’exclame.

M. Roland Courteau. Faut-il continuer de ne pas agir face à ces marchands de sommeil ? Les locataires continueront à payer, à dépenser des sommes folles, et à souffrir du froid !
Mme Sophie Primas s’exclame de nouveau.

(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.) Je pense là tout particulièrement aux locataires. Les gens doivent avoir droit à un logement décent. C’est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste ainsi que sur plusieurs travées du groupe CRC.

Pour moi, il est indécent, au XXIe siècle, de laisser les familles vivre dans des logements passoires ! §

Je m’exprimerai très rapidement pour dire que l’amendement rectifié de M. Dantec me convient parfaitement. En effet, il vise à prendre en compte un élément qui est au cœur de mes préoccupations : nous devons déterminer un objectif et l’accompagner des moyens pour les plus précaires.
Je vous rappelle une dernière fois qu’aujourd’hui, en ce qui concerne le programme « Habiter mieux », l’Anah, avec la dotation 2015, ne fait que payer les dossiers que l’on a réalisés, instruits et autorisés en 2014, mais que l’on n’a pas pu payer faute de moyens. Il est donc absolument nécessaire d’augmenter les moyens !
Nous examinerons des amendements défendus et votés en commission des affaires économiques sur les certificats d’économie d’énergie qui apporteront des ressources et qui sont essentiels. Nous ne pouvons pas nous donner des objectifs sans déterminer aussi des moyens !
Le présent amendement pourra certes être amélioré dans le cadre de la fin du travail parlementaire, mais il instaure la discussion et institue un préalable essentiel : nous devons nous donner des objectifs ambitieux, à condition de donner les moyens adéquats pour les plus précaires. Ces moyens existent : il faut les flécher et bien choisir les objectifs !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste, ainsi que sur les travées du groupe écologiste. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 719 rectifié ?

Cette nouvelle rédaction ne nous suffit pas. Aussi, je dépose un sous-amendement visant à ajouter les mots : « si le calcul économique le permet ».
La rédaction serait donc désormais la suivante : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, si le calcul économique le permet et sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. »
Cette rédaction répond beaucoup plus précisément à l’intervention de Mme Valérie Létard et a recueilli un avis favorable du Gouvernement. Je le répète, la rectification proposée par M. Dantec ne suffit pas, car cette rectification et le sous-amendement ont deux objets bien différents.
Dans ces conditions, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 719 rectifié.

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 963, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
performance énergétique,
Insérer les mots :
si le calcul économique le permet
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 963 et sur l’amendement n° 719 rectifié ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 719 rectifié sous-amendé par la commission. En effet, cette rédaction contraindra l’État à donner chaque année à l’Anah le budget dont elle a besoin…
Plusieurs sénateurs du groupe l'UMP sont dubitatifs et ironisent.
… pour permettre aux propriétaires de faire des travaux d’isolation avant 2030. Les propriétaires auront donc quinze ans pour les mener à bien. Cette disposition protège les propriétaires parce que cela valorise leurs habitations. De toute façon, un jour ou l’autre, il faudra que les bâtiments soient isolés pour que l’on puisse procéder à une mutation, comme c’est le cas dans la plupart des autres pays européens.

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 963.

Nous ne sommes pas favorables au sous-amendement défendu par la commission.

M. Didier Guillaume. Toutefois, si un consensus se dégage, nous nous y rallierons peut-être.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Nous y sommes opposés parce qu’il dénature l’objectif de l’amendement rectifié de M. Dantec.

Notre éminent collègue M. Philippe Dallier et M. Dominique de Legge ont parlé de lois déclaratives. Heureusement qu’il y a des lois déclaratives !

M. Didier Guillaume. Je prends des exemples de lois que vous avez vous-mêmes présentées. Sans la loi Chirac sur le handicap, le processus n’aurait pas été lancé ! Certes, on n’a pas réussi à tout faire
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Des déclarations sont nécessaires ! Aujourd'hui, gouverner, c’est prévoir, c’est annoncer de grandes orientations §et pas seulement dire que l’on va les mettre en œuvre à tel ou tel moment.
Quant à l’amendement tel qu’il était présenté, on verra bien où nous en serons en 2030 ! §Il ne faut pas rire de cela ! L’objectif n’est pas d’attendre 2030, mais de procéder à ces travaux dès à présent là où c’est possible.
M. Roland Courteau l’a excellemment démontré : aujourd'hui, il y a des gens dans la misère !

Ils vivent dans des logements indignes ! Il y a des marchands de sommeil ! Concernant l’isolation, il faut avancer. Un toit pour tous dans les meilleures conditions, c’est absolument indispensable !
Il est parfois nécessaire d’annoncer de grandes orientations politiques. Le Parlement comme le Gouvernement doivent impulser, fédérer, lancer de grandes orientations, alerter la population, interpeller nos concitoyens…

… pour leur dire que la situation est tellement grave que nous devons avancer dans cette direction ! Sans l’impulsion des gouvernements de droite comme de gauche et celle du Parlement, nous resterions souvent le pied à l’étrier : nous ne bougerions pas.
Nous savons que cet amendement est déclaratoire ! Nous revendiquons ce caractère déclaratoire de certaines lois, tandis que d’autres lois doivent être précises. Il faut impulser, aérer, indiquer le chemin ! C’était l’objet de cet amendement.
Il y a un accord entre le Gouvernement et la commission à propos de ce sous-amendement, soit ! Nous nous y rallierons. Cependant, la rédaction que propose la commission change partiellement le sens de l’amendement.

pour conserver une vraie déclaration d’intention qui incite un certain nombre de personnes et en particulier les marchands de sommeil à rénover les logements.
Si on ajoute le sous-amendement de la commission, nous entrons dans le détail d’un texte de loi qui concernerait 2030, alors que nous ne savons pas ce qui se passera à ce moment-là. Nous n’avons pas besoin de tant de précision ! Donnons des intentions fortes ! Parlons des familles comme celle qu’évoquait tout à l’heure notre éminent collègue M. Roland Courteau et que je ne connais pas. Des gens sont dans la misère ! Ils n’en peuvent plus ! Ils ont des factures énergétiques et des loyers qui absorbent tous leurs revenus et ils n’arrivent pas à faire manger leurs enfants ! §Soucions-nous de leur situation ! Adressons-nous aussi à ces gens-là !

Il est certain que si l’on prend en considération l’économie de chaque logement, nous n’y arriverons pas ! Mes chers collègues, quand nos offices municipaux ou départementaux et nos offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, font des logements sociaux, très peu nombreux sont les logements équilibrés financièrement. En général, ils sont équilibrés dans les grandes villes. En revanche, quand l’OPAC prend en charge le logement et la rénovation dans des villages de 500 ou 1 000 habitants, les équilibres économiques sont absents.
Cependant, notre rôle d’hommes est de parler à l’humain, de faire du logement, de rénover et d’isoler là où il n’est pas rentable de le faire ! C’est aussi le rôle du public de faire cela. Si on se préoccupait uniquement de rentabilité, on ne ferait plus de logements sociaux pour les personnes âgées en zone rurale. Or c’est précisément ce que nous voulons faire.

mais notre intention était plutôt de nous en tenir aux fondamentaux : l’amendement n° 719 de M. Dantec, rectifié par Mme Létard, qui fixait de grands objectifs. S’ils veulent évoluer, nous les suivrons.

M. Didier Guillaume. Quoi qu’il en soit, nous tenons à afficher des intentions fortes pour que la population les entende !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Je voudrais me féliciter de la qualité de nos débats : on s’écoute, on essaie d’avancer, de construire, de coconstruire… J’ai bien entendu l’ensemble des arguments, notamment ceux qui viennent d’être exposés par le sénateur Didier Guillaume. Au nom du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 963 et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 719 rectifié.

Il règne une certaine confusion ! La commission des affaires économiques a tenu compte des arguments avancés par Valérie Létard. Elle a proposé « si le calcul économique le permet », car c’est l’une des préoccupations qui ont été évoquées.
Nous avons entendu une autre préoccupation, la nécessité de mettre en œuvre des outils de financement, notamment de la part du Gouvernement.
Je voudrais faire observer à Didier Guillaume que « si le calcul économique le permet », c’est précisément la condition qui a été votée il y a une heure, à propos de la performance de 150 kilowattheures par mètre carré avec l’amendement n° 588 rectifié.

Nous avons repris les termes exacts qui ont été votés par l’ensemble du Sénat !

Je rappelle donc qu’il y a deux éléments à prendre en considération : d’abord, la situation économique des ménages, notamment des personnes âgées, et le calcul qui en découle ; ensuite, les outils à mettre en place pour favoriser le financement.
Les rédactions combinées de l’amendement n° 719 rectifié et du sous-amendement n° 963 permettent de couvrir l’ensemble des préoccupations qui ont été exprimées.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote, étant rappelé que nous sommes toujours sur le sous-amendement n° 963.

M. Jean Desessard. Certes, mais on prépare 2030, madame la présidente !
Sourires.

Je ne sais pas comment notre groupe va traduire l’avis de sagesse de Mme la ministre
Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.

Je ressens un léger décalage par rapport à la perception de cet amendement.

L’année 2030, ce n’est pas le début d’un cycle, c’est la fin d’un cycle ! Après tout ce qui a été dit sur les appartements passoires, sur la situation des personnes, sur la précarité énergétique, on ne va pas commencer la rénovation thermique en 2030 ! En 2030, on dira qu’il faut en finir ! C’est maintenant qu’il faut commencer, en mettant en place des mécanismes financiers pour aider les propriétaires et voir, le cas échéant, comment répartir les choses sur la durée entre le propriétaire et le locataire.
L’ensemble de ces mécanismes, c’est maintenant qu’il faut les mettre en application, c’est dès à présent qu’il faut lutter contre la précarité énergétique ! Donc, la rénovation thermique doit se mettre en place dès 2016, voire dès 2015 si l’on peut, mais on ne va pas attendre 2030 ! En effet, 2030, tout doit être terminé !
C'est la raison pour laquelle une mesure radicale sera prise pour obliger à agir celles et ceux qui n’auront rien fait avant 2030. Et nous choisissons de respecter les libertés plutôt que d’imposer les mêmes règles à tout le monde. Au lieu d’écrire qu’en 2030 tous les appartements et toutes les maisons devront être économes en énergie, nous proposons que la rénovation énergétique ait lieu « à l’occasion d’une mutation ».
C’est maintenant qu’il faut lutter : il ne faut pas attendre 2030, car il sera trop tard ! Si on attend 2030, c’est idiot, cela ne servira à rien et tout le bienfait de la rénovation thermique sera réduit à néant ! La date de 2030 doit concerner uniquement celles et ceux qui n’auront pas joué le jeu, celles et ceux qui n’auront manifesté aucune volonté d'agir !

D’ici à 2030, les gens ont le temps d’envisager la vente de leur maison ou de leur appartement, ils ont le temps de s’organiser sans devoir attendre la vente de leur bien pour engager la rénovation thermique.

Le sous-amendement du rapporteur est contradictoire avec le message politique très fort que nous sommes en train de faire passer.

En effet, il autorise le propriétaire, même après 2030, à faire lui-même son propre calcul – on ne dit même pas comment il le fera ! – pour justifier qu’il ne fait pas la rénovation énergétique. Ce que Mme Létard et moi-même proposons, c’est de mettre l’État devant ses responsabilités, précisément pour le forcer à mettre les moyens financiers à disposition des personnes concernées.
La proposition de la commission des affaires économiques est contradictoire avec la nôtre et elle complexifie énormément les choses. On ne sait plus ce qui emporte la décision – est-ce le décret, est-ce le calcul du propriétaire ? Si le sous-amendement de la commission est maintenu, nous ne pourrons que voter contre !

Je mets aux voix le sous-amendement n° 963.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 98 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je vais mettre aux voix l’amendement n° 719 rectifié.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Madame la présidente, je veux réagir à l’intervention de M. Desessard et attirer l’attention sur le fait que le Sénat a voté l’article 3 B.
J’en rappelle les termes : « Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique. »
Cela veut dire que tout le patrimoine privé doit avoir fait l’objet de cette rénovation énergétique avant 2030. Donc, cet amendement portant article additionnel et qui vise à préciser qu’à partir de 2030 les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique n’a pas de sens, puisque tout aura dû être fait avant 2030.

Il n’est ni en cohérence ni en concordance avec l’article 3 B.
Aussi, j’invite notre assemblée à rejeter l’amendement n° 719 rectifié, qui est en contradiction avec l’amendement précédent et redondant avec l’article 3 B. Le groupe écologiste, s’il est cohérent avec lui-même, devrait retirer son amendement.

Je mets aux voix l’amendement n° 719 rectifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que l’avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 99 :
Le Sénat a adopté. (
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 B.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à midi, est reprise à douze heures quinze.
Après l’article L. 123–5–1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123–5–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123–5–2. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
« 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
« 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
« 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
« La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant. »

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la question de l’isolation thermique des bâtiments couvre à elle seule l’ensemble des domaines visés par la transition énergétique : la sobriété, l’efficacité énergétique, la réduction du recours aux énergies fossiles et la croissance économique induite.
Pour cela, les dispositions législatives du titre II prévoient des actions pour accélérer le grand chantier de la rénovation et réduire la consommation énergétique des bâtiments, en priorité les logements construits entre 1948 et 1988, ceux dont les déperditions énergétiques sont les plus élevées.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communications’est saisie pour avis sur le titre II du texte. En effet, la généralisation de la rénovation énergétique des bâtiments et les contraintes qui s’y attachent posent des questions en matière de protection du patrimoine. Nous devons veiller à ce que les règles que nous allons adopter concernant la rénovation thermique des bâtiments ne soient pas un obstacle à la conservation et à la valorisation de notre patrimoine. Les professionnels de la protection du patrimoine ont d’ailleurs fait part à la plupart d’entre nous de leurs grandes inquiétudes à ce sujet.
Votre texte initial, madame la ministre, et les modifications que nos collègues députés y ont apportées n’avaient pas ignoré ces questions. Cependant, il nous a paru nécessaire d’aller un peu plus loin pour mieux affirmer que la protection du patrimoine qui fait l’objet d’une reconnaissance soit assurée.
Je voudrais également insister sur un point : certains d’entre vous connaissent déjà ma sensibilité pour les sujets qui concernent la ruralité. Ils ne seront donc pas surpris si je souligne que le patrimoine, hors des monuments, sites et zones reconnues, c’est aussi, tout simplement, le paysage ou l’architecture et l’organisation du bâti de nos villages. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP, intègrent d’ailleurs cette notion de patrimoine naturel et d’ensemble rural. C’est la raison pour laquelle il me semble indispensable que des dispositions soient prises pour éviter que les contraintes de la rénovation thermique des bâtiments ne se traduisent par des catastrophes esthétiques et patrimoniales.

Mme Marie-Pierre Monier. Bien sûr, on peut faire confiance aux maires et aux propriétaires, dont la grande majorité sera attentive à ne pas défigurer leur village ou dévaloriser leurs biens. Pour autant, il ne faudrait pas que, sous les contraintes de la loi et des exigences financières, certains se trouvent obligés de renoncer à l’esthétique et à l’harmonie du patrimoine local.
M. Gérard Longuet opine.

Voilà pourquoi, mes collègues du groupe socialiste et moi-même vous proposerons plusieurs amendements permettant, d’une part, de mieux assurer la protection du patrimoine protégé et, d’autre part, de prendre en considération le patrimoine local et rural, source majeure d’attractivité résidentielle et touristique.
Concernant le patrimoine protégé, pour l’examen du texte en commission, j’avais déposé un amendement à l’article 3 qui visait à assurer une protection architecturale de l’ensemble des bâtiments protégés, y compris dans les ZPPAUP ou les futures AVAP, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, ainsi que des bâtiments dont la construction est antérieure au 1er janvier 1948. La réécriture de l’ensemble de l’article 3 a fait « tomber » cet amendement.
Nous vous proposerons un nouvel amendement, reprenant les mêmes préoccupations, mais tenant compte de la nouvelle logique de l’article 3 qui repose maintenant sur des dérogations à la main de l’autorité compétente. Nous estimons qu’un certain nombre de secteurs doivent être d’office protégés, sans possibilité de dérogation.
Par ailleurs, comme je l’ai évoqué précédemment, nous proposerons plusieurs nouveaux amendements à l’article 5 et aux articles suivants permettant de protéger le patrimoine « ordinaire ».
L’isolation par l’extérieur d’un bâtiment ancien revient à gommer la spécificité de son architecture, en détruisant tout élément en relief des façades, et peut ainsi profondément transformer la perception de l’histoire et des diversités urbaines et régionales qui se sont exprimées par l’usage de styles différents.
Ainsi, il est primordial que les monuments historiques et autres bâtiments devant être protégés, mais aussi les bâtiments anciens ayant un caractère de patrimoine rural, ne soient pas contraints à une isolation énergétique par l’extérieur. Ils doivent faire l’objet de prescriptions dérogatoires ou, au cas par cas, de travaux d’isolation interne.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’isolation thermique, la maîtrise énergétique constituent les grands défis du XXIe siècle, j’en suis consciente. Conduire une politique ambitieuse dans ce sens ne saurait cependant, en aucun cas, nous dédouaner de l’obligation de préservation de notre patrimoine commun. Les monuments, les sites naturels ou bâtis exceptionnels et les ensembles architecturaux anciens sont nombreux en France et constituent un héritage irremplaçable, témoin des différentes cultures et identités de notre pays. Ne les détériorons pas de manière irrémédiable, même dans un objectif louable d’économie d’énergie. J’espère que, dans sa grande sagesse, le Sénat prévoira pour ce type de patrimoine des aménagements et dérogations légales, comme le prévoient nos amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons avec cet article 3, et nous y reviendrons avec l’article 5, la compatibilité entre les principes fixés en matière de transition énergétique et les nécessités du patrimoine.
Notre collègue vient de s’exprimer sur ce point et nous écouterons M. Leleux qui ira dans le même sens dans un instant. Pour ma part, je soulignerai simplement, mais avec une certaine solennité, madame la ministre, combien le patrimoine est un atout pour notre pays et combien il importe de le préserver ou, tout au moins, de trouver une conciliation préservant ce patrimoine dans le cadre des logiques défendues au titre de la transition énergétique.
Je limiterai mon propos à deux points. Le premier va dans le sens d’une recherche de cohérence, le second vise à souligner la confiance qu’il convient d’accorder à l’ensemble des élus et aux outils juridiques qui ont été constitués au fil du temps pour la préservation du patrimoine.
Premier élément donc : la cohérence.
Nous aurons en effet, madame la ministre, à gérer une sorte de compatibilité pour la période la plus proche entre trois textes : le projet de loi que vous défendez depuis quelques jours devant notre assemblée ; le projet de loi sur le patrimoine prévu par Mme la ministre de la culture, qui nous est parfois annoncé comme devant porter sur le patrimoine et l’architecture – plusieurs avant-projets ont circulé, nous aurons des dispositions strictement patrimoniales ; un texte consacré à la biodiversité, que vous portez également, madame la ministre, et dont certains éléments concernent la réforme de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Or, quand nous traitons du patrimoine bâti, nous sommes aussi, d’une certaine manière, sur le patrimoine naturel tant dans les logiques internationales – je ne reviens pas sur le Mémorandum de Vienne ou sur les recommandations données au titre de la Convention nationale du patrimoine de 2011 – nous raisonnons de plus en plus aujourd’hui sur la notion de paysage historique.
Vous le voyez, ce que nous adopterons en matière de transition énergétique doit être vraiment écrit, selon la formule classique, la main tremblante, afin de trouver la bonne cohérence avec les futures dispositions en matière de patrimoine.
Second élément : vous demander, madame la ministre, mes chers collègues, d’accorder vraiment toute notre confiance au travail des élus au service du patrimoine de notre pays. Nous avons au fil du temps, au cours des décennies, élaboré un certain nombre d’outils juridiques, que chacun connaît dans cette assemblée, qui se sont révélés pertinents pour la défense du patrimoine. Il convient absolument, dans le cadre des dispositions forcément générales de la transition énergétique, d’adopter des dispositions spécifiques permettant de préserver le patrimoine. Celui-ci ne peut, en effet, se plier à des règles générales, à des écritures, que ce soit en ce qui concerne l’isolation extérieure ou la possibilité d’avoir tel ou tel élément saillant sur le domaine public. Le patrimoine a sa subtilité, sa finesse, sa qualité. Il a fallu très longtemps pour le constituer, il pourrait être très vite déstabilisé si nous adoptions des modalités inadéquates.
Je n’en prendrai qu’un court exemple. J’ai eu l’honneur, pendant dix-neuf ans, de gérer une ville complètement rouge, rouge par ses façades constituées de brique…

Rose, si vous le souhaitez, monsieur Requier. Le cadre de cette ville, dont la cité épiscopale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, ne s’adapterait absolument pas aux règles d’isolation extérieure. Elle est non seulement rose ou rouge par ses façades de brique, mais elle l’est également par la cinquième dimension : les toitures, de tuiles canal, dites « romanes ». Si demain, y étaient intégrées des cellules photovoltaïques, seraient totalement changés le cadre, la couleur, l’esthétique et la logique patrimoniale, et, accessoirement, les éléments de la valeur universelle exceptionnelle au titre de laquelle la ville a été classée.
Cet exemple n’est, bien sûr, destiné qu’à souligner l’importance du patrimoine et de son adaptation et, donc, la confiance qui doit être accordée aux élus locaux.
Mon intervention vaut aussi, bien évidemment, explication de vote pour l’ensemble des amendements qui seront présentés dans la logique du travail réalisé par la commission de la culture ou des amendements déposés par M. Leleux et que j’ai cosignés.

Mes propos sur cet article 3 vont rejoindre ceux de Mme Monier et, bien sûr, ceux de M. Philippe Bonnecarrère.
Cet article 3, comme vous le savez, a trait à l’isolation thermique assurée essentiellement par des dispositifs extérieurs, dont la technologie ne cessera, à n’en pas douter, de s’améliorer, mais qui consiste à envelopper les bâtiments, à les emballer, en quelque sorte, dans des matériaux d’une épaisseur de dix à vingt centimètres.
La version initiale de cet article proposé par le Gouvernement, qui a été peu modifié par l’Assemblée nationale, visait à lever les freins à l’isolation par l’extérieur en interdisant à l’autorité compétente, c’est-à-dire aux maires ou aux présidents de la communauté responsable, de refuser un permis, même si celui-ci enfreignait les règles locales – PLU, POS, etc. – en matière d’emprise au sol par l’épaisseur des murs, de hauteur et d’aspect extérieur, voire d’esthétique, en cas d’une isolation en saillie ou en façade, ou par surélévation des toitures des constructions existantes.
Cet article, comme l’ont rappelé notre rapporteur dans son intervention générale ainsi que nos collègues à l’instant, a suscité une levée de boucliers dans les milieux professionnels ou politiques passionnés par la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine, grande richesse touristique et humaine de notre pays.
Cette crainte était légitime, car ne pouvant plus interdire des travaux réalisés avec ces matériaux isolants le maire perdait finalement la maîtrise sur son propre territoire. Une altération du bâti et une dégradation esthétique étaient à craindre, tant il est vrai que cette technique d’isolation extérieure suppose une destruction préalable des éléments de décor et de charpente préexistants. Une telle mesure non encadrée pouvait progressivement conduire à une forme d’altération de l’environnement de nos territoires.
Par une vision tout à fait intelligente et pertinente de notre rapporteur, le regard a été inversé : dans le texte qui nous est proposé, il n’est plus question d’interdire aux maires d’interdire ; il est question de les autoriser à autoriser !

C’est bien mieux, en effet, et je salue la lumière qui a présidé à la rédaction de cet article !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. C’est le Saint-Esprit qui m’est tombé dessus !
Sourires.
Nouveaux sourires.

Je salue cette évolution, mais, très franchement, je pense qu’il faut encadrer ce pouvoir dérogatoire des responsables, des autorités compétentes. J’ai quelques craintes sur la qualité des réalisations de ces isolations en saillie sur l’extérieur de façades situées dans les environnements qualitatifs de nos territoires. Puis, parfois, les maires subissent de fortes pressions de la part des maîtres d’œuvre et des fabricants pour utiliser ces techniques et ces matériaux dont la qualité et les prix vont forcément être à la baisse. La loi peut les aider à refuser certaines mesures.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons – nous sommes une vingtaine de sénateurs de gauche, du centre et de l’UMP – encadrer la possibilité pour l’autorité compétente de déroger, par l’exclusion d’un certain nombre d’espaces, notamment ceux qui sont protégés par des règlements, tels les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP ou les AVAP, la proximité d’éléments patrimoniaux importants et les bâtiments dont la construction est antérieure à 1948. Ainsi, on se concentrera sur l’isolation éventuelle par l’extérieur des immeubles dont la déperdition énergétique est beaucoup plus importante, ceux qui ont été construits dans les années 1950, 1960 et 1970. Il s’agit donc de proposer des exclusions au pouvoir dérogatoire de l’autorité compétente, quitte à demander, dans certains cas, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le permis de construire.

Après l’intervention de Jean-Pierre Leleux, je suis rassuré. Il aurait en effet été inacceptable de voir disparaître nos façades historiques, car elles ne sont pas toutes protégées.
L’histoire de France, aussi bien à Paris qu’en province, se lit sur nos façades. Imaginons un instant qu’il soit possible de procéder à une isolation extérieure des immeubles haussmanniens, cela aboutirait à nier l’identité de notre capitale. Comme l’a très justement indiqué Jean-Pierre Leleux, les détails doivent être protégés. Une façade de la révolution industrielle n’est pas une façade de la Restauration, qui elle-même n’est pas une façade de l’Ancien Régime. Il faut conserver cette diversité.
Les terroirs s’expriment également sur les façades. Les pierres ne sont pas les mêmes selon l’origine des carrières. Ceux qui investissent encore un peu d’argent, d’une façon totalement irrationnelle d’ailleurs, par sympathie, par intérêt ou par affection pour le patrimoine de leur pays, font appel aux ressources locales pour respecter la couleur des enduits et les matériaux utilisés à l’origine. En s’attachant à la tradition, ils évitent la banalisation et les innovations architecturales déconcertantes, lesquelles, avec le temps, deviennent parfois des manifestations de créativité, mais elles ne sont le plus souvent, d’abord et avant tout, que des incongruités.
Nos façades ont déjà connu des tragédies. L’impôt sur les portes et fenêtres au XIXe siècle a entraîné le massacre de nombreux bâtiments de la Renaissance, par exemple. La diminution du nombre de fenêtres, outils de mesure de richesse et du pouvoir d’achat de l’occupant, a rendu les logements obscurs.
Les pans de bois, la brique, le mariage de la brique et de la pierre, le chaînage, l’organisation des façades : tout cela doit être préservé, car cela constitue notre patrimoine. Quant aux constructions postérieures à 1948, il arrivera bien un moment où il faudra aussi les préserver. Si cette date paraissait récente au siècle dernier, elle deviendra bientôt une date historique – malheureusement, nous vieillissons tous…
Mes chers collègues, ne cédons pas à la facilité en instaurant l’obligation d’effectuer des travaux de rénovation dès lors que la consommation par mètre carré dépasse les 330 kilowattheures par an. La réduction de la consommation énergétique est un beau combat, mais il ne doit pas être mené au prix de travaux prohibitifs, au risque de décourager l’accès au logement, ou de solutions techniques médiocres, au risque de dégrader notre patrimoine. Dans les deux cas, nous ferions une mauvaise affaire. Les déperditions de chaleur sont certes regrettables, mais elles sont peut-être plus acceptables que la dégradation durable des façades de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Je ne peux que m’associer aux propos que viennent de tenir nos collègues.
Nous comprenons tous l’intérêt de l’isolation par l’extérieur : c’est un système pratique et efficace. Dans la plupart des cas, nous pourrons nous orienter vers cette technique. Toutefois, j’y insiste, ce qui fait la France, c’est la différence qui existe entre les constructions du Midi et celles que l’on trouve en Savoie, …

C’est la diversité des terroirs et de notre histoire qui rend la France attractive aux yeux de tous, en particulier des touristes.
Faire disparaître la beauté de ces constructions serait une profonde erreur. Voilà pourquoi il me paraît nécessaire de prévoir une protection. Évitons d’avoir demain un bâti standard et banalisé qui conduirait notre pays à ressembler à je ne sais trop quoi !

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 720, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone, du règlement national d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III du même article L. 123-1-5. » ;
3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Il n'est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables » ;
4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « deux alinéas précédents » est remplacée par les références : « troisième et cinquième alinéas ».
La parole est à M. Ronan Dantec.

La question soulevée est évidemment importante, comme en attestent les prises de parole.
Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de préserver la signature architecturale de nos régions.

Nous n’allons bien évidemment pas passer à la brique rouge dans le Finistère ! Reste que l’équilibre est difficile à trouver.
Parce qu’il nous semblait que les travaux de l’Assemblée nationale avaient permis d’aboutir à un équilibre intéressant, nous avons déposé un amendement visant à revenir à cette rédaction. Nous sommes toutefois ouverts à toute recherche de consensus et d’amélioration, car nous sommes ici pour cela.

L'amendement n° 502, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
du projet
par les mots :
architecturale du projet dans le bâti existant et
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Nous tenons à saluer les efforts de réécriture de l’article 3 de Ladislas Poniatowski. En effet, la rédaction de l’Assemblée nationale n’était pas satisfaisante en termes de respect du droit de l’urbanisme et des prescriptions des PLU en particulier. Les sénateurs de notre groupe ne sont pas favorables à l’instauration de dérogations automatiques aux règles d’urbanisme.
L’effort de rénovation thermique est louable et fondamental. Toutefois, il ne peut être accompli au détriment de la compétence des maires. C’est pourquoi il était important de redonner à ces élus la possibilité d’accorder des dérogations motivées en lieu et place des dérogations automatiques elles-mêmes assorties d’exceptions, afin de permettre une isolation des bâtiments par l’extérieur.
Le droit positif reconnaît que le permis de construire peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Nous souhaitons donc que l’article 3, qui reconnaît que la décision de dérogation motivée peut contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant, fasse référence à la bonne intégration architecturale du projet.

L'amendement n° 694 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Vogel et Mouiller, Mmes Canayer et Deromedi, MM. Gremillet, Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au présent article n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948, ni aux bâtiments bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou à ceux protégés en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 485 rectifié, présenté par MM. Leleux, Gilles, Commeinhes et Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi et Bonnecarrère, Mmes Mélot et Lopez et MM. Bouchet, Mouiller, Houel et Kennel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -5 -… - La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. »
La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Notre rapporteur, sollicité par une kyrielle de demandes de dérogation, aurait difficilement pu rédiger cet article autrement. Il est cependant souhaitable de prévoir des restrictions à la capacité dérogatoire pour certains espaces. Je pense aux secteurs sauvegardés, comme cela était d’ailleurs prévu dans le projet de loi initial – cela étant, je n’imagine pas qu’un maire puisse laisser faire n’importe quoi dans un secteur sauvegardé –, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, pour le temps qu’il leur reste à vivre, aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, qui ont, elles, vocation à perdurer et dans lesquelles l’architecte des Bâtiments de France peut intervenir, ou aux périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Le présent amendement tend donc à prévoir que la capacité dérogatoire de l’autorité compétente ne peut s’exercer dans ces espaces, déjà précisément délimités dans les plans locaux d’urbanisme. S’il était adopté, ce que je souhaite, je reviendrai tout à l’heure sur les périodes au cours desquelles la capacité dérogatoire de l’autorité compétence ne pourra pas s’exercer.

L'amendement n° 543, présenté par Mmes Monier, Blondin, Cartron, D. Michel et S. Robert, MM. Aubey, Boulard, F. Marc, Roux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente ne peut pas prendre de décision dérogatoire, en application des premier à cinquième alinéas, dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code, ni pour des travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. »
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.

Mon amendement va dans le même sens que celui de M. Leleux. Il a juste une portée moins grande, puisqu’il ne prend pas en compte les parcs naturels régionaux.

L'amendement n° 486 rectifié, présenté par MM. Leleux, Gilles, Commeinhes et Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi et Bonnecarrère, Mmes Mélot et Lopez et MM. Bouchet, Mouiller, Houel et Kennel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -5 - … - La capacité dérogatoire prévue à l'article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement est antérieure au 1er janvier 1948. »
La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Cet amendement tend à prévoir une date avant laquelle la capacité dérogatoire ne pourra s’exercer. Un tel dispositif n’est pas parfait, mais il aura au moins le mérite d’exister.
Il est vrai que le choix du 1er janvier 1948 peut surprendre. Si j’ai retenu cette date, c’est pour deux raisons : d’abord, parce qu’elle figure déjà dans le code de l’urbanisme, où elle marque une frontière entre deux façons d’envisager la construction ; ensuite, parce que j’ai relevé dans un grand nombre de documents que c’est à partir des années cinquante que la qualité énergétique des bâtiments s’est dégradée.
Certes, les bâtiments construits par nos anciens – Gérard Longuet a eu raison de rappeler que le temps passe et que nous prenons de l’âge… –, c’est-à-dire avant 1948, n’étaient pas parfaits, loin s’en faut, mais ils étaient faits de matériaux traditionnels sur lesquels une intervention n’améliorerait pas beaucoup les choses. Les performances énergétiques de ces bâtiments étaient alors bien meilleures que celles des constructions des années cinquante, soixante et soixante-dix. Ce n’est qu’après que l’on a pris conscience de la nécessité de faire des économies d’énergie.

L'amendement n° 487 rectifié, présenté par MM. Leleux, Gilles, Commeinhes et Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi et Bonnecarrère, Mmes Mélot et Lopez et MM. Bouchet, Mouiller, Houel et Kennel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -5-… La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »
La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où l’amendement n° 486 rectifié ne serait pas adopté. Il tend à effectuer une distinction entre les édifices construits en matériaux traditionnels et ceux construits en matériaux plus modernes, tel le béton, ce qui rendrait sa mise en œuvre plus difficile.

Par l’amendement n° 720, notre collègue Ronan Dantec souhaite revenir purement et simplement au texte de l’Assemblée nationale, qui prévoyait une dérogation automatique à certaines règles d’urbanisme pour permettre l’isolation extérieure des façades, l’isolation par surélévation des toitures et l’installation du dispositif de protection contre le rayonnement solaire.
Le dispositif de dérogation automatique a suscité de très nombreuses réactions de la part des élus et, surtout, des professionnels, qui nous ont rappelé qu’il existe plusieurs méthodes d’isolation en France. Au demeurant, comme plusieurs d’entre vous l’ont souligné, mes chers collègues, il convient de protéger le patrimoine architectural de nos régions. Il faut donc parfois choisir d’autres techniques que l’isolation par l’extérieur.
Voilà pourquoi la commission, au lieu de prévoir une dérogation automatique pour toute la France, a voulu laisser la liberté au maire de pouvoir déroger aux règles d’urbanisme.

En fonction de la particularité des bâtiments – la situation n’est pas la même lorsque tous les immeubles se touchent ou lorsqu’ils sont séparés les uns des autres –, le maire pourra donner son avis sur la solution la plus adaptée.
Monsieur Dantec, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement – je remarque que vous ne l’avez pas défendu de façon très virulente – et d’accepter la version de la commission, qui, je le rappelle, a été adoptée à l’unanimité.
L’amendement n° 502 vise à préciser que la décision de l’autorité compétente pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant. Cette précision est utile. C’est pourquoi la commission y est favorable.
Les autres amendements me gênent, y compris dans l’argumentation qui a été développée à leur appui.
Monsieur Leleux, vous estimez qu’il faut redonner du pouvoir aux maires. Mais, en réalité, vous vous méfiez d’eux, en refusant de leur laisser un trop large pouvoir de dérogation, notamment dans certains cas de figure bien précis. Ainsi, les auteurs des amendements n° 485 rectifié et 543, qui sont similaires, souhaiteraient notamment que le maire n’ait plus aucun pouvoir dans les zones comprenant des bâtiments classés ou protégés, dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Je pense, pour ma part, qu’il ne faut pas toucher au droit en vigueur. Dans ces zones, le maire ne peut pas faire n’importe quoi aujourd’hui : dans certains cas, il peut accorder des dérogations ; dans d’autres, il ne le peut pas, car il doit suivre l’avis d’un architecte des Bâtiments de France ou respecter les règles spécifiques applicables aux ZPPAUP et aux AVAP. Pourquoi se méfier ainsi des maires ? La réglementation actuelle ne me semble pas si mauvaise. Faisons donc confiance aux règles qui existent et ne soyons pas trop sévères ! Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 486 rectifié, j’ai bien entendu les arguments que vous avancez, mon cher collègue : vous proposez que l’autorité compétente ne puisse déroger aux règles du PLU pour permettre de réaliser l’isolation extérieure ou une isolation par surélévation pour les bâtiments achevés avant 1948. Je souhaite préciser que l’article 3 n’impose pas une obligation d’isolation par l’extérieur. Il permet seulement aux particuliers qui souhaiteraient isoler leur maison par cette technique de pouvoir le faire. En excluant tous les biens construits avant 1948, vous excluez aussi des bâtiments construits en béton avant cette date, pour lesquels une isolation par l’extérieur serait une solution appropriée, voire même, me semble-t-il, la seule qui existe.
J’ai fourni aux membres de la commission des affaires économiques la liste des bâtiments construits avant 1948 et leur état actuel. Il faut savoir que nombre d’entre eux sont de catégories F et G, c’est-à-dire des passoires énergétiques. Il faut donc absolument qu’ils puissent être isolés avec la meilleure technique possible. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 486 rectifié, de même que votre amendement de repli n° 487 rectifié.
Je ne peux que partager les prises de position que nous venons d’entendre sur la défense du patrimoine. Je tiens moi aussi tout particulièrement aux belles façades en pierre de taille de Charente, aux maisons à colombages du centre de Poitiers et au patrimoine rural des maisons du marais poitevin, pour lesquelles j’ai d’ailleurs élaboré une charte architecturale, en tant que présidente du parc naturel du marais poitevin. La diversité des régions et des terroirs est en effet très importante. C’est pourquoi il convient de mettre au point une rédaction équilibrée.
Mon souhait premier serait de revenir au texte de l’Assemblée nationale. Pour autant, je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendus : les dispositions du code de l’urbanisme, qui ne sont bien évidemment pas répétées dans un nouveau projet de loi, prévoient déjà que les ravalements sont soumis à déclaration préalable. Le maire peut s’y opposer en cas de modification de l’aspect extérieur des constructions et définir les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger. Il y va de même si l’aspect extérieur des bâtiments à modifier est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales.
J’ajoute que les ravalements, dans des secteurs identifiés par délibération de la commune ou de l’intercommunalité compétente, nécessitent, en secteur sauvegardé, aux abords de monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, un accord de l’architecte des Bâtiments de France.
J’entends souvent les maires et les propriétaires se plaindre des contraintes qui pèsent sur eux.
Ces contraintes sont en effet très nombreuses. Il faut donc trouver un juste équilibre entre la liberté des propriétaires de réaliser les travaux d’isolation – ces derniers n’ont de toute façon pas envie de détériorer la qualité architecturale de leurs maisons – et les raisons qui justifieraient d’interdire ces travaux.
Pour répondre à M. Longuet, je précise que les façades haussmanniennes sont particulièrement protégées et donc intouchables. En revanche, si la règle devait être étendue à la totalité de l’immeuble, elle empêcherait la rénovation et l’isolation des cours intérieures, qui sont de vraies passoires thermiques.
Quoi qu’il en soit, dans un esprit de compromis, le Gouvernement se rallie à la rédaction de la commission. J’accepte donc de ne pas revenir au texte de l’Assemblée nationale. Le travail de clarification qui a été réalisé, adopté à l’unanimité des membres de votre commission, permet d’apporter des garanties en matière de protection du patrimoine – ce sujet a été évoqué à juste titre sur toutes les travées de cette assemblée –, sans toutefois aller trop loin. En effet, on ne peut pas, d’un côté, voter comme à l’instant un objectif très ambitieux d’efficacité énergétique et, de l’autre, mettre des freins supplémentaires pour procéder aux travaux d’isolation.
J’ajoute que ces travaux sont réalisés sur l’initiative des propriétaires et qu’ils ne sont pas rendus obligatoires. Compte tenu des règles extrêmement contraignantes de protection du patrimoine qui existent déjà, notamment à travers le contrôle des architectes des Bâtiments de France, il convient de desserrer quelque peu l’étau qui restreint la liberté d’entreprendre ces travaux. Le texte adopté par la commission concrétise un équilibre, qui n’a pas été simple à trouver, mais qui me semble positif.

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 804, 2013-2014), dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est envoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires économiques et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.