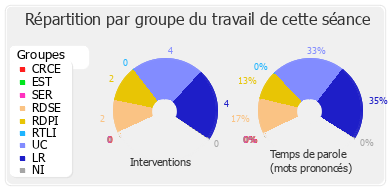Séance en hémicycle du 9 octobre 2007 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Communication d'un avis d'une assemblée territoriale
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
- Déclaration de l'urgence d'un projet de loi
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Accueil des enfants et adolescents handicapés lors des activités périscolaires et extrascolaires (voir le dossier)
- Structures d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées en île-de-france (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Georges Dagonia, qui fut sénateur de la Guadeloupe de 1977 à 1986.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l'assemblée de la Polynésie française par lettre en date du 26 septembre 2007, le rapport et l'avis de cette assemblée sur les projets de loi autorisant la ratification des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur et sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 22 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, le rapport sur l'emploi de la langue française.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires culturelles et sera disponible au bureau de la distribution.

Par lettre en date du 5 octobre 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

Monsieur le président, en ce qui concerne le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à l'asile, adopté lors de la précédente séance, les résultats du scrutin n° 8 sur l'amendement n° 203 de M. Jean-Jacques Hyest indiquent que je me suis abstenu, alors que je souhaitais voter contre. Par ailleurs, lors du vote sur l'ensemble du texte, j'ai été porté comme ayant voté pour, alors que je souhaitais m'abstenir.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, auteur de la question n° 15, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la sécurité générale dans Paris, mais concerne plus spécifiquement les lieux phares du VIIe arrondissement, dont je suis l'élu, et les problèmes qui en découlent.
Cet arrondissement compte un grand nombre de bâtiments officiels, comme l'hôtel Matignon, des ministères, des ambassades, et de nombreuses écoles, qui demandent une protection particulière, renforcée par le plan Vigipirate. Par conséquent, à la moindre manifestation - même si elle ne réunit que dix personnes -, un arsenal démesuré de protection est déployé. Pour ne prendre que l'exemple de l'Assemblée nationale, dès qu'une quinzaine de sans-papiers se rassemble place Aristide-Briand, dix cars de CRS sont mobilisés, soit pratiquement un car de CRS pour un manifestant !
Cet environnement lourd a des conséquences importantes pour la population : interdiction de stationner, mise en fourrière avec obligation de payer en liquide - usage surprenant, monsieur le secrétaire d'État ! - risques évidents, stationnement ininterrompu de véhicules de gendarmerie et de police, accès à certaines rues interdits. Il se dégage de ce déploiement de moyens l'impression d'être dans une situation de guerre permanente.
La mobilisation de nombreux militaires et fonctionnaires a un coût pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et donc pour l'État.
J'ai déjà interrogé M. le préfet de police à ce sujet, mais je demande aujourd'hui à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'il ne serait pas temps de reconsidérer cette question, de sortir de la paranoïa permanente qui règne dans cet arrondissement et de redéployer les moyens pour éviter cette lourde protection.
Je souhaite maintenant évoquer la situation particulière du Champ-de-Mars, lieu très convoité, où se déroulent de nombreuses manifestations nationales, sportives ou sociales, et sur lequel se trouve la tour Eiffel - dont je suis l'un des administrateurs -, qui exige des mesures spécifiques de sécurité. Ces problèmes de gestion de la sécurité du Champ-de-Mars sont représentatifs de ceux que connaît le VIIe arrondissement.
Depuis l'arrêté du 12 messidor an VIII, c'est-à-dire depuis deux siècles, le maire de Paris n'a aucun pouvoir de police. C'est la préfecture de police, et donc l'État, qui a entière compétence en ce domaine. Nombre de mes collègues ne le savaient pas jusqu'à ce que je présente l'année dernière un amendement à ce sujet. De nombreuses propositions de loi ont déjà été déposées pour remédier à cette situation et je soumettrai moi-même prochainement une proposition de loi relative à la suppression du régime d'exception en vigueur à Paris pour les pouvoirs de police.
Dans le VIIe arrondissement, qui correspond à une ville comme Colmar ou Cannes, le Champ-de-Mars est devenu un lieu d'insécurité. Je n'arrive pas à obtenir les chiffres de la préfecture de police, mais il semblerait que plus de 80 % des délits de cet arrondissement aient lieu dans cet endroit.
Je n'insiste pas sur les désagréments engendrés par la présence de 10 000 étudiants qui viennent fêter leur examen au mois de juin - l'alcool, les bouteilles cassées... - et sur le coût pour la ville de Paris. Mais il existe un véritable problème d'incivilité. Hier encore, une directrice d'école m'avouait être très inquiète, car des équipes de dealers viennent solliciter les enfants.
Les riverains du Champ-de-Mars très mobilisés ont fait signer une pétition par plusieurs milliers d'habitants pour que cet espace redevienne un lieu de vie agréable et qu'il retrouve sa quiétude, sa sécurité et son rayonnement. Je sais que le commissariat de police, qui a bien conscience du problème, et la préfecture de police déploient d'importants moyens. Mais il est nécessaire que Mme la ministre de l'intérieur se saisisse du problème. C'est la raison pour laquelle je pose cette question devant le Sénat, qui représente les collectivités territoriales de la République.

La parole est à M. le secrétaire d'État, que nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois au Sénat et à qui nous souhaitons la bienvenue.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui inaugure actuellement le MILIPOL, le salon mondial de la sécurité intérieure des États, et a le regret de ne pouvoir répondre en personne à votre question. Cela me donne en revanche le plaisir de vous transmettre sa réponse, d'autant que, comme vous l'avez rappelé, mon administration est concernée.
Il est vrai que vous connaissez parfaitement ces questions de sécurité et les difficultés qu'elles entraînent, notamment pour la vie quotidienne des habitants de cet arrondissement qui vous tient à coeur. Vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, le VIIe arrondissement de Paris regroupe de nombreux ministères et ambassades. Depuis 2002, les conditions de protection des points sensibles ont été redéfinies et le nombre des gardes statiques est en forte diminution. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de privilégier les gardes dites « dynamiques ».
C'est dans cette optique que l'unité mobile d'intervention et de protection, l'UMIP, a été créée sur l'initiative du préfet de police. Cette unité privilégie notamment l'emprunt d'itinéraires aléatoires, le recueil d'informations stratégiques auprès des services de sécurité présents sur les sites protégés et la mobilisation rapide de forces de renfort. Vous aviez d'ailleurs contribué à cette avancée, monsieur le sénateur.
Cette redéfinition des conditions de protection des points sensibles a permis une rationalisation des effectifs. Il serait toutefois difficile, sans affecter la sécurité de ces différents sites, de diminuer beaucoup plus encore le nombre des gardes statiques dans cette zone sensible, en particulier dans le contexte du plan Vigipirate.
Par ailleurs, et vous avez eu raison d'insister sur ce point, monsieur le sénateur, la mise en place des barrièrages est essentielle lors des fréquentes manifestations revendicatives ou des rassemblements spontanés. Leur absence pourrait affecter la sécurité de certains édifices, en particulier dans le VIIe arrondissement. Toutefois - et c'est essentiel -, les forces de l'ordre ont reçu l'instruction d'ôter rapidement ces barrières à l'issue de chaque manifestation afin de limiter au mieux la gêne occasionnée aux riverains.
Enfin, comme vous le savez, monsieur le sénateur, le maire de Paris est seul habilité à gérer le Champ-de-Mars, espace municipal. Aussi, la préfecture de police ne peut en aucun cas délivrer d'autorisation pour l'organisation d'événements sans un accord explicite du maire de Paris, qui doit ici assumer ses responsabilités. Lorsque des manifestations à caractère revendicatif sont organisées à Paris, sur le Champ-de-Mars ou dans un autre quartier, la préfecture de police est informée par simple déclaration et elle informe alors systématiquement la mairie de Paris.
Tels sont les éléments que je suis en mesure de vous apporter sur cette question, monsieur le sénateur.

Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse concernant la lourdeur des dispositifs de sécurité autour des établissements officiels. Je le remercie également d'avoir apporté des précisions sur le problème des barrières, car c'est une question que je pose depuis longtemps et que j'ai soumise à de nombreuses reprises au préfet de police.
Quant aux problèmes spécifiques au Champ-de-Mars, je sais que la préfecture de police comme le commissariat de police du VIIe arrondissement y sont très sensibles et accomplissent des efforts importants. Mais peut-être faudrait revoir si le dispositif en place est suffisant, car il s'agit d'un espace difficile à gérer. Alors que les élus du VIIe arrondissement s'efforcent de limiter la fréquentation du Champ-de-Mars, le maire de Paris a tendance à multiplier les événements festifs, dont les conséquences sont très gênantes pour les riverains.

La parole est à M. Bernard Murat, auteur de la question n° 4, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le secrétaire d'État, nous allons passer du Champ-de-Mars à la Corrèze et à la Haute-Loire. Nous abordons des problèmes qui touchent nos territoires ruraux.

Absolument, mon cher collègue !
Le problème de la défense incendie est récurrent. J'interviens régulièrement sur ce dossier depuis 2004.
Des projets de réforme des règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales, visant notamment à l'abrogation de tous les anciens textes, dont la circulaire du 10 décembre 1951, sont toujours en cours d'élaboration, malgré les efforts fournis.
Un groupe de travail technique, mis en place sous l'égide de la Direction de la défense et de la sécurité civile, a ainsi été constitué, afin de définir les axes d'une réforme selon une nouvelle méthode de la défense incendie appuyée sur l'analyse des risques. La définition de nouvelles règles a donc été décidée à trois échelons : au plan national, un décret sera pris ; au niveau départemental, un règlement de la défense incendie en liaison avec l'organisation du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, sera élaboré et, au niveau communal ou intercommunal, un schéma de la défense incendie sera établi.
Comme vous le savez certainement, monsieur le secrétaire d'État, cette question me tient particulièrement à coeur et c'est à plusieurs reprises que je suis intervenu au cours de la précédente législature sur ce dossier. Il m'a ainsi été annoncé, au mois de mars dernier, que la rédaction d'un décret en Conseil d'État ainsi que d'un guide méthodologique devant préciser et éclaircir les responsabilités et rôles respectifs des communes, des intercommunalités et du SDIS était achevée. Ces deux documents devaient être soumis à l'avis des acteurs concernés, dont l'Association des maires de France, afin que l'ensemble du dispositif nouveau puisse être prêt pour la fin de l'année. Pourriez-vous m'informer de l'état d'avancement de ces documents, afin que tous les élus concernés au sein du Parlement puissent donner leur avis ?
Cette réforme est attendue par de nombreux élus locaux, par les services d'incendie et de secours et par les services chargés de l'instruction des permis de construire. Je me permets donc de vous demander, monsieur le secrétaire d'État, si elle interviendra bien dans les délais prévus.
Monsieur le sénateur, comme je le disais à l'instant, Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales m'a chargé de vous demander de bien vouloir excuser son absence ; elle représente ce matin le Gouvernement lors de l'inauguration du salon international de la police et de la sécurité. Aussi m'a-t-elle chargé de vous transmettre sa réponse.
Connaissant, monsieur le sénateur, la particulière attention que vous portez à ce dossier important pour le développement du monde rural - dossier qui me tient aussi à coeur puisque nous avons un point en commun, à savoir le Massif Central -, je vais m'efforcer d'être le plus précis possible, d'autant que vous êtes sans doute l'un des meilleurs experts de cette question. Votre connaissance en matière de réglementation relative à la défense incendie sera très précieuse. Votre avis sera important pour le Gouvernement afin qu'il puisse mener l'action la plus équilibrée possible, eu égard aux réalités du terrain, que vous connaissez parfaitement.
Comme vous le savez, le Gouvernement s'est engagé en 2004, lors de la discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, à réformer les règles devenues obsolètes.
Il s'agit, en l'espèce, de revoir, avec le plus grand pragmatisme, l'organisation de l'approvisionnement en eau des communes au profit des services d'incendie et de secours. Vous avez raison de souligner à quel point il s'agit d'un enjeu important pour les communes rurales. La défense incendie est un élément indispensable lors de l'examen des permis de construire.
Il s'agit là d'une réforme complexe, mise en oeuvre pour la troisième fois en trente ans, les deux précédentes tentatives n'ayant pas abouti. Ainsi, pour la mener à bien, méthode et concertation seront indispensables.
Le projet de réforme de la réglementation incendie prévoit donc la définition de règles à trois échelons totalement complémentaires.
Premièrement, au niveau national sera élaboré un décret fixant les grands principes - recours à la pluralité des approvisionnements, évaluation des besoins fondée sur l'analyse des risques, notamment -, complété par un arrêté interministériel.
Deuxièmement, au niveau départemental, un règlement sera établi en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours. Il s'appuiera sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques pour déterminer la réponse à apporter aux besoins en eau d'extinction, notamment. La réalité des ressources en eau mobilisables - alimentation par canalisations, réserves, points d'eau naturels - sera désormais mieux prise en compte.
Enfin, troisièmement, au niveau communal ou intercommunal, un schéma de défense incendie permettra aux maires, à tous les élus locaux, de connaître les risques couverts par la défense incendie existante et les modalités nouvelles à mettre en place, en particulier pour le développement de l'urbanisation locale ou, tout simplement, pour l'extension des communes.
Ainsi, pour répondre concrètement à votre question, monsieur le sénateur, je peux vous annoncer que les textes nationaux vont être soumis dans le courant de ce mois à l'avis de tous les acteurs concernés, c'est-à-dire non seulement l'Association des maires de France ainsi que les autres départements ministériels concernés, mais aussi la Fédération nationale des collectivités concédantes, les régies et la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Lors de cette phase de concertation, votre avis sera plus que précieux.
Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble de ce dispositif puisse être prêt d'ici à la fin de l'année 2007. Vous avez raison, monsieur le sénateur, il est urgent de clarifier les règles pour les élus locaux.
Le Gouvernement entend bien privilégier une concertation approfondie, notamment en lien avec vous, et rechercher l'adhésion de l'ensemble des différents acteurs concernés.

Je me félicite de la réponse que vous venez de m'apporter, monsieur le secrétaire d'État. Votre sensibilité d'élu du Massif Central vous a certainement fait comprendre l'importance de ce dossier qui comporte deux éléments essentiels selon moi.
D'une part, dans toutes les communes de France, la qualité de la défense incendie doit être la même que dans n'importe quelle grande ville.
D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise veut s'installer dans une zone d'activité située sur le territoire d'une petite commune rurale, les réglementations, voire les déréglementations actuelles, induisent de tels coûts que la commune ne peut pas financer les infrastructures adéquates. De ce fait, l'entrepreneur porte son choix sur des communes, voire des villes plus importantes où il n'est pas confronté à ce problème.
Pour les élus que sont les sénateurs, cette réforme très importante concerne l'aménagement du territoire. Voilà pourquoi je plaide ce dossier depuis un certain nombre d'années. Je suis très heureux d'apprendre qu'il sera réglé à la fin de cette année.

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 24, transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

J'avais fait parvenir ma question au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique parce que je voulais surtout insister sur un problème budgétaire. Mais je suis ravi que M. Bussereau, qui connaît bien ce problème, m'apporte une réponse.
Il est urgent et très important de faire le point sur le coût du maintien des prédateurs, qu'il s'agisse des loups dans les massifs alpins et au-delà, des ours dans les Pyrénées ou des lynx dans les montagnes, voire les petites montagnes.
L'actualité le réclame plus que jamais puisque, vous le savez, encore tout récemment, un troupeau de plus de quatre cents moutons a péri en Savoie en se jetant dans un ravin, effrayé par les loups.
La première attaque vient également d'avoir lieu dans mon département, le Jura, provoquant la mort de vingt-trois agneaux, car la progression des loups s'étend bien au-delà du massif alpin.
Monsieur le secrétaire d'État, vous connaissez les dégâts catastrophiques dont ces prédateurs sont la cause et qui suscitent le découragement, l'incompréhension et le désarroi de tous les éleveurs ovins.
Actuellement, mon collègue M. Fortassin et moi-même sommes chargés, par la commission des affaires économiques, d'établir un rapport sur les élevages ovins. À la faveur des déplacements que nous effectuons dans toutes les régions de France concernées par la production ovine, je prends conscience des problèmes immenses posés par lesdits prédateurs. Il me paraît donc particulièrement urgent de faire le point sur les deniers publics utilisés pour l'introduction ou le maintien de ces animaux dans les zones montagneuses en ce qui concerne les agents de l'administration, l'indemnisation, la prévention, les mesures de protection.
Alors que l'élevage ovin est souvent le dernier rempart avant la friche, il contribue, de surcroît, à éviter les feux dans les alpages, l'herbe étant broutée. Ce problème est particulièrement sensible dans les régions méditerranéennes. Au cours de l'un de nos déplacements, dans les Alpes-Maritimes, nous avons pu constater la détresse des éleveurs qui, de plus, ont dû gérer l'absence de pluie pendant cinq mois cette année. Nous avons apprécié l'ampleur des difficultés. Dans d'autres massifs, l'élevage tend à éviter les avalanches. Par ailleurs, sa pratique permet de maintenir une population en milieu rural.
Les dépenses engagées pour introduire ou pour maintenir les prédateurs doivent être connues de tous, au moment où des économies doivent être réalisées sur tous les budgets. Je souhaiterais pouvoir inclure ces données dans le rapport que je suis en train d'établir. C'est pourquoi je demande officiellement que soit effectué un point exact de la situation financière, afin que nos concitoyens soient informés en toute transparence. Comme vous pouvez le penser, nous sommes très fréquemment interpellés au cours des déplacements que nous effectuons.
Je souhaiterais que le point soit fait par espèce, à savoir l'ours dans les Pyrénées, le loup dans les Alpes et au-delà, puis le lynx, et que la nature des dépenses soit indiquée.
Je voudrais également connaître précisément le nombre d'agents affectés dans les différentes administrations concernées par ce sujet, qu'il s'agisse des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les DDA, des directions régionales de l'environnement, les DIREN, des parcs nationaux et régionaux, voire de nombreuses associations. Il est important que la transparence soit faite sur ce sujet.
Il faut opérer un choix entre les prédateurs et les ovins. De jeunes agricultrices qui s'étaient lancés dans la production ovine ont versé des larmes après que leur troupeau eut subi plusieurs attaques. Parler de désarroi est bien mesuré pour de nombreux éleveurs !
Monsieur le sénateur, votre question, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a été transmise au ministre chargé de l'écologie. Toutefois, ayant été ministre de l'agriculture et secrétaire d'État au budget, j'ai quelques idées en la matière. Au nom de Jean-Louis Borloo, dont je vous demande d'excuser l'absence, je vais essayer de vous répondre.
Les grands carnivores présents en France - loup, ours, lynx, cette dernière espèce étant bien connue dans votre région - sont des espèces protégées par des dispositions internationales, notamment la convention de Berne, par une directive communautaire et par des dispositions nationales, plus particulièrement le code de l'environnement. Ils représentent une part non négligeable de la biodiversité, sujet abordé dans le cadre des travaux du « Grenelle de l'environnement ».
La protection instaurée vise à la conservation de ces espèces, voire à leur restauration. C'est en particulier le cas de l'ours qui, au fil des années, avait disparu des montagnes pyrénéennes.
Assurer la protection de ces espèces répond aux obligations internationales de la France et à ses engagements en faveur de la protection de la biodiversité.
En raison des impacts de la présence des grands prédateurs sur les activités humaines, en particulier sur l'élevage ovin, dont vous avez rappelé l'importance dans les zones de montagne et de moyenne montagne, les gouvernements successifs ont mis en place des mesures d'accompagnement du dispositif de protection pour soutenir les activités humaines.
A ainsi été mis en place un suivi efficace des populations animales. Les données recueillies sont communiquées aux autorités françaises et européennes.
Un soutien aux élevages confrontés à la prédation de ces animaux a également été instauré. En outre, notons l'animation pastorale et le soutien au gardiennage. Au-delà de la protection des troupeaux, les aides au pastoralisme permettent de maintenir le pâturage sur certains secteurs qui risqueraient, sinon, d'être abandonnés.
L'indemnisation des prédations permet une juste compensation des dégâts subis par les éleveurs. Cet aspect comprend le volet strictement monétaire, sans ignorer la nécessité de compenser le traumatisme que peut représenter pour un berger la perte d'un animal, de plusieurs, voire de la totalité de son troupeau.
Des opérations d'information et de communication à propos de ces espèces sont menées auprès des publics concernés et des actions partenariales de développement sont conduites avec les collectivités locales. Ces mesures peuvent avoir des conséquences favorables sur l'emploi local.
Le coût de l'ensemble de ces mesures a représenté environ 6, 3 millions d'euros en 2006. Pardonnez-moi de citer cette référence un peu lointaine !
La dépense occasionnée dans les Pyrénées représente près de 30 % du budget et, dans l'arc alpin, près de 70 %.
Par catégorie de dépenses, le suivi des espèces représente environ 11 % de la dépense, l'aide au pastoralisme 70 %, l'indemnisation des dégâts 13 %, et les actions d'informations et de développement local 6 %.
À la lumière de ces chiffres, c'est donc plus de 75 % du budget qui est consacré au soutien et au développement des activités humaines en présence des grands carnivores.
La mise en oeuvre de ces actions nécessite l'intervention de différents services de l'État - le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministère de l'agriculture et de la pêche - ainsi que de ses établissements publics, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les parcs nationaux, ces derniers en leur qualité de gestionnaires d'espaces protégés. Certains parcs naturels régionaux ont pu également s'impliquer dans les démarches d'accompagnement des activités en présence de loups.
Le nombre d'agents affectés aux missions d'animation et d'appui technique à la protection des troupeaux dans les services du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, ainsi que dans leurs établissements publics, est d'environ quarante sur l'ensemble de l'aire de répartition des trois espèces, 75 % des effectifs étant mobilisés dans les Alpes.
D'un point de vue comptable, il faut considérer que les données en termes d'effectifs mobilisés ne relèvent pas seulement de la stricte conservation des espèces mais, de surcroît, s'inscrivent dans une perspective plus large de développement durable et de soutien aux activités humaines prenant en compte la protection de la nature.
Monsieur le président, j'ai entre les mains un tableau récapitulatif relatif au coût de la conservation des grands carnivores en France, dont je souhaite qu'il figure sous cette forme dans le compte rendu intégral des débats.
Ce tableau synthétique fournit les crédits consacrés à ces activités pour l'année 2006, en fonction de l'espèce concernée et de la catégorie de dépenses.
Ours
Loup
Lynx
TOTAL
Suivi de l'espèce
Soutien au pastoralisme
Indemnisation des dégâts
Action d'information et activités partenariales
TOTAL
Ce tableau fait aussi état des effectifs mobilisés (ETP/équivalent temps plein) pour la conduite de ces actions par espèce.
Administrations de l'État (ministères de l'écologie et de l'agriculture)
Établissements publics (ONCFS/parcs nationaux)
Ours
Loup/lynx
dont 8 techniciens pastoraux

Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse précise. Nous autres, élus, sommes beaucoup interrogés sur ce sujet, et l'on nous demande de fournir des chiffres.
Ces questions seront certainement soulevées lors de la discussion budgétaire, dans des prochaines semaines, soit avec le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, soit avec le ministre de l'agriculture et de la pêche. Il est indispensable de rassurer les membres de la filière ovine, qui s'inquiètent de la propagation de la fièvre catarrhale. Au cours des dix dernières années, cette filière a déjà perdu 20 000 éleveurs et un million de brebis ; ce mouvement va s'accélérer si aucun signe fort dans le sens de la limitation des prédateurs ne lui est adressé.
Ma question, outre son aspect financier, avait pour objet de sensibiliser les autres élus sur le fait qu'« il y a quelque chose à faire », pour reprendre une formule d'une émission de téléréalité bien connue !

La parole est à M. Louis Souvet, en remplacement de M. Michel Doublet, auteur de la question n° 3, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Monsieur le président, M. Michel Doublet, étant souffrant, m'a prié de présenter sa question, C'est avec plaisir et conviction que j'accède à sa demande.
Aux termes de l'article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques, a été créé un crédit d'impôt en faveur de la récupération des eaux pluviales.
Un premier arrêté interministériel, en date du 4 mai dernier, est venu préciser les caractéristiques techniques des équipements de récupération des eaux pluviales ouvrant droit au crédit d'impôt, limité au 31 décembre 2009. Cet arrêté concerne uniquement l'utilisation de l'eau de pluie pour des usages extérieurs à l'habitation.
En revanche, un second arrêté, actuellement en cours de rédaction avec le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, portant sur les conditions d'usage de l'eau de pluie dans les bâtiments raccordés au réseau public de distribution d'eau potable, est fort inquiétant.
Autant l'arrêté précédent, portant sur l'utilisation de l'eau de pluie pour des usages extérieurs à l'habitation, semble facilement applicable et correspond bien à une attente sociale, autant le second apparaît comme étant susceptible d'entraîner de nombreuses difficultés pour les temps à venir.
Le risque sanitaire est très important, autant pour le propriétaire que pour le gestionnaire du service d'eau potable. Malgré les nombreuses prescriptions prévues, il existera toujours des risques sur l'origine de l'eau et sur le renvoi d'eau pluviale dans le réseau public. A minima, il serait souhaitable que le dispositif de déconnexion des deux réseaux soit mieux précisé dans le texte.
Il conviendrait également qu'il soit rappelé clairement, dans ce projet de décret, que les eaux usées domestiques rejetées dans le réseau d'assainissement feront partie de l'assiette de calcul de la redevance d'assainissement, et cela, même si le code général des collectivités territoriales le précise.
Enfin, la mission de contrôle du système de récupération des eaux pluviales pour un usage à l'intérieur de l'habitation exigera du service une compétence technique, et un temps passé important eu égard à la configuration des habitations.
Il s'ensuivra également une responsabilité pour le personnel d'intervention, sous l'autorité du maire.
Les inquiétudes suscitées par la récupération des eaux de pluie se trouvent malheureusement justifiées par le phénomène de la multiplication des forages privés constaté depuis quelques années.
Ces forages privés ne font pas l'objet de la déclaration réglementaire en mairie et sont à l'origine de contaminations du réseau public. En outre, les volumes ainsi utilisés échappent à la redevance d'assainissement des collectivités territoriales et des agences de l'eau.
Comment, alors, ne pas s'interroger sur l'intérêt économique pour un propriétaire de réaliser et d'entretenir un système de récupération des eaux de pluie pour un usage limité aux installations sanitaires, comparativement à une utilisation du réseau public ?
Du point de vue du service public d'eau potable, les volumes d'eau de pluie pouvant être récupérés pour l'alimentation des installations sanitaires représentent environ 30 % du volume consommé par un foyer domestique. Cela peut déséquilibrer gravement le budget de ces mêmes services, en entraînant une augmentation de la redevance pour la totalité des autres consommateurs.
Monsieur le secrétaire d'État, quel est votre sentiment sur l'utilité de la mise en place d'un dispositif administratif et juridique complexe ? Pouvez-vous nous apporter l'assurance que le texte sera complété et précisé sur les points évoqués précédemment ?
Monsieur le sénateur, je sais que M. Doublet souffre d'un lumbago et qu'il ne peut être aujourd'hui à Paris. Je vous remercie d'avoir bien voulu être son porte-parole vis-à-vis de M. Jean-Louis Borloo, dont je vous prie d'excuser l'absence.
M. Doublet est depuis longtemps un spécialiste de toutes les questions relatives à l'eau, au plan local comme au plan national.
Vous avez bien voulu m'interroger sur la suite que je souhaite donner à l'ouverture apportée par le crédit d'impôt sur les équipements de récupération d'eau de pluie en soulignant les risques sanitaires liés.
La période de validité du crédit d'impôt étant limitée au 31 décembre 2009, un premier arrêté a été pris le 4 mai 2007 afin de ne pas pénaliser les contribuables. Il se rapporte au seul crédit d'impôt pour des équipements de collecte des eaux de pluie pour un usage strictement extérieur.
Un second texte est en cours de rédaction avec le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. II précisera les usages acceptables et donc autorisés de l'eau de pluie dans l'habitation et modifiera le premier arrêté concernant le crédit d'impôt, selon les usages qui pourront être acceptés. Il sera proposé pour les immeubles d'habitation d'ouvrir l'utilisation aux toilettes et au nettoyage des sols.
Le Conseil supérieur d'hygiène public de France, par un avis de septembre 2006, a préconisé d'interdire l'utilisation de l'eau de pluie pour le lavage du linge. L'utilisation d'eau non potable sera interdite dans un certain nombre d'immeubles autres que les habitations, les hôpitaux et les crèches, notamment.
L'utilisation de l'eau de pluie par les industriels devrait être soumise à une instruction individuelle. Les utilisateurs auront l'obligation de se déclarer à la mairie, qui diffusera l'information auprès des services d'eau et d'assainissement.
Grâce à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a été introduite une possibilité pour les services d'eau potable de procéder à des contrôles des installations intérieures des utilisateurs de ressources alternatives.
Les connexions physiques entre réseaux de distribution d'eau de pluie et réseaux de distribution d'eau potable seront interdites, à l'exception de la surverse du réseau de distribution d'eau potable vers celui d'eau de pluie. C'est le système bien connu de la chasse d'eau.
Quant au prix de l'eau, il est nécessaire de rester vigilant, de façon à ne pas rompre la solidarité entre chacun afin que les plus faibles, les moins fortunés, puissent profiter du même service public, dans des conditions socialement acceptables.
Il est déjà prévu dans la réglementation la possibilité de percevoir la redevance d'assainissement sur les volumes transitant dans le réseau de collecte des eaux usées. Un compteur qui totalisera l'eau de pluie utilisée dans les toilettes sera obligatoirement installé.
Le projet de texte sur l'utilisation de l'eau de pluie dans les immeubles - utiliser l'eau de pluie est à la mode ! - devrait être proposé au Comité national de l'eau à l'automne.
Toutes ces précautions permettront de rendre compatibles, d'une part, un bon usage de l'eau de pluie, d'autre part, le respect des règles d'hygiène et la protection des consommateurs, y compris dans les établissements les plus exposés.

Au nom de M. Doublet, je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État.
Le risque d'intrusion de l'eau de pluie dans le réseau communal n'est pas nul.
Ainsi, en ma qualité de président d'une communauté d'agglomération de 140 000 habitants, dotée d'installations de grande ampleur pour la distribution de l'eau, et de maire d'une commune de 30 000 habitants, j'ai eu à déplorer un regrettable incident : une vanne ayant été entrouverte, l'eau de pluie avec laquelle était arrosé un terrain de football - cela partait du louable souci de la récupérer - a pénétré dans le réseau d'eau potable et l'a contaminé.
Il faut donc être très prudent en ce domaine.

La parole est à M. Louis Souvet, auteur de la question n° 22, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Il faut que les nouveaux ministres s'habituent à venir devant le Sénat : si nous pouvons comprendre qu'un ministre d'État soit pris par ses fonctions ce matin, les secrétaires d'État doivent être là !
Applaudissements

J'aurais été ravi d'avoir en face de moi M. Borloo, mais mon plaisir n'est pas moins grand de retrouver M. Bussereau, que nous connaissons bien.
Mon intervention ne se situera ni dans le registre du classique « tout sauf dans mon jardin », ni dans le style « oui aux énergies renouvelables, mais pas question de côtoyer un parc éolien ! » J'en passe et des meilleures. J'ai, moi-même, à gérer ce réflexe.
Je me bornerai à évoquer la conciliation de deux soucis d'intérêt général, d'une part, celui de l'amélioration des corridors de transport au sein de l'espace national et communautaire par la mise à deux fois trois voies, alors qu'il était à deux voies, d'un tronçon autoroutier, d'autre part, celui de la qualité des loisirs pratiqués sur une base nautique, et autour d'elle, ou sur un complexe sportif, via la mise en place des protections phoniques adéquates.
Le problème est général, car l'accroissement du volume de la circulation entraînera à n'en pas douter, au plan national, des mutations similaires. L'occasion nous est donc donnée, à travers un cas concret, non pas de modifier de fond en comble les règles, mais de les améliorer et de les actualiser.
Pour l'heure, seules sont concernées par la protection de dispositifs phoniques les zones d'habitat ; paradoxalement, les utilisateurs d'un camping, d'une zone de loisirs ou d'un plan d'eau, qui, par définition, viennent chercher un calme relatif et un repos réparateur, ne le sont pas.
Il serait logique de considérer le reformatage des équipements autoroutiers comme de nouvelles réalisations longeant les points d'eau et les zones de loisirs. Il serait normal d'assigner à ces nouvelles réalisations des cahiers des charges en adéquation avec le volume de décibels modélisé ou le volume constaté aux abords d'infrastructures similaires tant par la taille des voies autoroutières que par leur proximité des zones de loisirs.
On me rétorquera que les futurs progrès technologiques peuvent laisser espérer une réduction des bruits des moteurs, mais il convient de souligner, reprenant en cela les conclusions de la mission « bruit » du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qu'au-delà de cinquante ou soixante kilomètres à l'heure, donc a fortiori sur une autoroute, c'est le bruit de contact des pneus sur la chaussée qui domine.
Une autre objection doit être ici réfutée ou, au moins, discutée : les revêtements routiers et autoroutiers font l'objet de recherches constantes de la part des sociétés mettant au point les enrobés, mais se posera toujours la question de la tenue dans le temps des couches de roulement.
Monsieur le secrétaire d'État, sera-t-il procédé à un alignement de la protection phonique des usagers des campings, des plans d'eau et des zones de loisirs avec celle des populations riveraines d'une nouvelle infrastructure, les normes existantes étant respectivement de 60 décibels de jour et de 55 décibels de nuit ? Dans la mesure où l'isolation phonique créée par un mur antibruit représente un gain d'environ 25 décibels, des normes spécifiques plus contraignantes pourraient même être envisagées puisque, selon la direction générale de la santé, un niveau de bruit de 55 décibels en zone résidentielle et en extérieur constitue une gêne sérieuse le jour et en soirée.
Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue Nathalie Kosciusko-Morizet, qui m'a demandé de répondre en son nom à votre question dont elle a pris connaissance avec grand intérêt. Il s'agit, en quelque sorte, d'un remplacement mutuel, puisque, la semaine dernière, c'est elle qui a bien voulu me remplacer alors que je participais au conseil des ministres européens des transports à Luxembourg !
La politique conduite en France pour limiter les nuisances sonores provoquées par les infrastructures de transports, notamment terrestres, s'articule autour de quatre lignes directrices : le classement des voies bruyantes et la définition des secteurs où l'isolation des locaux doit être renforcée ; la prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification des infrastructures de transport ; le traitement des situations critiques ou « points noirs » ; plus globalement, l'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement.
Au titre de la lutte contre les nuisances sonores, le droit actuel impose ainsi aux lotisseurs et aux constructeurs de bâtiments de prévoir les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores, en application du principe d'antériorité. Cependant, lorsqu'il s'agit de créer ou de modifier de manière significative certaines infrastructures, il convient d'assurer la protection des bâtiments existants contre le bruit de la circulation.
Aux termes d'un décret du 9 janvier 1995, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructures est tenu de « prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées [...] à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés. » Ce texte prévoit également de fixer des limites nationales, que la contribution sonore des nouveaux projets ne saurait dépasser, mais une telle disposition ne s'applique qu'aux seuls bâtiments. Ainsi, les limites en vigueur pour les habitations situées aux abords d'un projet d'autoroute sont fixées par un arrêté du 5 mai 1995.
Si le droit fixe donc une obligation de résultat au maître d'ouvrage, c'est à lui de mettre en oeuvre librement les mesures pour le respecter, en concertation avec les populations concernées. Dans ce cadre, il peut retenir des objectifs opérationnels plus exigeants que la contrainte réglementaire et rechercher, ce qui est souvent le cas, des participations financières auprès des demandeurs ou des collectivités intéressées.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte des dispositions en vigueur au titre de l'évaluation, de la prévention et de la réduction du bruit. Les grandes infrastructures de transports et les principales agglomérations font l'objet de nouvelles obligations, en application des articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement, à la suite de la transposition de la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. À cet égard, des « zones calmes » peuvent être définies, notamment en agglomération, pour les « espaces extérieurs remarquables » ou pour ceux dont la « faible exposition au bruit » doit être préservée.
Par conséquent, il existe bien deux régimes juridiques distincts en la matière. Naturellement, le problème du bruit est au coeur des débats actuellement menés dans le cadre du « Grenelle de l'environnement », aussi bien au sein des groupes de travail mis en place sur le plan national que dans les forums régionaux et sur Internet. Nul doute que ces travaux déboucheront sur un certain nombre de dispositions nouvelles.
En tout état de cause, monsieur le sénateur, je ne manquerai pas d'attirer l'attention de ma collègue Nathalie Kosciusko-Morizet sur la situation précise des espaces extérieurs que vous avez évoquée ce matin, car les deux niveaux de réponse juridique méritent vraisemblablement d'être précisés à cet égard.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de la réponse que vous avez bien voulu m'apporter.
J'ai voulu profiter de la tenue du « Grenelle de l'environnement » pour attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre de nouvelles mesures en faveur de ces zones de calme, sur lesquelles les personnes viennent se reposer, voire, pour certaines d'entre elles, se ressourcer. À l'évidence, l'élargissement d'une autoroute de deux à trois voies, même si les usagers respectent les limitations prévues, rend tout de même la circulation plus dense, plus rapide et plus bruyante.
En la matière, il est donc nécessaire de contraindre les gestionnaires des autoroutes à prendre certaines dispositions alors qu'actuellement ils se contentent de n'assurer la protection que des zones habitées.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 6, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Ma question, qui s'adresse en réalité à Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, porte sur le droit d'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.
Trois situations doivent être distinguées dans le code de l'urbanisme : soit il s'agit de bâtiments destinés à l'agriculture, et ils sont classés en zone A selon les termes de l'article R. 123-7 ; soit il s'agit de bâtiments agricoles, qui, compte tenu de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent changer de destination, et ils sont zonés à cette fin selon l'article L. 123-3-1 ; soit, enfin, il s'agit de bâtiments qui se trouvent dans une zone naturelle à protéger, et ils sont classés en zone N selon l'article R. 123-8.
En revanche, rien n'est prévu pour les constructions existantes qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou qui ne sont pas situées dans une zone naturelle à protéger. Dans mon département de la Drôme, des milliers de logements sont ainsi concernés et se retrouvent alors, par défaut, classés en zone A, alors qu'ils n'ont aucun lien avec l'agriculture et que la rigueur du règlement des zones A ne permet aucune extension ni aménagement, les figeant ainsi en l'état.
Pour éviter de telles situations, les communes ayant lancé des révisions de leur document d'urbanisme ont procédé à cette occasion à « un pastillage », ou « microzonage », en zone N de chaque construction concernée, la réglementation applicable étant alors plus souple. Le tribunal administratif de Grenoble, ayant eu à apprécier la validité d'un PLU, un plan local d'urbanisme, de ce type, l'a considéré comme illégal en raison des microzones N insérées.
Face à ce risque avéré, les services de l'État refusent désormais tout microzonage au sein des PLU, ce qui place les élus locaux dans une grande difficulté, pour ne pas dire une impasse. Le vide juridique actuel, qui conduit à nier l'existence de milliers de logements, risque, par exemple, de conduire à la non-déclaration de travaux, rendant la gestion de ces dossiers encore plus difficile et plus conflictuelle pour les élus.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir m'indiquer les mesures précises que le Gouvernement entend rapidement faire adopter pour combler cette lacune juridique et pour permettre une évolution raisonnable et maîtrisée des constructions existantes concernées.
Monsieur Piras, je me permets de répondre à votre question au nom de Jean-Louis Borloo, car elle intéresse non seulement le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mais aussi le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, bien connues de tous les maires, limitent les constructions pouvant être autorisées sur des terrains agricoles, ce qui a conduit le Gouvernement à s'interroger sur la façon de traiter, dans les documents d'urbanisme, un certain nombre de constructions existantes dans les secteurs agricoles et, notamment, dans les parcelles non agricoles situées au milieu de terres cultivées. C'est pourquoi un décret du 27 mars 2001 n'interdit pas les aménagements sur les constructions existantes, sans toutefois les autoriser de manière générale dans les zones A, ce qui aurait conduit à les autoriser dans des zones beaucoup plus vastes sans qu'aucune limite ni précision quant à leur lieu d'implantation ne soit apportée.
Le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret précité, a prévu que les plans locaux d'urbanisme pouvaient instituer des zones naturelles sur lesquelles des constructions non agricoles étaient autorisées. Néanmoins, vous vous en doutez, le texte encadre strictement la création de ces zones, qui doivent être « de taille et de capacité d'accueil limitées » et ne porter atteinte « ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » Cette disposition du code de l'urbanisme autorise ainsi la création de « microzones N » au sein de zones A, par nature plus vastes.
Vous l'avez évoqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme illégale la création de microzones N au sein de zones agricoles, indépendamment de toute référence à l'intérêt esthétique des sites ou à l'intérêt architectural ou patrimonial de tel ou tel bâtiment agricole. Le contentieux est en cours. Pour l'instant, la cour administrative d'appel de Lyon est saisie ; l'affaire sera peut-être portée devant le Conseil d'État. Il n'y a donc pas de jurisprudence définitive en la matière.
Monsieur le sénateur, tant que la justice n'a pas tranché, le Gouvernement réitère sa position initiale, en affirmant la légalité des microzones N situées au sein d'une zone A. Telle est d'ailleurs la position défendue par les pouvoirs publics devant la cour administrative d'appel de Lyon. En l'état actuel, c'est donc la lecture par le Gouvernement du décret qui a force de loi. Si la cour administrative d'appel, voire le Conseil d'État en dernier ressort, statue différemment, nous serions amenés à étudier les moyens de faire évoluer les dispositions de ce décret.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de la clarté de votre réponse sur une question complexe. Il serait souhaitable, afin d'éviter tout blocage dans la mise en oeuvre des PLU, que le ministère puisse donner aux DDE, les directions départementales de l'équipement, des instructions précises pour qu'elles ne refusent plus de classer des parcelles en zone N. En l'attente d'une jurisprudence sur le sujet, nous sommes contraints d'en rester au statu quo actuel et la situation risque d'être toujours aussi bloquée pendant un an, deux ans, voire trois ans.

Les DDE devraient être effectivement plus attentives aux remarques des parlementaires.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 30, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d'État, en décembre dernier, au moment de sa prise de fonctions en tant que nouveau directeur de la branche fret de la SNCF, M. Marembaud annonçait le lancement du programme « Rendez le sourire à nos clients ».
Malheureusement, aujourd'hui, les chargeurs que j'ai rencontrés auraient plutôt tendance à « rire jaune ». Les PME se sentent particulièrement visées par cette décision, dont la mise en place est prévue au 30 novembre prochain. « Ce gouvernement déclare qu'il veut aider les PME, mais qui va subir la disparition des wagons isolés, si ce ne sont les PME elles- mêmes ? », me confiait l'un des professionnels concernés installé sur notre commune.
En mai dernier, une entreprise de logistique, Geodis, appartenant au groupe SNCF et installée à Saint-Pierre-des-Corps, a fait refaire son embranchement. Son client a négocié des tarifs avec la SNCF à partir de l'Allemagne, pour que son fournisseur l'approvisionne. Or il n'y a que quelques jours qu'il a appris la fermeture de la gare de triage. Le choix du client était pourtant clair, celui du transport écologiquement correct.
Monsieur le secrétaire d'État, l'heure est grave : cette affaire ne peut être traitée à la légère, car c'est la vie de nos entreprises qui est en jeu.
Je partage l'indignation des clients de la SNCF ainsi concernés. Vous pouvez le constater comme moi, au regard de la carte de restructuration du fret, seule la grande région Est, où sont concentrées les industries importantes, serait préservée. Dans le grand Ouest, c'est le grand vide, là même où l'économie repose sur le dynamisme des petites et moyennes entreprises. Avant d'avoir à déplorer la désindustrialisation de notre région, il serait bon de préserver les principales dessertes ferroviaires. C'est ce que je vous demande, au nom des chefs d'entreprises concernés.
La colère gronde chez les salariés, les chargeurs, mais aussi parmi les citoyens, et vous ne pouvez l'ignorer. Aussi la demande d'un moratoire me semble absolument justifiée. J'espère que vous y répondrez favorablement.
La gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps pourrait devenir le grand hub manquant sur ce territoire, car c'est un point stratégique pour les grandes circulations nord-sud, ainsi que sur l'axe ouest-est. Elle soulagerait également la région parisienne, fortement encombrée par la densité du trafic de marchandises et de voyageurs.
Cette gare peut devenir, avec le projet de nouvelle autoroute ferroviaire, en doublement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, le site complémentaire permettant de désengorger l'autoroute A10, qui est proche de la saturation.
Avec le plan Véron, 1 500 000 camions ont été transférés sur les routes entre 2004 et 2006. La disparition de 262 gares, dont 60 gares dans la seule région Centre, ferait basculer sur notre seul département d'Indre-et-Loire 26 000 camions supplémentaires. Dire, comme j'ai pu l'entendre, que le wagon isolé ne représenterait pas grand-chose, est un non-sens : ce sont des centaines d'entreprises et des milliers de salariés qui sont concernés. Sur tout le grand Ouest, des milliers d'habitants subiraient l'augmentation des nuisances autoroutières.
Monsieur le secrétaire d'État, vous savez que les difficultés rencontrées par le fret résultent, pour une bonne part, du mauvais état de nos infrastructures, et vous connaissez comme moi les résultats de l'audit réalisé, l'an dernier, par un cabinet suisse. C'est bien dans le sens de la rénovation des lignes qu'il faut oeuvrer si l'on veut que l'outil ferroviaire soit adapté et réponde aux besoins de nos entreprises et de notre économie.
Comment accepter qu'une telle mesure de fermeture massive soit prise sans attendre les propositions du Grenelle de l'environnement dans le domaine des transports ? Comment comprendre une telle décision alors que le Président de la République s'est lui-même engagé à ce que le fret non routier augmente de 25 % en cinq ans ?
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, d'intervenir auprès de la SNCF pour qu'elle revoie sa copie dans l'intérêt de notre développement économique régional, et de décider la mise en place d'un moratoire afin que nous puissions engager les discussions sur les réponses à apporter aux entreprises.
Vous avez eu raison, madame le sénateur, de rappeler l'engagement pris par le Président de la République. Nous souhaitons en effet la mise en place d'une meilleure intermodalité, ou comodalité, dans les années à venir, avec l'objectif très précis d'une augmentation de 25 % du fret non routier.
Le report du fret routier doit bénéficier à d'autres modes de transport, en l'occurrence le transport maritime, c'est-à-dire les autoroutes de la mer, le transport fluvial, là où c'est possible, et le transport ferroviaire.
Or nous nous heurtons à une grave difficulté depuis quelques années, difficulté qui n'est pas liée qu'aux infrastructures : la mauvaise situation de notre fret ferroviaire.
En Europe, dans tous les pays qui nous entourent, le fret ferroviaire gagne actuellement des parts de marché : en Grande-Bretagne, dont on s'est beaucoup moqué après la réforme rapide et brutale de ce secteur entreprise par Mme Thatcher, mais aussi en Espagne et en Allemagne. En France, en revanche, il perd des parts de marché depuis des années, quels que soient les gouvernements et les ministres en place. Même ceux qui annonçaient la réalisation de grands objectifs, comme M. Gayssot, n'ont pu les tenir.
M. René-Pierre Signé proteste.
Le secteur étant libéralisé depuis 2006, la SNCF se trouve en concurrence avec d'autres groupes, en l'occurrence cinq opérateurs privés. Vous connaissez bien ce sujet en tant que maire de Saint-Pierre-des-Corps, madame le sénateur.
La SNCF continue d'assurer 95 % environ du trafic ferroviaire, même si les opérateurs privés - dont certains partent de Marseille pour relier les grands ports, n'est-ce pas, monsieur le président !- jouent un rôle de plus en plus important.
Par ailleurs, parmi les 262 gares appelées à fermer, et dont un grand nombre se trouvent en région Centre, mais aussi dans ma région Poitou-Charentes, voisine de la vôtre, certaines n'accueillaient plus le moindre trafic depuis longtemps. Il faut le dire, même si cela ne justifie pas tout ! On ne peut pas demander à la SNCF de continuer à tracter des wagons à perte !
Je comprends très bien que la SCNF considère, comme la Deutsche Bundesbahn, que le transport ferroviaire, qui, selon le mot célèbre de Louis Armand, « s'il survit au vingtième siècle, sera le mode de transport du vingt et-unième siècle », convient surtout au trafic massifié.
Le trafic du port de Hambourg, par exemple, est assuré aujourd'hui à 50 % par le trafic ferroviaire, ce qui en fait le port européen dont le développement est le plus fort, avant ceux du range nord, Anvers et Rotterdam, alors qu'au Havre, ce trafic est d'à peine 10 %.
Il s'agit d'un problème de fonctionnement global de notre système ferroviaire. Les grandes compagnies ferroviaires doivent se regrouper et s'organiser sur le trafic massifié. Les Allemands commencent à envoyer des trains en Russie ou en Chine - ce mode de transport étant plus rapide que le fret maritime -, car ils comprennent l'intérêt de la longue distance.
J'en viens au problème des wagons isolés.
Deux cas peuvent se présenter : soit la SNCF trouve des solutions alternatives, au cas par cas, lorsque surviennent des difficultés telles que celles que vous avez citées à propos de Saint-Pierre-des-Corps, et nous l'encourageons en ce sens ; soit nous mettons en place, comme cela vient d'être fait de manière expérimentale dans votre région - j'ai signé récemment un protocole de partenariat à Orléans, le 26 septembre 2007 -, des opérateurs ferroviaires de proximité. Ces opérateurs de proximité peuvent être soit une organisation spécifique de la SNCF ou de l'une de ses filiales, soit d'un opérateur autonome, une entreprise, une chambre de commerce, un port, un établissement public de l'État ou bien encore des coopératives agricoles qui, rencontrant un problème d'acheminement, décident de se regrouper.
En Allemagne, si la Deutsche Bundesbahn réussit à assurer un trafic d'une telle densité, c'est grâce aux 300 opérateurs locaux de proximité qui l'aident à assurer cette mission.
Si, aux États-Unis, le trafic ferroviaire, qui s'était effondré, est redevenu aujourd'hui le premier mode de transport sur le continent nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, c'est grâce à l'existence, à côté des grandes compagnies ferroviaires, de short lines, de petits opérateurs regroupés qui assurent le trafic local.
Je suis donc favorable à la création d'opérateurs ferroviaires de proximité, comme celui que vous avez mis en place dans la région Centre, madame le sénateur, principalement tourné vers le trafic céréalier et engagé par les coopératives agricoles.
Il n'y a pas de raison que ne soit pas mis en place un tel opérateur local sur un site de fret ferroviaire historiquement aussi important que celui de Saint-Pierre-des-Corps, en collaboration avec la chambre de commerce, mais également d'autres acteurs, comme la municipalité, comme la communauté d'agglomération du Grand Tours. Cet opérateur assurera le trafic de proximité, les grands opérateurs massifiant ensuite le trafic, ce qui fera gagner des parts de marché.
Je préfère un wagon non siglé SNCF sur le rail qu'un camion, même appartenant à une filiale de la SNCF, sur les routes. C'est dans ce sens que nous souhaitons mener cette réforme.

J'ai bien entendu vos propos, monsieur le secrétaire d'État, mais je souhaite vous répondre sur plusieurs points.
Premièrement, l'opérateur Proxirail, qui doit être mis en place à Orléans, ne sera opérationnel que dans le cours du premier trimestre 2008. Or il existe une date butoir, la SNCF ayant prévenu qu'elle arrêtait le trafic de proximité le 30 novembre 2007. Il y a donc un problème ! C'est pour cette raison, et afin de pouvoir travailler sur ces questions, que je vous demande de lancer un moratoire.
Deuxièmement, vous avez dit que les opérateurs locaux de proximité étaient destinés aux petites distances. Or, dans les exemples que j'ai pris, les wagons isolés ne servent pas à assurer le trafic sur de petites distances !
Ainsi, le groupe Geodis, qui assure essentiellement, vous le savez, des activités de fret par camion, devait permettre d'utiliser la pleine capacité du groupe ferroviaire en remettant en service une complémentarité rail-route en association avec un fournisseur allemand : on devait donc travailler avec deux réseaux ferrés à l'intérieur de l'Europe. Ce dispositif est désormais rendu caduc par la décision de suppression du triage à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ces décisions sont incompréhensibles, et la mise en place d'un opérateur de proximité ne constitue en aucun cas une réponse appropriée.
Je rappelle par ailleurs que, si le trafic ferroviaire s'est amélioré en Grande-Bretagne, c'est parce que ce pays a décidé d'augmenter les crédits destinés à la remise en état des infrastructures, qui en avaient bien besoin.
Dans un article paru dans Les Échos à la suite de l'inaugurationde Proxirail, on a pu lire : « La montée en puissance de Proxirail va néanmoins nécessiter la remise à niveau de l'infrastructure ferroviaire. Hubert Dumesnil a reconnu hier que, sur les 600 kilomètres de voies dédiés au fret dans la région, une partie est menacée en raison de leur dégradation ».
La mise en place d'un opérateur de proximité ne résout donc en rien la question posée. Il s'agit surtout, pour le moment, de préparer le retrait de la SNCF de l'activité de fret, alors que l'on sait très bien que c'est elle qui va fournir l'ensemble de la logistique nécessaire au démarrage de Proxirail, tant en personnel qu'en matériel.
On assiste donc au démantèlement de la SNCF en termes d'outils de transport ferroviaire, sans qu'aucune réponse soit apportée aux entreprises de notre grande région. On s'aperçoit même, en regardant les cartes, que la solution du rail a été complètement exclue de cette région.
Je tiens, tout d'abord, à préciser à Mme Beaufils que le projet Proxirail comprend également la rénovation des infrastructures puisque le contrat de plan signé entre l'État et la région Centre concerne des engagements qui doivent être tenus dès l'année prochaine. Nous allons consacrer des moyens financiers importants à la rénovation d'un certain nombre de lignes dans les étoiles ferroviaires de Blois, Tours et Orléans, afin de les adapter au trafic de fret. Vous savez comme moi, madame le sénateur, en tant qu'ancien membre du conseil d'administration de la SNCF, que les contraintes de sécurité ne sont pas les mêmes sur les voies dédiées au fret et sur celles réservées au trafic voyageurs.
S'agissant ensuite de l'affaire entre la SNCF et Geodis, j'ai envie de dire, si vous me le permettez : que les entreprises la règlent entre elles ! Geodis étant une filiale de la SNCF, elles doivent être capables de se parler. Je rappelle que le directeur général de Geodis siège au sein du comité exécutif de la SNCF, sous la présidence de Mme Idrac.
J'en viens enfin à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. La région Centre électrifie, avec le concours de l'État, la voie reliant Saint-Pierre-des-Corps et Vierzon. Ainsi la totalité de l'axe est-ouest sera-t-il électrifié.
Comme je l'ai indiqué lors du Grenelle de l'environnement, je suis partisan de la construction, en plus de l'autoroute ferroviaire qui passera à Saint-Pierre-des-Corps dans le sens nord-sud, en utilisant la voie actuelle Paris-Bordeaux, d'une autre autoroute ferroviaire dans le sens ouest-est, reliant les ports de Nantes et Saint-Nazaire à la région lyonnaise en transitant par Saint-Pierre-des-Corps.
Cette étoile d'autoroutes ferroviaires sera tout à fait utile pour le développement du triage et des installations ferroviaires de votre ville, madame le sénateur.

La parole est à M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 32, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, lors d'un déplacement récent dans le département de la Dordogne, vous avez annoncé un plan tendant à consacrer 8 millions d'euros aux différents acteurs de cette production.
Réparti entre les différentes catégories de professionnels et considéré à l'échelle nationale, où l'on dénombre des milliers d'ateliers, ce plan s'avère, de l'avis même des professionnels, très insuffisant.
Les entreprises d'intégration que vous avez visitées, comme Sobeval, connaissent des pertes sévères et les éleveurs sont pénalisés en retour. Face à cette situation, il est unanimement admis que le compte n'y est pas.
Le cercle vicieux est connu : un aliment laitier plus cher, un coût de production majoré, des prix de vente peu flexibles du fait des pressions de la grande distribution, et donc des pertes pour les industries et pour les éleveurs, qui sont, en quelque sorte, leurs employés.
Il en est ainsi de la vie d'une entreprise. Mais le problème est que la répartition des pertes de la filière menace aujourd'hui des centaines d'exploitations agricoles et, à terme, notre capacité à produire.
On nous dira que la solution technologique au problème alimentaire est en gestation avec la création de nouveaux produits pour l'engraissement des veaux, mais toutes les techniques actuelles demeurent imparfaites, et donc non généralisables pour l'instant.
Captifs du système productif, les éleveurs des filières intégrées pâtissent en dernière instance de cette situation, tout à la fois victimes d'une rétractation de la production et d'une élévation concomitante du coût des emprunts réalisés pour la mise aux normes des bâtiments d'élevage.
Le découragement est grand parmi les éleveurs auxquels on a demandé d'investir il y a quelques années et qui voient désormais leurs charges s'alourdir tandis que les prix chutent. La situation exige donc une action forte des pouvoirs publics.
Faudra-t-il attendre que s'installe la pénurie, comme dans le cas des céréales ou du lait, avant que l'on songe à préserver notre capacité de production ?
Monsieur le ministre, je vous demande donc quelles dispositions vous comptez prendre afin de permettre à cette communauté agricole de reprendre confiance en elle.
Monsieur Cazeau, votre question me donne l'occasion de confirmer un certain nombre de mesures annoncées lors de ma visite dans votre département et d'exprimer le grand intérêt que j'ai pris à cette visite.
Non seulement j'ai pu mesurer sur place la grande inquiétude, voire la désespérance, qui règne parmi les éleveurs de veaux de boucherie de votre département - et d'autres, d'ailleurs - mais j'ai également pu apprécier le volontarisme et le professionnalisme d'un certain nombre d'entreprises de transformation. La SOBEVAL en fait partie, mais elle n'est pas la seule, même si elle est la plus importante dans cette région. J'ai été très impressionné par l'ancrage de cette filière dans un territoire.
Comme vous le rappelez, monsieur le sénateur, la filière des veaux de boucherie affronte de graves difficultés liées à un déséquilibre récurrent entre l'offre et la demande de viande de veau et, surtout, au renchérissement des coûts de production. Au demeurant, nous insistons aujourd'hui sur les difficultés propres à la filière du veau de boucherie, mais cette dernière n'est malheureusement pas la seule à subir les conséquences de l'augmentation du prix des matières premières. Une autre filière rencontre actuellement de grandes difficultés, celle du porc, pour ne pas parler des volailles, même si le contexte est un peu différent.
Pour en revenir au veau de boucherie, je rappellerai que des concertations entre les professionnels et ma propre administration ont permis d'aboutir à une proposition qui, je le reconnais, en réponse à votre interpellation, est conjoncturelle dans la mesure où les conditions budgétaires - vous en conviendrez - sont extrêmement difficiles. Nous proposons d'établir un cadre interprofessionnel visant à mieux maîtriser la production et à relancer ce secteur, tout en tenant compte, autant que faire se peut, de la situation difficile de beaucoup d'éleveurs.
Le 21 août 2007, j'ai annoncé la mise en place d'un plan de soutien à cette filière d'un montant de 7, 8 millions d'euros, dont 1, 5 million d'euros consistent en allègements de charges d'emprunts professionnels. Cette première ligne de crédits est en cours d'affectation dans les régions concernées.
S'agissant des autres mesures, comme l'adaptation du nombre de places dans les exploitations ou la compensation des pertes de marge brute des entreprises d'intégration, les moyens financiers ont été sécurisés au niveau de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions pour leur mise en oeuvre, sous réserve du cofinancement interprofessionnel de l'aide aux éleveurs.
Ce plan de soutien comporte par ailleurs un volet en faveur de la recherche et de la promotion - vous en avez d'ailleurs fait état dans votre question - car la qualité des productions peut toujours être améliorée, ce qui suppose un effort de recherche.
Je rappelle enfin que nous avons contribué à la défense de la production française de veau en obtenant des autorités communautaires, en juin 2007, de réserver la dénomination « veau » aux seuls bovins de moins de huit mois. Cette mesure mettra un terme aux distorsions de concurrence existant avec certains pays du nord de l'Europe.
Enfin, au-delà de cette proposition de plan - dont je reconnais le caractère conjoncturel, je le répète -, nous travaillons à un certain nombre de mesures plus structurelles, conformément au voeu exprimé par le Président de la République le 11 septembre 2007 à Rennes.
Nous allons devoir affronter de nombreuses crises - quand je dis nous, je parle de l'État et de la profession : des crises climatiques, qui vont se multiplier avec le réchauffement de l'atmosphère et dont les agriculteurs sont les premières victimes, des crises sanitaires, notamment celle de la fièvre catarrhale ovine - sans doute la crise sanitaire la plus grave que nous ayons eue à affronter depuis très longtemps -, des crises économiques. Or nous ne disposons pas encore des outils nécessaires pour y faire face.
Dans le cadre des discussions engagées à propos du bilan de la PAC et de la future politique alimentaire, rurale et agricole que nous voulons construire pour l'après 2013, je vais travailler à la mise en place de meilleurs outils de gestion de crise, de prévention et de mutualisation des risques, et je serais heureux que le Sénat s'associe à ce travail. Cette réflexion apportera une réponse durable et plus structurelle aux crises économiques du type de celle que traverse la filière du veau de boucherie.

Monsieur le ministre, vous reconnaissez - très honnêtement, il faut le dire - le caractère extrêmement conjoncturel, donc implicitement insuffisant, de l'action menée. Je ne sous-estime pas votre préoccupation pour l'avenir ni la qualité du travail que vous réaliserez pour résoudre cette crise, qui ne touche pas seulement le veau de boucherie mais l'ensemble de la profession agricole.
Même avec des moyens relativement modestes - 8 millions d'euros, c'est insuffisant quand la profession évalue les besoins à quinze millions d'euros ! - vous pouvez aider un secteur agricole en très grande difficulté, au niveau national comme au niveau périgourdin, ce qui n'exclut pas d'aider les autres. Si la conjoncture se maintient, vous savez bien que des milliers d'entreprises agricoles et industrielles en France vont souffrir et risquent de disparaître. J'espère donc que vous tiendrez compte de mon interpellation et que vous pourrez nous annoncer une amélioration des aides que vous accorderez à cette profession, en fonction des disponibilités budgétaires.

La parole est à M. Christian Demuynck, auteur de la question n° 17, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Pour entrer en fonction, un policier municipal doit d'abord être agréé par le préfet. La durée de cette procédure d'agrément varie entre cinq et sept mois ; elle comporte une enquête sur la moralité et l'honorabilité du fonctionnaire. Pour vous donner un exemple, la ville de Neuilly-Plaisance a recruté en mai 2007 un policier municipal qui n'a toujours pas été agréé à ce jour.
Ensuite, le candidat doit recevoir l'agrément du tribunal de grande instance, valable au niveau départemental. La procédure dure, là aussi, de cinq à six mois.
Enfin, le fonctionnaire doit prêter serment devant le tribunal d'instance. À ce stade, les délais sont beaucoup plus courts et n'excèdent pas quelques semaines. Si, par-dessus le marché, cet agent entre dans une police municipale où le port d'arme est autorisé, les procédures s'allongent encore de quelques semaines supplémentaires.
Monsieur le ministre, ne pourrait-on pas réduire la durée de ces procédures et faire en sorte qu'un policier municipal arrivant dans une collectivité puisse être très rapidement opérationnel ?
Monsieur le sénateur, Mme Alliot-Marie m'a demandé de vous répondre en son absence, qu'elle vous prie d'excuser. Je le fais bien volontiers.
La question de la délivrance de l'agrément des agents de police municipale par le préfet et le procureur de la République est essentielle pour le fonctionnement concret des polices municipales. Nous connaissons l'importance du concours apporté par ces dernières à la sécurité du pays et l'attente légitime de tous les maires sur ce sujet.
Actuellement, monsieur le sénateur, la nomination des agents de police municipale est subordonnée à l'obtention par ces derniers de l'agrément du préfet et du procureur de la République. L'accès à ces fonctions, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique, exige en effet un contrôle préalable de la moralité de toute personne candidate. Ce contrôle porte sur les antécédents judiciaires des intéressés.
Toutefois, ce régime qui engendre des délais d'attente pour la prise de fonctions de ces agents, y compris en cas de mutation, peut poser des difficultés aux maires qui ne peuvent disposer d'agents opérationnels dès leur recrutement. Le contrôle de la moralité des agents de police municipale devrait donc être indépendant de leur affectation géographique.
Aussi Michèle Alliot-Marie est-elle favorable à une simplification de ces procédures dans le sens que vous avez vous-même esquissé, monsieur le sénateur. Dans cet esprit, elle a élaboré un projet de modification de l'article L. 412-49 du code des communes tendant à ce que les agents de police municipale soient agréés par le préfet et le procureur de la République dès leur réussite au concours d'entrée dans la profession. Ils continueraient alors à bénéficier de cet agrément indépendamment de leur affectation géographique, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'honorabilité et de moralité requises pour exercer leurs fonctions.
Dans le souci de conduire rapidement cette réforme attendue par les maires - attente dont vous vous êtes fait l'écho, monsieur Demuynck - le Gouvernement saisira très prochainement le Parlement d'un texte en ce sens.

Je remercie M. le ministre de sa réponse et j'espère que ce nouveau mode d'agrément entrera rapidement vigueur.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous signaler que, dans la deuxième ville de France, la police municipale n'étant pas armée, elle cesse ses activités à 21 heures. Pour qu'elle soit armée, il faudrait faire des efforts de formation supplémentaires. En effet, lorsqu'une bavure se produit, un policier municipal n'est pas traité de la même manière qu'un membre de la police nationale. Là encore, il faudrait introduire plus de justice et d'équité !
M. René-Pierre Signé approuve.

Mes chers collègues, pardonnez-moi de m'être substitué à notre éminent collègue Christian Demuynck.

La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 35, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la circulaire d'application n° 2007-142 de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui étend au financement des écoles privées sous contrat d'association les procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques.

Désormais, les communes ne comportant pas d'école privée sous contrat d'association devront financer la scolarisation d'un enfant résidant sur leur territoire et fréquentant un établissement d'enseignement privé situé dans une autre commune.
Une disparité de traitement avec l'enseignement public est ainsi créée, puisqu'en cas de scolarisation d'un enfant dans une école publique d'une autre commune, la commune de résidence n'est tenue de contribuer financièrement que si le maire a donné son accord à cette scolarisation.
Plus largement, les dispositions de l'article 89 risquent de ruiner les politiques volontaristes menées par de nombreux élus pour maintenir un service public de qualité sur leur territoire et de contribuer à la disparition de nombreuses écoles publiques, avec des conséquences particulièrement dommageables dans les zones rurales.
Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir reconsidérer le contenu de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 lors de cette session parlementaire et, dans l'attente, de ne pas mettre en application la circulaire n° 2007-142.
Monsieur Teston, vous savez qu'il s'agit d'un sujet difficile. J'ai déjà eu l'occasion de répondre récemment à votre collègue Michel Houel sur ce sujet, lors de questions d'actualité.
Comme vous l'avez dit, votre question porte sur l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Vous pouvez difficilement demander à un membre du Gouvernement de ne pas appliquer une loi votée, même si je peux comprendre un certain nombre de vos réticences !
Revenons cependant sur cet article, que vous connaissez bien puisqu'il a été voté sur proposition sénatoriale.
Dans sa rédaction actuelle, il précise les modalités d'application aux écoles privées sous contrat de dispositions existant par ailleurs pour d'autres échanges scolaires entre communes - il est vrai que ceux-ci se fondent sur des accords ou des conventions passés entre les maires. Dans les deux cas, il s'agit de la prise en charge financière, par les communes de résidence, des élèves scolarisés sur le territoire d'une autre commune.
La transposition de ce dispositif à l'enseignement privé est guidée par un principe de dialogue.
La mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives privilégie d'ailleurs l'accord des communes intéressées, comme c'est déjà le cas, vous l'avez dit, pour le public. Or, ce qui est valable pour le public doit l'être pour le privé. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre communes, ce qui est possible mais sera tout de même assez rare, que l'intervention du préfet sera éventuellement sollicitée ou requise.
L'équité a donc guidé le vote, par votre Haute Assemblée, de l'article 89 de la loi, tout comme la rédaction de la circulaire, puisque celle-ci repose sur deux principes : l'équité à l'égard des communes, qui ne sauraient payer plus pour le privé qu'elles ne payent pour le public, et l'équité à l'égard des familles, qui ont droit à ce que leur liberté de choix, qui est inscrite dans la loi, soit respectée.
Ce double principe d'équité me semble pouvoir être admis par chacun.
C'est la raison pour laquelle, à la suite de l'annulation de la circulaire de décembre 2005 - pour des raisons de pure forme, puisqu'il s'agissait d'une question de compétence des signataires -, ma collègue ministre de l'intérieur et moi-même avons considéré qu'il convenait d'en reprendre le texte.
Avant la parution de la nouvelle circulaire au Bulletin officiel du 6 septembre 2007, j'avais cependant pris la précaution, comme je l'ai rappelé jeudi dernier, de faire relire le projet par l'association des maires de France, ce qui a permis de retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée - et, ce faisant, de rendre la circulaire moins « oppressante » - les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles ainsi que les dépenses relatives aux activités extrascolaires.
La nouvelle circulaire rappelle les règles de parité, auxquelles tout le monde doit souscrire, que je viens de rappeler. Sur ces bases claires, je suis convaincu qu'elle sera appliquée dans un esprit de mutuelle compréhension et dans le légitime souci de l'équilibre des finances locales et du respect du choix des familles. Elle devrait donc permettre de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties concernées et d'éviter les éventuels conflits que vous avez évoqués, monsieur Teston, conflits qui seront arbitrés par le préfet mais qui, je le crois, seront extrêmement rares et très circonscrits.
M. Roland Courteau s'exclame.

La réponse de M. le ministre appelle de ma part les remarques suivantes.
Selon les explications données par son auteur, l'« amendement Charasse », puisque c'est cet amendement, que vous avez évoqué sans le citer expressément, qui a donné naissance à l'article 89 de la loi du 13 août 2004, ne concernait que les communes qui n'ont pas ou plus d'école publique, mais le moins que l'on puisse dire est qu'il n'était pas très explicite sur ce point. Or il a été adopté tel quel et, devenu article de loi de portée générale, il concerne toutes les communes, ce qui a introduit des disparités de traitement entre les communes de résidence quand il y a scolarisation d'un enfant dans une commune voisine, situation assez fréquente.
Si l'école est publique et, hormis les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212 - 8 du code de l'éducation, le maire de la commune de résidence peut refuser son accord et, dans cette hypothèse, sa commune n'a pas à participer financièrement.
En revanche, s'il s'agit d'une école privée, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté et sa commune est tenue de participer financièrement.
Monsieur le ministre, je renouvelle donc ma demande pour que le Gouvernement dépose un projet de loi visant à modifier l'article 89 de la loi n° 2004-809.
À mon sens, deux voies s'offrent à vous : soit l'article 89 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes qui n'ont pas ou plus d'école publique. » ; soit il est modifié par la substitution des termes : « Tous les alinéas de l'article L. 212 - 8 du code de l'éducation sont applicables » aux termes : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 212 - 8 du code de l'éducation sont applicables ».
Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.
Vous êtes les législateurs : c'est vous, et non pas moi, qui votez la loi !

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 13, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, bien avant le récent congrès annuel de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui a dressé un bilan alarmiste de la situation des services de secours à personnes, j'avais déjà été alerté, comme d'ailleurs mon collègue Bernard Dussaut, par de nombreux élus des cantons ruraux de la Gironde, en particulier par des maires du sud du département, très inquiets quant à l'avenir de la protection civile dans les cantons ruraux.
En juin dernier, un dramatique incendie a coûté la vie à quatre personnes, provoquant une très vive et légitime émotion à laquelle, bien entendu, nous nous sommes associés.
Pour autant, il n'est pas opportun d'utiliser ce drame pour critiquer ou discréditer l'organisation des secours incendie et des hommes qui oeuvrent en son sein. C'est une attitude que nous refusons et que nous dénonçons et, pour ma part, je tiens à réaffirmer mon indéfectible attachement, partagé d'ailleurs par tous les élus, aux pompiers, dont l'engagement volontaire ou professionnel ne saurait être mis en cause.
En revanche, ce tragique fait divers a mis en lumière l'extrême sensibilité des élus locaux et des populations qu'ils représentent sur une question essentielle : la nécessaire et urgente réorganisation des services de sécurité civile. Le Président de la République s'est d'ailleurs récemment prononcé en faveur d'une « expérimentation, dès 2008 de coopération nouvelle » entre tous les services de secours.
Ainsi, nous nous interrogeons sur l'intérêt de la centralisation des appels, qui concerne aussi bien le Centre 15 que les gendarmes ou les pompiers. Pour ces derniers, il est évident que la centralisation des appels engendre des délais supplémentaires dans les temps d'intervention, d'où une efficacité réduite. La rigidité de ce système centralisé apparaît à beaucoup d'entre nous comme antinomique avec la nécessaire réactivité des secours. Des cas patents de dysfonctionnement ont déjà pu être constatés qui impliquent une adaptation du système en vue d'une meilleure efficacité et d'une amélioration de la performance des centres de proximité, particulièrement en milieu rural.
Il est urgent, madame la secrétaire d'État, d'apporter à ce système les corrections nécessaires dans l'intérêt de nos populations.
Le Conseil national de sécurité civile, créé par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, avait retenu le secours à personnes et la médicalisation des secours parmi les orientations de ses travaux.
Vous le savez, madame la secrétaire d'État, nous avons tous le souci d'assurer un traitement équitable de tous les citoyens dans le droit d'accès à tous les services de secours. Or ce traitement équitable n'est pas assuré aujourd'hui. Les secteurs ruraux, déjà pénalisés par leur éloignement des services de sécurité civile, souffrent en outre de cette organisation, qui semble privilégier l'application mécanique des règles édictées au détriment de la mission qu'elle est censée servir : porter secours à nos concitoyens !
Le problème se pose encore avec plus d'acuité en période de vacances ou pendant les week-ends, en l'absence de médecin de garde et, là encore, du fait de la centralisation des appels téléphoniques.
En refusant toute logique de concurrence, il faut chercher à valoriser les plus-values des uns et des autres et revoir toute l'organisation du nécessaire partenariat entre acteurs publics et acteurs privés de l'ensemble des professionnels des secours à personnes : Centre 15, SAMU, pompiers et médecins.
Lorsque tous ces acteurs réussissent à travailler ensemble, ils font un travail remarquable, comme j'en ai été le témoin, voilà quelques semaines, un dimanche après-midi à La Réole.
Alors que nous savons pouvoir compter dans notre pays sur l'expérience et la compétence des médecins et des pompiers, nous ne comprenons pas pourquoi dans certaines situations d'extrême urgence toutes ces capacités peuvent être mises à mal par la rigidité de règlements qui entravent l'efficacité de ces services dont l'objectif est pourtant de sauver la vie !
Vous reconnaîtrez aisément, madame la secrétaire d'État, qu'il y a véritablement urgence à réorganiser et à harmoniser les différents services de secours à personnes, urgence qui me conduit à vous demander ce que compte faire le Gouvernement.

La parole est à Mme la secrétaire d'État, qui a siégé dans notre assemblée et que j'engage à se considérer ici comme chez elle !
Je vous remercie, monsieur le président.
Monsieur Madrelle, les secours à personnes ont représenté pour les SDIS 2, 5 millions d'interventions en 2006, soit 70 % de leur activité opérationnelle, avec un taux de croissance de 7 % entre 2005 et 2006.
Ces missions impliquent des relations permanentes entre les différents acteurs, en premier lieu avec les SAMU. Leur médicalisation a permis ces dernières années de diminuer de 30 % la mortalité des urgences vitales. Ces progrès sont le fruit du travail de tous les acteurs de l'urgence.
Notre objectif commun est clair : il faut mieux s'organiser, mutualiser davantage nos moyens, mieux se coordonner pour gagner en qualité et être encore plus opérationnels au service de nos concitoyens.
Comme l'a annoncé le Président de la République lors de la clôture du cent quatorzième congrès national des sapeurs-pompiers, le 29 septembre, nous allons revoir l'organisation du secours à personnes, sans querelles de chapelle, en instaurant une collaboration entre les différents acteurs.
Ainsi, la coordination régionale entre SDIS et SAMU se concrétisera, dès 2008, par un rapprochement systématique des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques et des schémas régionaux pour l'organisation des urgences médicales et du secours à personnes.
Pour faire face à une augmentation sans précédent des demandes d'intervention, il est nécessaire de repenser les modes opératoires de réception des appels au 15 et au 18 ainsi que l'interconnexion entre les différentes structures.
La coopération opérationnelle entre les SDIS et les SAMU sera améliorée grâce aux technologies de l'information, qui facilitent les échanges de données en temps réel. Dès 2008, la mise en service d'outils de radiocommunications numériques à ressources partagées sera développée.
Pour une utilisation plus rationnelle des ressources, une expérimentation sera lancée en 2008. L'objectif sera d'envoyer le plus rapidement possible une équipe auprès de la victime pour évaluer, sous le contrôle du Centre 15, la réponse médicale la plus appropriée. Un comité de suivi évaluera l'efficience de ce système de réponse graduée pour valider une généralisation nationale du dispositif, laquelle interviendra dès 2009.
Nos concitoyens, en tout point du territoire, bénéficient d'un système de secours efficace grâce au dévouement des sapeurs-pompiers et des personnels médicaux des SAMU, auxquels je veux rendre hommage. Ce système doit être amélioré pour s'adapter aux besoins actuels liés aux enjeux démographiques. C'est l'engagement pris par Michèle Alliot-Marie, engagement qu'elle m'a chargée de vous confirmer ce matin.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de cette réponse encourageante, puisqu'elle fait apparaître que le Gouvernement a bien compris que l'efficacité des secours n'avait pas été améliorée par la dernière réorganisation, à l'égard de laquelle les populations et les élus sont donc restés assez dubitatifs. Incontestablement, il faut modifier les procédures, beaucoup trop complexes. Reste à espérer que la volonté du Gouvernement permettra de changer les choses !

La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 5, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d'État, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 donne aux enfants souffrant d'un handicap un droit à la scolarisation en milieu ordinaire.
Afin d'améliorer l'accueil des enfants et adolescents handicapés, un plan d'action a été lancé au mois d'août dernier par le Gouvernement et les moyens d'accompagnement ont été renforcés. Pour l'accueil collectif, les CLIS et les UPI, ou classes d'intégration scolaire et unités pédagogiques d'insertion, ont été ouvertes à la satisfaction de beaucoup. En outre, des places en service d'éducation spéciale et de soins à domicile sont prévues.
La montée en puissance de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés en milieu ordinaire va, inévitablement, générer des besoins en matière d'accueil, d'accompagnement hors du temps scolaire et de loisirs.
La préparation de la Conférence de la famille 2007 a été l'occasion d'une réflexion intéressante sur la question de l'épanouissement des enfants hors du temps scolaire, chacun étant conscient que les horaires scolaires correspondent rarement à ceux de l'activité professionnelle des parents.
Le problème de la conciliation des temps de la famille et des temps des enfants se pose souvent avec une pressante acuité. Il prend une dimension plus particulière quand il s'agit de surcroît de concilier l'accueil hors du temps scolaire avec la spécificité du handicap.
L'accueil des enfants handicapés nécessite des moyens adaptés, ce qui pose également la question de la formation des personnels d'encadrement et d'animation.
Madame la secrétaire d'État, M. le ministre de l'éducation nationale a annoncé que le Gouvernement devait présenter des mesures spécifiques relatives à la formation et à la qualification professionnelle de l'ensemble des métiers du handicap. Toutefois, dans l'immédiat, en ce qui concerne plus particulièrement les AVS, ou auxiliaires de vie scolaire, nouvellement recrutés, il a demandé aux recteurs de « veiller de très près à la mise en place » de la formation initiale de soixante heures qui découle de la loi du 30 avril 2003, en s'appuyant sur « les personnels compétents de l'académie et sur les partenaires associatifs ».
Une convention nationale visant à améliorer cette formation devrait être signée. M. le ministre de l'éducation nationale a souhaité voir le principe de l'intégration de tous les élèves, et en particulier des élèves handicapés, inscrit « au coeur de la formation dispensée dans les IUFM ».
S'agissant de l'accompagnement des enfants et des adolescents hors du temps scolaire, ne serait-il pas judicieux, madame la secrétaire d'État, de prévoir, en profitant du mouvement ainsi engagé, l'intégration de modules spécifiques au handicap au sein des formations dispensées pour l'obtention du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs, ou des autres diplômes d'animation et d'éducation sportive ?
Monsieur le sénateur, merci tout d'abord d'avoir souligné que le Gouvernement avait pris cet été des mesures importantes afin d'accompagner la rentrée scolaire de septembre des enfants handicapés, avec la création de 2 700 postes d'auxiliaires de vie scolaire, de 200 UPI, ou unités pédagogiques d'intégration, et de 1250 places dans les CESAD, les centres d'éducation spécialisés et de soins à domicile.
Comme vous, je souhaite que les enfants handicapés se voient offrir la possibilité de participer aux activités périscolaires et extrascolaires proposées à tous les enfants. C'est une question de justice et d'égalité des chances !
Monsieur le sénateur, vous avez raison : bien souvent, l'accueil des enfants dans le cadre de ces activités suppose que les animateurs soient formés ou, tout au moins, qu'une aide humaine connaissant l'enfant puisse participer avec ce dernier aux activités.
Cette nécessité est d'ores et déjà prise en compte dans un certain nombre de domaines. Ainsi, en ce qui concerne les pratiques sportives, une politique de formation des animateurs et moniteurs est menée depuis plusieurs années par le ministère de la jeunesse et des sports.
Dans ce cadre, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, finance 300 postes d'animateurs sportifs spécialisés dans les fédérations « Handisport » et « Sport adapté ». Des modules de formation à l'accueil des personnes handicapées sont par ailleurs dispensés aux moniteurs qui le souhaitent, sur la base du volontariat.
S'agissant de l'accueil des enfants handicapés en centres de loisir ou de vacances, des recommandations ont été émises, dès 2001, par le ministère de la jeunesse et des sports et par le ministère de la solidarité, pour faciliter leur intégration. Un guide méthodologique à l'attention des formateurs intervenant au cours des sessions de formation au BAFA a également été édité en 2003 ; il prévoit de sensibiliser les futurs animateurs à l'accueil des enfants handicapés.
Faut-il aller plus loin ? C'est sans doute souhaitable. L'inclusion systématique au sein des formations au BAFA d'un module sur le handicap constitue une piste qu'il me paraît intéressant d'explorer. Je compte demander à mes services de se rapprocher de ceux de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, afin d'étudier cette possibilité.
Plus largement, il me semble que d'autres formations pourraient être utilement adaptées à la problématique du handicap. Je pense à celles qui sont destinées aux enseignants, aux architectes, aux autres métiers du bâtiment ou encore aux gestionnaires des ressources humaines.
C'est pourquoi je veux, dans le cadre de la préparation du « plan métiers » prévu par la loi du 11 février 2005, passer en revue l'ensemble des formations et des certifications professionnelles, afin de repérer les métiers pour lesquels une sensibilisation à la question du handicap est indispensable.

Madame la secrétaire d'État, c'est la première fois qu'il m'est donné de m'adresser à vous en votre qualité de membre du Gouvernement ; j'en profite pour vous exprimer ma satisfaction de vous voir siéger au banc des ministres ! Compte tenu d'ailleurs de l'ampleur de vos compétences, j'aurai sans doute d'autres occasions de vous interroger !
Pour l'instant, je vous remercie de votre réponse. S'agissant du problème qui nous intéresse, il est exact que la rentrée scolaire a été marquée par des avancées utiles. Pour les sports, et pour les activités physiques en général, des efforts remarquables ont été accomplis, qui se poursuivent d'ailleurs, nous pouvons le constater, dans tous les départements, et en particulier dans celui dont je suis l'élu.
Comme vous l'avez souligné, madame la secrétaire d'État, il est nécessaire d'aller plus loin dans cette direction, et c'est ce que je souhaite. Vous avez d'ailleurs déjà élargi le champ de vos engagements, s'agissant notamment du « plan métiers ».
Madame la secrétaire d'État, de tous les efforts qui sont accomplis, et dont je souhaite qu'ils aboutissent effectivement et positivement, je vous remercie.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 21, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'éventuelle réduction du nombre des structures d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées au sein de la région d'Île-de-France.
La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées que nous avons adoptée a modifié le mode de prise en compte des travailleurs handicapés dans le décompte de l'entreprise. En augmentant de façon significative leur contribution, qui a d'ailleurs progressé de près de 20 %, elle a créé une forte incitation pour les entreprises.
Les « recettes » de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIPH, doivent s'en trouver abondées de façon mécanique. Quant à la renégociation de la convention entre l'État et l'AGEFIPH, elle devrait intégrer logiquement un accroissement des moyens dédiés à l'insertion.
Or, de façon paradoxale, l'AGEFIPH, qui envisage de recourir à des agences d'intérim ou à d'autres entreprises, va réduire le nombre des Cap Emploi dans certains départements, notamment dans la région d'Île-de-France, mais peut-être pas uniquement.
Les interventions des Cap Emploi, créés pour certains d'entre eux en 1976, s'inscrivent dans le cadre de la convention liant l'État à l'AGEFIPH, sous la forme de délégation de service public et de partenariat avec le service public de l'emploi.
Or ces Cap Emploi non seulement jouent un rôle primordial dans l'accueil, l'accompagnement et l'insertion des travailleurs handicapés, mais aussi constituent les interlocuteurs privilégiés des entreprises en matière de placement.
En se fondant sur une interprétation erronée de la loi, l'AGEFIPH met en quelque sorte de côté les Cap Emploi.
Pourtant, je le rappelle, la commission des affaires sociales du Sénat avait indiqué, lors de l'examen du rapport d'information sur l'application de la loi de 2005 : « Le législateur a souhaité que l'État conserve ses responsabilités de pilotage du dispositif Cap Emploi : en témoigne d'ailleurs la création du comité national de pilotage [...]. Il n'a donc jamais été question de confier à la seule AGEFIPH le conventionnement des Cap Emploi ».
Ce problème se pose dans les départements de la région d'Île-de-France, mais d'autres sont peut-être également concernés. Quelle est donc, madame la secrétaire d'État, la position de l'État à l'égard du conventionnement des Cap Emploi par l'AGEFIPH ?
Madame la sénatrice, comme vous, je suis extrêmement attachée à l'existence des Cap Emploi, qui rendent des services considérables pour l'emploi des handicapés, puisqu'ils accompagnent chaque année plus de 80 000 personnes et contribuent au placement de 45 000 d'entre elles.
Les Cap Emploi disposent d'une compétence propre, qui leur est confiée par la loi, celle de préparer, d'accompagner vers l'emploi et de placer les travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Ils ne constituent donc pas des prestataires auxquels l'AGEFIPH peut choisir de recourir, ou non, afin d'exercer l'une de ses missions propres. Ils sont des partenaires, et la loi impose à l'AGEFIPH, compte tenu de son objet social, de contribuer à leur financement.
Cette précision apportée, vous conviendrez, madame la sénatrice, qu'il est indispensable de s'assurer de la qualité des prestations offertes en matière de préparation, d'accompagnement vers l'emploi et de placement des travailleurs handicapés. C'est pourquoi la loi a prévu que les organismes de placement spécialisés, auxquels cette mission est confiée, sont préalablement conventionnés et voient leurs résultats régulièrement évalués.
En cas de défaillance, un déconventionnement doit pouvoir intervenir et un nouvel opérateur être sélectionné, afin que ces missions continuent d'être assurées sur le territoire considéré. Dans ce contexte, il n'est pas anormal de prévoir une procédure de sélection par appel d'offre.
Madame la sénatrice, vous vous interrogez sur l'autorité responsable du conventionnement des Cap Emploi, et je reconnais volontiers que la loi n'est pas explicite à ce sujet.
En l'absence de précision législative, vous concluez, légitimement d'ailleurs, que cette responsabilité incombe à l'État, et vous avez raison. Toutefois, l'État est libre de déléguer cette compétence, sous son contrôle, à un autre opérateur, s'il juge que c'est plus pertinent. En l'occurrence, c'est ce qu'il a choisi de faire pour le conventionnement des Cap Emploi.
L'État intervient ainsi de deux manières dans le conventionnement des Cap Emploi.
Tout d'abord, il exerce un rôle d'orientation et d'impulsion de la politique en faveur des Cap Emploi, à travers la définition de leur offre nationale de service. Ainsi, un protocole national a été signé sur ce sujet en janvier 2007 avec l'AGEFIPH et les têtes de réseau Cap Emploi.
Ensuite, il cosigne chaque convention passée au niveau local avec les Cap Emploi. Il s'agit donc de conventions tripartites, car il était normal d'associer l'AGEFIPH, en tant que financeur.
Au quotidien, l'État a choisi en revanche de déléguer le suivi des conventions à l'AGEFIPH et à son réseau régional. À ce titre, l'association s'assure du respect de l'offre de service élaborée avec l'État, à travers une procédure d'audit dont les conclusions auront été rendues pour l'ensemble des structures d'ici à la fin de l'année 2007.
Enfin, L'AGEFIPH assure, pour le compte de l'État, la sélection du nouvel opérateur lorsque l'audit conclut à un nécessaire déconventionnement du Cap Emploi existant. Néanmoins, l'État continue de ratifier cette sélection à travers la signature de la convention.
Vous le voyez, madame la sénatrice, l'État reste largement mobilisé dans le pilotage du réseau Cap Emploi. Je veillerai d'ailleurs à ce qu'il en aille encore ainsi à l'avenir : des instructions seront données aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin notamment qu'elles participent activement aux comités de pilotage régionaux chargés d'instruire les décisions de conventionnement.
S'agissant du recours à l'appel d'offre, il ne me paraît pas contestable, tant qu'il demeure un moyen de sélectionner le nouvel opérateur en cas de défaillance du précédent et non une procédure systématique visant, tous les trois ans, l'ensemble du réseau. En effet, une telle démarche conduirait véritablement à déstabiliser le dispositif, en empêchant la constitution d'une authentique expertise professionnelle.
Je m'attarderai toutefois sur la question particulière de l'appel d'offre lancé par l'AGEFIPH en région parisienne, car tel est votre souci, madame la sénatrice.
L'Île-de-France se trouve dans une situation particulière : pour des raisons historiques, elle compte dix-sept Cap Emploi pour huit départements. Bien que la taille des bassins d'emploi puisse justifier un nombre de structures plus important qu'ailleurs, vous conviendrez, madame la sénatrice, qu'il est légitime de s'interroger sur une optimisation de l'implantation de ces dernières.
Un travail est engagé en ce sens depuis 2004, mais il n'a abouti à ce stade qu'à une seule fusion. Considérant cette unique fusion comme insuffisante, l'AGEFIPH, en accord avec ses autorités de tutelle, a décidé de prendre en main cette optimisation en définissant elle-même un schéma régional d'implantation et en lançant un appel d'offre afin de sélectionner les structures qui répondent aux orientations de ce schéma.
Si cette démarche est légitime, l'AGEFIPH est allée trop vite, me semble-t-il, en considérant d'emblée, de façon systématique et sans attendre les conclusions de l'audit qu'elle avait elle-même lancé, que le schéma optimal d'implantation est un seul Cap Emploi par département ; or, sélectionner de façon rigide une organisation unique sans attendre les conclusions de l'audit, c'est prendre le risque de supprimer des structures qui rendent de réels services.
Je crois donc prudent de nous donner du temps dans cette procédure, pour pouvoir prendre connaissance des résultats de l'audit et définir un schéma d'implantation des Cap Emploi partagé entre l'AGEFIPH, le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, qui est chargé de la tutelle de l'agence, et les organismes de placement spécialisés concernés. Ces démarches accomplies, l'appel d'offre pourrait être réactivé, sur des bases plus saines.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de votre réponse très complète. Je proposerai à certains collègues de Paris et d'Île-de-France de réunir les Cap Emploi de la région pour leur indiquer le contenu de votre réponse. Je ne doute pas que cela suffira à apaiser les esprits.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 9, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, ma question avait été formulée à l'adresse du précédent gouvernement, si bien qu'elle a perdu beaucoup de son actualité. Pour autant, les problèmes restent les mêmes.
Je voulais donc attirer votre attention, monsieur le ministre, sur l'avenir de l'EIAT, l'établissement d'imprimerie de l'armée de terre situé à Château-Chinon.
Depuis la réduction très sensible des effectifs militaires consécutive à la suppression du service obligatoire, le travail d'impression a forcément diminué, même s'il reste important, et les mutations des personnels, maintenant civils, sont beaucoup plus difficiles à obtenir.
Dans une étude qui, il est vrai, date de quelques mois, sont évoquées diverses options assez peu favorables : attendre le départ à la retraite de la majorité du personnel et envisager une fermeture à moyen terme ; constater la carence d'encadrement et fermer plus rapidement l'établissement ; regrouper l'EIAT de Château-Chinon et l'Établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre de Saint-Étienne, ce regroupement n'étant évidemment pas prévu à Château-Chinon.
Il semble que le taux d'encadrement se soit amélioré et que l'activité de l'EIAT se soit consolidée : il devient donc possible d'assurer la sauvegarde de l'établissement. Une confirmation de votre part, monsieur le ministre, serait la bienvenue.
Monsieur le sénateur, effectivement, une étude sur l'ensemble de la fonction d'impression du ministère de la défense a été réalisée voilà quelques mois et a conduit à examiner, notamment, la situation de l'EIAT de Château-Chinon.
À la fin de l'année 2005, la fonction d'impression du ministère occupait 1 000 agents, dont 480 ouvriers d'État et 200 militaires, répartis en 41 points ou ateliers d'impression : 8 établissements au sein de l'armée de l'air, 4 au sein de la marine, 17 au sein de l'armée de terre, 3 au sein de la gendarmerie, 8 au sein du secrétariat général pour l'administration, 1 pour le service de santé.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, l'établissement de Château-Chinon. Créé en 1982, comme vous le savez, il emploie 79 personnels, dont 17 sont affectés à des tâches d'administration et 14 à des tâches de soutien.
Quelle est la situation actuelle ? Quelle réflexion mène le ministère de la défense sur cet établissement, comme d'ailleurs sur tous ses établissements et sur toutes les fonctions de soutien et d'administration qu'il assume ?
À son arrivée, le Gouvernement a lancé la révision générale des politiques publiques, qui consiste pour les ministères à examiner chacune de leurs fonctions et à se demander s'il n'est pas possible de faire aussi bien, voire mieux, pour moins cher. Il s'agit donc pour mon ministère d'éviter que chaque armée n'assume de son côté des fonctions qu'une coopération permettrait au contraire de mutualiser.
Dans le cadre de cette révision, qui durera jusqu'au mois de mars, nous étudions la situation des établissements d'impression. Pour l'instant, je ne peux donc vous faire d'autre réponse que celle que je fais, chaque fois que je me déplace au sein des forces, lorsqu'on me demande quel est l'avenir de telle base aérienne, de tel régiment, de tel établissement : je ne peux que vous donner rendez-vous au mois de mars prochain, à l'issue de l'ensemble de ces travaux, car c'est alors que nous déterminerons un nouveau format, un nouveau plan d'organisation des forces de soutien et d'administration générale dans le cadre duquel sera examinée la situation de l'établissement de Château-Chinon.

Monsieur le ministre, votre réponse, sans me surprendre, m'inquiète quelque peu. Je sais bien qu'il n'y a pas de crainte sans espoir - pas d'espoir sans crainte, non plus -, mais je redoute fortement que la mutualisation des différents services et la révision de l'organisation de tous ces ateliers d'impression - en effet, 41 points, cela me paraît beaucoup - ne soient guère favorables à des établissements modestes et relativement enclavés dans le rural profond.
Vous avez cité le nombre d'emplois à l'EIAT : c'est extrêmement important pour une petite ville comme Château-Chinon ! Je ne veux pas arracher des larmes ni m'apitoyer sur le sort des régions défavorisées, mais nous avons subi des traumatismes, des séismes industriels liés aux fermetures d'usines. Si l'EIAT devait disparaître, ce serait un coup supplémentaire porté à notre ville, et probablement très douloureux.
J'espère, monsieur le ministre, que vous aurez l'amabilité de bien vouloir considérer la situation qui résulterait d'une fermeture dans une zone déjà très fragilisée et défavorisée.
Monsieur le sénateur, je n'ai ni message positif ni message négatif à vous délivrer aujourd'hui !
Nous sommes en train d'examiner la situation dans sa globalité, ce qui va prendre encore plusieurs mois : ce n'est qu'à l'issue de ce travail que je pourrai venir vers vous. Aujourd'hui, je ne peux vous apporter ni message pessimiste ni message vous garantissant le maintien de cet établissement.
Une sorte de logiciel a été mis en place dans lequel il est prévu que les éléments liés à l'implantation de tel ou tel établissement par rapport aux forces, par rapport à la situation économique du secteur..., seront bien entendu pris en considération.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 11, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur les dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, aux termes duquel la « vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle » est interdite, car « contraire aux objectifs de santé publique ».
On le sait, tout voyageur français quittant le territoire métropolitain pour se rendre dans un département d'outre-mer a la possibilité de se procurer, dans les boutiques hors taxe des aéroports, des produits du tabac à un prix défiant toute concurrence. De ce fait, je m'interroge sur les conditions réelles de l'application de cet article du code de la santé publique.
Monsieur le secrétaire d'État, prenons comme référence l'année 2004, au cours de laquelle 480 000 passagers sont arrivés à la Réunion. Si l'on considère comme avéré que la population française compte en moyenne 30 % de fumeurs, et même en prenant pour base la moitié de ce taux, ce sont 1, 44 million de paquets de cigarettes qui sont acquis à un prix de nature promotionnelle dans les boutiques hors taxe des aéroports de métropole, et près de 3 millions de paquets si l'on tient compte du taux réel, puisque la moyenne d'achat est de deux étuis par acheteur. Encore ce chiffre est-il en dessous de la réalité, puisque mes calculs ne concernent pas les Antilles, mais uniquement la Réunion, et dans le seul sens Paris - Saint-Denis.
Dans ce contexte, et dans un souci de cohérence avec la politique de santé publique menée par le Gouvernement, il me semble opportun, lors de vols à destination et en provenance des DOM, d'interdire la vente de produits du tabac à des prix promotionnels dans les boutiques hors taxe des aéroports, comme c'est déjà le cas pour toute autre destination de la Communauté européenne.
En conséquence, monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir me faire connaître votre position sur ce dossier.
Madame le sénateur, je vous prierai tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence tant de Christine Lagarde que d'Éric Woerth, qui sont actuellement retenus à l'Assemblée nationale, l'un par la discussion d'une proposition de loi de simplification administrative, l'autre pour présenter en commission un certain nombre de missions.
Je vous dirai ensuite que vous avez raison lorsque vous rappelez les faits : les voyageurs en provenance ou à destination des départements d'outre-mer peuvent effectivement acheter en exonération de droits et taxes des produits du tabac, bien évidemment dans les limites de franchises quantitatives fixées par les directives communautaires.
Dans les échanges avec les pays de l'Union européenne, les DOM sont considérés comme pays tiers. Pour les cigarettes, par exemple, les franchises sont fixées à 200 unités - et non à 400 -, soit une cartouche. Au-delà, le voyageur à destination d'un DOM doit acquitter le droit de consommation sur les cigarettes, l'octroi de mer et la TVA, ce qui peut porter le paquet de cigarettes à un prix supérieur à celui qui est pratiqué en France et à la Réunion, où la fiscalité en vigueur est identique à celle qui s'applique en métropole. Tels sont les faits.
En revanche, madame, il ne convient pas de considérer avec vous qu'une telle vente se fait à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique, sauf à ouvrir une brèche dans la réglementation communautaire des échanges entre l'Union européenne et les pays tiers et à remettre globalement en cause le système des duty free.
C'est cette raison, et elle seule - car je suis comme vous sensible aux impératifs de santé publique -, qui fait que je ne puis, au nom du Gouvernement, apporter de réponse plus favorable à votre question : de toute évidence, et vous en conviendrez, remettre en cause le principe même des duty free ne peut pas être à l'ordre du jour.

Monsieur le secrétaire d'État, je ne veux pas remettre en cause le système du duty free. Au demeurant, mon intervention ne concerne que le tabac et non les autres produits.
En ce qui concerne la vente du tabac, il existe déjà d'autres dérogations outre-mer, sur lesquelles j'ai attiré à plusieurs reprises l'attention de votre prédécesseur l'année dernière : les buralistes n'ont même pas besoin de licence et la vente du tabac est possible dans les commerces de proximité et dans les stations services ainsi que par le biais de distributeurs automatiques, ce qui est interdit en métropole.
J'espère que des mesures seront prises rapidement afin d'enrayer ces dérives commerciales qui conduisent à banaliser un produit toxique. Nous ne devons pas oublier qu'à la Réunion 500 décès par an sont dus au tabac, ce qui représente cinq fois le nombre de personnes tuées sur les routes. C'est tout de même beaucoup !

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 26, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur la réforme de la taxe professionnelle et ses conséquences sur les ressources des collectivités locales.
Les collectivités constatent que ce sont elles qui supportent l'essentiel de l'effort financier, même si le principe de la compensation est effectivement bien respecté. Les différents rapports et études publiés à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la loi du 2 mars 1982 et de la mise en oeuvre progressive de « l'Acte II de la décentralisation » ont établi que les finances des collectivités locales étaient saines, mais de plus en plus contraintes par des facteurs exogènes qui progressent plus vite que la richesse nationale - 3, 6 % en volume contre 2, 2 % pour le PIB sur cette même période.
La taxe professionnelle représente 50 % de leurs ressources fiscales. Or l'article 85 de la loi de finances pour 2006 a porté réforme de la taxe professionnelle pour 2007.
Ainsi, pour les entreprises, le dégrèvement de la taxe professionnelle pour investissements nouveaux entrant dans le champ des amortissements dégressifs est pérennisé à hauteur de 100 % la première année, deux tiers la deuxième année et un tiers la troisième année.
Les entreprises bénéficient également d'un plafonnement de leur taxe professionnelle à hauteur de 3, 5 % de leur valeur ajoutée, soit un allègement total de 2, 7 milliards d'euros en 2007 et de 3, 4 milliards d'euros en 2008.
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la partie du plafonnement de taxe professionnelle imputable aux hausses des taux votées est mise à leur charge. Un mécanisme de réfaction peut s'appliquer en fonction de la situation de la collectivité.
Cet allègement de la fiscalité directe locale, qui profite certes au développement économique des entreprises et donc au développement économique de notre pays, est en partie compensé par l'État. Mais les différents rapports publiés soulignent l'obsolescence du système fiscal des collectivités locales et critiquent la part grandissante prise en charge par l'État au travers des compensations de dégrèvements et d'exonérations.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'État, dans quelles directions vous comptez mener la réflexion sur la future réforme de la fiscalité locale afin, notamment, d'assurer une relative neutralité fiscale pour chaque contribuable, mais aussi et surtout un volume de ressources stables et dynamiques pour chaque collectivité.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord d'excuser Mme Lagarde, qui est toujours retenue en commission à l'Assemblée nationale.
Sourires
Non, monsieur le président, mais les questions des députés sont au moins aussi insistantes que celles des sénateurs. Elles sont peut-être parfois un peu moins aiguës, mais j'exprime là une opinion !
Madame Procaccia, en posant votre question, vous entrez d'emblée dans le coeur de la réforme de nos prélèvements obligatoires. Comme cela a été annoncé hier, Mme Lagarde a été chargée par le Président de la République et le Premier ministre d'une mission en vue de parvenir à une réforme de ces prélèvements obligatoires.
Aux termes de la lettre de mission, il s'agit d'animer une revue générale des prélèvements obligatoires. Cet exercice devra déboucher au printemps 2008 sur des propositions concrètes. Il y aura d'abord le diagnostic, nous aurons donc une évaluation de tous les prélèvements, y compris, bien sûr, de la taxe professionnelle. À la suite de ce diagnostic seront constitués des groupes de travail qui préciseront les modalités et le calendrier des réformes éventuelles envisagées ; enfin, après une phase de concertation, la réforme sera mise en oeuvre. La question que vous posez doit s'intégrer dans cette revue générale des prélèvements obligatoires.
Sur le plan spécifique de la réforme de la taxe professionnelle, je me dois de faire un rapide rappel avant d'ouvrir quelques pistes devant vous.
La réforme de la taxe professionnelle a institué un plafonnement des cotisations effectivement acquittées par les entreprises à hauteur de 3, 5 % de leur valeur ajoutée.
Corrélativement, on a institué un mécanisme de partage du financement du coût du plafonnement entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, dotés d'une fiscalité propre.
Madame le sénateur, je rappelle que le coût de cette réforme est pour la plus grande partie pris en charge par l'État sur la base d'une cotisation déterminée en retenant un taux de référence actualisé, en l'occurrence le taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré d'un pourcentage variable, ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
La charge supplémentaire du dégrèvement résultant, le cas échéant, d'une augmentation de taux décidée par les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre par rapport au taux de référence est financée par ces collectivités ou les EPCI.
La participation ou non au financement du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'apprécie donc annuellement en fonction de la politique de taux de chaque collectivité ou chaque EPCI.
De plus, afin de tenir compte des situations particulières de certaines collectivités ou des EPCI, des mécanismes d'atténuation spécifiques s'appliquent sur le montant de cette participation.
Cette réforme, il ne faut pas l'oublier, était indispensable, au moins dans un premier temps par ce plafonnement, pour mettre fin aux situations de surimposition qui pesaient sur la compétitivité de nos entreprises et pour rendre à la taxe professionnelle son caractère d'impôt local.
À cet égard, un certain équilibre me semble aujourd'hui atteint quant aux charges et aux responsabilités pesant sur les collectivités, l'État et les contribuables.
J'en viens aux pistes de réforme de la fiscalité directe locale.
Comme vous l'avez rappelé, le système actuel est compliqué et il est en effet critiquable. Les réformes nécessaires doivent être menées en concertation avec les élus locaux, et ce dans deux directions : d'abord, moderniser les valeurs locatives ; ensuite, réfléchir à la mise en place de nouvelles relations avec les collectivités territoriales.
S'agissant de la modernisation des valeurs locatives, la révision prévue par la loi de 1990 n'a jamais été mise en oeuvre par crainte des transferts entre contribuables d'une même collectivité et entre collectivités. De fait, la fiscalité directe locale repose toujours sur des valeurs fixées en 1961 - il y a maintenant plus de quarante ans - pour les propriétés non bâties et en 1970 pour les propriétés bâties.
Cette situation n'est plus acceptable. Aussi, dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires à laquelle je faisais allusion, et en étroite concertation avec les associations des élus locaux, des propositions d'améliorations concrètes de notre système d'évaluation seront faites, notamment dans le sens d'un assouplissement des règles de mise à jour et d'un renforcement de la participation des élus locaux dans le processus de détermination de la valeur locative.
Il faut aussi, dans le même temps, réfléchir à la mise en place de nouvelles relations avec les collectivités territoriales. Comme vous le soulignez, nous devons redonner de la lisibilité au lien entre les collectivités territoriales et les contribuables. Pour ce faire, quatre principes guideront notre réflexion : premièrement, proscrire autant que faire se peut la superposition des autorités ayant un pouvoir de taux sur une même assiette ; deuxièmement, attribuer à chaque collectivité territoriale un niveau de diversification suffisant de ses ressources fiscales ; troisièmement, supprimer à terme toute interposition de l'État entre les collectivités et les contribuables ; quatrièmement, enfin, limiter les transferts entre collectivités.
Pour le Gouvernement, le chantier de la rénovation de la fiscalité locale est un chantier difficile, compliqué mais essentiel. Madame le sénateur, vous pouvez être assurée de la détermination du Gouvernement à aboutir en étroite collaboration, bien sûr, avec les élus locaux. C'est l'engagement qui a été pris par le Premier ministre le 4 octobre dernier, lors de la réunion d'installation de la Conférence nationale des exécutifs. Des décisions interviendront sans nul doute au printemps 2008...
après cette revue générale des prélèvements obligatoires à laquelle Mme la ministre a été priée de se livrer sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre.

Je constate que ma question était à la fois prémonitoire, puisque Mme Lagarde a été nommée hier et que ma question a été déposée avant, et prématurée, puisque la réflexion n'est pas encore lancée.
Cela dit, les pistes de réflexion que vous avez annoncées dans votre réponse me paraissent aller dans le bon sens.
Le Sénat étant le représentant des collectivités locales, j'ai souhaité, à travers cette question, vous faire part de notre inquiétude, en tant qu'élus locaux, quant à l'avenir du financement de nos projets car, pour engager des projets, il faut être sûr des sources de financement. Or, pour l'instant, ces sources ne sont pas sûres.
Vous nous annoncez une réflexion qui va durer plusieurs mois, je conçois bien qu'elle ne puisse aboutir en quelques jours, et je pense que les élus apprécieront que vos services les associent aux réflexions qu'ils mèneront sur le plan tant local que national.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 31, transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Monsieur le secrétaire d'État, depuis ces dernières années, la pratique des numéros de téléphone surtaxés, s'intensifie.
À l'origine, les numéros surtaxés ont été mis en place pour rémunérer les fournisseurs de service à faible valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, cette pratique n'a pour ses initiateurs, dans la plupart des cas, qu'un intérêt financier, et ce au détriment des usagers.
Certaines entreprises, banques, assurances, cliniques ou encore Air France, ont recours à ces pratiques sans qu'il y ait, en retour, un véritable service ; ou alors, le service est loin d'être à la hauteur du tarif.
Mais il y a plus grave car cette pratique des numéros surtaxés s'est propagée jusque dans les organismes sociaux, les services publics, les administrations. Je citerai, par exemple, les caisses d'allocations familiales ou les caisses d'assurance maladie, la SNCF, Infos douane service, le Centre impôts service, Allo service public, SOS carte bleue/visa perdue ou volée - service qui dépend de la Banque de France, me semble-t-il. Les tarifs varient de 12 centimes la minute à 45 centimes et plus, ce qui est à comparer aux 2 ou 3 centimes la minute au tarif normal.
Une simple demande de document auprès d'un organisme a coûté 8 euros lors d'un appel vers un numéro surtaxé, dont la durée s'est élevée à 17 minutes. Multiplié par des milliers d'appels, ce serait presque le jackpot pour les opérateurs et les éditeurs. De fait, leurs revenus sont évalués sur une année à 2, 5 milliards d'euros, et ce au détriment des usagers.
Et l'addition peut être plus salée encore car, pour les appels passés depuis un téléphone portable, à cette taxe s'en ajoute une autre qui varie, bien sûr, selon l'opérateur. C'est ce que l'on appelle la « double taxe ». Or il faut savoir que 30 % des appels sont effectués depuis des téléphones mobiles.
Monsieur le secrétaire d'État, ce sont bien souvent des personnes de condition modeste souhaitant joindre des organismes sociaux qui sont le plus touchées. De plus, en ce qui concerne les services publics, cela revient à faire payer l'impôt deux fois : au contribuable, d'abord, et à l'usager, ensuite.
Aux termes de l'article 55 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, « un décret en Conseil d'État détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à disposition des usagers les numéros d'appels spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles. »
Trois ans après le vote de cette loi, monsieur le secrétaire d'État, qu'attend-on pour publier ce décret ? Va-t-on enfin respecter la volonté du législateur ?
De plus, selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, il n'existe aucun cadre juridique permettant aux administrations et aux services publics de faire participer l'usager au financement des structures d'accueil téléphoniques au-delà du seul coût d'une communication non surtaxée.
Autre remarque, plus générale encore : qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, force est de constater que, lorsqu'il y a numéro surtaxé, l'usager n'a pas connaissance du numéro géographique qui pourtant existe, mais qui n'est plus communiqué au public et pour cause, on devine les raisons !
Or le site internet Geonumbers.com avait pris l'initiative de proposer au public les numéros géographiques, donc non surtaxés. Ce site a dû fermer sous l'effet d'importantes pressions Il est aisé de deviner d'où elles provenaient.
Monsieur le secrétaire d'État, peut-on attendre du Gouvernement qu'il légalise les démarches comme celle de Geonumber.com, qui sont des démarches à visée sociale ?
Avec certains de mes collègues, j'aurai l'occasion de revenir bientôt sur cette question. Une pétition circule qui atteindra vraisemblablement les 100 000 signatures en novembre.
Monsieur le secrétaire d'État, quelles sont vos intentions sur ce problème important ? Allez-vous tenir compte de nos demandes et sous quels délais ?
Monsieur le sénateur, la question que vous posez est tout à fait fondée ; elle est parfaitement d'actualité.
Le 25 septembre dernier s'est tenue à Bercy une table ronde réunissant les associations de consommateurs et les opérateurs de téléphone, coprésidée par Luc Chatel, le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, et moi-même, car il y a en effet dans ce domaine matière à réflexion.
S'agissant de la question spécifique des numéros surtaxés, il convient de bien distinguer plusieurs volets.
Les numéros dits « surtaxés », commençant généralement par 08, permettent d'accéder à une grande variété de services à valeur ajoutée. La surtaxe prévue est généralement pleinement justifiée par la prestation rendue par le destinataire de l'appel.
J'ai bien dit : « généralement » !
Il ne s'agit donc pas de remettre en cause - ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait - l'existence des numéros surtaxés, qui constituent un moyen de règlement efficace pour des prestations épisodiques d'un montant limité.
En revanche, dans le cas des services publics ou s'agissant des propres services après-vente des opérateurs téléphoniques, la question peut effectivement se poser, monsieur le sénateur, dans des termes radicalement différents.
Pour ce qui concerne les services publics, la question a été récemment examinée dans le cadre d'un audit de modernisation sur l'accueil à distance dans les administrations.
S'agissant du coût pour l'usager, le rapport d'audit souligne la diversité des pratiques des administrations, certains appels pouvant être surtaxés, alors que d'autres sont facturés au prix d'une communication locale. Le rapport recommande la mise en oeuvre d'une politique d'abaissement général du coût des appels vers les administrations, qui pourrait notamment passer par le recours à des numéros en 09, moins coûteux que les numéros payants existants en 08.
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a décidé de suivre cette recommandation et a donné instruction pour que les appels des usagers aux services placés sous sa responsabilité soient tarifés au prix d'une communication locale. Cette mesure importante concerne les appels au centre d'appel « Impôt service », le CIS, et à Infos Douane Service, soit plus d'un million d'appels par an. En outre, Éric Woerth, qui est plus globalement chargé de la réforme de l'État, a demandé que soit réalisée une évaluation de l'impact de la généralisation de cette mesure à l'ensemble des ministères.
Enfin, monsieur le sénateur, vous posez la question du décret d'application de l'article 55 de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le rapport d'audit dont j'ai parlé a, il est vrai, identifié une série de problèmes qui rendent difficile l'application littérale de cette disposition législative et expliquent le retard dont vous avez fait état.
D'abord, la gratuité totale de l'accès aux services est porteuse d'effets pervers, car elle est susceptible d'entraîner en grand nombre d'appels non pertinents, inutilement réitérés ou abusivement prolongés. De plus, le coût de la mise en place d'une telle mesure s'avère extrêmement important, de l'ordre de 80 millions d'euros pour les trois principaux organismes de protection sociale, la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales.
Les auteurs de ce rapport envisagent donc deux possibilités, soit une modification de l'article 55 de ladite loi, soit la publication d'un décret d'application ne concernant qu'un nombre très limité d'organismes, comme ceux qui répondent à un critère de « détresse sociale ».
La réflexion est en cours et le Gouvernement étudie actuellement ces propositions, sachant qu'il existe évidemment d'autres moyens d'assurer la gratuité ou le plafonnement du coût des appels pour certains publics. Ainsi, on pourrait envisager que certains usagers se voient reconnaître la possibilité d'appeler en PCV grâce à un code d'identification personnel ou que des lignes spécifiques moins coûteuses soient ouvertes pour certains publics.
Par ailleurs, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, la question du service après-vente des opérateurs de communications électroniques a été abordée lors de la rencontre du 25 septembre dernier avec les consommateurs et les opérateurs. À cette occasion, Luc Chatel a indiqué l'intention du Gouvernement de légiférer sur ce point dans le cadre du projet de loi sur la concurrence et les droits du consommateur qui sera déposé très prochainement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je vous donne l'assurance, monsieur le sénateur, que des dispositions concerneront la tarification de certaines communications électroniques.
L'interdiction qui pourrait être faite aux opérateurs de communications électroniques de recourir à des numéros surtaxés pour leurs services après-vente fait partie des possibilités actuellement à l'étude. En effet, il n'est pas juste qu'un client ait à supporter des surcoûts pour faire valoir une réclamation lorsque le service qu'il a souscrit n'est pas rendu. Tel est d'ailleurs le sens d'une décision récente du tribunal de grande instance de Paris, selon laquelle le professionnel « ne saurait faire supporter à son client le coût des moyens mis en oeuvre pour satisfaire son obligation de résultat ; qu' [il] doit donc en conséquence supporter le coût des frais de communication avec la hotline ».
En outre, il faut souligner que la quasi-totalité des opérateurs de communications électroniques ont déjà mis en place la gratuité des temps d'attente, ou vont très prochainement le faire, pour ce qui concerne les appels à destination de la hotline émanant de leur propre réseau. Le Gouvernement entend confirmer cette mesure dans le projet de loi sur la concurrence et les droits du consommateur.

Monsieur le secrétaire d'État, nous serons particulièrement attentifs à l'évolution de la situation. J'ai pris acte de vos d'engagements, et nous aurons très prochainement l'occasion de revenir sur ce sujet.

La parole est à M. José Balarello, auteur de la question n° 18, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Ma question concerne la rémunération des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités locales, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
La mission des agents concernés, communément appelés ACMO, prévue à l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985, « est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle [ils sont placés] dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions au travail, faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services ».
Afin de leur permettre d'acquérir et d'actualiser leurs connaissances dans ce domaine de compétence, les ACMO reçoivent, en application de l'article 4-2 du décret et de l'arrêté du 3 mai 2002, une formation préalable à leur prise de fonction d'un minimum de trois jours et une formation continue.
Je rappelle, monsieur le secrétaire d'État, que ces textes et la circulaire du 9 octobre 2001 ont également transposé dans le droit français la directive CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. L'article 7 de cette directive, dans son premier alinéa, précise notamment que, dans chaque collectivité territoriale, une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité.
Compte tenu de son caractère réglementaire et obligatoire, cette mission dévolue aux ACMO revêt une importance particulière dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cependant, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ne prévoit pas le versement d'une nouvelle bonification indiciaire à ces agents, alors que ces derniers exercent, en plus de leurs fonctions, une mission impliquant une technicité particulière en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'une responsabilité évidente.
Compte tenu de ces éléments, ne vous semblerait-il pas équitable, monsieur le secrétaire d'État, que ce décret soit complété, afin d'allouer aux ACMO une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points majorés ?
Monsieur le secrétaire d'État, c'est en ma qualité de parlementaire et de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes que j'interviens aujourd'hui auprès de vous.
Monsieur le sénateur, les décrets du 3 juillet 2006 ont réformé le dispositif territorial de la nouvelle bonification indiciaire, dite NBI, institué par le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, et ce dans un double objectif.
Il s'est agi, d'une part, de permettre le maintien de la NBI prévue pour certains fonctionnaires de l'État dont les compétences ont été transférées aux collectivités locales, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, d'autre part, de se conformer à la jurisprudence du Conseil d'État, qui a précisé à plusieurs reprises que l'attribution de cette nouvelle bonification indiciaire est fonction des missions exercées et non de l'appartenance à un grade ou à un cadre d'emplois.
Cette refonte a été élaborée à l'issue d'un travail de concertation avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, notamment au sein de la formation spécialisée n° 3, qui traite des questions statutaires. Elle n'avait toutefois pas pour objet d'actualiser la liste des emplois susceptibles de bénéficier de la NBI.
C'est pourquoi le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une telle actualisation rendue nécessaire par l'évolution des métiers depuis quinze ans au sein de la fonction publique territoriale, a confié à la même formation spécialisée la tâche d'évaluer le dispositif existant, notamment en vue de définir, le cas échéant, de nouveaux emplois pouvant bénéficier de la NBI.
Dans le cadre de ces travaux, qui devraient aboutir à l'élaboration d'un rapport avant la fin de l'année 2007, les représentants des personnels au sein de cette instance ont émis plusieurs propositions. Ils suggèrent notamment que les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficient d'une NBI, en raison de la technicité particulière de la fonction.
Compte tenu de l'impact financier des diverses propositions des représentants des personnels, il appartiendra au collège des employeurs territoriaux du CSFPT de se déterminer, afin que ces propositions figurent ou non dans le rapport qu'adoptera le Conseil en séance plénière.
Une concertation interministérielle sera ensuite engagée sur la base de ces propositions pour définir dans quelle mesure le dispositif existant devra être amendé. Le Gouvernement attend donc ce rapport avant de se prononcer.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.