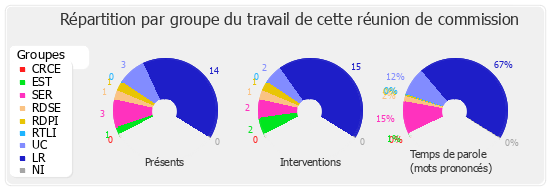Commission des affaires économiques
Réunion du 16 novembre 2016 à 9h35
Sommaire
- Loi de finances pour 2017
- Compte d'affectation spéciale cas « participations financières de l'état » - examen du rapport pour avis (voir le dossier)
- Mission « agriculture alimentation forêt et affaires rurales » - examen du rapport pour avis (voir le dossier)
- Proposition de résolution européenne sur l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques- examen du rapport et du texte de la commission (voir le dossier)
La réunion
La réunion est ouverte à 9h35.

Le compte d'affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l'État » retrace, en les isolant du budget général, les recettes et les dépenses patrimoniales liées à la gestion des participations financières de l'État.
Les recettes proviennent principalement de la cession des titres détenus par l'État ou du remboursement des avances d'actionnaires. Peuvent également y entrer des versements exceptionnels en provenance du budget général et destinés à financer des prêts. En revanche, les dividendes perçus sont reversés au budget général. Ils alimentent donc les dépenses courantes de l'État et non les dépenses du compte, ce que l'on peut regretter, car ils pourraient accroître la capacité d'investissement de l'État dans les entreprises porteuses de croissance, notamment les entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Les dépenses du CAS retracent les opérations d'investissement financier, comme l'achat d'actions ou la souscription d'obligations, ainsi que les opérations visant à réduire la dette des administrations au travers de dotations à la Caisse de la dette publique ou au Fonds de réserve pour les retraites. Sont également comptabilisés en dépenses les commissions bancaires et les frais juridiques directement liés à ces opérations.
L'examen de ce CAS constitue un exercice un peu particulier, car le bleu budgétaire comporte peu d'éléments prévisionnels : en dépense comme en recette, les sommes inscrites sont largement conventionnelles et ne renseignent pas vraiment sur les opérations à venir. C'est regrettable, car cela nous prive de vision stratégique.
Ainsi, en 2017, comme ce fut le cas les années précédentes, le projet de loi de finances (PLF) prévoit 5 milliards d'euros de recettes tirées de la cession de titres de l'État. Pourtant, selon toute vraisemblance, le produit des cessions effectivement réalisées en 2017 sera sans lien avec ce chiffre. Ainsi, en 2011, les cessions de titres n'ont rapporté que 280 millions d'euros sur les 5 milliards d'euros inscrits en recettes prévisionnelles. En 2012, ce fut 300 millions d'euros ; en 2013, 1,7 milliard d'euros ; en 2014, 1,6 milliard d'euros et, en 2015, 2,3 milliards d'euros. Les 5 milliards d'euros affichés chaque année en loi de finances initiale (LFI) ne sont donc pas un bon indicateur des cessions d'actifs réalisées au cours de l'année.
Cet écart entre les recettes inscrites en LFI et les recettes effectivement perçues ne révèle pas forcément un défaut de prévision. Il reflète plutôt la nature incertaine des opérations de cession. Un engagement ferme sur un montant de cessions serait absurde, car les décisions de vente dépendent étroitement de la situation des marchés, ainsi que de celle des entreprises concernées. Dans ce contexte mouvant, l'Agence des participations de l'État (APE) doit agir en opportunité et avec réactivité, dans le respect des grandes lignes de la doctrine de l'État actionnaire, sans être strictement tenue par les enveloppes prévisionnelles votées en LFI.
Toutefois, quelques recettes sont clairement identifiées : d'abord, un remboursement de 100 millions d'euros de l'avance d'actionnaire versée par l'État en 2007 à l'Agence de l'innovation industrielle - reprise depuis par OSEO Innovation, devenu Bpifrance ; ensuite, le remboursement de l'avance consentie par l'État en 2004 à la SOFIRAD, société financière de radiodiffusion - reprise également par Bpifrance - pour un montant de 180 millions d'euros ; enfin, le retour sur investissement de plusieurs fonds de capital-risque devrait rapporter environ 20 millions d'euros.
Pour les dépenses du CAS, une enveloppe de 6,5 milliards d'euros est prévue.
Il n'est pas prévu en 2017 que les ressources du CAS servent à financer le désendettement. Tant mieux ! En 2014 et 2015, les cessions d'actifs avaient servi à alléger la dette à hauteur, respectivement, de 1,5 et de 0,8 milliard d'euros. Or, si je suis totalement favorable à la réduction de la dette publique, j'estime absurde cette manière de traiter le problème, comme je l'ai expliqué lors de mes précédents rapports budgétaires. Si le rendement d'un euro d'actifs est supérieur à la charge d'un euro de dette, il vaut mieux conserver ses actifs pour profiter des revenus futurs et réduire le stock de dettes en utilisant les revenus générés par son portefeuille. J'espère donc que le choix fait cette année sera maintenu à l'avenir.
En outre, le Gouvernement envisage un montant exceptionnellement élevé d'investissements : 6,5 milliards d'euros, contre seulement 2,7 milliards d'euros en 2015 ou 1 milliard d'euros en 2014. À quoi correspond cette enveloppe considérable ? D'abord et surtout, au financement de la refondation de la filière électronucléaire.

Il est prévu pour cela de souscrire à une augmentation de capital d'Areva, sous réserve que la Commission européenne valide le montage envisagé par la France. Le plan prévoit la prise de contrôle d'Areva NP par EDF afin de rapprocher les branches « réacteurs » d'EDF et d'Areva. Un nouvel Areva verra le jour, recentré sur le cycle du combustible. Cette nouvelle société détiendra, via un apport partiel d'actifs, l'ensemble des activités actuelles d'Areva SA dédiées à la mine, à la conversion et à l'enrichissement du combustible, ainsi qu'au traitement aval - recyclage, logistique. Quant à Areva SA, elle continuera à exister, uniquement pour porter les actifs douteux dont on souhaite immuniser EDF et le nouvel Areva. Le plan de financement de ce montage prévoit des augmentations de capital pour un total de 5 milliards d'euros : 2 milliards d'euros iront à Areva, en charge des actifs douteux, et 3 milliards d'euros au nouvel Areva SA en charge du cycle du combustible. L'État y souscrira pour un montant compris entre 4 et 4,5 milliards d'euros.
La refondation de la filière suppose aussi d'accompagner EDF dans sa stratégie de développement. Celle-ci s'est enfin engagée dans une stratégie fondée sur la production d'électricité décarbonée. Cela se traduira par des investissements significatifs. J'y suis favorable. Dans ce cadre, l'État, actionnaire à 85 % d'EDF, a choisi de renforcer les capitaux propres de l'entreprise, en acceptant de percevoir ses dividendes en actions plutôt qu'en numéraire et en indiquant qu'il souscrira à hauteur de 3 milliards d'euros à l'augmentation de capital de 4 milliards d'euros prévue prochainement.
Au total, la recapitalisation de la filière va donc absorber entre 7 et 7,5 milliards d'euros d'investissement de la part de l'État.
Outre cet investissement massif dans la filière électronucléaire, les dépenses du CAS pour 2017 doivent aussi couvrir également plusieurs opérations déjà décidées.
D'abord, le financement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Un premier versement est intervenu en 2015 pour un montant de 60 millions d'euros. Un second doit être fait en 2017, à hauteur de 90 millions. Puis, l'État devra poursuivre la dotation de la Société pour le Logement intermédiaire, pour un montant encore indéterminé. Il devra participer à la recapitalisation de plusieurs banques multilatérales de développement, comme la Banque africaine de développement. Cela pourrait mobiliser environ 250 millions d'euros. Enfin, il faudra financer le renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (AFD), rendu nécessaire par l'entrée en vigueur des règles de Bâle III. Cela prendra la forme d'une souscription d'obligations perpétuelles, pour un montant d'environ 280 millions d'euros.
Si l'on additionne ces investissements et ceux que rend nécessaires le redressement de la filière électronucléaire, on trouve un total de dépenses de plus de 7,5 milliards d'euros en 2017. Il faut aussi tenir compte de la levée probable de l'option sur les actions d'Alstom, qui pourrait coûter 1,1 milliard d'euros à l'État. Les dépenses totales du CAS dépasseront donc 7,5 milliards d'euros en 2017, voire 8,5 milliards en cas d'achat des titres Alstom, soit 1 à 2 milliards d'euros de plus que la somme inscrite au budget. Il est donc clair que la présentation du CAS pour 2017 n'est pas réaliste.
Je me demande vraiment comment seront financées ces dépenses.
De manière conventionnelle, le montant des recettes tirées des cessions pour 2017 est fixé à 5 milliards d'euros. Supposons que, pour une fois, ce chiffre ne soit pas conventionnel et que l'État vende effectivement pour 5 milliards d'euros de titres. Comment céder un tel volume dans des conditions favorables ? Le contexte boursier est très déprimé et la majorité des titres cessibles de l'État relèvent du secteur de l'énergie, en chute libre depuis deux ans. Bref, en l'absence d'hypothèses positives ou négatives claires, il est difficile de prendre position.
Au cours de l'année écoulée, la composition du portefeuille est restée stable. L'APE gère des participations dans 81 entités. Il s'agit en majorité de sociétés anonymes : on en compte 55, dont 13 sociétés cotées, certaines étant des « navires amiraux » de l'économie française, dans les secteurs de l'énergie (EDF, Engie, Areva), de l'aéronautique et de la défense (Airbus, Safran, Thales), de l'automobile (Renault, PSA) ou du transport aérien ( Air France). On trouve aussi des sociétés d'économie mixte, des établissements publics à caractère industriel et commercial (RATP, SNCF Réseau) et des établissements publics chargés de la gestion d'infrastructures portuaires. Figure aussi la BPI, à laquelle l'État participe à hauteur de 10,8 milliards d'euros.
Si la composition du portefeuille a peu changé, il n'en va pas de même de sa valeur financière. Au 30 juin 2016, celle-ci était estimée à 90 milliards d'euros, contre 110 milliards d'euros un an plus tôt, soit un recul de 18 % : nous avons perdu 20 milliards d'euros. Cette baisse ne résulte pas d'une intensification des cessions de titres. Depuis mon précédent rapport, l'APE a cédé des actions Safran pour un montant de 753 millions d'euros et a procédé à la vente des sociétés de gestion des aéroports de Lyon et Nice, après celui de Toulouse, pour 1,7 milliard d'euros. Dans le même temps, l'État a acquis des titres pour 2,5 milliards d'euros. Le solde est donc positif.
C'est en réalité la chute de la valeur boursière des titres qui explique ce recul de 20 milliards d'euros. Si le portefeuille coté hors énergie a plutôt bien résisté, puisqu'il recule moins que le CAC 40 sur la même période, les titres du secteur de l'énergie se sont effondrés, de 57 % en un an pour Areva, de 45 % pour EDF, de « seulement » 12,8 % pour Engie. Il y a pourtant des années que nous réclamons une diversification des titres détenus par l'APE. La forte concentration du portefeuille sur le secteur de l'énergie a eu pour conséquence une exposition accrue à la volatilité des valeurs de ce secteur. Une très forte baisse des valeurs boursières de l'énergie s'était déjà produite entre 2010 et 2012. Elle fut suivie d'une très forte hausse entre 2012 et 2013, avec un doublement de l'action d'EDF. Nous pouvons espérer que la séquence actuelle est similaire - pour ma part, j'en doute.
La baisse des valeurs énergétiques a mécaniquement conduit à un rééquilibrage en valeur du portefeuille de l'État : le secteur énergétique ne représente désormais que la moitié du portefeuille géré par l'APE, contre 61 % il y a un an. Ce portefeuille demeure néanmoins structurellement peu diversifié, ce qui est regrettable. Sur les 81 entreprises entrant dans le périmètre de l'APE, les 13 entreprises cotées représentent les deux tiers du patrimoine financier de l'État.
Je signale une diversification du profil des administrateurs nommés par l'État. Ces dernières années, j'avais souhaité qu'il soit davantage fait appel à des administrateurs issus du monde de l'entreprise. Ce mouvement semble en marche et je m'en félicite. Sur les 92 administrateurs nommés au cours de l'année écoulée, la moitié n'étaient pas des agents publics. Je n'ai rien contre ces derniers, mais à Airbus, par exemple, il serait bon d'avoir, au lieu de quatre jeunes énarques, au moins deux chefs d'entreprises. Cela peut dynamiser la gestion du portefeuille.
Les dividendes perçus par l'État devraient atteindre en 2016 un montant de 3,6 milliards d'euros. Les cinq principaux contributeurs seront EDF, Engie, Renault, Orange et Aéroports de paris. Ils représentent près de 85 % du montant total versé. C'est considérable ! Dans n'importe quel fonds financier privé, des décisions urgentes seraient prises.
L'État actionnaire doit évidemment concilier l'objectif financier de retour sur investissement et son rôle d'accompagnement de long terme d'entreprises qui, par leur taille ou leur domaine d'activité, jouent un rôle stratégique pour l'économie et l'indépendance du pays. Actuellement, la priorité doit être clairement donnée au renforcement des capacités financières des entreprises du portefeuille. Or certaines sont confrontées à des besoins financiers importants. Des dépréciations d'actifs massives ont été enregistrées cette année dans le portefeuille de l'APE : 12,5 milliards d'euros au sein du groupe SNCF, 3,5 milliards d'euros à EDF et 8,7 milliards d'euros à Engie. Par ailleurs, outre la recapitalisation de la filière électronucléaire, l'ensemble des entreprises doivent faire face aux enjeux de la transformation numérique. Plusieurs sociétés, comme Orange, La Poste, EDF, Engie, Thales, Safran, PSA, Renault, La Française des jeux, se sont engagées dans un plan d'action global, portant sur l'innovation, l'adaptation de la stratégie de distribution, l'investissement dans de nouveaux systèmes, et sur des actions d'information et d'adaptation de leurs salariés. Tout cela engendre des besoins importants en capitaux.
Cette situation a conduit l'État actionnaire à adapter ses prétentions en matière de dividendes. Après avoir culminé à 5,5 milliards d'euros en 2008 et 2009, les dividendes versés à l'État se sont établis à un plateau de 4,4 milliards d'euros entre 2010 et 2013. Depuis lors, ils sont en recul : 4,1 milliards d'euros en 2014, 3,9 milliards d'euros en 2015 et 3,6 milliards d'euros en 2016. Il est peu probable que l'on assiste à une remontée dans les années prochaines. Par ailleurs, l'État a fait le choix depuis la fin 2015 de percevoir le dividende EDF en titres plutôt qu'en numéraire. On peut donc dire que la politique de dividendes de l'État correspond à ce que l'on peut attendre d'un actionnaire de référence responsable. C'est incontestable.
Pour conclure, compte tenu des incertitudes qui affectent les prévisions de dépenses et de déficit du CAS « Participations financières de l'État », je demanderai à la commission de rejeter ses crédits. J'ai eu des entretiens avec les directeurs successifs de l'APE. M. Azéma avait une belle orientation industrielle, mais il n'admettait guère la nécessité de chercher des administrateurs dans le secteur privé. Avec M. Turrini, le contact a été quasi inexistant. Nous avons de bonnes relations avec M. Vial, une personne brillante qui paraît tout à fait convenir. Il est venu ici pendant deux heures avec ses collaborateurs. Il n'a été nommé qu'en octobre, et n'a pas rencontré son prédécesseur ! Imaginez, dans une entreprise, qu'un gestionnaire sortant ne rencontre pas son successeur et qu'aucun délai ne soit ménagé pour la passation de pouvoirs...
Dans la situation actuelle, je constate que l'on n'affiche pas les bons résultats, et je le regrette. Le résultat apparent est ce qu'il est, mais il ne traduit pas véritablement l'exacte situation, ce qui fait craindre le report de dépenses lourdes sur les années à venir, sans contrepartie en termes d'objectifs stables. Nous ne lisons rien dans ce CAS sur des projets de cession ou de participation dans des activités susceptibles de créer de l'emploi ou de susciter des dividendes. En revanche, nous lisons un certain statisme, d'autant plus inquiétant que les risques pris ne sont pas compensés par des évolutions positives à court ou à moyen terme. En tout cas, ce CAS ne traduit pas une vision correcte de la situation pour les trois ou cinq ans à venir.

Il est paradoxal que nous ayons ce débat au moment même où la commission des finances se réunit pour discuter de la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances qui sera déposée par la majorité. Ainsi, les dépenses ne seront pas votées en séance publique. Et nous en débattons ici : c'est du jamais-vu au Sénat ! Vos interrogations et vos inquiétudes sont légitimes, monsieur le rapporteur. Mais, si la majorité refuse le débat, cela pose un problème démocratique majeur. Le rôle des parlementaires est de voter non seulement les lois, mais aussi le budget de la nation.
Je partage votre analyse de l'évolution des dividendes, qui ne doivent pas être l'alpha et l'oméga de la stratégie de l'État. En 2017, les participations de l'État subiront l'impact des 7 milliards d'euros pour la filière nucléaire. L'État devient un actionnaire stratège : c'est son rôle ! Nous devons fixer l'horizon et non le bout de nos chaussures. Il est donc important que les participations de l'État varient selon les opportunités économiques.
Je relève, pour m'en étonner, que notre commission n'est pas saisie du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises », au sein de la mission « Investissements d'avenir » : cela devrait nous concerner, d'autant que trois actions sont importantes pour l'avenir industriel de notre pays ! L'action « accompagnement et transformation des filières » est dotée de 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. L'action relative à « l'industrie du futur » renforce la compétitivité et notamment de l'automatisation et de l'internet industriel. Le sujet n'est plus en effet le coût de notre main-d'oeuvre, en tout cas par rapport à l'Allemagne, mais la modernisation de nos entreprises pour aborder l'économie numérique. Enfin, troisième action, l'adaptation et la qualification de la main-d'oeuvre ne sont pas à négliger. Il serait important de montrer notre intérêt pour ces trois actions qui figurent en bonne place dans le PLF 2017.
Les représentants de l'État doivent être en relation plus étroite avec la réalité industrielle. La formation a son importance, mais elle ne doit pas être le seul critère. Il faut aussi des représentants du monde de l'industrie, car les intérêts de l'État ne sont pas uniquement financiers à court terme.
Mais à quoi bon débattre de ces crédits, alors même que la commission des finances décide de ne pas en discuter en séance publique ? Quel paradoxe !

Ce n'est pas la première fois que le Sénat voterait une question préalable sur un PLF. Il l'a déjà fait en 1992 - sans parler du fait que la majorité sénatoriale de l'époque avait refusé, en 2012, de débattre de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013.

À quoi servons-nous ? Pas seulement à voter la loi, ou le budget, mais aussi à contrôler l'action du Gouvernement. N'importe quel rapporteur a le droit de débarquer dans un ministère et d'exiger tout renseignement de son choix. En l'espèce, le travail de M. Chatillon est une mission impossible, car on parle toujours des grands noms, mais, en réalité, l'État détient des participations dans des milliers d'entreprises. Notre collègue n'en a pas moins réalisé un rapport remarquable, et nous lui accordons toute notre confiance : nous ne voterons pas ces crédits. Mais il est dommage que le rapporteur n'ait pas eu les moyens de fouiller davantage, car la prise de décisions dans ce domaine reste très secrète. On ne sait pas du tout comment les représentants de l'État sont choisis, sauf dans les plus grandes entreprises. Ailleurs, ce sont souvent des fonctionnaires, nommés moins pour leurs compétences que pour les récompenser de services rendus. Comment sont prises les décisions de vente ou d'acquisition ? Des éléments restent secrets.
Je suis très inquiet pour Areva. En l'occurrence, les deux fonctionnaires nommés par l'État ne prennent aucune décision, et le dossier est géré par le Gouvernement. Du coup, nous ne savons rien. Les deux représentants n'ont pas eu leur mot à dire, car les choix sont purement politiques. Les besoins en capitaux sont beaucoup plus importants que ce qui figure dans le budget. Et ce n'est pas l'arrivée des Chinois, annoncée il y a trois jours, qui résoudra le problème. Je souhaite que le rapporteur puisse examiner plus précisément ce dossier inquiétant.

Si la LOLF a sanctuarisé le rôle du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, qui peuvent en effet exercer des contrôles sur pièces et sur place, ce droit n'est pas étendu aux rapporteurs pour avis. Reste que ceux-ci peuvent exercer leur autorité : je n'imagine pas un instant qu'un interlocuteur refuse de leur communiquer quoi que ce soit. D'ailleurs, il leur suffirait de s'associer à un rapporteur spécial de la commission des finances - voire au président de votre commission - pour lever le blocage.

Un rapporteur spécial de la commission des finances examine aussi ce budget.

Nous suivrons l'avis du rapporteur. Nous nous réjouissons d'avoir été entendus, et que des représentants de l'industrie soient nommés par l'APE. C'est essentiel, et il faut continuer. Je déplore, comme le rapporteur, la confusion entre la stratégie de l'État et la gestion active du fonds. Les règles doivent être plus précises. Je regrette notamment que les dividendes ne soient pas gérés par l'APE. Nous avons perdu 20 milliards d'euros. Certes, on ne peut pas comparer cette performance avec celles des gestionnaires de fonds privés. Mais nous pouvons faire mieux.

Je suivrai l'avis du rapporteur, d'autant que plusieurs des remarques qu'il avait faites l'an dernier n'ont pas été suivies d'effet. Ce CAS est un outil industriel important. Il peut aussi servir en cas d'urgence pour marquer, de temps en temps, que tous les coups ne sont pas permis. Nous devrions profiter de l'expérience de M. Chatillon pour publier un rapport sur les règles du jeu à fixer. Quelle part de secret faut-il pour que soit préservée la liberté d'action du Gouvernement ? Ces participations, en somme, s'apparentent à un fonds souverain. Et un fonds souverain est un excellent levier de politique économique...

Les actions relatives à la modernisation n'entrent pas dans le budget du CAS.
Pourquoi ne pas gérer ces participations avec un conseil de surveillance de sept ou huit personnes et un directoire de trois membres, qui devraient suivre des orientations précises que nous aurions votées ? Si une entreprise est en difficulté, faut-il obligatoirement la recapitaliser ? Ne peut-on la remplacer par une autre ? Il y a 3,5 milliards d'euros sur les comptes de ce CAS. À quoi servent-ils ? Imaginez leur effet si nous en consacrions la moitié à accompagner une dizaine d'ETI dans des domaines stratégiques ! Cela créerait des emplois et produirait des résultats, ce qui serait mieux que de recapitaliser des structures condamnées à plus ou moins long terme. Les valeurs boursières évoluent, mais les cinq premières participations occupent trop de place dans le portefeuille. Les changements récents aux États-Unis pourraient bouleverser la donne : si les droits de douane explosent, que deviendront les 3 000 milliards de dollars des fonds chinois investis aux États-Unis ?
Chez nous, l'agroalimentaire est en déconfiture. Or les agriculteurs créeront de la valeur avec des produits transformés. Nous devons les y aider. Nous finançons des start-up. Très bien, mais il faut aussi accompagner les pôles de compétitivité. Il suffirait de consacrer 10 % ou 15 % des crédits de ce compte pour aider des entreprises créatrices d'emplois. Cela passe par une réorientation de la direction de l'APE. Avec qui l'actuel directeur échange-t-il ? Il faut créer des conseils.
La commission émet un avis défavorable à l'adoption des crédits relatifs au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

L'examen du budget de l'agriculture constitue toujours l'occasion d'un tour d'horizon de la politique agricole. Après des années de baisse de ses crédits, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) disposera en 2017 d'une dotation budgétaire de 5,12 milliards d'euros, soit 15 % de plus qu'en 2016. L'essentiel de la hausse relève de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », qui passe d'un peu moins de 2,8 milliards d'euros à presque 3,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE). Les crédits consacrés à l'enseignement agricole relèvent d'autres missions, et augmentent plus faiblement.
Nous examinons également le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » (CASDAR), doté en 2017 comme en 2016 de 147,5 millions d'euros. Ce compte est largement surévalué. Il est en effet alimenté par la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles. La conjoncture rend peu probable que cette taxe rapporte autant en 2017 que les années précédentes. Or un compte spécial doit être à l'équilibre. De moindres recettes se traduiront nécessairement par de moindres dépenses. Déjà, en exécution 2016, les dotations en provenance du CASDAR ont été réduites. Ainsi, FranceAgrimer a eu 2 millions d'euros de moins sur les actions de génétique animale. Les actions financées par le CASDAR comme les programmes pluriannuels des instituts techniques agricoles ou les programmes de développement menés par les chambres d'agriculture risquent fort de subir des retards de paiement.
Les crédits d'État sont complétés par des recettes provenant de taxes fiscales affectées, par exemple la redevance versée par les abattoirs, qui permettent d'abonder des lignes budgétaires qui ne figurent pas au budget de l'agriculture. Ces taxes représentent 428 millions d'euros.
Au total, les dépenses de l'État en faveur de l'agriculture s'élèvent à 5,7 milliards d'euros.
Les dépenses effectuées directement par l'État ne résument pas à elles seules le soutien public à l'agriculture. En effet, l'essentiel des dispositifs de soutien relève d'un financement communautaire, qui s'élèvera à près de 9 milliards d'euros en 2017 : 7,3 milliards d'euros sur le premier pilier et 1,6 milliard d'euros sur le deuxième pilier. Enfin, les collectivités territoriales apportent également un soutien croissant à l'agriculture, notamment à travers les cofinancements fournis dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC). Les dernières évaluations de la contribution des collectivités territoriales donnent un chiffre d'un peu plus de 1 milliard d'euros. Le chiffre reste à vérifier.
Le soutien à l'agriculture ne passe pas seulement par des crédits, nationaux ou européens. Il prend aussi la forme d'allégements de charges fiscales ou sociales. Le coût de l'ensemble des dispositions fiscales en faveur de l'agriculture et de la forêt, évalué dans le projet de loi de finances pour 2017, dépasse 1,7 milliard d'euros, le principal poste étant l'exonération de taxe sur les carburants utilisés en agriculture. Ce montant a plutôt tendance à baisser depuis 2013. À l'inverse, le coût des allégements de charges sociales a plutôt tendance à augmenter, et représentera 4,8 milliards d'euros en 2017, dont une partie concerne toutefois la transformation et les services agricoles.
Les concours publics à l'agriculture atteignent donc 20 milliards d'euros, dont près de la moitié financés par la PAC. À ce montant s'ajoutent les subventions pour équilibrer le financement du régime de protection sociale agricole, soit 13,4 milliards d'euros par an.
Au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », la répartition des moyens entre programmes évolue en 2017, puisque le programme 149, sur la forêt, et le programme 154, qui portait les principaux dispositifs de soutien à l'économie agricole, ont été fusionnés pour former le nouveau programme 149, intitulé « Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières ». C'est le plus important programme de la mission, avec plus de 2,2 milliards d'euros. C'est sur ce programme qu'intervient la hausse des crédits de près de 600 millions d'euros, dont 480 millions pour compenser auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) les allégements de charges sociales des exploitants agricoles décidés début 2016.
Les crédits du programme 206, consacré à la sécurité et la qualité sanitaire de l'alimentation, augmentent un peu pour passer au-dessus des 500 millions d'euros. Enfin, le programme 215 consacré à la conduite et au pilotage des politiques de l'agriculture porte les crédits de personnel du ministère et des services déconcentrés. Ses crédits baissent légèrement, passant de 658 à 653 millions d'euros, ce qui correspond à une réduction de 200 postes environ sur ce programme.
Certaines lignes nous intéressent plus particulièrement.
Tout d'abord, l'installation et le renouvellement des générations. Nous vivons actuellement une situation curieuse. Le taux de remplacement est bon, de l'ordre de 75 à 80 %, car nous enregistrons peu de départs : beaucoup d'agriculteurs qui auraient dû normalement partir en retraite entre 2010 et 2015 sont partis plus tôt en profitant du dispositif de départ anticipé qui a fonctionné jusqu'en 2009. En sens inverse, beaucoup d'agriculteurs qui auraient pu partir en retraite à 60 ans ont, sous l'effet des nouveaux textes législatifs, retardé leur cessation d'activité. Mais cette situation ne va pas durer et les départs vont s'accélérer dans les années qui viennent, pour atteindre probablement 30 000 par an vers 2020. Serons-nous alors capables de les remplacer par de jeunes agriculteurs ?
Les crédits budgétaires pour l'installation sont maintenus en 2017. La suppression des crédits sur les prêts bonifiés, dispositif peu intéressant compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt, est compensée par la hausse de ceux de la dotation jeunes agriculteurs (DJA), qui s'élèvent pour 2017 à 40 millions d'euros. L'enveloppe consacrée aux stages à l'installation est en légère augmentation, avec 2 millions d'euros. Enfin, l'accompagnement de l'installation, qui relève du fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture (FICIA), ne dispose pas de crédits budgétaires, comme en 2016, mais doit faire l'objet d'une dotation à partir de la taxe sur les terrains nus rendus constructibles, évaluée à 12 millions d'euros.
Le ministère dispose donc des marges de manoeuvre budgétaires pour réaliser l'objectif de 6 000 installations aidées par an. Il convient de rester vigilant pour que l'installation reste une priorité de la politique agricole, car on constate depuis quelques années une non-consommation inquiétante des crédits à l'installation.
Ensuite, la gestion des crises. Comme chaque année, le budget 2017 est très peu doté en crédits de crise : 1,8 million d'euros pour Agridiff, 1,5 million d'euros pour le fonds d'allégement des charges, 1,5 million d'euros pour les aides à la cessation d'activité. Clairement, le budget n'est pas à la hauteur des besoins. Je rappelle que le dernier plan de soutien à l'élevage comportait une enveloppe d'allégement des charges de 100 millions d'euros.
À chaque crise, il est donc nécessaire de solliciter des crédits par redéploiements budgétaires ou ouvertures de crédits en loi de finances rectificative (LFR). Ainsi, on attend pour 2016 l'ouverture de crédits à hauteur de 157 millions d'euros uniquement pour le Fonds d'allégement des charges mobilisé dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des entreprises agricoles. On attend aussi des crédits pour compenser auprès des collectivités territoriales les pertes de recettes liées aux mesures de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Calculé au plus juste, le budget agricole ne dispose d'aucune marge de manoeuvre pour faire face aux crises et se révèle donc très fragile.
Enfin, les crédits consacrés à la forêt. Tout d'abord, ils ne font plus l'objet d'un programme, comme nous l'avons vu, mais d'une simple action : certains acteurs de terrain en tirent un sentiment de rétrogradation dans la nomenclature budgétaire. Ce réaménagement n'empêche pas la comparaison à structure constante des crédits consacrés à la forêt : ceux-ci diminuent de 4 millions d'euros par rapport à 2016. La tendance des crédits à la forêt reste donc baissière, alors même que leur niveau est au plancher.
Près des trois quarts des crédits de l'action 26 sont alloués à la gestion des forêts publiques avec, principalement, le versement compensateur de l'État à l'Office national des forêts (ONF), maintenu depuis plusieurs années à 140,4 millions d'euros. Comme son nom l'indique, ce versement vise à compenser la différence entre les charges de l'ONF imputables au régime forestier et les recettes, ou « frais de garderie », versées par les communes en contrepartie des services rendus pour gérer les forêts communales. À la satisfaction des communes, ces frais de garderie n'ont pas été augmentés, comme cela avait été envisagé, lors de la renégociation du nouveau contrat de performance de l'ONF. En contrepartie, les communes forestières se sont engagées à augmenter les coupes de bois, avec un objectif fixé à 8,5 millions de mètres cubes en 2020. Cela implique toutefois de surmonter la difficile acceptabilité sociale des coupes. C'est pourquoi les campagnes d'information organisées par l'ONF sont indispensables pour mieux faire connaître à nos concitoyens la nécessité de la régénération forestière, même si la repousse n'est visible qu'après plusieurs dizaines d'années, ce qui crée un impact psychologique.
Pour la forêt privée qui représente 75 % des surfaces boisées, la subvention au profit du Centre national de la propriété forestière s'établit à 15,1 millions d'euros, en baisse de 2 %. Les représentants de ce centre, qui oriente la gestion de la forêt privée, s'inquiètent de la perspective de devoir recruter des fonctionnaires au moment où l'ONF, en sens inverse, fait appel à des apprentis ou à des emplois aidés. Le ministre, quand nous l'avons entendu en commission des affaires économiques, a surtout insisté avec talent sur les 28,5 millions d'euros d'AE alloués au Fonds stratégique de la forêt et du bois et destinés à la régénération et au reboisement. On estime à 150 millions d'euros les crédits nécessaires à la replantation de 340 millions de plants. En même temps, il a répété à plusieurs reprises qu'il se joignait à l'« appel de Mende », en rendant hommage à l'initiative lancée par Philippe Leroy et le groupe sénatorial d'études Forêt- Bois.
Tout le problème, c'est que l'appel de Mende est un plaidoyer pour le reboisement - car notre forêt vieillit - et pour que la France joue enfin sa carte forestière de façon beaucoup plus dynamique. Il y a là un énorme potentiel d'emplois et de croissance verte sur nos territoires. Or, malgré la bonne volonté de notre ministre, la réalité du financement de la forêt est celle d'un stop and go des crédits budgétaires et d'une tuyauterie assez compliquée puisqu'aujourd'hui c'est par le biais de la mission « écologie » et du fonds chaleur, géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) que transitent les sommes les plus importantes allouées à la forêt.
Le bon sens consisterait à rationaliser les canaux de financement et à garantir en permanence à notre politique forestière, qui a besoin d'une vision à long terme, 150 millions d'euros par an. Cela nous permettrait de rattraper notre retard par rapport aux autres nations forestières, et de rassembler les acteurs de la forêt autour d'un objectif d'intérêt national. Comme vous le savez, l'irrecevabilité financière de l'article 40 est devenue un couperet qui nous interdit de présenter un amendement dans ce sens. Cela ne doit pas nous empêcher de formuler des propositions cohérentes, et nous soutenons l'idée d'un mécanisme qui consisterait d'abord à rappeler que la filière forêt-bois compense environ le cinquième des émissions françaises de gaz à effet de serre. En contrepartie, l'État pourrait abonder le fonds stratégique à hauteur de 150 millions d'euros par an en prélevant, par exemple, une toute petite partie de la composante carbone de la contribution climat-énergie.
Pour conclure, j'émets un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

Vous connaissez bien la situation de l'agriculture française. Dans la filière laitière, le prix des 1 000 litres est passé de 361 euros en 2014 à 307 euros en 2015, puis 280 euros au troisième trimestre 2016. Nous notons toutefois une légère reprise depuis quelques semaines. Vous connaissez aussi l'évolution de la filière porcine. Quant à celle des palmipèdes gras, elle a dû faire face au vide sanitaire mis en place. Les grandes cultures ont souffert d'un été très pluvieux, et d'un niveau préoccupant des cours mondiaux, surtout pour les céréales.
C'est dans ce contexte assez déprimé que nous allons aborder l'année 2017. Il faudra donc passer la vitesse supérieure en matière de gestion des risques économiques dans les exploitations agricoles, qu'il faudra moderniser tout en compensant les handicaps naturels.
La gestion des risques en agriculture est décisive pour faire face aux aléas climatiques. Or elle est un peu le parent pauvre du budget 2017.
Au niveau individuel, la déduction pour aléas (DPA) est aujourd'hui le seul instrument d'encouragement à l'épargne de précaution. Or elle ne décolle pas. Les derniers chiffrages des chambres d'agriculture indiquent que la DPA représentait 19 millions d'euros pour 6 900 bénéficiaires en 2015 contre 39 millions d'euros pour 11 400 bénéficiaires en 2014. Le budget 2017 reconduit la DPA à l'identique, mais il faut s'interroger sur sa faible attractivité. Dans la proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculture, nous proposions de la simplifier et d'augmenter les plafonds.
Au niveau collectif, le développement de l'assurance multirisque climatique - ou assurance-récolte selon son ancienne dénomination - que l'on avait observé entre 2010 et 2013 s'est arrêté net. Le taux de couverture a même régressé depuis 2013 en grandes cultures. En 2016, cette baisse semble enrayée, mais la couverture assurantielle est encore très partielle : 26 % des surfaces en grandes cultures et 22,9 % en viticulture, 12,5 % en maraîchage et 2,6 % en arboriculture. Rien n'est fait au niveau budgétaire pour encourager l'assurance : une enveloppe de 100 millions d'euros est prévue pour subventionner la souscription des contrats d'assurance par les agriculteurs en 2017. Mais depuis 2016, cette enveloppe est intégralement prise sur des crédits européens et il n'y a plus de cofinancement national. Or les besoins ont été estimés en 2016 à 106 millions d'euros et devraient progresser, notamment sous l'effet des hausses de primes de 5 à 10 % du fait de la sinistralité élevée en 2016. On risque donc de manquer de fonds et de devoir minorer le taux de subvention en dessous de 65 % - ce qui serait une catastrophe - pour tenir dans l'enveloppe.
L'incertitude pour les agriculteurs sur le niveau réel de prime versée, combinée au caractère tardif du versement de la subvention, constituent des freins réels à la souscription d'assurances. La souscription des contrats est faite à un moment où les indications budgétaires de compensation ne sont pas connues. Enfin, l'exigence d'un sinistre avec 30 % de pertes pour faire jouer l'assurance, avec une franchise de 30 %, rend l'assurance peu attractive.
Le contrat-socle a été mis en place l'année dernière pour permettre aux agriculteurs de moduler leurs niveaux de couverture, avec des niveaux d'aide qui évoluent en fonction de la couverture choisie. Les assureurs proposent des produits encore plus élaborés pour couvrir les risques de rendement et les risques de prix. Si la dynamique de souscriptions d'assurances multirisques climatiques reprenait en 2017, ce que nous souhaitons, il faudrait dégager de nouveau des crédits nationaux pour y faire face. Le fait qu'ils ne soient pas prévus au budget est le signe d'un relatif désintérêt pour l'assurance qui est tout à fait regrettable.
Une autre inquiétude concerne l'alimentation du Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE). Celui-ci doit faire face à des dépenses importantes liées à différents phénomènes. Or, avec l'assèchement de l'enveloppe européenne sur les assurances, le FMSE pourrait se retrouver sans soutiens publics.
Enfin, l'instrument ultime de gestion des risques est le fonds des calamités agricoles. Comme les années précédentes, le budget 2017 ne prévoit pas de dotation pour les calamités agricoles, des crédits devant être ouverts en cours d'année en cas d'événements climatiques rendant son intervention nécessaire. Si les années 2013 et 2014 ont nécessité peu d'indemnisations au titre des calamités, l'année 2015 a été gourmande en crédits : 180 millions d'euros ont été nécessaires pour faire face à la sécheresse. Pour 2016, les indemnisations devraient aussi être élevées.
Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la pertinence des deux décisions prises l'année dernière. D'abord, la division par deux du taux de la taxe additionnelle sur les contrats d'assurance souscrits par les agriculteurs conduit à réduire les ressources du régime des calamités agricoles de 120 à 60 millions d'euros. Ensuite, la ponction des 255 millions d'euros de réserves du Fonds national de gestion des risques agricoles (FNGRA) a totalement asséché les ressources du fonds et oblige à ouvrir sans cesse des crédits nouveaux en cas de calamité. La politique de gestion des risques du Gouvernement me paraît donc à la fois peu prudente et très peu ambitieuse. Si l'on veut développer l'assurance, il faudra que les moyens suivent.
Concernant la modernisation des exploitations et le soutien à l'investissement, indispensable pour améliorer la compétitivité et la performance des exploitations, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), lancé en 2015, voit ses crédits pour 2017 maintenus quasiment à la même hauteur que dans le budget 2016, soit 84,5 millions d'euros. Cette enveloppe est complétée par des crédits européens, mais aussi des crédits des régions dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, ou encore des Agences de l'eau ou de l'ADEME. Au final, le Gouvernement indique que le PCAE permet de mobiliser 350 millions d'euros de subventions annuelles, permettant de financer 1 milliard d'euros d'investissements, dans l'attente des futurs dispositifs régionaux.
Le PCAE est donc censé jouer un rôle de levier pour le développement de l'investissement en agriculture. Encore faut-il que les versements suivent. Or nous observons des retards importants. Des retards de paiement par l'ASP ont été aussi constatés sur les avances de trésorerie remboursables (ATR) que les agriculteurs devaient recevoir au titre des aides PAC du premier pilier en octobre. La solution n'est donc pas optimale.
Une dotation supplémentaire de 11 millions d'euros est attribuée pour 2017 afin de résoudre toutes ces difficultés, qui ont pénalisé les agriculteurs en cette année si difficile pour leur trésorerie. Au-delà des lignes budgétaires, j'insiste sur la nécessité de tout mettre en oeuvre dans les services de l'État et les établissements publics rattachés pour ne pas freiner la dynamique d'investissement.
L'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) vise à maintenir l'activité agricole dans les zones défavorisées : montagne, piémont et zones défavorisées simples. Le budget 2017 voit son enveloppe augmenter encore de 3 %, passant de 256 à 264 millions d'euros. Il s'agit d'appliquer l'engagement pris fin 2013 de revaloriser de 15 % l'aide entre 2014 et 2017. Par ailleurs, l'ancienne prime herbagère agro-environnementale (PHAE) a été supprimée pour être intégrée à l'ICHN. L'ICHN a été également ouverte à de nouveaux bénéficiaires : les éleveurs laitiers en zones défavorisées simples et zones de piémont et les éleveurs de porcs de montagne.
En tenant compte des crédits européens du deuxième pilier, l'ICHN atteint plus d'1 milliard d'euros. C'est donc une aide tout à fait essentielle, qui concerne près de 100 000 exploitations.
Mais l'inquiétude monte avec le projet de nouvelle carte des zones défavorisées simples (ZDS). Cette nouvelle carte ne concerne pas les zones de montagne, mais uniquement les zones défavorisées simples. La réglementation communautaire exige en effet que la carte de cette dernière catégorie soit définie en fonction de critères objectifs : pente, basses températures, sécheresse, excès d'eau, profondeurs des sols, etc... Or l'application stricte de ces critères conduit à écarter du bénéfice de l'ICHN de très nombreuses exploitations. Le projet de carte des zones soumises à contraintes naturelles appliquant strictement les critères a été publié début septembre et on en voit très concrètement les effets sur nos territoires : des départements entiers ne bénéficieront plus de l'ICHN.
Certes, à l'échelle nationale, on dispose de marges de manoeuvre pour définir des zones soumises à des contraintes spécifiques qui, s'ajoutant à la liste des communes classées en ZSCN, pourront continuer à bénéficier de l'ICHN. Mais ces zones ne doivent pas représenter plus de 10 % du territoire national. Cela fait tout de même 5 millions d'hectares. Cette souplesse sera-t-elle suffisante pour rattraper toutes les zones défavorisées qui seraient rayées de la carte ? L'inquiétude des professionnels est forte.
La nouvelle carte doit être présentée au plus tard au 1er avril 2018, ce qui fera de 2017 une année de discussions et de choix. J'en appelle à la plus grande vigilance du Sénat dans l'application de cette réforme, qui peut avoir des effets massifs dans certaines communes : les exploitations pourraient perdre plusieurs milliers d'euros en sortant du bénéfice de l'ICHN. Nous attendons des précisions.
Pour conclure, j'émets le même avis défavorable sur l'adoption des crédits de la mission : « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d'affectation spéciale.

Le simple fait que les crédits consacrés à l'agriculture et la forêt augmentent dans le PLF pour 2017 pourrait suffire à qualifier cette année de bon millésime.
Nous avons comme politique constante de rechercher un niveau très élevé de sécurité sanitaire en agriculture. Il y va de la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires qui en sont issus. Ce haut niveau de sécurité sanitaire n'est pas seulement un objectif français mais un objectif européen, porté par une réglementation communautaire très stricte. Il ne peut être garanti que par des moyens à la hauteur de nos ambitions, ce qui est d'autant plus difficile que l'on assiste d'une part à une montée des menaces sanitaires dans le domaine tant végétal qu'animal et, d'autre part, à une montée des attentes de nos concitoyens en matière d'expertise sur les risques.
C'est le programme 206 qui porte les moyens de l'État en matière de sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. Il augmente dans le projet de budget pour 2017 de 4,3 % pour s'établir à près de 510 millions d'euros, traduisant concrètement la priorité donnée par le Gouvernement à la sécurité sanitaire.
Les effectifs sont renforcés cette année encore de 60 postes. C'est la dernière tranche de l'augmentation de 180 postes en trois ans lancée en 2015 afin de renforcer les contrôles de sécurité sanitaire, notamment dans les abattoirs. Je salue le maintien de cet effort qui était indispensable pour répondre aux critiques de la Commission européenne, de la Cour des comptes et de l'Office alimentaire et vétérinaire européen. Presque 5 millions d'euros de plus sont prévus sur le risque végétal, pour porter l'enveloppe totale au-dessus de 25 millions d'euros. Il s'agit de renforcer le plan de surveillance de l'expansion de la bactérie xylella fastidiosa, qui a commencé sa propagation en Corse et sur la Côte d'Azur. Ce plan coûtera au total 5,7 millions d'euros en 2017, auxquels s'ajoutent les dépenses d'indemnisation en cas d'arrachage, financées par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE).
L'augmentation des crédits en matière de lutte contre les maladies animales traduit la nécessité de compenser la réduction de certaines subventions européennes et non l'élargissement des actions du ministère dans ce domaine. Or les risques dans le domaine animal restent élevés : influenza aviaire, fièvre catarrhale ovine, tuberculose bovine... L'année 2016 a été marquée par des crises sanitaires d'envergure sur le secteur animal nécessitant la prise d'un décret d'avance de 64 millions d'euros sur le programme 206 pour payer des vaccins FCO ou encore financer le vide sanitaire dans les élevages de canards du Sud-Ouest. Je salue ce souci de répondre vite à la crise, et constate que, lorsque les crédits ordinaires ne permettent pas de faire face, des moyens supplémentaires sont rapidement mobilisés.
Le budget prend bien en compte la montée des besoins relatifs à la lutte contre les salmonelles en élevage : 1,3 million d'euros supplémentaires sont prévus.
Une ligne budgétaire est consacrée aux programmes alimentaires territoriaux (PAT) : elle est modeste avec moins d'un million d'euros, mais c'est une bonne chose d'accompagner cette dynamique.
Enfin, je rappelle le rôle central de l'ANSES, dont les missions ne cessent de se renforcer : délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en 2015, des produits biocides en 2016, responsabilité de la toxicovigilance et de l'évaluation des effets du tabac et de ses dérivés depuis 2016, responsabilité de la phytopharmacovigilance, exigence d'évaluation nouvelle des néonicotinoïdes dans la loi biodiversité.
Pour 2017, la dotation budgétaire de l'ANSES en provenance du ministère de l'agriculture baisse de 1,6 million d'euros pour atteindre 60,1 millions d'euros - sur un budget total de l'ANSES de 138 millions d'euros. Cette réduction devrait pouvoir être absorbée par l'Agence, qui dispose aussi d'autres recettes : dotations des autres ministères et taxes diverses. La difficulté se situe à un autre niveau : son plafond d'emplois est abaissé de six postes en 2017. En outre, les souplesses autorisées en matière de recrutements hors plafond prennent fin en 2017.
Ainsi, l'ANSES risque tout simplement de ne pas pouvoir recruter, quand bien même elle disposerait de ressources provenant des taxes et redevances. Elle risque ainsi de prendre du retard dans l'exécution de ses missions, d'autant plus qu'avec le Brexit, se profile une hausse de la charge de travail, les évaluations de produits qui étaient faites au Royaume-Uni devant être transférées dans d'autres États membres de l'Union européenne. Il est indispensable de régler cette difficulté qui est technique et non budgétaire.
Deuxième sujet de mon intervention, l'accompagnement des changements de pratiques agricoles : cette transition vers une conduite des exploitations moins dépendante des intrants, ayant moins d'impact sur l'environnement, est nécessaire pour des raisons économiques, environnementales et pour répondre aux attentes de la société vis-à-vis du monde agricole.
Des moyens importants sont prévus dans le projet de loi de finances pour 2017 pour répondre à cet enjeu. Les aides à l'agriculture biologique progressent. Lancé en 2013, le programme Ambition bio 2017 visait à doubler les surfaces du bio en France. Le rythme de progression est bon : plus 28 % en deux ans. Nous attendons encore les chiffres de 2016, qui devraient être également orientés à la hausse. Le total des aides au bio, nationales et européennes - à la conversion et au maintien - a cru de 90 à 160 millions d'euros par an. Le budget 2017 poursuit cet engagement en faveur du bio. Il maintient notamment les crédits du Fonds avenir Bio, géré par l'Agence Bio à 4 millions d'euros, soit 1 million de plus que sur la période 2008-2012. Enfin, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est conservé.
Les mesures agroenvironnementales (MAE) sont renforcées : le budget global pour ces deux mesures passe de 71,9 millions d'euros dans le précédent budget à 85 millions d'euros. L'orientation vers l'agroécologie constitue une préoccupation transversale qui se concrétise dans l'enseignement agricole, encore renforcé en 2017 de 140 postes d'enseignants et 25 postes d'auxiliaires de vie scolaire. Elle se concrétise aussi dans les appels à projets du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural », et à travers 1 million d'euros sur le programme 149 destiné à l'animation des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE).
Les programmes Ecophyto et Ecoantibio contribuent aux mêmes objectifs de changements des pratiques agricoles : les crédits d'Ecoantibio sont maintenus en 2017 à 2 millions d'euros ; le budget de l'État est un contributeur marginal - à hauteur de 370 000 euros - au plan Ecophyto, principalement financé par une enveloppe de 41 millions d'euros provenant de la redevance pour pollutions diffuses collectée par les agences de l'eau.
L'accompagnement des changements de pratiques agricoles mobilise des moyens spécifiques - crédits bio, MAE, Ecoantibio, Ecophyto -, mais cette préoccupation n'est pas absente du reste des dispositifs de la politique agricole : ainsi, les aides à la modernisation des exploitations doivent aussi répondre à cet enjeu de conduite écoresponsable des exploitations.
Le budget 2017 propose également un autre type d'accompagnement des exploitations agricoles, vers l'amélioration des performances économiques et de la compétitivité des exploitations agricoles. C'est un sujet cher au Sénat, une proposition de loi a été adoptée l'année dernière.
Nous devrions être satisfaits, car le budget de l'agriculture pour 2017 répond à cette préoccupation : l'augmentation de l'enveloppe de 600 millions d'euros s'explique, pour 480 millions, par la prise en charge de la baisse de sept points de cotisation des exploitants agricoles décidée début 2016, qui s'ajoute à la baisse générale de trois points des cotisations familiales décidée en 2015.
Par ailleurs, les agriculteurs employeurs, mais aussi les entreprises de l'agroalimentaire bénéficient des mesures de réduction du coût du travail par l'allégement des cotisations patronales dans le cadre du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Les coopératives, non éligibles au CICE, ont bénéficié de la suppression en 2015 de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Le dispositif d'exonération pour l'embauche de travailleurs agricoles occasionnels dit TO-DE, recentré en 2013 sur les bas salaires, est maintenu en 2017. Il représente 430 millions d'euros intégralement compensés à la Mutualité sociale agricole (MSA) par le budget du ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture chiffre à 2,2 milliards d'euros les allégements de charges des entreprises dans la production agricole en 2017 et 1,8 milliard d'euros pour les coopératives agricoles et les sociétés de l'agroalimentaire.
La problématique de la compétitivité n'est donc pas oubliée. Les agriculteurs et les industries agroalimentaires devraient retrouver des marges de manoeuvre, notamment à l'exportation. Je salue le choix d'augmenter de 21 % en 2017 les crédits de la promotion et de l'action internationale, pour financer les conventions avec les acteurs du secteur : Business France, Sopexa, Adepta... Avec cette politique de présence à l'étranger, nous reconquerrons des marchés extérieurs, où les produits français jouissent d'une excellente image de marque.
J'émets donc un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

Je félicite, en toute sincérité, les rapporteurs pour leur travail qui est une mine d'informations, à la suite de nombreuses auditions.

J'émets certaines réserves sur ce budget qui, s'il répond à un vrai besoin agricole, ne prône pas suffisamment la nécessité vitale de réorienter l'agriculture. Le compte n'y est pas. Selon l'Agence bio, depuis le premier semestre 2016, chaque jour, 21 nouvelles exploitations agricoles entrent dans une démarche bio. Le modèle que certains s'échinent à défendre est en bout de course. Une révolution se prépare : anticipons, pour répondre à la demande d'une alimentation de proximité.

L'agriculture doit être relancée. Un million d'euros consacré aux projets agricoles de territoire (PAT), c'est faible, pour un projet très ambitieux. La relocalisation aboutit à toujours plus de qualité. Organisons cette relocalisation. Une généralisation de ces PAT serait une superbe vitrine. Je regrette que l'on ne soit pas plus volontariste et ambitieux. J'attends le résultat de l'étude sur les externalités négatives et les aménités positives pour que nous nous rendions vraiment compte du coût d'un type d'agriculture et des bénéfices de l'autre.

Il n'y a pas d'agriculture sans jeunes agriculteurs. En moyenne, cela coûte 534 000 euros de s'installer. La taxe sur les terrains nus devenus constructibles peut aider un peu à financer l'installation. Cependant, dans les dents creuses ou les hameaux, ces terrains nus ne sont plus constructibles, d'où une perte pour l'installation et pour la commune, qui ne perçoit pas la taxe sur le foncier bâti. L'aide à l'installation relève de la PAC, mais aussi des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), qui peuvent louer des terres à un particulier. La location des terres agricoles varie de 30 à 180 euros par hectare, selon l'endroit et la qualité du sol.
Ayons une vision plus claire des potentiels d'emploi du bois, pour la transition énergétique, la construction ou le chauffage, qui en mobilisent davantage.

Ce budget est-il à la hauteur de la crise ? Mettez-vous à la place d'un paysan qui, malgré la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche sous le gouvernement précédent, et la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sous ce gouvernement, n'a jamais été autant en difficulté. En tant que sénateurs, nous croyons bien faire en votant des lois, mais avec quelle efficacité sur le terrain ? Voilà la triste réalité. Je m'interroge sur le rôle de l'élu, et suis déçu... Comprenons les agriculteurs.
De nombreux territoires qui percevaient auparavant l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) n'en bénéficieront plus, et des jeunes seront moins aidés à s'installer. Travaillons sur des critères de rattrapage pour donner de l'espoir à ceux qui vivent mal leur exclusion. Les risques économiques sont toujours là. De nombreuses conséquences de la loi sur le Grenelle de l'environnement alourdissent gravement les difficultés de gestion des entreprises. Les campagnes en ont ras-le-bol des beaux discours, prenons-en conscience.
Deux priorités doivent être privilégiées : lever les menaces sanitaires gênant les exportations, en raison de la fermeture de débouchés - sans parler des décisions politiques - et accélérer la recherche pour limiter l'usage des pesticides. Que propose-t-on, aux agriculteurs qu'on montre du doigt, pour remplacer ces produits ? J'ai pu voir à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Clermont-Ferrand que l'on patine à produire des variétés plus résistantes aux mauvaises herbes ou aux maladies.
Je n'ai rien contre le bio, mais il est pénible d'entendre que tout ce qui n'est pas bio serait dangereux : on dirait que les autres agriculteurs nous empoisonnent !
Allons plus vite sur le plan stratégique forêt. Certaines coupes blanches dans des forêts de résineux, sans replantation, deviennent des caches à sanglier. Dans 70 ans, dans mon secteur, il n'y aura plus grand-chose à la place.

Je rejoins les propos tenus un peu plus tôt par M. Vaugrenard. Il est dommage que vous ne vouliez pas discuter du projet de loi de finances (PLF) en séance publique. Soyons conscients de l'image du Sénat que nous donnons aux citoyens français, d'autant plus que le Sénat est décrié. À quoi nous sert-il de débattre du PLF en commission ?
Nous nous accordons sur certains points : nous avions proposé d'augmenter le plafond de la déduction pour aléas au sein de la proposition de loi sur la gestion des risques. Adaptons-la au mieux au chiffre d'affaires.
Ne dissocions pas les différents risques, qu'ils soient économiques, sanitaires ou climatiques. Traitons-les ensemble, à travers la PAC. Le ministre de l'agriculture souhaitait créer un troisième pilier. Conserver le budget de la PAC sera difficile. Réorientons les piliers vers la gestion des risques, d'autres pays le font déjà.
Les Jeunes agriculteurs sont réservés sur l'assurance obligatoire et souhaiteraient en discuter : travaillons avec eux.
Je suis surpris de la carte proposée sur l'ICHN. Le ministre est ouvert à d'autres propositions. J'ai rédigé un courrier avec d'autres parlementaires pour évoquer certaines zones de mon département qui étaient bénéficiaires de l'ICHN, ne le sont plus et mériteraient de l'être.
Je suis heureux de voir le maintien, voire l'augmentation des efforts sur le bio. Le bio n'est pas contradictoire avec les autres pratiques agricoles ; c'est un phénomène de société à reconnaître et à accepter. Portons les efforts sur ce domaine, avec l'engagement volontaire des exploitants. La consommation de bio augmente dans notre pays.
Au-delà de la volonté politique de rapprocher les établissements publics fonciers (EPF) des SAFER, tout dépend de la volonté du directeur de l'EPF régional. Une réflexion nationale, voire une loi, serait nécessaire. Les EPF ont les moyens, les SAFER les compétences. Rapprochons-les.

Le traitement par cyperméthrine des grumes destinés à l'exportation n'est plus acceptable pour la qualité des sols, des ruisseaux et la santé des utilisateurs. Des mesures d'interdiction ont été prises, reportées, de nouveau annoncées... J'espère que ce traitement sera interdit et que des traitements alternatifs seront annoncés.
Le changement climatique a des effets importants sur l'agriculture. Au bord de la Méditerranée, les régions viticoles ont perdu 30 à 50 % de leur production en raison de la sécheresse. Ces périodes se renouvelleront à l'avenir, il faudra faire avec. Les assurances ne pourront pas tout couvrir. Nous sommes condamnés à multiplier l'irrigation et à mieux adapter nos cultures. Or on ne peut pomper dans les fleuves en dessous de l'étiage, ni dans les nappes réservées à l'usage alimentaire. Seule solution : il faut conserver l'eau de pluie dans des retenues à usage agricole, ce qui suppose de simplifier la législation. Différencions la réglementation pour les retenues à usage agricole de celle sur les carrières.

C'est l'objet d'une proposition de loi. Prévoyons un accompagnement et des aides.

Je remercie M. César d'avoir repris les propositions du groupe d'étude forêt-bois, également entendues par le ministère. Avec les communes forestières et les propriétaires forestiers, nous avons lancé l'appel de Mende pour obtenir 150 millions d'euros et reboiser. Depuis 15 ans, on ne plante plus rien, faute de fonds forestier national. Il faudrait replanter sur 1/140e de la surface forestière, chaque année, pour rajeunir la forêt et préparer l'avenir, région par région, en tenant compte des choix techniques et écologiques afin de respecter la diversité des peuplements forestiers. Nous n'avons pas pu déposer d'amendement en ce sens, en raison de l'application de l'article 40 de la Constitution.
Nous avons cherché un système tuyau-de-poêle pour que la forêt satisfasse au mieux les besoins en bois-énergie. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), richement dotée, nous concède 20 à 30 millions de crédits pour le reboisement à destination du chauffage bois. Mais ces crédits sont insuffisants et incertains. Trois ans sont nécessaires pour réaliser un plan pépinières : il faut de la lisibilité et de la continuité. Nous avons fait appel à notre collègue Alain Bertrand, dont le département s'est beaucoup boisé grâce aux plantations d'après-guerre.
Le traitement des arbres pour l'export pose des problèmes sanitaires. Des mesures ont été prises, mais nous craignons que cela ne pénalise l'export. Les exportations de bois ne sont pas criminelles ; la France dispose d'une énorme quantité de chênes et de hêtres. Par l'export, on soutient les cours, donc on récolte ensuite et on renouvelle la forêt. Nous espérons qu'un traitement nouveau permettra de continuer l'export. Il est faux de dire que l'on exporte du bois brut pour importer des produits finis. Les Chinois n'achètent pas du bois pour nous renvoyer du parquet ; cela leur coûterait trop cher ! Nous espérons la levée des mesures anti-exportation.

L'ANSES craint un surcroît de travail à la suite du Brexit. Le Sénat devra bien contrôler que lui soient accordés des moyens à la hauteur de sa tâche, inflationniste : c'est le prix à payer pour garder un libre arbitre scientifique.
Je n'ai rien contre le bio, je distribue moi-même des subventions pour la conversion. Mais une production bio n'est pas nécessairement de proximité. Vérifions qu'il y ait suffisamment d'argent dans le fonds pour la conversion, actuellement insuffisant pour couvrir les besoins. Attention au prix du bio : le modèle de gestion de l'agriculture bio n'est viable que lorsque le prix de vente est supérieur au conventionnel, largement valorisé. Actuellement, les prix de tous les produits agricoles sont beaucoup trop bas.
Nous avons reçu le collectif du « Petit-déjeuner à la française », d'industriels s'inquiétant que la diminution de la pratique du petit-déjeuner ait des implications tant économiques que sanitaire, pour les enfants. La diminution de la consommation de lait correspondante équivaut à la fermeture d'une laiterie française par an. Abondons le Programme national pour l'alimentation (PNA) et vérifions qu'il y ait des appels à projets. Centrons notre discours sur la qualité des produits agricoles.
Je comprends les regrets de nos collègues socialistes, mais, lorsque nous constatons le peu d'écoute sur les amendements du Sénat, c'est le moment d'affirmer notre désapprobation.

Où en est-on des prairies retournées ? Les agriculteurs compensent leurs activités classiques et essaient de diversifier leur production, mais la réponse diffère d'un territoire à un autre. Ainsi, la Mayenne a une forte avance sur l'Orne et l'Eure, dont les terres sont différentes. Existe-t-il une politique équitable ?

L'assurance récolte est de moins en moins utilisée, car elle n'est pas la bonne réponse au problème. Développons l'assurance sur le chiffre d'affaires. Groupama et le Crédit Agricole réalisent des expérimentations. Actuellement, la franchise est si importante que c'est la faillite d'abord : on est mort avant d'être guéri...
L'intervention de M. Leroy m'étonne : les communes sont obligées de planter, et des plans simples de gestion sont obligatoires pour les grandes forêts privées. Certes, des politiques incitatives sont indispensables. Le Fonds forestier national a permis de beaucoup replanter après-guerre. Parlons-en au ministre de l'agriculture, incitons les propriétaires forestiers à entretenir leurs forêts. En Haute-Marne, j'attribue une subvention aux propriétaires privés et publics pour replanter des forêts. Si on lève le pied, la production ne redémarrera pas immédiatement, le coût se fera sentir dans 50 ans, ce qui sera grave pour notre richesse et pour l'environnement.

Certains territoires perdent beaucoup avec la nouvelle carte des zones défavorisées simples (ZDS). Le ministre se veut rassurant : le projet ne serait pas d'application immédiate, 10 % de la surface peut être réattribuée. Mais c'est son successeur qui prendra la décision, et les 10 % ne tiendront pas compte des problèmes locaux. Les critères doivent être revus, et une simulation effectuée pour savoir comment les 10 % pourraient être consommés. Je crains que ce sujet ne mette le feu à certains territoires, non seulement dans l'Orne, mais aussi dans le Sud-ouest. Nous pourrions aussi créer un groupe de travail informel sur cette question, qui rendrait service à de nombreux sénateurs qui sont interpellés.

Nous avons auditionné de nombreux acteurs : l'ANSES, le ministère de l'agriculture, France Agrimer, les chambres d'agriculture, l'ONF... Je remercie Mme Primas d'avoir organisé cette rencontre sur la nutrition et le petit-déjeuner, où nous étions nombreux.
La PAC interdit le retournement des prairies permanentes à une échelle régionale, et non individuellement. Deux régions françaises ont trop retourné : les Hauts-de-France et la Normandie, ce qui conduit désormais à des restrictions pour tous les agriculteurs dans ces zones.
L'appel de Mende pour la forêt est très important. Avec un euro par tonne de carbone stockée, on peut replanter, sur de nombreux hectares, 356 millions de plants. Souvent, les visiteurs s'opposent à l'abattage, mais il est nécessaire lorsque l'arbre a atteint une certaine taille.
Les produits de traitement sur les grumes ne sont-ils pas une forme de protectionnisme dissimulé ? Des courants d'échange existent ; tous les bois ne sont pas transformables en France. Le prix du chêne a augmenté de 50 % en deux ans, en raison de la demande de barriques. Développons le bois usiné en France, et non seulement la production de bois brut. Il faut 70 ans pour qu'un résineux soit à maturité, 200 ans pour un chêne - comme dans la forêt de Tronçais.

À 4 kilomètres de Mortagne-au-Perche, des chênes ont été plantés dans la forêt de Réno-Valdieu par Colbert, il y a plus de 370 ans !

Les crédits consacrés à la gestion de crise sont insuffisants : les agriculteurs n'ont aucune marge de manoeuvre en cas de sinistre. Le CASDAR a été reconduit à hauteur de 147 millions d'euros en 2017, mais la recette est surestimée.
L'INRA et l'ANSES nous ont rappelé l'importance de disposer de plants plus résistantes à la sécheresse. Mais l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et dans les zones d'appellation certains organismes de gestion des appellations d'origine ne reconnaissent pas ces plants. Améliorons la recherche, et apportons la preuve de la résistance de ces plants au changement climatique.
Vous connaissez nos différends avec certaines associations sur les retenues collinaires. Si l'on veut que l'agriculture existe, les agriculteurs doivent pouvoir arroser les arbres fruitiers ou les cultures, sachant que le cahier des charges de certaines appellations ne l'autorise pas toujours.
Je suis favorable à l'assurance obligatoire pour les jeunes qui s'installent, car ils prennent tous les risques. La dotation jeune agriculteur (DJA) devrait être subordonnée à la remise obligatoire d'une attestation d'assurance sur tous les biens de l'exploitation.

Bonaparte, en Égypte, déclarait au pied des pyramides qu'il fallait planter des cèdres. Comme on lui précisait qu'ils pousseraient en deux siècles, il a répondu : « Raison de plus pour commencer tout de suite ! »
La commission émet un avis défavorable aux crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».
Proposition de résolution européenne sur l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques- examen du rapport et du texte de la commission
Proposition de résolution européenne sur l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques- examen du rapport et du texte de la commission

Nous examinons la proposition de résolution européenne qui vise à mieux adapter les normes agricoles et la politique commerciale de l'Union européenne afin de ne pas trop pénaliser l'économie de nos outre-mer.
Je commencerai par un rappel. Le 16 janvier 2016, vous avez adopté une proposition de résolution portant sur une urgence : les accords commerciaux négociés par l'Union européenne dans le secteur de la canne à sucre. Le rapport que je vous avais présenté soulignait que, pour soutenir le développement endogène des outre-mer, l'Union européenne a très opportunément financé la modernisation de la filière sucrière ultramarine et son positionnement sur les sucres « haut de gamme ». Vous avez admis, à l'unanimité, qu'il aurait été absurde de ruiner ces efforts de long terme en ouvrant brutalement ce marché à des pays où le coût de la main-d'oeuvre est 19 fois moins élevé que dans nos outre-mer - en l'occurrence le Vietnam, qui pouvait se voir offrir un « boulevard » pour se positionner sur ce segment. Je tiens à vous rappeler que notre démarche a été couronnée de succès, puisque l'accord définitif avec le Vietnam inclut une clause de contingentement strict des importations de sucres roux, à hauteur de 400 tonnes. On regrette souvent, comme dans le cas du Traité transatlantique, le caractère flou du mandat de négociation confié à la Commission : nous avons démontré ici toute l'efficacité du Sénat lorsqu'il porte une voix de bon sens.
Comme cela vous avait été alors annoncé, je vous présente aujourd'hui un texte plus général, même s'il répond aussi à une préoccupation immédiate portant sur le secteur de la banane : la proposition de résolution européenne sur l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques. La version initiale de ce texte, cosignée par cinq membres de la délégation à l'outre-mer - Éric Doligé, Jacques Gillot, Gisèle Jourda, Catherine Procaccia et moi-même - a été adoptée par la commission des affaires européennes sans modification et à l'unanimité.
Ce texte comporte deux volets, l'un sur les normes agricoles européennes et l'autre sur la politique commerciale de l'Union. S'agissant du premier, la commission des affaires économiques a abordé le thème des normes agricoles européennes principalement sous l'angle hexagonal. Nous avons adopté le 29 juin 2016 le rapport d'information Normes agricoles : retrouver le chemin du bon sens de M. Daniel Dubois. Constatant que l'avalanche de réglementations handicape l'agriculture métropolitaine, pourtant l'une des plus performantes du monde, ce rapport formule 16 propositions pour limiter la profusion normative et la soumettre au principe de réalité.
Pour les outre-mer, la situation est encore bien pire, comme l'a démontré de façon approfondie le rapport d'information élaboré conjointement par M. Éric Doligé, M. Jacques Gillot et Mme Catherine Procaccia, au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Il constate que les dispositifs sanitaires et phytosanitaires conçus pour l'Europe continentale s'imposent dans les régions ultrapériphériques (RUP) sans prendre sérieusement en compte les caractéristiques de l'agriculture en zone tropicale. Cette application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées conduit à une véritable impasse. Ainsi, la fourmi manioc, présente à la Guadeloupe et en Guyane, est capable de détruire, en 24 heures, une culture de patate douce, d'igname ou d'agrumes. Les petits planteurs sont démunis puisqu'aucune solution efficace ne peut être utilisée sur des cultures de plein champ. Certains produits existent, mais ils ne sont autorisés que pour le seul usage domestique, car ils relèvent de la catégorie des biocides. Rien, en revanche, dans la catégorie des pesticides qui sont de la compétence de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. Le ministère de l'agriculture pourrait créer cet usage afin que l'ANSES autorise une préparation phytopharmaceutique. On voit bien, sur cet exemple, que la sécurité des récoltes ultramarines n'est donc pas garantie et, globalement, seuls 29 % des usages phytosanitaires - c'est-à-dire les moyens de défense contre les attaques - sont couverts dans les DOM, contre 80 % en métropole.
Pourtant, les réponses phytosanitaires existent et sont utilisées chez nos concurrents mais, dans l'Union européenne, les procédures d'homologation sont si complexes et coûteuses que, pour les fabricants, le jeu n'en vaut pas la chandelle : ils renoncent à déposer une demande d'autorisation parce que le marché ultramarin est trop étroit pour amortir le coût des formalités administratives. Et, quand les produits sont autorisés, c'est leur utilisation qui fait l'objet de normes européennes inadaptées. Par exemple, l'Équateur - premier exportateur de bananes sur le marché européen et sur le point d'adhérer à l'accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou - traite ses bananes 40 fois par an avec une gamme de 50 produits phytopharmaceutiques, alors que les bananiers français ne disposent que de deux produits autorisés et réalisent sept traitements par an. Telle est la situation inextricable que nous connaissons face à une concurrence sans merci.
Pour réduire les handicaps imposés à l'agriculture ultramarine, la délégation à l'outre-mer a énoncé 20 recommandations qui forment le socle du volet « normes agricoles » de la présente proposition de résolution. J'en résume ici les trois axes : il faut d'abord adapter les normes ainsi que les processus d'homologation pour garantir la sécurité des récoltes. Pour réduire les usages orphelins et rétablir un peu la balance entre les outre-mer et les pays tiers, la proposition de résolution suggère d'établir une liste positive de pays dont les procédures d'homologation sont équivalentes à celles de l'Union européenne. À partir de cette liste, les autorités françaises pourront autoriser directement l'usage en outre-mer d'un produit homologué dans un des pays de la liste. Ensuite, contrôlons mieux les échanges commerciaux pour rééquilibrer les contraintes imposées aux producteurs. Enfin, promouvons une stratégie de labellisation des produits ultramarins haut de gamme.
Le second volet de la proposition de résolution consacré aux accords commerciaux concerne plus particulièrement le secteur de la banane. Je rappelle que conformément aux accords de libre-échange conclus en 2012 avec l'Amérique centrale, les droits de douane sur les bananes importées dans l'Union européenne seront passés de 176 euros par tonne en 2009 à 75 euros par tonne en 2020. Les volumes importés ont bondi et la perte de parts de marché pour nos producteurs met en péril l'avenir de la filière.
Théoriquement, des mécanismes de protection sont prévus sous deux formes. Selon une clause de sauvegarde spécifique, l'Union peut suspendre le droit de douane préférentiel si l'augmentation des importations de bananes depuis les pays partenaires cause ou menace de causer un préjudice grave à l'économie de l'Union. En outre, le mécanisme de stabilisation autorise l'Union à suspendre temporairement le droit de douane préférentiel, si les importations de bananes dépassent les seuils d'importation prévus dans les accords. En pratique, jamais, depuis 2013, la Commission européenne n'a activé un seul de ces dispositifs, alors que l'évolution du marché pouvait, à plusieurs reprises, le justifier.
En réponse à cette carence, la proposition de résolution suggère l'activation sans délai par la Commission des mécanismes de stabilisation dès que les seuils de déclenchement prévus dans les accords sont atteints. Elle préconise également que ces mécanismes de stabilisation soient prorogés au-delà de la date butoir du 31 décembre 2019, alors qu'il est prévu de les supprimer à cette date. Créons aussi des observatoires des prix et des revenus pour les grandes filières exportatrices des outre-mer - banane et canne à sucre - afin de disposer de mesures fiables. Enfin le texte que nous examinons prône une réalisation systématique, par la Commission européenne, d'études d'impact préalables sur les RUP des accords commerciaux passés par l'Union européenne. Comme nous le constatons depuis des années, les RUP sont systématiquement oubliées dans les réflexions préalables à la négociation d'accords commerciaux...
Au final, je vous propose d'approuver cette proposition de résolution sur la base de trois considérations. Tout d'abord, l'impératif d'adaptation des normes agricoles européennes et des procédures d'homologation s'impose de manière évidente. En second lieu, les producteurs ultramarins luttent pieds et poings liés contre les producteurs des pays tiers : cela appelle un rééquilibrage et, à tout le moins, de garantir le respect des mécanismes de sauvegarde prévus dans les accords commerciaux. Enfin, la « montée en gamme » est la grande ligne directrice de l'économie et de la société française. Tirons les conséquences pratiques du rapport Gallois, objet d'un remarquable consensus, avec une stratégie de labellisation des produits agricoles ultramarins.
Je vous propose d'apporter un complément à cette proposition de résolution en complétant ses visas. Ce n'est pas anodin car il s'agit de rappeler un arrêt important de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE): la Commission européenne l'avait saisie pour tenter de faire valoir une interprétation très restrictive de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle n'a pas obtenu gain de cause et il est désormais établi que le principe d'adaptation du droit européen aux régions ultrapériphériques a une large portée.
En conclusion je fais d'abord observer que la planète entière - ou presque - s'effraie du danger majeur d'un réchauffement climatique d'un ou deux degrés. Dans un tel contexte, comment a-t-on pu ignorer si longtemps la différence de 15 à 20 degrés entre le climat tempéré et le climat équatorial et ses conséquences déjà avérées ? C'est incompréhensible.
Enfin, il est indéniable que la mondialisation et le libre-échange ont des effets bénéfiques car, nous le savons depuis Ricardo, on produit plus en se spécialisant. Mais ne soyons pas en retard d'une guerre économique : le Brexit et les évolutions aux États-Unis confirment que le monde anglo-saxon ne prône plus une mondialisation à outrance. Cette proposition de résolution s'inscrit donc dans une stratégie non pas tant protectionniste que réaliste.

Merci pour cet excellent rapport. La délégation à l'outre-mer justifie une fois de plus sa création opportune, il y a 5 ans, en répondant aux préoccupations du monde agricole, tant des gros que des petits exploitants.
L'histoire parlementaire est un éternel recommencement. Le 18 janvier 2011, M. Éric Doligé et moi-même avions déposé une proposition de résolution européenne pour dénoncer l'indifférence de la Commission européenne sur nos préconisations relatives à l'agriculture ultramarine, notamment lors de la négociation de l'accord de Genève sur le commerce des bananes de décembre 2009 baissant progressivement les droits de douane pour l'Amérique latine, et l'accord de libre-échange avec les pays andins annoncé par la Commission le 1er mars 2010. Nos recommandations portaient sur la protection des marchés par l'activation d'une clause de sauvegarde locale, la compensation de la baisse de revenus pour les agriculteurs, la facilitation de mesures de développement endogène pour les RUP et des études d'impact préalables systématiques sur les coûts des accords, incluses également dans le mémorandum de 2010 sur les RUP signé aux Canaries.
Nos initiatives européennes dénoncent les effets collatéraux des récents accords avec les pays tiers, comme le Vietnam, qui menacent le coeur de l'économie outre-mer. Les conséquences, identiques à celles des accords passés, sont désastreuses pour l'agriculture outre-mer, l'emploi, et l'intensification de la concurrence extérieure. L'absence de garde-fous est tout particulièrement dangereuse pour une agriculture exposée à la concurrence de pays non soumis aux contraintes sociales, salariales ou sanitaires.
Comme l'a souligné le rapporteur, la différence du nombre de produits et de traitements autorisés pose problème. D'ailleurs je signale que pour la canne à sucre, aucun produit n'est autorisé. Vous pouvez donc consommer du sucre et du rhum sans modération !
J'ajoute qu'il suffit parfois à nos voisins d'Amérique latine de déverser quelques conteneurs de produits agricoles sur nos côtes pour concurrencer à la fois nos cultures d'exportations mais aussi nos productions vivrières. Ces pays n'ont pas les mêmes conditions de production que les nôtres et il faudrait plus d'exigences de traçabilité pour ces produits qui proviennent des pays tiers, pour rééquilibrer la balance avec la situation de nos producteurs qui doivent prouver l'origine de leurs produits.
Nous soutenons totalement cette proposition de résolution, même si son effet juridique n'est pas immédiatement contraignant. Continuons à nous battre inlassablement pour défendre cette juste cause. La France est diverse, à la fois continentale et fière de son insularité. Cayenne est même une île entourée de forêts !

La demande d'autorisation, à titre dérogatoire, de cultiver des variétés résistantes aux ravageurs tropicaux, non inscrites sur le catalogue européen des variétés, n'est-elle pas dangereuse ? Ce catalogue me semble une garantie d'avoir des semences ou des plants certifiés, même s'il est coûteux et parfois inadapté aux réalités. Une telle dérogation ne pose-t-elle pas des problèmes de traçabilité, de transparence, mais aussi de risques sanitaires ?
Avez-vous des précisions sur la démarche ministérielle de définition des objectifs de sélection des variétés cultivées dans les outre-mer ?

Cette proposition de résolution, synthèse de l'ensemble de nos démarches, traduit la continuité de l'action de la délégation à l'outre-mer. Comme nous l'avons rappelé les résolutions européennes portant sur le secteur sucrier ont été efficaces. Pour donner plus de poids à celle que nous examinons ici, nous l'avons traduite en quatre langues, et l'avons envoyée avec la commission des affaires européennes au Gouvernement et aux parlementaires européens pour qu'ils la relaient. Malgré la force d'inertie de l'Union européenne, gardons l'espoir d'un résultat positif.
Par principe, l'agriculture ultramarine est soumise aux mêmes normes et contrôles que dans l'hexagone. Dans les RUP, les règlements européens s'appliquent d'office, de même que les directives transposées en droit français. Cependant, l'article 349 du TFUE prévoit une adaptation aux réalités des outre-mer et l'amendement que je vous soumets rappelle que l'arrêt Mayotte de la CJUE, a tranché en faveur de l'interprétation large des possibilités d'adaptation du droit européen dans son ensemble. Je n'ai donc aucune crainte.
Les accords de libre-échange autorisent, sur le marché européen, la concurrence de produits qui ne répondent pas au même niveau d'exigence que les nôtres. Comment expliquer le droit d'épandre 40 fois par an en Équateur une gamme de 50 produits, contre sept fois dans les DOM où ne sont autorisés que deux produits ? Si l'Union européenne valide de fait l'utilisation de certains produits adaptés au climat tropical, pourquoi dès lors ne pas dresser une liste qui placerait les producteurs concurrents dans une situation moins déséquilibrée ?
L'amendement n° COM-1 est adopté.
À l'issue du débat, la commission a adopté, à l'unanimité, la proposition de résolution européenne ainsi modifiée.
La réunion est close à 12 h 25.