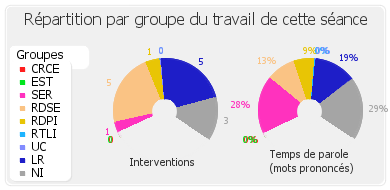Séance en hémicycle du 18 mai 2010 à 22h10
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures dix, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Je suis saisi, par Mme Labarre, MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, d'une motion n°39.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (procédure accélérée) (n° 437, 2009-2010).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les membres de notre groupe estiment que le présent projet de loi est en contradiction avec la Constitution, parce qu’il ne respecte pas la Charte de l’environnement.
Si besoin est, rappelons que, en inscrivant dans le préambule de la Constitution une référence « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 » et en plaçant ainsi ce texte sur le même plan que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a conféré une valeur constitutionnelle à la Charte.
Ce texte, en son article 6, dispose : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » Or nous estimons que la forêt constitue un véritable patrimoine écologique et social. Pourtant, l’article 15 du présent projet de loi entend « renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers ».
Alors qu’il faudrait soustraire ce patrimoine forestier à la vision de court terme et de rentabilité dictée par le marché, le Gouvernement propose une véritable marchandisation de la forêt, en contradiction avec le développement durable de celle-ci.
En effet, l’exploitation des forêts doit être réalisée dans le sens de l’intérêt général. Or le texte organise une privatisation des missions exercées par l’ONF, l’Office national des forêts, qui s’inscrit directement dans la logique du démantèlement de cet établissement public.
De plus, force est de le constater, le Gouvernement tient en piètre estime le Parlement, puisqu’il multiplie, dans ce projet de loi, sur des sujets variés, les dispositions lui permettant de légiférer par ordonnance, c’est-à-dire sans le débat ni l’aval de la représentation nationale : c’est le cas aux articles 2, 15 bis, 17 et 24.
Avant son examen en commission, le texte proposé par le Gouvernement en contenait d’ailleurs davantage, alors qu’aucune urgence ne peut justifier ce recours excessif aux ordonnances. Il s'agit là d’une nouvelle preuve, s’il en fallait, des dérives monarchistes de la Ve République. Qu’il est loin l’objectif affiché par Nicolas Sarkozy de rendre du pouvoir au Parlement !
Toutefois, en étudiant le présent texte, on comprend fort bien pourquoi le Gouvernement souhaite limiter le plus possible le débat parlementaire.
Pour nous, cette loi de modernisation aurait dû être l’occasion de réorienter rapidement et massivement l’agriculture vers des systèmes de production écologiquement responsables et permettant aux paysans de vivre décemment. Néanmoins, le Gouvernement ne semble pas souscrire à ces objectifs, si ce n’est, parfois, dans les discours du Président de la République, qui se voudraient rassurants pour les agriculteurs !
En effet, le but premier du Gouvernement est purement électoral : récupérer des votes qui lui échappent de plus en plus, comme on l’a vu lors du dernier scrutin régional. Monsieur le ministre, les agriculteurs ne sont pas dupes de votre opération politicienne, qui ne règle rien à leurs problèmes !
Pis, le présent projet de loi prévoit une véritable restructuration globale de l’agriculture française, au nom de la culture de l’entreprise et de la compétitivité. L’élimination des petits paysans devrait en être encore accélérée.
Nous nous félicitons que certains points très dangereux aient été supprimés par la commission, en particulier l’article 11, le plus emblématique de la conception du Gouvernement, qui introduisait le statut d’agriculteur-entrepreneur. Cette disposition visait clairement à faire le tri entre les agriculteurs et à favoriser un type d’agriculture écologiquement dangereux et socialement injuste. Toutefois, il subsiste dans ce projet de loi de nombreux outils qui, soit ne régleront rien aux problèmes des agriculteurs, soit les aggraveront.
Monsieur le ministre, vous glorifiez la contractualisation qui, selon vous, permettra d’assurer une rémunération à tous les agriculteurs. Vous voulez nous faire prendre des vessies pour des lanternes ! Au moment où la production agricole a besoin de régulation et de maîtrise des volumes, la contractualisation ne nous apparaît pas comme une solution aux crises actuelles : elle est incapable de remplacer une politique agricole, la somme des contrats ne pouvant aboutir à la maîtrise des volumes et des prix, comme nous allons vous le démontrer.
En effet, les industriels auront tendance à ne pas contractualiser tous les volumes, afin de conserver un minimum de souplesse. Ce seront alors les volumes non contractualisés qui joueront le rôle de variable d’ajustement, ce qui conduira à une inévitable baisse des prix moyens payés aux paysans.
Par ailleurs, comme on l’a vu récemment pour le lait, si l’un des acteurs le souhaite, le contrat n’a plus de valeur, et les pouvoirs publics doivent alors intervenir pour rétablir la situation.
En effet, un contrat reste un rapport de forces qui, en l’occurrence, sera forcément défavorable au producteur, confronté à de puissants industriels. Seule la loi, porteuse de l’intérêt général, pourrait garantir un droit au revenu pour les paysans, en interdisant la vente à perte par exemple, et en fixant des prix minimums rémunérateurs. Or un prix contractualisé n’entre pas forcément dans cette catégorie !
Le Gouvernement met également en avant un autre outil : le système assurantiel de l’article 9.
Tout d’abord – faut-il le rappeler ? –, un mécanisme d’assurance ne crée pas de richesses nouvelles, mais répartit celles qui existent déjà. Jamais donc il ne pourra remplacer une politique publique, ni remédier à l’instabilité des prix agricoles !
Surtout, le système qui est proposé aujourd’hui peut se résumer à cette formule : « Beaucoup d’argent public au profit des compagnies d’assurance, au bénéfice d’une minorité d’agriculteurs ». Nous sommes dans la même logique d’élimination : il y aura ceux qui pourront se payer de bonnes couvertures et ceux qui en seront incapables et qui, en cas de problème, devront cesser leur activité. Contre ce système, notre groupe propose un mécanisme mutualisé de garantie contre les aléas.
De plus, nous regrettons que la commission ait supprimé le principe de l’institution d’une taxe pour freiner l’artificialisation des terres. Aujourd’hui, la situation est dramatique : 50 000 à 80 000 hectares de terres agricoles changent de destination chaque année. Au rythme de consommation actuelle, une mesure d’urgence de type moratoire aurait dû être envisagée.
Pour le long terme, le Gouvernement, en reprenant une proposition de la Confédération paysanne, avait eu raison d’instaurer une « taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ».
La commission a supprimé l’article 13 au motif qu’une telle taxe existait au profit des communes. Mais il s’agit d’un dispositif optionnel. Moins de 5 000 communes l’ont institué, et il ne permet donc pas de lutter contre l’artificialisation des terres.
Nous pensons donc que la loi doit rendre obligatoire une telle taxe. Au demeurant, si le principe qui avait été posé par le Gouvernement constituait une avancée, force est de constater que le taux prévu, de 5 % à 10 %, était totalement inadéquat. Certaines terres se vendent jusqu’à 200 fois plus cher après classement. Ainsi, cette taxe n’aurait rien résolu. Nous vous demandons d’instituer une taxe plus efficace, autour de 50 %. À titre de comparaison, je mentionnerai qu’elle existe au Danemark, où elle est fixée à 80 %, afin de lutter contre l’artificialisation des terres agricoles. C’est en ce sens que nous avons déposé nos amendements.
Tels sont les outils mis en place par cette loi qui ne permettent pas de répondre aux enjeux posés par l’agriculture, quand ils ne les aggravent pas.
Cela dit, le projet de loi brille aussi par ses lacunes. Ainsi, alors que la majorité des paysans, qui se tuent à la tâche, ne gagne pas suffisamment pour vivre décemment, ce projet de loi ne comporte aucun volet social.
Le Figaro, journal que l’on ne peut accuser de bolchévisme
Sourires sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Le législateur aurait été inspiré d’instituer la règle de prix rémunérateurs, afin de garantir à tous les agriculteurs un droit au revenu.
Ce projet de loi aurait dû être aussi l’occasion de s’attaquer au problème de l’accès au métier et au statut de l’exploitant.
L’accès au métier de paysan est conditionné par l’accès au statut social de chef d’exploitation. Celui-ci confère une reconnaissance de l’activité agricole de la personne, et donne accès aux droits spécifiques des paysans. Le problème réside dans le fait que l’accès au statut est conditionné par la direction d’une ferme, dont l’importance doit être au minimum d’une demie SMI, ou surface minimum d’installation.
Cette référence pose de nombreux problèmes : elle ne permet pas les installations progressives dans une période où la pression foncière s’est fortement accentuée. Elle diffère fortement d’un département à l’autre, provoquant de fortes inégalités sur les territoires. Elle revient à nier l’existence des pluriactifs pour lesquels l’activité agricole est secondaire, et elle ne permet pas de prendre en compte les projets à haute valeur ajoutée à l’hectare, car intégrant la valorisation, la transformation ou la commercialisation des produits de l’exploitation.
Nous proposons donc de faire dépendre l’octroi du statut, non plus à une taille minimum d’exploitation, mais à une déclaration d’heures de travail, comme cela existe déjà pour certaines activités.
Nous dénonçons par ailleurs le statut de cotisant solidaire, qui n’ouvre aucun droit professionnel à des paysans en activité. Les cotisants solidaires non retraités exerçant une activité agricole sont environ 100 000 en France. Les pouvoirs publics ont reconnu implicitement la réalité de leur activité en leur accordant en 2008 des droits pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, et prochainement pour la formation professionnelle. Il est désormais nécessaire d’aller plus loin en ouvrant l’accès au statut de chef d’exploitation à ces cotisants solidaires. Voilà ce qui serait une décision de justice sociale !
Il est consternant de constater que cette loi ne mentionne nullement l’inscription du modèle agricole français au sein d’un environnement international, particulièrement européen, surtout dans la perspective de l’échéance de 2013 pour la politique agricole commune.
Deux crises additionnent aujourd’hui leurs effets : la crise écologique, qui disqualifie notre modèle de développement économique basé sur le productivisme ; la crise économique causée par le néolibéralisme mondialisé, qui a partout dérégulé les échanges.
L’agriculture se trouve au confluent de ces deux crises, et il devient urgent d’y porter remède. Le modèle productiviste d’agriculture intensive doit laisser la place à une agriculture soucieuse de l’environnement, avec des productions relocalisées. Les crises successives que l’agriculture a connues ces dernières années, je pense à la crise du lait, montrent que les politiques de dérégulation, initiées par l’Organisation mondiale du commerce et soutenues par l’Union européenne, doivent prendre fin.
La France doit promouvoir au niveau communautaire la mise en œuvre de toutes les mesures permettant de garantir des prix rémunérateurs aux producteurs, à savoir la mise en place d’un prix minimum indicatif européen pour chaque production, l’activation de dispositions visant à appliquer le principe de préférence communautaire, une politique douanière européenne garantissant que les produits importés sont fabriqués dans des conditions sociales et environnementales acceptables, et sont payés à un juste prix aux producteurs.
De même, la France doit promouvoir au niveau communautaire la mise en œuvre de mécanismes de régulation, notamment le maintien ou la création de mécanismes de production pour certaines productions, et l’activation, en cas de crise exceptionnelle, d’outils de stockage public de productions agricoles et alimentaires.
Enfin, nous devons mettre en place les outils permettant une véritable planification de la transition écologique de l’agriculture. Nous devons tendre vers une agriculture beaucoup plus diversifiée, réintégrant activité agricole et élevage, rapprochant les cycles du carbone et de l’azote. Nous devons tendre vers une agriculture relocalisée, autonome, valorisant la richesse potentielle des écosystèmes cultivés, en lieu et place de systèmes basés sur l’usage intensif d’engrais chimiques et de pesticides, et sur la motorisation à outrance.
Cette agriculture que nous devons promouvoir nous permettra donc de contribuer à la lutte contre le changement climatique, de diminuer l’utilisation de carbone fossile et des autres ressources non renouvelables, de produire des aliments de meilleure qualité, de protéger l’environnement des contaminations diverses, et de restaurer la biodiversité.
Mais cela implique une agriculture plus intensive en temps de travail et en emplois et donc, à la fois, des prix rémunérateurs pour que le travail agricole soit payé à son juste prix, et une véritable politique foncière volontariste permettant de stopper la course à l’agrandissement des exploitations, voire, dans certaines régions, d’inverser ce phénomène en facilitant l’installation d’agriculteurs.
Une loi qui ne prendrait pas en compte l’ensemble des aspects que je viens d’évoquer ne répondrait pas aux enjeux lancés par l’agriculture du XXIe siècle.
Loin d’améliorer la situation, elle ne ferait que retarder la date ou il nous faudra prendre des décisions drastiques pour réparer les dégâts sociaux et environnementaux du libéralisme, et du modèle d’agriculture productiviste qui lui est lié.
Une disposition législative adéquate pourrait encadrer efficacement les plans régionaux de développement de l’agriculture durable, et l’action des SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de telle sorte qu’ils soient dans l’obligation de répondre à certains de ces objectifs, notamment en matière de politique foncière et de transition écologique de l’agriculture.
Malheureusement, le Gouvernement est trop soucieux d’enjeux électoraux à court terme. Il est pris en tenaille par ses dogmes libéraux de dérégulation entière de l’économie, qui nous ont pourtant menés au bord du gouffre. Nombreux sont les parlementaires, y compris au sein de la majorité, qui savent que cette loi ne résoudra rien. Mais c’est parce qu’en outre nous la jugeons anticonstitutionnelle au regard de la Charte de l’environnement que nous vous appelons, mes chers collègues, à voter la motion d’irrecevabilité que nous avons déposée.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les auteurs de la motion estiment que le texte du projet de loi, et notamment ses dispositions relatives à la forêt, serait contraire à l’objectif de promotion du développement durable posé par l’article 6 de la Charte de l’environnement.
Je ferai observer que le développement durable, comme l’indique justement cet article 6 de la Charte, comprend non seulement la protection et la mise en valeur de l’environnement, à laquelle participent fortement les agriculteurs, mais aussi le développement économique et le progrès social, deux points sur lesquels la commission a enrichi le texte du projet de loi.
La commission ne peut donc être que défavorable à cette motion.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement tient le Parlement en très haute estime. Il a d’ailleurs limité le recours aux ordonnances, à la suite des travaux de la commission. Comme je l’ai dit tout à l’heure, il a fait évoluer le texte conformément à vos objectifs, auxquels il souscrit – je pense notamment au développement des circuits courts et à la modification des règles d’appel d’offres – pour aller dans le sens du développement durable.
Je le répète la promotion d’une agriculture durable est un objectif également poursuivi par le Gouvernement. En effet, cet objectif correspond à la fois à une attente des citoyens et à une obligation économique pour les producteurs. L’intérêt des producteurs est évidemment de devenir plus indépendants des énergies fossiles dont la ressource se raréfie et dont le prix ne cesse d’augmenter. Ce constat est valable pour les agriculteurs, mais aussi pour les pêcheurs.
Récemment, en Bretagne, dans un port où je me trouvais, un pêcheur qui travaillait sur un bâtiment moyen m’a expliqué qu’un centime d’euro supplémentaire par litre de gazole signifiait pour lui 7 000 euros supplémentaires par an. Ce pêcheur n’aspire qu’à une chose, comme tous les autres pêcheurs de France : devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis du gazole.
En ce qui concerne la taxe sur les plus-values foncières, sachez que j’y tiens aussi personnellement. Je crois qu’il est indispensable de taxer la spéculation sur les terres agricoles. Je pense que nous aurons l’occasion de revenir sur cette taxe au cours du débat et, je l’espère, de la rétablir, en affectant son produit à l’installation des jeunes agriculteurs.
Enfin, vous savez que je me bats pour la régulation européenne des marchés agricoles depuis plusieurs mois, et que je continuerai ce combat dans les mois à venir.
J’espère vous avoir rassurée, madame Labarre. En tout cas, telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cette motion d’irrecevabilité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à M. le rapporteur et M. le ministre, je souscris à l’argumentation développée par ma collègue Marie-Agnès Labarre pour défendre cette motion, qu’il s’agisse de l’irrecevabilité en matière de respect environnemental et des points qu’elle a soulevés concernant la gestion forestière, ou encore des problèmes liés à la contractualisation, qui reste, et vous le savez bien, une épreuve de force entre deux parties bien inégales… Nous ferons à cet égard des propositions au cours du débat.
Marie Agnès Labarre a également dénoncé les lacunes par lesquels s’illustre votre texte. Pour ma part, je souhaiterais insister sur une lacune particulièrement criante : ce texte ne donne au monde agricole, et surtout aux agricultrices et agriculteurs, aucune perspective d’avenir à moyen terme dans la pratique de leur métier.
En effet, malgré les avancées effectuées par la commission, trop d’incertitudes, trop de flou persistent quant à la lisibilité de ce métier.
Rien n’est prévu, par exemple, pour lutter contre la volatilité des prix agricoles, qui a pour conséquence la baisse du revenu des agriculteurs : en Rhône-Alpes, elle était en moyenne de 20 % en 2008 et de 34 % en 2009. Dans cette même région, 1 500 agriculteurs touchent le revenu de solidarité active, dont plus de 600 dans mon seul département de l’Isère.
Le poids des traditions n’est pas non plus pris en compte dans l’évolution proposée par ce texte. Bien sûr, personne ne conteste que chacune, chacun doit « vivre avec son temps », mais le temps de l’agriculture ne rime sans doute pas avec celui voulu par la PAC, dont les nombreux contrôles et formalités imposent aux agriculteurs de passer plus de temps dans leurs dossiers que sur leur exploitation !
C’est en tout cas ce que nous a fait savoir M. Jean-Bernard Bayard, membre du bureau de la FNSEA lors de son audition devant la mission « mal être » du Sénat, soulignant les conséquences néfastes de cet état de fait sur la santé des exploitants, dans la mesure où « ils vivent dans la crainte que leurs ressources diminuent encore un peu plus parce qu’ils n’auraient pas correctement rempli tel ou tel document »…
Selon M. Jean-Pierre Grillet, médecin chef de l’échelon national de santé au travail de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, on enregistre environ 400 suicides d’agriculteurs par an. Bien sûr, l’isolement, le célibat, la précarité favorisent le passage à l’acte, mais la perte de la terre que l’on a héritée de sa famille est vécue dramatiquement, surtout lorsqu’elle fait suite à une faillite.
Pourtant, ce qui a failli, ce n’est pas l’agriculteur, mais bien le système économique actuel, fondé sur la compétitivité, la libre concurrence et la volatilité des prix. C’est ce système qui est à l’origine de la crise que traverse notre agriculture, alors même que la question alimentaire n’a jamais été aussi prégnante : les prix agricoles baissent en Europe et, à nos portes mêmes, la famine menace.
Aujourd'hui, 70 % des agriculteurs ont un revenu inférieur au SMIC et, je l’ai dit, beaucoup touchent le RSA. Pourtant, ces femmes et ces hommes ne demandent pas plus à toucher cette allocation qu’à recevoir des aides de l’Europe ! Elles et ils veulent pouvoir vivre de leur travail, qu’il soit justement rémunéré et mieux considéré !
Je voudrais, pour conclure, évoquer le regard que porte la société sur nos agricultrices et agriculteurs, qui se sentent parfois culpabilisés parce qu’ils exerceraient une activité polluante, qu’ils toucheraient d’innombrables primes, qu’ils feraient du bruit, que sais-je encore…
Sans doute ces griefs sont-ils fondés, mais les agriculteurs en portent-ils l’entière responsabilité ? Vous aurez deviné ma réponse : les agriculteurs n’ont fait que s’adapter au progrès technique et ont eu recours aux modes de production recommandés à chaque époque.
Je suis persuadée de l’utilité de notre agriculture non seulement parce qu’elle constitue un secteur économique important, chacun l’a souligné, mais aussi parce qu’elle contribue à l’aménagement de notre territoire. C’est tout particulièrement le cas dans mon département, l’Isère, où la montagne tient une grande place. En zone de montagne, l’agriculture joue un rôle essentiel dans la préservation du milieu – maintien des alpages, conservation des prairies sèches et des zones humides, etc. – et l’entretien du paysage. Pourtant, rien dans ce texte ne répond à cet enjeu !
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à adopter cette motion.

Je mets aux voix la motion n° 39, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, dont l'adoption entraînerait le rejet du projet de loi.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC-SPG, l'autre, du groupe UMP.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement demandent le rejet de cette motion.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Je suis saisi, par M. Bel, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 86.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (procédure accélérée) (n° 437, 2009-2010).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Bel, auteur de la motion.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Permettez-moi tout d’abord, monsieur ministre, de saluer votre courtoisie et l’attention que vous accordez à chacun des orateurs : les réponses que vous leur avez apportées, tant à l’issue de la discussion générale qu’à l’instant, en témoignent.
Il n’en reste pas moins que je partage le constat qui a été dressé de façon quasi unanime cet après-midi : notre agriculture connaît une crise profonde, brutale et, en un sens, totalement inédite.
Depuis 2008, les agriculteurs ont perdu en moyenne plus de 50 % de leur revenu. Le revenu des chefs d’exploitation a baissé de 23 % en 2008, avant de chuter de 32 % en 2009. Ces quelques chiffres résument à eux seuls la gravité de la situation et la violence de la crise.
Nous le savons bien, certains secteurs sont tout particulièrement frappés. C’est le cas de la production laitière, pour laquelle les perspectives sont absolument catastrophiques. La présidente-directrice générale de l’Institut national de la recherche agronomique, Marion Guillou, indique que, avec la fin des quotas, seules 40 000 à 50 000 exploitations survivront. C’est la disparition annoncée, en France, d’une exploitation laitière sur deux ! C’est dire la profondeur de la crise.
Mais aujourd’hui, et c’est une nouveauté, toutes les filières agricoles de notre pays sont touchées. Car cette crise frappe non seulement avec violence, mais aussi sans distinction ! De ce fait, près d’un agriculteur sur six envisage de cesser son activité dans les douze mois à venir : 50 000 exploitations en moins, c’est, dans le même temps, la disparition de 200 000 emplois dans notre pays.
À tous, il nous arrive de rencontrer dans nos territoires des agriculteurs qui nous disent que, compte tenu de la situation, ils vont devoir fermer leur exploitation. Quelle preuve plus éclatante de leur désarroi, de leur désespérance, que cette tentation, ô combien déchirante, de renoncer à ce qui a représenté toute leur vie ? Car chacun d’eux a un amour viscéral pour le travail de la terre !
Ce désespoir est aujourd’hui aggravé par les mots, par l’attitude des pouvoirs publics au plus haut niveau, par l’impression d’impuissance qu’ils donnent. Il l’est aussi par la froideur et la distance du Président de la République à l’égard du monde agricole, qui renforcent encore le sentiment d’abandon ; dans ce contexte, le rendez-vous manqué du Salon de l’agriculture est apparu comme un révélateur. Il l’est encore par les politiques conduites ces dernières années par les différents gouvernements.
À ce titre, comment ne pas relever la responsabilité de la loi de modernisation de l’économie ? Son objectif, louable, était de relancer la consommation par une baisse des prix, mais elle a eu pour effet déplorable de permettre à la grande distribution d’imposer aux exploitants des prix d’achat de moins en moins rémunérateurs, sans conduire pour autant à une baisse des prix à la consommation. Bien plus, elle a abouti à cet incroyable paradoxe : les prix à la consommation, dans le meilleur des cas, sont stables, quand ils n’augmentent pas, alors que les prix payés aux producteurs, au mieux, sont inchangés et, au pis, diminuent !
Comment, dans le même temps, ne pas regretter notre isolement en Europe – vous avez déjà répondu sur ce point, monsieur le ministre, mais je maintiens le terme – et dénoncer l’abandon des quotas laitiers par votre prédécesseur, M. Michel Barnier, lors du « bilan de santé » de la PAC ?
Je crains malheureusement que le texte qui nous est présenté aujourd’hui ne mette pas fin au désespoir, car il n’est pas à la hauteur des enjeux, et c’est le moins que l’on puisse dire !
Avant d’aborder plus précisément le contenu de ce projet de loi, je veux saluer le travail de tous nos collègues en commission et me féliciter des progrès qu’il a rendus possibles. Le groupe socialiste a analysé et examiné ce texte avec sérieux et bonne foi. Nous avons déposé 140 amendements constructifs – c’est dire l’attention que nous y avons portée –, mais une douzaine seulement a été retenue. D’ailleurs, je ne me priverai pas de souligner les quelques avancées que le texte permettra de réaliser.
Cela étant, force est de reconnaître que, pour l’essentiel, le projet de loi lui-même n’est guère porteur d’espoirs. Nous en récusons la philosophie générale, nous déplorons la faiblesse des moyens concrets mis en œuvre et nous regrettons profondément l’absence d’outils nouveaux qui contribueraient à inventer l’agriculture de demain.
Que dire, d’abord, de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ? L’initiative est en soi louable, si ce n’est que cet organisme existe déjà, à défaut de pouvoir fonctionner, privé qu’il est de moyens concrets. En la matière, ce sont les initiatives privées et les associations de consommateurs qui, aujourd’hui, font l’essentiel du travail et permettent un accès aux données chiffrées.
L’inscription de cet observatoire dans la loi ne nous pose aucun problème, mais ce que nous demandons au Gouvernement, c’est de mettre enfin en application tous les dispositifs garantissant une totale transparence en matière de formation des prix. Or, depuis des années, nous ne sentons pas un fort volontarisme sur ce sujet…
Que dire, ensuite, de l’orientation générale qui sous-tend ce projet de loi ? L’inspiration est évidente et tient en deux mots, même si vous les avez récusés, monsieur le ministre : libéralisation et dérégulation. En somme, après avoir détricoté, tant à l’échelon national qu’au niveau européen, les outils de régulation publique de l’agriculture, vous vous offrez une session de rattrapage en mettant en place dans la précipitation des tentatives de régulation privée qui, malheureusement, seront insuffisantes.
Je veux parler de l’obligation de contractualisation entre agriculteurs et acheteurs, qui semble constituer l’axe principal de ce projet de loi. Telle qu’elle est proposée, la contractualisation n’est qu’un leurre, car elle donne à croire que l’on pourrait introduire par contrat de l’égalité entre deux parties foncièrement inégales : d’une part, l’acheteur, à savoir quelques transformateurs hégémoniques et quelques immenses centrales d’achat hyperpuissantes, et, d’autre part, le vendeur-exploitant, dont l’offre est éclatée et que ses produits, généralement périssables à très court terme, placent dans une situation de fragilité manifeste à l’égard de son cocontractant.
Certes, la contractualisation peut présenter des avantages, notamment en clarifiant les relations entre acheteur et vendeur, mais elle ne peut constituer à elle seule une politique globale de régulation. Pour le dire plus clairement encore : non, la contractualisation n’est pas et ne sera jamais une réponse satisfaisante à la disparition des quotas laitiers, que la France a abandonnés dans la négociation communautaire.

Il vous arrive souvent d’être approximatif, mon cher collègue, nous en avons eu encore l’éclatante manifestation cet après-midi. Je vous engage à vérifier vos affirmations.
J’ajoute que le dispositif proposé quant à la contractualisation est pour le moins timoré. Ainsi, le texte ne précise même pas si les contrats devront garantir aux producteurs un prix couvrant au moins leurs coûts de production, rémunération du travail comprise. Faute de tels prix planchers, lesquels ne seraient pourtant pas une panacée, la viabilité des exploitations liées à un acheteur par un contrat de vente écrit n’est donc, à notre sens, en rien assurée.
Vous le voyez, le contenu du texte est malheureusement insuffisant pour répondre à la crise et inventer des outils nouveaux ; il ne permet pas même de construire, modestement, un cadre d’action pertinent.
Mais il y a plus regrettable encore que le contenu du texte : c’est tout ce que le texte ne contient pas… Bien sûr, aucun projet de loi ne peut en lui-même apporter de solution à tous les problèmes et je comprends la difficulté de votre tâche, monsieur le ministre. Pour autant, un projet de loi relatif à la modernisation de l’agriculture se doit, à tout le moins, de ne pas oublier les chantiers qui, précisément, contribueraient à faire entrer l’agriculture dans la modernité et qui constituent les clés indispensables à l’agriculture de demain.
De grands chantiers d’avenir ne sont pas – ou à peine – abordés dans le texte, alors qu’ils sont vitaux. L’absence d’une réflexion à long terme et d’une prise en compte des enjeux de fond est évidente.
À cet égard, le titre Ier, un peu pompeusement consacré à la « politique publique de l’alimentation », n’en fournit même pas l’esquisse.
Pourquoi ne pas aller au bout des choses et assumer le choix d’une alimentation de qualité, en encadrant très fortement, voire en interdisant purement et simplement certaines publicités lors de programmes télévisés destinés aux enfants ?
Pourquoi ne pas simplifier l’étiquetage nutritionnel des produits alimentaires pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés ?
Il est vrai que, une fois encore, monsieur le ministre, vous semblez nous inviter à agir dans la précipitation, au risque de mal légiférer.
Pourquoi, alors que vous avez demandé au Conseil national de l’alimentation de constituer des groupes de travail chargés d’élaborer des propositions sur des thématiques amples, n’avez-vous pas attendu la communication des conclusions de ces derniers, prévue pour la fin du mois de mai ? La prise en compte de ces réflexions aurait certainement permis d’alimenter votre projet de loi de manière plus substantielle puisque chacun de ces groupes travaille sur des thématiques qui nous semblent avoir été sous-estimées dans le texte. Les rapports qui nous sont promis paraissent être riches – je vous en épargnerai l’énumération – et vous auriez pu les utiliser pour nourrir plus abondamment le titre Ier.
Monsieur le ministre, comment ne pas souscrire aux bonnes intentions que vous manifestez ? Comment ne pas s’accorder sur certaines des directions que vous indiquez ? Le problème vient de ce que vos propos, souvent bien sentis, ne sont pas traduits dans le projet de loi que vous nous présentez aujourd’hui.
Ce texte ne comporte, selon nous, rien de concret.
Rien de concret sur le développement des circuits courts pour favoriser les produits locaux et de saison.
Rien de concret pour les hommes et les femmes qui vivent de l’agriculture, pour les jeunes qui souhaitent s’installer mais peinent à le faire, notamment en raison des difficiles conditions d’accès au foncier.
Rien de concret pour les moins jeunes en quête d’une reconversion, pour les retraités qui, après une vie de travail, survivent tout juste avec des pensions indignes.
Rien de concret pour la promotion des labels, alors qu’ils constituent autant de signes de distinction de nature à encourager les productions de qualité.
Rien de concret pour aider nos terroirs à améliorer leur image, alors même que la compétitivité de notre agriculture – vous en avez parlé cet après-midi – se joue aussi là-dessus, notamment au regard de la concurrence européenne et internationale.
Rien de véritablement concret sur le bio, qui, s’il ne constitue pas à lui seul la solution à tous les maux, n’en est pas moins une piste stratégique pour l’avenir.
Rien de concret sur la formation, la recherche, l’innovation : comme si l’agriculture française n’était pas, aussi, un secteur de pointe !
Rien de concret, enfin, sur la transparence de la chaîne de commercialisation et du processus de formation des prix, alors que c’est la clé pour permettre aux agriculteurs d’avoir des revenus décents sans accroître le coût de leurs produits pour le consommateur final : comme si l’on craignait de prendre des mesures fortes qui pourraient viser directement la grande distribution !
Bien sûr, nous avons vu la belle opération de communication organisée hier autour du Président de la République. Or, ce que nous demandons au Président, c’est non pas de communiquer, mais d’agir ! Et le seul résultat de la réunion d’hier, ce sont de belles déclarations d’intention, un résultat a minima qui ne changera pas la donne et ne leurrera pas les producteurs, lesquels l’ont d’ailleurs déjà fait savoir.
En outre, et c’est peut-être le plus inquiétant, aucune vision stratégique ne se dégage sur le futur de notre agriculture à long terme, aucune perspective n’est tracée sur l’avenir de la politique agricole commune, sur l’action possible de la France aux niveaux européen et international, alors que tout le monde sait bien que c’est là, d’abord, que tout se joue et que c’est là, demain, qu’il faudra faire entendre notre voix, au moment où la renégociation de la PAC pourrait conduire à « renationaliser » encore davantage cette politique et à amputer son budget de 40 %.
Monsieur le président, mes chers collègues, en un mot comme en mille, faute d’ambition politique et faute de volonté d’action, ce texte manque sa cible.
La régulation de notre agriculture est abandonnée entre les seules mains d’acteurs privés, sans dispositif permettant de rétablir de l’égalité entre des parties inégales. L’État se désengage d’un secteur qui, pourtant, autant que d’autres, a besoin d’une vision stratégique et d’une action publique lisible à long terme.
La France a cessé de porter un message fort sur la nécessaire harmonisation fiscale et sociale en Europe, seul instrument qui nous permettrait de lutter contre les distorsions de concurrence préjudiciables à notre agriculture.
Monsieur le ministre, vous passez à côté de nombreux chantiers d’avenir pour l’agriculture française : la qualité, la durabilité, les circuits courts, les terroirs.
Notre agriculture est riche d’un passé au cours duquel elle a relevé le défi de nous nourrir. Elle doit être riche aussi d’un avenir, car elle a tous les atouts pour entrer dans le monde de demain.
Il nous faut sortir de la crise par le haut, en nous fondant sur nos terroirs, sur nos pratiques, sur la qualité de nos produits pour nous projeter vers l’avenir.
Ce projet de loi nous paraît décidément timoré. Puisqu’il n’apporte pas les solutions nécessaires, il faut peut-être le retravailler et élaborer un texte qui réponde enfin aux grands défis que j’ai évoqués. C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je vous propose d’adopter la motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Les auteurs de la motion qui vient d’être présentée par le président Jean-Pierre Bel mentionnent avec raison la gravité de la crise que traversent l’agriculture et la pêche en France. Mais ils recommandent, dans le même temps, l’arrêt immédiat de la discussion du projet de loi alors que l’élaboration d’un nouveau texte prendrait nécessairement de nombreux mois et retarderait d’autant l’apport de solutions aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.
La commission a modifié ce projet de loi et l’examen en séance publique permettra d’apporter encore à ce dernier, nous n’en doutons pas, de nombreuses améliorations.
Mon cher collègue, je ne peux donc qu’être défavorable à l’adoption d’une motion qui mettrait fin à la discussion de ce projet de loi.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai au président Bel avec la même courtoisie qu’aux autres sénateurs, courtoisie dont il bien voulu me créditer, mais aussi avec la même fermeté.
Sur le constat, on ne peut évidemment qu’être d’accord : situation dramatique de l’agriculture française, crise économique et, comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, crise morale.
Monsieur Bel, vous l’imaginez bien, mes fonctions me conduisent à me rendre sur une exploitation agricole une fois tous les deux ou trois jours. Autrement dit, je suis perpétuellement en discussion avec les agriculteurs, et encore tout à l’heure, lors de la suspension de nos travaux, j’ai rencontré ceux d’entre eux qui assistent à la séance, je les ai les interrogés sur la façon dont ils perçoivent la situation et sur leur sentiment quant à la capacité du projet de loi à améliorer la situation. Bref, je ne cesse d’écouter leur détresse et de m’enquérir des solutions qu’ils attendent du Gouvernement.
Je tiens à rétablir un certain nombre de faits.
S’agissant de la production laitière, ne laissons pas dire que la production ne cesse de se détériorer et que la situation sur le terrain va de mal en pis, car ce n’est pas vrai. La vérité, et vous pourrez le constater en examinant les faits, c’est que la situation s’améliore doucement. Je ne vous dis pas qu’elle est idéale, mais simplement qu’il faut regarder précisément ce qui s’est passé.
En 2009, une crise laitière dramatique a abouti à faire baisser le revenu des producteurs de lait de 54 %. Cette baisse a été consécutive à la conjonction de phénomènes qui ont frappé tous les pays européens et qui dépassent de loin la France. Ces phénomènes, vous les connaissez : une surproduction de lait de 3 % en Nouvelle-Zélande et une baisse de la consommation en Chine à cause de la crise de la mélamine ont provoqué l’effondrement des cours du lait.
Quel État a exigé de la Commission européenne que soient débloqués des moyens d’intervention pour faire remonter les cours ? La France.
Quel État a obtenu que 300 millions d’euros soient mis sur la table, même si ce versement est intervenu trop tardivement, car la réaction européenne a été, comme souvent, beaucoup trop lente ? La France.
Qui a pris la tête du mouvement visant à rétablir les cours du lait en Europe, obtenant ainsi une remontée de ces derniers ? C’est la France ! C’est le gouvernement de François Fillon, sous la direction du Président de la République. Au moment où je vous parle, le cours du lait a atteint 300 euros la tonne, alors qu’il était à 230 euros il y a encore huit mois ; là aussi, ce sont des faits !
Encore une fois, je ne prétends pas que la situation est idyllique, je dis simplement qu’elle n’est pas si dramatique que cela, qu’il ne faut pas noircir le tableau et qu’il faut aussi mesurer les efforts qui ont été accomplis par le gouvernement français. Si nous n’étions pas intervenus, il ne se serait rien passé !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Je dis bien : rien ! Et vous le savez aussi bien que moi.
Je tiens également à préciser que, pour ma part, je ne me satisfais pas de la situation actuelle.
Bien sûr, les cours remontent et les perspectives paraissent plutôt positives pour la production laitière en 2010, mais il me semble que c’est justement le moment adéquat pour sécuriser le revenu des producteurs de lait, mettre en place des contrats, renforcer le pouvoir des producteurs de manière générale.
C’est le moment de demander la modification du droit de la concurrence européen pour que l’on ne soit plus obligé de restreindre à 300 ou 400 producteurs la capacité de négociation face à des industriels comme Lactalis ou Danone et pour que les fournisseurs soient tous capables de négocier seuls avec l’industriel concerné. C’est bien le travail que nous engageons.
Ce n’est pas parce que la situation s’améliore qu’il faut renoncer à introduire des changements ; c’est au contraire à ce moment précis qu’il faut engager les réformes, et c’est ce que nous essayons de faire.
S’agissant des quotas laitiers, je développerai deux idées qui vont peut-être vous surprendre, mais qui s’appuient également sur des faits.
C’est en 1999, je le rappelle, que l’Union européenne a pris la décision d’abandonner les quotas. Mon prédécesseur de l’époque, M. Jean Glavany – et je rends ici justice au parti socialiste –, avait défendu l’idée du maintien des quotas. Mais il a été battu !
Du reste, je dois vous le dire, j’assume totalement le fait que nous abandonnions les quotas laitiers ; et je n’ai pas l’habitude de me cacher derrière mon petit doigt quand j’assume une décision ! En effet, les quotas laitiers, nous les avons connus… et nous avons subi la crise laitière la plus grave en dix ans ! C’est bien la preuve que les quotas ne constituent pas la réponse au problème de la production laitière en Europe.
J’assume également cette décision parce que l’Européen convaincu que je suis ne pense pas que les quotas soient défendables auprès des autres pays de l’Union. Allez donc expliquer aux Suédois qu’ils n’ont pas le droit de produire plus de 1 000 ou 2 000 Saab par an sous prétexte que leur pays est moins peuplé que d’autres ! Or c’est la logique des quotas : vous êtes un petit pays, vous produisez peu de lait ; vous êtes un grand pays, vous produisez beaucoup de lait.
Une telle argumentation est indéfendable aujourd’hui en Europe. Si le ministre de l’agriculture s’était amusé à faire preuve de populisme en disant qu’il allait continuer à défendre les quotas laitiers, il aurait certainement été plus populaire, mais il aurait tout aussi certainement été battu ! Je préfère défendre la régulation du marché du lait, l’application de nouveaux instruments rendant possible des évolutions, que rester attaché à des instruments anciens comme les quotas laitiers.
Monsieur Bel, vous regrettez que le projet de loi ne propose pas d’outils nouveaux. Permettez-moi de vous dire que votre argumentation est un peu contradictoire ! En effet, vous reprochez à la fois à ce projet à la fois d’aller trop loin sur certains sujets, d’être trop audacieux, et de ne pas fournir d’outils nouveaux et concrets !
Je ne dresserai pas ici la liste de tous ceux que le projet contient, mais permettez-moi d’en citer quelques-uns. La réassurance publique, c’est nouveau et c’est concret ! Tous les gouvernements, droite et gauche confondues, ont voulu mettre sur pied la réassurance publique dans l’agriculture ; aucun n’y est parvenu. J’espère sincèrement que vous voterez la disposition qui s’y rapporte, car cette mesure me paraît dépasser de loin les clivages entre droite et gauche.
Par ailleurs, je suis évidemment favorable à la taxation de la spéculation foncière – c’est concret ! – et je souhaite que le produit de cette taxe soit affecté à l’installation des jeunes agriculteurs, sujet dont vous vous souciez raison, monsieur Bel.
Les contrats systématiques, l’assurance forêt, la réduction des marges en période de crise, la suppression des remises, rabais et ristournes : autant de mesures concrètes ! La modification des règles du code des marchés publics pour favoriser les circuits – c’est d’ailleurs une proposition que le groupe socialiste a faite et que je soutiens totalement –, c’est encore une disposition très concrète !
Sur le bio non plus, on ne peut pas dire que nous ne faisons rien ! Chaque jour, en France, grâce aux mesures fiscales mises en place par le Gouvernement, ce sont dix nouvelles installations en bio qu’on enregistre. La filière connaît une ascension fulgurante, même si elle continue de ne représenter qu’une part très marginale de la production.
Tout cela – et je pourrais multiplier les exemples dans le même sens – pour vous dire que ce projet de loi peut se voir opposer tous les reproches possibles, sauf celui de manquer de dispositions concrètes !
Quant à la philosophie générale que nous défendons au travers de ce texte, croyez-le bien, elle n’est en rien celle de la libéralisation et de la dérégulation ; telle n’est d’ailleurs pas ma vision de l’action politique. Ce que nous prônons, c’est la responsabilité : celle de l’État, au travers du mécanisme de la réassurance publique et de la possibilité qui lui est offerte d’être assureur en dernier recours ; celle des agriculteurs, pour qu’ils se dotent des instruments leur permettant de faire face à la crise.
Sur l’alimentation, je rejoins vos propos. Nous avons fixé un cadre général et annoncé une politique publique de l’alimentation. Toutes les propositions de nature à en favoriser la mise en place seront les bienvenues.
J’en viens maintenant aux perspectives de long terme et aux négociations internationales. Bien entendu, celles-ci sortent du cadre du présent projet de loi puisqu’elles se jouent à une autre échelle et en d’autres lieux. Mais je tiens tout de même, là aussi, à rappeler certains faits.
La Commission européenne a déposé au mois de novembre dernier un projet de texte visant à réduire de 40 % le budget de la politique agricole commune. Quel est l’État qui a su réagir, rassembler ses partenaires et lancer, dès le mois de décembre, l’Appel de Paris pour refuser une telle réduction ? C’est la France ! Voilà des faits tangibles, et non des affirmations en l’air !
Le gouvernement français a fait de même sur la régulation européenne des marchés agricoles. Lorsque j’en ai parlé en août, tous mes homologues m’ont regardé comme si j’étais un martien prônant un retour à l’orthodoxie marxiste !
Sourires
Au fond, deux modèles totalement différents s’affrontent en Europe, et je peux vous garantir que nous ne sommes pas du côté des tenants la libéralisation à outrance et la dérégulation. À entendre nos partenaires européens du Nord et de Grande-Bretagne, nous sommes au contraire perçus comme ceux qui défendent – sans doute trop à leurs yeux – la régulation et le retour à des règles de marché plus raisonnables.
Je conclurai par quelques faits, là encore, concernant l’action de la France dans les négociations à l’échelle mondiale.
Qui s’est opposé à la reprise des négociations commerciales entre l'Union européenne et le MERCOSUR ? C’est nous !
Qui a proposé, pour la première fois, de réunir les ministres de l’agriculture des pays du G20 pour introduire une certaine régulation sur le cours des matières premières ? C’est encore nous !
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous demande de rejeter cette motion tendant à opposer la question préalable. Je le répète, il aborde ce débat dans un esprit d’ouverture totale : toutes les propositions qui permettront de compléter ce projet et de l’améliorer seront les bienvenues !
Vifs applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

En présentant la motion tendant à opposer la question préalable, notre collègue Jean-Pierre Bel a largement souligné les insuffisances, les lacunes et les effets pervers potentiels du projet de loi.
En effet, tout le monde l’a souligné, le monde agricole connaît des difficultés structurelles ; de notre point de vue, le présent texte, en l’état actuel, ne permettra pas de les résoudre.
Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs le savent, c’est tout un système qu’il est nécessaire de repenser. Fondamentalement, il est plus qu’urgent de soustraire le secteur agricole aux règles de la concurrence libre et non faussée.
Lors des débats au sein de la commission de l'économie, la majorité des sénateurs qui se sont exprimés était d’accord pour défendre aux niveaux européen et international l’utilité des outils de régulation et la nécessité de garantir un revenu agricole.
Pourtant, sous la présidence française de l’Union européenne, le 20 novembre 2008, un accord politique sur le bilan de santé de la politique agricole commune a été conclu par les ministres européens de l’agriculture. Or cet accord va dans un tout autre sens.
La réforme de la PAC soutenue par les députés européens de droite et par les gouvernements s’inscrit dans une logique de dérégulation de la production et des marchés. L’Union européenne s’est engagée, rappelons-le, à ouvrir de plus en plus largement le marché européen.
Lors d’un déplacement au Brésil que j’ai effectué il n’y a pas si longtemps avec plusieurs de mes collègues de la commission, nos interlocuteurs sur place nous l’ont dit très clairement : « Arrêtez et laissez-nous le champ libre ! Pourquoi donc continuez-vous à avoir un secteur agricole ? »
M. le ministre le confirme.

Le bilan de santé de la politique agricole commune signe l’abandon des outils de régulation du marché. De plus, le démantèlement des OCM, les organisations communes des marchés – et le cas de l’OCM viti-vinicole est significatif – ne laisse rien présager de bon.
Voilà, très brièvement résumée, l’analyse faite par notre groupe.
Par ailleurs, nous nous réjouissons des déclarations de nos collègues sénateurs de la majorité en commission et nous espérons qu’ils soutiendront une position conforme à leurs déclarations.
Nous pensons que le projet de loi ne tire aucun enseignement de la crise et de ses causes. L’agriculture souffre d’une sous-rémunération du travail paysan, car les prix ne couvrent pas les coûts de production. Face à cela, le Gouvernement se propose d’observer et de contractualiser. Or cette possibilité de contractualisation existe déjà dans la loi, y compris avec la fixation d’un prix plancher, mais elle n’a jamais été appliquée par l’interprofession et par le Gouvernement. De surcroît, elle ne suffira pas à infléchir le déséquilibre des relations commerciales. À ce jour, la concentration et la restructuration de l’offre n’ont pas réglé la question des prix agricoles.
L’agriculture souffre aussi des pertes économiques importantes liées aux aléas climatiques, qui nécessiteraient une politique publique de grande ampleur, centrée sur la solidarité. La mise en place d’un marché du risque exclut de fait les agriculteurs qui n’auront pas les moyens de payer, notamment lorsque les primes d’assurance seront trop importantes. Ce n’est pas acceptable !
Pour ce qui est de la forêt, disons pour faire bref que sa marchandisation, telle qu’elle est prévue, induit la mise en danger de la biodiversité et montre à quel point le Gouvernement a en permanence la volonté de soumettre tous les secteurs à la loi du marché.
Mon collègue Gérard Le Cam l’a dit tout à l’heure, ce projet de loi porte bien mal son titre, car il n’induit aucune modernisation. Il n’est pas à la hauteur des enjeux pour construire l’agriculture du xxie siècle.
La France doit promouvoir avec courage, pour l’après-2013, une réforme de la politique agricole commune fondée sur la souveraineté alimentaire et la préférence communautaire, dans le cadre d’un développement économique, agronomique et écologique. Il incombe à l’Europe de fixer des objectifs de rémunération du travail paysan et de développement de l’emploi. L’urgence est là pour les agriculteurs, et notre responsabilité est d’y répondre avec détermination.
Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons la motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en présentant la motion tendant à opposer la question préalable, le président de notre groupe a dressé l’inventaire de nos préoccupations quant aux problèmes que rencontre aujourd’hui le monde agricole.
Monsieur le ministre, après vous avoir écouté cet après-midi et ce soir, nous ne sommes pas loin, c’est vrai, de faire nôtres plusieurs de vos affirmations et même de partager, dans une certaine mesure, votre vision de l’agriculture.
Marques de satisfaction sur plusieurs travées de l ’ UMP – M. Jacques Blanc applaudit.

Cependant, à y regarder de plus près, on note une distorsion entre vos propos et le contenu du texte lui-même. C’est d’ailleurs ce qui a motivé le dépôt de cette motion.
Il y a certes les grandes idées et les principes que nous pouvons partager. Mais il y a aussi la dure réalité d’un texte qui, pour nous, ne va pas assez loin dans un grand nombre de domaines.
Disant cela, je ne remets bien entendu pas en cause le travail de la commission et des rapporteurs, lesquels ont mené de nombreuses auditions. De notre côté, nous avons aussi rencontré beaucoup de monde, mais nous n’avons pas forcément entendu les mêmes analyses.
L’un de mes collègues a tout à l’heure parlé de précipitation. C’est vrai : la procédure accélérée a été engagée sur ce projet de loi alors même qu’on en entendait parler depuis un certain temps déjà… L’urgence est telle que nous allons devoir en débattre en nous « faufilant » dans les interstices de notre ordre du jour de cette semaine et de la semaine prochaine, bref, travailler en pointillé. Or, il avait été question, au départ, d’examiner ce texte au mois de juillet, ce qui nous aurait donné un peu de temps pour approfondir la réflexion
Cela étant, monsieur le ministre, notre principale interrogation est ailleurs. Vous nous dites que vous allez vous battre pour défendre, à Bruxelles, les orientations – contractualisation, système assurantiel – fixées dans ce texte et qu’elles feront vraisemblablement partie de la future PAC.
Était-il alors opportun d’inscrire de telles notions dans une loi nationale avant que Bruxelles n’ait indiqué comment elle les entendait ? Ne serons-nous pas obligés de revenir sur ce texte ou d’en examiner un autre en vue de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de ce qui ressortira du débat sur la future PAC ?
Vous avez par ailleurs évoqué les quotas laitiers et l’action qu’avait menée à cet égard, lorsqu’il occupait les fonctions qui sont aujourd'hui les vôtres, notre ami Jean Glavany. C’est vrai, bien qu’il se soit beaucoup battu au sein des instances communautaires, il n’a pas réussi à rassembler une majorité autour de lui. Mais j’aurais aimé que d’autres avant vous se battent de la même manière !
Je dirai enfin un mot sur les contrats. Les premiers à avoir vu le jour, ce sont bien sûr ceux qui ont fondé la coopération. Mais il y a eu aussi ces contrats passés entre les agriculteurs et la société qu’étaient les fameux CTE, et qui ont été mis en place par la gauche.
Tels sont, monsieur le ministre, les éléments de réponse que je souhaitais apporter à votre intervention.
J’invite en tout cas mes collègues à voter avec nous cette motion tendant à opposer la question préalable.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel débat surréaliste !

Tout le monde l’a dit, nos agriculteurs vivent dans l’angoisse et attendent des réponses. Et Dieu sait si chacun d’entre nous, quelle que soit notre sensibilité politique, est conscient de la réalité du problème ! Or qu’est-ce qui nous est ici proposé par nos collègues du groupe socialiste ? Rien d’autre que de renvoyer le débat !
Excusez-moi de le souligner, monsieur le président Bel, mais, j’ai eu beau écouter attentivement, je n’ai pas entendu de la part du groupe socialiste une seule proposition concrète de substitution !
Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Puisqu’il a été question du rôle de Bruxelles, je rappellerai ce que tout le monde sait : à partir du moment où l’on a voulu une Europe des États, le jeu fait que l’on ne peut pas tout imposer d’un coup.
Monsieur le ministre, je suis très admiratif de ce que vous avez d'ores et déjà accompli à Bruxelles. Pour connaître un peu le fonctionnement des institutions communautaires, je prétends qu’il était tout sauf évident d’obtenir l’accord de vingt-deux pays pour demander une régulation !
Il m’a été reproché tout à l’heure d’avoir fait référence au ministre socialiste de l’époque, à savoir Jean Glavany. Mais je n’ai jamais dit c’était sa faute si l’on avait renoncé aux quotas ! J’ai simplement souligné le fait que c’était sous un gouvernement de gauche que le principe de la suppression des quotas avait été adopté par l’Union !

Par les gouvernements libéraux européens, et contre l’avis du gouvernement français !

Cela s’est décidé à la majorité ! Pour avoir présidé le Comité des régions de l’Union européenne, je peux vous dire que les réactions des différents gouvernements à Bruxelles sont souvent surprenantes. Sur des problèmes tels que la régulation ou l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, croyez bien que les gouvernements socialistes défendent des positions plus libérales que les nôtres !
Mes chers collègues, ne faisons donc pas de procès d’intention. D’ailleurs, les agriculteurs méritent mieux que de faux débats entre nous !

C’est donc pour eux que nous devons nous mettre immédiatement au travail.
Le texte a été préparé par le Gouvernement, puis amélioré en commission. À nous, lors du débat en séance publique, de l’enrichir encore davantage !
Alors, de grâce, ne rejouons pas le film Courage fuyons ! Il s’agit non de fuir, mais d’appréhender objectivement les instruments que nous proposent à la fois le Gouvernement et la commission pour répondre au drame que vivent nos agriculteurs.
Tous ensemble, trouvons et dégageons des solutions ! Du reste, je pense que, si nous montrons ici que nous voulons travailler dans cet esprit, l’action du ministre à Bruxelles s’en trouvera facilitée.
J’ai cru, madame Herviaux, vous entendre suggérer d’attendre la réforme de la politique agricole commune. Mais cela va prendre du temps, vous le savez très bien, quelle que soit la qualité de l’action du gouvernement français ! Il me paraît beaucoup plus intelligent et efficace de commencer par voter le texte, puis d’épauler l’action du Gouvernement devant le Parlement européen, puisque ce dernier aura son mot à dire via le Comité des régions, dont les avis pourront faire progresser dans l’Union la conception de l’agriculture que défend la France, et sur laquelle nous pouvons nous rassembler : une agriculture reposant notamment sur des exploitations familiales et des spécificités liées aux territoires.
Vraiment, mes chers collègues, travaillons sérieusement et ne renvoyons pas à demain ce qu’on peut faire le jour même !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur plusieurs travées de l ’ Union centriste.

Je mets aux voix la motion n° 86, tendant à opposer la question préalable, et dont l'adoption entraînerait le rejet du projet de loi.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement demandent le rejet de cette motion.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 200 :
Nombre de votants339Nombre de suffrages exprimés338Majorité absolue des suffrages exprimés170Pour l’adoption153Contre 185Le Sénat n'a pas adopté.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

L'amendement n° 87, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur et Teston, Mme Bourzai et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche spécifique à l’outre-mer est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Gillot.

Cet amendement est la reprise d’une proposition qui faisait consensus. En octobre 2005, M. Dominique Bussereau, répondant devant l’Assemblée nationale à mon collègue Victorin Lurel au cours du débat sur la loi d’orientation agricole, se disait prêt à évoquer un projet de loi spécifique sur l’agriculture et la pêche avec son collègue de l’outre-mer et le Premier ministre. Ce consensus semblait d’autant plus affirmé sur ce point que le texte de 2005 ne contenait aucun levier de développement et que les quelques mesures proposées étaient largement insuffisantes pour traiter les difficultés de l’agriculture ultramarine.
Dans le texte qui nous est présenté aujourd’hui, la plupart des dispositifs ne s’appliquent pas en l’état aux outre-mer. C’est ce qui ressort de l’étude d’impact adossée à ce projet de loi, qui indique par ailleurs pour l’outre-mer, et à chaque chapitre, les mesures spécifiques à prendre.
J’aurais préféré, monsieur le ministre, retrouver dans ce projet de loi les dispositions préconisées tant par l’étude d’impact que par le rapport de la mission sénatoriale ou encore par le conseil interministériel de l’outre-mer qui s’est tenu le 6 novembre 2009. Mais, une nouvelle fois, le Gouvernement a choisi de procéder, pour nos régions, par voie d’ordonnance.
Je ne peux donc que m’associer au rapporteur du texte quand il regrette que, « une fois encore, le Gouvernement utilise la procédure des ordonnances pour traiter les questions relatives à l’outre-mer, procédure qui, dans les faits, dessaisit le Parlement de ses pouvoirs ».
Je demande donc que, à défaut d’intégrer l’outre-mer dans ce projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche en France, le Gouvernement dépose un projet de loi spécifique à l’outre-mer en matière d’agriculture et de pêche.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Non, monsieur Gillot, l’outre-mer n’est pas oublié dans le présent projet de loi. En effet, certaines dispositions, comme celles qui sont relatives aux contrats, aux organisations de producteurs, à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, s’appliquent de plein droit à l’outre-mer.
Par ailleurs, la politique de l’alimentation est une politique nationale qui concerne tous les territoires de la République, y compris donc les territoires ultramarins.
En outre, l’article 24 prévoit d’adapter par ordonnance certaines dispositions de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, en particulier celles qui sont relatives au foncier agricole.
Enfin, sur la forme, le Parlement ne peut, conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, enjoindre au Gouvernement de déposer un projet de loi.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Gillot, le développement de l’agriculture outre-mer est effectivement une question majeure, je l’ai rappelé tout à l’heure dans ma présentation.
Pour autant, le Gouvernement estime que cet amendement n’a pas d’objet à partir du moment où un titre spécifique à l’outre-mer figure dans le projet de loi et où les mesures définies le 6 novembre dernier y seront intégrées. Il nous faut toutefois, pour cela, consulter préalablement les collectivités concernées.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous procédons par ordonnance. Il n’en demeure pas moins que le développement de l’agriculture outre-mer est un enjeu majeur et qu’il sera traité en tant que tel.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

TITRE Ier
DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION
I. – Le livre II du code rural est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Avant le chapitre 1er du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La politique de l’alimentation
« Art. L. 230-1. – La politique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise ainsi à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans un programme national pour l’alimentation après avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il est rendu compte tous les trois ans au Parlement de l’action du Gouvernement dans ce domaine.
« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
« - la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
« - la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« - la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;
« - l’éducation et l’information notamment en matière d’équilibre et de diversité alimentaires, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité et de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production, de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;
« - la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;
« - la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;
« - les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ;
« - le respect des terroirs par le développement de filières courtes ;
« - le patrimoine alimentaire et culinaire français.
« Art. L. 230-2. – L’autorité administrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de sa politique de l’alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission.
« Art. L. 230-3. – Les gestionnaires des services de restauration scolaire et universitaire publics et privés sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent déterminées par décret.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des obligations fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.
« Lorsqu’un agent mentionné à l’alinéa précédent constate dans un service de restauration scolaire ou universitaire la méconnaissance des règles relatives à la nutrition mentionnées au premier alinéa, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration scolaire ou universitaire concerné de respecter ces dispositions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement scolaire ou universitaire des résultats des contrôles diligentés par l’État.
« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établissement d’enseignement privé, l’autorité compétente de l’État informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’il a ordonnées.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
« Art. L. 230-4. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux plus démunis. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par des personnes publiques et privées.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.
« Des décrets fixent les modalités d’application du présent article, notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes morales de droit privé ; ces conditions doivent permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. »
II. -Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. – La politique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural. »
III. – Au début du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 3231-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-1-1. – La politique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, sur l’article.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le titre Ier de ce texte vise à définir et à mettre en œuvre une politique publique de l’alimentation. C’est un projet ambitieux, qui pouvait laisser augurer de grandes avancées en matière de santé publique.
En effet, avec la dégradation des pratiques alimentaires et toutes leurs conséquences, il semblait indispensable que les pouvoirs publics se saisissent concrètement de cette question pour y apporter des réponses.
Très investie sur ce sujet, j’attendais beaucoup de ce texte. Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur de mes espérances.
Pourtant, on trouve dans ce titre Ier des dispositions importantes. Je pense notamment à celles qui tendent à assurer une aide alimentaire aux plus démunis, à améliorer la qualité de nos aliments ou encore à promouvoir l’éducation nutritionnelle.
Le problème qui se pose porte donc non sur le fond, mais sur les moyens réels qui devraient être mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.
C’est ainsi qu’il est proposé de renforcer le contrôle des repas servis dans la restauration scolaire afin que soient respectées des règles nutritionnelles. Très bien ! Mais vous ne proposez rien pour permettre aux collectivités en charge de ces questions d’améliorer la qualité des aliments qu’elles achètent.
Vous proposez aussi qu’il soit possible d’imposer aux producteurs transformateurs et distributeurs la transmission de données techniques ou économiques relatives à leurs activités. Mais rien n’indique que ce contrôle pourra donner lieu à des sanctions en cas non-respect des obligations en question.
En l’état, ce texte n’est qu’un ensemble de recommandations et de préconisations très générales, qui ne précisent ni les moyens dégagés pour atteindre les objectifs affichés ni les sanctions effectivement mises en place en cas de manquement à certaines règles.
Cette politique publique de l’alimentation est donc, malheureusement, beaucoup trop vague !
C’est très décevant, car il est aujourd’hui essentiel que les pouvoirs publics mettent en place des mesures claires et concrètes favorisant l’accès à une nourriture de qualité pour tous.
Vous le savez, les enjeux d’une politique de l’alimentation sont des enjeux majeurs, à commencer par celui de la santé. En effet, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle ou encore le diabète ont, bien souvent, pour origine une alimentation déséquilibrée et de mauvaise qualité. L’obésité se développe aussi de façon très inquiétante et touche particulièrement les plus jeunes et les catégories sociales les moins favorisées.
Il apparaît donc indispensable que des mesures claires et normatives, avec des moyens bien précisés, soient prises pour lutter contre la dégradation des pratiques alimentaires, parallèlement à la mise en place d’une véritable éducation nutritionnelle, à destination des enfants comme des adultes. De simples recommandations ne suffiront pas !
Le groupe socialiste reviendra, tout au long de l’examen de l’article 1er, sur cette nécessité par le biais de nombreuses propositions.
Alors que vous avez dit tout à l’heure, monsieur le ministre, qu’il nous fallait une alimentation « sûre et saine », je veux vous interpeller sur une problématique totalement occultée dans ce projet de loi, celle de l’utilisation des pesticides.
Nous savons tous que les pesticides comportent des risques pour les agriculteurs utilisateurs, les consommateurs et l’environnement. Or la France est le troisième consommateur de pesticide d’Europe, avec 5, 4 kilogrammes par hectare et par an. Ce constat est très alarmant quand on connaît l’incidence de l’utilisation des pesticides sur le développement de certaines pathologies : problèmes neurologiques, stérilité, cancers ou maladie de Parkinson.
Il aurait donc été indispensable que la question des pesticides soit abordée dans ce texte, en lien avec la mise en place d’une politique de l’alimentation « saine, sûre et de qualité ».
Mais, derrière cette question, il y a celle de l’industrialisation massive de l’agriculture, qui conduit trop souvent à substituer la quantité à la qualité. Il nous faut donc promouvoir une politique agricole alternative, dans laquelle la qualité des aliments, le respect de nos terroirs et la promotion des filières courtes soient autant de priorités. Nous ne pouvons plus nous en tenir à des considérations d’abord économiques.
À cet égard, je suis extrêmement étonnée de constater que ce titre Ier n’aborde ni la question du mode de production ni celle de la juste rémunération des agriculteurs. Comment mener une politique de l’alimentation favorisant la consommation de produits de qualité si nous ne donnons pas la possibilité aux agriculteurs de vivre décemment de leur activité ? En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte n’interdit pas de mener cette politique avec des produits importés, au détriment des agriculteurs français.
Pour conclure, je dirai que la politique publique de l’alimentation qui nous est proposée n’est pas à la hauteur des enjeux fondamentaux - économiques, environnementaux et de santé publique – qu’elle soulève. Je redoute que la politique de l’alimentation qui est ici affichée ne relève, une fois de plus, que de l’effet d’annonce et ne contribue finalement à pérenniser un système libéral, destructeur à plusieurs titres.

Je me permettrai d’abord de rappeler à notre collègue Jacques Blanc un vieux dicton que ma grand-mère répétait souvent : « Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de la rage ». Car, mon cher collègue, dans vos propos, vous avez manqué d’objectivité et vous avez même fait preuve de dogmatisme. Les reproches que vous avez adressés au président de notre groupe, Jean-Pierre Bel, n’étaient pas fondés : non seulement il a rappelé, dans son intervention, beaucoup de nos propositions, mais notre motion n’avait nullement pour objet de repousser je ne sais quelle échéance ; il s’agissait d’inviter à pousser plus loin la réflexion, de façon à faire émerger un texte plus riche que celui qui nous est présentement soumis.
J’en viens à l’article 1er. Nous l’avons dit lors de la discussion générale, et le président Bel l’a répété tout à l'heure, faire figurer la politique de l’alimentation en tête de ce projet de loi est une bonne chose. Nous avons toutefois déposé des amendements pour améliorer le contenu de cet article.
Cette loi est censée bouleverser l’avenir. Nous ne pouvons que saluer cette nouvelle volonté qui est affichée de lier notre bien-être, au sens physique du terme, au « bien-manger ». On ne le rappellera jamais assez, le but principal de l’agriculture est bien de nourrir l’ensemble de la population.
L’objectif de cet article est donc de rapprocher la politique agricole de la politique alimentaire et, par conséquent, de la politique de santé publique. Pour cela, il est nécessaire de développer la transversalité et l’« interministérialité » entre ces secteurs. Jusqu’à présent, il n’a jamais été fait référence, dans aucun code, à la politique de l’alimentation.
Le groupe socialiste a à cœur d’enrichir ce débat d’utilité nationale et, pour cela, il estime qu’il faut suivre les trois orientations suivantes, car elles nous semblent essentielles : premièrement, s’attaquer aux disparités sociales ; deuxièmement, mener collectivement une réelle action en direction de la restauration scolaire ; troisièmement, engager les moyens et les solidarités nécessaires pour conduire une politique volontariste de l’alimentation.
Afin de s’attaquer aux disparités sociales, qui persistent, il nous paraît nécessaire de mener une politique de l’alimentation plus engagée. Aujourd’hui, nous le constatons tous, les chaînes de restauration rapide, où la qualité nutritionnelle et gustative des produits n’est pas prouvée, sont envahies par une clientèle à petits revenus, notamment par les étudiants, car ce sont les seuls lieux qui permettent de se nourrir à l’extérieur à un coût aussi peu élevé que possible.
Le président Bel l’a souligné, il est décevant que l’agriculture biologique soit la grande absente de ce texte. Alors que le Grenelle de l’environnement– ou ce qu’il en reste ! – vient d’être voté, établir un lien entre ces deux textes aurait permis d’assurer une meilleure cohérence politique.
Si l’on veut tenir les objectifs du Grenelle de 6 % de la SAU – surface agricole utile – en bio en 2012 et de 20 % en 2020, il faut changer de braquet. C’est possible, mais nous devons nous en donner les moyens. Nous ne devons pas nous contenter d’afficher dans la loi de grandes intentions.
De plus, en ces temps de crise, il est établi que les agriculteurs biologiques s’en sortent mieux que les autres. Pour autant, nous sommes loin des objectifs fixés : 1, 5 % de la SAU seulement est consacré à l’agriculture biologique.
À l’époque des contrats territoriaux d’exploitation, reconnaissons-le, le nombre de conversions à l’agriculture biologique était dix fois plus important qu’aujourd'hui.
M. le ministre en doute.

Nous devons faire preuve de volonté pour démocratiser l’accès à ces produits.
Opposer l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle serait une erreur, pis, une absurdité, car elles sont selon moi complémentaires. Toutes les recherches faites dans le domaine de l’agriculture biologique servent également à l’agriculture conventionnelle. Il n’en demeure pas moins que l’objectif à atteindre n’apparaît pas suffisamment dans le projet de loi.
En ce qui concerne la restauration collective, vous voulez imposer aux gestionnaires des établissements de restauration de respecter des règles très strictes. Nous ne pouvons y être opposés. Mais nous devrions nous rapprocher du Conseil national de l’alimentation, qui accorde une grande importance à ce secteur.
Il faut cependant faire attention aux conséquences de ces règles pour les gestionnaires de la restauration scolaire. Nous devons, en particulier, veiller à ce que la gestion en régie ne disparaisse pas, ce que personne ne souhaite, au profit de la délégation à des grands groupes, car nous ne serions plus à même de garantir le respect des règles nutritionnelles.
Nous adhérons aux grandes orientations du texte, mais nous souhaiterions qu’y soit apporté un bémol, pour que l’obligation de respecter des règles strictes n’empêche pas les gestionnaires de la restauration scolaire…

J’en viens donc à ma conclusion, monsieur le président.
Enfin, il faut donner les moyens aux collectivités locales de mener cette politique volontariste. Le rouleau compresseur de la RGPP ne permet plus aux services de l’État déconcentrés dans les départements de remplir leur rôle et cela se retournera vraisemblablement contre les collectivités locales.

Mes chers collègues, dans la mesure où de nombreux orateurs se sont inscrits pour intervenir sur l’article 1er, je demande à chacun de respecter le temps de parole imparti.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, sur l'article.

Beaucoup, parmi les différents orateurs, ont relevé les lacunes de ce texte ou ont critiqué les propositions qui nous sont faites. Heureusement, la commission a enrichi le projet de loi pour donner satisfaction à un certain nombre d’entre nous.
Comme de nombreux sénateurs, je me déplace beaucoup sur le terrain. Avant que le projet de loi ne vienne en discussion devant le Sénat, j’ai rencontré en Dordogne un certain nombre d’acteurs du monde agricole. La grande majorité d’entre eux, qu’il s’agisse de représentants des Jeunes agriculteurs, de la FDSEA ou de la Confédération paysanne, a estimé que ce texte ne répondait pas aux problèmes actuels du monde agricole.
Dans le prolongement de ce qu’ont déjà dit mes deux collègues socialistes, je voudrais souligner que l’article 1er n’est pas à la hauteur des ambitions affichées. L’absence de prise en compte de la dimension économique dans l’accès à l’alimentation est particulièrement évidente.
Si l’un des enjeux majeurs du texte est bien d’encourager une meilleure alimentation et de la rendre plus accessible à tous les consommateurs, alors, on fait ici fausse route.
Une alimentation de qualité est une chose ; y accéder en est une autre. Cela a déjà été dit, la fracture alimentaire qui existe aujourd’hui dans notre pays ne cesse de se creuser. Autrement dit, aujourd’hui encore plus qu’hier, les revenus déterminent l’accès à l’alimentation. Dans ces conditions, il est important de se montrer ambitieux. C’est en tout cas la position de notre groupe et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à reconnaître l’accès de tous à une alimentation de qualité.
En effet, il me paraît logique de réaffirmer dès le début du texte que la politique publique de l’alimentation qu’on se propose d’élaborer s’adressera bien à tous les citoyens, et pas seulement à quelques consommateurs. Une fois cette base posée, il restera alors à bâtir cette nouvelle politique. À défaut, je crains pour la solidité de l’ouvrage.
Il faudrait, par exemple, développer la concertation et favoriser une plus grande transparence. Il serait en réalité assez logique que cette politique de l’alimentation et le programme national pour l’alimentation soient élaborés après consultation des instances qualifiées en matière scientifique.
De la même manière, il conviendrait de faire en sorte que les agricultures de proximité, biologiques et paysannes, dont vient de parler Didier Guillaume, soient davantage présentes dans les services de restauration scolaire. Cela me semble constituer un enjeu important, a fortiori si l’on fait de l’éducation au goût un objectif de la politique d’alimentation.
Dans ces conditions, il me paraît indispensable que le Parlement soit tenu informé par un rapport annuel de l’évolution de cette question.
La mise en place d’une politique de nouvelles normes de nutrition ne doit pas entraîner des coûts trop importants pour la restauration scolaire ni conduire à ce que des communes qui assurent en régie le service de restauration se déchargent de cette tâche parce qu’elle serait devenue trop compliquée à gérer ou trop chère à assumer.
Enfin, l’État doit montrer l’exemple en la matière. On ne peut pas, en effet, s’engager à assumer de nouvelles obligations à l’égard des citoyens sans s’interroger sur leur coût. Si je suis favorable à la mise en place de nouvelles règles nutritionnelles, je suis en revanche tout à fait opposé au dispositif qui nous est proposé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de l’introduction de la notion d’alimentation à l’article 1er du projet de loi, une alimentation qui doit être saine, de qualité et suffisamment abondante.
Il est extrêmement important qu’elle soit saine, car c’est bien de santé qu’il s’agit.
Il va de soi qu’elle doit être de qualité, mais encore faudrait-il prendre un certain nombre de précautions. Le texte est muet, ou à tout le moins discret, sur cette question. À l’évidence, la qualité de la nourriture ne peut être simplement analysée sous le seul aspect scientifique, car elle relève avant tout de la perception gustative du consommateur, et le goût est quelque chose qui s’éduque.

Ainsi, pour un palais non formé, une viande persillée peut paraître moins bonne qu’une viande qui ne l’est pas, et celle d’un animal de quatre ou cinq ans moins savoureuse que celle d’un animal de dix-huit mois. Cette éducation du goût passe bien entendu par l’école, mais également par l’information des consommateurs.
Mes chers collègues, moi qui suis un consommateur de viande rouge – cela ne vous étonnera pas !
Sourires

J’en viens à la traçabilité, dont on fait des gorges chaudes. Encore faudrait-il qu’elle soit suffisamment précise, car la mention « viande d’origine européenne » ne nous renseigne guère ! L’entrecôte que l’on va manger vient-elle d’une blonde d’Aquitaine, dont vous devez savoir, monsieur le ministre, qu’elle est la Rolls-Royce des races à viande ? §
Sourires
Sourires

En tout cas, je le répète, il faudrait que le consommateur dispose d’informations précises, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.
Il conviendrait également d’en finir avec un certain nombre de lieux communs. On nous répète à l’envi qu’il faut consommer cinq fruits et légumes par jour. Mais, s’ils sont bourrés de pesticides, il vaut mieux que les gamins n’en mangent pas !
Parlons donc d’agriculture biologique, comme l’a fait Didier Guillaume, ou, mieux encore, d’agriculture raisonnée.
Sourires.

Nous vivons quand même dans le pays de la tradition culinaire, d’où la « malbouffe » doit être totalement bannie. Voilà aussi ce qui doit être mis en exergue dans un texte traitant de l’alimentation. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.)

Je salue l’intitulé du titre Ier, « Définir et mettre en œuvre une politique publique de l’alimentation », car il permet de rappeler implicitement que le premier objectif de l’agriculture est de nourrir les hommes, et non les voitures. Je fais ici référence au lobbying intense qui s’est déployé il y a quelques mois pour empêcher que le mot « agrocarburant » figure dans la loi ; mais c’est finalement par une opération de greenwashing que la dénomination « biocarburant » a été présente.
Je me félicite donc que le sujet de l’alimentation soit abordé, car, comme les autres, notre pays souffre de la « malbouffe », et ce à plusieurs titres.
Tout d’abord, ce phénomène crée des problèmes de santé publique. Sans revenir sur cet aspect, car il a déjà été évoqué, je veux simplement rappeler un chiffre qui croît de manière linéaire depuis une quinzaine d’années dans notre pays, celui de l’obésité : chaque année, le nombre de personnes atteintes d’obésité augmente de 5 % par an. Cela signifie qu’il double tous les quinze ans et qu’en 2020 plus d’un tiers de la population française sera touché par ce fléau. Il faut donc y remédier.
Ensuite, sur le plan sociologique, la déstructuration des repas entraîne une perte de la relation humaine. Aujourd’hui, les enfants monologuent devant leur ordinateur et leur console de jeux en grignotant n’importe quoi au lieu de partager une vie de famille.
Enfin, il y a la dimension culturelle, sur laquelle je ne reviens pas non plus, car notre ami Fortassin l’a déjà évoquée.
Cela étant, le véritable problème tient à ce que l’on n’articule pas la politique alimentaire avec la politique agricole : tel qu’il est rédigé, le texte pourrait permettre de développer une politique de l’alimentation de qualité reposant sur des importations. Certains grands pays sont d’ailleurs capables de nous fournir à des prix très bas de la nourriture de très grande qualité, même à haute valeur environnementale, ou HVE.
L’articulation de la politique alimentaire et de la politique agricole suppose que nous agissions dans deux directions.
Premièrement, il nous faut parvenir à la souveraineté alimentaire. Nous devons avant tout produire pour satisfaire la demande intérieure. Or, nous sommes bien obligés de le constater, une partie non négligeable de notre agriculture, la plus productiviste d’ailleurs, est tournée vers l’exportation.
J’ai entendu tout à l’heure que l’on remettait au goût du jour un vieux concept datant d’il y a trente ans : le « pétrole vert ». Or les exportations se font vers des marchés fragilisés et ne se maintiennent qu’à coup de subventions européennes. Il est donc grand temps de recentrer l’agriculture vers les besoins de notre population, ce qui nous permettrait de nous appuyer sur des circuits plus courts.
Deuxièmement, il nous faut définir le type d’agriculture que nous voulons.
Je n’aime pas trop l’expression d’« agriculture durable », qui est devenue un fourre-tout. Parlons plutôt d’« agriculture soutenable », ce qui implique un système d’exploitation plus autonome. À ce titre, je voudrais répondre à l’intervention de M. le ministre dans la discussion générale.
Monsieur le ministre, la prise en compte de la problématique énergétique de l’agriculture française ne saurait se limiter à la promotion de la méthanisation sur les exploitations agricoles. Bien sûr, c’est une excellente chose, et nos voisins allemands se sont engagés avec succès dans cette direction. Il s’agit en effet de produire de l’énergie renouvelable et de manière parfaitement décentralisée.
Mais le problème de fond, le problème numéro un réside ailleurs, et il est particulièrement préoccupant : c’est le degré extrêmement élevé de dépendance de notre agriculture vis-à-vis des énergies fossiles. Celle-ci dépend en effet du pétrole, notamment à travers le gazole, mais aussi et surtout à travers les engrais de synthèse et les pesticides, dont la fabrication exige énormément d’énergie. Aussi, tant que nos systèmes de production agricole n’iront pas vers une utilisation plus économe de ces intrants, nous serons hors sujet !
Je le répète, nous devons articuler la politique alimentaire avec une politique agricole soutenable, s’inscrivant dans une perspective de souveraineté alimentaire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

L'amendement n° 646, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1 :
Remplacer les mots :
code rural
par les mots :
code rural et de la pêche maritime
II. - En conséquence, procéder à la même modification dans l'ensemble du projet de loi.
La parole est à M. Gérard César, rapporteur.

Cet amendement rédactionnel vise à tirer les conséquences du changement de nom du code rural, qui est devenu le code rural et de la pêche maritime par effet de quatre ordonnances publiées au Journal officiel au lendemain de la réunion au cours de laquelle la commission de l'économie a adopté le texte du projet de loi.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 88, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur et Teston, Mme Bourzai et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
par les mots :
Politique de l'alimentation, contrôle sanitaire des animaux et des aliments
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

Les premiers alinéas de l’article 1er visent à modifier les intitulés du livre II du code rural et de son titre III afin d’y intégrer une définition de la politique de l’alimentation.
Ainsi, de « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux » l’intitulé du livre II du code rural devient « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux ».
Le changement de l’intitulé du titre III est moins anodin. Il ne s’agit pas d’un simple ajout puisque « Le contrôle sanitaire des animaux et aliments » devient « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments ».
Selon nous, la suppression de la référence explicite au contrôle sanitaire des animaux, particulièrement dans un contexte de multiplication des crises sanitaires d’origine animale, n’est pas pertinente ; elle peut même être dangereuse. Le contrôle sanitaire des animaux porte d’ailleurs sur de nombreux points : normes des bâtiments d’élevage, conditions d’élevage, alimentation des animaux, traçabilité de la viande.
Il faut donc au contraire souligner que, pour assurer la protection de la santé des consommateurs, il est impératif de réaliser des contrôles à chaque étape de la production, notamment sur les animaux vivants ; d’où, d’ailleurs, l’importance des services vétérinaires publics.
De plus, la politique de l’alimentation ne saurait être réduite à la seule qualité nutritionnelle.
Nous proposons donc d’intituler le titre III : « Politique de l’alimentation, contrôle sanitaire des animaux et des aliments ».

Le nouveau titre proposé pour le titre III du livre II du code rural « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » désigne mieux l’objet des dispositions qu’il contient. Il permet ainsi de s’assurer que le consommateur bénéficiera de produits agricoles sains et sûrs.
L’intitulé actuel, auquel les auteurs de l’amendement proposent de revenir, vise le contrôle sanitaire des animaux et aliments, mais le terme « contrôle » est devenu ici impropre, car le contrôle fait également l’objet de dispositions dans le titre II intitulé « La lutte contre les maladies des animaux ». Le titre III traite des animaux, mais plus dans l’optique de leur insertion dans la chaîne alimentaire.
C’est pourquoi la commission propose de conserver l’intitulé prévu par le projet de loi et émet un avis défavorable.
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, mais j’ai peur que leur acception ne soit plus restrictive que les termes « sécurité sanitaire des aliments ».
Je préfère retenir un objectif plus large en la matière plutôt que de restreindre cette notion au contrôle sanitaire des animaux et des aliments.

Voilà pour moi une occasion de souligner la révolution culturelle qui est opérée par le fait que c’est désormais au ministère de l’agriculture qu’il revient en quelque sorte de piloter la politique de l’alimentation, y compris dans les incidences de celle-ci sur la santé. Cela répond à une demande qui a été exprimée à de nombreuses reprises.
Conserver l’intitulé « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » permet d’assigner à l’agriculture la mission d’offrir une alimentation qui, à la fois, soit de qualité et garantisse la sécurité sanitaire. Une dimension nouvelle très forte de l’agriculture est ainsi affirmée. Cela fait partie des grandes perspectives qui s’ouvrent.
Au moment où une vocation nouvelle est reconnue aux agriculteurs, il serait dommage d’apporter une restriction en limitant le dispositif au contrôle sanitaire des animaux.

Je comprends les intentions universalistes de notre collègue Jacques Blanc.
Cela étant, monsieur le ministre, vous nous expliquez qu’en étant trop précis, on manque de précision.
Sans engager une bataille sémantique, je voudrais souligner que la mémoire des consommateurs conserve des traces des crises sanitaires d’origine animale. C’est pourquoi il nous semble indispensable de les rassurer en faisant explicitement référence au contrôle sanitaire des animaux.
L'amendement n'est pas adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 19 mai 2010 :
À quatorze heures trente :
1. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, pour le développement des sociétés publiques locales (n° 359, 2009-2010).
Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 429, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 430, 2009-2010).
2. Question orale avec débat n° 60 de M. Jean-Louis Carrère à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation de la gendarmerie nationale.
M. Jean-Louis Carrère attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences désastreuses de l’application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale et notamment du rattachement à la police nationale.
De nombreuses inquiétudes ont été exprimées ces derniers mois sur la situation de la gendarmerie sans que le Gouvernement n’y apporte de réponse concrète. Pourtant, la situation sur le terrain est extrêmement préoccupante, et notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines. Le rattachement de la gendarmerie à la police nationale et les conséquences budgétaires qui l’accompagnent posent aujourd’hui clairement la question de l’avenir même du service public de la sécurité : personnel, statut, formation et matériels de gendarmerie sont aujourd’hui mis à mal par ce « rattachement ».
Cette situation est d’autant plus dramatique que la révision générale des politiques publiques entraîne des coupes supplémentaires dans les moyens dont dispose la gendarmerie nationale. En témoignent la suppression de 1 300 emplois prévus en 2010 et la fermeture de 175 brigades territoriales d’ici 2012.
Il souhaite ainsi interroger le Gouvernement sur l’évaluation de cette politique, particulièrement dommageable pour l’équilibre des territoires. Il demande que dans le cadre de ce débat, le Gouvernement permette l’accès à l’intégralité du rapport de l’Inspection générale de l’administration consacré aux conséquences financières du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur.
Il souhaite également demander au Gouvernement des éclaircissements quant à la cohérence de cette politique de réduction des moyens de la gendarmerie avec les objectifs affichés par le Gouvernement en termes de sécurité et de prévention.
Le soir :
3. Suite du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (Procédure accélérée) (n° 200, 2009-2010).
Rapport de M. Gérard César et M. Charles Revet, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 436, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 437, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.