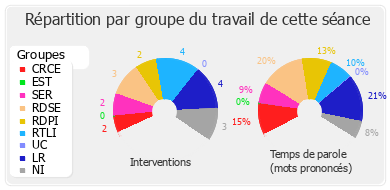Séance en hémicycle du 22 novembre 2011 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Problème des justificatifs d'existence à fournir tous les trois mois pour les retraités établis à l'étranger hors de l'union européenne (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Yannick Botrel, auteur de la question n° 1428, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, j’ai souhaité attirer l’attention du ministre de la culture et de la communication sur les modalités d’attribution des fréquences d’émissions radiophoniques par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA.
À titre d’exemple, j’évoquerai une radio commerciale qui émet dans mon département, les Côtes-d’Armor. Cette dernière, qui emploie dix salariés, souhaite depuis plusieurs années déjà étendre sa couverture radiophonique du territoire, notamment vers les départements voisins.
Malgré ses demandes répétées auprès du CSA quant à l’attribution de nouvelles fréquences, ce dernier lui oppose un refus systématique. Cette fin de non-recevoir est d’autant plus injustifiée que cette radio a vu son audience croître d’année en année, si l’on se réfère aux études réalisées par Médiamétrie.
En effet, cette radio fait aujourd’hui partie des trois radios les plus écoutées du département. Cela démontre qu’elle est très appréciée, car elle met en place une programmation qui répond aux attentes d’une partie importante de la population.
Cette non-attribution de fréquences supplémentaires ne favorise aucunement la pluralité des médias au sein du département des Côtes-d’Armor. À l’heure actuelle, trois groupes radiophoniques d’envergure nationale se partagent la majeure partie des fréquences de la région, et ce au détriment de nouvelles radios qui ont des projets de développement. Je croyais pourtant que l’une des missions du CSA était « d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ».
On va m’opposer que le nombre de fréquences disponibles sur la bande FM est limité et que le CSA n’est donc pas en mesure de satisfaire l’ensemble des demandes qui lui sont faites par chacun des opérateurs.
Pour autant, je note que le Conseil supérieur de l’audiovisuel réattribue systématiquement aux radios déjà en place les fréquences qui leur ont été antérieurement accordées. Ainsi, au terme de la période de quinze années à l’issue de laquelle les dossiers d’agrément doivent être réexaminés sur le fond par le CSA, celui-ci se contente très souvent de reconduire les exploitants en place.
Dès lors, il devient quasiment impossible pour de nouveaux acteurs de développer leur activité, ces derniers devant faire face à un blocage de leurs projets de manière irrémédiable, et ce malgré la solidité de leur dossier, qui répond parfaitement aux exigences du CSA, dont les décisions manquent parfois en la matière de transparence.
D’ailleurs, le département des Côtes-d’Armor n’est pas le seul département dans lequel des radios expriment leurs désaccords quant aux décisions rendues par le CSA. Dernièrement, plusieurs radios locales émettant dans le département de la Réunion ont décidé de se réunir en association pour faire pression sur cette instance en demandant une révision de l’attribution des fréquences, une question vitale pour la survie de certaines d’entre elles.
Par conséquent, j’aimerais connaître les motivations du refus du CSA d’ouvrir la possibilité d’accorder des fréquences supplémentaires à une radio qui en fait la demande depuis plus de dix années et qui présente un dossier en conformité avec le cahier des charges du CSA.
Mme Odette Herviaux applaudit.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, qui m’a priée de vous répondre.
En application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, c’est au Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’il revient de délivrer les autorisations d’émettre aux radios privées diffusées par voie hertzienne terrestre, et donc, en l’espèce, à la radio commerciale émettant dans les Côtes-d’Armor que vous avez évoquée.
La procédure du CSA est transparente. Elle débute par la publication d’un appel à candidatures qui précise les zones géographiques, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios. Au terme de cet appel, le CSA arrête la liste des candidats recevables, puis procède à leur présélection, en appréciant l’intérêt de chaque candidature au regard des critères définis par la loi, parmi lesquels figurent notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, le financement ou encore les perspectives d’exploitation du service.
Après avoir signé une convention avec chaque radio, le CSA délivre les autorisations de diffusion pour une durée maximale de cinq ans. Il est tenu de motiver ses décisions négatives. Les candidats non sélectionnés ont toujours la possibilité de saisir le Conseil d’État pour obtenir l’annulation des décisions du CSA.
Les fréquences hertziennes constituent un bien public rare. Cette rareté est une contrainte qui pèse aussi bien sur le développement des grands réseaux que des radios locales indépendantes qui souhaitent étendre leur zone de couverture. C’est d’ailleurs pour cette raison que le législateur a demandé au CSA, en 2004, de lancer un nouveau plan de fréquences pour optimiser la diffusion radiophonique sur le plan national et dégager de nouvelles fréquences.
Après avoir consulté les radios sur le plan de fréquences envisagé, le CSA a ainsi réexaminé et amélioré la planification de la bande FM, en lançant quinze appels à candidatures entre janvier 2007 et avril 2010. Ces travaux ont permis au CSA de dégager plus de 1 300 nouvelles fréquences, soit une augmentation moyenne de 21 % du nombre de fréquences.
À titre d’exemple, l’appel général à candidatures lancé en Bretagne en 2006 avait permis de dégager quatorze nouvelles fréquences pour le département des Côtes-d’Armor. La replanification de la bande s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et les ressources supplémentaires dégagées ont, pour l’essentiel, été attribuées aux radios du secteur privé et associatif.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse détaillée. Vous avez raison de dire que les ondes hertziennes sont un « bien public rare ». Au travers des exemples qui m’ont été fournis, je constate que les radios, singulièrement celle que j’ai évoquée, ne peuvent y accéder, en dépit des progrès que vous avez soulignés.
En réalité, ce n’est pas la procédure en soi qui est en cause ; le problème réside plutôt dans les modalités de son application. En effet, les fréquences qui ont été attribuées à de grands groupes commerciaux d’envergure nationale ne sont pas remises en cause. On crée donc de facto une rente de situation en faveur de ces groupes, au détriment des initiatives locales.
Personnellement, je ne conteste pas du tout le rôle essentiel en la matière du CSA. Mais je conteste la déclinaison des décisions prises, qui sont préjudiciables à la vie culturelle, associative, voire économique des territoires. De mon point de vue, cette situation est inacceptable, et le CSA devrait faire preuve d’une plus grande vigilance. D’autres départements doivent d’ailleurs connaître une situation analogue à celle que j’ai évoquée.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, auteur de la question n° 1407, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Par cette question, j’entendais attirer l’attention de M. le garde des sceaux sur l’impunité des attaques diffamatoires qui s’exercent sur les réseaux sociaux.
À l’heure où ces réseaux sociaux connaissent leur apogée et deviennent un instrument de communication pour nombre d’entre nous, les insultes et les diffamations formulées sur ces réseaux se sont multipliées d’une manière que je qualifierai d’« exponentielle ».
Parmi les premières victimes de ce fléau, on retrouve un public fragile tel qu’un enfant handicapé victime d’un lynchage en ligne ou une jeune fille rouée de coups par le frère d’une amie pour avoir insulté celle-ci en toute impunité. Les élus sont, eux aussi, malheureusement trop souvent les victimes de ces agissements : il est devenu en effet extrêmement simple de déverser en ligne, en quelques mots, son lot d’accusations, singulièrement à l’occasion des campagnes électorales. Je pense ici tout particulièrement à un élu que je connais bien, qui a subi de tels débordements lors des dernières élections cantonales.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les délits d’injures et de diffamations publiques. Ce texte, qui est appliqué dans la majeure partie des cas, concerne les crimes et délits commis par voie de presse ou tout autre moyen de communication, entendu au sens large du terme.
Les réseaux sociaux constituent un moyen de communication et peuvent donc être soumis à la répression. Or ces agissements bénéficient, au nom de la liberté de poursuite du ministère public, d’une quasi-impunité. Les auteurs d’attaques diffamantes ne sont nullement intimidés par une loi, qui, en l’espèce, n’est le plus souvent pas appliquée. De ce fait, ils osent de plus en plus braver les interdits en insultant et en calomniant.
Le parquet argue du fait qu’il est impuissant eu égard au nombre d’insultes et de diffamations formulées. Pour ma part, je prétends que c’est précisément parce qu’il est impuissant que de tels débordements se sont multipliés de manière exponentielle.
Par le jeu du classement sans suite, les réseaux sociaux deviennent une zone de non-droit, comme il en existe tant sur Internet. Bien que les victimes aient le droit d’engager des poursuites et de passer outre un classement sans suite, elles réclament le plus souvent un simple rappel à la loi plutôt qu’un procès qui serait long et coûteux.
Dès lors, que faire quand l’État ne protège plus les citoyens contre les excès récurrents de la liberté d’expression commis sur les réseaux sociaux ? À l’ère d’Internet et de la e-démocratie, l’État se doit de faire respecter une loi qui a fait ses preuves puisqu’elle régit la liberté de la presse depuis, je le répète, 1881. En effet, les victimes ne doivent plus se sentir en quelque sorte les oubliés de la justice.
Mme Odette Herviaux et M. Yannick Botrel applaudissent.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser M. le garde des sceaux, qui, ne pouvant être présent ce matin, m’a chargée de vous répondre.
La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou encore par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette liberté est toutefois relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés.
En droit français, la liberté d’expression se trouve notamment limitée par la loi du 29 juillet 1881, qui reconnaît comme mode de publication, au sens de son article 23, la diffusion via Internet au même titre que la publication par écrit ou par un moyen audiovisuel. Dès lors, les propos diffusés via Internet sont susceptibles d’être incriminés pour diffamation ou injure publiques, qualifications pénales définies à l’article 29 de la loi précitée.
S’agissant de la poursuite des infractions commises par voie de presse, l’article 47 de la loi de 1881 dispose que « la poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public ».
Si le ministère public conserve, en vertu de cet article, la maîtrise de l’action publique en matière de presse, la portée de cette règle est néanmoins atténuée par l’exigence, dans la plupart des cas, d’une plainte préalable de la victime. Le législateur a en effet laissé à la victime le soin d’apprécier la gravité de l’atteinte subie et l’opportunité de mettre en mouvement l’action publique. Elle a la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction ou bien de citer directement l’auteur des propos devant le tribunal correctionnel.
Il est par conséquent inexact de parler d’impunité en matière de diffamation ou d’injure sur Internet, et ce d’autant que les moyens de lutte contre de tels comportements ont été renforcés.
Il faut ainsi rappeler que le juge des référés peut être saisi, en application de l’article 50-1 de la loi de 1881, pour que soit ordonné l’arrêt du service de communication au public en ligne, dès lors qu’il contient des messages appelant à la commission de crimes ou de délits ou provoquant à la haine, à la violence ou à la discrimination et qu’il constitue un trouble à l’ordre public.
De manière plus générale, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [...] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
En outre, ce même texte retient la responsabilité pénale des hébergeurs s’ils n’agissent pas rapidement pour rendre impossible l’accès à un contenu illicite ou le retirer dès lors qu’ils ont effectivement eu connaissance, par tout moyen, du caractère illicite d’une activité ou d’une information dont ils assurent le stockage.
Enfin, en vue de lutter contre ces dérives sur Internet, un système de signalement des sites à contenus illicites a été mis en place en 2008 au sein de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, ou OCLCTIC, de la police judiciaire.
La plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, ou PHAROS, est composée de manière paritaire de policiers et de gendarmes. Elle est accessible au public, via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d’accès et les services de veille étatique à signaler en ligne les sites ou les contenus potentiellement contraires aux lois ou aux règlements diffusés sur Internet.

J’aurais souhaité avoir un dialogue singulier avec le ministre concerné. En effet, madame la ministre, vous m’avez apporté une réponse que je qualifierai d’ampoulée, d’exhaustive et de convenue.
En effet, dans le cas précis que j’évoquais, à savoir des insultes proférées à l’égard d’un élu, la marche à suivre que vous préconisez a été respectée. L’élu concerné a bien porté plainte. Mais, quelque temps après, il a reçu du parquet une lettre plutôt lapidaire lui expliquant que ce dernier, en matière d’injure et de diffamation, ne prenait pas l’initiative de poursuites.
L’élu concerné demandait simplement – c’est le moins qu’il pouvait faire, du reste ! – qu’il y ait un rappel à la loi, ce que j’évoquais dans ma question initiale. Vous comprenez bien que, pour une injure et un propos diffamatoire sur Internet, il n’allait pas faire citer l’auteur de la diffamation devant le tribunal correctionnel, avec, à la clé, un procès long, coûteux et parfaitement décalé par rapport à la réalité de la situation !
Par conséquent, je ne peux considérer votre réponse comme satisfaisante, d’autant que, en l’occurrence, le droit n’est pas appliqué, et singulièrement à l’égard d’un élu. Ce dernier étant du Sud-Ouest, cela me ramène à la problématique du rugby, sport que j’ai moi-même pratiqué à quelques reprises. Quand, au cours d’un match, l’arbitre ne fait pas son boulot, on sait comment cela finit ! Par conséquent, madame la ministre, votre réponse n’est pas satisfaisante, loin s’en faut !
M. Jean Besson applaudit.

La parole est à M. Jean Besson, auteur de la question n° 1421, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette question adressée à M. le garde des sceaux porte sur la réforme de la carte judiciaire dans la Drôme.
L’une des conséquences les plus emblématiques de cette réorganisation, menée sans concertation préalable, concerne le tribunal d’instance de Valence, dont le ressort territorial a été étendu aux huit cantons qui relèvent du tribunal d’instance de Die, moyennant quoi la population dépendant de cette juridiction dite de « proximité » est passée de 195 000 habitants à 231 000 habitants.
De fait, cela occasionne de grandes difficultés pour les justiciables. Aucun point d’accès au droit n’ayant été créé dans le Diois, les administrés domiciliés dans ce territoire sont dans l’obligation, pour se présenter au greffe à Valence, de parcourir environ 220 kilomètres aller-retour, soit trois heures trente de trajet. Il en est de même pour les juges des tutelles, qui sont obligés de se déplacer.
Par ailleurs, j’ai pu constater moi-même, sur place, que les conditions de travail se détériorent en raison de la baisse des dotations de fonctionnement et de la réduction des effectifs.
Ainsi, il n’est pas rare que les magistrats, bien qu’affectés au service du tribunal d’instance, soient sollicités pour participer aux activités du tribunal de grande instance. Il faut savoir aussi que la juridiction à Valence ne bénéficie plus, depuis plusieurs années, des crédits permettant d’assurer un entretien courant des locaux.
Madame la ministre, le malaise ne fait que croître au sein de l’institution judiciaire. Il prend sa source au cœur même des territoires ruraux, là où beaucoup de juridictions de proximité ont été soit sacrifiées, soit précarisées, cela pour des motifs de rentabilité pour le moins contestables. La Drôme, je peux en témoigner, ne fait malheureusement pas exception à cette règle.
C’est pourquoi je souhaite savoir précisément quelles mesures vous comptez prendre afin de donner à la justice les moyens de fonctionner dans des conditions dignes de ce nom, dans la Drôme et à Valence.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. le garde des sceaux, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.
Vous avez interrogé M. Mercier sur la situation du tribunal d’instance de Valence, à la suite de la réforme de la carte judiciaire.
À l’occasion de cette réforme, la situation de chaque tribunal d’instance a été analysée sur de nombreux critères, y compris le volume d’activité annuel.
Le tribunal d’instance de Die et le greffe détaché de Crest connaissaient une très faible activité : 289 affaires civiles nouvelles par an en moyenne entre 2004 et 2006, pour un niveau moyen d’activité, sur le plan national, de 615 affaires par an et par magistrat. Cela ne permettait donc pas d’affecter dans cette juridiction un magistrat à temps plein.
Les préoccupations d’aménagement du territoire et l’accessibilité pour le justiciable sont également des éléments qui ont été pris en compte – la juridiction de rattachement, Valence, se situe à un peu plus d’une heure de route de la juridiction supprimée de Die –, ainsi que les dispositions de l’article 1235 du code de procédure civile relatives aux déplacements du juge des tutelles.
S’agissant des effectifs de magistrats de la juridiction valentinoise, la localisation des emplois est déterminée chaque année à l’issue des dialogues de gestion qui se déroulent entre les chefs de cours et la direction des services judiciaires.
En 2009, trois postes ont été localisés au tribunal d’instance de Valence après absorption du tribunal d’instance de Die. En 2010, un poste supplémentaire y a été localisé. Enfin, en 2010, un poste supplémentaire de vice-président a été localisé au tribunal de grande instance de Valence.
Cela se justifie, d’abord, par l’évolution de l’activité constatée dans chaque juridiction, ensuite, par le transfert d’activité des tutelles des mineurs et, enfin, par la nécessité d’accroître la participation des magistrats au service correctionnel du tribunal de grande instance.
En ce qui concerne les fonctionnaires, leur nombre au tribunal d’instance est fixé à quatorze. Toutefois, deux adjoints administratifs ont prévu de prendre leur retraite prochainement ; leurs deux postes sont d’ores et déjà publiés pour la prochaine commission administrative paritaire de mobilité, avec une prise de fonctions prévue le 1er mars 2012.
S’agissant, enfin, des conditions matérielles de travail au sein du palais de justice de Valence, je précise que des travaux d’un montant de un million d’euros ont été réalisés au sein du bâtiment pour l’installation de la climatisation, la rénovation complète de la salle des pas perdus et des salles d’audience.
Un projet de 1, 5 million d’euros visant à permettre la réfection des façades du bâtiment et la mise en accessibilité du palais de justice va prochainement démarrer. Les études sont programmées pour la fin de cette année et les travaux devraient être entrepris au cours de l’année 2012.

Madame la ministre, je vous remercie de ces réponses, dont certaines sont positives ; vous comprendrez néanmoins que, sur l’essentiel et sur le fond, je ne sois pas totalement convaincu.
Selon un classement effectué par la Commission européenne, la France, s’agissant du budget annuel alloué au système judiciaire rapporté au PIB par habitant, ne se situe plus qu’au 37e rang sur 43 pays ! Ce chiffre illustre malheureusement le manque de considération de l’État envers la justice et son personnel.
La situation budgétaire ayant dépassé le seuil critique, je souhaite que la justice se voie octroyer, après les élections de 2012, un budget permettant à la France de se retrouver à nouveau dans les premiers rangs européens qu’elle n’aurait jamais dû quitter.

La parole est à M. Philippe Dallier, auteur de la question n° 1434, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Ma question s’adresse à M. Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Depuis plusieurs mois, on déplore, sur les communes de Seine-Saint-Denis limitrophes de la capitale, une explosion du phénomène des « marchés sauvages », véritables supermarchés de la misère à ciel ouvert.
Sur le secteur des portes de Montreuil et de Bagnolet en particulier, proche du marché aux puces de la porte de Montreuil, ce sont, chaque week-end, des centaines de vendeurs à la sauvette qui investissent les trottoirs, sans aucune autorisation, pour vendre à même le sol tout et n’importe quoi, y compris des objets de contrefaçon, des produits de récupération ou des produits issus de la contrebande, voire du recel de vols ; la presse s’en est fait l’écho à plusieurs reprises.
Les habitants, les associations de riverains et les commerçants de ces secteurs s’alarment de la réelle dégradation de la situation et de l’ampleur de ce phénomène nouveau, encore inconnu voilà quelques années. Les nuisances de voisinage occasionnées par ces pratiques sont bien réelles et le préjudice pour les commerçants qui sont régulièrement installés et qui, eux, paient un loyer et leurs impôts, est évident et parfois même considérable, avec des pertes de chiffres d’affaires approchant les 40 % le week-end.
Madame la ministre, cet été, le ministère de l’intérieur et la préfecture de police de Paris ont engagé une action déterminée pour lutter contre des pratiques similaires dans les zones touristiques de Paris. L’urgence de la situation en Seine-Saint-Denis, département aux portes de Paris, impose également aujourd’hui une réponse rapide et très ferme.
Par conséquent, je souhaite savoir quelles mesures vont être prises rapidement pour garantir la salubrité et la tranquillité publiques sur ces secteurs.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Vous avez appelé son attention sur le projet de mise en œuvre d’une police d’agglomération sur les marchés clandestins aux portes de Paris.
Pour lutter contre la recrudescence des marchés aux puces et des vendeurs à la sauvette, la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de Police multiplie les actions de sécurisation, entre autres à Saint-Ouen, à Aubervilliers, à Pantin, à Bagnolet et à Montreuil-sous-Bois.
Les moyens opérationnels de lutte contre cette forme de délinquance ont été renforcés, sur le plan juridique, avec l’entrée en vigueur, le 14 mars 2011, de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2.
Les effectifs de police ont été confortés dans leur action par ce nouvel arsenal répressif, l’article 51 de la LOPPSI 2 correctionnalisant la pratique des ventes à la sauvette, passibles désormais de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Ainsi, au cours des dix premiers mois de l’année 2011, 216 opérations ont été réalisées à Aubervilliers. Plus de 800 personnes ont été contrôlées, 66 ont été interpellées et placées en garde à vue, 81 infractions ont été relevées et 41 contraventions ont été dressées.
À Saint-Ouen, 31 opérations de contrôles ont été menées permettant l’interpellation de 81 personnes, dont 55 pour vente de contrefaçons. Parmi elles, 31 personnes ont été placées en garde à vue.
À Pantin, 52 opérations de contrôles ont été réalisées. Ces actions ont permis de relever 47 infractions et d’interpeller 53 personnes, dont 19 ont été placées en garde à vue.
À Bagnolet, des opérations de contrôles sont menées chaque week-end ; 13 personnes ont été interpellées, dont 4 ont été placées en garde à vue et 9 ont fait l’objet d’une verbalisation.
À Montreuil-sous-Bois, 42 opérations de contrôles ont été réalisées, aboutissant à l’interpellation de 37 personnes, dont 31 ont fait l’objet d’une contravention, 2 de procédures judiciaires pour contrefaçon et 4 pour faits délictueux.
Au total, 6 972 procédures pour des ventes à la sauvette ont été réalisées sur l’ensemble de l’agglomération.

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. Je ne doute pas de la volonté du Gouvernement d’essayer d’enrayer ce phénomène ; vous avez d’ailleurs rappelé que les dispositifs législatifs avaient été renforcés.
Cela dit, nous connaissons une situation tout à fait particulière en raison du développement dans des proportions incroyables de ce phénomène de marchés clandestins qui pose bien des problèmes, non seulement aux habitants, mais aussi aux commerçants de ces quartiers.
En effet, lorsque les trottoirs sont totalement envahis par les vendeurs à la sauvette – car telle est bien la réalité ! –, les clients potentiels des commerçants concernés s’en retournent. Je n’ai jamais connu une situation aussi étonnante, alors même que j’ai toujours habité en Seine-Saint-Denis ! Il faut donc mettre un terme le plus rapidement possible à de telles pratiques.
J’ai pris bonne note des informations qui viennent de m’être transmises. Je serai bien évidemment très attentif à l’évolution de la situation et ne manquerai pas de vous ressaisir le cas échéant, madame la ministre.

La parole est à M. Robert Laufoaulu, auteur de la question n° 1429, adressée à Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.

Madame la ministre, ma question porte sur la situation des fonctionnaires territoriaux à Wallis-et-Futuna.
Actuellement, les agents permanents de ce territoire sont régis par un arrêté préfectoral de 1976, qui a donc été pris voilà trente-cinq ans et est devenu de ce fait largement obsolète.
Un projet de statut est en préparation, en vertu d’une loi ayant habilité le Gouvernement à préparer une ordonnance. Je souhaite donc connaître, madame la ministre, l’état d’avancement de ce projet, ainsi que le calendrier actuellement prévu par le Gouvernement.
J’en profite pour attirer votre attention sur l’utilité qu’il pourrait y avoir, notamment en terme de gain de temps, à ce que le projet de décret d’application puisse être prêt et transmis pour avis en même temps que le projet d’ordonnance. Pensez-vous, madame la ministre, que cela soit possible ?
Par ailleurs, je profite de cette question orale pour vous dire de nouveau combien il me paraît important qu’une attention particulière soit portée aux agents exerçant des missions de sécurité, à savoir les gardes territoriaux et les pompiers.
Vous avez raison, monsieur le sénateur, le statut des agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna relève malheureusement toujours de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1976, dont les dispositions ne sont plus en conformité avec les évolutions statutaires nationales en matière de fonction publique.
Une modernisation des règles statutaires s’imposait donc, et je me suis engagée à porter cette réforme, notamment à la suite de vos démarches, dont je vous remercie, monsieur le sénateur.
Cette réforme tend à créer, grâce à de meilleures conditions de recrutement et de déroulement de carrière, une fonction publique de qualité, adaptée au contexte des îles Wallis et Futuna.
Comme nous en avions parlé et ainsi que je l’avais annoncé lors de ma visite à Wallis-et-Futuna à la fin du mois de juillet dernier, une habilitation législative a été accordée par le Parlement aux fins de permettre cette évolution statutaire : la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique autorise en effet le Gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ».
Soyez-en assuré, mes services ont d’ores et déjà élaboré un projet d’ordonnance, qui fait actuellement l’objet d’une consultation interministérielle. Celui-ci définit les droits et obligations des fonctionnaires dont les corps seront déterminés par arrêtés de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les agents qui remplissent les conditions posées par l’ordonnance ont vocation à être intégrés et titularisés dans les corps ainsi créés, en fonction, d’une part, des emplois qu’ils occupent et des fonctions qu’ils exercent réellement et, d’autre part, des titres ou diplômes requis pour l’accès à ces emplois ou de l’expérience professionnelle acquise.
Ce projet d’ordonnance nécessite l’intervention d’un décret d’application, qui est également en cours d’élaboration.
Toutefois, sans attendre la rédaction des textes fondateurs d’un nouveau statut, j’ai demandé au représentant de l’État d’entreprendre une négociation sur les statuts particuliers des agents, corps par corps : ce travail est très avancé et pourra être finalisé dès la publication de l’ordonnance et du décret.
Pour ce qui concerne le calendrier, sur lequel vous m’avez interrogée, le projet d’ordonnance devrait pouvoir être adressé pour avis à l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna au début de l’année 2012. Dans le même temps, le Conseil d’État sera saisi.
En outre, puisque vous me le demandez, monsieur le sénateur, c’est très volontiers que j’accède à votre demande relative à la concomitance de transmission des projets d’ordonnance et de décret. Le calendrier s’en trouvera ainsi accéléré.
Enfin, s’agissant des agents concernés par les missions de sécurité – je pense notamment aux pompiers et à la garde territoriale –, dont je sais les contraintes et les services qu’ils rendent, soyez assuré de mon attention à leur égard, qui rejoint du reste la vôtre.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui, compte tenu de l’engagement que vous avez pris, me satisfait complètement. Le personnel vous sera reconnaissant de votre écoute et de votre réactivité. Grâce à la transmission simultanée des projets d’ordonnance et de décret, la situation devrait à mon avis s’accélérer, à la satisfaction des fonctionnaires concernés.

Mes chers collègues, nous avons pris un peu d’avance. Dans l’attente de l’arrivée de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures cinq, est reprise à dix heures vingt.

La parole est à M. Claude Dilain, auteur de la question n° 1439, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la recrudescence significative des cas de tuberculose observée ces dernières semaines sur certains territoires français.
L’incidence de la tuberculose en France est d’environ 9 cas pour 100 000 habitants. Mais, en Seine-Saint-Denis, elle est estimée à 30 cas pour 100 000 habitants. Et, dans certains quartiers de ce département que je connais bien, elle atteint pour l’instant jusqu’à 300 cas pour 100 000 habitants ! je dis « pour l’instant », car les premiers résultats de la campagne de dépistage paraissent déjà extrêmement inquiétants…
Ces statistiques mettent en évidence le problème des inégalités territoriales : tous les experts, en effet, s’accordent à dire que la tuberculose est un marqueur précis de la pauvreté.
Cette recrudescence pose également le problème de la stratégie sur laquelle repose la politique nationale de santé publique de lutte contre la tuberculose, adoptée en 2007.
En Seine-Saint-Denis, la fréquence de la tuberculose est élevée alors qu’une grande majorité de la population est vaccinée par le BCG – je crois même que ce département présente le meilleur taux de vaccination en France ! C’est la preuve que le BCG joue un rôle très faible dans la protection contre la tuberculose ; du reste, il s’agit d’une donnée médicale connue.
D’ailleurs, l’esprit du programme national de lutte contre la tuberculose de 2007 consistait à mettre fin à l’obligation vaccinale et à prendre pour priorités le dépistage, le diagnostic précoce et le traitement des tuberculoses latentes : il s’agit des axes 1 et 2 de ce programme.
D’autres pays, comme la Belgique ou l’Allemagne, ont adopté depuis plusieurs années cette stratégie – pas d’obligation vaccinale par le BCG –, qui s’est révélée efficace. En France, malheureusement, le BCG reste privilégié sur le terrain, au risque de négliger les actions de dépistage, et donc le traitement précoce.
Ainsi, madame la secrétaire d’État, comment accepter que les enseignants ne bénéficient jamais de visites médicales professionnelles – c’est d’ailleurs illégal –, donc d’un dépistage annuel de la tuberculose, même dans les territoires à haut risque ?
Madame la secrétaire d’État, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour que l’axe 1 du programme national de lutte contre la tuberculose devienne une réalité sur le terrain ?
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de mon collègue Xavier Bertrand, qui m’a demandé de vous répondre.
Comme vous l’avez précisé, la tendance à la baisse de la fréquence de la tuberculose en France est certaine sur le long terme : elle se manifeste par la diminution tant des taux de prévalence que du nombre des cas.
De 60 cas pour 100 000 habitants en 1972, le taux de prévalence de la tuberculose est tombé à 32 cas en 1980, puis à 8, 3 cas en 2009. En nombre de cas, la décroissance est similaire : 5 276 cas ont été déclarés en 2009, contre plus de 9 000 il y a quinze ans.
Certes, cette diminution se poursuit aujourd’hui plus lentement. Mais nous restons bien dans un mouvement de diminution de l’incidence de cette maladie dans notre pays. C’est donc à tort que vous avez parlé de « recrudescence ».
Il est connu depuis longtemps que la répartition de cette maladie sur le territoire est très inégale. La tuberculose frappe les plus fragiles, soit pour des raisons sociales, comme la proximité, la provenance de pays de forte endémie ou les séjours réguliers dans ces mêmes pays, soit pour des raisons médicales, comme les déficits immunitaires ou des traitements médicamenteux particuliers.
C’est ainsi que, aujourd’hui, des départements dans lesquels la proportion de personnes défavorisées est significative, comme la Seine-Saint-Denis, Paris ou la Guyane, présentent des taux supérieurs à la moyenne nationale.
C’est la raison pour laquelle nous continuons à concentrer les efforts de dépistage et de suivi des cas sur les populations les plus fragiles.
Le BCG, il est vrai, ne protège pas totalement contre la tuberculose pulmonaire ; mais il serait dangereux de considérer qu’il est inutile. Si l’obligation vaccinale a été suspendue pour la population générale, ce vaccin reste vivement recommandé au sein, précisément, des populations les plus exposées aux risques, qu’il s’agisse des risques géographiques – en région parisienne, en Guyane ou en cas de provenance de pays à forte endémie –, professionnels ou sociaux.
En l’absence de vaccin totalement efficace, il est préférable, plutôt que de laisser les populations à risque élevé démunies face à la maladie, de déployer ce moyen de prévention reconnu sur le plan international comme efficace contre les formes graves de tuberculose. Le BCG est d’ailleurs largement utilisé par l’Organisation mondiale de la santé dans les pays d’endémie élevée, dans le cadre du programme élargi de vaccination.
En sus de cette prévention, les efforts d’interruption de la chaîne infectieuse par le traitement rigoureux et le dépistage actif de la tuberculose, notamment autour des cas identifiés, constituent le quotidien des services de lutte contre la tuberculose présents sur tout le territoire national.
Il existe en effet au minimum un centre de lutte antituberculeux dans chaque département. Le maillage est bien entendu plus serré dans les départements de forte incidence, comme la Seine-Saint-Denis ou Paris. C’est grâce à l’action incessante de ces services de lutte contre la tuberculose que la maladie recule.
Concernant enfin votre interrogation sur l’axe 1 du « plan tuberculose », je vous précise que ce plan est terminé depuis 2009. En revanche, les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge se poursuivent, conformément aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique.
Monsieur le sénateur, le ministère de la santé ne considère pas la tuberculose comme une pathologie d’un autre temps ; il adapte sa réponse à la nouvelle situation épidémiologique de cette pathologie, qui apparaît aujourd’hui comme un marqueur social absolument inacceptable.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, même si celle-ci me laisse quelque peu sur ma faim.
Vous dites qu’il serait dangereux d’arrêter la vaccination par le BCG ; je n’en suis pas certain, car, si cela était vrai, les cas de tuberculose en Belgique ou en Allemagne seraient alors bien plus nombreux qu’ils ne le sont chez nous. Or tel n’est pas le cas, bien au contraire.
Il est tout aussi dangereux de faire croire à la population que la vaccination par le BCG assure une protection totale contre la tuberculose.
En tant que médecin, je suis bien placé pour savoir que, sur le terrain, les actions de dépistage et de prévention sont peu nombreuses. En particulier – et vous n’avez pas répondu à ma question sur ce point, madame la secrétaire d'État –, les enseignants ne sont soumis à aucune visite médicale professionnelle, ce qui est illégal. À cet égard, je rappelle que les premiers cas de tuberculose découverts à Clichy-sous-Bois l’ont été parmi des enseignants en collège à qui n’avait jamais été administrée la moindre injection intradermique ou qui n’avaient jamais passé de radiographie pulmonaire.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1441, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les risques de démantèlement que fait peser un récent décret pris par le Gouvernement sur le régime minier de sécurité sociale.
Chacun sait le rôle joué en France, dans certaines régions, plus particulièrement en Lorraine, par les mineurs depuis la révolution industrielle et plus encore après la Seconde Guerre mondiale.
La dureté de leur métier et l’importance de leur activité pour l’économie du pays ont justifié la création, en novembre 1946, d’un statut des mineurs et la mise en place d’un régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
La spécificité du régime de sécurité sociale, défini par le décret du 27 novembre 1946, tient à deux éléments : d’une part, la gestion d’un réseau de soins médicaux de proximité et de qualité dispensés par des médecins et des praticiens salariés du régime ; d’autre part, une fonction assurantielle garantissant aux affiliés l’accès à la gratuité réelle.
Ce régime, depuis qu’il existe, a toujours été accepté, soutenu et conforté comme signe de reconnaissance de la Nation à l’égard des mineurs.
Or, sans la moindre concertation avec les organisations professionnelles ni le moindre débat au Parlement, a été pris le décret du 30 août 2011, qui menace l’existence de ce régime. En effet, entre autres mesures, il est prévu, pour la fin de l’année 2013, le transfert du régime de sécurité sociale des mineurs vers le régime général.
Aujourd’hui, en Lorraine, de 60 000 à 70 000 personnes, dont la moyenne d’âge est de plus de soixante-dix ans, bénéficient de ce régime – elles sont, paraît-il, 176 000 pour la France entière – et plus de 1 800 personnes en sont salariées.
Cette remise en cause est non seulement une atteinte forte à une corporation qui mérite notre respect, mais également une nouvelle atteinte à l’emploi. Elle ne serait par ailleurs pas sans poser de véritables problèmes de santé publique.
J’ai bien noté que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a permis d’inscrire des sommes qui avaient été supprimées par le décret du 31 décembre 2009, qui mettait lui-même un terme aux dispositions visées au b) du 2° de l’article 2 du décret du 24 décembre 1992 relatif à la prise en charge de certains frais d’ambulance, de transport et d’hébergement en cure thermale ainsi que de produits pharmaceutiques.
Ce retour sur un décret néfaste est une bonne chose, mais cela n’engage guère au-delà de 2012. De surcroît, cela ne répond en rien aux conséquences dramatiques du décret du 30 août 2011.
C’est pourquoi, madame la secrétaire d'État, avec les parlementaires de ces régions minières, qui se sont tous exprimés sur ce sujet, et avec les organisations syndicales, je vous demande d’abroger ce décret, qui pénalise des personnes dont le revenu moyen est inférieur de près de 30 % à celui des salariés retraités du régime général et qui ont largement participé au développement économique de notre pays.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Xavier Bertrand, qui ne peut être présent ce matin au Sénat.
Le Gouvernement a entrepris une réforme ambitieuse du régime de sécurité sociale minier afin de garantir la pérennité de son offre de soins et de conforter les droits des affiliés et des salariés du régime.
Xavier Bertrand a transmis un courrier, en date du 30 juin dernier, aux fédérations minières ainsi qu’aux parlementaires du bassin minier afin de les informer de l’augmentation des crédits d’action sociale – 2, 5 millions d’euros en 2011 et 3, 5 millions d’euros en 2012 – en vue de compenser les effets de la suppression du b) du 2° de l’article 2 du décret de décembre 1992, afin qu’aucun affilié au régime minier n’ait à renoncer aux soins.
Le décret du 31 août dernier relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines est entré en vigueur le 1er septembre 2011.
Afin d’assurer la pérennité de l’offre de soins du régime ainsi que la préservation de son réseau de proximité, le Gouvernement a décidé d’adosser le régime à un partenaire capable de financer les investissements nécessaires à sa modernisation, à savoir le régime général d’assurance maladie, au travers des unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, les UGECAM.
En vue de conforter le financement du risque maladie, celui-ci fera l’objet d’une intégration financière au sein du régime général d’assurance maladie. Cette intégration, monsieur le sénateur, s’effectuera sans remise en cause des garanties spécifiques offertes par le régime minier.
Le Gouvernement proposera que le remboursement à 100 % des dépenses de soins, prévu depuis 1946 et justifié par la situation et les besoins spécifiques des mineurs, fasse l’objet d’une inscription législative.
À ce titre, je vous rappelle que le régime minier est le seul régime spécial à ne pas appliquer les dispositifs de participation forfaitaire et de franchises médicales, respectivement instaurés par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Par ailleurs, l’action sanitaire et sociale sera transférée à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l’ANGDM, très proche des mineurs et de leurs familles.
Conformément aux engagements pris par le Président de la République, et afin de remédier aux injustices créées par le dispositif mis en place en 2001, les pensions de retraite minières seront revalorisées à compter de la fin de 2011. Une première revalorisation de 3 % des pensions liquidées avant 1987 a été mise en œuvre dès le 1er novembre 2011. Cet effort sera progressivement porté à 5 % d’ici à 2015.
Enfin, monsieur le sénateur, Xavier Bertrand tient à réaffirmer que la garantie d’emploi sera assurée à tous les salariés des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, les CARMI, et qu’ils bénéficieront de la liberté dans le choix de leur convention collective avant le transfert des activités entre la convention minière et la convention de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, l’UCANSS. Aucune mobilité géographique ne leur sera imposée.

Madame la secrétaire d'État, si je vous comprends bien, au fond, rien n’a changé et tout va bien !
Assez étrangement, les mineurs, les affiliés aux assurances des mines, ne sont pas rassurés par les propos de Xavier Bertrand et continuent de penser que le plus simple serait de ne pas mettre en œuvre ce fameux décret et donc, tout simplement, de conserver ce régime minier.
Tout le monde sait que, en raison du très faible nombre d’actifs et du grand nombre d’ayants droit, ce régime est naturellement déficitaire. Actuellement, son déficit est couvert par le régime général.

Quel intérêt sa suppression présenterait-elle ? L’équilibre financier du régime sera de toute façon assuré par la solidarité nationale.
Le sentiment prévaut vraiment qu’on s’est attaqué à ce régime de manière un peu mesquine, à la suite de la publication du rapport de M. Yves Bur. Je transmettrai néanmoins les informations que vous m’avez communiquées.
Je note avec satisfaction que le tollé suscité par le décret du 31 décembre 2009 a conduit le Gouvernement à rétablir les moyens nécessaires, à travers le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour le financement d’un certain nombre de frais, notamment les frais de transport en ambulance.
Nous ne doutons pas que notre mobilisation vous amènera, en fin de compte, à abroger le décret de 2011, solution de loin la plus raisonnable.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1379, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Madame la secrétaire d'État, en juillet dernier, la Cour des comptes a rendu public un rapport intitulé Du RMI au RSA : la difficile organisation de l’insertion. Constats et bonnes pratiques, relatant une étude menée par dix-sept chambres régionales des comptes dans vingt-quatre départements sur le revenu minimum d’insertion et sur le revenu de solidarité active.
Dans ce rapport, la Cour pointe les lacunes du retour à l’emploi avec un bilan qui reste souvent mitigé. Il faut dire que le contexte économique n’est pas très favorable, en France comme dans le reste du monde.
La Cour souligne en effet que, s’agissant de l’accompagnement vers l’emploi, la décentralisation de la gestion du revenu minimum d’insertion et le passage au revenu de solidarité active n’ont pas permis des progrès significatifs à la hauteur des espoirs suscités, bien que, grâce à ce revenu complémentaire, des foyers modestes aient pu traverser moins difficilement la crise.
Ce dispositif novateur et exceptionnel proposé par Martin Hirsch et salué lors de sa création par tous, au-delà des sensibilités politiques, s’inscrivait dans une véritable politique du retour à l’emploi. Le RSA est versé à 1, 82 million d’allocataires et son coût était évalué, en 2010, à 8 milliards d’euros.
Aussi, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais connaître vos intentions pour renforcer et compléter le dispositif actuel afin qu’il atteigne son objectif initial, qui concerne les plus démunis.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu interroger Roselyne Bachelot-Narquin sur les conclusions du rapport relatif à l’insertion des bénéficiaires du RMI, et maintenant du RSA, rendu par la Cour des comptes en juillet 2011.
Si, comme l’a indiqué Roselyne Bachelot-Narquin dans sa réponse à la Cour, nous partageons un certain nombre des constats relatifs aux limites de la politique d’insertion, je rappelle néanmoins que le RSA, comme le RMI, est une prestation décentralisée, placée sous la responsabilité des présidents de conseil général.
Je tiens à vous indiquer que la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a apporté des évolutions notables par rapport au RMI sur le champ de l’accompagnement et de l’insertion.
Dorénavant, un accompagnement est proposé dès l’entrée dans le dispositif RSA. Les conseils généraux orientent les bénéficiaires vers un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, et Pôle emploi est désormais positionné comme le principal acteur chargé d’assurer l’accompagnement professionnel des bénéficiaires.
De nouvelles relations entre Pôle emploi et les conseils généraux se sont développées depuis 2009. Pour les optimiser et pour renforcer leur efficacité, Marc-Philippe Daubresse, en juillet 2010, a décidé la mise en œuvre de mesures rapides. Dans chaque site de Pôle emploi, un référent a été désigné afin d’assurer les liaisons opérationnelles avec le conseil général. Puis nous avons lancé une expérimentation pour mieux articuler les actions d’insertion sociale et professionnelle dans huit départements.
Roselyne Bachelot-Narquin a, en lien avec l’Assemblée des départements de France, procédé à l’amélioration du partage d’informations entre les acteurs du dispositif pour faciliter l’accompagnement des bénéficiaires. Un comité de pilotage des échanges d’informations entre les différents opérateurs a été créé et un décret mettant en œuvre de nouveaux transferts automatisés de flux de données va être publié en décembre.
Bien sûr – vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur –, il reste des progrès à accomplir sur la question de l’accompagnement des bénéficiaires par Pôle emploi ou d’autres acteurs.
Ces points seront abordés lors de la conférence nationale d’évaluation du RSA, qui se tiendra le 15 décembre. Nous souhaitons aboutir à des propositions concrètes pour améliorer le dispositif à partir des observations conduites par le comité national d’évaluation.
Sur la question de la politique d’insertion, une nouvelle gouvernance territoriale a été mise en œuvre avec les pactes territoriaux pour l’insertion dont la responsabilité est confiée aux conseils généraux. Une soixantaine de pactes ont été élaborés ou sont en cours de finalisation afin de mettre en place une politique d’insertion territorialisée, pilotée, évaluée et répondant aux besoins des bénéficiaires.
S’il faut améliorer le contenu, l’évaluation et les complémentarités de ces pactes, sachez que l’État sera présent aux côtés des conseils généraux pour le faire. Une nouvelle gouvernance territoriale doit voir le jour pour renforcer l’insertion et améliorer le dispositif des droits et devoirs.
L’objectif central du dispositif est l’insertion : Marc Philippe Daubresse a proposé dans son rapport remis au Président de la République vingt-deux mesures pour renforcer l’insertion et les droits et obligations des bénéficiaires.
Roselyne Bachelot-Narquin vient de retenir l’une d’elle, le CUI – contrat unique d’insertion – de sept heures par semaine, et lancer l’expérimentation de 10 000 CUI pour des bénéficiaires éloignés de l’emploi. Une quinzaine de conseils généraux volontaires pourront les proposer à des bénéficiaires éloignés de l’emploi relevant d’une orientation sociale ou socioprofessionnelle.
Ils viendront s’ajouter aux 110 000 CUI de plus de vingt heures réservés aux bénéficiaires du RSA susceptibles de reprendre un emploi et accompagnés généralement par Pôle emploi.

Madame la secrétaire d’État, il est vrai que le contexte économique actuel est très difficile. Il est apparu au moment de la mise en place de ces mesures. La réponse qui a été donnée par le Gouvernement à la Cour des comptes me paraît forte. Comme vous l’avez indiqué, il importe de poursuivre et de renforcer ce partenariat qui existe entre les collectivités et l’État au niveau de Pôle emploi.

La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond, auteur de la question n° 1432, adressée à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

Monsieur le président, madame et monsieur les secrétaires d'État, mes chers collègues, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation qui semble condamner à terme l’existence des institutions accueillant des enfants handicapés, au profit d’un accueil dans les familles ou dans des services de proximité aux contours encore mal définis.
Cette recommandation préconise que soit découragée la construction de nouveaux établissements en s’abstenant de les autoriser ou de les financer. Il est même déclaré de façon très militante que « le passage des services en Institution aux services de proximité devrait être géré en anticipant les résistances au changement, en combattant les préjugés ».
S’il est effectivement préférable, autant que possible, que les enfants handicapés soient élevés dans leur famille et scolarisés dans l’école de leur quartier, il ne peut être nié, me semble-t-il, que dans de nombreux cas l’accueil en institution, qui reste la plupart du temps en relation étroite avec la famille, s’avère la seule solution possible.
Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale opine.

Cette recommandation du Conseil de l’Europe m’apparaît donc trop brutale. Elle ne prend pas en compte le fait que l’intérêt de l’enfant est parfois mieux sauvegardé dans une institution que dans une famille qui ne dispose pas, à certains moments ou dans certaines circonstances, de la possibilité d’assurer à son enfant handicapé, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 365 jours par an, les moyens de son éducation, les soins particuliers qu’il réclame et les conditions de son épanouissement.
J’aimerais, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez nous rassurer sur l’avenir de ces institutions en France, qui sont au demeurant animées et gérées par des personnels de grande qualité, au dévouement exemplaire et auxquels je tiens à rendre hommage. §
Monsieur le sénateur, je vous remercie de l’attention que vous portez à la politique du handicap, priorité du Président de la République et du Gouvernement, rappelée lors de la Conférence nationale du handicap le 8 juin dernier.
Vous appelez notre attention sur la recommandation adoptée le 3 février 2010 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés.
De votre point de vue, monsieur le sénateur, cette recommandation ne prendrait pas suffisamment en compte l’intérêt de l’enfant, qui exigerait, dans certaines situations, un accueil en structure adaptée.
Cette recommandation s’inscrit dans le cadre de principes fondamentaux, juridiquement consacrés, au rang desquels figure le droit de tous les enfants à la vie de famille, à l’éducation, à la formation, à la santé et à la protection sociale. Elle ne s’affranchit pas du principe selon lequel, dans les décisions qui concernent l’enfant, son intérêt supérieur prime sur toute autre considération.
C’est pourquoi le Conseil rappelait la nécessité, pour l’État, d’organiser l’accompagnement de l’enfant en dehors de sa famille par des structures de petite dimension lorsque cette solution lui est la plus favorable.
Par ailleurs, cette recommandation prend tout son sens au regard des élargissements intervenus dans l’Union européenne au cours des vingt dernières années. En effet, dans certains pays, le handicap a pu être traité sur un mode asilaire qui impose aujourd’hui une reconversion des établissements.
Dans le respect de la loi du 11 février 2005 et en réponse aux attentes des enfants handicapés et de leurs familles, la politique du Gouvernement en matière d’accompagnement médico-social des personnes handicapées met d’abord, et avant tout, l’accent sur l’adaptation et l’individualisation de l’accompagnement. Dans ce cadre, l’essentiel est que le lieu de vie retenu soit adapté à la personne et corresponde à son libre choix ou, dans le cas des enfants, à son intérêt supérieur.
Le plan pluriannuel de création de places entre 2008 et 2012, qui témoigne de la forte volonté du Gouvernement de prévoir un accompagnement suffisant et soutenu, prévoit la création, à l’horizon de 2015, de 12 000 places supplémentaires pour les enfants et adolescents, dont 1 000 places en services d’éducation spécialisée et de soins à domicile, ou SESSAD, auxquelles s’ajoutent des places en services issus de la transformation d’établissements.
Je souligne l’effet positif de la loi du 11 février 2005 sur le rôle des établissements et services médico-sociaux. Un accompagnement de qualité se reconnaît en effet aujourd’hui, de plus en plus, à la capacité de la structure à être ouverte sur l’extérieur notamment du fait de la scolarisation des enfants.
Je ne doute pas que la mission que Roselyne Bachelot-Narquin et moi-même avons confiée à Jean-Yves Hocquet sur le rôle et la place des établissements et services médico-sociaux depuis les lois de 2002 et 2005 permettra de faire avancer la réflexion.
Monsieur le sénateur, vous avez raison, c’est sur cette piste de la complémentarité des réponses qu’il faut évidemment avancer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu préciser l’interprétation que donne de la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le gouvernement français, et d’avoir rappelé que ce dernier devra encore créer un nombre très important d’établissements destinés à accueillir des enfants handicapés.
Il est vrai que les situations en Europe sont très différentes d’un pays à l’autre. Cela explique vraisemblablement le contenu de cette recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui s’applique peut-être plus à certains de nos partenaires qu’à notre propre pays.
Je vous remercie d’avoir rassuré toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la permanence, à la pérennité et à l’expansion d’une telle formule d’accueil des enfants handicapés.

La parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la question n° 1436, adressée à M. le ministre de la défense et des anciens combattants.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question porte sur le projet de restructuration des activités de défense entre Safran et Thales.
Cette étude commandée par le Gouvernement, principal actionnaire, a été annoncée par voie de presse sans que les salariés soient préalablement informés. Le comité central de l’entreprise a d’ailleurs voté un délit d’entrave.
Les informations les plus récentes distillées à travers la presse ne font qu’attiser, monsieur le secrétaire d’État, l’incertitude des salariés sur l’avenir industriel des deux groupes et le doute sur le postulat d’un tel projet.
J’attire votre attention sur les conséquences d’un tel déficit de communication auprès des salariés. Les représentants des personnels témoignent du climat délétère dans les entreprises. Les risques psychosociaux liés à une forte inquiétude de leur devenir sont aujourd’hui réels, et, bien sûr, l’activité des entreprises s’en ressent.
Il me semble donc urgent de rétablir le dialogue social.
Sur le fond, l’intersyndicale de Sagem Défense Sécurité de Montluçon dénonce un projet qui pourrait s’avérer dramatique pour l’emploi et l’avenir industriel du territoire. La séparation des activités de navigation inertielle et d’optronique diviserait les 1 250 salariés de l’entreprise, cassant les collectifs de travail, amplifiant les risques liés à la diminution du nombre d’activités et appauvrissant la qualité des produits qui bénéficient aujourd’hui d’une expertise croisée. Cette séparation compliquerait le développement de produits élaborés en synergie et fragiliserait l’équilibre financier de l’entreprise. De plus, que deviendraient les 150 personnes travaillant dans les autres secteurs de l’usine, les 180 salariés des ateliers mécaniques et les 300 personnes employées aux services généraux ?
Ces questions, légitimes, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d’État, se posent, au-delà de l’entreprise montluçonnaise, à l’ensemble des entreprises des deux groupes.
L’évocation de joint ventures, structures éventuellement dépourvues de personnalité juridique et souvent définies comme limitées dans le temps, ne contribue pas, vous l’admettrez, à rassurer sur l’avenir des secteurs d’activité concernés.
À l’opposé, l’intersyndicale propose d’autres formes de coopération, estimant par exemple qu’une approche commune entre EADS, Dassault, Safran et Thales pourrait parfaitement commencer à s’appliquer dans le secteur des drones.
Ce projet aux implications humaines, sociales et industrielles si lourdes ne peut se construire hâtivement et sans concertation.
Avec les salariés, je vous demande un moratoire sur les travaux actuels de restructuration avant toute décision engageante, afin de laisser le temps au mûrissement d’un véritable projet industriel porteur de développements futurs et qui préserve les intérêts des salariés. Dans un premier temps, une étude détaillée mettant en avant les domaines de compétence et les potentialités de tous les sites doit être conduite et portée à connaissance.
Je vous demande également l’organisation de tables rondes au niveau national et sur les principaux sites de production, réunissant, sous votre autorité, l’ensemble des industriels de l’aéronautique et de la défense, les organisations syndicales et les élus.
Si l’industrie aéronautique et de défense française occupe une place de premier plan dans le paysage économique national, si elle est mondialement reconnue pour ses innovations technologiques, c’est avant tout grâce aux compétences et au savoir-faire de ses salariés. Je suis convaincue que ces mêmes salariés sont indispensables aujourd’hui à l’élaboration de projets plus efficaces industriellement et plus responsables socialement.
Madame la sénatrice, soucieux de préserver la pérennité des activités nationales dans les domaines de l’optronique et de la navigation inertielle, l’État, à la fois actionnaire et client de Thales et de Safran, a demandé aux présidents de ces deux sociétés de réfléchir à un rapprochement éventuel de leurs activités dans ces deux domaines.
L’objectif stratégique est de contribuer à la rationalisation de la base industrielle et technologique de défense par la création de deux pôles d’excellence nationaux positionnés au meilleur niveau mondial dans ces domaines de très haute valeur ajoutée.
Le regroupement des activités d’équipements d’optroniques de Safran avec celles de Thales présente une vraie logique sur le plan industriel et commercial, avec notamment la création du numéro 2 mondial – viseurs et combat terrestre.
Le regroupement des activités de Thales et de Safran dans la navigation inertielle permettrait de créer un leader européen, alternative crédible aux deux grands acteurs américains du secteur que sont Honeywell et Northrop Grumman.
Il appartient toutefois aux entreprises de déterminer le meilleur mode de coopération permettant de satisfaire cet objectif. Les discussions entre industriels se poursuivent et la forme précise que pourraient prendre ces projets de rapprochement est toujours discutée au fond.
S’agissant plus précisément de Montluçon, je connais, madame la sénatrice, les spécificités propres à l’entreprise Sagem, qui doivent être considérées. Je salue à cet égard l’action du maire de Montluçon, Daniel Dugléry, et du sénateur Gérard Dériot. Je sais aussi que le site de Montluçon est un centre d’excellence pour nos armées, notamment du fait de sa très grande compétence dans la conception et la production de centrales de navigation inertielle de précision pour nos équipements les plus critiques. Je connais, enfin, le volume des investissements réalisés localement par Safran. Au total, les compétences accumulées à Montluçon doivent être précieusement préservées, et il est raisonnable de penser que ce site peut envisager l’avenir avec sérénité.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Vous dites que l’on peut envisager l’avenir avec sérénité. Toutefois, les salariés des entreprises concernées, sur l’ensemble des sites du territoire national, souhaiteraient être informés autrement que par voie de presse.
J’ai sollicité une entrevue avec Gérard Longuet, une initiative qu’ont prise également les présidents des conseils régional et général, le député de la circonscription ainsi que les maires des communes concernées. M. le ministre ne m’a toujours pas reçue à ce jour, et j’en suis désolée.
Sans doute viendra-t-il à Montluçon : nous serons heureux de le recevoir, mais j’aurais souhaité connaître plus précisément la date de sa visite.
Il est urgent que les salariés soient informés et qu’ils puissent faire valoir leurs propositions. Ils ne sont pas opposés à un rapprochement entre Thales et Safran, mais sous des formes qui garantissent l’emploi sur l’ensemble des sites.
Pour préserver le climat social dans ces entreprises, il serait utile de répondre à leurs demandes, d’autant qu’ils ont déjà été reçus à l’Élysée, ont été entendus par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, et sont allés à l’Assemblée nationale.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteur de la question n° 1437, adressée à M. le ministre de la défense et des anciens combattants.

Je souhaite par cette question attirer l’attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la restructuration des activités de défense entre Safran et Thales, un sujet qui vient d’être évoqué par Mme Schurch.
Ce rapprochement dans le domaine de l’optronique et de la navigation inertielle met en effet en péril l’emploi, soit par mobilité, soit par licenciements, soit par fermeture partielle ou totale d’établissements, avec des conséquences très graves sur les économies locales.
Dans le département de l’Essonne, c’est la société Sagem, implantée sur le territoire de Sénart, et plus précisément dans la ville de Saint-Pierre-du-Perray, qui est directement visée, provoquant l’inquiétude légitime des salariés de l’entreprise ainsi que celle des élus.
Mais l’ensemble de notre pays est concerné, des sites étant également menacés à Poitiers, Dijon, Valence, Argenteuil et Éragny.
L’État, actionnaire des deux sociétés Thales et Safran, à hauteur de 30 %, pèse sur les décisions et ne peut invoquer une pression des marchés pour imposer ce démantèlement.
Si les arguments relatifs à une structuration de la chaîne des fournisseurs sont compréhensibles, ils ne semblent pas constituer les principales justifications conduisant à une restructuration.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais savoir quel est le périmètre du regroupement organisé par le Gouvernement.
Les choix qui sont faits auront un fort impact en termes d’emploi et de compétitivité de notre industrie. C’est pourquoi j’aimerais connaître la stratégie industrielle du Gouvernement en la matière.
Au regard des conséquences sociales que ces mesures pourraient avoir, une plus grande transparence sur leur logique industrielle et sociale est absolument indispensable.
J’attends avec impatience une réponse, en espérant qu’elle sera plus complète que celle que vous venez de faire à ma collègue, monsieur le secrétaire d’État.
Madame Claire-Lise Campion, comme je l’indiquais à Mme Mireille Schurch dans ma précédente réponse, l’État étant à la fois actionnaire et client de Thales et de Safran, il a demandé aux présidents de ces deux sociétés de réfléchir à un rapprochement éventuel de leurs activités dans les domaines de l’optronique et de la navigation inertielle. En effet, il est nécessaire de préserver la pérennité des activités nationales dans ces deux domaines.
L’objectif industriel recherché est double : d’une part, un rapprochement de ces activités permet d’atteindre une masse critique et de dégager des marges de manœuvre financières permettant de continuer à investir significativement sur ces technologies de pointe, et de conserver ainsi un tout premier rang mondial ; d’autre part, un rapprochement permet de dégager des synergies commerciales entre les deux entreprises, notamment sur les marchés à l’exportation.
Il appartient aux entreprises de déterminer le meilleur mode de coopération pour atteindre ces objectifs. Les discussions entre industriels se poursuivent et la forme précise que pourraient prendre ces projets de rapprochement est toujours discutée au fond.
Mais sachez que, en toute hypothèse, M. le ministre de la défense et des anciens combattants est extrêmement attentif à l’impact potentiel de ce projet sur l’emploi, en particulier sur l’emploi industriel local.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de nous avoir livré ces éléments partiels de réponse, au nom de M. Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.
Je rappelle que plus de 2 400 salariés de la société Sagem et leurs familles sont directement concernés par ce projet, qui risque également, de manière plus indirecte, de toucher le tissu économique de nombreuses communes, tant dans mon département de l’Essonne que dans le reste de la France.
Il est nécessaire qu’une plus large concertation s’engage, qui réunirait l’ensemble des acteurs – industriels, élus et représentants des salariés –, sur tous les sites concernés, dans mon département comme au plan national.
Je m’associe aux demandes d’entretien qui viennent, de nouveau, d’être formulées dans cette enceinte. Il me semble en effet indispensable que nous soyons entendus par M. le ministre, les précisions que vous venez d’apporter ne nous rassurant que partiellement, monsieur le secrétaire d’État.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 1435, adressée à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Ma question était en effet adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes, mais je me réjouis de pouvoir m’adresser directement à vous, monsieur le secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger.
Mon propos concerne les problèmes rencontrés par les Français retraités résidant à l’étranger, trop souvent contraints de transmettre tous les trois mois à leur caisse française un justificatif d’existence.
Depuis le dépôt de ma question, voilà quelques semaines, le Sénat a adopté l’amendement que j’avais déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, visant à simplifier l’obligation faite aux retraités de justifier périodiquement de leur existence pour toucher leur pension française.
Mais il me semble important de saisir cette occasion pour insister encore sur la nécessité d’une telle simplification, au regard de la probité de l’immense majorité des retraités français à l’étranger, qui, bien souvent, ne touchent qu’une petite pension et ne sont pas ces fraudeurs auxquels le Président de la République a déclaré la guerre.
En réalité, l’alignement sur la fréquence annuelle applicable dans les pays européens est largement suffisant pour prévenir tout risque de fraude, d’autant que l’article 1983 du code civil, s’il reconnaît aux bénéficiaires d’une pension de retraite la nécessité de justifier de leur existence, n’en précise toutefois pas à quelle fréquence.
De surcroît, l’envoi trimestriel occasionne pour les retraités français établis hors de l’Union européenne des contraintes liées à l’envoi de ces justificatifs – je pense notamment aux soucis de transport pour se rendre à la poste locale, alors même qu’on vit dans une région lointaine ou isolée, ou encore aux contraintes financières pour les titulaires de petits revenus, qui doivent s’acquitter aussi fréquemment d’un envoi avec accusé de réception. Les affiliés des caisses de retraite sont en outre tributaires du bon acheminement de leur envoi, sous peine d’une suspension brutale de leur pension qui les précipite du jour au lendemain dans la plus grande précarité.
Je ne sais ce qu’il adviendra, lors de la commission mixte paritaire, de cet amendement adopté par le Sénat, mais je voulais, monsieur le secrétaire d’État, attirer votre attention sur la situation particulière de ces retraités, qui est trop souvent méconnue.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame Lepage, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui ne peut malheureusement être présent.
Cette circonstance me donne l’occasion d’intervenir sur un sujet qui me tient à cœur. Car je partage, madame la sénatrice, votre préoccupation visant à simplifier et à faciliter la vie de nos compatriotes à l’étranger, dont je conviens qu’ils puissent effectivement mal comprendre les raisons et les modalités de telle ou telle procédure administrative.
Il est vrai que l’article 1983 du code civil français pose le principe général selon lequel le propriétaire d’une rente viagère doit justifier de son existence pour en demander les arrérages, sans toutefois fixer de périodicité.
Il est tout aussi vrai que, depuis le décret n° 2000–1277 du 26 décembre 2000 portant suppression de la fiche d’état civil, les modalités et la périodicité selon lesquelles les retraités apportent la preuve de leur existence échappent à tout cadre juridique et reviennent donc à l’appréciation des caisses.
Or de grandes disparités caractérisent la pratique suivie par les caisses selon les pays de résidence des pensionnés.
Cependant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse ainsi qu’un certain nombre d’autres caisses ont mis au point, depuis 2001, un formulaire plurilingue destiné à être renseigné par les autorités locales. Il semble que, joint à un réseau bancaire fiable, permettant de réduire la périodicité des contrôles, ce dispositif donne satisfaction, en Europe tout au moins.
Je suis conscient de la difficulté que représente le fait de faire remplir un tel formulaire par des autorités étrangères hors d’Europe, avec une fréquence que les caisses ont fixé trimestriellement ou semestriellement, non par excès de formalisme, mais en fonction des risques de fraude constatés dans certains pays.
C’est pourquoi une réflexion est actuellement menée avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse et le groupement AGIRC-ARRCO sur l’harmonisation et l’assouplissement des contrôles en faveur des Français de l’étranger.
Plus globalement, d’autres travaux destinés à répondre à cette demande récurrente de nos compatriotes établis à l’étranger et de leurs représentants seront effectués dans le cadre d’une concertation plus large entre le ministère des affaires étrangères et européennes, en particulier la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, et le ministère des solidarités et de la cohésion sociale, en association avec les caisses des régimes général et complémentaires.
L’un des axes de cette réflexion vise à étendre le dispositif en vigueur en Europe à tous les pays industrialisés, où résident la grande majorité des retraités de nationalité française, et à examiner les aménagements possibles pour nos compatriotes résidant dans les autres pays.
S’il est prématuré, à ce stade, d’indiquer des amorces de solutions ou d’annoncer des mesures concrètes, j’espère pouvoir le faire lors du prochain bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger, les 16 et 17 décembre prochains.
Je veux vous assurer, une nouvelle fois, madame la sénatrice, mesdames, messieurs les sénateurs, de ma détermination à faire aboutir cette question qui touche au plus près la vie quotidienne de nos compatriotes résidant à l’étranger, en particulier de ceux qui ont fait le choix de vivre hors de France à l’issue de leur vie professionnelle.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
J’insiste simplement sur le fait que les Français de l’étranger ne sont ni plus ni moins fraudeurs que leurs compatriotes de métropole.
Nous attendrons donc à la fois le résultat de la commission mixte paritaire et les propositions que vous formulerez lors du prochain bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Toutefois, si ces mesures n’étaient pas satisfaisantes, je ne manquerais pas de me manifester de nouveau.

La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 1433, adressée à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question s’adresse à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, et porte sur la question complexe des conditions juridiques du transfert de la quote-part de la taxe d’habitation des départements vers les communes et intercommunalités, au regard des taux d’abattement.
Un certain nombre de communes et EPCI avaient délibéré conformément au droit tel qu’il résultait de la loi de finances pour 2010, votant sur un taux conforme aux taux antérieurement pratiqués par les conseils généraux, y compris en matière d’abattements, ce dans un souci de lisibilité, tant pour l’administré que pour les communautés.
Les délibérations prises à cet effet avaient été adoptées légalement et tiraient donc les conséquences du nouvel état du droit.
Le 14 octobre 2010, l’annonce par un membre du Gouvernement d’une évolution du dispositif, traduite par un amendement inséré dans le projet de loi de finances pour 2011, avait changé la donne.
En effet, la nouvelle règle avec la neutralisation a des effets pervers qui réduisent à néant l’esprit de la loi.
Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, ce point avait été très discuté l’an passé dans cet hémicycle à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, sur l’initiative de Philippe Marini, alors rapporteur général de la commission des finances.
Il proposait ainsi de maintenir le droit existant pour les collectivités territoriales qui avaient délibéré sur les abattements de taxe d’habitation avant le 14 octobre 2010, date de l’annonce de l’introduction du mécanisme en cause, c’est-à-dire de les exonérer de l’application du mécanisme de neutralisation du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation en vue d’adopter leur propre politique d’abattements.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés à l’article 1411 du code général des impôts et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée, le produit de taxe d’habitation est égal aux bases nettes 2010 de taxe d’habitation multipliées par le taux de référence défini au V de l’article 1640 C du même code. »
M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, avait répondu que le Gouvernement n’était pas favorable à une telle exonération pour un ensemble de raisons qui avaient été longuement discutées et qui ne sont pas apparues comme parfaitement claires.
Un délai avait certes été laissé aux communes et aux EPCI pour voter des délibérations tenant compte du correctif, délai porté au 1er décembre 2010. Mais certaines collectivités n’ont pas souhaité revenir sur leurs délibérations.
Dans ces conditions, le Gouvernement pourrait-il me fournir des éléments de réponse actualisés à ce sujet à destination des communes et des EPCI de mon département qui sont dans cette situation et continuent de réclamer l’exonération de l’application du dispositif de correction ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Valérie Pécresse ce matin, qui est, comme vous le savez, retenue par une réunion de mobilisation des préfets sur la situation économique. Je l’ai quittée pour venir vous répondre et je la rejoindrai ensuite.
Vous avez appelé son attention sur les conséquences du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation vers le bloc communal.
Sachez tout d’abord que, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, le bloc communal a bénéficié du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation via un mécanisme de correction des taux d’imposition.
Corrélativement, les abattements décidés jusqu’en 2010 par les départements n’ont plus trouvé à s’appliquer et ont été remplacés par les abattements décidés par la commune ou par l’intercommunalité.
Afin de garantir la neutralité de ce transfert, le Gouvernement a introduit dans le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de taxe d’habitation un mécanisme d’ajustement.
Corrélativement, les communes et les intercommunalités qui avaient délibéré pour fixer le taux des abattements applicables sur leur territoire en tirant les conséquences de la réforme ont disposé d’un délai exceptionnel jusqu’au 1er décembre 2010, pour revenir si elles le souhaitaient sur leur délibération.
Sachez, ensuite, que la mise en œuvre du mécanisme correcteur assure la neutralité du transfert de la part départementale de taxe d’habitation vers le bloc communal dans l’immense majorité des situations.
Mais il n’a pas vocation à neutraliser les effets engendrés par les délibérations adoptées en 2010 et non rapportées avant le 1er décembre 2010, qui sont indépendants de la réforme et procèdent de l’exercice de leurs compétences par les collectivités.
Il apparaît toutefois que pour les EPCI qui ne percevaient pas de taxe d’habitation en 2010, ou qui en percevaient sans avoir adopté leur propre politique d’abattements, la variable d’ajustement n’est pas la même sur l’ensemble du territoire intercommunal, dans la mesure où elle est déterminée à partir de données communales.
Lorsque, par la suite, l’EPCI délibère pour adopter sa propre politique d’abattements, les abattements demeurent différents et les redevables de l’EPCI sont traités différemment selon la commune où ils résident.
C’est pour permettre une harmonisation des abattements applicables sur le territoire de ces EPCI que le Gouvernement propose, dans le cadre de l’article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2011, de leur permettre de supprimer la correction des abattements. Il est proposé d’offrir la même possibilité aux autres EPCI et aux autres communes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. C’est une situation, il est vrai, assez complexe. Cette disposition pose un vrai problème dans les départements où les taux d’abattement général à la base étaient élevés et les EPCI héritent d’une situation plutôt difficile en termes de recettes et d’harmonisation avec les abattements des communes qui composent l’EPCI.
Par ailleurs, il apparaît aujourd’hui que le mécanisme de neutralisation engendre, pour les EPCI ayant reconduit les taux d’abattement des départements, des disparités très importantes pouvant aller jusqu’à 50 %.
La proposition formulée par le Gouvernement me paraît tout à fait intéressante car elle peut permettre de clarifier cette situation tout à fait complexe pour les communes rurales.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 1468, adressée à M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette question, à laquelle j’associe ma collègue Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, s’adresse effectivement à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique. Elle concerne la fermeture annoncée pour juin 2013 de l’usine Honeywell de Condé-sur-Noireau.
Cette fermeture serait la plus grosse fermeture d’un site industriel en Basse-Normandie depuis Moulinex en 2001, avec 323 personnes qui se retrouveraient au chômage.
L’annonce a donc fait l’effet d’un choc pour les salariés, les élus et l’ensemble de la population locale dans cette région qui a déjà payé un lourd tribut en matière de désindustrialisation et d’exposition à l’amiante.
Aujourd’hui, la surprise a laissé place à la colère.
Colère d’apprendre cette fermeture alors que, au même moment, Honeywell, qui réalise des bénéfices considérables – plus de 2 milliards d’euros en 2007 –, annonce des résultats prometteurs, notamment une hausse de 45 % de son bénéfice au troisième trimestre et de 14 % du chiffre d’affaires – 9, 3 milliards d’euros –, ainsi que la création d’une nouvelle usine à Ploiesti en Roumanie dont l’activité démarrera à la fin de l’année 2012 et qui serait susceptible de bénéficier de fonds européens.
Je rappelle, au passage, que PSA est le principal donneur d’ordre de l’entreprise, via Valeo, et aura donc à valider les produits fabriqués par la future usine roumaine et par là même cautionnera cette délocalisation.
Colère face aux refus de coopérer de l’entreprise et de ses dirigeants.
Les collectivités locales avaient déjà proposé leur soutien afin notamment de faire baisser les coûts de production à travers la restructuration des bâtiments. Aujourd’hui, elles souhaitent mettre sur pied une autre proposition permettant le maintien du site, à l’instar de ce que la région a déjà mis en œuvre pour le développement du site Faurecia à Flers. Jusqu’à présent, elles se sont heurtées à un refus systématique et ont été contraintes de rompre les dernières discussions face à l’indigence des propositions faites par l’entreprise. Le représentant de l’État a lui aussi – fait rare – condamné publiquement l’attitude de l’entreprise et son « absence de volonté sérieuse d’examen des alternatives » à la fermeture.
Il est aujourd’hui manifeste que cette décision a, en fait, été prise de longue date et s’inscrit dans la stratégie plus globale d’un groupe qui a fait le choix de quitter l’Europe de l’Ouest pour l’Europe de l’Est, qui plus est, peut-être, avec l’aide des fonds européens. C’est inacceptable !
Voilà pourquoi je souhaite savoir ce que le Gouvernement entend désormais faire, d’une part, face au double jeu du groupe Honeywell et, d’autre part, pour que les fonds européens ne servent pas à délocaliser des usines françaises en Roumanie.
Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d’abord d’excuser, pour les mêmes raisons que précédemment, M. Éric Besson, que je rejoindrai dans quelques instants.
Le groupe américain Honeywell a en effet, comme vous l’avez dit, annoncé le 19 octobre son souhait d’arrêter, à l’horizon 2014, ses activités de production de plaquettes de frein sur le site de Condé-sur-Noireau.
Dès cette annonce, le ministre de l’industrie Éric Besson a, vous le savez, condamné cette décision. Il a convoqué les dirigeants du groupe Honeywell, pour leur demander des explications et les inviter à suspendre la mise en œuvre de leur plan.
À l’appui de sa décision, le groupe, qui emploie en France 3 600 salariés sur trente sites différents, a invoqué son souhait de produire et commercialiser prioritairement ses plaquettes de frein dans les marchés est-européens. Les dirigeants de Honeywell ont également souligné l’existence de pertes de 150 millions d’euros sur les activités liées aux matériaux de friction, et des pertes importantes sur le site de Condé-sur-Noireau depuis cinq ans.
L’intervention du ministre de l’industrie a permis d’obtenir la participation d’Honeywell à un groupe de travail réunissant, au niveau local, vous le savez, les salariés et les élus locaux avec pour objectif d’identifier les conditions d’un réinvestissement de Honeywell sur le site.
Les réunions qui se sont tenues la semaine dernière en préfecture n’ont pas donné suffisamment satisfaction aux parties prenantes. Il a donc été décidé d’en appeler au président mondial de Honeywell pour obtenir un réexamen de ses projets par la direction du groupe.
À la demande du député Jean-Yves Cousin, le ministre de l’industrie a également décidé d’organiser prochainement à Paris une table ronde sur la situation du site de Condé-sur-Noireau. Les élus concernés y seront naturellement conviés.
En tout état de cause, le Gouvernement veillera au maintien des 352 emplois industriels. Il mobilisera pour ce faire l’ensemble des outils publics, tant locaux que nationaux, permettant de développer le tissu industriel local, à l’instar de ce qui s’est fait pour Faurecia à Flers. Dans ce schéma, Honeywell sera naturellement invité à participer, soit dans le cadre d’un investissement en direct, soit au titre des actions de revitalisation.
Monsieur le sénateur, Condé-sur-Noireau conservera donc son activité industrielle et ses emplois, avec une mobilisation inédite des pouvoirs publics.

Je prends surtout acte de cette volonté de réunir prochainement un groupe de travail car il faut absolument, me semble-t-il, que le groupe Honeywell comprenne que Condé-sur-Noireau est dans une situation très particulière.
Cette ville a payé un lourd tribut à l’amiante et son activité a toujours été liée à la fabrication de plaquettes de frein. Les salariés de Condé-sur-Noireau craignent aussi, en cas de reconversion – hypothétique –, que le fait, pour certains d’entre eux, d’avoir été exposés à l’amiante ne nuise à leurs possibilités de reclassement.
Il est tout à fait nécessaire que cette réunion, à laquelle je souscris – je souhaitais d’ailleurs la demander, mais le Gouvernement a anticipé mon souhait –, se tienne très rapidement afin que nous puissions, en Basse-Normandie, étudier les conditions dans lesquelles nous pouvons maintenir l’activité et la pérennité d’un site à Condé-sur-Noireau.

La parole est à M. Georges Patient, auteur de la question n° 1431, adressée à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cette période de gel des finances locales, la fiscalité directe locale est régulièrement présentée comme l’unique levier d’action pour restaurer les finances des collectivités territoriales de Guyane. Déjà, dans une déclaration faite à Cayenne le 6 avril 2009, le ministre de l’outre-mer évaluait le manque à gagner pour ces dernières à 14 millions d’euros selon une hypothèse basse, mais il reconnaissait en même temps de nombreuses lacunes dans l’identification des bases.
En effet, si les collectivités territoriales bénéficiaires de ces taxes peuvent, dans un intérêt réciproque, apporter leur concours à la gestion de la fiscalité directe locale – ce qui est le cas en Guyane –, c’est à l’État qu’il incombe d’en établir les bases dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le législateur. Tout récemment, en juillet 2011, la Cour des comptes, dans un rapport sur la situation financière des communes des départements d’outre-mer, vient de le rappeler en indiquant qu’il convient de préciser ce qui relève de la mission régalienne, c'est-à-dire la détermination de l’assiette et la liquidation de l’impôt, et les activités préparatoires et connexes auxquelles les collectivités pourraient participer.
C’est là où le bât blesse.
Il n’y a eu aucune mission cadastrale depuis 1975 en Guyane ; aucune actualisation des bases n’est intervenue outre-mer en 1980, contrairement à la métropole.
Il existe en outre un défaut de prise en compte des procès-verbaux de référence et d’actualisation de la valeur réelle des biens déjà évalués.
Faute de géomètres ou en raison de géomètres en nombre insuffisant, les bases cadastrales sont peu ou mal renseignées. En conséquence, le plan cadastral est obsolète et des zones de plusieurs milliers d’hectares occupées par des particuliers ne sont pas cadastrées.
Enfin, de nombreux abattements et exonérations, pour l’essentiel, ne sont pas compensés par l’État.
Force est de constater que la Guyane bénéficie d’une gestion fiscale « au rabais », avec un retard important préjudiciable aux collectivités locales. Il appartient donc à l’État, par une meilleure gestion des bases cadastrales qui lui incombe, de pratiquer un remaniement de la quasi-totalité des plans de sections cadastrales et de créer dans les meilleurs délais les plans cadastraux de toutes les zones occupées afin de permettre aux collectivités de Guyane de parvenir à une identification exhaustive de leurs bases fiscales de l’État.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Valérie Pécresse, qui ne pouvait être présente ce matin et m’a chargé de vous répondre.
Depuis 2008, l’action de la direction régionale des finances publiques de la Guyane pour améliorer l’établissement des bases de la fiscalité directe locale s’appuie essentiellement sur une démarche partenariale avec les collectivités locales.
L’objectif visé est d’élargir les bases d’imposition des impôts directs locaux, de faire progresser le produit fiscal des collectivités locales et d’améliorer l’identification des biens et des personnes dans un contexte de difficultés spécifiques locales que vous connaissez bien : constructions illégales, incertitudes sur la propriété liées à la lourdeur des successions, à la tradition orale et aux constructions sur sol d’autrui, problèmes d’adressage.
Dans le cadre de ces conventions, les collectivités locales ont mis quatorze agents à disposition, la direction régionale des finances publiques assurant leur formation et le suivi des travaux de recensement des constructions dans les communes signataires de conventions.
La direction régionale des finances publiques a parallèlement poursuivi ses efforts de recensement des constructions et de relance des propriétaires défaillants.
Cette direction a mobilisé ses services pour prendre en compte les déclarations collectées dans les bases de la fiscalité directe locale. C’est ainsi, monsieur le sénateur, qu’ont été prises en compte 11 100 déclarations de propriétés bâties en 2009 et 11 045 en 2010, contre 3 928 en 2008.
Cette démarche se révèle positive puisque les bases de taxes foncières sur les propriétés bâties en Guyane ont globalement progressé significativement depuis trois ans, soit de 7, 5 % entre 2008 et 2009, de 8, 2 % entre 2009 et 2010 et de 7, 5 % entre 2010 et 2011.
Ces évolutions sont particulièrement significatives pour certaines communes signataires de conventions. À titre d’exemple, les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d’Apatou ont progressé de plus de 110 % entre 2008 et 2011. Celles de Maripasoula ont augmenté de plus de 340 % entre 2008 et 2011.
La progression est moins forte dans les communes plus importantes, mais elle reste significative. Ainsi, celles de Saint-Laurent-du-Maroni ont crû de 49, 3 % entre 2008 et 2011.
Ces évolutions auront également des conséquences sur les bases d’imposition de taxe d’habitation. D’ores et déjà, celles-ci ont progressé de 19 % en Guyane entre 2006 et 2009.
Malgré un ralentissement de l’action des agents recenseurs dû à la fin prochaine des conventions, les services de la direction régionale des finances publiques ont ainsi été saisis, au cours des quatre premiers mois de l’année 2011, de près de 3 000 déclarations.
L’action de la direction générale des finances publiques se poursuit en 2011 par le renouvellement ou la signature de nouvelles conventions.
Cette démarche partenariale s’accompagne également d’actions dans le cadre de sa nouvelle offre de services aux collectivités locales, afin d’inciter les maires à réunir régulièrement les commissions communales des impôts directs et de former les commissaires.
Enfin, les services de la direction régionale des finances publiques de Guyane ont engagé en parallèle un programme d’extension des surfaces cadastrées de 1 260 kilomètres carrés sur trois ans.

Vos propos sont loin de me satisfaire, monsieur le ministre, car tout le travail que vous avez évoqué repose sur l’effort consenti par les collectivités locales, y compris dans les domaines relevant de la compétence de l’État.
Si je me permets d’insister sur ce point, c’est parce que la Cour des comptes, dans son récent rapport de juillet 2011 que je vous ai cité, a confirmé les chiffres de la direction régionale des finances publiques, soit un écart de potentiel brut mobilisable de 32 millions d’euros, qui se traduit par une perte de recettes annuelles de l’ordre de 12 millions d’euros pour les communes de Guyane.
Il convient d’ajouter ce manque à gagner fiscal à toutes les dispositions discriminatoires dont sont victimes les communes de Guyane.
Je citerai, pour mémoire, le plafonnement à 27 millions d’euros de l’octroi de mer pour les communes de Guyane, fait unique dans les départements d’outre-mer, de même que celui de la dotation superficiaire. Les subventions exceptionnelles ont en outre été abolies en Guyane, alors que des communes comme Saint-Laurent-du-Maroni ou Roura sont structurellement déficitaires.
Dans ces conditions, vous comprendrez que l’exaspération des collectivités de Guyane soit très forte.
Pour conclure, je tiens tout de même à rappeler que la responsabilité de l’État a déjà été engagée en Guyane en raison de l’absence prolongée d’actualisation des bases cadastrales d’une ville et du dommage qui en est résulté pour les finances locales du fait du manque à gagner fiscal.
Il serait regrettable d’en être réduit à une solution aussi extrême. Vous devez prévoir les moyens nécessaires et affecter des géomètres en Guyane, même si le territoire est immense : ce département a droit à une gestion fiscale, au même titre que les autres départements français.

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 1430, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en juillet dernier, dans cet hémicycle, en terminant mon intervention sur les conséquences de la modification du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, j’évoquais les graves problèmes causés par les opérations de désamiantage.
Alors que le nombre de victimes de l’amiante ne cesse de progresser, force est de constater que les problèmes de l’amiante n’épargnent aucun domaine, en particulier ceux de la santé et de l’environnement.
Il paraît aujourd’hui urgent de penser et d’élaborer des règles très précises s’appliquant aux opérations de désamiantage. Ces opérations, qu’elles soient effectuées par des professionnels ou par des particuliers, sont trop fréquemment réalisées en dehors de toute protection, faute d’une réglementation précise. En outre, de telles opérations révèlent des dysfonctionnements dangereux.
Présente dans tous les bâtiments construits avant 1997, année de son interdiction, l’amiante et ses fibres mortelles représente toujours un danger pour tous ceux qui la côtoient.
En Gironde, de nombreux travaux de désamiantage ont été effectués dans différents établissements scolaires, dans les bureaux de la Cité administrative et dans le cadre des travaux de réaménagement du quartier de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Même si, lors de telles opérations, des contrôles sont effectués, on peut déplorer que les conditions de sécurité ne soient jamais respectées.
Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que les contrôles devraient être renforcés et les observations dressées par l’inspection du travail respectées ? C’est ainsi que devraient être diminuées par dix les valeurs d’exposition à l’amiante, c'est-à-dire la mesure qui permet d’évaluer le nombre de fibres à l’heure que l’on peut respirer lors d’une opération de désamiantage.
Les mesures de formation et l’information des salariés travaillant dans les sociétés spécialisées sont fréquemment insuffisantes. Les professionnels du bâtiment travaillent trop souvent en ignorant ces règles. Devant cet état de fait, nous dénonçons l’arrêté du 23 mai 2011 qui repousse au 1er janvier 2012 les nouvelles règles pour la formation des intervenants qui étaient prévues par l’arrêté du 22 décembre 2009. Même si les contrôles sur le terrain existent, les condamnations demeurent trop rares.
Lors de la récente démolition des ateliers de la SNCF rue Amédée Saint-Germain à Bordeaux, l’association Allo Amiante a fait preuve de vigilance, notamment en matière d’information des riverains et d’application stricte des normes. Son président n’a pas oublié les trop nombreux décès liés à l’amiante présente dans ces ateliers.
Vous le savez, monsieur le ministre, de tels chantiers de désamiantage génèrent des tonnes de déchets qu’il faut éliminer. Avant d’être transportés, ces déchets doivent être stockés. Pouvez-vous nous apporter des garanties relatives aux conditions de stockage, de transport et de vitrification de ces tonnes de déchets ? Ces camions bâchés sur lesquels on peut lire « Unité Mobile de Désamiantage » présentent-ils toutes les garanties de protection et d’étanchéité ? J’en doute.
Ces opérations de désamiantage concernent également les particuliers qui sont amenés à réaliser de tels travaux sans aucune protection, sans aucune information. On sait que toute opération de manutention ou de démolition de matériaux amiantés comporte un danger non seulement pour l’intervenant, mais également pour les voisins. Ne pourrait-on pas envisager une législation claire et pratique destinée au particulier ?
La parution du décret n° 2011–629 qui se substitue en grande partie au code de la santé publique ne va pas dans ce sens. En effet, il repousse le délai de neuf ans qui était précédemment imposé aux propriétaires d’immeubles pour effectuer les opérations de désamiantage. L’association nationale de défense des victimes de l’amiante, l’ANDEVA, a déposé un recours.
Depuis les années 2000, plus de 1 500 personnes sont décédées en Aquitaine des conséquences de l’amiante. Il ne faudrait pas que ce nombre déjà trop important soit encore aggravé par les conséquences de telles opérations de désamiantage.
Comme je le disais déjà en juillet dernier, il est urgent d’agir avant que de nouveaux scandales sanitaires fassent la une de l’actualité !
Monsieur le sénateur, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, m’a chargé de vous répondre concernant les opérations de désamiantage.
Depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la cession à titre gratuit ou payant de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant sont interdites.
Les déchets d’amiante sont codifiés dans la nomenclature des déchets de l’article R. 541–8 du code de l’environnement et sont classés comme dangereux, qu’il s’agisse de déchets d’amiante libre ou de déchets d’amiante lié.
Ces déchets sont créés lors des travaux de rénovation, de démolition ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante tels que les flocages, le calorifugeage, les dalles de sols, le carrelage, les tôles ou les ardoises en amiante-ciment.
Ces travaux de retrait sont réalisés dans le cadre juridique défini par le code du travail concernant les dispositions relatives aux risques d’exposition à l’amiante.
C’est au producteur qu’incombe la responsabilité du choix de la filière d’élimination des déchets d’amiante. Les services de l’État, quant à eux, veillent à ce que ces filières soient décrites dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux dont l’élaboration relève de la compétence des conseils régionaux.
Les entreprises procédant au retrait de matériaux contenant de l’amiante doivent évacuer les déchets conformément aux dispositions du code de l’environnement. Les dispositions prises en la matière sont précisées dans le plan de retrait ou de démolition établi pour le chantier. À cet égard, dans le cadre de la certification obligatoire des entreprises prévue au titre du code du travail – article R. 4412–115 –, les audits de surveillance annuelle menés par les organismes certificateurs permettent de s’assurer du respect de la réglementation en matière de gestion des déchets, qu’il s’agisse de l’identification des filières de traitement de déchets amiantés, du transport et de la traçabilité.
En matière de transport, les déchets d’amiante doivent être transportés dans des conditions permettant de prévenir la libération de fibres d’amiante. Le transport de déchets d’amiante est ainsi soumis aux dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres.
Concernant le conditionnement et l’étiquetage, deux systèmes existent.
Pour les déchets d’amiante libre, ils doivent être conditionnés en double enveloppe étanche et rassemblés dans des contenants de grande capacité sur lesquels doit être apposé un étiquetage spécifique imposé par la réglementation.
Pour les déchets d’amiante lié, ils doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en conteneur. Une étiquette doit être apposée sur les contenants.
S’agissant de la traçabilité, le producteur ou le détenteur de déchets d’amiante est tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante en application de l’article R.541–45 du code de l’environnement.
Enfin en matière d’élimination, les déchets d’amiante libre doivent être éliminés soit par vitrification, soit par stockage en installation de stockage de déchets dangereux.
L’élimination des déchets d’amiante lié est autorisée dans les centres de stockage de déchets dangereux et dans les installations de stockage de déchets non dangereux disposant d’un casier de stockage dédié.
L’amiante lié à des matériaux inertes est un déchet inerte. Ces déchets peuvent être utilisés soit en remblaiement de carrière, soit dans des installations de stockage de déchets inertes disposant d’un casier de stockage dédié.
Toutes ces installations, monsieur le sénateur, sont soumises à autorisation préfectorale et sont très régulièrement contrôlées par les services de l’État.
Je peux vous assurer de la mobilisation de l’ensemble des services de l’État sur le contrôle du respect de cette réglementation.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, de votre volonté personnelle, mais le problème de l’amiante est, hélas ! toujours d’actualité.
Ainsi, comme vous le savez, les récentes perturbations sur la ligne B du RER dues à un retrait des conducteurs de rames n’avaient rien à voir avec le mouvement social de la SNCF. Elles ont été provoquées par les négociations sur les opérations de dépoussiérage sous les rames.
Les travaux de désamiantage nécessaires n’ont toujours pas commencé alors que l’inspection du travail a préconisé des procédures approuvées par les syndicats, mais jugées trop coûteuses par la direction de la RATP.
En outre, un tout récent rapport de la Cour des comptes dénonce le désastre financier que constitue le chantier de désamiantage de l’université parisienne de Jussieu. Lancé par l’État en urgence en 1996, ce chantier, qui devait durer trois ans, ne sera achevé qu’en 2015, pour un montant de près de 2 milliards d’euros ! De nombreux dysfonctionnements ont entraîné une dérive dans les délais et dans les coûts, ce qui signifie que l’État n’a pas assuré son rôle de pilote. Comment éviter à l’avenir de telles défaillances à l’occasion d’opérations si mal préparées ?

La parole est à M. Alain Néri, auteur de la question n° 1438, adressée à M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.

Monsieur le ministre, si le désenclavement autoroutier de l’Auvergne est réalisé, ce n’est pas le cas pour les liaisons ferroviaires. L’Auvergne attend toujours le TGV, même si le dossier avance grâce à l’action des élus de la région. En attendant, les Auvergnats veulent une bonne desserte ferroviaire, en particulier entre Clermont-Ferrand et Paris.
Malheureusement, les usagers constatent journellement la dégradation régulière des conditions dans lesquelles ils voyagent : retards toujours plus nombreux, wagons en fin de vie et mal entretenus, chauffage et climatisation en panne chronique – il faut choisir entre le chauffage et l’électricité pour lire son journal ! –, toilettes inutilisables, arrêts inopinés sans explication...
Le Téoz, monsieur le ministre, n’est en fait qu’une mise à niveau du Corail. Il me fait penser à ce que faisait ma grand-mère, qui fabriquait des chemises neuves pour nous dans les vieilles chemises de mon grand-père. Cela n’a jamais été des solutions d’avenir ! Nous ne pouvons nous contenter de cette précarité. Nous nous sentons même humiliés par cette situation.
La direction de la SNCF a décidé que, à compter du 11 décembre prochain, le Téoz Clermont-Ferrand – Paris arrivera non plus en gare de Lyon, mais en gare de Bercy, contrairement à ce qui nous avait été promis et à l’engagement pris par la SNCF auprès des élus locaux. Le 15 septembre à Paris et le 17 novembre à la préfecture de Clermont-Ferrand, des réunions de concertation ont enfin eu lieu. Espérons qu’elles aboutiront.
Cette décision est grave, car elle entraînera un service à deux vitesses. Les privilégiés prendront le TGV pour aller à Lyon, Genève ou Marseille. Ils partiront de la gare de Lyon, entièrement rénovée – elle sera d’ailleurs inaugurée au moment où les Auvergnats en seront chassés – pour 75 millions d’euros, dotée de multiples commerces, restaurants, hôtels et services, et connectée à tous les moyens de transports. Les autres, les laissés-pour-compte, partiront d’une gare de marchandises déconnectée de tous les réseaux de transport de la capitale, sans services dignes de ce nom à proximité, à bord d’un train aux motrices quinquagénaires, bonnes pour le musée !
Monsieur le ministre, tous les élus de la région Auvergne s’opposent formellement à la desserte de la liaison ferroviaire Clermont-Ferrand – Paris par la gare de Bercy.
À la suite de nos réunions de concertation, une étude a été confiée à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Cette étude, nous a-t-il été dit lors de la réunion de tous les élus de la région le 7 novembre à la préfecture de Clermont-Ferrand, semble laisser présager un retour possible en gare de Lyon à la fin de l’année 2012. Nous en prenons acte, monsieur le ministre. Nous espérons juste qu’il ne s’agit pas là d’une perspective destinée à endormir notre vigilance.
Monsieur le ministre, ma question est simple et claire. Au nom de l’État, qui est l’autorité organisatrice des transports de la ligne Clermont-Ferrand – Paris, allez-vous, d’une part, imposer le retour de l’arrivée de cette ligne à la gare de Lyon à la fin de l’année 2012, comme l’exigent l’ensemble des élus d’Auvergne, et, d’autre part, améliorer enfin la qualité des matériels roulants en mettant à la disposition des voyageurs des trains dignes de ce nom, modernes et rapides, entre la capitale auvergnate et celle de la France ?
Je sais que vous êtes très concerné par la desserte ferroviaire de l’Auvergne, comme d’ailleurs tous les élus de cette région.
La ligne Paris – Clermont-Ferrand est intégrée aux douze lignes sensibles concernées par le plan de renforcement de la qualité de service et fait à ce titre l’objet d’une attention particulière.
Compte tenu de la saturation envisagée en gare de Lyon en 2012, notamment du fait de la mise en service de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône et des réorganisations de circulations prévues dans le cadre du service annuel 2012, la SNCF et RFF ont effectivement prévu l’arrivée de la ligne Paris – Clermont-Ferrand en gare de Bercy à compter du mois de décembre 2011.
Après avoir rencontré Brice Hortefeux, qui m’a alerté sur la situation, j’ai organisé en juin dernier une réunion de mobilisation de l’ensemble des acteurs : le STIF – Syndicat des transports d’Île-de-France –, la SNCF, la RATP et RFF. L’objectif est de disposer de nouvelles structures répondant aux attentes des utilisateurs du Téoz en matière de qualité du service offert en gare de Bercy dès décembre 2011.
Dans ce cadre, mes services ont mandaté trois membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, pour expertiser l’ensemble des sujets liés à l’arrivée en gare de Bercy, à savoir l’optimisation de l’interconnexion entre la gare et la station de métro Bercy et la qualité de service en gare de Bercy, laquelle est, comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, nettement améliorable, et c’est un euphémisme.
À l’échelon régional, et en parallèle de ces réflexions, le préfet de la région Auvergne est convenu avec le conseil régional de coprésider un comité de suivi de l’évolution de l’axe Paris – Clermont-Ferrand. Il a permis à la SNCF et à RFF de présenter localement l’état des lieux de l’infrastructure actuelle et les chantiers d’entretien et de rénovation envisagés, l’ensemble des services de transport ferroviaire sur cet axe, le projet de rénovation du matériel roulant et les aménagements et actions d’optimisation prévus en gare de Bercy.
Lors des comités d’axe du 3 octobre et du 7 novembre 2011, la SNCF et RFF ont pu détailler les améliorations attendues sur la ligne : gain de vitesse sur l’axe après l’achèvement des travaux en gares de Moulins-sur-Allier et de Riom-Châtel-Guyon, études en cours visant à développer la couverture 3G sur le réseau.
Les deux entreprises ont également présenté les travaux d’amélioration en cours de réalisation en gare de Bercy : optimisation des espaces d’attente au rez-de-chaussée et à l’étage, création de deux bornes de libre-service supplémentaires, aménagement d’un espace pour les enfants, installation de deux portes automatiques supplémentaires au rez-de-chaussée.
Des actions destinées à optimiser l’intermodalité ont également été présentées : mise en place d’une signalétique plus adaptée, service de navettes gratuites entre les gares de Lyon et de Bercy, transfert éventuel à Bercy de terminus de lignes de la RATP. En outre, le STIF et la RATP étudient conjointement les modalités de création d’un nouvel accès à la ligne 14 à proximité de la gare de Bercy.
Lors de la réunion de présentation du service annuel 2012 par RFF et la SNCF le 15 septembre dernier, les élus auvergnats ont soulevé de nombreuses questions sur la justification du transfert de la liaison Paris – Clermont-Ferrand en gare de Paris-Bercy. Il a donc été décidé d’étendre la mission initiale confiée aux membres du CGEDD à l’analyse, en lien avec RFF et la SNCF, des capacités disponibles en gare de Lyon, ou susceptibles de l’être à court terme.
S’appuyant sur un audit réalisé par un prestataire externe, dont la neutralité est garantie puisqu’il s’agit de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le CGEDD a rendu ses conclusions, lesquelles ont été présentées lors du dernier comité d’axe par le préfet de région.
Si l’étendue des changements d’horaires induits par le cadencement au titre du service annuel 2012 et par la mise en service de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône rend impossible un retour en gare de Lyon au 11 décembre 2012 de l’ensemble des Téoz, il n’est pas exclu que le retour de ces trains soit techniquement possible à moyen terme. La mission recommande en effet le lancement d’une étude complémentaire sur les conditions du rapatriement de l’ensemble des Téoz à l’occasion du service annuel 2013, le transfert de certains d’entre eux en gare de Lyon étant envisageable au milieu de l’année.
Nous sommes tous conscients, notamment vous-même, monsieur le sénateur, qui avez multiplié les interventions auprès de moi ou de Brice Hortefeux, et d’autres parlementaires, que la gare de Bercy a moins de qualités que celle de Paris-Lyon.
Pour autant, le transfert vers cette gare ne constitue pas des représailles. N’y voyez pas une marque d’ostracisme à l’égard de votre région. Simplement, il y a de plus en plus de trains et les voies sont de plus en plus saturées, en raison notamment de la mise en service de la liaison à grande vitesse Rhin-Rhône.
Nous allons essayer de trouver une solution, mais qui dit plus de trains dit plus d’encombrements dans les gares. Dès lors, il faut trouver des solutions pour l’arrivée de certains trains.

Votre réponse, monsieur le ministre, ne me donne pas satisfaction, car, dans cette affaire, on s’est moqué de nous. Les Auvergnats sont patients, mais ils sont aussi tenaces, surtout lorsqu’ils ont des arguments incontestables.
Lorsqu’on nous disait que nous reviendrions à la gare de Lyon au mois de juin, nous savions pertinemment qu’on nous mentait, car les horaires étaient déjà en préparation pour décembre 2011. On nous a donc menti, et c’est inacceptable.
En outre, nous ne pouvons pas accepter d’être accueillis à Paris au milieu de nulle part – et je pèse mes mots ! –, fut-ce dans une gare dont vous dites qu’elle sera modernisée, monsieur le ministre, car cette modernisation coûtera 2 millions d’euros, contre 75 millions d’euros pour la gare de Lyon !
Et comme aujourd’hui il est encore possible d’arriver en gare de Lyon, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions en être chassés afin que d’autres puissent y être accueillis. En outre, ce procédé a les apparences d’une maladie chronique. En effet, dans le domaine des transports aériens, les avions au départ de Clermont-Ferrand arrivent à Roissy 2G, soit, là aussi, au milieu de nulle part, ce qui pose des difficultés de liaison pour prendre les correspondances.
Monsieur le ministre, je le répète : les Auvergnats sont patients, mais tenaces. Il nous a été dit lors de la réunion à la préfecture que, selon l’étude indépendante de l’École polytechnique de Lausanne, un retour en gare de Lyon était envisageable. Nous vous demandons donc, en tant qu’autorité organisatrice de transports, de faire preuve de toute votre autorité pour imposer cette mesure de justice. Tous les citoyens ont droit à un aménagement du territoire correct et égal.
M. Alain Bertrand applaudit.

La parole est à M. Alain Bertrand, auteur de la question n° 1460, adressée à M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.

Monsieur le ministre, ma question s’inscrit dans le droit fil de l’intervention de mon collègue auvergnat puisque je vais moi aussi évoquer en partie le Massif central. J’ai moi aussi essayé de faire le trajet Clermont-Ferrand – Paris en train, avant d’opter pour l’avion. Il est vrai qu’on est toujours maltraité : on arrive à Orly, on n’a pas le hub, il faut prendre un autobus, etc. Maintenant, je prends l’avion à Montpellier !
Ma question porte sur la RN 88, à savoir l’axe Lyon-Toulouse, décrit également comme étant la route Varsovie-Séville, soit un axe européen.
J’évoquerai des promesses non tenues, monsieur le ministre, non par le gouvernement auquel vous appartenez, mais par un précédent gouvernement.
En 1993, M. Balladur, alors Premier ministre, s’était rendu en Lozère à l’occasion d’un comité interministériel d’aménagement du territoire. Je tiens à la disposition de M. Mariani, qui doit les avoir, les coupures de presse sur sa visite.
Il avait alors déclaré : « La liaison Toulouse-Lyon par la RN 88 constitue un axe interrégional auquel l’État accordera une priorité nationale dans le cadre de la troisième génération des contrats de plan. À ce titre, elle bénéficiera d’un effort financier préférentiel et elle doit être réalisée en 2x2 voies. » M. Bosson, ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, avait quant à lui affirmé que la RN 88 était « capitale pour le désenclavement de la Lozère ».
La RN 88, qui forme un axe Lyon-Toulouse, traverse toute la Lozère. Elle passe par le Puy-en-Velay, Mende, Rodez et Albi. Depuis 1993, très peu de ce qui était annoncé a été fait. Seuls 2, 4 kilomètres ont été réalisés en dix-huit ans, dans le secteur du Romardiès. À ce rythme, il faudra six cents ans pour terminer les 78 kilomètres que représente la traversée de la Lozère !
Dans un document qui émane du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, j’observe pourtant que l’État investit pour développer d’autres liaisons : l’A 35 en Alsace, la RN 122 en Auvergne, la RN 12 et la RN 26 en Basse-Normandie, la RN 7, l’A 38 et l’A 39 en Bourgogne, l’A 81, la RN 24, la RN 136 et la RN 164 en Bretagne, la RN 4, la RN 19, la RN 31, la RN 67, l’A 304 en Champagne-Ardenne ! La France traverse certes une période de crise, mais l’État poursuit ses investissements dans des infrastructures nationales. Pour la Lozère, en revanche, rien ou très peu !
La Lozère, monsieur le ministre, est le département de l’« hyper-ruralité ». Elle subit, comme d’autres, la réduction drastique des emplois publics. La Lozère n’a malheureusement pas d’université, d’aéroport, de « Zénith » ou de théâtre. Elle mérite donc d’être désenclavée.
J’utiliserai deux exemples pour appuyer mon propos. Un aller-retour en train entre Mende – la préfecture – et Montpellier se fait en neuf heures. Un aller-retour à Paris demande entre seize et dix-huit heures, selon les cas. Je tiens à votre disposition, monsieur le ministre, les horaires de la SNCF !
L’orateur brandit un document.

Mende est une préfecture. Je constate, soit dit en passant, que M. Wauquiez a obtenu que des travaux d’infrastructures routières soient réalisés dans le secteur du Puy-en-Velay, préfecture de la Haute-Loire. Pourtant, les artisans et entreprises de Mende ne sont même plus livrés directement par les transporteurs européens ou français, sauf si leurs commandes remplissent un camion entier. Les colis sont livrés à Rodez, au Puy-en-Velay ou à Alès.
La modernisation de la RN 88 s’impose aussi pour des raisons de sécurité. C’est la seule route de France où cohabitent les grumiers, les camions internationaux, les poids lourds de 40 tonnes, les voitures, les motos, les cyclistes, les piétons, les tracteurs, sans compter les troupeaux de moutons et de vaches ! Cela fait beaucoup ! La traversée de Mende ou de Langogne pose également des problèmes de sécurité.
Les travaux de la RN 88 sont aujourd'hui relégués au programme de modernisation des itinéraires routiers, le PDMI, ce qui signifie, en somme, qu’ils ne seront pas réalisés. Or, je le répète, il s’agit d’une promesse !
La Lozère, qui est le plus petit département de France avec quelque 75 000 habitants, offre pourtant beaucoup au reste du pays : elle accueille tous ceux qui le souhaitent sur le plateau de l’Aubrac, en Margeride, dans les gorges du Tarn, les Cévennes ou les Causses. La Lozère est un département généreux, et je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas le droit à la solidarité nationale.
Sommes-nous encore, monsieur le ministre, une partie de la République ? Ou bien sommes-nous abandonnés par les gouvernements qui se succèdent, j’allais dire de gauche comme de droite ?
Une promesse a été faite, monsieur le ministre, il faut la respecter. Qu’attendez-vous pour commencer ces travaux urgents, qui peuvent être échelonnés sur plusieurs années ? Ces travaux revêtiraient en outre une portée symbolique : étant le département le plus faible économiquement et le moins peuplé, la Lozère mérite que la République fasse preuve à son égard de solidarité. En effet, la République, c’est d’abord la solidarité.

Mon cher collègue, votre question était certes la dernière de la matinée, mais vous avez dépassé votre temps de parole de deux minutes trente. Vous voudrez bien à l’avenir veiller à respecter les trois minutes qui sont imparties à chaque auteur d’une question orale.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous confirmer toute l’attention que porte l’État à la modernisation et à la sécurisation de la RN 88, notamment en Lozère. Comme vous le rappelez, cette route joue un rôle important dans le désenclavement et le soutien à l’activité économique des territoires qu’elle traverse. C’est pourquoi, comme vous l’indiquez, la partie orientale de la RN 88 entre l’A 75 et le département de la Loire figure dans la liste des rares axes mentionnés dans le schéma national des infrastructures de transport comme devant être aménagés à terme à 2x2 voies pour répondre à des enjeux de désenclavement.
Très concrètement, la modernisation de la RN 88 en Lozère est aujourd’hui bien engagée et se poursuit activement dans le cadre des programmes de modernisation des itinéraires routiers, qui succèdent au volet routier des contrats de plan État-région.
Dans ce cadre, la priorité porte sur la réalisation de la rocade ouest de Mende. Après l’aménagement du viaduc de Rieucros et le raccordement de la RN 88 à l’A 75 par le franchissement du vallon du Romardiès mis en service en décembre 2009, elle constitue la prochaine étape de modernisation de l’axe et le premier maillon d’un grand contournement de Mende.
Ainsi, l’actuel PDMI de la région Languedoc-Roussillon retient plus de 21 millions d’euros pour cette opération.
Après l’avis positif de l’Autorité environnementale rendu le 11 mai dernier, l’enquête publique s’est déroulée du 22 juin au 22 juillet. Dans son rapport et ses conclusions du 22 août, la commission d’enquête a émis un avis favorable sans réserve à ce projet, ouvrant ainsi la voie à sa déclaration d’utilité publique. Celle-ci devrait d’ailleurs être prononcée par arrêté préfectoral dans les jours qui viennent. Il s’agit d’une étape significative pour l’avancement de cette opération.
Je rappellerai enfin que, parallèlement aux procédures de la déviation ouest de Mende, les études relatives au contournement Est de la commune et aux déviations de Langogne et Pradelles sont aujourd’hui largement engagées. Elles sont menées de manière à permettre la réalisation de ces opérations lors de la prochaine génération de PDMI.
Je reconnais que ces travaux sont engagés depuis un certain nombre d’années, mais je pense que l’on n’attendra tout de même pas six cents ans pour les terminer ! §

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Toutefois, la rocade ouest de Mende n’est pas un élément de la RN 88 en tant que telle. Je suis maire de Mende, je connais le dossier.
Par ailleurs, les collectivités territoriales – la ville, le département et la région – vont largement participer aux travaux sur la rocade ouest de Mende. Nous attendons la réponse de l’État quant à sa participation au financement du projet, selon les modalités que le département, la ville et la région lui proposent conjointement.
Monsieur le ministre, vous connaissez la limite des PDMI. Nous sommes de petites collectivités territoriales. On ne peut pas demander à Mende, qui a un budget de 15 millions d’euros, ou à Langogne, dont le budget est peut-être de l’ordre de 5 millions d’euros, de participer à la même hauteur que les grandes villes, les agglomérations ou les grandes préfectures !
Vous ne répondez que partiellement à ma question. La rocade ouest est une infrastructure urbaine, qui fait partie de la petite agglomération de Mende. Je souhaiterais donc que l’État s’attaque au chantier de la RN 88 elle-même, dans tout son trajet en Lozère, en commençant par Langogne et Mende. Je demande par conséquent à l’État de mettre sur pied un calendrier des travaux, et de tenir sa promesse, même si elle a été faite par un gouvernement précédent.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.