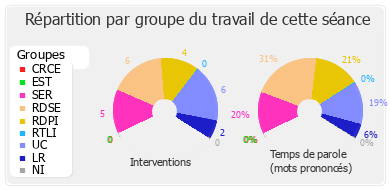Séance en hémicycle du 27 avril 2010 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Communication du conseil constitutionnel
- Retrait d'une question orale
- Questions orales (voir le dossier)
- Accessibilité des transports en commun pour les personnes handicapées et à mobilité réduite (voir le dossier)
- Indemnisation du préjudice causé à une commune par l'utilisation d'une source pour l'alimentation en eau potable d'un groupement (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé M. le président du Sénat que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 23 avril 2010.
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

J’informe le Sénat que la question orale n° 854 de M. Jean Boyer est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

La parole est à Mme Jacqueline Alquier, auteur de la question n° 804, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Monsieur le secrétaire d’État, en 1991, au terme de plusieurs rencontres et débats organisés sur le territoire national, le ministre de l’environnement, M. Brice Lalonde, concluait à la nécessité de fixer dans la loi les règles applicables à la circulation des véhicules tout terrain. Il s’agissait déjà d’empêcher que le développement anarchique de cette pratique ne nuise à la préservation des espaces naturels et n’entraîne des conflits d’usage insupportables.
La loi du 3 janvier 1991, aujourd’hui codifiée, énonce clairement le principe de l’interdiction de la circulation des véhicules terrestres dans les milieux naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Diverses mesures ont précisé ce dispositif afin de renforcer l’interdiction dans certaines zones sensibles, mais aussi de mieux organiser la pratique des sports motorisés – plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, cartographie des voies autorisées dans les parcs naturels, par exemple. Enfin, des exceptions au principe d’interdiction sont prévues pour l’exercice des missions de service public, de certaines activités professionnelles et pour l’organisation exceptionnelle de randonnées motorisées dans les espaces naturels.
Cet édifice très complet a permis de concilier les intérêts en présence, d’autant que la jurisprudence, en rappelant que l’on doit considérer comme voie ouverte à la circulation publique toute voie carrossable et donc praticable par un véhicule ordinaire, a mis fin aux vaines polémiques qui pouvaient se faire jour sur cette notion pourtant assez simple.
Cette réglementation garde tout son intérêt aujourd’hui. Les milieux naturels sont toujours vulnérables, voire plus vulnérables encore, et les conflits d’usage potentiels entre promeneurs, randonneurs et véhicules motorisés sont toujours présents, notamment du fait de l’apparition des quads, dont le nombre a explosé depuis quelques années.
C’est dans ce contexte que M. Saint-Léger a déposé fin 2009 sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à autoriser en montagne l’accès des voies non carrossables aux véhicules tout terrain. Une telle autorisation reviendrait à ouvrir toute la montagne aux quads, aux 4 x 4 et autres engins motorisés.
Le bureau de la fédération des parcs naturels régionaux de France, parcs qui couvrent de nombreux territoires de montagne, a voté une motion s’opposant à cette proposition de loi dont l’adoption entraînerait de graves conséquences pour les milieux naturels. En outre, une telle proposition de loi est en totale contradiction avec le Grenelle de l’environnement. Dans ma région, le parc naturel régional du Haut-Languedoc, comme de nombreux autres parcs naturels régionaux, a également adopté une motion de ce type.
Face à cette situation, il me semble indispensable que le Gouvernement rappelle les fondements de sa politique dans ce domaine et précise quelles dispositions il entend prendre afin de garantir l’interdiction de circulation des engins motorisés dans les espaces montagnards en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, telles qu’elles sont définies aujourd’hui.
C’est d’autant plus nécessaire que M. Saint-Léger a récidivé voilà quelques semaines en déposant une seconde proposition de loi visant à permettre l’utilisation par les véhicules tout terrain de toutes les voies non carrossables, et non plus seulement des voies de montagne, et à prévoir une ouverture de principe des chemins privés à cette pratique !
Madame le sénateur, l’objectif étant de protéger les espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Les véhicules à moteur peuvent uniquement circuler sur les voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, sur les chemins ruraux et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, quel que soit le territoire concerné.
Les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels, outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, sont susceptibles de porter gravement atteinte aux habitats naturels, ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages.
Par ailleurs, certains utilisateurs, par leur comportement, sont à l’origine tant de nuisances pour les riverains et les touristes que de conflits entre les différentes catégories d’usagers fréquentant ces espaces.
Ces dispositions ont été rappelées dans la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Tout contrevenant s’expose à une amende de la cinquième classe, pouvant atteindre 1 500 euros, ainsi qu’à l’immobilisation et à la mise en fourrière de son véhicule.
Le Gouvernement n’envisage pas de remettre en question ce dispositif général équilibré, qui concilie liberté d’aller et venir et préservation des espaces naturels.

Je me félicite, monsieur le secrétaire d’État, comme tous les amoureux de la montagne et des espaces naturels, de votre réponse ferme et sans ambigüité.
Je tiens cependant à rappeler que l’efficacité commande d’accorder, contrairement à ce que prônent les partisans de la révision générale des politiques publiques, plus de moyens à l’ensemble des garderies, en particulier à l’Office national des forêts et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, afin de leur permettre de faire respecter cette législation, de faire comprendre cette dernière aux jeunes adeptes de loisirs motorisés et de sanctionner tous les abus.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 813, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité du maintien de la gare de Briare, dans le Loiret.
Sans doute connaissez-vous la ville de Briare, célèbre par son pont-canal, œuvre absolument majeure de l’architecture industrielle.
M. le secrétaire d’État acquiesce.

Il a été question dans l’actualité récente de la gare de Briare : il était envisagé de réduire les services que cette gare offre aux usagers et d’y supprimer toute présence humaine, c’est-à-dire tout agent de la SNCF, au bénéfice d’automates délivrant des billets aux voyageurs.
Cette annonce a suscité une vive émotion. Je rappelle en effet que les habitants de cette commune, comme tous les habitants de France, sont attachés à leur gare. De surcroît, cette gare est utilisée par de nombreux habitants domiciliés non seulement dans le Loiret, mais aussi dans le nord du Cher, dans l’ouest de l’Yonne et dans le nord-est de la Nièvre.
Au-delà du sort de la gare de Briare, monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais connaître les intentions du Gouvernement concernant les gares situées dans les petites communes, en particulier dans le monde rural. Il me semble que toute gare digne de ce nom doit être dotée de personnels de la SNCF. En effet, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes étrangères qui ne comprennent pas toujours très bien notre langue, ainsi que, de façon générale, tous les habitants souhaitant obtenir des renseignements en matière de chemins de fer sont très attachés à une telle présence humaine, présence qu’aucune machine ne saurait remplacer au regard tant de l’aide aux personnes que de la sécurité.
Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous me rassurer sur le maintien de la gare de Briare et m’indiquer s’il y aura toujours et en permanence des personnels de la SNCF dans cette gare ? Par ailleurs, pourriez-vous me confirmer que l’intention du Gouvernement est bien de maintenir à l’avenir une présence humaine dans chaque gare ? Une gare sans présence humaine est en effet une gare morte.
Monsieur le sénateur, vous évoquez l’inquiétude des clients de la SNCF fréquentant la gare de Briare, clients qui vous ont saisi afin d’être rassurés sur l’avenir de cette gare, de ses services et de son personnel.
Mon collègue Dominique Bussereau connaît votre attachement à cet équipement. Au-delà du cas de Briare, vous savez combien Dominique Bussereau et le Gouvernement sont attentifs à l’aménagement du territoire en général, au développement des transports collectifs en particulier et, plus précisément encore, au développement de ces transports en milieu rural. Le Président de la République a d’ailleurs souligné à juste titre, dans son discours de Morée du 9 février dernier, l’importance de la qualité des dessertes pour la vitalité des territoires ruraux.
Pour cette raison, le Gouvernement veille à la fourniture de prestations de qualité par la SNCF, tant pour les dessertes ferroviaires assurées que pour les services offerts en gare, notamment par son personnel. Ce sera d’ailleurs un thème très important du prochain comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, prévu le mois prochain.
Aujourd'hui, la gare de Briare est desservie quotidiennement par cinq TER-Centre dans chaque sens. Ainsi, 3 639 trains ont marqué un arrêt dans cette gare en 2009 ; environ 300 voyageurs la fréquentent chaque semaine ; la SNCF y a recensé 47 300 voyageurs en 2008.
Aussi Dominique Bussereau est-il heureux de pouvoir vous rassurer ce matin. D’abord, la gare n'est concernée par aucun projet de suppression de service. En conséquence, des personnels d'accueil, d'information aux voyageurs et de vente de billets resteront bien affectés à la gare de Briare. De même, aucune modification de desserte de cette gare n'est envisagée.
Cette réponse satisfait à mes yeux votre attente, bien légitime, de visibilité sur l’avenir immédiat de cet équipement important pour votre département.
De manière plus générale, vous le savez, la SNCF analyse régulièrement la situation de ses points de vente afin de les adapter aux évolutions de la demande et des modes de consommation de la clientèle. Cette démarche est logique, et toutes ces questions seront bien évidemment évoquées à l’occasion du prochain CIADT. L’État y réaffirmera son souhait de maintenir une présence de la SNCF en milieu rural.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie, ainsi que M. Dominique Bussereau, de la réponse extrêmement claire et précise que vous venez de m’apporter s’agissant du maintien de la gare de Briare, des dessertes actuelles et du personnel chargé de l’accueil, de la vente des billets et de l’information.
Au-delà de ce cas, je suis très attaché, vous l’aurez compris, à garantir sur l’ensemble du territoire national qu’il n’y aura pas de gare sans agent. Certes, des méthodes modernes existent pour acheter des billets sur Internet, ou directement par téléphone, la possibilité étant donnée de recommencer en cas d’erreur. Ces évolutions sont sans doute bénéfiques d’un point de vue technologique, mais ne remplacent pas la présence humaine. Plus aucune gare sans présence humaine, tel est l’objectif que je souhaite atteindre.

La parole est à M. Georges Patient, auteur de la question n° 827, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais attirer votre attention sur l'aéroport de Cayenne Rochambeau, confronté depuis un certain nombre d'années à de multiples difficultés d'ordres technique, logistique, matériel et humain.
À la suite de la question écrite que j’avais adressée à ce sujet le 22 octobre 2009 à M. le secrétaire d’État chargé des transports, le plan d'action relatif à l'aéroport de Cayenne, lancé par la direction des services de la navigation aérienne le 28 octobre 2009, a apporté quelques éléments de réponse.
Cependant, des interrogations fortes demeurent chez les agents du centre de contrôle. Ces derniers ressentent une incompréhension face au refus de créer un service de la navigation aérienne propre à la Guyane et à l'absence de réponse concernant le reclassement en bureau de traitement de l'information de vol du bureau régional d'information aéronautique et d'assistance en vol de Cayenne. Ce dernier n’est pas mentionné dans le plan d'action alors qu’il est dans une situation dramatique et que la question de son avenir est pourtant posée. En effet, le constat actuel est inquiétant à plus d'un titre.
En matière d'effectif, le nombre d’agents du bureau régional d'information aéronautique et d'assistance en vol, le BRIA, est passé de neuf à sept, et il ne sera plus que de six au printemps 2010. En outre, l'idée de confier l'espace de Cayenne au Brésil, comme solution temporaire aux problèmes de manque de personnel, suscite une vive inquiétude et des interrogations quant à l'activité de la tour et du BRIA. Ce dernier ne fonctionnera plus vingt-quatre heures sur vingt-quatre mais sera en effet fermé de vingt et une heures trente à sept heures trente. Pour pallier cette réduction d’activité, la Direction générale de l’aviation civile, ou DGAC, propose de confier les tâches nocturnes au BRIA des Antilles. Or, celui de la Guadeloupe est déjà en sous-effectif.
Monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais avoir des réponses précises sur ces aspects qui ne figurent pas dans le plan d'action de la Direction des services de la navigation aérienne, ou DSNA.
Monsieur le sénateur, vous avez d'ores et déjà attiré l'attention de Dominique Bussereau sur ce sujet par votre question écrite, dont la réponse a été publiée au Journal officiel en janvier dernier.
Les services de la navigation aérienne sont des échelons interrégionaux de la Direction des services de la navigation aérienne, la DSNA, ce qui permet de mettre en place des supports techniques de bonne dimension – de 250 à 500 agents –, afin de mutualiser les procédures et les ressources. Le SNA Antilles-Guyane, organisé avec un échelon central basé en Martinique, joue donc un rôle de direction et de support interrégional qui profite totalement à la Guyane, comme le montre la réalisation de la nouvelle tour de contrôle.
L'idée de créer un bureau de traitement de l'information de vol au lieu d'un bureau régional d'information aéronautique et d'assistance en vol a été abordée lors de la visite du directeur des services de la navigation aérienne en Guyane les 23 et 24 novembre 2009.
Les personnels du BRIA avaient en effet proposé cette solution afin de rendre les services d'information de vol et d'alerte aux vols à vue, en lieu et place des contrôleurs, et d'apporter ainsi une réponse au manque d'effectif de ces derniers.
Mais l'analyse l’a montré, la séparation de la gestion des vols à vue, d'un côté, et des vols aux instruments, de l’autre, ne serait pas la meilleure solution en termes de sécurité alors qu'ils évoluent dans le même espace aérien. D'ailleurs, l'ensemble des services de la navigation aérienne en métropole s'oriente vers une organisation analogue à celle qui prévaut aujourd'hui à Cayenne, en privilégiant le développement de secteurs d'information de vol gérés par les contrôleurs eux-mêmes.
Cela n'empêche évidemment pas de renforcer les moyens puisque trois avis de vacance d'emploi ont été ouverts à la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Par ailleurs, l'étude visant à examiner la possibilité de confier au Brésil l'espace de Cayenne, comme solution temporaire au manque de personnel, a fait apparaître des difficultés, notamment techniques, qui conduisent vraisemblablement à écarter cette solution.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez fait référence à la visite de M. Georges à l’automne dernier. Ce dernier s’était effectivement prononcé en faveur de la prise en compte des spécificités de l’aéroport de Cayenne. Mais de fait, rien de nouveau n’est intervenu depuis concernant la prise en compte des « spécificités de l’organisme de Rochambeau » qui ont été reconnues, « notamment en matière océanique ». De même, qu'en est-il du reclassement du centre ? Cette question est fondamentale dans la mesure où une telle opération aurait pour conséquences une meilleure attractivité de l'organisme de contrôle et un recrutement favorisé.
En l’absence de changement, la situation continue à se dégrader, en grande partie en raison du manque d'effectif. On pourrait presque parler, sans exagérer, d'hémorragie. Et pour cause : jamais un centre de contrôle n'a vu 75 % de ses contrôleurs désireux de partir ! L'effectif des contrôleurs qualifiés de Cayenne vient de tomber à 11 alors que le besoin opérationnel s’établit à 21. Sur les 12 contrôleurs qualifiés, 9 demandent leur mutation. Depuis février, à différents moments de la journée et une grande partie de la nuit, un seul contrôleur est en poste dans la tour de contrôle. Je pourrais énumérer nombre d’exemples similaires, mais le temps imparti ne me le permettra pas.
Vous comprendrez, monsieur le secrétaire d’État, qu'avec des conditions de travail aussi mauvaises le climat social se détériore et que de nombreux agents soient désespérés, découragés, et éprouvent un fort sentiment d'abandon. Leurs cris restent inaudibles. Les notes s'accumulent mais aucune mesure concrète n'a été prise. Pendant ce temps, la sécurité du trafic s'en trouve considérablement aggravée.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 821, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur les difficultés engendrées par la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux transports publics.
L’objectif de cette loi est tout à fait légitime, et nous ne le contestons pas. En revanche, la question du financement de cette mise en accessibilité pour les personnes handicapées est plus préoccupante. Les élus locaux que nous sommes doivent en effet prévoir des dépenses nouvelles pour la mise aux normes des bâtiments, des trottoirs, des voiries et des transports. Ceux qui gèrent ce type d’infrastructures le savent, les schémas d’accessibilité nous amènent à envisager des dépenses auxquelles nous ne pourrons pas faire face dans les délais impartis, dépenses dont certaines, au dire même des associations concernées par cette réforme, sont tout à fait inutiles.
La loi impose de mettre en conformité les transports en commun en vue d'un accès complet aux personnes handicapées. Mais même avec une programmation pluriannuelle d'investissement pour les prochaines années, il paraît difficilement concevable, voire impossible, sans une aide significative de l'État, que tout soit prêt pour février 2015. Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, comment le Gouvernement prévoit d'aider les communes et les autorités organisatrices de transport.
En outre, j’attire votre attention sur les conditions de dérogation à ce principe prévues par la loi : en cas d'impossibilité technique avérée – les cas sont nombreux – et à condition que soient mis en place des services de substitution adaptés, dont le coût pour la personne handicapée ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Ces dérogations et le coût très élevé des aménagements nécessaires à cette mise en accessibilité des transports existants posent question. Ne serait-il pas plus efficace, en premier lieu pour les publics concernés, de mettre en place des services à la demande au profit des personnes handicapées ou à mobilité réduite plutôt que d’imposer des dispositifs très coûteux, souvent inadaptés et parfois totalement inefficaces ?
Monsieur le sénateur, vous évoquez la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui confie aux autorités organisatrices de transport la charge de mettre en accessibilité leurs services de transport public d'ici à février 2015.
Comme vous le soulignez, la réalisation de cet objectif est légitime et nécessaire. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, elle s'inscrit dans la durée puisque le législateur a accordé un délai de dix ans pour la mise en accessibilité des réseaux de transport et a imposé aux autorités organisatrices d'établir la programmation des travaux nécessaires dès l'élaboration de leur schéma directeur d'accessibilité.
L'État, autorité organisatrice des services ferroviaires d'intérêt national, a pour sa part approuvé, le 11 juin 2008, le schéma directeur fixant la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des gares et des quais.
Ce schéma prévoit la mise en accessibilité de 418 gares d'ici à 2015, opération pour laquelle la SNCF s'est engagée à hauteur de 500 millions d'euros. De son côté, le contrat de performance liant l'État et Réseau ferré de France prévoit de rendre accessibles, d'ici à 2012, les quais de 250 gares ; 114 millions d'euros y sont consacrés, et le plan de relance a permis d'accélérer ce programme.
Pour les autres autorités organisatrices de transport, les dispositions de la loi sont des mesures de portée générale et n'entraînent pas une compensation ou une participation financière de l'État.
L’État, qui a précisé les modalités d'application de la loi en élaborant un corpus réglementaire, peut en revanche apporter aux collectivités qui le désirent un appui juridique et technique, en mobilisant le réseau scientifique et technique du ministère en charge des transports. Le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, ou CERTU, a ainsi publié de nombreux guides et recueils de bonnes pratiques. Il a aussi organisé des journées d'échanges sur ce sujet avec les acteurs concernés.
Cet appui a d'ailleurs été institutionnalisé le 11 février dernier par l'installation d'un Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, dont les missions sont d'évaluer l'accessibilité, d'identifier les obstacles à la mise en œuvre de la loi et de constituer un centre de ressources à la disposition de l'ensemble des partenaires.
Le ministère organisera également, au cours de l’année 2010, des « journées territoriales du handicap » pour dresser un constat au plus près du terrain et pour accompagner les collectivités territoriales, afin de sensibiliser ces dernières aux enjeux de la loi.
Enfin, les autorités organisatrices ne pourront invoquer des dérogations au principe de mise en accessibilité de services de transports qu’à une double condition : tout d’abord, le constat d’une impossibilité technique, ensuite, la mise en place d’un service de substitution adopté sans surcoût pour l’usager. De tels services de substitution sont à définir par l’autorité organisatrice dans le cadre de sa libre administration, en fonction des caractéristiques locales et en concertation avec les associations concernées. Ils seront ensuite décrits dans le schéma directeur d’accessibilité.

Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse ne m’apporte strictement aucun élément positif.

C’est bien joli d’établir des guides des bonnes pratiques, d’instituer des observatoires ministériels ou de sensibiliser les collectivités territoriales, mais cela ne résout pas les problèmes concrets sur le terrain !
Lorsque l’on élabore un schéma d’accessibilité, ce que j’ai été amené à faire en qualité de président d’une autorité organisatrice de transports, et que l’on voit les chiffres et les difficultés techniques, on se rend compte que les normes sont une fois de plus trop contraignantes et souvent contraires à la réalité de terrain.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous le dis clairement : la loi ne pourra pas être appliquée dans de bonnes conditions au mois de février 2015, y compris par ceux qui sont tout à fait conscients de l’importance du problème et qui souhaitent la mise en œuvre de telles dispositions !

La parole est à M. Yvon Collin, auteur de la question n° 816, transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l’organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation et modifiant le code de l’environnement, dont les dispositions, bientôt applicables, risquent de nuire à l’activité de nombreux agriculteurs, en particulier dans le grand sud-ouest.
Je ne méconnais pas la nécessité de maîtriser à terme la ressource en eau. Pour autant, certains choix relèvent, me semble-t-il, plus d’une idéologie anti-irrigation que d’une véritable prise en compte des réalités de terrain et des expériences acquises.
En effet, alors que tous les acteurs locaux concernés ont pris leurs responsabilités depuis au moins vingt-cinq ans pour mettre en place d’importants réseaux d’irrigation adaptés à la fois à l’environnement et aux besoins des exploitations fruitières et des cultures spécialisées, le décret précité impose des restrictions qui appellent plusieurs remarques quant à leur bien-fondé.
À partir de 2011, la détermination de nouvelles autorisations de pompage à l’échelle de chaque bassin versant conduirait à des volumes prélevables désastreux pour l’agriculture. Alors que l’on n’a pas recensé de conflits d’usage, les agriculteurs devraient gérer des baisses de volume de l’ordre de 20 %, de 30 %, de 50 % et parfois même de 100 % dans certains bassins versants.
Monsieur le secrétaire d’État, vous l’imaginez bien, ces nouvelles conditions sont inacceptables. Elles risquent de mettre en péril un secteur économique fondamental, notamment dans mon département, le Tarn-et-Garonne, où l’irrigation concerne environ 85 000 hectares sur les 225 000 hectares de surfaces agricoles utiles.
Les agriculteurs comprennent parfaitement le principe de gestion de l’eau. Ils ont d’ailleurs fourni de nombreux efforts qui ont abouti à une économie de 30 % de l’eau pour une même quantité produite grâce à une modernisation du matériel d’irrigation, des modifications des itinéraires techniques et une évolution des assolements.
En revanche, ils ne comprennent pas que ce décret soit aujourd'hui encore maintenu en l’état, sachant de surcroît que M. le ministre de l’écologie accepte enfin de parler plus de débit que de volume. Il serait donc souhaitable d’abandonner au plus vite, au moins partiellement, ce décret dont le principe est acceptable pour les rivières installées, mais qui se révèle inadapté pour les petites rivières. Les exploitants agricoles doivent pouvoir continuer à gérer le pompage au jour le jour dans une logique raisonnée, comme ils l’ont d’ailleurs toujours fait.
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, il faudrait également remettre en route une véritable politique du stockage de l’eau. Sur ce point, des solutions respectueuses de l’environnement existent. Il faudrait les envisager rapidement pour répondre au grand défi de l’alimentation en eau, auquel, vous l’imaginez, tout le monde peut être sensible.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l’organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation et modifiant le code de l’environnement.
Ce décret définit les responsabilités et la procédure de désignation des organismes uniques, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique pluriannuelle et la procédure d’homologation du plan annuel de répartition du volume d’eau. Il s’appuie sur les objectifs d’étiage qui ont déjà été fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux adoptés à la fin de l’année 2009.
La réforme induite par ce décret est partie d’un constat très simple. Au cours des dix dernières années, on a observé systématiquement sur plus d’une vingtaine de départements des arrêtés sécheresse qui remettent en cause les autorisations accordées quelles que soient les conditions hydrologiques. Ce chiffre est doublé les années sèches et il concerne plus de soixante départements les années les plus sèches.
Cela montre que les autorisations accordées devenaient de plus en plus théoriques et ne correspondaient plus aux volumes réellement prélevables par les agriculteurs au cours de l’année.
La réforme proposée vise simplement à établir la vérité des autorisations en considérant, d’une part, la ressource disponible et, d’autre part, les besoins exprimés. Au lieu d’accorder des demandes théoriques, de constater ensuite qu’elles dépassent les ressources et de gérer les prélèvements à chaud par arrêtés sécheresse successifs, il est proposé de se mettre d’accord sur la ressource à répartir, puis de la partager au mieux entre les irrigants. Cela n’exclut évidemment pas de devoir la moduler au cours de l’été en fonction de l’état de la ressource.
Une telle réforme ne signifie clairement pas que l’État soit opposé à l’irrigation, bien au contraire. Les agriculteurs ont besoin de connaître réellement la quantité d’eau qu’ils sont susceptibles d’avoir en début de saison, au moment des choix d’assolement. Personne ne peut nier qu’il y a des problèmes dans certains secteurs, mais ce n’est pas généralisé sur l’ensemble du territoire. Des solutions acceptables d’un point de vue tant environnemental que socio-économique doivent, me semble-t-il, être trouvées au niveau local pour ces cas particuliers.
Le retour à l’équilibre entre la ressource disponible et les besoins peut être envisagé, sans ordre de priorité, par des mesures d’économie d’eau et par l’amélioration des pratiques agricoles existantes, mais également par la réalisation de retenues et par la réorientation des filières agricoles dans les zones où les réductions de prélèvements seront les plus importantes. Le ministère chargé de l’écologie et le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche réfléchissent actuellement à un plan global destiné à accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques et de leurs systèmes de production.
Comme vous l’avez souligné, cette évolution est indispensable à la résorption des déséquilibres quantitatifs structurels.
Enfin, des concertations approfondies se déroulent actuellement sur tout le bassin Adour-Garonne, sous l’égide du préfet de bassin. Bien entendu, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat suit ce dossier avec une attention toute particulière.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre réponse, et je note qu’elle est marquée par un esprit d’ouverture. Vous n’excluez pas des discussions ou des concertations au niveau local, et j’en prends acte.
En effet, rien ne serait plus terrible qu’une approche complètement intégriste assortie d’un texte imposé à nos agriculteurs sans possibilité de discussion quant à l’utilisation des débits.
Cela étant, et vous l’avez également évoqué dans votre réponse, au-delà de cet arrêté particulier, le problème de la ressource en eau – je pense en particulier à la question des grandes réserves – n’est pas complètement résolu.
Je sais que les écologistes sont actuellement assez hostiles aux grandes réserves.
Vous avez évoqué le bassin Adour-Garonne et le grand sud-ouest. En l’occurrence, le barrage de Charlas, qui fait un peu figure d’ « arlésienne », serait vraiment la réponse à tous nos maux, en tout cas s’agissant de l’hydrologie. Il permettrait de réguler l’étiage et d’apporter les bonnes réponses en termes d’alimentation en eau pour nos agriculteurs et pour tous les usages.
Il faut, à mon avis, relancer un tel projet. Je ne manquerai pas de le souligner auprès de M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, que je dois rencontrer prochainement.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 811, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à attirer votre attention sur la situation des personnes handicapées, qui, en dépit de toutes les annonces du Gouvernement en leur faveur, voient leur situation se dégrader.
Ainsi, de nombreuses questions restent en suspens, et les personnes en situation de handicap attendent une réponse, certes brève compte tenu du temps imparti, mais claire et précise.
Comment justifier le report de six mois de la sur-contribution Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, ou AGEFIPH, pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’emploi des personnes en situation de handicap ? Comment justifier les tentatives incessantes du Gouvernement visant à instaurer des dérogations pour les bâtiments au regard du principe d’accessibilité, et cela au mépris de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ?
Quelle est la position du Gouvernement sur la proposition de loi votée au mois de décembre 2009 à l’Assemblée nationale ayant notamment pour finalité de rendre optionnel, et non plus obligatoire, le plan personnalisé de compensation, qui vise à répondre aux différents besoins de la personne handicapée ?
L’État a-t-il bien la volonté de gérer les assistants de vie scolaire et d’assurer la pérennité de leur statut ? Quelles sont les décisions envisagées en faveur des très nombreuses personnes handicapées qui vivent encore sous le seuil de pauvreté ?
Quelles dispositions sont-elles prévues pour aider les très nombreux établissements et services d’aide par le travail, ou ESAT, dans une situation financière intenable, qui ont par ailleurs vu leur dotation diminuer ?
Quelles mesures de soutien sont-elles envisagées pour faire face aux difficultés que ces établissements rencontrent lorsqu’il s’agit de conserver leurs marchés ou d’en trouver de nouveaux, difficultés notamment liées à un parasitage des marchés potentiels ou aux règles fiscales qui s’appliquent ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, qui m’a demandé de bien vouloir vous transmettre sa réponse.
Améliorer la situation des personnes handicapées, être à la hauteur des ambitions de la loi du 11 février 2005, être au rendez-vous de nos engagements en 2015, c’est la priorité du Gouvernement !
Vous évoquez la question de l’emploi. Actuellement, 725 000 personnes handicapées sont dans l’emploi, dont 80 % en milieu ordinaire, ce qui représente une augmentation de 4 % dans le secteur privé depuis 2005. En outre, 40 % des entreprises atteignent ou dépassent le taux de 6 %. Dans le public, ce taux est passé de 3, 7 % en 2005 à 4, 4 % en 2009. De tels chiffres parlent d’eux-mêmes !
Le délai de paiement de six mois accordé aux PME n’est qu’une mesure de bon sens. En période de crise, l’urgence est de les sauver de la faillite et de préserver l’emploi. Des entreprises qui mettent la clé sous la porte, cela signifie moins d’emploi pour tous et, d’expérience, l’éloignement quasi inexorable des personnes handicapées du monde du travail.
Monsieur le sénateur, ménager les entreprises, c’est ménager les perspectives d’embauche des personnes handicapées !
En outre, je le rappelle, passé le délai de six mois, soit les entreprises auront effectivement embauché et elles s’acquitteront de leur contribution ordinaire pour les bénéficiaires manquants, soit elles n’auront rien fait et, dans ce cas, elles se verront imposer la sur-contribution prévue, sur la totalité de l’année 2010.
Il n’est pas question de faiblir, de s’accommoder ou de capituler en matière d’accessibilité. Le 11 février dernier, nous avons mis en place l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, présidé par votre collègue Sylvie Desmarescaux. Sa mission sera de veiller à faire en sorte que la France soit au rendez-vous prévu pour 2015.
Il y aura peut-être des dérogations – elles sont parfois inévitables –, mais au compte-gouttes. L’Observatoire y veillera ! Je le précise, cet organisme aura pour vice-président M. Jean-Marie Barbier, le président de l’Association des paralysés de France, qui n’est pas connu – c’est le moins que l’on puisse dire – pour transiger sur de telles questions.
Vous évoquez également la question de la scolarisation : notre mobilisation dans ce domaine permet aujourd’hui à 180 000 élèves handicapés d’être scolarisés à l’école ordinaire, soit 10 000 élèves de plus à chaque rentrée.
Quant aux auxiliaires de vie scolaire, Nadine Morano en a fait l’une de ses priorités dès sa prise de fonctions : un groupe de travail, copiloté avec l’éducation nationale, s’est réuni tout au long de l’automne et de l’hiver derniers. Il a d’ores et déjà permis d’aboutir à un consensus sur les compétences attendues de ces professionnels.
Enfin, vous évoquez la question des ressources des personnes handicapées. Ce gouvernement restera dans les mémoires comme celui qui a fait plus dans ce domaine que tous les autres gouvernements avant lui : 25 % de revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés en cinq ans, c’était une décision historique !
Nous tenons cet engagement, loi de finances après loi de finances, et ce malgré les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les finances publiques.
Bien sûr, des progrès restent à faire, mais notre détermination est entière. Le 9 février dernier, le Comité interministériel du handicap a été présidé par le Premier ministre en personne, signe que tout le Gouvernement s’engage en faveur des politiques du handicap.

Madame la secrétaire d’Etat, je ne suis pas très satisfait de la réponse qui m’a été faite, mais je ne m’attendais pas, de la part du Gouvernement, à autre chose qu’à de l’autosatisfaction.
En tout cas, c’est non pas le sénateur que je suis qu’il faut convaincre, mais le monde du handicap, lequel a nettement le sentiment que la loi du 11 février 2005 est vidée de sa substance. Les décrets d’application ne sont pas publiés assez vite, et les essais de contournement attaquent la loi dans ses fondements.
Beaucoup d’autres questions ont été soulevées sur le handicap. Je souhaite que Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité tienne ses engagements en ce qui concerne la mise en application de la loi du 11 février 2005.

La parole est à M. Rachel Mazuir, auteur de la question n° 822, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Madame la secrétaire d'État, l’état des finances des associations d’aide à la personne ne cesse de se dégrader alors même que ces dernières sont de plus en plus sollicitées par les pouvoirs publics en raison des services qu’elles procurent aux personnes âgées et handicapées.
Depuis 2002, le Gouvernement, face à la dépendance, a mis en œuvre une politique sociale pertinente qui tend à la professionnalisation des services d’aide à domicile, services érigés en institutions sociales reconnues par les conseils généraux, compétents en matière d’aide sociale.
De nombreuses associations ont ainsi été agréées par les présidents de conseils généraux avec lesquels elles ont conclu des conventions partenariales, avec un tarif.
Pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, ou de l’aide sociale, le prix de l’heure d’aide ménagère financée par le conseil général est calculé en prenant en considération les coûts réellement supportés par les associations, de façon à ne pas déséquilibrer le budget de ces dernières.
Il n’en va pas de même des régimes de retraite, qui financent également les services d’aide à domicile pour les personnes âgées ne bénéficiant pas des dispositifs d’aide sociale du conseil général. Les tarifs fixés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, sont en effet nettement inférieurs à ceux des conseils généraux, et c’est précisément ce qui entraîne des déficits dans le budget des associations.
À cela, s’ajoute l’arrivée sur le marché des services d’aide à la personne, initialement créés pour offrir de menus services aux retraités solvables non dépendants. Intéressés par le créneau de l’aide aux personnes âgées dépendantes financée par les fonds publics, ces services ont réussi à s’imposer et à proposer des tarifs préférentiels.
Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, souligne que la coexistence de ces deux systèmes est un facteur de crise et qu’une solution doit être recherchée.
Madame la secrétaire d'État, je souhaite connaître les mesures qu’entend prendre à cet égard le Gouvernement, en considérant non seulement la situation du secteur associatif de l’aide à domicile, qui emploie aujourd’hui quelque 300 000 salariés, mais également la qualité des prestations qui doivent être servies aux personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’APA.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Éric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.
L’aide à domicile, et particulièrement la situation financière des services d’aide à domicile, est un sujet sur lequel le Gouvernement a été sensibilisé.
Ce secteur est complexe, car il fait appel à des financements publics variés – ceux des conseils généraux, des caisses de retraite, des exonérations fiscales et sociales –, ainsi qu’à des financements privés : ceux des usagers.
Les exonérations fiscales et sociales pour le secteur représentent par exemple à elles seules 6, 6 milliards d’euros en 2009.
Une table ronde sur le financement de l’aide à domicile a été organisée, à la demande des ministres concernés, par la Direction générale de la cohésion sociale le 22 décembre dernier. Elle a permis de dresser un premier état des lieux des difficultés et de recenser les attentes du secteur.
À la suite de cette table ronde, nous avons lancé des travaux qui devront nous permettre de mieux appréhender l’origine des difficultés du secteur et de définir les améliorations susceptibles d’y remédier.
À cet effet, Éric Woerth a signé le 29 mars dernier des lettres de mission à l’attention du directeur général de la cohésion sociale et du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA. La Direction générale de la cohésion sociale est ainsi chargée de l’animation d’un groupe de travail ayant pour mission d’établir un état des lieux territorialisé de l’offre de services d’aide à domicile. Cette cartographie vise à mieux appréhender les profils et les besoins des personnes aidées, ainsi qu’à comparer les pratiques des départements en termes d’autorisation et de tarification.
De la sorte, nous devrions disposer d’un « observatoire » sur ce secteur qui souffre d’un manque de données partagées, objectivées et disponibles pour tous.
Ce groupe travaillera également sur l’efficience des structures et aura pour objectif de proposer des solutions opérationnelles en termes de modernisation, de mutualisation et d’adaptation des services.
La CNSA est, quant à elle, chargée d’animer un groupe de travail sur le contenu qualitatif des plans d’aide qui sont mis en place pour le maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées, afin d’aboutir à des référentiels partagés entre les différents acteurs.
Enfin, dans les prochains jours, les trois inspections générales – l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration – vont être saisies d’une mission large sur le financement et la tarification des services d’aide à domicile. Cette mission portera sur les facteurs déterminant les coûts des prestations, sur les règles de tarification, sur la solvabilisation des besoins et des plans d’aide par l’APA et sur les contrôles d’effectivité des dépenses publiques d’aide à domicile.
L’ensemble de ces travaux devra être remis au Gouvernement le 30 septembre prochain. D’ici là, nous sommes bien évidemment attentifs aux difficultés signalées localement afin de pouvoir y apporter la meilleure réponse possible.

Mme la secrétaire d'État m’a apporté une réponse intéressante s’agissant de l’ensemble des problèmes sociaux qui sont en priorité ceux des conseils généraux.
Je sais que mon collègue Claude Jeannerot a déjà posé une question écrite se faisant l’écho des inquiétudes des associations. Beaucoup d’associations sont en effet en grande difficulté. Il importe donc d’aller vite, car il y a urgence !

La parole est à M. Bernard Piras, en remplacement de M. Robert Navarro, auteur de la question n° 812, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette question porte sur l’application de la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Dans le secteur de la défense, ce sont 54 000 emplois civils et militaires qui sont concernés.
Mon collègue Robert Navarro a été alerté, voilà plusieurs semaines, sur la situation des personnels civils de la garnison de Montpellier. La suppression de cette garnison est prévue pour le courant de l’année : 1 000 personnes, sans compter les emplois privés liés à la garnison par des contrats de sous-traitance, devraient être affectées par cette décision.
Or, à quelques mois de la fermeture, une centaine de salariés restent sans solution de reclassement.
Alors qu’un comité pour la reconversion des sites de défense a été mis en place dès septembre 2008, les personnels ont dû attendre janvier 2009 pour que leur sort soit pris en compte et qu’un plan ministériel d’accompagnement soit finalement mis sur pied.
Il est tout de même choquant qu’on se soit préoccupé des bâtiments avant de s’inquiéter des salariés.
C’est bien le retard pris par le processus de reclassement qui est à l’origine de la situation difficile dans laquelle ces employés se trouvent aujourd’hui. Mais le calendrier de fermeture des sites n’a, quant à lui, pas changé.
La RGPP intervient dans un contexte économique et social particulièrement difficile, et vous ne pouvez pas l’oublier. Elle est menée d’une manière plutôt opaque et parfois improvisée, comme en témoigne le cas présent.
S’il est bien entendu qu’il faut réformer l’État, cela doit du moins se faire dans le respect des personnels, et de façon prévoyante et intelligente. En tout cas, il ne faut pas agir à la légère.
Le ministre de la défense ne peut pas laisser ainsi des centaines de salariés de l’État dans l’incertitude sur le sort qui les attend. Il est de son devoir de s’assurer que la réforme est mise en œuvre dans les meilleures conditions. C’est en effet l’avenir de personnes réelles et de leurs familles qui est en jeu !
On a proposé aux personnels un reclassement, mais à l’intérieur de l’administration de la défense, ce qui les obligerait à quitter le secteur de Montpellier. Certains d’entre eux sont à quelques années de la retraite. Leurs salaires sont souvent modestes. Comment peuvent-ils, dans ces conditions, envisager sans appréhension de déménager dans une autre région ?
Ces personnels devraient pouvoir être accueillis dans les autres administrations de l’État et des collectivités territoriales, ce qui leur permettrait de rester dans la région où ils ont fait leur vie.
En tant qu’élu local, je ne peux pas ignorer non plus que tout le secteur de Montpellier subira le contrecoup de cette réforme. Le dynamisme d’un territoire est également un aspect dont il faut tenir compte dans une réforme d’une aussi vaste ampleur.
Aucune urgence opérationnelle ou économique ne semble obliger à fermer les sites de Montpellier dans les délais fixés initialement.
Les salariés concernés demandent un moratoire de deux ans sur les opérations de restructuration prévues pour 2010. Je me fais aujourd’hui leur relais auprès du ministre de la défense : pourquoi ne pas envisager une telle solution, qui permettrait d’aborder plus sereinement le reclassement des personnels et de mettre en place des mesures incitatives en direction des employeurs publics potentiels ?
Les représentants du personnel civil de la garnison de Montpellier ont demandé à prendre connaissance d’un courrier transmis par Hervé Morin à Claude Baland, préfet du Languedoc-Roussillon et de l’Hérault, au sujet de ce moratoire. Je souhaite que me soient indiquées aujourd’hui les raisons pour lesquelles cette solution est repoussée. Par ailleurs, que compte faire M. Morin pour remédier à la situation intenable dans laquelle se trouvent des centaines de personnes dépendant de son ministère ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. Hervé Morin : le ministre de la défense participe en ce moment même au conseil des ministres qui se tient exceptionnellement aujourd’hui, et je vous répondrai donc en son nom.
Comme vous le savez le Gouvernement mène depuis trois ans une profonde politique de modernisation de notre défense. Le ministère de la défense a constamment voulu tenir compte des aspects sociaux qu’impliquait la réorganisation de nos armées et de ses services. Aussi des mesures sont-elles prévues dans un plan d’accompagnement des restructurations publié en janvier 2009.
Tous les services et établissements du ministère de la défense touchés par des opérations de restructuration ou de réorganisation dans les trois années à venir figurent dans un arrêté ministériel, ce qui ouvre droit, pour les agents de ces services ou établissements, à des indemnités de mobilité ou de départ volontaire et à un accompagnement social poussé.
Le ministère de la défense s’est donc donné les moyens de l’accompagnement social de cette réforme fondamentale pour répondre aux grands défis de demain.
Le ministre de la défense est personnellement très attentif à cet aspect de la réforme, considérant que les personnels civils et militaires du ministère constituent la première richesse de celui-ci. Aussi Hervé Morin s’est-il déplacé récemment à Nantes et a-t-il demandé à son cabinet de se rendre sur tous les sites restructurés.
C’est ainsi qu’une délégation conduite par le directeur adjoint de son cabinet s’est rendue à Montpellier le 28 janvier dernier pour aller à la rencontre du personnel et évoquer avec lui les conséquences des transferts des écoles de l’infanterie, du commissariat de l’armée de terre et des autres structures.
Il n’y a pas eu, contrairement à ce que vous avancez, de retard dans le processus de reclassement. Annoncées en juillet 2008, les structures de concertation se sont mises en place en février 2009. Le comité de site s’est réuni dès la fin de 2008.
À notre connaissance, ce sont moins de 70 personnes qui restent à reclasser aujourd’hui sur les 300 personnes auxquelles vous faisiez référence.
Ainsi, une vraie dynamique a été enclenchée avec les autres services de l’État pour proposer des reclassements locaux.
Par ailleurs, l’ouverture d’un internat d’excellence sur le site de l’ancienne École militaire supérieure d’administration et de management, à la rentrée de 2010, ouvre des perspectives d’emploi pour treize agents du ministère de la défense. De même, la gendarmerie a fait état de la nécessité de pourvoir seize postes d’agent civil dans les services de soutien, qui pourraient correspondre à des profils de personnels du ministère de la défense disposés à se reclasser localement.
Il est également utile de rappeler que le ministère de la défense offre toujours des postes vacants à Draguignan aux personnes qui souhaitent accompagner le déménagement de l’École d’application de l’infanterie. En outre, des postes à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la CNMSS, à Toulon, sont ouverts en priorité aux agents de la direction interdépartementale des anciens combattants. À la suite des instructions données par le ministère de la défense, le maire de Toulon, M. Hubert Falco, a facilité l’installation des agents qui accepteront de rejoindre la CNMSS.
Quant au moratoire que vous demandez, monsieur le sénateur, vous comprendrez aisément qu’il n’est pas possible de l’envisager aujourd’hui.
En effet, d’une part, les opérations de restructuration menées à Montpellier font partie d’un plan d’ensemble du ministère de la défense, dont la mise en œuvre s’échelonne entre 2009 et 2014. L’opération en cours ne peut donc être reportée localement, au risque de compromettre une manœuvre complexe, où chaque étape doit s’effectuer dans les délais impartis pour ne pas en retarder d’autres ni décaler toutes les échéances. Ces éléments ont été précisés aux représentants du personnel lors de la rencontre du 28 janvier dernier à Montpellier.
D’autre part, l’ouverture d’un internat d’excellence ainsi que la création d’environ quatre cents places d’hébergement au profit du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS, dès la rentrée de 2010, imposent la poursuite des opérations selon le calendrier prévu.
Enfin, malgré les efforts du commandement et du préfet, un seul reclassement dans la fonction publique territoriale est intervenu, alors que les candidats ne manquent pas, ni d’ailleurs les postes ! Monsieur le sénateur, si les élus concernés se mobilisent vraiment, il n’y aura plus de difficultés de reclassement des personnels du ministère de la défense à Montpellier !
Rires sur les travées du groupe socialiste.

Madame la secrétaire d’État, mon collègue Robert Navarro prendra connaissance de votre réponse et jugera s’il doit ou non interpeller à nouveau M. le ministre de la défense ou ses services sur ce sujet…

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 820, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Avec la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le Gouvernement a rendu obligatoire l’inscription des infirmiers au sein d’un nouvel ordre professionnel, après avoir imposé la même mesure aux masseurs-kinésithérapeutes en 2004.
Nous devons replacer cette décision dans le contexte de l’application de cette loi, qui conduit à fermer des hôpitaux, à supprimer des services, à réduire le personnel, à rationner les moyens et même à ne pas reconnaître les qualifications des personnels. Dans les hôpitaux publics, la contestation de cette politique enfle.
À Tours, par exemple, les infirmiers anesthésistes se sont mis en grève pour se faire entendre, car on leur refuse injustement une reconnaissance à la hauteur de leurs responsabilités et de leurs qualifications. De même, à l’hôpital pour enfants de Clocheville, les services de néphrologie et d’hémodialyse manquent d’effectifs et la fermeture de l’unité saisonnière, un moment envisagée, aurait entraîné la suppression de vingt-neuf postes. D’autres services sont en grève pour dénoncer le manque de moyens pour répondre aux besoins des malades.
Il en va de même du démantèlement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui aura de graves conséquences pour la population de l’Île-de-France, car il en résultera une réduction de l’offre de soins.
Parallèlement, vous remettez en cause le droit au départ à la retraite à 55 ans pour les infirmiers, partant du principe que la pénibilité peut être compensée financièrement. Cette position n’est naturellement pas acceptable, la seule compensation possible de la pénibilité étant une réduction du temps de cotisation, c’est-à-dire la possibilité de partir à la retraite de manière anticipée en bénéficiant du taux plein.
À vos yeux, l’hôpital doit être rentable et vous n’avez qu’une hâte : faire réaliser demain par des professionnels libéraux les soins prodigués aujourd’hui par les personnels publics.
La tentative de mise au pas de la profession à travers ces différentes réformes n’a qu’un objectif : rendre inopérant notre système de santé public pour justifier qu’il soit livré au secteur privé. Vous voulez imposer à notre hôpital public le modèle libéral, compatible avec la tarification à l’activité, la T2A, et le transformer en entreprise de soins.
La création des ordres infirmiers participe de cette logique. En affaiblissant les organes de représentation existants, professionnels et syndicaux, vous espérez diviser les salariés en leur imposant, au travers de ces ordres professionnels, un carcan qu’ils rejettent de façon quasiment unanime. Vous souhaitez contenir par la contrainte la contestation montante des salariés dans les hôpitaux, mise en évidence par les manifestations de ces dernières années, celles de 2003 en particulier.
Lors de son audition à l’Assemblée nationale, la présidente du conseil national de l’ordre des infirmiers s’en prenait d’ailleurs aux syndicats, qu’elle considère hostiles à la reconnaissance « des dimensions fondamentales de fierté, de responsabilité et d’autonomie que l’ordre incarne », en les accusant de « désinformation systématique, [de] menaces personnelles, [d’]actes de délinquance organisée, [de] dégradations, [de] campagnes tapageuses », du blocage ou de la destruction des courriers d’inscription à l’ordre. Ces attaques violentes contre l’activité syndicale ne changent rien au fait que les salariés refusent d’être enfermés dans un ordre dont ils ne veulent pas !
La seule solution, me semble-t-il, c’est l’abrogation de cette loi qui fait l’unanimité contre elle. Le taux de participation de 13 % aux dernières élections ordinales exprime d’ailleurs clairement la réponse des salariés.
En transférant au conseil de l’ordre les missions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS, concernant l’enregistrement des diplômes, l’attribution d’un numéro dans le registre commun des professions paramédicales, la tenue du tableau de démographie professionnelle, le suivi des densités de professionnels par territoire, vous faites financer par la profession ce qui l’était auparavant par la solidarité nationale.
Ne croyez pas que tous les infirmiers et kinésithérapeutes libéraux soient favorables à la création d’un ordre professionnel, car j’en ai rencontré de nombreux qui ne comprennent pas l’utilité d’une telle institution !
Madame la secrétaire d’État, que compte faire le Gouvernement face à cette levée de boucliers contre ces ordres professionnels dont il projette de renforcer encore les prérogatives alors qu’ils sont rejetés, à la quasi-unanimité, par les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ?
Madame la sénatrice, vous interrogez Mme la ministre de la santé et des sports sur l’obligation faite aux infirmiers salariés ou fonctionnaires de s’inscrire au tableau de l’ordre national des infirmiers.
La loi du 21 décembre 2006 a institué un ordre professionnel des infirmiers, regroupant obligatoirement l’ensemble des infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux qui sont régis par le statut général des militaires. Cet ordre est chargé d’organiser la profession d’infirmier et d’infirmière dans le cadre d’une mission de service public que l’État lui a déléguée. À l’heure actuelle, et en l’état du droit positif, l’inscription au tableau de l’ordre national des infirmiers demeure une obligation légale pour l’ensemble des infirmiers en exercice, tant salariés que libéraux.
La ministre de la santé et des sports s’est à plusieurs reprises exprimée au sujet du montant de la cotisation annuelle, dont la fixation relève du seul conseil national de l’ordre. Cependant, Mme Bachelot-Narquin a introduit différentes mesures dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, permettant au conseil national de modérer et de moduler le niveau de cette cotisation, ce qui a rendu possible la fixation d’un montant moins élevé pour les jeunes diplômés. La ministre de la santé et des sports attend du conseil national des avancées complémentaires dans ce domaine, de sorte que l’ordre gagne, auprès de l’ensemble de la profession qu’il défend, toute la légitimité nécessaire à son action.
Par ailleurs, en ce qui concerne les moyens accordés aux personnels infirmiers pour leur permettre d’accomplir leurs missions, Mme la ministre a signé le 2 février dernier un protocole d’accord avec les organisations syndicales représentatives du personnel. Ce protocole apporte des revalorisations d’une ampleur inégalée pour les personnels paramédicaux, au premier rang desquels les infirmiers.
Par exemple, dès cette année, les infirmiers titulaires de la fonction publique hospitalière pourront choisir de conserver leur situation actuelle ou d’intégrer la catégorie A avec une carrière prolongée. Ceux qui opteront pour cette seconde possibilité bénéficieront, à l’issue des opérations de reclassement, en 2015, d’une majoration de plus de 2 000 euros nets en moyenne par an.
D’ici à 2015, tous les personnels paramédicaux –kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, manipulateurs radio, etc. – formés en trois ans au moins pourront bénéficier de ces dispositifs, après que leur formation aura été reconstruite conformément au standard LMD. Seront également concernés les infirmiers spécialisés, les puériculteurs, les infirmiers anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire.
Madame la sénatrice, ces mesures ont bien un caractère prioritaire, qu’il s’agisse de la reconnaissance du diplôme d’État d’infirmier au niveau de la licence, de la traduction statutaire de cette reconnaissance par une intégration des personnels concernés dans la catégorie A ou des revalorisations salariales que ces évolutions impliquent.

Il me semble qu’un certain nombre d’organismes publics, comme le Haut Conseil des professions paramédicales, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, les observatoires des professions de santé ou les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, sont en mesure d’apprécier la qualité des professionnels intervenant dans les hôpitaux. Les ordres professionnels qui sont appelés à remplir cette fonction à leur place ne répondent nullement aux attentes des personnels concernés, au-delà d’ailleurs des seuls salariés.
En outre, en ce qui concerne la reconnaissance que vous avez évoquée, les personnels infirmiers n’ignorent pas qu’un tel changement de catégorie implique un départ plus tardif à la retraite, alors qu’aujourd’hui celui-ci intervient souvent bien avant l’âge de 55 ans, en raison d’un épuisement lié à l’insuffisance des effectifs. Cette reconnaissance est donc loin de répondre à leurs attentes.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, auteur de la question n° 825, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941, aux heures les plus sombres de notre histoire. Il n’a pas été recréé depuis, mais les herboristes diplômés d’État peuvent, depuis l’ordonnance de 1945, continuer à exercer leur profession jusqu’à leur mort. Force est de constater qu’ils ne sont plus très nombreux et que la profession d’herboriste va disparaître.
Une réelle demande existe cependant : au moins deux cents étudiants chaque année souhaiteraient devenir herboristes, mais aucune formation ne leur est proposée. Le diplôme de pharmacien n’est pas adapté et les tentatives gouvernementales pour recréer le diplôme d’herboriste, en 1986 et en 1987, ainsi que les propositions de loi en ce sens n’ont jamais abouti.
Le Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne offrent des formations diplômantes en herboristerie. Avec l’apparition d’internet, les produits peuvent être commandés dans les herboristeries de ces pays limitrophes et livrées en France. Les plantes médicinales connaissent un regain d’intérêt, en raison de leur coût moindre et de leurs effets plus positifs sur la santé que ceux des médicaments chimiques.
Il existe donc une réelle demande émanant d’une population qui souhaite approcher d’autres formes de soins, moins agressifs. Pour cela, les indications d’un herboriste professionnel sont nécessaires. Les patients souhaitant recourir à ce type de soins iront probablement se procurer ces plantes auprès de fournisseurs pas forcément aptes à prodiguer de bons conseils, alors qu’un spécialiste prendra le temps d’écouter le patient, en évitant toute interaction médicamenteuse indésirable. En outre, la recréation de cette profession représente une voie d’avenir à l’heure où l’on s’alarme du déficit grandissant de la sécurité sociale.
Les préparations magistrales à base de plantes réalisées en pharmacie ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, et ce depuis 2007. Quelle est donc la logique de leur maintien sous monopole pharmaceutique ?
Soigner par les plantes suppose une véritable remise en cause des modes de pensée des médecins, des pharmaciens et des populations, et le fait que les marges des pharmaciens soient plus importantes sur les composés chimiques que sur les préparations magistrales ne va pas contribuer à élever le débat. Il faut offrir à l’herboristerie une vraie chance !
Quelles sont donc, madame la secrétaire d’État, les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour permettre un accès au diplôme d’herboriste à ceux qui souhaitent se consacrer à la médecine des simples, à des soins à moindre coût, à des soins plus respectueux de la nature ?
Comme vous l’avez indiqué, monsieur le sénateur, le diplôme d’herboriste a pratiquement disparu en France, puisqu’aucun n’a été délivré depuis 1941.
L’herboriste pouvait détenir et vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l’exception des plantes inscrites sur les listes des substances vénéneuses. Les plantes ne devaient pas être mélangées entre elles.
Actuellement, la plupart des plantes médicinales relèvent du monopole pharmaceutique et ne sont disponibles qu’en pharmacie. En effet, le pharmacien reçoit des cours de botanique au cours de sa formation, et il est donc habilité à vendre des plantes médicinales, mélangées ou non. Avec près de 23 000 officines de pharmacie réparties sur le territoire national, nous disposons d’un maillage suffisant pour répondre aux besoins de la population.
Toutefois, certaines plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, qui figurent sur une liste établie par décret, sont exclues du monopole pharmaceutique et peuvent être vendues en dehors d’une officine. Aux termes d’un décret de 1979, cette liste comprenait 34 plantes, mais, par un décret publié au Journal officiel du 26 août 2008, la ministre de la santé a porté à 148 le nombre de plantes qui peuvent être vendues en dehors du circuit officinal. Ce décret a été pris après que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé eut procédé à une évaluation de ces plantes.
Le double circuit actuel de vente – en officines pour les plantes dont l’usage comporte le plus de risques et en dehors pour celles qui ne présentent pas de danger – permet donc un accès large et sécurisé aux plantes médicinales. De ce fait, il n’est pas envisagé de le modifier.

Je redoutais une telle réponse, madame la secrétaire d’État…
Si nous revenons régulièrement sur cette question du diplôme d’herboriste, c’est parce que l’on constate que les pharmaciens ne s’intéressent pas à cette dimension de leur profession. Aujourd’hui, l’herboristerie représente environ 3 % des ventes des pharmacies et les conseils prodigués dans ce domaine sont pratiquement inexistants. De plus, sur le plan économique, la vente de plantes n’offre pas de marges aussi importantes que celle de médicaments chimiques.
Cela étant, recréer un diplôme d’herboriste permettrait d’ouvrir une voie à de nouvelles formes de médecine. Vous faites état, madame la secrétaire d’État, de la possibilité actuelle de vendre 148 plantes en dehors des officines de pharmacie, mais les producteurs et les distributeurs de ces plantes, faute d’un diplôme officiel, ne peuvent théoriquement prodiguer aucun conseil à la vente. Il leur est en effet interdit de donner des indications à visée thérapeutique.
Votre réponse me semble donc insuffisante. Je souhaiterais vraiment que l’on puisse envisager la recréation d’une formation et d’un diplôme d’herboriste, quitte à mettre en place un tronc commun en première année avec le cursus de pharmacie. Cela permettrait de répondre à une réelle attente de la population, mais aussi d’un certain nombre de jeunes désireux de suivre une formation spécifique en herboristerie.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 815, transmise à Mme la ministre de la santé et des sports.

En fait, je voudrais surtout attirer l’attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, sur les contraintes pesant sur les communes dans lesquelles a été déclarée d’intérêt public la création de périmètres de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine.
Il est évident que la présence de périmètres de captage peut constituer une contrainte importante pour les communes, en rendant impossibles les implantations industrielles, commerciales, de loisir ou de tout autre type, sans du reste que leurs habitants ne bénéficient nécessairement des eaux captées. C’est le cas, par exemple, lorsque les ressources en eau sont exploitées pour alimenter une agglomération à laquelle n’appartient pas la commune concernée. Ainsi, le territoire de la commune de Budos, dans mon beau département de la Gironde, accueille une zone de captage d’eau pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux.
Or l’indemnisation prévue dans ce cas par les articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique concerne les seuls propriétaires privés, à l’exception des collectivités publiques. En revanche, une collectivité locale peut bénéficier du régime de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Si un préjudice spécifique et anormal est avéré, il revient donc aujourd’hui à la commune de se retourner contre l’État, et non – dans le cas de Budos – contre la communauté urbaine de Bordeaux.
Je souhaiterais donc savoir, madame la secrétaire d’État, s’il est envisagé de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Madame la sénatrice, vous avez bien voulu attirer l’attention du Gouvernement sur les contraintes pesant sur les communes dans lesquelles a été déclarée d’utilité publique l’instauration de périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine, en particulier quand l’alimentation en eau ne profite pas à ces communes.
Je souhaiterais tout d’abord réaffirmer l’objectif d’un accès à une eau potable et non polluée pour l’ensemble de nos concitoyens.
Plus de 18, 5 millions de mètres cubes d’eau sont distribués chaque jour, à partir d’environ 30 000 captages. Le premier plan national santé-environnement, couvrant la période allant de 2004 à 2008, avait pour ambition l’instauration de périmètres de protection pour 80 % des captages en 2008 et pour 100 % d’entre eux en 2010. Cet objectif n’a été que partiellement atteint. Parmi les douze mesures phares du deuxième plan national santé-environnement figure, à l’horizon de 2012, la protection des aires d’alimentation des 500 captages d’eau les plus menacés, ce qui reprend l’engagement n° 101 du Grenelle de l’environnement.
Pour en revenir à votre question, madame la sénatrice, les communes ne perçoivent effectivement aucune compensation financière en contrepartie des servitudes créées, la loi actuelle ne le permettant pas. Aujourd’hui, le nombre des collectivités concernées par cette situation n’est pas connu avec précision, et il est difficile d’estimer le coût que représenteraient ces indemnisations supplémentaires. Il est vrai que l’indemnisation des propriétaires privés dont les terrains sont grevés de servitudes représente un coût financier pour les collectivités.
Le retard dans la mise en place des périmètres de protection est actuellement en cours de résorption puisque, au mois de janvier 2010, 19 395 captages bénéficient de périmètres de protection, soit 57 % des captages publics d’eau destinée à la consommation humaine utilisés en France. Au total, plus des deux tiers de nos concitoyens bénéficient d’une eau issue d’un captage protégé par une déclaration d’utilité publique.
Dans ces conditions, de nouvelles indemnisations risqueraient de décourager les collectivités qui s’engagent dans cette démarche.
Il convient de rappeler que la préservation de l’eau est une obligation légale, un devoir pour les collectivités territoriales, et que l’absence d’indemnisation pour les collectivités non bénéficiaires participe du principe de solidarité en matière d’environnement. Ainsi, le deuxième plan national santé-environnement prévoit la mutualisation des actions dans ce domaine, via la mise en place, à l’échelon local, de communautés d’aires de protection.

J’ai bien entendu les arguments et observations du Gouvernement sur cette question, qui concerne beaucoup de petites communes en France. Pour en avoir discuté avec bien des collègues, je ne doute pas de l’importance de leur nombre, même s’il est vrai que celui-ci n’est pas connu avec exactitude.
Quoi qu’il en soit, je considère qu’un vide juridique reste à combler et que le législateur doit se saisir de cette question.
Cela étant dit, madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir clarifié la position du Gouvernement sur ce problème.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures dix.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, auteur de la question n° 735, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Ma question porte sur les abus bancaires, et plus particulièrement sur les frais de découverts facturés par les établissements bancaires.
Aujourd’hui, cinq banques se partagent 80 % du marché de la distribution des moyens de paiement et de crédit. Ces établissements se trouvent donc en position dominante à l’égard des clients. Cette situation d’oligopole conduit les banques à des abus et à des dérives, tels que la perception de frais de découvert exorbitants.
En effet, le découvert s’apparente souvent à un véritable crédit, assorti d’intérêts, d’agios et d’un taux effectif global, ou TEG, flirtant généralement avec le seuil de l’usure. Une étude fait apparaître que les commissions d’intervention appliquées lorsque le découvert n’est pas autorisé sont particulièrement élevées : elles sont comprises entre 5, 90 euros et 10 euros par opération, selon les banques.
Cette tarification paraît d’autant plus injuste que les banques ne tiennent pas compte de la jurisprudence : dans son arrêt du 5 février 2008, la Cour de cassation estime que les commissions d’intervention doivent être incluses dans le calcul du TEG, conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, ce qui n’est jamais pratiqué. Le TEG indiqué est donc erroné.
De plus, aux termes des conclusions d’un récent rapport de la Commission européenne, les banques françaises ont les pratiques tarifaires les plus onéreuses et les plus opaques pour les consommateurs. C’est ainsi que, en moyenne, la gestion d’un compte courant est facturée 154 euros dans notre pays, contre 58 euros en Belgique et 46 euros aux Pays-Bas. Les tarifs appliqués pour les découverts bancaires sont également supérieurs à la moyenne européenne.
De surcroît, malgré le plan de sauvetage de 360 milliards d’euros du Gouvernement, les banques françaises ont dû admettre qu’elles ne tiendraient pas leur engagement d’augmenter le volume des crédits accordés de 3 % à 4 % sur l’année 2009.
Pour le CERF – Créateurs d’emplois et de richesse de France – et la FNACAB – la Fédération nationale des associations contre les abus bancaires –, les banques ont en réalité délaissé leur métier traditionnel de sécurisation des fonds déposés et de distribution de crédit, pour investir des domaines plus rentables. Au final, ce sont les ménages et les TPE-PME qui paient les conséquences de la crise financière.
Monsieur le secrétaire d'État, les clients étant mal informés et désarmés, quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour favoriser l’instauration d’une tarification bancaire transparente et raisonnable et renforcer les moyens de contrôle des établissements bancaires ? Pouvez-vous nous dire si les commissions d’intervention seront enfin incluses dans le calcul du TEG ?
Madame la sénatrice, la question que vous soulevez, relative aux frais facturés par les banques en cas de dépassement d’une autorisation de découvert et au calcul du taux effectif global, est importante et préoccupe depuis longtemps tant les associations de consommateurs que les pouvoirs publics.
S’agissant de l’assiette du TEG, le code de la consommation pose aujourd’hui une règle claire : sont intégrés au TEG l’ensemble des frais, directs ou indirects, intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du crédit. Le juge a l’occasion de rappeler régulièrement la portée de cette règle, et c’est à juste titre que vous avez cité l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 à propos des frais de forçage.
Cette jurisprudence, mentionnée dans votre question, ne s’applique qu’aux frais de forçage qui sont directement liés aux crédits accordés. En revanche, elle ne s’applique pas aux commissions d’intervention. En effet, ces dernières sont facturées quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement de découvert. Ces frais ne sont donc pas liés à l’opération de crédit.
Comme la Cour de Cassation, le Gouvernement considère que les frais qui ne sont pas accessoires au crédit ne doivent pas entrer dans le calcul du TEG. Cela risquerait de faire perdre à celui-ci sa signification et son efficacité.
Pour autant, les frais bancaires pèsent effectivement sur la situation financière des consommateurs, en particulier des plus fragiles d’entre eux. Le Gouvernement est favorable à une tarification des services bancaires qui soit à la fois juste et adaptée. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà adopté une série de mesures visant à encadrer les frais bancaires.
Ainsi, le décret du 16 novembre 2007 a prévu un dispositif de plafonnement des frais pour incidents de paiement qui est entré en vigueur en mai 2008.
S’agissant des frais pour chèque impayé, le décret prévoit que le montant maximal des frais bancaires dans le cas du rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros est fixé à 50 euros. Dans le cas du rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, le plafond est fixé à 30 euros.
S’agissant des frais pour incident de paiement autre qu’un chèque impayé, le décret prévoit que le montant maximal des frais bancaires dans le cas du rejet d’un virement ou d’un prélèvement est inférieur au montant de l’ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 euros et à 20 euros pour les paiements d’un montant supérieur.
Plus largement, et au-delà de la seule question du plafonnement, le Gouvernement a mis récemment en œuvre plusieurs réformes importantes visant à accroître l’information des consommateurs sur les frais bancaires.
Depuis le 1er janvier 2009, les consommateurs reçoivent chaque année un récapitulatif annuel des frais bancaires qui ont été facturés durant l’année écoulée.
En outre, le 28 mai 2008, les banques ont pris l’engagement de mettre en place un nouveau service d’aide à la mobilité bancaire, destiné à faciliter le changement de banque.
Par ailleurs, Christine Lagarde a demandé à Emmanuel Constans, président du comité consultatif du secteur financier, et à Georges Pauget, ancien directeur général du Crédit agricole, de réaliser une mission visant à établir, en concertation notamment avec les associations de consommateurs, un diagnostic sur l’ensemble des frais bancaires.
Cette mission portera sur les pratiques des professionnels et l’usage par les Français de leurs comptes et de leurs moyens de paiement. L’objectif est d’identifier les principales causes d’incidents et les moyens, pour les clients, de mieux utiliser les services bancaires. Les découverts bancaires et les moyens de paiement feront l’objet d’une attention particulière. La question que vous soulevez sera examinée dans le cadre de cette mission, dont les conclusions inspireront le Gouvernement pour réformer, si cela s’avère nécessaire, les règles de tarification des frais bancaires.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, mais je tiens à souligner l’existence de certaines pratiques regrettables. Ainsi, le montant d’un chèque n’est crédité sur le compte en banque que trois ou quatre jours après le dépôt, alors que, entre-temps, des prélèvements automatiques ont pu intervenir et entraîner la perception d’agios en cas de découvert, fût-il d’un faible montant. C’est là que le bât blesse. Il faut absolument remédier à ces situations, dont pâtissent, en période de crise, les ménages aux budgets modestes. J’attends donc avec impatience les conclusions de la mission que vous avez évoquée.

La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 840, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais tout d’abord souligner, pour faire suite à l’intervention de Mme Schillinger, que les PME rencontrent elles aussi des difficultés liées à certaines pratiques bancaires.
Ma question portera sur les conséquences, pour les syndicats d’initiatives communaux déjà existants, de la création d’un office de tourisme par la communauté de communes.
En effet, lorsque le nouvel office de tourisme intercommunal exerce les missions d’accueil, d’information et de communication, les syndicats d’initiative communaux se trouvent purement et simplement vidés de leur substance, même s’ils avaient jusqu’alors parfaitement exercé ces fonctions.
Les textes prévoient pourtant qu’un partage des compétences entre l’échelon communautaire et l’échelon communal peut intervenir.
Si l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale de tourisme et des programmes locaux de développement touristique, de même que les actions de promotion concernant l’ensemble du territoire de la communauté de communes, doivent, tout naturellement, relever de la responsabilité de l’office de tourisme intercommunal, les missions d’accueil, d’information, de promotion touristique de chaque commune devraient pouvoir être exercées conjointement par ce dernier et par les syndicats d’initiative communaux.
Il ne faut pas perdre de vue que chaque syndicat d’initiative fédère tout un réseau de bénévoles qui apportent leur concours à la promotion de la commune. Il serait donc regrettable de casser un outil efficace qui donne entière satisfaction.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais que vous puissiez me préciser quelles initiatives vous comptez prendre pour permettre aux syndicats d’initiative de continuer à participer, à leur échelon, à la mise en œuvre d’une véritable politique touristique locale.
J’ajoute que, au-delà de la question des offices de tourisme intercommunaux, les maires ont conscience de ne plus pouvoir s’occuper de développement, ce qu’ils regrettent quelquefois. Il ne me semble pas souhaitable que leur rôle se réduise à la transmission de consignes ou à l’exercice de missions de police judiciaire – quand ils ont les moyens de les assurer !
Monsieur le sénateur, la loi apporte une réponse claire à la question intéressante que vous avez posée.
Si la compétence « tourisme » a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, avec la création d’un office de tourisme communautaire, il est clair que les organismes locaux de tourisme – offices de tourisme ou syndicats d’initiative – voient leur compétence, et donc leur existence, cesser, au nom du principe d’exclusivité.
En revanche, l’office de tourisme communautaire peut se déconcentrer sur son territoire. En effet, la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui a été adoptée à la quasi-unanimité et dont les dispositions ont été précisées par une circulaire aux préfets du 29 décembre 2009, a introduit dans le code du tourisme un article précisant que l’office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux, permanents ou non, chargés notamment de l’information touristique.
Certes, ces bureaux ne sont pas dotés de la personnalité juridique, mais ils peuvent être considérés comme un échelon déconcentré de l’office de tourisme, personne morale dont ils sont un élément constitutif. Ils peuvent être soit pérennes, soit temporaires. Il appartient aux collectivités territoriales de décider de l’organisation la plus adéquate en fonction des saisonnalités touristiques, de la localisation des centres d’intérêt attirant les clientèles et des modes de transport permettant de les atteindre.
Compte tenu de ces dispositions, le syndicat d’initiative transfrontalier de Marville, commune membre de la communauté de communes du pays de Montmédy, n’a plus d’existence légale, mais peut, le cas échéant, devenir un bureau de l’office de tourisme communautaire.
La circulaire d’application précitée de la loi du 22 juillet 2009 apporte d’autres précisions sur la simplification et l’actualisation du dispositif de classement des offices de tourisme. Cette loi réaffirme le principe de liberté organisationnelle de l’office de tourisme. Les groupements de communes ont désormais la liberté du choix statutaire. Il résulte de la circulaire que, à l’instar des communes, les syndicats mixtes ont désormais toute liberté pour déterminer le statut qu’ils souhaitent adopter en créant leur office de tourisme. Plusieurs solutions sont envisageables : la régie dotée de la seule autonomie financière, la régie qui dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public industriel et commercial, l’association relevant de la loi de 1901, la société d’économie mixte ou le groupement d’intérêt économique. Comme vous le voyez, monsieur Biwer, la palette est assez large.
En ce qui concerne la procédure de classement des offices de tourisme, le dossier présenté par la commune demanderesse est constitué conformément à un formulaire type. Le maire transmet au préfet un dossier de demande de classement approuvé par délibération du conseil municipal sur proposition de l’office de tourisme. Le préfet doit se prononcer dans un délai de deux mois à réception du dossier complet. Les formalités préalables de consultation de la commission départementale de l’action touristique et de l’union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative sont supprimées. Cette simplification est l’un des avantages de la réforme. La décision du préfet est exempte de tout avis obligatoire et se fonde sur les seuls éléments versés au dossier. Le classement est prononcé par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments que je souhaitais vous communiquer en réponse à votre fort pertinente question.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions.
Mon seul objectif est de souligner qu’il convient de permettre le maintien, fût-ce sous la forme d’annexes d’un office de tourisme communautaire, des syndicats d’initiative qui travaillent bien. En effet, leur action répond parfois à des circonstances très particulières au regard de la situation du reste de l’intercommunalité.
L’essentiel est que les syndicats d’initiative et ceux qui les animent puissent continuer à travailler. J’ai cru comprendre qu’ils pourraient poursuivre leur action – à titre bénévole…
Sourires

La parole est à M. Roger Madec, auteur de la question n° 814, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Le statut régissant l’organisation administrative de Paris, de Lyon et de Marseille résulte de la loi du 31 décembre 1982. Le nombre de conseillers municipaux et leur répartition par arrondissement ou par secteur se fondent sur le recensement de 1982.
Or, entre 1982 et 2010, la population parisienne a sensiblement évolué et la répartition des sièges de conseiller de Paris entre les arrondissements n’a pas fait l’objet d’aménagements.
J’avais déjà déposé une question écrite sur ce sujet. Je rappelle que le Gouvernement a en principe un délai d’un mois, éventuellement prolongé d’un mois supplémentaire, pour y répondre. L’absence de réponse gouvernementale m’amène aujourd’hui à poser la présente question orale.
En 2006, j’avais interrogé le ministre de l’intérieur de l’époque sur la répartition des sièges de conseiller de Paris entre les arrondissements. Faisant montre de prudence, celui-ci nous avait incités à attendre la publication du recensement général de 2008. Nous sommes en 2010, et j’espère, monsieur le secrétaire d’État, que votre réponse, dans sa prudence, ne m’invitera pas à attendre la publication des résultats du recensement général de 2013…
Paris compte 163 conseillers, dont la répartition entre les arrondissements est fortement inégale. En effet, à l’exception du XVe arrondissement, plus l’arrondissement est peuplé, moins il est représenté. Certains ratios entre le chiffre de la population et le nombre d’élus vont même à l’encontre de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
À titre d’exemples, le XIXe arrondissement compte douze élus au Conseil de Paris pour 186 180 habitants, soit un conseiller pour 15 515 habitants ; le XVIe arrondissement, avec 153 920 habitants, a treize élus au Conseil de Paris, représentant chacun 11 840 habitants ; le XVIIe arrondissement, dont la population est moindre, dispose de treize sièges de conseiller, soit un pour 12 409 habitants : force est de constater que les écarts entre les arrondissements sont aujourd’hui si importants que les Parisiens ne sont plus représentés de façon égale au Conseil de Paris. Tout un chacun admettra qu’il n’est pas normal qu’un certain nombre de Parisiens ne soient pas pris en compte dans la représentation de leur arrondissement.
Depuis le dépôt de cette question orale, la réforme des collectivités territoriales a été adoptée. Les scenarii tendent à indiquer que Paris devrait perdre 100 élus, sa représentation passant de 163 conseillers de Paris à 63 conseillers territoriaux.
Paris est une ville-département où un conseiller est à la fois conseiller municipal et conseiller général. La fusion des entités territoriales et la création des conseillers territoriaux par les articles L. 3121-1 et L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales m’amènent à m’interroger sur l’avenir des conseillers de Paris.
En premier lieu, le nombre des conseillers de Paris sera-t-il corrigé afin de compenser cette carence de démocratie ? Avez-vous des indications chiffrées à nous fournir ?
En second lieu, dans le cadre de la mise en place de la réforme des collectivités territoriales, pouvez-vous nous indiquer expressément si l’objectif est de passer de 163 conseillers de Paris à 63 conseillers territoriaux ?
Monsieur le sénateur, vous soulevez deux questions de nature différente, la première tenant aux effectifs des conseils d’arrondissement et la seconde à la représentation des arrondissements au sein du Conseil de Paris.
Les effectifs des conseils d’arrondissement échappent au droit commun des conseils municipaux et ne relèvent pas de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. En effet, comme vous l’avez vous-même rappelé, la loi du 31 décembre 1982, adoptée par la majorité socialiste de l’époque, a introduit dans ledit code des dispositions selon lesquelles « le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante ». Les arrondissements ne disposant pas des mêmes compétences que les communes, il n’est pas nécessaire de prévoir pour leur conseil un effectif correspondant exactement à celui du conseil municipal d’une commune de taille équivalente. Telle est la réponse qui a été faite par tous les gouvernements à la question que vous avez posée.
Pour ce qui concerne la représentation des arrondissements au Conseil de Paris, votre question touche à la fois au principe de l’égalité du suffrage et au bon fonctionnement tant de notre système électoral que des assemblées locales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1982, a déclaré conforme à la Constitution la loi relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Par là même, il a validé l’actuelle répartition des sièges de conseiller de Paris entre les arrondissements, qui prend naturellement en compte les écarts de population entre ces derniers.
D’autres motifs d’intérêt général entrent cependant en considération.
En premier lieu, il s’agit d’assurer ainsi le bon fonctionnement du mode de scrutin proportionnel avec application d’une prime majoritaire. Le recours à la représentation proportionnelle a pour objet de permettre la représentation de la minorité et constitue donc une garantie du pluralisme. Afin que cela fonctionne, il convient que trois conseillers de Paris au moins soient élus dans chaque arrondissement.
En second lieu, il n’est pas envisageable en l’état d’augmenter le nombre global de conseillers de Paris afin de mieux doter certains arrondissements. Le Conseil de Paris compte déjà 163 membres, ce qui en fait la deuxième plus importante assemblée délibérante de collectivité locale, après le conseil régional d’Île-de-France. L’augmentation de son effectif induirait des coûts supplémentaires et rendrait son fonctionnement plus lourd et plus complexe.
Cela étant, la loi Jospin-Vaillant de 2002 a mis en place une nouvelle forme de recensement annuel pour les grandes villes. Il en sera bien entendu tenu compte pour les prochaines élections municipales, comme il en a été tenu compte lors du découpage en vue des élections législatives.

Monsieur le secrétaire d’État, je pense que vous m’avez mal entendu : je n’ai pas demandé que l’on augmente le nombre des conseillers de Paris et je n’ai pas remis en cause l’élection d’au moins trois conseillers par les arrondissements peu peuplés du centre de la capitale.
Il sera tenu compte des résultats du recensement annuel pour les prochaines élections municipales, dites-vous ; dont acte. Cependant, je reste sur ma faim concernant la déclinaison de la réforme que vous avez portée devant le Parlement : que deviendra le statut particulier de Paris, qui est une ville-département, et quel sera le nombre de ses conseillers territoriaux ? J’espère que nous y verrons plus clair prochainement.

La parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la question n° 823, adressée à M. le Premier ministre.

Monsieur le secrétaire d’État, bien que je déplore l’absence ce matin de M. le Premier ministre, je n’en serai pas moins très attentive à la réponse que vous m’apporterez. C’est en effet pour mettre un terme à trois ans d’attente que je l’avais interrogé sur la publication du décret du 25 mars 2007 créant l’observatoire de la laïcité, décret qui reste encore sans suite à ce jour.
C’est en 2003 que, parallèlement aux travaux de la commission Stasi consacrés à la laïcité, le Président de la République de l’époque, M. Jacques Chirac, avait pris l’engagement de constituer cet organisme. L’objectif affiché était clair : mieux faire respecter la laïcité dans les hôpitaux et les services publics et surtout alerter les Français et les pouvoirs publics sur les risques de dérive ou d’atteinte au principe de la séparation des églises et de l’État.
Selon les termes mêmes du décret, l’observatoire « réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches » en lien avec la laïcité et « remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu public ».
En outre, la composition de l’observatoire doit garantir une approche transversale de la question. Celui-ci compte parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, dix personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience, ainsi que des représentants de la haute administration issus des ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la justice, de la santé, de la fonction publique, de l’outre-mer.
Je déplore que le Gouvernement saisisse chaque occasion d’instrumentaliser les questions relatives aux religions et à la laïcité, comme nous avons encore pu le voir cette semaine. Plutôt que de jouer d’effets d’annonce, il est urgent que le Gouvernement donne enfin à l’observatoire les moyens de vivre et de remplir son rôle en matière de mesure et de promotion de la laïcité. Un tel outil, à l’instar de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, est nécessaire à notre République. La laïcité, grand principe fondateur de la République et de la paix sociale dans notre pays, le vaut bien ! Trois ans après la publication du décret, qu’en est-il concrètement de l’observatoire de la laïcité ? Quand comptez-vous procéder à la désignation de ses membres ?
Madame Laborde, M. le Premier ministre vous prie de bien vouloir l’excuser.
Le Gouvernement est bien entendu extrêmement attaché au principe de laïcité. Énoncé à l’article 1er de la Constitution, il constitue l’un des piliers de notre pacte républicain. C’est assurément l’une des valeurs dans lesquelles nos concitoyens se reconnaissent le plus.
Vous l’avez rappelé, un décret en date du 25 mars 2007 avait prévu la création d’un observatoire de la laïcité ayant vocation à assister « le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics ».
Comme vous l’avez souligné, cet observatoire ne s’est jamais réuni. En effet, bien que l’attention des pouvoirs publics à ces questions ne se soit jamais démentie, il a semblé opportun, dans le contexte de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui prévoit la suppression de commissions administratives et la reconfiguration des instances chargées de veiller au respect des libertés fondamentales, de s’appuyer sur des institutions existantes, à l’autorité reconnue, plutôt que de favoriser l’émergence de nouvelles structures.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement envisage de confier à brève échéance à une institution dont les compétences pourraient utilement reprendre celles de l’observatoire de la laïcité le soin d’orienter l’action des pouvoirs publics en la matière. Cette mission pourrait ainsi être confiée au Défenseur des droits ou au Haut conseil à l’intégration. J’en prends l’engagement devant vous aujourd’hui, le Gouvernement fera connaître sa position définitive avant l’été, après avoir évalué la pertinence de ces deux options.

L’observatoire n’ayant pas été constitué à cause de la RGPP, qui est mise à toutes les sauces, il ne pouvait se réunir…
Je tiens à souligner la disparition d’un certain nombre de lieux de vigilance : plus de secrétariat d’État aux droits des femmes, bientôt plus de Défenseure des enfants. Plutôt que de créer un nouvel organisme, vous jugez préférable de recourir à une institution reconnue, mais je crains que le Défenseur des droits n’ait beaucoup de missions à mener de front à l’avenir. En tout cas, comptez sur notre vigilance !

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 754, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur la hausse vertigineuse des prix en rayons des aliments peu transformés au regard de la stagnation ou de la baisse des prix à la production.
L’abandon des prix agricoles aux lois du marché et de la concurrence a entraîné une dérégulation, mise à profit par les prédateurs de la grande distribution qui, en vérité, fixent les prix.
Une enquête portant sur les prix agricoles, tels que ceux de la volaille, du porc ou du lait, relève une hausse à la vente alors que, dans le même temps, on note une baisse du prix payé aux producteurs ; pour le lait, particulièrement, on observe une baisse de 7 % des prix à la production et une hausse de 5 % à 11 % des prix de vente. On constate évidemment des écarts suivant les distributeurs, mais on retrouve toujours la même opacité pour les étapes intermédiaires.
Pour que le consommateur ne soit plus victime de ces déréglementations qui l’inquiètent, il paraît nécessaire de fixer le prix de vente d’un produit en se fondant sur son prix agricole. Les agriculteurs, qui répondent à toutes les exigences de l’Union européenne, veulent, c’est bien le moins, vivre de la vente de leurs produits estimés à leur juste valeur, d’autant que la prochaine révision de la PAC risque de les pénaliser.
Monsieur le ministre, le Gouvernement peut-il envisager de prendre des dispositions pour lutter contre ces prix et ces marges injustifiés ? Le coefficient multiplicateur, déjà appliqué aux fruits et légumes, peut-il être étendu aux produits bruts ou peu transformés, même si je n’ignore pas qu’il ne favorise pas la concurrence ?
Monsieur Signé, vous avez raison : il faut redonner une plus grande part de la valeur ajoutée aux producteurs agricoles, qui sont aujourd'hui les acteurs les plus lésés au sein de l’ensemble de la filière alimentaire. Toute la politique du Gouvernement vise à renforcer leur pouvoir dans les négociations et à faire en sorte qu’ils récupèrent une part plus importante de la valeur ajoutée.
À cette fin, le Gouvernement présentera un certain nombre de dispositions dans le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui sera examiné en première lecture au Sénat à partir du 18 mai prochain.
Une première mesure consistera à renforcer l’Observatoire des prix et des marges, aujourd’hui simplement présent sur internet et dont les travaux ne donnent lieu à aucune suite. Je souhaite qu’il puisse à l’avenir couvrir l’ensemble des produits agricoles, prendre en compte les coûts de production et commander des études spécifiques sur la formation des marges. Il devra remettre chaque année un rapport au Parlement, qui exercera un droit de suite.
Une deuxième mesure visera à instaurer, dans chaque filière, le recours obligatoire au contrat écrit, ce qui permettra de négocier un prix plus rémunérateur qu’actuellement pour les producteurs.
Une troisième mesure tendra à renforcer le rôle des organisations de producteurs. Elles pourront alors négocier en position de force pour conclure des contrats efficaces. Une telle évolution suppose une modification du droit de la concurrence européen, car en son état actuel le droit communautaire ne permet pas aux producteurs de se regrouper de manière plus cohérente pour mieux négocier les prix, et donc les marges, avec les industriels et les distributeurs.
J’ai déjà demandé à M. Joaquin Almunia une telle modification du droit de la concurrence, dont je parlerai demain à M. Dacian Cioloş, commissaire européen à l’agriculture et au développement durable. Je souhaite que nous avancions sur ce sujet. La bataille sera longue et difficile, mais il me paraît indispensable de la livrer.
Enfin, je suis réservé sur l’extension du coefficient multiplicateur, car je crains que les inconvénients ne l’emportent sur les avantages. Les prix risqueraient de s’établir à un niveau trop élevé, au détriment du consommateur. Il convient de trouver un équilibre entre la défense des intérêts des producteurs et la valorisation de leurs marges, d’une part, et la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs, d’autre part.

Monsieur le ministre, je prends bonne note de votre réponse encourageante. Sur l’essentiel, nous sommes d’accord.
J’insiste sur le fait que le maintien de prix de vente élevés n’a, a priori, aucune justification. Cela ne profite qu’à la grande distribution et pénalise les consommateurs.
Par ailleurs, la chaîne de commercialisation des produits agricoles et le mécanisme de formation des prix doivent devenir plus transparents. À cet égard, il me paraît en effet nécessaire de renforcer le rôle des organisations des producteurs et de développer un système de nature réglementaire permettant d’encadrer les marges, dont la progression peut être injustifiée.
Enfin, si le dispositif du coefficient multiplicateur présente à l’évidence certains défauts, son extension, fût-ce pour une période limitée, pourrait néanmoins avoir pour effet bénéfique de freiner l’envolée des prix en rayons et de stabiliser le système de commercialisation.

La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 770, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, j’ai souhaité attirer votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur : l’enseignement agricole. Rapporteur pour avis de ce budget depuis neuf années, c’est toujours avec enthousiasme que je le défends. Je salue d’ailleurs votre engagement pour lui redonner des perspectives : je pense notamment à l’organisation des assises nationales de l’enseignement agricole public et à la mise en œuvre du pacte renouvelé pour cet enseignement.
À ce sujet, je souhaiterais connaître les principales orientations fixées pour les prochaines années et les suites concrètes qui seront données à ces assises, s’agissant plus particulièrement des complémentarités qui pourraient être cultivées entre le ministère de l’éducation nationale et celui de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.
En effet, un tel partenariat entre les deux systèmes d’éducation aurait tout son sens et correspondrait parfaitement à l’esprit de la loi organique relative aux lois de finances. Il permettrait de rendre plus perméables et de conforter les deux principaux dispositifs d’éducation de notre pays, tout en reconnaissant la culture et les spécificités de chacun d’entre eux.
Comme vous le savez, j’ai toujours soutenu une logique de recherche et de mutualisation en vue d’optimiser la gestion des moyens d’enseignement. Développer les liens entre les deux ministères me semble être une bonne solution. Cela contribuerait à redonner à l’enseignement agricole une place de choix au sein de notre système éducatif.
Madame la sénatrice, je tiens tout d’abord à saluer votre engagement au service de l’enseignement agricole et l’attention que vous portez à ce dossier essentiel.
Je rappelle que l’enseignement agricole, qui compte plus de 173 000 élèves, est une filière d’excellence pour notre pays : le taux de réussite aux examens s’élève à plus de 80 % et, surtout, le taux d’insertion professionnelle atteint 85 %.
Lors de la clôture des assises nationales de l’enseignement agricole public, le 10 décembre dernier, j’ai tracé les lignes de force d’un pacte renouvelé avec cet enseignement.
Ce pacte place les nouveaux enjeux de l’agriculture et des territoires au cœur de l’enseignement agricole. En particulier, l’agriculture ne pourra pas se développer demain en France sans prise en compte de ces deux dimensions vitales que sont le respect de l’environnement et le développement durable et sans amélioration de la compétitivité, notamment par rapport à notre grand voisin allemand.
Le pacte repose sur des pôles régionaux à forte identité thématique et doit s’appuyer sur de véritables complémentarités entre l’enseignement agricole, l’enseignement supérieur et la recherche. Cela n’a pas été suffisamment le cas par le passé.
Soixante mesures concrètes ont été définies dans le cadre des assises. Leur mise en œuvre a commencé et s’étalera jusqu’en 2011. J’en citerai trois, qui me paraissent emblématiques.
La première vise à la mise en place de formations professionnelles orientées vers les nouveaux métiers de la croissance verte. C’est là une source d’emplois tout à fait intéressante, qui répond de surcroît aux attentes de nombreux jeunes.
La deuxième mesure emblématique tend à la réalisation dans chaque région d’un projet pluriannuel pour l’enseignement agricole public, dans un souci de meilleure visibilité.
Enfin, une troisième mesure consiste à assurer l’accompagnement des élèves de l’enseignement technique agricole vers l’enseignement supérieur et la recherche. Il n’y a aucune raison que les passerelles ne soient pas plus importantes.
Par ailleurs, vous pouvez compter sur le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche pour maintenir et renforcer le partenariat avec l’éducation nationale, auquel vous êtes attachée, madame la sénatrice. De nombreux partenariats et coopérations sont menés, à l’échelon local, entre les rectorats et les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. La mise en œuvre par mon ministère des réformes lancées par le ministère de l’éducation nationale, notamment celle du baccalauréat professionnel, permettra de renforcer les ponts entre les deux ministères. Nous en avons souvent parlé avec M. Chatel, et je sais, madame Férat, que vous suivez ce dossier avec beaucoup d’attention.

Monsieur le ministre, je ne cacherai pas ma satisfaction devant vos annonces. J’ai le sentiment que l’avenir de l’enseignement agricole s’éclaircit.
Nous sommes à la croisée des chemins. Votre projet me semble de nature à donner à l’enseignement agricole un nouveau souffle.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 817, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Ma question a trait à la disparition du bail à colonat partiaire et à sa reconversion automatique en bail à ferme.
En 2005, lors de l’examen du projet de loi d’orientation agricole, nous avions adopté un amendement tendant à modifier le code rural et à abolir le bail à colonat partiaire dans les départements d’outre-mer. Le texte interdit l’installation de nouveaux colons et prévoit la reconversion en bail à ferme à l’expiration des contrats, qui, en général, ont une durée de neuf ans. Dans les faits, le versement d’un fermage annuel, donc fixe, se substituera à l’ancienne rémunération en parts de récolte, donc variable puisque proportionnelle.
La profession agricole s’est félicitée de la disparition du colonat partiaire, qui rend un peu de dignité aux 386 derniers agriculteurs concernés par ce système. Selon le nouveau dispositif, pour un bail signé juste avant la loi d’orientation agricole, la reconversion en bail à ferme n’interviendra qu’en 2014.
Les tendances observées ces quarante dernières années montrent un net recul, à hauteur de 92, 2 %, du nombre d’hectares exploités dans ces conditions et une diminution du nombre d’exploitants concernés, à concurrence de 95, 6 %. Tous les professionnels souhaitent la suppression rapide et définitive de ce système inégalitaire.
Dans ce contexte, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir me faire connaître les dispositions que vous comptez prendre pour accélérer la disparition du colonat partiaire.
Comme vous l’avez rappelé, madame la sénatrice, la loi d’orientation agricole de 2006 a rendu impossible la conclusion de nouveaux baux à colonat partiaire en outre-mer. Je partage votre appréciation : c’est une bonne chose, et c’est aussi une question de respect de la profession agricole.
Cette mesure permet aujourd’hui au métayer titulaire d’un bail en cours d’assurer la gestion de son exploitation. Elle lui permet également de demander à bénéficier de la conversion automatique de son contrat en bail à ferme, soit lors du renouvellement du bail, soit lorsqu’il est en place depuis huit ans et plus. Dans ces conditions, cette forme de bail est donc appelée à disparaître en outre-mer.
Au-delà de cette réponse à votre question, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner combien l’agriculture est au cœur de la stratégie du Gouvernement pour l’outre-mer. Je me bats tous les jours pour défendre l’agriculture en France et en outre-mer, où elle joue un rôle très important.
Dans le prolongement du Comité interministériel de l’outre-mer, le CIOM, du 6 novembre dernier, et sous l’impulsion du Président de la République, 40 millions d’euros seront, dès 2010, consacrés à la diversification et au développement des filières agricoles.
L’accent sera mis sur l’augmentation de la production, sur la baisse des coûts pour le consommateur de produits locaux et sur la consolidation de l’organisation économique des filières.
Je souhaite également que nous développions des réflexions sur des filières particulièrement prometteuses pour l’outre-mer, comme l’aquaculture, la pêche et le bois.
Par ailleurs, 630 millions d’euros seront consacrés, sur la période 2007-2013, à la modernisation des exploitations, à l’amélioration de leur compétitivité et à l’intégration des enjeux agro-environnementaux, qui ont aussi une importance majeure en outre-mer.
Madame la sénatrice, vous pouvez compter sur le Gouvernement pour continuer à soutenir activement la modernisation de l’agriculture ultramarine. J’entends d’ailleurs me rendre sur place dans les meilleurs délais pour constater les résultats de ces efforts et chercher les moyens de les améliorer.

Monsieur le ministre, il est vrai que l’agriculture a une grande importance dans les départements d’outre-mer.
Si la profession agricole souhaite une disparition plus rapide du colonat partiaire, s’agissant des contrats signés juste avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est parce que ce dispositif archaïque, qui n’avantage pas le preneur et ne l’incite pas à augmenter ses rendements, est une survivance de l’esclavage mais aussi de l’engagisme, que Victor Schœlcher a combattu et qu’il a qualifié d’esclavage déguisé.
Il est vraiment dommage de devoir attendre quatre ans encore la disparition définitive de ce système inégalitaire. Nous aurions souhaité qu’elle intervienne plus rapidement.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à midi, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.