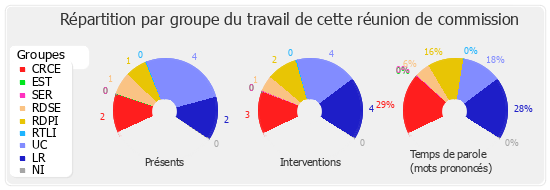Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 15 janvier 2020 à 9h35
Sommaire
La réunion

Nous commençons nos travaux relatifs à la restitution des biens culturels en accueillant M. Jacques Sallois, ancien directeur des musées de France, ancien président de la Commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art (CRDOA) et président de la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) jusqu'à une date très récente. Son mandat est arrivé à expiration en janvier 2019 et il avait indiqué au préalable qu'il ne souhaitait pas conserver ces fonctions. Depuis lors, aucun successeur n'a été nommé.
En décembre dernier, je vous ai présenté mon activité au sein de la CSNC, où je représente le Sénat. Créée par la loi de 2002 relative aux musées de France - texte pour lequel le Sénat s'était beaucoup impliqué et dont Philippe Richert était rapporteur -, cette instance est notamment chargée d'autoriser le déclassement d'un bien entré dans les collections des musées de France, afin de conserver une certaine souplesse dans l'application du principe d'inaliénabilité des collections. Son rôle a été renforcé par la loi de 2010 sur les têtes maories, texte issu d'une proposition de loi que j'avais déposée : avant cette date, la CSNC ne fonctionnait tout simplement pas.
Le Gouvernement a récemment annoncé son intention de supprimer cette commission dans le courant de 2020, sans préciser si elle serait remplacée par une nouvelle instance. Or, d'ici à la fin de l'année, il pourrait également déposer un projet de loi pour faciliter la restitution d'oeuvres d'art à l'Afrique, en réponse aux revendications présentées par plusieurs pays et à la promesse, formulée par le Président de la République dans son discours à l'université de Ouagadougou le 28 novembre 2017, de rendre possibles d'ici à 2022 des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain aux pays concernés.
Monsieur Sallois, nous sommes particulièrement heureux de bénéficier de votre grande expertise sur ces questions. J'ajoute que vous avez été chargé d'une mission de médiation en 1999 dans l'affaire des manuscrits coréens. Je vous cède la parole pour vous laisser dresser le bilan de l'action de la CSNC et évoquer avec nous l'épineux problème posé par les restitutions.
Ma dernière venue au Sénat remonte au 16 mars 2015 ; je rendais alors à votre commission le premier rapport annuel d'activité de la CSNC. J'étais également venu devant vous en 2014, en tant que président de la CRDOA, créée en 1998 à la suite d'un rapport extrêmement sévère de la Cour des comptes quant aux carences des inventaires des musées. C'est essentiel : on ne peut pas parler d'inaliénabilité si les inventaires ne sont pas bien tenus. Par définition, sans inventaire rigoureux, il ne saurait y avoir de déclassement.
Il y a près de quarante ans, j'étais venu pour présenter à Henri Caillavet le budget du ministère de la culture pour 1982. Entre-temps, j'ai présenté, en 1992, le premier projet de loi Musées devant Maurice Schumann, texte abandonné après les élections législatives de mars 1993, mais que la loi de 2002 a repris pour ainsi dire in extenso. En outre, entre 1984 et 1988, j'ai débattu au Sénat du budget de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar) avec Jean François-Poncet ; et, dans les années 2000, j'ai remis divers rapports à Jean Arthuis en ma qualité de président de la septième chambre de la Cour des comptes. Je n'ai jamais eu les mêmes rapports avec l'Assemblée nationale et, au fil du temps, je suis ainsi devenu un fervent bicaméraliste !
L'an dernier, j'ai démissionné de la présidence de la CRDOA, après dix ans d'activité et en rendant un épais rapport publié par la Documentation française. De plus, j'ai demandé que mon mandat ne soit pas renouvelé à la tête de la CSNC : je me présente donc devant vous avec la plus grande liberté, mais aussi avec beaucoup de prudence, n'étant pas sûr d'être au fait des tout derniers développements en la matière. De plus, les deux sujets que vous m'imposez sont immenses et s'inscrivent dans des perspectives fort différentes.
Au sujet de la CSNC, j'aborderai quatre points.
Tout d'abord, la création de cette commission a fait suite à deux échecs successifs : quoique prévue dans le texte de 1992-1993, puis, grâce à M. Richert, dans la loi de 2002, cette instance n'avait jamais siégé.
Madame la présidente, vous vous en êtes formalisée lors du débat relatif aux têtes maories et, grâce à votre initiative, la CSNC a enfin pu voir le jour. Toutefois, la gestation a été longue : votre proposition de loi a été déposée le 8 février 2008 et la loi a été votée le 18 mai 2010. Puis, l'accouchement a été particulièrement difficile : il a duré trois ans et demi. Après la publication du décret, en février 2011, il a fallu plus de deux ans pour nommer les membres de la commission - le choix du président s'est révélé singulièrement délicat pour les autorités successives - et neuf mois supplémentaires pour que la première réunion ait lieu - la CSNC a d'ailleurs été installée, non par le ministre de la culture, mais par le directeur général des patrimoines.
En mars 2015, je suis venu rendre compte devant vous de la première année de fonctionnement de cette commission.
Dans mon rapport, je rappelais le principe d'inaliénabilité des collections publiques et les conditions limitées dans lesquelles des déclassements pouvaient intervenir. Je rappelais également les compétences de la commission, qui étaient à la fois élargies à l'ensemble des collections publiques et réduites puisque la commission n'avait à traiter, ni des biens spoliés dont les musées ne sont que les gardiens, ni des transferts de propriété entre l'État et les collectivités territoriales pour tous les dépôts faits par l'État avant 2010, ni pour les restitutions d'oeuvres d'art.

Le législateur avait souhaité que la commission travaille aux critères de déclassement, le déclassement étant un préalable à toute restitution.
Certes, mais la commission n'était saisie qu'au moment du déclassement éventuel.
Nous avons formulé des recommandations pour chaque catégorie de biens - les collections des musées, de la Manufacture de Sèvres ou du musée de l'armée posent des difficultés très différentes. Nous avons notamment préconisé que chaque dossier soit étudié par les personnes chargées de la conservation des biens avant leur envoi à la commission, et que toutes les solutions alternatives au déclassement soient préalablement évoquées.
Il y a deux ans, j'ai décidé de ne pas demander le renouvellement de mon mandat. Dans une lettre adressée à la ministre, j'expliquai que cette commission a été conçue de manière à ne pas fonctionner. En effet, elle comptait 40 personnalités réparties au sein de quatre collèges, si bien que le quorum n'était jamais atteint. Toutes les décisions ont dû être prises par consultation postale. Dans ces conditions, malgré les critiques qui ont été formulées sur le nombre limité de réunions et d'avis rendus, je me félicite de notre bilan.
Nous n'avons été saisis d'aucun cas de musée, à l'exception du musée de la défense, dont seuls deux fusils Lebel ont été déclassés.
Nous avons également été saisis du cas du musée de Saint-Cyprien, dont le maire, qui avait frauduleusement acheté des collections, s'est suicidé en prison. Nous n'avons pu rendre qu'un avis négatif, mais je regrette l'incapacité de l'administration à dialoguer dans des situations aussi douloureuses.
Tel est le résultat de nos travaux concernant les musées.
En revanche, nous avons fait oeuvre utile en matière de déclassement historique. Le Mobilier national et la Manufacture de Sèvres ont vendu pendant des décennies quantité de biens de manière totalement désorganisée. Même si beaucoup reste à faire, nous avons contribué à organiser le déclassement de ces biens.
Nous avons également réalisé un travail essentiel dans le domaine particulier des restes humains, que mon collègue Michel Van Praët évoquera tout à l'heure.
Depuis ma démission, la commission n'a plus été réunie. Le ministère de la culture, arguant du fait qu'elle n'avait rendu que neuf avis, a jugé qu'on pouvait en faire l'économie, mais il vous appartient de décider s'il faut ou non la recomposer. Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu'elle soit recomposée à l'identique.
J'en viens aux restitutions, sujet que je n'aborde qu'avec beaucoup de précautions, car, bien qu'une mission m'ait été confiée par le président Chirac et que le sujet m'intéresse, je n'ai pas de réelle compétence en la matière. J'évoquerai d'abord le cas de l'Afrique.
Avec Alpha Oumar Konaré, qui était alors président du Musée national du Mali, nous avons organisé à Lomé en 1992 le premier congrès des conservateurs des musées africains. Si les restitutions ont été évoquées, une immense demande de coopération, d'appui et d'échanges a surtout été exprimée.
J'ai également monté, avec le professeur Jean Devisse et une équipe très compétente, l'exposition « Vallées du Niger ». Celle-ci a eu beaucoup d'écho en France et elle a été présentée aux Pays-Bas, à Philadelphie et dans cinq pays africains. J'estime toutefois que nous aurions dû faire beaucoup plus dans ce domaine.
J'en viens à l'affaire des manuscrits coréens. Celle-ci a commencé, en 1993, par un coup de force du Président de la République et du ministre de la culture. En tant que directeur des musées, j'ai alors pris position contre cette manoeuvre. Cinq ans plus tard, le Président de la République m'a pourtant chargé d'une mission de médiation. Les archives de ce dossier montrent qu'une discussion de spécialistes peut se bloquer dès lors que les politiques s'en mêlent de manière inopinée et injustifiée. Il reste que, au bout de quelques années, le Président de la République suivant a balayé les efforts patiemment accomplis pour construire un compromis.
J'évoquerai également le cas des collections inuites du musée-château de Boulogne-sur-Mer. Le maire de la commune et la conservatrice du musée ont entretenu avec les communautés d'origine un dialogue confiant. Au terme de ces échanges, les Inuits ont remercié la France d'avoir si bien conservé leurs collections, qui auraient probablement été détruites à la suite de rituels si elles avaient été restituées.
Ces deux derniers exemples montrent que chaque situation est singulière et ne peut être comparée à une autre. C'est la raison pour laquelle, si je devais me prononcer, je militerais davantage pour des lois de circonstance que pour une disposition législative applicable aux restitutions. Cela reviendrait à substituer un régime de balayage à un régime d'exception.
En revanche, en matière de biens ayant un caractère militaire, un mécanisme mis en place par le législateur serait un grand progrès. En effet, ces biens ont été restitués sans tambour ni trompette par des ministres, des secrétaires d'État ou même des directeurs sans que le Gouvernement en soit informé et que le Parlement soit consulté. Il serait d'ailleurs souhaitable que l'administration concernée fournisse la liste de ces biens.
Enfin, concernant les biens qui ont un caractère vraiment muséal, l'édit de Michel de l'Hospital indiquait à Charles IX qu'un souverain ne peut aliéner les biens accumulés par les souverains précédents sans avis préalable du Conseil. Je me féliciterais que le Parlement soit ainsi sollicité, et cela avant toute déclaration publique.
La France dispose d'un réseau de musées moderne et dynamique. Ses biens bénéficient des compétences scientifiques de conservation les plus remarquables au monde. Nos musées sont ouverts sur le monde, tels le Louvre, qui, au-delà de son antenne à Abou Dhabi, résonne sur l'ensemble des continents.
Nous devons inciter nos musées à entretenir les relations de coopération les plus dynamiques.
Je regrette, par exemple, que le Musée des civilisations noires à Dakar ait été financé par les Chinois et non par les Européens. Il nous faut adopter une stratégie offensive, conforter notre capacité de rayonnement et développer une politique de l'offre plutôt que nous retrancher derrière une ligne Maginot.

Merci de ces propos liminaires extrêmement complets.
Pour la bonne compréhension de tous, je souhaite rappeler que, à l'époque, le législateur n'avait aucunement l'intention de faire de la Commission scientifique nationale des collections une usine à gaz. Il s'était simplement dit favorable à une diversification de sa composition, afin que des juristes, des penseurs et des anthropologues puissent en être membres, et ce en vue d'une meilleure appréciation du sujet.
Je regrette que le ministère ait freiné des quatre fers sur ce dossier : il a fallu trois ans pour que tout se mette en place et que l'on aboutisse finalement à une instance qui ne fonctionne pas bien. J'insiste d'autant plus sur ce point que M. Richert avait fait un constat similaire en 2002 s'agissant du fonctionnement de la CSNC, et que celle-ci a un rôle important puisqu'elle pourrait utilement éclairer le politique en cas de demandes de restitution de biens culturels.

Monsieur le président, d'après vous, on aurait empêché la Commission scientifique nationale des collections de fonctionner, ne serait-ce qu'en rendant sa composition pléthorique ? Pensez-vous néanmoins qu'il conviendrait de restaurer une telle commission avec une équipe évidemment restreinte ? Le rétablissement de la commission, sous une autre forme, ne serait-il pas le corollaire du maintien du principe d'inaliénabilité des collections publiques ?
Pensez-vous qu'il serait possible de définir des critères objectifs - si tant est que l'on puisse véritablement parler d'objectivité - de nature à justifier la restitution de biens culturels dans certains cas ?
Je voudrais évoquer les suites du rapport Sarr-Savoy sur la restitution des objets d'art africains. Ce rapport était souhaité par le Président de la République, mais nous savons tous que ses conclusions ont été exclusivement à charge. Ses auteurs ont suggéré d'inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il appartiendrait à la France désormais de prouver le caractère légal de leur acquisition pour justifier l'entrée de ce patrimoine dans les collections publiques françaises. Selon vous, quel risque une telle évolution pourrait-elle faire peser sur le principe d'inaliénabilité des collections ? Les auteurs du rapport partent du principe que la présence de l'essentiel des collections africaines hors d'Afrique pose un problème de fait. Aujourd'hui, les États africains expriment clairement leur dépit d'avoir été dépossédés de leur patrimoine, et ce à l'échelon de tout un continent.
Dernier point, je souhaite aborder le problème des « regalia » du Bénin : à qui restituer ces bronzes ? Doit-on envisager une restitution d'État à État ? Quelle procédure mettre en oeuvre sachant que, comme vous l'avez rappelé, le Président de la République a d'ores et déjà pris un engagement à ce sujet ?

J'ai grand plaisir à retrouver dans votre discours la même humanité, la même exigence intellectuelle et la même distance par rapport à certains comportements corporatistes que celles dont vous faisiez preuve en tant que directeur des musées de France.
Ayant travaillé au ministère de la culture, je me souviens que le principe d'inaliénabilité des collections suscitait déjà des interrogations à l'époque. Très souvent, il était reproché aux conservateurs de garder certaines oeuvres dans les dépôts, alors qu'il aurait été sans doute plus intéressant de les vendre, un peu sur l'exemple de ce que font certains musées américains, voire de les diffuser plus largement. Le principe d'inaliénabilité était souvent perçu comme une résistance corporatiste de la profession, qui souhaitait conserver la mainmise sur les collections.
Je trouve au contraire qu'il serait intéressant de considérer, comme vous le faites, que le principe d'inaliénabilité permet de tendre vers une meilleure coopération. Le fait de détenir des collections est un levier pour développer des échanges avec des pays dont les moyens sont bien moindres. Il conviendrait d'avoir une vision plus universaliste de notre patrimoine, car il n'est pas seulement celui de la France : c'est celui de l'humanité.
Monsieur Schmitz, la commission ne devrait sans doute pas être rétablie dans sa forme actuelle. Cela étant, je ne sais pas très bien quelle forme elle pourrait prendre. Votre initiative de lancer une mission d'information, à l'image de ce qu'avait fait l'Assemblée nationale en 1998 en amont de la loi Musées, me semble positive. Il vous appartient en effet d'organiser la réflexion. Quant à moi, je me garderai bien d'adopter une position fermée sur le sujet, compte tenu de sa complexité.
Le principe d'inaliénabilité est ancien : il remonte à la monarchie et aux débats de 1792 entre les intégristes de l'époque, qui voulaient abolir les signes honnis de l'Ancien Régime, et l'abbé Grégoire qui expliquait, lui, qu'il s'agissait des biens de la Nation, biens à conserver précieusement. Ce principe a été confirmé par la loi de 2002, ce dont je me réjouis.
La mise en place d'une commission, dont la mission consiste à restituer des biens culturels, est par nature extrêmement difficile. On peut faire des recommandations générales, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais il faut en même temps rester très ferme sur le principe d'inaliénabilité. Par ailleurs, la définition de critères objectifs pour la restitution de ces oeuvres ne peut découler que d'une très longue réflexion, car tous les cas sont particuliers.
Vous avez évoqué le rapport Sarr-Savoy : pour moi, il est absurde de prétendre qu'il faut réaliser un recensement des biens. C'est physiquement impossible ! Par définition, on ne peut pas inverser la charge de la preuve.
À qui restituer les biens ? Il s'agit d'une interrogation permanente. Vous évoquez le cas du Bénin, mais on pourrait aussi citer le Cameroun ou d'autres États africains. En revanche, il faut s'assurer que le pays qui se voit restituer un objet d'art soit aussi scrupuleux sur l'inaliénabilité dudit bien que nous l'avons été de notre côté tout au long des siècles.
Monsieur Ouzoulias, vous avez parlé de vendre certaines oeuvres. Le rapport Rigaud de 2007 a longuement traité de la question, en rappelant que cela faisait longtemps que même les musées américains ne vendaient plus leurs oeuvres. Les musées enrichissent leurs collections bien plus par des dons et des legs que par des acquisitions. Comment voulez-vous susciter ces dons et ces legs si les donateurs et les légataires ne sont pas assurés que vous n'allez pas vendre leurs oeuvres ? Soyons réalistes sur ce point.
Il faut certes défendre la vocation universaliste de nos musées, mais il faut également avoir en tête que la France a certainement l'un des réseaux de musées les plus importants au monde, et certainement l'une des collections les plus ouvertes sur le monde. Il faut poursuivre notre politique de développement systématique de relations, d'échanges et de soutien avec les autres pays. Je suis persuadé que, en agissant ainsi, nous ferons disparaître certains problèmes soulevés par des demandes de restitution ou que, en tout cas, ceux-ci seront envisagés sous un angle tout à fait différent.

Heureusement que François 1er a acheté la Joconde à Léonard de Vinci ! Si la France devait la restituer aujourd'hui, ce serait compliqué !
Elle a tout de même été réclamée !

Il est difficile d'évoquer sereinement la question de la restitution des biens culturels. Quand on s'y oppose, on est souvent taxé de raciste ou de néo-colonialiste. Au contraire, quand on y est favorable, on nous rétorque que la promesse est intenable, bien qu'il existe un droit au retour des objets sur leur territoire d'origine.
Vous avez parlé de l'Afrique : l'hypothèse de la création d'une succursale du musée Branly en Afrique a été émise. Ce faisant, ne se livre-t-on pas à une forme de néo-colonisation ? Comment faire pour éviter cet écueil tout en restituant les oeuvres culturelles ?
On ne peut pas éluder la question des restitutions, mais il existe différentes manières d'y répondre. La coopération systématique est de nature à réduire sensiblement la pression et à faire comprendre que la restitution n'est pas forcément la seule bonne réponse.
Vous avez mentionné la création d'antennes ou de musées à l'étranger. La création d'un musée à Shanghai avec l'aide du Centre Pompidou ou le musée du Louvre à Abou Dhabi sont-ils considérés comme des démarches colonialistes ? Je n'en suis pas sûr.
Quoi qu'il en soit, toutes les actions que la France et l'Europe engageront pour développer une politique d'offre et de soutien à la création d'un corps de conservateurs dans les pays tiers vont dans le bon sens.

Vous avez indiqué qu'il fallait en rester à un régime d'exception et, donc, prévoir un projet de loi par sujet. Les discussions se cristallisent sur des questions extrêmement pointues, relevant autant d'une dimension politique que des caractéristiques des biens concernés. Ne peut-on donc dégager un certain nombre de sujets d'intérêt général, pour lesquels on simplifierait un peu les choses, afin d'échapper à ces débats fallacieux qui, en définitive, engendrent trouble et confusion ?
S'agissant des objets trouvés et vendus par des personnes habitant le pays d'origine, doit-on considérer qu'ils appartiennent à la puissance publique du pays d'origine ou aux personnes qui les ont trouvés et vendus ? Je pense, par exemple, aux objets égyptiens. Dans certains cas, il n'y a pas eu vol.
Peut-on définir des critères permettant d'éviter d'avoir à traiter séparément chaque thématique ? C'est très difficile... Des catégories de biens soulèvent des problèmes particuliers : c'est le cas des restes humains, qui posent des questions culturelles, mais aussi éthiques et scientifiques. De la même manière, il y a une certaine communauté de nature entre les biens militaires. Pour le reste, franchement, je ne sais pas, et je ne crois pas que notre réflexion soit suffisamment avancée pour que l'on puisse trancher la question. C'est tout l'intérêt de la méthode que vous avez retenue : peut-être les travaux de la mission permettront-ils d'apporter un éclairage.
Le deuxième sujet évoqué est tellement complexe qu'il est difficile d'apporter une réponse. Il a donné lieu à de nombreuses discussions juridiques ; il vous revient d'en débattre.

D'après vous, il vaut mieux un régime d'exception qu'un régime de balayage. C'est là une question importante.
Très souvent sollicités par des autorités d'autres pays, nous constatons que ces dernières ne demandent pas forcément un retour des biens. Dans le cadre de mes contacts avec la Mongolie au sujet de correspondances de la période postérieure à Gengis Khan échangées avec les rois de France, par exemple, mes interlocuteurs souhaitent plutôt disposer de fac-similés et organiser une interaction autour de l'histoire de ces documents.
À l'occasion de certaines arrivées au pouvoir un peu « dures », des oeuvres ont aussi été cachées, puis envoyées vers d'autres pays, ce qui a permis leur conservation. Il faut donc également s'interroger sur la stabilité des pays demandeurs et sur l'intérêt qu'ils porteront à la conservation et la protection des objets.
Tout cela nous conduit vers des logiques de coopération, d'échange et de circulation des oeuvres, de co-formation et de co-information entre partenaires, plus que vers la simple restitution de patrimoine.

Vous n'avez pas mentionné le rôle des organisations internationales, notamment de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Une réflexion est-elle engagée à ce niveau pour tenter de dégager des principes internationaux ? La France a-t-elle intérêt à voir ce travail de réflexion mené ?
Effectivement, la coopération m'apparaît comme une nécessité. Il y a, pour aller plus loin, un travail fondamental d'approfondissement de la mémoire collective à mener. Nous ne l'avons pas encore assumé. Or une restitution sèche ne permet pas ce travail ; pour le mener à bien, il faut coopérer, travailler ensemble.
L'Unesco est un lieu de débats, mais, dans cette affaire, nous ne pouvons nous contenter de débats. La France a souvent eu un rôle pionnier dans le domaine des musées ; l'Unesco et le Conseil international des musées (ICOM) l'ont souvent suivie. C'est à nous d'élaborer une doctrine !

La Commission scientifique nationale des collections disposait-elle de moyens dédiés, humains et financiers ?
La commission ne disposait d'aucun moyen : les frais de voyage n'étaient pas remboursés et elle n'avait pas de personnel spécifique. Elle n'a jamais rien coûté - Michel Van Praët vous indiquera si la situation a été différente pour le groupe de travail sur les restes humains.

Cette absence d'un minimum de moyens n'a pas contribué, me semble-t-il, à un fonctionnement fluide.

Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Michel Van Praët, qui a assumé d'éminentes fonctions au cours d'une carrière bien remplie.
Enseignant-chercheur en biologie marine, professeur émérite du Muséum d'histoire naturelle, il est un grand spécialiste de la question des restes humains, ce qui lui a valu une nomination, en 2012, au Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et, en 2013, à la Commission scientifique nationale des collections (CSNC). Il a également occupé des fonctions à l'international, exerçant notamment au sein du Conseil international des musées (ICOM).
Vous avez mené, monsieur Van Praët, dans le cadre de la CSNC, un travail de réflexion qui émanait d'une volonté du législateur exprimée au moment du vote de la loi de restitution des têtes maories. Il s'agissait d'établir une typologie des restes humains et de dégager des critères pertinents pour permettre la restitution de restes humains. Au terme de ce travail, vous avez publié un vade-mecum sur le sujet, qui, du fait des dysfonctionnements de la CSNC, n'a pas pu être présenté officiellement et approuvé. Il nous a semblé utile que vous puissiez partager vos conclusions devant le Sénat.
Pour compléter l'intervention précédente, je rappellerai qu'un débat fort long a occupé la communauté muséale pour savoir si les restes humains étaient des collections comme les autres. Ce débat est devenu particulièrement vif au moment de la restitution des têtes maories. Certains craignaient qu'en les traitant différemment du reste on ouvre une boîte de Pandore ; d'autres, dont je fais partie, estimaient qu'il fallait examiner en quoi ces collections différaient des autres. Il faut garder ce point en tête, même si les débats actuels sont beaucoup plus apaisés.
Je préciserai également, au sujet des moyens de la CSNC, que j'ai pris en charge personnellement tous mes déplacements.
L'étude qui a été menée s'est accompagnée de réunions de travail et de formation dans les musées, les muséums et les universités. Entre 2017 et 2019, dix journées de rencontres ont été organisées par l'Office de coopération et d'information muséales (OCIM), et c'est dans ce cadre que j'ai pu me déplacer en province, outre la journée organisée à Paris. Cela a permis progressivement, à moi et à mes collègues, d'affiner notre analyse.
Très vite, la commission a considéré que la question des restes humains ne pouvait pas s'envisager simplement sous l'angle de la restitution. Au cours de l'année 2015, nous avons suggéré aux ministères de tutelle, à savoir, à l'époque, le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'essayer de mettre en place une mission spécifique sur la localisation et le type de restes humains, sur la question de savoir s'il était possible d'édicter des principes généraux et si la législation permettait de résoudre les problèmes qui se posaient.
À la fin de l'année 2015, par lettre de mission interministérielle, m'a été confiée la mise en place d'un groupe de travail, dont je peux considérer qu'il existe toujours, même si j'ai le sentiment que les attentes ont quelque peu évolué à son sujet. Ce premier rapport de la CSNC a été suivi d'un second rapport, remis aux tutelles en 2018 et qui a fait l'objet d'une réunion avec les deux cabinets conjointement à l'été 2018. Malheureusement, depuis lors, ce rapport n'a pas été officiellement remis. Il pointait la nécessité de continuer à développer en France de bonnes pratiques et de définir à cette fin un vade-mecum.
Lors de cette réunion, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé qu'il acceptait de prendre en charge son financement à travers l'OCIM. Le vade-mecum a été publié au début de l'année 2019 et a fait l'objet d'articles en mars 2019 dans deux revues professionnelles : La Lettre de l'OCIM, diffusée dans tous les musées, et Le Journal des arts. Depuis lors, je n'ai eu aucun écho de la part du ministère de la culture.
Où en sont les réflexions de cette commission ? Nous avons fourni des éléments permettant de dire que ce ne sont pas des collections comme les autres, non seulement d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue objectivement incontestable puisqu'elles ne peuvent pas être acquises comme les autres : en effet, le code civil interdisant que le corps humain puisse faire l'objet d'opérations marchandes, les collections se sont constituées essentiellement par dons et legs et elles ne peuvent être ni achetées ni vendues.
Le souhait du groupe de travail était d'évaluer ce qu'elles représentaient en France. Il ne s'agissait pas de dresser un inventaire des restes humains, opération difficile sachant qu'un corps humain compte 220 pièces. Faut-il le considérer dans son entièreté, même s'il manque certaines pièces ? Faut-il prendre en compte le fait que le crâne est une pièce majeure pour nombre de cultures ? Faut-il fixer une limite dans le temps ? Faut-il considérer les restes d'Homo sapiens ou d'Homo neanderthalensis comme faisant partie des restes humains dans les collections ou bien sont-ce des objets culturels dès l'instant où ils ont été remaniés dans le cadre d'une pratique ?
En revanche, un repérage nous semblait possible et celui-ci a été mené au moyen d'une consultation de l'ensemble des musées de France - plus de 540 d'entre eux ont répondu - et de l'ensemble des universités françaises, qui ont toutes répondu. Il en est ressorti qu'environ 250 musées et 25 universités revendiquaient la conservation de collections de restes humains, pour un total de 150 000 pièces. Pour l'essentiel - 100 000 pièces - il s'agit de pièces françaises et d'ordre archéologique.
L'essentiel des 50 000 autres pièces est constitué de pièces d'anatomie humaine et d'anthropologie physique - probablement plus de 30 000 -, situées essentiellement dans des universités et des musées d'histoire naturelle ou des musées ayant des sections d'histoire naturelle. Ces pièces d'anthropologie physique ont été constituées pour l'essentiel au XIXe siècle à un moment où la compréhension du développement de l'embryon et du corps humain nécessitait, en l'absence de techniques d'imagerie, la fabrication de pièces anatomiques de référence.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'essentiel, voire la quasi-totalité de ces pièces, est d'origine française. Par la suite, dans le contexte colonial, les chercheurs essaient d'obtenir des pièces de telle ou telle partie du monde à des fins de comparaison et pour trancher la question de l'unicité ou non du genre humain. Celles qui viennent de l'étranger et dont les conditions de collecte posent question peuvent être considérées comme étant les plus sensibles. La restitution de certaines d'entre elles, comme la Vénus hottentote, a nécessité le vote d'une loi spécifique, même si celle-ci n'était pas nécessaire en l'absence de textes d'application de la loi relative aux musées de France.
À la même époque, la restitution d'un cacique sud-américain qui avait participé aux luttes d'indépendance et qui, après sa mort en exil en France dans les années 1830, était entré dans les collections du Museum est intervenue par simple décision administrative.
Parmi ces pièces sensibles d'anthropologie physique, quelques milliers viennent de l'étranger.
Le groupe de travail a été surpris de découvrir des pièces pouvant être considérées comme culturellement sensibles en nombre dans les musées, moins nombreuses dans les universités, à savoir l'ensemble des reliques chrétiennes - quelques milliers. Celles-ci sont souvent mal inventoriées, parce que c'est souvent simplement le reliquaire qui l'est sans qu'ait été menée une étude sur la relique elle-même.
J'en viens au cas particulier des pièces d'égyptologie. Nous avons été surpris d'en dénombrer nettement plus que ce qu'en disaient jusqu'alors les ouvrages spécialisés -plusieurs centaines. Ces pièces ont été rassemblées vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe, quand la mode était à l'égyptomanie. Ces pièces ont souvent été dissociées, tel musée préférant acquérir un sarcophage pour des raisons culturelles et tel autre un squelette pour des raisons d'anatomie comparée et d'anthropologie. Il y a là un champ d'études intéressant.
Guimet a voulu constituer son musée des religions à Lyon, avant de créer son musée à Paris puis celui de Lyon, qui a servi de base au musée Guimet, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Lyon et du muséum de Lyon, ancêtre du musée des Confluences ; on y dénombre plus de momies qu'à celui de Paris. Le « fouilleur » qu'avait financé Guimet se flattait d'avoir fouillé 20 000 sépultures, ce qui explique que le Louvre et le musée de Guimet aient été submergés. Le Louvre et le Museum se partageaient l'un des sarcophages, l'autre les squelettes, y compris les squelettes d'animaux, importants à l'époque dans l'étude de l'évolution biologique. Aujourd'hui, de nombreux musées de France possèdent, sous une forme ou sous une autre, un reste humain ou un élément de parure d'un reste humain. Il faut également savoir que le produit de ces fouilles est constitué en majorité des pièces coptes.
Les pièces les plus sensibles sont donc celles qui ont été collectées en tant que pièces d'anthropologie, à une époque où on ne distinguait ni anthropologie physique ni anthropologie culturelle, et qui sont aujourd'hui considérées comme des pièces d'anthropologie culturelle, constituées en totalité ou en partie, de restes humains. Ces pièces sont très peu nombreuses, même si elles font le buzz : au plus quelques centaines et en tout état de cause moins de mille - et le musée du quai Branly en compte assez peu.
Parallèlement à ce repérage, nous avons essayé de définir des critères généraux permettant de regrouper ces pièces. Parmi les restitutions ou réinhumations qui sont intervenues, il en existe deux dont on ne parle jamais.
D'une part, les pièces qui sont à l'origine de la création de la compagnie des guides de Chamonix. Au XIXe siècle, en l'absence d'une telle compagnie, les scientifiques désireux d'entreprendre des expéditions scientifiques payaient des guides pour les accompagner. Les corps de plusieurs guides décédés lors de l'ascension du mont Blanc ont été retrouvés dans l'entre- deux-guerres, quand le glacier les a rejetés. Dans un premier temps recueillis par le musée d'Annecy, ces corps, à la suite d'une polémique, ont été réinhumés. Cette restitution s'est faite par voie administrative dans l'entre-deux-guerres sans difficulté, mais au terme de nombreux débats.
D'autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'anatomiste nazi qui dirigeait le service d'anatomie de l'université de Strasbourg avait mené des expérimentations sur des cadavres de juifs exterminés très « proprement » dans un camp des Vosges. L'idée complètement déviante de ce conservateur était de garder trace, au moyen d'un musée, d'un groupe humain qui allait disparaître. Numérotés et conservés, ces corps ont été inhumés au cimetière de Cronenbourg après la guerre, là encore par décision administrative et sans que cela soulève le moindre problème.
Dans l'affaire de la Vénus hottentote, une loi a été votée. D'autres restitutions ont été autorisées par voie administrative durant la même période. Je citerai aussi la restitution de têtes maories, notamment celle de Rouen, et plus récemment le retour de deux pièces kanakes en Nouvelle-Calédonie ; néanmoins, ces pièces appartenaient à une association et non au patrimoine national.
Dans tous les cas, la restitution a porté sur des restes d'individus que nous pouvions identifier ou dont nous pouvions identifier l'appartenance à une communauté - au sens de famille. Ces éléments ont été déterminants pour justifier la restitution, outre le fait que l'intérêt scientifique de ces pièces n'était pas toujours établi en vertu du code du patrimoine. Et les restitutions ont toujours été réalisées à la demande d'un État démocratique relayant le souhait d'une famille ou d'une communauté culturelle.
Des discussions ont eu lieu à ce propos au sein du groupe de travail et trouvent leur prolongement dans le rapport, car il nous semble essentiel qu'un examen soit systématiquement effectué pour relier chaque pièce à son origine ou à un mode d'acquisition précis et à une communauté ou à une famille. En tout cas, le simple critère de la perte d'intérêt public ou scientifique, s'il peut simplifier les choses, n'est pas suffisant en lui-même ; une pièce peut avoir un intérêt réel et être restituée. Ce critère fera sans doute l'objet de nombreux débats entre les différents points de vue au sein de votre commission.
Aujourd'hui, compte tenu du cadre législatif et réglementaire en vigueur, la situation en matière de restitution des restes humains est nécessairement bloquée, puisque les restes humains présents dans les collections proviennent en grande partie de dons et de legs. Or le code du patrimoine précise que ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, en vertu d'un principe juridique qui est central. Nous avions proposé de faire évoluer le droit pour permettre la remise en cause de l'acquisition en sollicitant son annulation auprès du juge.
Le ministère de la culture avait envisagé d'introduire cette possibilité dans le cadre du projet de loi sur la liberté de la création, à la fois pour les pièces acquises de manière illicite, les restes humains et les possessions du IIIe Reich. Il y a finalement renoncé pour ne pas alourdir ce texte législatif déjà dense.
S'agissant des restes humains, je crois que le juge serait tout à fait à même de décider s'il y a lieu de procéder à l'annulation de l'acquisition ou non. Les collections de restes humains sont différentes des autres, car nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, et la valeur des dons et des legs de ce fait est subtile et discutable. Des critères simples pourraient être utilisés à l'appui de l'annulation, à laquelle il pourrait être procédé dès lors que les restes sont identifiés, que la demande est justifiée et soutenue par un État souverain et que cette restitution permettra d'engager avec le pays demandeur une réflexion commune sur ce que représente la restitution.
Les pièces relevant de l'archéologie - il y a un spécialiste parmi vous - se trouvent aujourd'hui dans une situation quelque peu absurde. Une circulaire prévoit que les restes humains font partie, non du matériel archéologique, mais de la « documentation », le but étant que ces pièces puissent être récupérées par les propriétaires des terrains. Toutefois, à la moindre contestation, la décision serait cassée. Or sont concernées près de 100 000 pièces. C'est pourquoi, outre la question de la stricte restitution, la clairvoyance politique, au sens noble, impose de donner aux restes humains issus de l'archéologie un statut plus digne.

En 2002, Philippe Richert s'était également ému de la situation des restes de la Vénus hottentote au Muséum national d'histoire naturelle et avait déclaré qu'il fallait absolument faire quelque chose. Depuis, des travaux ont été engagés, notamment grâce aux recherches de Marie Cornu, sur le mode de conservation des restes humains à travers les musées de France, travaux qui ont abouti à la formalisation de plusieurs critères pour la restitution.
Parmi les critères retenus pour les têtes maories, d'autres ont été ajoutés, car les restes pouvaient avoir fait l'objet d'une patrimonialisation forcée - c'est le cas des têtes maories - et de trafics barbares des butins de guerre. Dans ces cas, il n'était évidemment question ni de legs ni de dons. Or des pièces anthropologiques se trouvent encore au musée de l'Homme.
Nous sommes régulièrement sollicités au travers des groupes d'amitié interparlementaires comme le groupe d'amitié France-Australie. Les demandes récentes en ce sens sont de plus en plus fortes. Certes, il existe des lois de circonstances, mais leurs contenus doivent être très précis et éclairants pour éviter que nous n'ouvrions la boîte de Pandore.

Monsieur le directeur, je vous remercie de votre propos liminaire, qui nous donne des éléments instructifs sur des problèmes juridiques non résolus à propos des restes humains. Vous avez parlé de ceux qui font partie des collections publiques après les fouilles. Avant qu'ils n'entrent dans des collections, l'archéologue ne doit-il pas les réinhumer après leur découverte ? La question est d'une grande complexité.
Dans le Nord et dans l'Est, des opérations visent à réenfouir les restes de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale dans des cimetières militaires de chacune des nations belligérantes à l'époque. Pour la période médiévale, les restes sont parfois réenfouis avec des croix, mais pas toujours. Pour l'époque gallo-romaine, tout est possible : les restes peuvent être présentés dans des musées ou être réenfouis dans des cimetières catholiques, ce qui n'était pas le cas au IIe siècle après Jésus-Christ. Deux tombes musulmanes du VIIe siècle après Jésus-Christ pourraient être réinhumées par la communauté maghrébine, qui aurait la possibilité de revendiquer une cérémonie selon son rite et sur le lieu d'origine des restes. Quant à la préhistoire, réinhumer l'Homo sapiens sapiens en Dordogne n'aurait plus vraiment de sens...
En réalité, le choix est laissé à la libre appréciation de l'archéologue. À quel moment et sous quelles conditions faut-il procéder à l'inhumation des restes humains ? Ce problème reste entier ; il faut le traiter dès maintenant même si la situation est délicate, sinon il se reposera plus tard.

Monsieur le professeur, je vous remercie de votre intervention. Pensez-vous que la CSNC ait un sens ? Convient-il de la reconstituer si elle venait à être supprimée, en en modifiant éventuellement le périmètre et en l'allégeant, pour qu'elle soit enfin efficace ? Les restes humains ne sont pas des collections comme les autres. Quelle est la position des autres États européens ? Et quels sont les pays qui revendiquent le plus la restitution de restes humains ?
La situation a beaucoup évolué depuis l'époque où M. Richert s'était ému de la situation des collections. Aujourd'hui, les collections du musée de l'Homme et du musée du quai Branly sont gérées de manière remarquable. Pour le reste, les collections sont majoritairement traitées, avec les moyens mis à leur disposition, par des professionnels soucieux de garantir la dignité. Le seul risque encouru est celui de l'abandon d'une collection, oubliée ou cachée. Si la valorisation des pièces est également importante, en particulier du point de vue historique ou sociologique, c'est parce qu'elle est le préalable à toute restitution.
Monsieur Ouzoulias, je partage votre point de vue sur les collections archéologiques, qui est un point sensible de la restitution des biens culturels en Allemagne. De nombreuses familles réclament que le corps d'un de leurs parents faisant partie de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale ne soit pas inhumé près de celui des SS. Elles souhaitent une reconnaissance. Or les corps de certains soldats, y compris croates ou musulmans, ont été regroupés outre-Rhin, une pratique qui n'a pas cours en France.
Dans notre pays, les restes humains ont été conservés en fonction du choix effectué, au cas par cas, par les conservateurs. Au musée d'Aquitaine, du fait de sa foi catholique, une conservatrice a pris elle-même la décision d'inhumer des momies coptes. Et l'on a perdu la trace de ces restes...
À mon sens, à côté du conflit lié aux dons et aux legs, il existe, plus globalement, un conflit entre les normes existantes. En effet, on a spontanément recours en premier au droit de la famille, en particulier pour l'archéologie militaire. C'est également le cas pour les fouilles récentes. Or, lorsqu'on examine les critères de restitution, il faut aussi prendre en compte des règles applicables en matière de droit de la famille quand il s'agit de pièces d'anthropologie françaises, car cet élément est très important.
Sur les autres sujets pour lesquels la commission scientifique telle qu'elle a été constituée par les textes d'application devait se prononcer, on peut saluer M. Jacques Sallois, car il a réussi à la faire fonctionner en dépit des nombreux obstacles. Une rupture a été opérée entre le texte de loi et les mesures d'application.
Si chaque cas mérite un examen scientifique particulier, il est indispensable qu'existe une commission plus fonctionnelle et moins large comme référence permanente, notamment pour maintenir la réflexion auprès de l'administration. De fait, à toutes les périodes et sous toutes les majorités, les différents ministères impliqués adoptent des points de vue différents ; ce n'est aucunement un problème, mais, face à cette diversité d'approches, il est bon qu'une réflexion constante suive son cours.

Notre assemblée entamera sous peu l'examen du projet de loi Bioéthique : n'y a-t-il pas des outils législatifs à instaurer dans ce cadre, notamment en ce qui concerne les restes humains ?

L'intérêt scientifique n'est pas une notion facile à cerner, d'autant qu'il évolue avec la science. Voyez les momies : plus on avance, plus on arrive à reconstituer l'histoire et les généalogies de pharaons. Peut-on concevoir des procédures qui n'obèrent pas l'avenir de la recherche, tout en restituant les restes humains quand les conditions sont réunies ? En d'autres termes, peut-on conserver certains éléments biologiques ou descriptifs tout en faisant droit aux considérations éthiques ?

Je voudrais revenir sur la légitimité des demandes portant sur des restes humains. S'agissant de la dimension communautaire, on peut penser à la communauté religieuse, mais aussi ethnique. À cet égard, certains États sont pluralistes et reconnaissent des droits aux peuples autochtones : le Canada, qui en fait partie, pourrait-il revendiquer des restes inuits ou amérindiens, ou seule la communauté concernée le pourrait-elle ? D'autres États ne sont absolument pas démocratiques, comme la Chine, qui pourrait revendiquer des objets ou des reliques humaines provenant du Tibet : sommes-nous en mesure de résister à de telles demandes, plus ou moins légitimes, quand elles sont formulées par des États puissants ?

Sans être spécialiste de ces questions, comme nos deux co-rapporteurs, je voudrais insister, en contrepoint de la notion d'intérêt scientifique dont vient de parler Mme de la Provôté, sur celle d'intérêt public. En effet, représentant des collectivités territoriales, le Sénat a peut-être une conception de l'intérêt public quelque peu différente de celle de MM. Sallois et Van Praët.
Il me semble aussi que la mission à laquelle j'appartiendrai devra s'intéresser au travail d'inventaire. Nous avons beaucoup de pièces dans nos réserves, plus ou moins cachées. Avons-nous les moyens de les inventorier ? Serait-ce ouvrir la boîte de Pandore ? La mission aura à en débattre.

Il est important de distinguer les restes humains des autres pièces à restituer. Mais comment caractériser les restes humains, étant entendu qu'un corps humain compte 220 pièces et que différents degrés de transformation ont été évoqués ?
Par ailleurs, faut-il accéder seulement aux demandes des pays démocratiques ?

Lors des débats sur la restitution des têtes maories, nous avons constaté un vide juridique. Pour préciser la question de Mme Brulin, faudrait-il inscrire dans le projet de loi relatif à la bioéthique que les restes humains ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial ?
Je me souviens que, parmi les critères évoqués il y a quelques années, il fallait que les éléments restitués ne se retrouvent pas sur les étagères ou dans les réserves d'un musée : qu'en pensez-vous ?
Enfin, les droits culturels reconnus dans les textes internationaux et transposés dans le droit français sur l'initiative du Sénat sont-ils revendiqués par les États qui demandent la restitution de restes humains ?
Le Conseil international des musées, qui regroupe environ 30 000 professionnels dans le monde, a toujours plaidé pour qu'on ne passe pas par des lois de circonstance : nous voulons que les restitutions procèdent d'une coopération scientifique et s'inscrivent dans un développement des échanges culturels. Cette démarche explique d'ailleurs certaines tensions avec l'Unesco, qui se place du point de vue des États. Pour ce qui est de la démocratie, je me garderai bien d'essayer de la définir. J'aurais dû évoquer des États souverains plutôt que démocratiques.
Il est clair que, pour une raison que j'ignore, mais à mon avis structurelle, les juristes des différents ministères ne communiquent pas entre eux. Ainsi, alors que la loi de restitution de la Vénus hottentote se préparait en même temps qu'une révision de la loi Bioéthique, il n'y a eu aucun échange sur les incidences croisées des deux textes ! Résultat : les conséquences du principe selon lequel la dignité ne s'arrête pas au décès n'ont pas été totalement anticipées par le monde du patrimoine.
À la même période, les mêmes discussions se sont tenues en Angleterre : moins d'un an après le Human Tissue Act, équivalent de nos lois bioéthiques, une série de textes a précisé le cadre éthique de la conservation des restes humains.
Comme membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), j'ai participé à la phase préparatoire de la révision de la loi Bioéthique : je me souviens que le ministère de la santé ne souhaitait nullement que des dispositions soient prises intéressant la culture. Pas plus tard que le mois dernier, un autre membre de ce comité, retraité du Conseil d'État, m'a demandé : « des restes humains patrimonialisés, qu'est-ce que cela signifie ? » Bref, il n'y a pas de contact entre les différentes approches ministérielles ! Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous pouvez faire quelque chose...
Aujourd'hui, quand j'explique devant le CCNE que les archéologues se permettent d'entreprendre des recherches sur des restes humains sans passer par la commission nationale compétente, laquelle n'a d'ailleurs nulle envie de se pencher sur les recherches des archéologues, surprise de mes collègues ! En vérité, s'il n'y a pas de conflit de normes, c'est seulement parce que chacun ignore ce que font les autres !
À la faveur de l'examen du projet de loi Bioéthique, il serait merveilleux qu'on s'interroge sur les conséquences des dispositions prises dans d'autres domaines que ceux dont s'occupe le ministère de la santé, car, visiblement, ce n'est pas l'habitude en France de croiser ainsi les points de vue...
En Angleterre, je le répète, on est allé relativement vite. Il est vrai que, dans ce pays, une grande autonomie est laissée aux établissements muséaux. En quelque sorte, l'État s'est déchargé sur les instances muséales des restitutions, au demeurant assez nombreuses.
En Allemagne, l'Association des conservateurs de musée a lancé une démarche dont est sorti un guide de bonnes pratiques. Les restitutions existent, mais la situation dans ce pays est particulière, compte tenu d'une histoire spécialement dramatique : l'Allemagne est le seul pays à avoir créé dans ses colonies des camps de concentration, destinés à fournir aux musées des corps d'indigènes en bonne santé. Il y avait même des cartes postales qui montraient le départ des caisses du Bostwana...
Les États-Unis suivent une logique fédérale et communautariste dans le cadre du Native American Graves Protection Act (NAGPRA), dont il y aurait beaucoup à dire.
Par ailleurs, certains pays demandent des restitutions sans qu'il y ait forcément un accord en leur sein. Par exemple, les autorités aborigènes sont réservées sur la forme de certaines demandes de l'État australien. Elles souhaitent plutôt développer des recherches avec les professionnels des pays détenteurs pour améliorer les connaissances sur les restes, voire envisager leur restauration. Surtout, ces autorités sont fortement opposées au projet de l'État australien de créer une sorte de Mémorial national, qui ne serait qu'un geste par rapport aux drames qui se sont poursuivis, bien après la période coloniale, jusque dans les années soixante.
Les restes de cinq Inuits sont conservés dans nos collections nationales. Sous la présidence de M. Hollande, un accord a été signé entre le Premier ministre canadien et la France pour faciliter le retour de ces restes. Les Inuits sont venus se recueillir devant les collections du musée de l'Homme. Ils ont fait remarquer que par rapport à leur culture les restes devraient plutôt être conservés allongés que debout. Mais à ce jour, ils n'en ont toujours pas demandé leur restitution, alors même que l'établissement et son ministère de tutelle y étaient favorables.
Lorsque des échanges se mettent en place, la restitution devient finalement seconde par rapport à la coopération naissante. Le silence n'est jamais une bonne façon de gérer un dossier. En ce qui concerne la restitution des crânes de résistants algériens de la période du XIXe siècle, après la défaite d'Abdelkader, on peut comprendre la position de l'État qui la souhaite, même si on ne la partage pas. Il s'agit d'individus qui ont été considérés comme des résistants dans un contexte historique qu'il faudrait retravailler. Bien sûr, le fait qu'il y ait bien plus de pièces algériennes de cette époque dans les collections françaises peut poser problème. S'il s'agit de faire de l'anthropologie comparée, ces pièces d'origine kabyle renvoient à des individus qui ont été des auxiliaires de l'armée française. La difficulté existe aussi en ce qui concerne les pièces qui viennent des hôpitaux d'Alger ou d'Oran, dès lors que c'était la puissance coloniale qui construisait les hôpitaux. On ne peut pas faire l'économie d'un travail sur l'histoire du pays pour traiter ces questions.
On a pu le constater lors de la restitution des têtes maories. Au départ, il s'agissait simplement de les rendre à la communauté à laquelle elles appartenaient, d'après les tatouages retrouvés. Or, on a découvert que ces tatouages avaient en réalité été réalisés par la communauté sur un prisonnier. Des collaborations se sont développées entre le musée Te Papa Tongarewa, la Nouvelle-Zélande et les musées français, qui ont donné lieu à des échanges et à la venue d'artistes.
Si la restitution se fait de manière silencieuse et creuse, elle est une perte pour tout le monde. Pour les aborigènes australiens, il est évident qu'il faut étudier les pièces qui les concernent, mais pas seulement du point de vue anglo-saxon. Un regard autre, français par exemple, enrichirait l'interprétation. Il est clair que la restitution doit se faire dans une démarche collaborative.
Quand on parle de 220 pièces, il ne s'agit que des squelettes, et on ne prend pas en compte le coeur, le foie, les cheveux ou les ongles. Le repérage qui a été effectué par le groupe de travail consistait surtout à identifier les types de collections présentes dans les musées.
L'intérêt public se définit selon des points de vue multiples, ce qui peut susciter des troubles. Quant à l'intérêt scientifique, il est difficile à cerner, car si vous mettez trois scientifiques ensemble, trois points de vue différents se dégageront. Si vous en mettez mille, vous obtiendrez une moyenne. Le principe reste d'éviter qu'une restitution ne crée des trous dans la connaissance.
La science étant une construction culturelle, le regard que l'on porte sur tel ou tel objet évoluera forcément au fur et à mesure que se développeront de nouvelles idées. Au moment de la découverte des momies, on a eu tendance à les isoler de leur environnement matériel, en les séparant de leur sarcophage, notamment. On considérait alors qu'elles pouvaient servir à l'étude de l'évolution de l'humanité. Cela a été un échec. Les scientifiques ont perdu la main, et on sait désormais que les momies égyptiennes ne nous diront rien sur l'évolution humaine. En revanche, les chats momifiés ont livré des informations sur l'évolution des espèces domestiquées : l'imagerie moderne a permis d'étudier l'empreinte de leur cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, laissant voir qu'on était dans une période de début de la domestication des chats.
Le processus de restitution des restes humains ne va pas sans une démarche de valorisation globale qui permettra de définir dans quel type de collection la ranger. La documentation sur l'origine de certaines pièces australiennes est très faible ; on pourrait la compléter.
Ce qui importe, c'est que la démarche soit publique et parfaitement transparente, que ce soit au niveau scientifique, au niveau culturel, mais aussi en matière de coopération.
À mon sens, l'inventaire sur les restes humains reste difficile à réaliser. Certains restes humains sont vendus en France lors de ventes publiques : crânes, momies amérindiennes, etc. Certains considèrent en effet que les restes sont devenus des biens culturels. On trouve ainsi dans des catalogues de vente les mentions « reliure en peau humaine », « poitrine avec poils et tétons », « dos avec tatouages ». Sur ce point, l'interprétation de la loi reste à clarifier.

Merci beaucoup pour ces éclairages précis. Je peux témoigner que la restitution des têtes maories a renouvelé la coopération entre la France et la Nouvelle-Zélande. Un département Océanie a été créé au musée de Rouen. Des artistes y viennent en résidence, et l'un d'eux s'est même marié avec une Normande ! C'est le début d'une nouvelle histoire. Il faut aussi mentionner les belles expositions du quai Branly sur les Maoris, qui ont renouvelé le dialogue interculturel. En ce sens, la restitution s'inscrit dans une démarche extrêmement positive.
Qu'en est-il techniquement du rapport que vous avez établi pour la Commission nationale scientifique des collections ? J'imagine qu'il doit être validé avant d'être diffusé.
Vous disposez du rapport. Je trouve dommage qu'on ne fasse pas état de l'avancée de la réflexion. Je comprends la décision du ministre de la culture de faire du cas par cas. Sur les restes humains, le cadre de discussion doit être apaisé et collaboratif. On pourra l'étendre par la suite à toutes les restitutions. Une thèse sur la restitution des biens africains a récemment incité à regarder au cas par cas plutôt que de poursuivre une démarche globale.
De grâce, prenez l'initiative. Les travaux ont suffisamment progressé sur les restes humains pour qu'on puisse encadrer leur restitution.

Cette tendance est dans l'esprit du Sénat. Je rends hommage à M. Van Praët qui a su orienter ce groupe de travail dans une direction éclairante et positive.
Ces auditions ont fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 12 h 10.