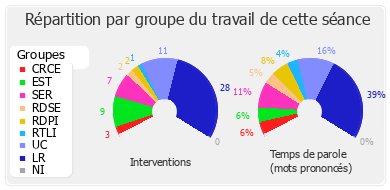Séance en hémicycle du 3 novembre 2022 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que deux candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (projet n° 889 [2021-2022], texte de la commission n° 83, rapport n° 82, avis n° 80, 70).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
M. François Patriat applaudit.
Monsieur le président, madame, monsieur les présidents de commission, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, deux tiers, c’est aujourd’hui la part d’énergies fossiles dans notre consommation d’énergie – du pétrole et du gaz, importés, pour l’essentiel, du reste du monde. Le nucléaire et les énergies renouvelables ne représentent donc qu’un tiers de la totalité de notre consommation d’énergie. Cela signifie que, à consommation égale, il faudrait multiplier par trois notre production d’énergie bas-carbone pour compenser la sortie des énergies fossiles.
2035, c’est la date à laquelle 26 de nos 56 réacteurs nucléaires arriveront au terme de cinquante années d’exploitation. Tous devront alors passer le cap d’une visite de sécurité exigeante pour être prolongés dix années de plus. Or, en matière énergétique, 2035, c’est demain !
Plus 60 %, c’est, selon Réseau de transport d’électricité (RTE), la proportion d’électricité que nous devrons produire en plus à l’horizon de 2050, si nous voulons enfin sortir des énergies fossiles, atteindre la neutralité carbone et répondre à nos besoins croissants d’électrification pour l’industrie, les transports et les bâtiments.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ces trois éléments montrent bien que nous sommes à un tournant historique. Si nous voulons atteindre la neutralité carbone, si nous voulons enfin devenir maîtres de notre destin énergétique, nous ne pourrons nous passer d’aucune énergie décarbonée – nucléaire comme renouvelable – tant la marche à franchir est haute.
Soyons clairs : lorsque je dis « renouvelables », je parle bien de toutes les énergies renouvelables – je sais que vous y êtes sensibles –, celles qui produisent de l’électricité, mais également de la chaleur – géothermie, biomasse, biométhane, éoliennes terrestres et marines, hydraulique, etc.
Ce que nous vivons aujourd’hui donne un avant-goût de ce qui nous attend demain si nous n’agissons pas. Je pense d’abord à la crise climatique, qui provoque les dérèglements que nous constatons tous : sécheresses, canicules et feux. Du reste, nous venons de vivre en France le mois d’octobre le plus chaud que l’on ait jamais connu. L’urgence est là, devant nous.
Ensuite, je pense à la crise énergétique, qui est la plus grave depuis les années 1970. Devoir importer des énergies sans en maîtriser le coût, c’est affaiblir le pouvoir d’achat des Français, c’est peser sur la compétitivité de nos entreprises et c’est réduire les capacités d’action des collectivités locales.
Pour répondre à ces enjeux, nous ne sommes pas sans solutions. Nous connaissons les leviers que nous devons actionner pour être à la hauteur du défi.
Le premier, ce sont les économies d’énergie, grâce à la sobriété et à l’efficacité énergétiques. Je ne reviendrai pas sur le plan de sobriété que nous avons annoncé avec la Première ministre. Il s’ajoute aux actions menées en matière d’efficacité énergétique. Retenons que, d’ici à 2050, nous devons réduire de 40 % notre consommation d’énergie pour atteindre la neutralité carbone.
Le deuxième est la production massive d’énergies renouvelables. C’est l’enjeu du plan pour accélérer le développement de la production d’énergies renouvelables que j’ai lancé en juin dernier. Il a permis de débloquer la production de 10 gigawatts d’électricité et d’un 1 térawatt de biométhane. Il a aussi permis de mobiliser les services de l’État, de renforcer les équipes d’instruction sur le terrain et d’accélérer les raccordements – je sais que vous êtes également sensibles à ces enjeux. Le texte qui vous est présenté aujourd’hui constitue le volet législatif du plan en faveur des énergies renouvelables que nous allons continuer de déployer.
Le troisième est le lancement d’un ambitieux programme nucléaire. C’est la proposition du Président de la République. Elle est désormais soumise à une large consultation publique. Nous travaillons à simplifier les procédures administratives afin d’anticiper la construction de nouveaux réacteurs à proximité des sites qui en accueillent déjà.
Tels sont les grands chapitres de notre stratégie énergétique. Il nous appartient maintenant de les décliner dans une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui tienne compte de la nécessité de rehausser notre ambition climatique et d’accélérer notre sortie des énergies fossiles. Nous avons commencé ce travail par le lancement, conformément à la loi, d’une grande consultation publique en octobre dernier. Elle est inédite par son ampleur, car l’enjeu est de taille. Ce travail, qui vous sera intégralement restitué, nourrira vos réflexions dans le cadre du projet de loi qui vous sera soumis en 2023 visant à mettre à jour notre mix énergétique.
Alors, pourquoi présenter ce projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables sans attendre 2023 ? Parce que nous constatons aujourd’hui que nous devrons être encore plus ambitieux pour la production énergétique. Nous ne pouvons que nous rendre compte de notre retard dans la production des énergies renouvelables. Nous devons donc le rattraper.
Vous l’avez compris, le combat à mener est celui des énergies bas-carbone contre les énergies fossiles. Ce choix s’inscrit, je pense, dans la continuité de la position de notre pays depuis le cri d’alarme poussé à Johannesburg par le président Jacques Chirac jusqu’à aujourd’hui, en passant par le Grenelle de l’environnement conduit par Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo ou par les accords de Paris portés par le président François Hollande et Laurent Fabius.
Le texte qui vous est présenté est le fruit des échanges que j’ai eus, depuis plusieurs mois, avec des acteurs associatifs et économiques, des élus locaux et des associations, ainsi qu’avec vous, très en amont, mesdames, messieurs les parlementaires des différents groupes du Sénat et de l’Assemblée nationale. À cet égard, je souhaite souligner la qualité des échanges et du travail conduit par les deux rapporteurs, Didier Mandelli et Patrick Chauvet, et par les présidents des commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques, Jean-François Longeot et Sophie Primas. Je tiens aussi à souligner la mobilisation de la commission de la culture et le travail qui a été mené par la rapporteure pour avis, Laurence Garnier.
Comme vous le savez, je n’y reviens pas, ce projet de loi vise quatre objectifs : accélérer les procédures administratives sans rien enlever à nos exigences environnementales ; libérer du foncier dégradé ; permettre une planification par grande façade maritime pour les éoliennes marines ; améliorer le partage de la valeur de ces projets et sécuriser les coûts de l’énergie au profit des habitants, des collectivités locales et des entreprises.
Le texte qui a été adopté par la commission montre qu’il existe de fortes convergences au sein des différents groupes pour aboutir à une loi facilitant le déploiement des projets d’énergies renouvelables, remettant les collectivités locales au cœur de la planification énergétique et visant un haut niveau d’exigence en ce qui concerne le nombre de projets réalisés.
Des enrichissements ont été apportés, pour élargir certaines mesures au biométhane ou ajouter un article sur l’agrivoltaïsme reprenant une proposition de loi largement votée sur ces travées par exemple ; nous les soutiendrons bien volontiers.
Reste toutefois à résoudre la question la plus difficile : celle de savoir comment l’État, les élus locaux et les porteurs de projet travailleront ensemble pour permettre le développement – certes rapide, mais raisonné et équilibré – des énergies renouvelables. Du reste, l’implantation des projets au cœur des territoires suscite plusieurs questions : comment les projets répondent-ils aux besoins énergétiques des territoires ? Comment mobiliser et associer les acteurs locaux à leur élaboration ? Comment minimiser autant que possible leurs effets sur la biodiversité et leurs nuisances sur les communes voisines ? Comment ces projets se fondent-ils dans le paysage et comment les faire bien cohabiter avec les riverains ?
Au regard des retours d’expérience en la matière, certains projets sont incontestablement des succès, d’autres ne le sont guère – nous devons le reconnaître. Ces échecs expliquent les réticences manifestes, à raison, de territoires qui ne souhaitent pas connaître les mêmes difficultés. Cela doit nous faire réfléchir sur une nouvelle méthode de conduite de ces projets. Je crois pouvoir dire, au regard de mes nombreux échanges avec vous, ainsi qu’avec des élus locaux et des associations d’élus, que nous partageons unanimement ce diagnostic.
Le constat d’un indispensable changement de méthode est à l’origine de nombreux amendements – nous allons les examiner – qui encadrent plus fortement les projets d’énergies renouvelables, mais, je le crains, au risque de les freiner.
Dans ce contexte, notre responsabilité commune est bien de prendre en compte ces réticences, tout en veillant à ne pas céder à la tentation de l’immobilisme, mais encore faut-il savoir comment.
Notre vision de la planification énergétique n’est pas descendante, bien au contraire. Nous appelons de nos vœux une planification remettant les collectivités locales et les territoires au centre des décisions. À cet égard, je serai très claire, le Gouvernement ne reviendra pas sur la suppression de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par le préfet.
Je m’y étais engagée auprès de vous, monsieur le rapporteur, et auprès des associations d’élus.
La planification que j’appelle de mes vœux fait des élus des partenaires et leur donne les leviers pour agir.
Comprenons-nous bien : monsieur le rapporteur, je vous rejoins sur le fait que les maires doivent avoir le dernier mot sur des projets structurants pour leur territoire. Mais cette possibilité doit être précédée par une volonté de planifier le déploiement de ces projets d’énergies renouvelables – et cela peut se faire en s’appuyant sur les documents d’urbanisme. Nos élus peuvent davantage pour nos énergies. Planifier, c’est plus orienter qu’interdire.
Les élus nous demandent de les accompagner dans le déploiement des projets – nous voulons le faire ! disent-ils. Selon eux, l’État doit donner le cap pour l’ensemble du pays et être facilitateur auprès de chaque territoire.
Eh bien, c’est le sens de l’amendement n° 647 du Gouvernement. Il vise à permettre aux élus de définir des zones prioritaires pour les énergies renouvelables au niveau des schémas de cohérence territoriale (Scot), tout en maintenant les dispositions de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, dont les sénateurs Darnaud et Gatel ont été rapporteurs, en permettant de prévoir des zones où le développement des éoliennes terrestres serait encadré. Afin d’inciter les porteurs de projet à se porter candidats dans ces zones, l’État pourra prévoir des bonifications dans ses appels d’offres ou organiser des appels d’offres dédiés à ces zones prioritaires.
De plus, cet amendement donnera également la possibilité au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s’opposer à une zone d’implantation prioritaire sur son territoire. Le maire aura ainsi le dernier mot dans un processus de planification réfléchi et volontaire. Au regard de cette proposition complète et équilibrée, le Gouvernement demandera la suppression des articles 1er A et 1er C.
Par ailleurs, en ce qui concerne les éoliennes en mer, se pose la question des zones d’implantation et de leur distance de la côte – cela soulève, au fond, un débat du même type que pour les éoliennes terrestres. En tant que ministre responsable de notre transition énergétique, je me dois de vous dire que, à ce jour et au regard des avancées technologiques, une distance d’implantation des éoliennes en mer à plus de 40 kilomètres des côtes réduirait significativement notre potentiel de développement.
Elle nous priverait d’un levier majeur, alors qu’un parc éolien en mer de 2 gigawatts produit l’équivalent de la puissance d’un réacteur nucléaire. À cause de cette disposition, nous ne pourrions plus lancer de projets, même flottants, en mer du Nord et dans la Manche – c’est évident – et en Méditerranée, en raison des canyons. Seul l’océan Atlantique pourrait accueillir des projets, notamment au large des régions Bretagne et Pays de la Loire.
C’est également, je crois, un très mauvais signal envoyé à des filières industrielles qui sont aujourd’hui les plus compétitives au plan mondial – c’est une chance pour notre pays ! – et qui sont largement exportatrices vers les États-Unis et l’Écosse. Elles représentent près de 6 600 emplois directs, notamment à Cherbourg, au Havre ou encore à Saint-Nazaire. Nous disposons de peu de filières d’énergies renouvelables aussi puissantes, prenons garde à les ménager !
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement proposera de revenir à la rédaction initiale du texte dans son amendement n° 584 à l’article 12.
Au-delà de ces deux éléments, je tiens à saluer le travail qui a été mené en commission afin d’enrichir le texte. Les nombreux apports effectués concourent pleinement à l’objectif du texte qui est d’accélérer la production des énergies renouvelables.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis confiante sur le fait que nous trouverons le chemin du consensus avec tous ceux – ils sont nombreux dans cet hémicycle et sur le terrain – qui défendent la souveraineté énergétique et politique de notre pays, avec tous ceux qui veulent défendre le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises et avec tous ceux qui veulent lutter contre le dérèglement climatique.
Vous le savez, pour sortir des énergies fossiles, nous n’avons pas le luxe d’attendre. Les Français nous regardent.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC et SER.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une semaine après son examen en commission, l’heure est venue d’examiner, dans cet hémicycle, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En préambule, je remercie les administrateurs de la commission de leur travail, mes collègues de la commission de leur participation aux auditions et vous-même, madame la ministre, de la qualité des échanges que nous avons eus depuis plusieurs semaines.
Comme la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable l’a noté, c’est la première fois qu’un projet de loi est intégralement consacré aux énergies renouvelables : c’est un signal politique fort, dont nous nous réjouissons.
Rappelons avec fermeté et sans ambiguïté que ces énergies sont indispensables à la préservation de notre souveraineté et à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Constatons également, avec lucidité, que la France est très en retard dans leur déploiement ; elle est du reste le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint en 2020 les objectifs fixés par la PPE que nous avons votée. Nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire de ce retard, qui affaiblit notre pays.
Notre commission souscrit donc pleinement à l’objectif d’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
Une fois le constat dressé, nous devons, dans un second temps, nous poser la question de l’adéquation de ce texte aux enjeux énergétiques et climatiques : le projet de loi qui nous a été proposé est-il suffisant ? Nous pouvons en douter, car ce texte semble tout d’abord précipité. Nous ne pouvons que regretter la méthode consistant à aborder, par ce projet de loi, l’exception et le particulier avant le cadre général : il eût été préférable, pour la clarté du travail parlementaire, de débattre, au préalable, des objectifs de développement, filière par filière, dans le cadre de la loi quinquennale que nous aurons à examiner en 2023.

Nous regrettons ensuite que le projet de loi proposé soit décevant et inabouti dans son ambition simplificatrice : peu de mesures du texte initial sont de nature à accélérer substantiellement les projets, en particulier sur le plan des procédures administratives. Même si l’on supposait que le texte proposé ainsi que son volet réglementaire lancé parallèlement cet été permettent de simplifier ponctuellement les procédures, des doutes majeurs persisteraient quant à la capacité des services déconcentrés de l’État à répondre aux besoins et à instruire l’ensemble des dossiers, à effectifs constants. Enfin, notre commission déplore de nombreux oublis et sujets non traités dans le texte initial.
Forte de ces constats, notre commission a souhaité relever l’ambition du texte proposé, ce qu’elle a fait indiscutablement en le complétant et en l’améliorant substantiellement.
Le premier axe de travail sur lequel nous avons avancé porte sur la planification territoriale et l’amélioration de la concertation autour des projets d’implantation d’énergies renouvelables. Il s’agissait d’un véritable angle mort du texte initial. Nous savons pourtant que le manque d’acceptabilité est ce qui empêche véritablement le déploiement des projets d’énergies renouvelables.
Notre commission a donc proposé l’instauration d’un dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables. Je dis bien « global », car l’enjeu est moins de déterminer quel document identifierait les zones de développement des énergies renouvelables que d’instaurer une méthode de concertation permettant leur identification, en cohérence avec les objectifs nationaux.
Nous avons donc proposé que d’abord les maires, puis les établissements publics de coopération intercommunale, en lien avec les syndicats d’énergie et les départements, enfin les comités régionaux de l’énergie soient à la manœuvre pour définir des zones propices à l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables. Pour ce faire, ils pourront s’appuyer sur une estimation du potentiel de production de leur territoire, qui leur sera transmise par l’État. Une fois ces zones définies, il reviendra ensuite, et seulement ensuite, à l’État de les avaliser par décret. Ces zones pourront alors bénéficier de souplesses qui permettront d’accélérer substantiellement le développement des projets concernés.
M. Jean-Michel Houllegatte manifeste sa désapprobation.

À côté de cette planification générale, nous avons souhaité établir une planification spatiale et temporelle particulière pour le développement des projets éoliens en mer. Nombre d’acteurs critiquent la méthode actuelle, qui consiste à développer les projets par à-coups, sans visibilité quant au nombre de projets envisagés à moyen terme sur une même façade maritime ou aux zones précises dans lesquelles ces projets pourront – ou pourraient – s’implanter.
Afin de favoriser l’acceptabilité sociale des projets éoliens en mer, nous avons souhaité que soient prioritairement ciblées – j’insiste sur ce point –, pour les futurs appels d’offres, des zones d’implantation situées dans la zone économique exclusive (ZEE). Afin d’orienter l’État et les porteurs de projet vers la technologie prometteuse de l’éolien flottant, qui devrait atteindre leur maturité commerciale à l’horizon de 2030-2035, j’ai également proposé que soient privilégiées – là encore, j’insiste sur ce terme – des implantations au-delà d’une distance de 40 kilomètres du rivage. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une obligation ; cette règle devra être mise en œuvre en tenant compte des contraintes existantes sur chaque façade. L’idée est d’encourager la tendance à éloigner les parcs éoliens des côtes, lorsque c’est possible, en laissant au Gouvernement toute la latitude nécessaire.
L’une de nos autres propositions fortes est de renforcer la voix des élus locaux en leur permettant de s’exprimer favorablement ou défavorablement sur l’implantation d’une série de projets d’énergies renouvelables. Les élus sont les mieux placés pour savoir quels sont les projets les plus pertinents pour leur territoire.
Il faut leur redonner un pouvoir décisionnaire. Je l’assume, car je sais que la grande majorité des élus est en faveur du développement des énergies renouvelables. Faisons-leur confiance !

Nous avons également souhaité associer plus étroitement les particuliers, les entreprises, les associations et les collectivités territoriales situés à proximité d’un site d’implantation, en demandant aux porteurs de projet de leur proposer une participation à l’investissement ou au capital, comme cela existe au Danemark.
Par ailleurs, nous avons considérablement avancé sur notre deuxième axe de travail, consacré à la simplification.
Sur ce volet, nous avons proposé un nouvel équilibre dans la législation environnementale, qui repose sur trois piliers : premièrement, davantage de concertation avec le public et les élus, en amont du dépôt formel des demandes d’autorisation des projets ; deuxièmement, établir une instruction plus rapide des projets avec des dossiers de meilleure qualité, dès leur dépôt ; troisièmement, garantir une simplification, en aval, pour la consultation du public, grâce à des ajustements pragmatiques.
Dans ce cadre, nous avons notamment suggéré de supprimer certains dispositifs qui ne sont plus pertinents à l’heure actuelle et qui sont sources de charges pour les services administratifs, à l’image du certificat de projet dans le cadre de l’autorisation environnementale. Nous avons également souhaité créer un référent unique, au sein de la préfecture de chaque département, pour faciliter l’instruction de tous les projets d’énergies renouvelables visés par le texte. Ainsi, nous aurons un guichet unique et un référent unique.
Nous proposons nombre d’autres mesures, telles que la création d’un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux et la création de nouvelles dérogations procédurales temporaires.
Notre troisième axe de travail porte sur la libération de surfaces de déploiement à faibles enjeux environnementaux ou fonciers, car nous sommes convaincus que notre politique de décarbonation ne nous permettra pas de relever les défis de demain si elle conduit, dans le même temps, au dépassement des autres limites planétaires que sont l’érosion de la biodiversité et le changement d’utilisation des sols.
Nous avons donc souhaité renforcer les obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nouveaux, afin d’anticiper les orientations européennes consécutives au déclenchement de la guerre en Ukraine. En contrepartie de ces obligations, nous avons souhaité faciliter l’achat de procédés de production d’énergies renouvelables afin d’équiper ces bâtiments, notamment par l’introduction d’un suramortissement au bénéfice des entreprises.
Il nous faut également lever les contraintes réglementaires et techniques qui peuvent limiter l’installation d’ouvrages renouvelables sur les bâtiments. C’est pourquoi nous avons proposé de rendre les bâtiments neufs solarisables, c’est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables, en laissant la porte ouverte à toutes les nombreuses innovations de nos start-up et entreprises.
Dans un quatrième et dernier axe, nous avons souhaité sécuriser juridiquement les porteurs de projet et les autorités administratives compétentes en matière de projets d’énergies renouvelables. En la matière, nos ajouts sont divers et nombreux. Je citerai l’exemple des améliorations apportées à l’article 4 visant à garantir l’effectivité de la reconnaissance de raisons impératives d’intérêt public majeur. En l’état du texte initial, cette reconnaissance ne pouvait concerner que les plus gros projets d’énergies renouvelables, alors que nous devons entrer dans une logique décentralisée et d’autoconsommation.
En résumé, ces apports de bon sens jouent sur le ressort d’une plus grande intelligence collective et témoignent du souci d’une meilleure prise en compte des réalités du terrain. Formons le vœu que le travail en séance publique nous permette de poursuivre dans cette voie.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Franck Menonville applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de remercier les administrateurs de la commission des affaires économiques, car l’action publique n’est pas que le fait des élus.
Compétente en matière d’énergie et d’urbanisme, notre commission a veillé aux aspects économiques du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables que nous examinons aujourd’hui. Notre commission a reçu en délégation les articles 3 et 16 et les titres IV et V. Elle s’est saisie pour avis des autres dispositions.
Au cours de mes travaux, j’ai entendu 45 organismes, 100 personnalités et reçu 75 contributions. Leur constat est convergent : l’objectif du texte est partagé, mais la méthode est critiquée !
Nous déplorons ainsi un mauvais séquençage. Il aurait d’abord fallu commencer par l’examen de la loi quinquennale sur l’énergie, puis de celle qui porte sur le nucléaire, avant de nous pencher sur celle-ci, qui porte sur les énergies renouvelables.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Stéphane Demilly applaudit également.

Nous regrettons aussi une évaluation parcellaire. Il est proposé de modifier la facture d’énergie des Français, sans étude d’impact exhaustive…
Nous dénonçons également une concertation limitée, comme nous l’ont dit les élus locaux et les professionnels.
Enfin, certaines mesures sont sous-calibrées. Alors que la France a souscrit au plan européen visant à porter les énergies renouvelables à 45 % d’ici à 2030, rien ne garantit que cet objectif soit atteint.
Pour répondre à la crise énergétique, nous sommes convaincus qu’il est indispensable d’accélérer l’essor des projets d’énergies renouvelables, parallèlement à la relance de la filière nucléaire et à l’effort de sobriété énergétique, pour renforcer notre transition et notre souveraineté énergétiques.
Dans ce contexte, notre commission a travaillé selon trois axes. Le premier axe est la garantie de la neutralité technologique entre les différentes sources d’énergie décarbonée, en supprimant les angles morts du texte. Sur l’hydroélectricité, la commission a facilité les augmentations de puissance, consolidée les concessions échues, ajusté les débits minimaux et simplifié les comités de suivi. Sur l’hydrogène, elle a intégré les conclusions de sa mission d’information sur le sujet. Sur le biogaz, elle a créé des contrats d’achat de long terme, conforté les contrats d’expérimentation, simplifié les autorisations d’urbanisme, facilité les raccordements et instauré des opérations d’autoconsommation. Sur l’agrivoltaïsme, elle a repris in extenso la proposition de loi en faveur de son développement, adoptée par le Sénat, par 251 voix pour et 3 voix contre, le 20 octobre dernier.
Autre point, la commission a renforcé le critère du bilan carbone conditionnant les soutiens publics aux projets d’énergies renouvelables, pour prendre en compte les métaux stratégiques et englober l’hydrogène.
Le deuxième axe est l’accélération de la production des énergies renouvelables par l’organisation de l’État, la simplification des normes, le financement des projets et la résolution des litiges.
Sur l’article 6, nous avons encadré l’habilitation à légiférer par ordonnances pour que celles-ci n’induisent pas une érosion des compétences des collectivités, une hausse des coûts de raccordement ou une déstabilisation des rabais pour les producteurs d’énergies renouvelables et les consommateurs électro-intensifs. De plus, nous avons inscrit deux dispositions « en dur » : la suppression d’une contribution locale et l’attribution d’une compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Sur l’article 18, nous avons ainsi récrit le dispositif de partage territorial de la valeur, pour prévoir que le reversement soit public et collectif et non privé et individuel.

Le contraire aurait été complexe à mettre en œuvre et attentatoire au principe de péréquation tarifaire, qui garantit un prix égal de l’électricité. Ce sont donc les communes et leurs groupements qui bénéficieront de ce versement, à charge pour eux de le redistribuer. Ils devront rendre compte de son montant et de son allocation.
De plus, nous avons créé une contribution dès la notation des appels d’offres.
Enfin, nous avons prévu que les communes et leurs groupements puissent entrer facilement au capital des sociétés d’énergies renouvelables.
Le dernier axe est l’association des collectivités, en respectant leurs compétences et leurs finances, et en décentralisant les procédures.
Sur l’article 3, nous avons supprimé la possibilité pour l’État de modifier unilatéralement les documents d’urbanisme. Nous avons, au contraire, fourni de nouveaux outils aux élus locaux : modification simplifiée des Scot, amélioration de la planification locale et articulation avec l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN).
Sur l’article 16 visant à permettre d’implanter des ouvrages de raccordement en zone littorale, nous avons prévu l’avis des communes ou de leurs groupements, la priorité donnée à l’enfouissement et l’articulation avec l’objectif ZAN.
Au total, nous avons infléchi et enrichi le texte, en gardant toujours à l’esprit deux impératifs : la simplification des normes, cruciale pour les producteurs d’énergies renouvelables, et la territorialisation des projets, nécessaire à leur insertion locale et donc à leur acceptation sociale.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de la culture a été saisie pour avis sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Permettez-moi de saluer à mon tour le travail des administrateurs de la commission.
Dans notre rapport, nous avons d’abord souhaité affirmer notre conviction que la transition énergétique ne pourra se faire qu’en cherchant toujours à conjuguer, et jamais à opposer, développement des énergies renouvelables (EnR) et préservation du patrimoine et du cadre de vie des Français.
Notre commission se réjouit des modifications apportées par la commission du développement durable afin d’accorder aux conseils municipaux la possibilité d’accepter ou de refuser un projet d’EnR. Les maires et les élus locaux sont, en effet, les meilleurs garants du cadre de vie des habitants. L’article 1er C, issu de l’initiative conjointe du rapporteur Didier Mandelli et de la commission de la culture, nous paraît donc essentiel.
Nous regrettons, en revanche, l’introduction dans le texte de dispositions qui fragilisent la protection du patrimoine.
L’article 11 quinquies autorise ainsi des dérogations à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) pour l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des monuments historiques. Nous avons conscience que les décisions des ABF peuvent parfois susciter l’incompréhension des élus locaux.

Cette disposition nous est toutefois apparue comme dangereuse pour le cadre de vie et pour l’attractivité touristique de nos territoires, alors même qu’elle n’apporte pas de gains significatifs en termes de production d’énergie renouvelable. Je rappelle que l’avis conforme de l’ABF ne concerne aujourd’hui que 6 % du territoire national et que, dans ces espaces, le taux de refus des projets dépasse à peine les 10 %.
Une telle mesure risque donc d’abîmer nos paysages pour un bénéfice énergétique purement symbolique, c’est pourquoi je vous appelle à voter l’amendement de suppression que j’ai déposé.
La commission vous propose également des amendements visant à adapter notre législation aux évolutions technologiques des EnR.
Concernant l’éolien terrestre, vous le savez, la taille des mâts a considérablement augmenté ces dernières années, et ceux-ci sont désormais plus visibles sur de plus larges périmètres. L’installation de nouveaux parcs et le renouvellement des parcs plus anciens dégradent donc de plus en plus nos paysages.
Pour prendre en compte ces évolutions, notre commission présente un amendement visant à étendre l’avis conforme de l’ABF aux projets de parcs éoliens terrestres entrant dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable, dans un rayon de dix kilomètres. Il ne s’agit pas d’une interdiction, mais bien d’un contrôle renforcé, afin de protéger notre patrimoine et nos paysages.
Dans d’autres cas, les avancées technologiques constituent, au contraire, une opportunité pour sauvegarder nos paysages. J’ai en particulier à l’esprit les éoliennes flottantes, qui permettront de positionner les parcs offshore à plus grande distance des terres.
L’implantation récente du premier parc éolien en mer, au large du Croisic, a suscité beaucoup d’incompréhension de la part des élus locaux. Soucieuse de préserver nos littoraux de l’impact visuel et de l’effet d’encerclement, que j’ai pu moi-même constater dans mon département de la Loire-Atlantique, notre commission vous invitera donc à interdire la mise en place de tels dispositifs à moins de 40 kilomètres des côtes, à compter des prochains appels d’offres.

Personne ici ne conteste la nécessité du développement des EnR pour faire face aux enjeux d’écologie et de souveraineté énergétique. Veillons toutefois à ce que leur déploiement ne constitue pas un nouveau motif de division sociale et territoriale.
Alors que les éoliennes terrestres se multiplient souvent en milieu rural, et particulièrement en milieu rural pauvre, une étude datant de 2019 a montré que les manifestants pour le climat étaient majoritairement jeunes, urbains, et issus de classes sociales privilégiées.
Si l’on souhaite que les enjeux écologiques ne soient pas portés par quelques-uns, mais au contraire partagés par tous les Français, nous devons tracer cette ligne de crête et trouver le bon équilibre entre EnR et cadre de vie.

Mme Laurence Garnier, rapporteure pour avis. Reprenons le discours de Malraux défendant sa loi en 1962 et souvenons-nous du passage dans lequel il imagine les quais de Seine livrés sans règles aux promoteurs : « Si nous laissions détruire ces vieux quais de la Seine semblables à des lithographies romantiques, il semblerait que nous chassions de Paris le génie de Daumier et l’ombre de Baudelaire. »
Exclamations sur les travées du groupe GEST.

Mme Laurence Garnier, rapporteure pour avis. N’oublions pas que nos prédécesseurs ont su préserver le patrimoine français qui a fait de notre pays la première destination touristique mondiale. Notre responsabilité est donc bien de conjuguer le développement des énergies renouvelables avec les enjeux économiques, touristiques, territoriaux et sociaux, afin que la France soit au rendez-vous de toutes ces ambitions.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Nathalie Delattre applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au nom des membres de la commission de l’aménagement du territoire, je remercie Didier Mandelli pour son travail, mais aussi pour avoir ouvert l’ensemble de ses auditions à tous les collègues qui souhaitaient y assister.
Il y a exactement trois semaines, nous débattions de la politique énergétique de l’État, dont le présent projet de loi constitue l’une des déclinaisons opérationnelles.
Si j’osais une métaphore culinaire, je dirais que, dans le menu que nous a proposé le chef de l’État lors de son discours de Belfort, le projet de loi initial, tel qui nous a été soumis, est apparu comme une recette bien allégée et manquant cruellement d’ingrédients.
Le sujet aurait mérité une approche globale et je suis convaincu qu’un temps de maturation plus long aurait donné naissance à un texte plus cohérent, prenant en compte l’ensemble des énergies renouvelables : l’hydrogène, l’hydroélectricité, chère à Daniel Gremillet, le gaz vert, l’énergie marémotrice ou encore l’agrivoltaïsme.
S’agissant de ce dernier point, notre groupe peine à comprendre pourquoi l’amendement de notre collègue Nathalie Delattre visant à intégrer les fermes pédagogiques au dispositif a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d’établissements scolaires agricoles aurait permis de produire de l’énergie, tout en ayant des vertus pédagogiques pour de futurs jeunes agriculteurs. Brandir cet article pour refuser un tel investissement me semble abusif.

Le travail de nos deux commissions a fort heureusement conduit à enrichir le texte et je me félicite, en particulier, des avancées concernant l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Nous aurons encore à en débattre et je sais que nombre de nos collègues ont déposé des amendements sur ce sujet.
Nous devons également approcher globalement la question énergétique elle-même. Alléger les contraintes administratives pour accélérer les projets est une chose, mais il nous faut aussi créer les conditions pour réussir la transition. Cela concerne l’adaptation des réseaux, qui doivent devenir intelligents ; l’organisation du stockage de l’énergie produite – un défi ! – ; la structuration d’une véritable filière industrielle ; la nécessaire recherche, en parallèle, d’une réduction de nos consommations par l’optimisation des outils de pilotage et de nos comportements ; la décarbonation de notre économie, laquelle repose encore à plus de 60 % sur les énergies fossiles.
Nous ne pouvons éviter d’avoir une discussion sur ces sujets urgents ; à défaut, nous raterions le tournant de la troisième révolution industrielle en cours, chère au prospectiviste Jeremy Rifkin.
S’agissant du contenu du texte, il me semble que nous devons être extrêmement prudents sur les motifs mis en avant, en particulier en ce qui concerne la lenteur des procédures. C’est un procès récurrent intenté à nos administrations, mais la principale cause de cette situation ne serait-elle pas le manque de moyens humains et financiers ?
Nous le vivons tous au quotidien dans nos territoires : l’État s’est désengagé depuis longtemps, les effectifs des directions départementales ont fondu comme neige au soleil et nos services déconcentrés sont bien souvent en panne sèche. Madame la ministre, vous nous avez heureusement rassurés sur ce point.
Dans le même temps, le texte doit restaurer le rôle légitime des collectivités, qui sont, au côté des habitants, les premières à être concernées par les impacts des nouvelles installations. Comme l’a relevé très justement Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, interrogée au sujet du ZAN, elles sont les mieux placées pour évaluer leurs besoins et leurs contraintes. Pour chaque dispositif, ce sont les principes d’adaptation, de planification, de programmation et de territorialisation qui doivent donc s’imposer.
Sur ce sujet également, notre commission a d’ores et déjà amélioré le texte, mais il nous faut aller plus loin. Aussi, je salue les dispositions qui visent à créer un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ou à exiger des sociétés de projet qu’elles proposent des parts aux résidents et aux collectivités.
Cependant, la très grande majorité de mon groupe s’opposera au droit de veto des collectivités sur les projets d’installation d’éolien terrestre, de biogaz ou de photovoltaïque, ainsi qu’à la distance minimale de 40 kilomètres des côtes en matière d’éolien en mer.
De manière générale, parce que les enjeux pour les générations futures sont colossaux, nous devons faire preuve de responsabilité et de lucidité s’agissant de la simplification des procédures et trouver le juste équilibre entre la préservation de notre environnement et la nécessité d’accélérer notre transition énergétique, sans céder à l’arbitraire non plus qu’aux pressions. Je suis donc convaincu que les principes de proportionnalité et de réalisme doivent nous guider.
Je prendrai un seul exemple : l’amendement relatif à la suppression de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour l’installation de panneaux solaires sur les toits des habitations à proximité de sites classés. Il s’agit, à mon sens, d’une avancée bienvenue : défendons notre patrimoine, mais restons raisonnables !
Vous l’aurez compris, notre groupe adoptera une attitude constructive sur ce texte, tout en étant attentif aux impératifs de notre démocratie participative et aux enjeux de la préservation de nos richesses naturelles.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, nos concitoyens regardent avec inquiétude leur facture d’énergie. Ils se posent des questions, car, autour de nous, en Europe, les compteurs s’affolent. Le prix de l’électricité est en hausse de 80 % au Royaume-Uni, de 55 % en Belgique, de 45 % aux Pays-Bas. Une seule solution s’impose : produire plus.
Une électricité abondante, disponible, et bon marché, c’est cela que les Français attendent. À défaut d’offrir cette réponse, ce texte a le mérite d’en apporter une. Les vertus environnementales du renouvelable ne sont plus à démontrer et aident la France à tenir ses engagements internationaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Je salue la volonté du Gouvernement d’amplifier notre production d’énergie bas-carbone. Il était temps ! Je forme le vœu que ce chemin augure d’autres déclics. Je nourris malgré tout un regret : cette politique énergétique est subie et non choisie ; elle se construit au coup par coup : un jour on fragilise le nucléaire, le lendemain on promeut les EnR, demain on réhabilitera le nucléaire, un autre jour on louera l’hydrogène… Tout cela est brouillon et manque de cap comme de vision.
Nous aurions certainement gagné à l’organisation d’un grand débat sur la stratégie et l’avenir énergétique de la France.
Cette volonté d’amplifier et de diversifier notre production bas-carbone ne surgit pas de nulle part. Comme c’est le cas ailleurs dans le monde, nous sommes rattrapés par un dérèglement climatique incontestable et par un contexte international dégradé, qui vient bousculer des approvisionnements et des échanges commerciaux que nous pensions pérennes.
Pour autant, la situation internationale ne doit pas nous faire oublier la réalité nationale, laquelle a contribué, depuis dix ans, à affaiblir notre production d’énergie bas-carbone et à fragiliser l’autonomie énergétique de notre pays. Accélérer les EnR demain, oui, mais pour faire oublier que, hier, on a fermé Fessenheim ; que l’on a renoncé au projet Astrid ; que l’on a vendu puis racheté Alstom Power ; que l’on a repoussé le grand carénage ; que l’on a échoué à pérenniser les EPR (European Pressurized Reactors) ! §Qu’avons-nous fait de notre indépendance énergétique, qui garantissait à la France une énergie abondante, disponible et bon marché ?
Aujourd’hui, nous comptons sur le charbon pour compenser nos réacteurs arrêtés, et nos concitoyens se tournent vers le gaz pour espérer se chauffer. Alors, évidemment, faisons en sorte que, demain, nous puissions pleinement nous appuyer sur le secteur du renouvelable dans le mix énergétique français.
Cependant, madame la ministre, combien de kilomètres carrés de champs photovoltaïques, combien de kilomètres de côtes garnies d’éoliennes en mer seront nécessaires pour répondre aux besoins de la France ? Et quelles précautions devrons-nous prendre en matière d’environnement et de souveraineté énergétique ? Telle doit être la contribution de ce projet de loi aux grands enjeux énergétiques. C’est son ambition et je l’approuve.
Pourtant, ce texte élude certains sujets essentiels.
Accélérer la production des EnR implique leur déploiement massif partout dans les territoires. Dès lors, il est salutaire, voire crucial, de s’interroger sur leur impact environnemental et économique. Soyons lucides : les mettre en œuvre sans discernement et sans quelques précautions reviendrait à financer une industrie venue d’ailleurs. C’est un constat regrettable, mais que chacun connaît : les géants industriels de ces filières sont aujourd’hui principalement chinois, pour le photovoltaïque, danois et allemands, pour l’éolien et l’éolien en mer.
Je souhaite que les entreprises françaises se saisissent des opportunités environnementales et économiques que le texte laisse entrevoir. Veillons, madame la ministre, à encourager et à soutenir les initiatives françaises dans les différents plans d’investissements d’avenir comme dans le plan France 2030. Ne réitérons pas les erreurs du passé : nous n’avons pas su créer une filière industrielle française d’équipements compétitifs et vertueux sur tout leur cycle de vie.
Le traitement des déchets et le recyclage sont également un enjeu impératif des installations démantelées. Accélérer aujourd’hui les implantations, c’est devoir, demain, en subir le coût environnemental, avec tout ce que cela comporte en termes de traitement et de valorisation des déchets. Pour le photovoltaïque, une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) s’est structurée ; ce n’est pas le cas, à ce jour, en ce qui concerne l’éolien.
L’échéance est pourtant déjà là : d’ici à 2025, les premières générations d’éoliennes devront être démantelées. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la masse d’une éolienne est recyclable à 90 %. Toutefois l’essentiel de cette masse se trouve dans les fondations, pour lesquelles des filières existent. Ce n’est pas le cas pour tous les composants, par exemple pour les pales. Or, si nous accélérons le déploiement des éoliennes, il est impératif d’anticiper le traitement de tous les déchets issus de leur démantèlement. Construisons une vision d’avenir à trente ans, sur l’ensemble du cycle de vie des dispositifs implantés.
Dans un souci d’économie circulaire, je me réjouis de l’adoption en commission de mon amendement visant à créer une filière REP, ou tout système équivalent de prévention et de gestion des déchets, pour l’éolien.
Avant de conclure, je souhaite à mon tour remercier notre rapporteur, Didier Mandelli, pour son écoute tout au long de l’examen du texte et pour tout le travail effectué au sein de notre commission. Ce texte, enrichi de l’apport de tous les commissaires, va libérer les énergies dans un secteur qui ne demande qu’à se développer.

Mme Marta de Cidrac. Toutefois, pour que le déploiement des EnR soit ambitieux et accepté dans nos territoires, madame la ministre, il faudra tenir compte de l’ensemble des enjeux importants qu’il aborde.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Merci à tous de respecter les temps de parole !
La parole est à M. Pierre Médevielle.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Pierre Louault applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques et économiques ont bouleversé les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques fossiles, rappelant la dépendance de notre économie et de nos modes de vie aux énergies importées. Cette situation constitue un nouveau paradigme dont il nous faut prendre acte.
Dans ce contexte, le Gouvernement a présenté ce projet de loi ayant vocation à répondre rapidement et efficacement aux défis énergétiques que nous aurons à relever dans les années à venir. Il s’agit d’un signal politique fort.
Je tiens d’abord à relever que le Gouvernement a prêté une oreille très attentive dans la phase de préparation de ce texte et à saluer le travail effectué au sein de chaque commission, qui a permis, notamment, l’adoption de plusieurs amendements déposés par des sénateurs de notre groupe sur des points essentiels.
Vous le savez, le groupe Les Indépendants soutient une écologie libérale, pragmatique et pertinente. Nous devons absolument aller vers une simplification en matière de déploiement de dispositifs générateurs d’énergie renouvelable.
Ici, simplifier implique de réduire le temps de développement des EnR pour accélérer leur mise en œuvre sur notre territoire, mais également de libérer des énergies et des technologies nouvelles pour gagner en souveraineté, grâce à la production d’énergies renouvelables bas-carbone. Celles-ci constituent, à mon sens, une pierre angulaire de notre mix énergétique qui, à terme, doit nous permettre d’assurer notre alimentation en électricité, tout en préservant notre environnement.
Par ailleurs, si ce projet de loi couvre un large spectre de solutions énergétiques, il a dû être complété afin d’y inclure l’hydrogène, la géothermie ou l’agrivoltaïsme.
Ce dernier secteur me semble essentiel. Au sein de son ordre du jour réservé du 20 octobre 2022, notre groupe a présenté et fait adopter une proposition de loi visant à encadrer son développement, dont les mesures ont pu être insérées dans ce texte dès l’examen en commission. Je remercie les auteurs des différents amendements déposés à cette fin.
L’agrivoltaïsme m’importe tout particulièrement, car ses avantages sont multiples : il permet à nos agriculteurs de bénéficier d’un revenu complémentaire, tout en garantissant la primauté de l’activité agricole ; il constitue également une nouvelle source de production énergétique, sans aggraver l’artificialisation des sols, un point qui a souvent été abordé durant nos débats.
Je viens d’évoquer des avancées notables, pour autant, le travail doit se poursuivre. Je suis convaincu que nous devons penser nos transitions dans une architecture plus large, c’est pourquoi les autres textes annoncés dès le début de l’année prochaine me semblent indispensables afin d’atteindre nos objectifs en matière d’indépendance énergétique.
J’ai en particulier à l’esprit la programmation pluriannuelle de l’énergie ou encore le projet de loi sur le nucléaire, une énergie qui restera essentielle dans notre mix énergétique décarboné.
Rappelons également l’importance du stockage des EnR, une question absente jusqu’ici. Pour ces énergies dites intermittentes, celui-ci présente un potentiel substantiel, notamment grâce à la technique du power to gas, qui vise à transformer les EnR en hydrogène.
Une dernière problématique me tient à cœur : la place des collectivités locales et des élus locaux dans le développement des EnR. Je suis convaincu de leur rôle en la matière, mais il me semble qu’il faut trouver un équilibre juste entre le droit de veto qui leur serait octroyé et l’impératif de développement de ces énergies. La question peut paraître clivante, mais nos besoins énergétiques immédiats sont une réalité et ne peuvent souffrir d’un droit de blocage dont l’exercice serait souvent arbitraire.
De même, je ne suis pas persuadé que l’on rendrait service aux maires en leur concédant le pouvoir d’autorisation en matière d’énergie renouvelable. Ils risquent de se retrouver dans tous les cas seuls et sous une trop forte pression. On peut se référer à ce titre au communiqué national de l’Association des maires ruraux de France (AMRF).
À travers ce texte, nous devons privilégier le sens de l’intérêt collectif et mettre de côté les intérêts politiques partisans.
En matière d’énergies renouvelables, le meilleur reste à venir. Ainsi, le projet toulousain d’Airbus Defence and Space, Solar Beam, une centrale photovoltaïque spatiale, permettra d’alimenter les avions par faisceaux. Notre indépendance énergétique reposera également sur notre audace, sur notre ambition et sur les progrès technologiques futurs.
Notre groupe votera en faveur de ce projet de loi, pour soutenir l’effort commun vers une transition durable et vers davantage de souveraineté énergétique.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Pierre Louault applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

M. Ronan Dantec . Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, enfin, l’État reconnaît que, face à la très grave crise énergétique que nous vivons, nous n’avons qu’une seule solution : le développement rapide et massif des énergies renouvelables, notamment pour la production d’électricité !
« Et le nucléaire ! » sur des travées du groupe Les Républicains.

Toutefois, cette loi arrive malheureusement bien tard, presque huit ans après que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé à l’horizon 2025 le rééquilibrage du mix énergétique français entre le nucléaire et les énergies renouvelables.
Huit années auraient suffi pour développer une réelle stratégie territoriale et industrielle et pour mettre les politiques publiques en cohérence avec les objectifs fixés par la loi. Force est de constater que ce temps a été gaspillé, au détriment de notre économie et du pouvoir d’achat des Français. Nous sommes aujourd’hui le seul pays européen à ne pas atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus dans la directive-cadre de 2009.
En urgence, le Gouvernement nous dit son intérêt, voire son empressement, en faveur des énergies renouvelables, que Mme la ministre a qualifiées hier matin sur une grande radio nationale d’« ultracompétitives ».
L’État s’étant rallié à l’analyse de notre groupe Écologiste – Solidarité et Territoires selon laquelle notre salut passait par les énergies renouvelables – Mme la Première ministre a même évoqué « une question de survie » –, nous accueillons favorablement ce projet de loi, mais – car il y a un « mais » – nous nous interrogeons tout de même sur son efficience.
Pour commencer, le retard du développement des énergies renouvelables nous semble d’abord lié au prix trop bas proposé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui empêche le succès complet des appels d’offres. Si ces dispositifs produisent clairement l’électricité la moins chère, les tarifs sont trop peu élevés.
Madame la ministre, j’entends votre préoccupation de ne pas créer de superprofits injustifiés pour les entreprises du secteur – que vous vous interdirez en outre de taxer ensuite –, mais avec quelques euros de plus sur les tarifs d’achat garantis, les énergies renouvelables resteront de loin les moins onéreuses.
Mme Sophie Primas s ’ exclame.

Ensuite, une autre cause de retard relève de la prudence des investisseurs, qui attendent que tous les recours, même ceux qui ne sont pas suspensifs, soient purgés. Sur ce point, un amendement du rapporteur de la commission du développement durable, dont je salue l’engagement sur ce texte, a très opportunément conduit à créer un fonds de garantie mutualisant les risques liés aux recours contentieux. Il s’agit probablement de la disposition qui nous permettra de gagner le plus de temps dans la mise en œuvre des projets. Les gains à espérer sur les simplifications administratives apparaissent assez secondaires en comparaison.
Notre groupe reste très vigilant pour s’assurer que ce texte ne détricote pas le droit de l’environnement et ne s’applique pas en dehors des énergies renouvelables, au risque d’affaiblir le principe de non-régression de ce droit.
Le Gouvernement a entendu l’avis négatif très ferme du Conseil national de la transition écologique (CNTE) et le texte a été modifié dans le bon sens depuis sa première présentation. Certains points sont néanmoins toujours problématiques, s’agissant, notamment, des enjeux de biodiversité. Nous y reviendrons durant le débat.
Restent les lignes rouges allègrement franchies par la majorité sénatoriale, laquelle a fait de ce projet de loi un texte de ralentissement plus que d’accélération.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Le droit de veto accordé aux maires sur des aménagements reconnus, par ailleurs, comme relevant de l’intérêt général est étonnant ; il s’agit d’une mesure proche de l’oxymore. Elle constitue d’ailleurs un revirement historique de la part d’un mouvement aux racines gaullistes et jacobines, …

… toujours fier de mettre en avant les épopées industrielles du pompidolisme.
Dans le cas qui nous occupe, c’est l’inverse qui se produit : l’intérêt national s’efface devant les enjeux locaux. Il s’agit d’une première, qui ouvrira la porte à l’interdiction par décision locale, ici d’un bout de ligne de TGV, là-bas – pourquoi pas ? – d’un petit réacteur nucléaire.

M. Ronan Dantec. Il va devenir très compliqué de mettre en place une stratégie nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

De même, renvoyer les éoliennes en mer à 40 kilomètres des côtes en interdit le développement sur la majorité du littoral.

soit plus important que l’avenir de notre industrie et que la facture énergétique des Français, mais je m’interroge tout de même sur le sens de certaines priorités.

Le maintien de ces deux barrières nous conduirait à ne pas voter ce texte, mais nous espérons que le bon sens collectif l’emportera. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.)

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre maison brûle, nous l’avons constaté cet été avec les 66 000 hectares de forêt partis en fumée en Gironde, dans les Landes, et même dans le Finistère.
Le mois d’octobre qui vient de s’achever aura été le plus chaud de notre histoire. Face à cette réalité, à cette menace d’un réchauffement climatique de près de trois degrés, l’Organisation des Nations unies, par l’intermédiaire de son programme pour l’environnement, a rappelé que l’unique option était la transformation rapide, urgente, de nos sociétés.
À l’occasion du lancement du Conseil national de la refondation (CNR) Climat et biodiversité, la Première ministre a également alerté sur la radicalité des changements à effectuer afin de franchir la marche, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en milieu de siècle. Le défi à relever est colossal et la fenêtre d’opportunité est en train de se refermer.
À plus court terme, face à des circuits d’approvisionnement en pétrole et en gaz mis à mal par la guerre en Ukraine, il est essentiel d’activer tous les leviers. Nous devons développer toutes les sources d’énergie décarbonée, notamment renouvelable : l’éolien, le photovoltaïque, ou encore la méthanisation. Nous devons accélérer ; c’est une nécessité, alors que notre pays est en retard.
En 2020, la part de ces énergies dans la consommation finale brute était d’environ 19 %, soit trois points de moins que la moyenne de l’Union européenne. Sur la base de ce constat, ce texte apporte une réponse, à laquelle il faut bien entendu ajouter l’entretien et le développement de notre parc nucléaire pour défendre notre souveraineté, maîtriser les coûts et atteindre la neutralité carbone.
Il y a une semaine, notre commission a adopté 129 amendements. Je veux saluer ici l’engagement sur ce texte de notre rapporteur Didier Mandelli, qui nous a permis d’assister aux auditions, ainsi que les qualités d’écoute dont a fait preuve Mme la ministre.
Le titre Ier du projet de loi tend à apporter des mesures d’urgence, notamment procédurales, visant à accélérer les projets relatifs aux énergies renouvelables et les projets industriels.
Notre commission a ajouté et précisé des dispositions utiles aux premiers articles du texte. Je pense notamment à la désignation des référents préfectoraux dans chaque département pour l’instruction des autorisations relatives aux projets d’EnR.
D’autres modifications ne nous conviennent pas – j’y reviendrai.
Afin d’accélérer le développement de l’énergie solaire, qui est l’objet du titre suivant, le texte rend notamment possible l’installation de ces ouvrages aux abords des autoroutes et des routes à grande circulation. Il nous faudra également la rendre possible aux abords des voies ferrées. Un travail d’inventaire est en cours en ce sens.
Par ailleurs, lorsque nous avions débattu de votre proposition de loi en février dernier, monsieur le rapporteur, j’avais rappelé la nécessité d’offrir à nos élus locaux des zones littorales un cadre juridique protecteur, mais adapté aux enjeux contemporains. Dans cette logique, je soutiendrai en séance plusieurs amendements à l’article 9.
Nous avons également fait adopter en commission une dérogation, sur le modèle des dispositions relatives aux antennes relais prévues dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, afin de rendre obligatoire un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France pour tout projet d’installation à des fins d’autoconsommation sur les bâtiments situés en zone classée. Un décret fixera les conditions d’application de cette disposition. Je m’en expliquerai lors des échanges à venir, mais j’ai eu de très bons retours des élus de mon territoire sur cette proposition.
La même philosophie préside aux dispositions relatives à l’agrivoltaïsme, qui constitue une grande réserve de foncier, sous réserve que la pratique en soit régulée de manière à ne pas mettre en cause l’activité agricole.
À ce propos, mon groupe tient à remercier nos collègues pour leur travail qui a abouti à une proposition de loi équilibrée et raisonnée, adoptée il y a deux semaines, dont les dispositions ont été introduites dans le texte.
En ce qui concerne le développement de l’éolien, ensuite, dans le pacte signé il y a quelques mois, l’État a confirmé sa volonté d’un déploiement ambitieux, avec un objectif d’attribution de 40 gigawatts d’ici 2050.
La filière s’est engagée pour sa part à quadrupler le nombre d’emplois directs et indirects liés à l’éolien en mer d’ici 2035 et à investir plus de 40 milliards d’euros en quinze ans. Cette filière structurée et en forte croissance a besoin de visibilité et de planification. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors du débat.
Cette filière a aussi besoin d’être confortée. C’est pourquoi nous voterons contre le seuil des 40 kilomètres, qui interdirait tout nouveau projet sur la côte d’Opale, sauf à l’implanter sur le territoire britannique… Plus sérieusement, une telle distance au large de nos littoraux serait contraire à une planification territoriale équilibrée de cette énergie.
En matière d’éolien terrestre, nous avions trouvé un juste équilibre dans la loi 3DS. Or les dispositions qui ont été votées en commission reviennent à donner un coup d’arrêt aux projets de construction et d’exploitation.
S’il faut naturellement que des concertations locales soient menées et que les élus locaux puissent intervenir sur des projets d’implantation dans le cadre d’un échange encadré avec le porteur de projet, nous sommes opposés au droit de veto qui a été introduit. Cette position est partagée par l’Association des maires ruraux de France, comme celle-ci l’indique dans son communiqué de presse en date du 2 novembre.
Parmi les dispositions relatives au financement et au partage de la valeur, il nous est apparu nécessaire de soutenir des mesures d’appropriation et des modèles de financement locaux au service des territoires. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à faciliter le développement de l’autoconsommation du gaz renouvelable.
Dans le même esprit d’efficacité et de diversification, nous avons déposé un amendement de séance tendant à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation et les contrats d’achat d’électricité renouvelable. Ces mesures facilitatrices mais simples pourront se révéler très utiles pour nos collectivités et nos PME.
En conclusion, notre groupe suivra toutes les propositions susceptibles de soutenir et de renforcer le développement des énergies décarbonées. A contrario, nous nous opposerons à toutes les mesures défensives qui se traduiront par une décélération.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout le monde s’accorde à dire que nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables, en particulier pour faire face à la demande croissante en électricité qui se substituera, notamment dans les transports et l’industrie, aux énergies fossiles.
Rappelons tout de même que notre production actuelle d’électricité, grâce à son mix énergétique, est faiblement carbonée.
La crise énergétique liée à l’agression de l’Ukraine par la Russie nous fait mesurer combien il est urgent d’agir. Elle nous fait aussi regretter que les grandes orientations stratégiques et la planification qui en découle n’aient pas été anticipées au cours du précédent quinquennat.
Ce projet de loi est certes bienvenu, mais il aurait été plus logique de procéder de façon rationnelle, en élaborant de manière concertée la stratégie française pour l’énergie et le climat. Cette stratégie globale doit certes tenir compte de la production, mais aussi de la sobriété, de l’efficacité énergétique grâce à l’intensification des procédés industriels, de l’isolation thermique des bâtiments et enfin de la captation par les puits de carbone.
Tout cela nous est annoncé pour 2023 au travers d’une loi de programmation pour l’énergie et le climat, d’une troisième loi de programmation pluriannuelle de l’énergie qui couvrira la période 2024-2033, d’une troisième stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et enfin d’un plan national d’adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte, nous devons analyser ce projet de loi avec pragmatisme, en essayant d’anticiper tout ce qui peut l’être et en posant des accroches qui pourront servir d’appui à la future stratégie, en ayant pour boussole le principe selon lequel l’accélération ne doit se faire au détriment ni de la concertation ni de l’environnement.
La concertation et les procédures qui en découlent sont souvent perçues comme un boulet qui freine les projets. Au contraire, plus la concertation est menée en amont, plus elle associe la population et les élus et plus elle facilite le déroulement des projets. La concertation fluidifie les procédures ; son absence les crispe et les grippe. L’avis du Conseil économique, social et environnemental, intitulé Acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique : transition subie, transition choisie ?, est éloquent dans ce domaine.
Le texte qui nous est soumis a été profondément remodelé par les commissions sénatoriales – je salue d’ailleurs à mon tour l’implication des rapporteurs.
Cette réécriture comporte de nombreuses avancées : l’introduction d’une planification territoriale, même si l’on doit se poser la question de l’échelle pertinente et de la méthode ; la mise en place d’une concertation préalable systématique ; la désignation d’un référent départemental préfigurant un guichet unique, mais qui renvoie aux moyens dont l’État dispose pour instruire et accompagner les projets ; la création d’un fonds de garantie ; l’extension à de nombreux bâtiments de l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ; la prévention des pratiques de dumping social sur les navires dans les parcs éoliens en mer ; la création d’un mécanisme de suramortissement ; enfin, la mise en place d’un nouveau dispositif de partage de la valeur.
Hélas ! ce qui a été accordé d’une main pour faciliter les projets semble avoir été repris de l’autre par l’ajout de verrous qui compliqueront le déploiement de ces projets. La majorité sénatoriale, mue sans doute par un tropisme vendéen, risque de transformer la vie des porteurs de projet en épreuve de Fort Boyard !
Sourires sur les travées des groupes SER et UC. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

M. Jean-Michel Houllegatte. Le rejet implicite de l’éolien en mer au-delà des 40 kilomètres condamne l’éolien posé en Méditerranée, il exclut la quasi-totalité de la Manche et de la mer du Nord et fragilise de la sorte la filière industrielle française qui s’est implantée en créant des emplois au Havre, à Cherbourg et même à Saint-Nazaire, car la technologie française de l’éolien flottant n’est pas encore parvenue à une totale maturité.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.

M. Jean-Michel Houllegatte. Dans un autre domaine, même si l’on comprend et que l’on partage l’exaspération des élus locaux auxquels on a quasiment imposé des champs d’éoliennes terrestres, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de trouver des moyens consensuels, fondés sur l’intelligence collective des territoires, pour substituer une décision collégiale à la décision individuelle.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Je ne doute pas que ces sujets animeront nos débats. En tout état de cause, notre groupe déterminera sa position en fonction des amendements adoptés et du texte définitif qui sera soumis au vote.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe GEST. – M. François Patriat applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur la nécessité de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
S’il identifie des solutions pour y parvenir dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’industrie et de l’usage des terres, il insiste sur la nécessité d’une transition juste, tant les inégalités sont flagrantes au niveau mondial. En effet, les 10 % les plus riches sont à l’origine de 36 % à 45 % des émissions, quand les pays les plus pauvres ne sont responsables que de 3 % à 5 % de celles-ci.
En matière de déploiement des EnR, nous faisons figure de mauvais élève, puisque nous sommes le seul pays à ne pas avoir atteint notre objectif de 23 % dans notre consommation finale d’énergie. Je rappelle que cet objectif est de 33 % à l’horizon 2033.
Si le groupe communiste républicain citoyen et écologiste est favorable au développement des énergies renouvelables au côté de notre mix énergétique historique d’origine nucléaire et hydraulique, il considère cependant qu’elles ne doivent pas être génératrices de nouvelles dérégulations et que leur essor exige la structuration de véritables filières par la puissance publique. Nous savons en effet que la théorie qui consiste à laisser faire le marché se révèle extrêmement coûteuse pour les usagers.
Ce projet de loi, en promouvant une accélération intensive des projets plutôt qu’une planification réfléchie en amont, propose la manière forte, qui comporte le risque de se révéler contre-productive en radicalisant les oppositions et en éloignant les citoyens des enjeux de la transition énergétique.
À l’occasion de la concertation que vous n’avez pas manqué d’organiser autour de ce texte, madame la ministre, nous n’avons pas manqué non plus de nous faire l’écho des élus, associations et citoyens de nos territoires qui, face à des implantations quasi imposées, exigent légitimement de prendre toute leur place en amont des projets.
Dans le rapport présenté au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, notre collègue rapporteur Didier Mandelli, qui a remanié ce projet de loi au moyen de 129 amendements, insiste sur les avancées nécessaires en matière d’acceptabilité et de planification des projets.
Il demeure cependant dans ce texte des adaptations de procédures administratives qui constituent des reculs démocratiques, comme la consultation des citoyens par la voie électronique alors que ce sont précisément les territoires concernés par ces implantations qui sont les plus éloignés du numérique.
Dans son avis sur le sujet, le Conseil économique, social et environnemental recommande justement « d’aller chercher la contribution des personnes “silencieuses”, des “invisibles” », « en veillant à prendre en compte l’illectronisme ». Il prône également l’évaluation a posteriori de la concrétisation des engagements des porteurs de projet.
La procédure simplifiée de modification des documents d’urbanisme est de nature à faciliter les atteintes à l’environnement.
Par ailleurs, et vous le savez, madame la ministre, ces nouvelles procédures accélérées ne pourront être efficientes sans un renforcement des moyens humains alloués aux services de l’État, ce que le Conseil d’État n’a pas manqué de relever.
Ce projet de loi défend un modèle visant à décarboner la production qui selon nous doit aller de pair avec la notion de sobriété, au travers notamment du soutien aux transports collectifs dans le ferroviaire et de l’isolation thermique des bâtiments.
Face au prix de l’énergie, face aux attentes des Françaises et les Français, nous devons être le plus efficaces possible. Quelque 13 millions de familles vivent aujourd’hui dans des « passoires thermiques » et se chauffent souvent dans des conditions déplorables. Les 3 000 intoxications au monoxyde de carbone qui ont lieu chaque année nous le rappellent. Il y a urgence à soutenir un grand plan de lutte contre la précarité énergétique susceptible de créer des emplois non délocalisables, avec de vrais résultats en termes de confort et de pouvoir d’achat des ménages.
Par ailleurs, mon groupe ne soutiendra pas les modèles de financement hybride promus dans ce texte en matière de partage de la valeur. Ce système aboutit à différencier le prix de l’énergie en fonction de la localisation des clients, contrevenant ainsi gravement au principe d’égalité entre les usagers. S’il doit y avoir un retour économique lié à la présence de ces installations, celui-ci doit revenir aux collectivités locales qui gèrent l’intérêt général.
L’énergie est un bien commun, un droit fondamental et universel, car il permet l’accès aux autres droits que sont l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, à l’emploi, à la sécurité, à l’égalité entre les hommes et les femmes.
La libéralisation des marchés de l’électricité, engagée en 1996, a conduit à l’éclatement du service public de l’électricité et du gaz. Les EnR doivent être sorties des griffes du marché pour être développées là où elles sont les plus efficaces, en ayant pour critère l’intérêt collectif et celui de la protection de l’environnement.
Si ce projet de loi amendé par la commission comporte effectivement quelques avancées, notre vote dépendra des débats et des amendements qui seront adoptés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mme Martine Filleul et M. Franck Montaugé applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui revêt une importance toute particulière alors que nous connaissons une crise énergétique sans précédent.
À l’heure où le spectre d’une pénurie d’énergie resurgit, d’autant plus menaçant que notre parc nucléaire est pour moitié indisponible, il est en effet plus nécessaire que jamais d’accélérer notre production d’énergies renouvelables.
Cela permettrait d’éviter à nos ménages, nos entreprises et nos collectivités locales de subir délestages, rationnements ou blackout, tout en garantissant notre souveraineté énergétique et en s’inscrivant dans la lutte contre le changement climatique.
Il ne s’agit pas pour autant de négliger le nucléaire : nous sommes tous bien conscients de ses atouts. Cependant, la construction de nouveaux réacteurs s’inscrit dans le long terme, alors que les énergies renouvelables peuvent répondre à nos besoins énergétiques dès maintenant.
Le Gouvernement semble avoir pris la mesure de l’urgence avec ce projet de loi qui prévoit de nombreuses mesures de simplification et d’accélération des procédures. Je m’en réjouis, mais ce texte reste perfectible.
Je tiens à saluer le travail accompli au Sénat par les différentes commissions impliquées. Il montre l’attention portée par notre Haute Assemblée à ce que la transition énergétique menée par l’État ne se fasse pas contre les collectivités territoriales, mais bien avec elles.
Ma collègue Daphné Ract-Madoux détaillera le point de vue de notre groupe sur les avancées proposées par la commission des affaires économiques, notamment grâce à l’engagement de notre collègue rapporteur pour avis Patrick Chauvet.
Pour ma part, j’accueille favorablement plusieurs propositions présentées par mon collègue rapporteur Didier Mandelli lors des travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je pense par exemple à la limitation de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale à quatre mois, ou encore au référent préfectoral chargé de l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
Par ailleurs, j’estime que les amendements du rapporteur visant à démultiplier les possibilités d’implantation du photovoltaïque introduisent des dispositions indispensables pour maximiser le déploiement de cette énergie.
Je déplore toutefois que certaines dispositions introduites par voie d’amendement en commission mettent en péril l’édifice que nous avons coconstruit. Comment pouvons-nous ainsi proposer de revenir sur le dispositif équilibré de la loi 3DS sur l’éolien en envisageant aujourd’hui un veto des élus municipaux sur les projets ?

Mme Denise Saint-Pé. Cela ralentirait la procédure, ce qui serait contre-productif.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et GEST. – M. Frédéric Marchand applaudit également.

Plus dangereux, cela mettrait les projets éoliens terrestres à la merci de critères politiques, et donc subjectifs, un risque d’autant plus grand si toutes les communes en covisibilité sont concernées.

C’est pourquoi je ne crois ni raisonnable ni responsable d’instaurer un tel dispositif.
De même, comment soutenir des mesures visant à gêner l’implantation d’éoliennes offshore à moins de 40 kilomètres des côtes, quand, dans le même temps, l’éolien flottant qui permet d’aller au-delà de cette distance n’est pas encore mature ? C’est à se demander si nous avons tous la même conscience de la gravité du moment, en pleine crise climatique et énergétique.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Mon groupe n’étant pas unanime sur ces questions, l’avis que j’exprime est celui d’une partie de mes collègues. Toutefois, nous comptons tous sur le débat d’aujourd’hui et des jours à venir pour que le Gouvernement et le Sénat s’accordent sur des solutions de compromis satisfaisantes.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de retracer brièvement l’histoire qui nous a amenés à examiner ce texte un peu en urgence.
Tout a commencé lorsque le général de Gaulle a fait le choix du nucléaire et de la construction d’infrastructures hydroélectriques.
Les présidents qui se sont succédé l’ont suivi – après les présidents Pompidou et Giscard d’Estaing, même le président Mitterrand, passé un temps d’hésitation, a poursuivi les investissements dans le nucléaire, de même que les présidents Chirac et Sarkozy ensuite.
En raison de ce choix, la France a été sans le savoir le premier pays à disposer d’une énergie décarbonée à plus de 85 %, à raison de 75 % pour le nucléaire et de 13 % pour l’hydroélectrique.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Telle est la réalité. Et cela va plus loin, car ce choix a également permis aux Français et à notre économie de disposer d’une énergie abondante et compétitive dans tous les territoires.
Les difficultés, les non-décisions ont commencé sous les présidences Hollande et Macron.
Protestations sur des travées des groupes SER et RDPI.

(Marques d ’ approbation sur les travées du groupe Les Républicains.) Il est peut-être gênant de l’entendre, mais la réalité est qu’on a décidé de ramener la part du nucléaire de 75 % à 50 %, et partant, de fermer quatorze réacteurs, dont les deux de Fessenheim, qui ne devaient être fermés que lorsque la centrale de Flamanville serait en capacité de produire…
Exclamations sur les travées du groupe GEST.

On a aussi décidé d’abandonner le projet de réacteur de quatrième génération Astrid.
Cette histoire m’évoque la fable La Cigale et la Fourmi. Non contents de toutes ces décisions, nous avons également stoppé la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur notre territoire. Alors que nous nous lancions dans le « tout électrique », nous avons interdit l’exploitation des gaz de schiste, que d’autres pays développent.
Si nous examinons ce texte aujourd’hui, c’est parce qu’il n’y a pas eu d’« en même temps ». La décision de réduire notre production énergétique, responsable de la situation que nous connaissons, alliant une précarité et des coûts de l’énergie inédits, supérieurs de 100 euros par mégawattheure à ceux de l’Allemagne, ne s’est pas accompagnée du « en même temps », car nous n’avons pas été en mesure de produire d’autres énergies, y compris renouvelables.
Madame la ministre, j’ai lu l’entretien que vous avez accordé au journal Les Échos hier. Je vous renvoie aux difficultés incroyables que nous avons rencontrées pour inscrire dans la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, que l’on ne fermerait plus de réacteurs tant que l’on ne disposerait pas « en dur » d’une capacité de production énergétique équivalente.
Je vous renvoie aussi aux travaux du Sénat, en particulier aux propositions de la commission des affaires économiques, qui a eu le souci constant de garantir la souveraineté énergétique de notre pays, l’accessibilité de l’énergie à nos concitoyens et sa compétitivité pour notre économie. Le Sénat a voté de très nombreux textes en ce sens, mais vous ne l’avez pas entendu !
Aujourd’hui, c’est en quelque sorte une séance de rattrapage, car en dehors de l’augmentation des capacités de production nucléaire, qui n’interviendra que dans un horizon de dix ans, il y a urgence à agir pour garantir cette énergie à nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous l’avons dit lors d’un récent débat avec le Gouvernement, SNBC et PPE auraient dû constituer le point d’entrée de la politique énergétique de la France. À défaut, nous débattons aujourd’hui, sans connaître vos objectifs précis, du déploiement de certaines énergies renouvelables, nous débattrons demain du nouveau nucléaire, et après-demain, peut-être, de l’hydraulique.
Dans ce contexte flou et pour le moins problématique, rarement projet de loi gouvernemental aura été autant modifié sur le fond par les commissions du Sénat et leurs rapporteurs – que je salue –, et à la suite des nombreuses observations du Conseil d’État.
Il fallait qu’il le soit, tant il nous est apparu comme approximatif et imprécis sur bien des points, et de surcroît, contrevenant aux libertés les plus fondamentales des élus locaux.
Dans la perspective d’intérêt général du zéro carbone en 2050, les sénateurs du groupe socialiste se sont placés du point de vue des élus locaux pour améliorer votre texte. Madame la ministre, je souhaite rappeler notre opposition ferme à votre proposition d’ingérence des préfets dans les orientations des plans locaux d’urbanisme (PLU). La solution est ailleurs, dans le respect et le dialogue avec les élus locaux.
Pour faire avancer efficacement la production d’énergies renouvelables sur notre territoire, il faut définir et déployer une planification dans le sens État-collectivités territoriales et dans le sens collectivités territoriales-État.
Nous disposons dans la législation actuelle de tous les outils pour y parvenir : contrats de plan État-région, schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), schémas de cohérence territoriale (Scot), plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et PLU.
J’ajoute que bon sens et dialogue à tous les échelons nous permettront d’être au rendez-vous des objectifs fixés sur tous les territoires et dans les délais.
En ce qui concerne le développement de l’éolien, nous vous ferons des propositions réalistes inspirées par le vécu de terrain et de nature à diminuer l’impact des nuisances.
En revanche, nous estimons que le partage de la valeur doit s’opérer par l’intermédiaire des collectivités locales concernées. Nous tenons à ce que le principe de péréquation tarifaire perdure pour tous les consommateurs et sur l’ensemble du territoire national. Lois de Kirchhoff obligent, la consommation ne se fait pas obligatoirement à proximité immédiate du lieu de production.
Nous tenons aussi à vous rappeler la nécessité de restructurer le marché européen et les tarifs de l’électricité.
Dans ce cadre, les tarifs régulés doivent être maintenus et développés. Le texte permet l’accès des collectivités locales aux contrats de long terme de type PPA (Power Purchase Agreements). Ils doivent être encadrés pour être protecteurs et pour éviter les situations que subissent de nombreuses collectivités locales dans le contexte énergétique actuel.
Je rappelle aussi que mon groupe est réservé sur le nombre de critères à retenir pour qualifier l’agrivoltaïsme. Parmi les quatre critères proposés, un seul nous paraît insuffisant. Il y a un risque certain de dérive vers l’« énergie-culture », alors que la préservation des terres nourricières doit l’emporter sur toute autre considération.
Ayons conscience que c’est notre modèle agricole qui est en question, tout en gardant en tête que les agriculteurs, comme tous les Français, peuvent être des contributeurs du mix énergétique national.
Nous vous présenterons un amendement visant à déployer des programmes de contrôle des installations photovoltaïques sur cultures.
Pour terminer, nous souhaiterions savoir comment les communes devront prendre en compte l’objectif « zéro artificialisation nette » dans les projets d’énergies renouvelables. À cet égard, il est nécessaire d’inscrire la comptabilisation du ZAN dans un dispositif de solidarité ou de péréquation territoriale nationale. Quelle est votre position à ce sujet, madame la ministre ?
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre collègue Denise Saint-Pé s’étant prononcée sur les articles relevant de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, mon intervention ne portera que sur les articles délégués au fond à la commission des affaires économiques.
Je ne peux commencer qu’en félicitant notre collègue rapporteur pour avis Patrick Chauvet pour l’excellence de son travail et pour l’attention particulière avec laquelle il s’est efforcé de trouver des solutions de synthèse, quelle que soit la technicité des sujets abordés.
Les apports de notre commission des affaires économiques sont nombreux : insertion du stockage de l’électricité dans le dispositif de la loi, facilitation de la production du biogaz, encouragement à la production d’hydrogène vert, possibilité de renforcer les capacités des installations hydroélectriques, etc.
Le temps qui m’est imparti ne me permettant pas de tout traiter, je me concentrerai sur trois points.
Le premier, sans doute le plus préoccupant pour les territoires, est bien sûr l’objectif de « zéro artificialisation nette » – le fameux ZAN –, qui inquiète. Du fait de la transition énergétique, les territoires se trouvent confrontés à un conflit d’impératifs écologiques. D’un côté, il faut limiter l’artificialisation pour préserver les milieux naturels ; de l’autre, il faut construire et développer des infrastructures énergétiques pour décarboner notre mix.
Il est donc nécessaire d’articuler ces deux impératifs pour que l’artificialisation énergétique ne phagocyte pas tout le potentiel, au détriment de l’aménagement local. Compte tenu du décret en vigueur concernant la nomenclature du ZAN, il faut impérativement en exclure les infrastructures énergétiques.
C’est précisément ce qu’a fait la commission sous la houlette de son rapporteur, qui a ouvert la boîte de Pandore, en procédant au premier aménagement de l’objectif ZAN depuis son adoption dans la loi Climat et résilience. Madame la ministre, il y en aura d’autres – le Gouvernement s’y est déclaré favorable. Nous les accompagnerons attentivement en gardant pour ligne directrice de rendre l’objectif ZAN applicable sur tous les territoires sans le vider de sa substance.
Le deuxième sujet que je souhaite aborder porte sur le partage de la valeur, qui est un élément clé en matière d’acceptabilité des projets d’énergies renouvelables. Dans le dispositif initial, en fléchant l’intéressement sur les riverains, on donnait l’impression de vouloir acheter leur silence. On pouvait, de plus, craindre que ce partage ne soit en réalité qu’anecdotique. Nous avons donc adopté en commission un amendement visant à réorienter le dispositif en augmentant le montant du partage : ce dernier est ainsi étendu à toutes les EnR et le versement forfaitaire est complété par une contribution territoriale servant à financer des projets locaux de transition écologique. De plus, notre commission l’a rendu collectif et public, ce qui semble plus logique.
Le dernier sujet que j’aborderai est plus problématique. Il porte sur la déclinaison territoriale des objectifs de production d’énergie décarbonée.
Comment satisfaire nos besoins nationaux si les projets ne sont ni voulus ni acceptés dans les territoires ? Concernant les éoliennes terrestres, la problématique est caricaturale et clivante. Elle l’est aussi en réalité pour toutes les énergies bas-carbone, depuis les centrales jusqu’aux panneaux photovoltaïques, en passant par la production de biogaz.
Nous devons trouver un système de gouvernance de la transition énergétique qui parvienne à conserver un équilibre entre objectifs de production et soutien territorial. Or nous en sommes loin.
Notre commission a néanmoins commencé à poser des jalons en permettant aux collectivités qui le souhaitent d’améliorer leur planification énergétique via le Scot et de manière simplifiée.
La programmation pluriannuelle de l’énergie devrait nous apporter un cadre global. C’est du moins ce que nous appelons de nos vœux. Madame la ministre, nous serons à vos côtés pour l’élaborer.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au moment d’examiner ce projet de loi, nous sommes nombreux à nous interroger tant sur sa finalité que sur les moyens envisagés. Accélérer, mais pour quoi faire, dans quel but et avec quelle visibilité ?
Madame la ministre, votre objectif primordial est-il de limiter drastiquement nos émissions de carbone ? Dans ce cas, nous ne pouvons que pointer l’incohérence d’une démarche qui consiste à isoler une thématique particulière, celle des seules énergies renouvelables, au lieu d’envisager le sujet du mix énergétique dans sa globalité.
Certes, dans une sorte de parallélisme des formes, le Gouvernement nous proposera d’examiner prochainement un texte analogue concernant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Or ce texte aurait très bien pu être intégré au débat du jour, ce qui aurait eu le mérite de nous conduire à considérer globalement les forces et les faiblesses de notre production électrique.
Nous ne mesurons toujours pas la réalité concrète de la politique du Gouvernement dans le domaine du nucléaire. Quelle est la stratégie du président Macron en la matière ? Est-ce celle des années 2017 à 2019, qui a conduit à la fermeture des réacteurs de Fessenheim et à l’arrêt du programme de recherche Astrid, ou bien celle des années 2020 à 2022 où les annonces de relance du nucléaire se sont succédé sans jamais aboutir à la signature de commandes ? Quand le « en même temps » se traduit par le stop and go, les effets sont catastrophiques.
En outre, la programmation pluriannuelle de l’énergie est intenable. La multiplication d’objectifs plus ambitieux les uns que les autres, fixés à un horizon très lointain, n’y change rien. Comme l’a souligné le rapporteur Didier Mandelli, sa redéfinition aurait dû être un préalable à toute discussion sur les orientations à prendre pour les prochaines décennies. Madame la ministre, c’est encore une occasion ratée de mener un débat de fond qui aurait pu être dépassionné.
Pour accélérer, il faut avoir une certaine visibilité. Du point de vue méthodologique, l’idéal serait d’avoir une feuille de route et un itinéraire clair avant de s’engager sur une voie d’accélération. A minima, connaître la direction de son déplacement est d’une utilité certaine pour quiconque envisage de prendre la route.
Madame la ministre, l’initiative du Gouvernement ne satisfait aucun de ces critères. Il n’y a ni visibilité, ni feuille de route, ni direction bien identifiée ; en définitive même la boussole fait défaut !
Mes chers collègues, sommes-nous certains de vouloir accélérer dans le brouillard, quand il s’agit d’une politique publique essentielle tant pour le développement économique que pour la souveraineté de notre pays ?
D’un point de vue très personnel, tout cela me fait penser à la copie d’un mauvais élève en mathématiques, que le ministre de l’éducation nationale essaierait de nous dissimuler et dans laquelle on trouverait pêle-mêle, sans aucune logique, un tas de théorèmes inappropriés, censés mener à une conclusion dont on ne discernerait plus du tout les contours.
Aussi, dans la grande sagesse du Sénat, que votre Gouvernement reconnaît désormais régulièrement et souligne même tout particulièrement depuis quatre mois, les commissions saisies de ce texte ont tenté de le remodeler pour mieux encadrer certaines dispositions.
Je citerai notamment les simplifications envisagées en matière de droit de l’urbanisme, dont les rapporteurs ont voulu qu’il relève davantage de l’initiative des élus locaux, et le régime de partage de la valeur prévu à l’article 18, qui privilégie une redistribution publique et collective plutôt que celle, privée et individuelle, dont on peut soupçonner qu’elle vise surtout à éteindre le feu des contestations grâce à quelques piécettes empruntées au budget de la Nation.
Je salue donc le travail des rapporteurs qui ont réussi, malgré la confusion des intentions et l’absence de rigueur du Gouvernement dans son approche méthodologique, à produire un texte pragmatique et proche des réalités de terrain.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d’abord saluer les apports des différents groupes dans l’examen de ce texte. Ces avancées contribueront à tenir l’objectif d’une production amplifiée d’électricité bas-carbone dans les années à venir.
Toutefois, des sénateurs issus de plusieurs groupes ont mentionné le droit de veto préalable des maires, le terme « préalable » se justifiant par le fait que ce veto interviendrait très en amont des projets sans qu’on ait pu en analyser l’impact économique, énergétique, environnemental et paysager. Il faut nommer ce droit tel qu’il est, en reconnaissant donc qu’il consiste à bloquer certains projets. Or je ne crois pas que ce soit là l’ambition qu’ont défendue les représentants des groupes qui se sont exprimés.
Je renouvelle donc la proposition que j’ai faite au rapporteur, celle de trouver un dispositif équilibré qui concilie l’accélération des énergies renouvelables et la participation des élus, qui doivent avoir le dernier mot.
J’ai aussi entendu les réflexions que vous avez fait remonter au sujet du traitement des dossiers et des ressources humaines. Je veux donc redire ici que l’État doit en effet mieux s’organiser pour permettre le déploiement des énergies renouvelables. Nous l’avons fait puisque, comme vous le savez, nous avons renforcé les moyens de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), grâce à 37 ETP supplémentaires, ce qui est inédit dans l’histoire du budget du ministère de la transition énergétique et de celui de la transition écologique et solidaire. Jamais, en effet, depuis vingt ans, on n’a vu un tel renforcement des équipes.
J’y reviendrai, monsieur le sénateur.
Nous avons également adressé une circulaire aux préfets afin qu’ils puissent non seulement animer leurs propres équipes, mais aussi aller chercher des solutions, accompagner les élus locaux et mettre à leur disposition des cartographies pour déterminer plus rapidement avec eux les zones les plus propices au développement des énergies renouvelables. La dynamique est lancée et nous avons tenu compte des retours du Conseil national de la transition écologique (CNTE), auquel participent des associations d’élus, des associations environnementales, des organisations syndicales et des représentants d’entreprises.
Nous avons signé, le 29 octobre dernier, le décret relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, hors énergie éolienne, et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, qui réduit à dix mois les périodes de contentieux devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel, entraînant en l’absence de décision du juge un passage automatique à l’instance supérieure.
Ces décisions très pragmatiques montrent que nous abordons le sujet de la production des énergies renouvelables de la manière la plus analytique possible. À quels blocages se heurtent les projets ? Comment les lever ou, autrement dit, comment faire pour que les Français disposent d’une énergie bas-carbone en abondance et à un prix compétitif ?
Quant à la stratégie énergétique du Gouvernement, il me semble que vous la connaissez déjà, puisque lors d’un débat de trois heures, organisé le 12 octobre dernier, la Première ministre – j’étais malheureusement absente, souffrant de la covid-19 – est venue devant vous répondre à toutes les questions sur le sujet.
Vous la connaissez d’autant mieux qu’elle étaye les différents scénarios envisagés par RTE, dont vous auditionniez les représentants, hier encore, sauf erreur de ma part. La construction de ces scénarios est l’aboutissement d’un travail de deux ans sans équivalent dans les autres pays européens et qui n’existe pas de manière aussi approfondie dans les autres pays de l’OCDE. Ce travail a permis d’élaborer pas à pas une perspective de production énergétique sur la base du nucléaire et des énergies renouvelables, en fixant des objectifs potentiels et en traçant des scénarios qui peuvent aussi être de réduction de la consommation, puisque – vous l’avez compris – la sobriété et l’efficacité énergétique sont au cœur des enjeux énergétiques.
Je veux aussi rappeler que, en plus de nous orienter selon cette boussole qui existe bel et bien et que vous connaissez, nous avons aussi respecté la décision du Parlement selon laquelle le Gouvernement devait s’appuyer sur un débat public très large. Lancé en octobre dernier, celui-ci a déjà permis de recueillir 8 000 contributions en moins de deux semaines, ce qui témoigne de l’intérêt des Français pour le sujet.
Par conséquent, nous ne forçons pas le processus, mais nous nous appuyons sur l’acquis de la précédente programmation pluriannuelle de l’énergie. Comme vous avez été nombreux à le signaler, nous sommes en retard sur les énergies renouvelables. Faut-il donc attendre encore, alors que nous sommes tous d’accord – vous l’avez dit unanimement – sur la nécessité d’accélérer ? Bien entendu, nous construirons ensemble la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Il me semble important de revenir sur un point. À aucun moment depuis le lancement du programme électronucléaire, la part du nucléaire n’a dépassé 20 % de notre consommation d’énergie. Il est nécessaire de le rappeler parce qu’il y a souvent une confusion, dans les débats en matière énergétique, entre électricité et énergie. Or l’énergie, c’est aussi la chaleur et le carburant. L’enjeu de la transition énergétique consiste précisément à pouvoir se passer de carburant pour se déplacer et de gaz pour se chauffer. Nous aurons besoin pour cela non seulement de réduire notre consommation, mais aussi de développer le nucléaire.
Le chiffre pourra vous surprendre, mais, depuis l’an 2000, nous avons renforcé notre résilience énergétique de sorte que nous sommes moins dépendants de l’extérieur. Alors que, en 2000, nous dépendions à 72 % des importations pour notre consommation d’énergie, en 2020, nous n’en dépendons plus qu’à 65 %. Il ne s’agit pas de se féliciter d’un tel chiffre, mais de constater que, contrairement aux idées reçues, nous avons réduit notre dépendance aux importations d’énergie. Il est essentiel de le préciser dans ce débat et de ne pas confondre électricité et énergie pour éviter d’entretenir de fausses idées auprès des Français.
Je souhaite moi aussi que nous ayons un débat de fond, dépassionné, sur l’énergie. Il interviendra en 2023 à l’occasion de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie, mais vous connaissez déjà les grands axes de ce que nous proposerons, puisque le Président de la République, il y a déjà huit mois, a annoncé très clairement sa volonté de relancer la construction de six nouveaux EPR. Il a également exprimé son souhait de mettre à l’étude le projet de huit EPR additionnels et il a signifié que nous nous engagerions dans une stratégie de réduction de la consommation en nous calant sur les scénarios de RTE. Il a enfin précisé la trajectoire qu’il recommandait en matière d’énergies renouvelables, soit la multiplication par dix d’ici à 2050 de notre production photovoltaïque et l’installation de 40 gigawatts d’éoliennes marines. Nous aurons un débat sur tous ces sujets.
Le Président de la République a également indiqué que nous prolongerions les centrales nucléaires pour une durée maximale, en tenant compte des impératifs de sécurité.
Enfin, lorsque nos prédécesseurs ont lancé le programme électronucléaire, ils l’ont fait pour quarante ans. Personne n’ignorait, lorsque les centrales nucléaires ont été mises en service entre 1977 et le début des années 1980, que, quarante ans plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, nous devrions faire des visites de contrôle qui dureraient plus de six mois. Personne ne l’ignorait, tout comme personne n’ignore que, dans dix ans, il faudra répéter le même exercice dans des conditions plus difficiles encore, puisque les centrales auront dix ans de plus et qu’elles sont soumises comme tout équipement à une forme d’obsolescence liée à leur utilisation. Une partie des composants est remplaçable et cela autant de fois que nécessaire, mais une autre ne l’est pas, c’est notamment le cas des cuves.
Toutes ces évolutions sont connues et sans surprise. La crise énergétique que nous traversons nous montre que les importations sur lesquelles nous avons compté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – pour ne pas remonter à des temps antédiluviens – ne sont pas acquises, que ce soit à cause d’arrière-pensées géopolitiques, notamment dans le cas de la Russie, ou parce que la transition énergétique dans laquelle nous sommes engagés a pour conséquence d’augmenter les prix. Ces importations ne sont pas non plus acquises à un prix compétitif, parce que nous payons – c’est bien légitime – le prix de l’empreinte carbone du pétrole et du gaz. L’enjeu auquel nous devons faire face est celui du dérèglement climatique, dont plus personne ne peut minorer l’impact.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
TITRE Ier A
MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)
I. – Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :
1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies, mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 dudit code ;
2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;
3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.
II. – Pour l’identification de ces zones, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégories d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ;
2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;
3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article, et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie.
Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration des listes mentionnées au 3° du présent II ;
4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° du présent II, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1°, et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.
La liste régionale mentionnée au 4° ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes mentionnées au 3°.
III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.
IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II du présent article, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire métropolitain, les zones mentionnées au I du présent article. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.
V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».
VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.
IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.
X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article.
XIII. – Le III de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »

Le projet de loi sur les énergies renouvelables était nécessaire dans le contexte actuel de la crise énergétique, du dossier EDF auquel il reste à trouver une solution et de son corollaire, à savoir le renouvellement des concessions des barrages et les investissements à venir. Quelle est l’ambition du Gouvernement en matière d’énergies renouvelables, quelles sont les perspectives dressées pour le secteur ? Je constate, une nouvelle fois, que l’examen du projet de loi par les différentes commissions du Sénat aura permis d’améliorer le texte et de lui donner une cohérence.
En effet, il était surprenant qu’un texte sur les énergies renouvelables ne contienne pas de dispositions relatives à l’hydroélectricité, dont je rappelle qu’il s’agit de la deuxième source de production électrique après le nucléaire, puisqu’elle représente 14 % de la production d’électricité. En outre, avec une part de 49 % de production brute, elle est aussi la première source d’électricité renouvelable. Grâce à ses 2 300 installations hydroélectriques de taille et de puissance très diverses, la France est le deuxième pays de l’Union européenne en puissance hydraulique installée pour un total de 25, 5 gigawatts, dont 14 gigawatts totalement flexibles.
Enfin, la filière industrielle française de l’hydroélectricité est une filière d’excellence au rayonnement mondial, composée à la fois de grands groupes et de PME performantes et créatrices d’emplois.
L’hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable, flexible et non intermittente, est essentielle dans le mix énergétique actuel. Elle a donc toute sa place dans ce projet de loi. C’est pourquoi l’adoption en commission d’amendements facilitant les procédures administratives pour le développement de l’hydroélectricité est une bonne chose.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

Élu du département de l’Oise, où une forte partie du territoire est couverte, pour ainsi dire, de forêts ou de bosquets éoliens, je souhaite m’exprimer sur un aspect parfois négligé, voire oublié, du sujet – seule Laurence Garnier l’a mentionné –, celui du déséquilibre de la cartographie et de l’implantation des éoliennes, et des enseignements qu’il faut en tirer.
En effet, on ne part pas d’une feuille blanche, loin de là. Ces profondes disparités en disent long sur les méthodes de puissants promoteurs qui se parent de l’habit écologiste pour accumuler de l’argent sur le dos des collectivités les plus modestes.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Stéphane Demilly Applaudit également.

En effet, les élus des territoires les moins favorisés économiquement se trouvent trop souvent contraints de céder à une forme de chantage financier. N’ayant que peu ou pas de ressources, ils acceptent cette manne pour tenter d’entretenir et d’améliorer les services et les équipements offerts à leurs administrés.
Chacun pourra constater, cartes à l’appui, que les territoires les plus pauvres sont aussi les plus saturés d’éoliennes. C’est là où les entreprises ont péri que les éoliennes ont fleuri.
Ce texte traduit d’ailleurs, en son article 18, cette volonté d’acheter l’acceptabilité sociale et politique des projets. Cette générosité hypocrite nourrit le mépris à l’égard de citoyens ruraux jugés réfractaires au progrès. Victor Hugo l’écrivait déjà en 1869 : « C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. »
Personne, ni dans cette assemblée ni dans les conseils municipaux, ne s’oppose aux énergies renouvelables, mais rien ne pourra s’accomplir au détriment de la démocratie locale et de l’adhésion populaire. La bonne conscience environnementale des uns ne peut pas faire l’impasse sur la qualité du cadre de vie des autres ni sur leur volonté.
Lutter contre le péril climatique et environnemental, ce n’est pas non plus satisfaire les lubies de citadins favorisés, qui ne subiront jamais les nuisances du diktat éolien.

C’est encore moins céder aux résolutions technocratiques d’un État aveugle aux réalités locales.
Mes chers collègues, saisissons l’occasion offerte par ce texte pour changer la donne en redonnant le pouvoir aux territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

L’article 1er A, introduit en commission, prévoit la mise en œuvre d’une planification ascendante, sur l’initiative des territoires, pour le choix des sites de production d’énergies renouvelables.
Si je peux comprendre les contraintes qui s’imposent au Gouvernement et motivent son objectif, je déplore que ce texte tienne si peu compte de l’avis qui s’exprime dans les territoires, ceux-là mêmes dont nous sommes les gardiens, au Sénat, ce qui nous oblige.
La concertation et l’acceptabilité, qui figurent de manière louable dans l’exposé des motifs du texte, restent – je le crains – des habillages verbaux. Pourrait-on m’expliquer comment elles pourraient être améliorées grâce à des enquêtes publiques dématérialisées, dans un processus mené au pas de course et sans tenir compte de l’avis des populations et des élus, alors que les voies de recours sont toujours plus restreintes ?
De même, comment les éoliennes peuvent-elles devenir « des atouts et des facteurs d’attractivité pour les territoires » – je vous cite, madame la ministre –, alors même qu’elles entraînent la ruine touristique et une dépréciation inestimable de la qualité de vie et du foncier pour les habitants ?
Marques de désapprobation sur des travées des groupes SER et GEST.

Dans une démocratie digne de ce nom, qui part des territoires, l’avis des populations locales doit être souverain en actes, pas seulement en paroles. Il leur revient de décider du devenir de leur cadre de vie et de la préservation de leur patrimoine environnemental. S’il y a des arbitrages à faire, par nécessité, et des territoires à sacrifier, ce choix doit leur revenir, avec, en garantie des préjudices nommés et conformément à notre droit, un dédommagement à juste valeur, selon l’encadrement juridique prévu, sans qu’il soit besoin d’inventer le concept de « valeur partagée », dont la générosité se résume à la poignée de chique de la ristourne sur consommations futures payée par le contribuable.
Oui à l’accélération des EnR, mais de toutes les EnR, celles qui remontent des initiatives locales dans le cadre de projets résilients, développés dans les territoires avec l’appui des populations, et qui reposent sur une intégration complète et objective de la décarbonation réelle et des coûts imposés à la collectivité.
Dans ces conditions, je serai très vigilante quant au respect de la concertation, …

Mme Kristina Pluchet. … avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels le maire et son conseil municipal.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La crise énergétique que nous traversons est sans précédent : restrictions de gaz, centrales nucléaires à l’arrêt, barrages en manque d’eau après les sécheresses estivales, tout le parc de production électrique français est sous pression et nos concitoyens sont confrontés à des difficultés inédites.
Le projet de loi que nous examinons a pour ambition de favoriser le développement des énergies renouvelables. Cela est nécessaire et le contexte géopolitique a fini par convaincre les plus récalcitrants.
Le Conseil d’État a approuvé ce texte tout en relevant que son étude d’impact était « insuffisante sur plusieurs articles, voire inexistante sur certaines dispositions pourtant importantes ». Or l’impact de ce texte peut être très lourd pour nos concitoyens.
Il prévoit notamment d’alléger les exigences environnementales imposées pour installer éoliennes et panneaux en nombre, et de dédommager certains riverains s’ils acceptent près de chez eux ces sources d’énergie dites « vertes ».
Si je comprends – une fois de plus – l’intérêt d’agir rapidement et la nécessité d’alléger les procédures, je souhaite néanmoins que l’on n’évacue pas d’un revers de main l’avis des populations concernées par certaines installations, dont en particulier dans ma région les mâts éoliens.
Sur ce point, je salue les avancées obtenues en commission. Je plaide depuis longtemps en faveur d’un droit de veto pour les conseils municipaux des communes d’implantation des projets. Ce droit de veto doit être clair et ne pas s’appliquer « d’une certaine manière », comme vous l’avez laissé entendre, madame la ministre, car « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ».
Ce n’est pas une lubie que de reparler des éoliennes à l’occasion de l’examen de ce texte. Madame la ministre, les Hauts-de-France sont la première région en matière d’implantation de mâts éoliens, avec 28 % de puissance installée et 30 % de la production nationale. À certains endroits, nous sommes confrontés au mitage du territoire.
Pour favoriser l’acceptabilité de tels projets, il ne suffira pas de distribuer des chèques, mais il faudra consulter les représentants des populations locales et obtenir leur accord. On ne peut pas, sous couvert de l’urgence, accepter un déni de démocratie locale.
Nous savons tous ici qu’une transition écologique, résiliente et souveraine, ne peut se faire contre les populations. Je souhaite donc que la stratégie et les choix d’investissement soient élaborés dans la transparence, …

M. Stéphane Demilly. …en concertation avec les représentants des territoires et que le débat parlementaire qui s’ouvre soit constructif.
Mme Nadia Sollogoub applaudit.

Nous sommes tous d’accord, il faut accélérer très fortement l’installation et le développement des énergies renouvelables. Toutefois, la question reste de savoir comment le faire.
Je salue le travail accompli par la commission à l’article 1er A, notamment les mesures visant à renforcer la planification territoriale et à améliorer la concertation. Tous ceux qui se sont exprimés précédemment en conviennent, cette planification est nécessaire ainsi que des orientations nationales qui pourront se décliner ensuite à l’échelle locale. C’est sans doute ce qui a manqué jusqu’à présent. Il convient de travailler à ces différents échelons et d’orienter nos efforts vers l’articulation de cette planification et d’un ciblage des zones d’implantation.
J’avais déposé un amendement qui visait plus particulièrement l’énergie solaire, mais qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Je note au passage que l’on ne peut même plus confier de mission aux agents publics en poste, sans fixer de date butoir, pour que le dispositif s’étale dans le temps. Notre marge de manœuvre en matière d’amendement devient très étroite…
Je tiens toutefois à défendre le concept de cadastre solaire, car il me semble que pour développer cette énergie, il faut que l’on identifie toutes les zones solarisables de France, notamment celles des toitures, grâce auxquelles on pourrait enrichir la planification. La meilleure échelle pour le faire est celle des EPCI et des métropoles via leur syndicat des énergies renouvelables.
La métropole de Lyon, par exemple, s’est livrée à ce travail, dont elle a publié les résultats en 2018. Il me semble que c’est un exemple à suivre, car cela permettrait de renforcer l’implantation de la production d’énergie solaire.
Telle est selon moi la manière la plus efficace de concilier le développement des EnR et la lutte contre l’artificialisation des sols.

La crise environnementale que nous voyons venir depuis des années, et dont nous commençons à peine à entrevoir les effets dévastateurs, nous oblige à diversifier et intensifier notre mix énergétique, notamment grâce à l’usage des énergies renouvelables. Cependant, cela ne doit pas nous pousser à déployer de manière anarchique des éoliennes et des panneaux solaires.
Dans le département du Nord, les éoliennes sont légion, et les projets nombreux. La concentration est telle qu’à certains endroits les habitants ressentent un phénomène d’encerclement et de saturation. La concertation avec la population n’est pas accessoire ; elle doit être approfondie, pour éviter rejets, recours, retards et finalement échecs.
J’imagine mal comment nous pourrions viser l’acceptabilité de nouveaux projets d’EnR en recourant à la participation électronique et en supprimant le commissaire enquêteur des enquêtes publiques. L’ensemble des acteurs associatifs connaît le rôle social indispensable des commissaires enquêteurs lors de la conduite d’enquêtes publiques. Il aide les populations consultées en leur rendant accessible le dossier du projet ; il les accompagne et les aide à formuler des réponses.
J’en viens au phénomène de l’illectronisme, qui touche 14 millions de Français. Contrairement aux idées reçues, il ne touche pas seulement les plus âgés d’entre nous. Près d’un Français sur deux est en difficulté avec le numérique. La participation électronique exclut de fait une grande partie de notre population.
Ainsi, c’est pour des raisons qui touchent à la fois à l’illectronisme et au rôle social fondamental du commissaire enquêteur dans notre démocratie environnementale que son intervention doit être garantie.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Renforcer la planification territoriale, améliorer la concertation et favoriser la participation des collectivités territoriales à l’implantation des énergies renouvelables nécessite de prendre en compte la situation actuelle.
L’inégalité en termes d’implantation est criante. La saturation devient insupportable par endroits, tout comme le mépris des projets et des avis des élus locaux. Par exemple, treize départements, dont la Somme, sont parties prenantes de l’association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre, qui a pour objectif de classer au patrimoine mondial de l’Unesco les sites mémoriels du front ouest de la Première Guerre mondiale. Le projet aboutira s’il répond aux recommandations du Conseil international des monuments et des sites (Icomos), à savoir garantir un plan de gestion des sites, ce qui implique de préserver leur environnement. Malheureusement, les élus sont confrontés à l’obstination gouvernementale, qui passe outre les avis des élus locaux opposés à ces implantations.
Je vous renvoie au projet autour du site du mémorial australien et néo-zélandais Sir John Monash à Villers-Bretonneux, la ministre de l’époque ayant refusé d’attaquer la décision de la cour d’appel désavouant la décision préfectorale.
En outre, la Somme comptait, en juillet 2022, 747 aérogénérateurs en production, 212 autorisés et 178 en instruction, soit une consommation d’espace de 180 hectares.
Nous sommes convaincus de la nécessité du développement des énergies renouvelables, dans le cadre du mix énergétique indispensable pour satisfaire nos besoins et garantir notre souveraineté énergétique, mais l’effort doit être, territorialement et techniquement, équitablement réparti.
Ainsi, le Sraddet devrait définir, dans la concertation entre l’État et les élus locaux, les objectifs territoriaux de production des EnR, selon un mix adapté aux potentialités locales. Il devrait ensuite créer une zone de développement des EnR, intégrée dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), à laquelle n’échapperaient pas les métropoles et où les objectifs et les règles de construction seraient déterminés.
L’avis conforme des maires serait respecté ; en contrepartie, la conférence des maires devrait s’organiser pour atteindre ces objectifs, via les PCAET et une péréquation fiscale qui serait délibérée en commun.
Décréter le développement des EnR, y compris des éoliennes terrestres, est une chose, l’organiser en est une autre. Nous ne pourrons aboutir que si vous soutenez les principes de la concertation et de l’équité territoriale.
Applaudissements sur les travé es du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.

Effectivement, nous sommes en retard pour atteindre les objectifs de développement des EnR, d’autant plus que l’énergie hydraulique représente déjà 10 % de notre production d’électricité, et ce depuis très longtemps.
La question de l’acceptabilité des projets d’EnR se pose. Il faut dire que, pour l’instant, leur développement s’est fait de façon désordonnée – pour ne pas dire anarchique –, comme on le voit dans mon département pour les parcs photovoltaïques.
Maints projets ont connu et vont connaître une levée de boucliers. La concertation est absolument nécessaire. Elle doit être respectueuse de ce que sont les citoyens – il nous faut tenir compte de la problématique de l’illectronisme. Il faut aussi associer davantage les collectivités et les citoyens, y compris financièrement.
L’énoncé du problème est très clair : accroître la production est nécessaire, mais il nous faut aussi mesurer le changement de paradigme que constitue la production d’électricité grâce aux énergies renouvelables.
Je me permets un petit rappel de physique. Lorsque le courant circule dans un conducteur, celui-ci s’échauffe toujours, ce qui induit une perte d’énergie sous forme de chaleur, appelée « effet Joule ». Pour limiter cette perte, il est possible d’élever la tension électrique, c’est-à-dire de passer sous haute tension. Lorsqu’on produit de l’électricité dans une centrale nucléaire, la production d’électricité est très importante. On fait donc en sorte d’augmenter la tension à la sortie, pour ensuite distribuer cette électricité en minorant les pertes.
En revanche, à la sortie d’un parc photovoltaïque ou éolien, la production est limitée. Il est impossible d’augmenter la tension et d’installer des lignes à haute tension à la sortie de ces parcs. Il serait donc beaucoup plus vertueux de consommer cette électricité alentour, sur place, et donc de favoriser nettement l’autoconsommation.

Vous avez raison, madame la ministre, nous sommes plongés dans une crise durable. Les facteurs conjoncturels sont nombreux : guerre en Ukraine, stress hydrique, la moitié de notre parc nucléaire à l’arrêt. S’ajoutent des facteurs structurels : libéralisation du marché, marché européen, couplage du prix de l’électricité et du gaz. Nombre d’entre nous sont d’accord. Enfin, le défi est de sortir des énergies fossiles. Des dizaines de milliards d’euros d’investissements sont nécessaires.
Nous avons besoin d’avoir un débat global, de construire une vision d’ensemble. Or, madame la ministre, vous nous proposez de saucissonner les problèmes : aujourd’hui nous avons un débat sur les énergies renouvelables, hier vous avez présenté un projet de loi sur le nucléaire, puis viendra la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Voilà le problème : aucun débat sur le mix énergétique que nous voulons. Est-ce le public ou le privé qui aura la main ? Les manques sont patents, et nous serons sans doute contraints de revenir sur les dispositions que nous voterons aujourd’hui lors de l’examen de la PPE, voire de nous contredire.
Je note trois manques principaux dans ce texte. Premièrement, l’hydroélectricité, énergie renouvelable la plus puissante, est ignorée, alors qu’elle représente 11 % de notre mix énergétique.
M. Laurent Burgoa et Mme Dominique Estrosi Sassone exprim ent leur approbation.

Deuxièmement, disposons-nous d’une filière industrielle pour développer ces EnR ? Non ! À Grenoble, pourtant, la société Photowatt, filiale d’EDF, manque d’investissements, à tel point qu’EDF elle-même préfère acheter des panneaux photovoltaïques chinois.
Troisièmement, nous ne parlons pas non plus du plus grand acteur, de notre puissant outil industriel, EDF. Vous abordez la question seulement dans un amendement au projet de loi de finances rectificative (PLFR). Nous devons avoir un débat sur l’avenir d’EDF.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER, ainsi que sur d es travées des groupes UC et Les Républicains.

Je rejoins les propos de M. Olivier Paccaud, qui a dénoncé l’hypocrisie ambiante, parmi les porteurs de projet et l’administration, au sujet des contraintes liées aux projets d’éolien terrestre.
Je vous donnerai deux exemples. Est-il normal qu’un préfet passe outre la décision d’une commune, d’un conseil municipal ou d’un maire ayant pris position contre l’installation d’un champ éolien, et que l’arrêté préfectoral finisse par être contesté devant le tribunal ? Arrêtons ! Ces situations engendrent des climats absolument délétères dans nos territoires.
Est-il raisonnable qu’un champ de 45 éoliennes, en limite d’un parc naturel régional, à proximité d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, puisse continuer à se développer et à obtenir des avis favorables. Arrêtons une telle hypocrisie !
Nous devons nous fixer trois objectifs. Premièrement, les situations doivent être acceptables, du point de vue des citoyens comme des maires. Aujourd’hui, les habitants et les maires ne veulent plus être « violés »
Protestations sur les travées des groupes RDPI et GEST .

J’ai entendu la ministre et le rapporteur dire : « Le maire doit avoir le dernier mot. » Je suis d’accord, tout comme lorsque vous affirmez, madame la ministre, que les collectivités doivent être au cœur de la planification écologique. Mais seulement si les concertations nécessaires ont lieu.

J’aborderai les deux autres points au cours de l’examen des amendements. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

La parole est à M. Frédéric Marchand, sur l’article. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Le constat est clair, et nous le partageons : nous n’avons plus le temps de prendre le temps. Le constat fait par Réseau de transport d’électricité (RTE), il y a quelques mois, est limpide : « Atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. » Ce développement passe par un développement de toutes les énergies renouvelables, notamment de l’éolien terrestre.
J’entends le procès en sorcellerie fait à l’éolien terrestre, notamment dans la région des Hauts-de-France, a fortiori dans le département du Nord, où nous avons de l’éolien terrestre à disposition. Prenons garde, mes chers collègues, à ne pas hystériser par trop le débat. §Nous devons être à la hauteur des enjeux, dans le cadre d’une coopération renforcée entre tous les acteurs, territoriaux et nationaux. Les mécanismes existent, nous le savons, comme l’ont rappelé différents orateurs.
Ne tombons pas dans ce particularisme franco-français, que certains adorent, mais qui interpelle nombre de nos voisins européens, qui ont fait le choix, depuis quelques années, du mix énergétique. Non loin des Hauts-de-France, dans un petit pays qui s’appelle la Hollande, le pays de Vermeer, de Van Gogh, de Jérôme Bosch et de Rembrandt, on se fait très bien aux installations d’énergies renouvelables et d’éolien terrestre.
Mes chers collègues, prenons garde à ne pas trop caricaturer les choses. Avançons dans le sens que nos concitoyens attendent.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées des groupes SER et GEST.

Sans énergie, il n’y a pas de vie. La question est au cœur des préoccupations de nombre de nos concitoyens, surtout dans le contexte géostratégique que nous connaissons. J’ai en mémoire des échanges que nous avions eus à l’Assemblée nationale, il y a quelques années, à la suite du Grenelle de l’environnement, qui visait l’objectif très louable des trois fois vingt : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20 % notre consommation d’énergie et avoir 20 % d’énergies renouvelables. Force est de constater que nous n’avons pas atteint cet objectif.
S’il est essentiel de développer tous les éléments de réflexion et de stratégie, force est de constater que nous avançons dans un ordre qui n’est pas logique. Une grande loi relative à la programmation d’une stratégie énergétique de notre pays aurait été la bienvenue ; c’est ce que souhaitait le général de Gaulle, en son temps. Puis nous aurions pu décliner celle-ci, notamment en matière d’énergies renouvelables.
Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut développer les énergies renouvelables. Il s’agit maintenant de savoir comment. Seront-elles développées en lien avec les acteurs de nos territoires ou imposées d’en haut, en fonction de directives et de stratégies nationales qui ne seront pas acceptées par les élus locaux ?
Dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, l’objectif de 300 éoliennes a été atteint. Aujourd’hui, on veut aller au-delà, au mépris des positions des élus locaux. Faut-il défigurer la Montagne noire ? Certainement pas !
Ce texte doit instaurer un certain nombre de garde-fous, pour que la parole des élus locaux et des populations concernées au premier chef puisse enfin être entendue.
Applaudissements sur des travées du groupe UC.

Je m’inscris dans les propos de M. Jean-Marc Boyer, qui veut une France équilibrée. Nous savons qu’il faut avancer, mais regardons la carte des énergies renouvelables. Les Sraddet, et donc les régions, jouent un rôle important. Les collectivités en viennent aussi à s’opposer entre elles. Bien des communes et des départements ont à redire des débats qu’ils ont avec leur région.
Madame la ministre, vous avez dit que les élus doivent avoir le dernier mot. Moi, je voudrais que les élus aient le premier mot. Peut-être que l’expression « droit de veto » est malheureuse, peut-être nous renvoie-t-elle à une forme d’Ancien Régime. Dans tous les cas, les maires doivent absolument être entendus et respectés.
Cela m’amène à un autre débat, celui des architectes des Bâtiments de France (ABF). Au cours de mes mandats, j’ai eu affaire avec huit ABF différents : des bons, et des moins bons. Parfois, j’avais en face de moi non pas un architecte et urbaniste de l’État (AUE), mais un technicien.
Les maires sont responsables de tout et sont à portée d’engueulades matin, midi et soir : laissons-les décider pour leur territoire, celui pour lequel ils ont reçu un mandat. C’est ainsi que nous aurons une France équilibrée !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente, pour la suite de l’examen de ce texte.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.