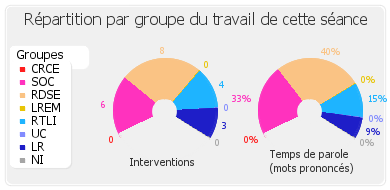Séance en hémicycle du 21 mars 2006 à 10h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

La parole est à Mme Françoise Henneron, auteur de la question n° 986, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, ma question porte sur le rachat des périodes accomplies en qualité d'aide familial par les personnes désireuses de prendre leur retraite agricole de manière anticipée.
Je rappellerai, tout d'abord, monsieur le ministre, que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoyait la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations agricoles.
Un décret du 24 août 2004 est venu préciser les modalités de ce dispositif, alors applicable jusqu'au 31 décembre 2005. Il a d'ailleurs permis à un nombre significatif d'anciens aides familiaux de bénéficier de ces possibilités de rachat, tout en ne compromettant pas l'équilibre de nos régimes de retraite.
Cependant, depuis le 1er janvier 2006, ces dispositions ne sont plus applicables. Ainsi, les personnes ayant souhaité déposer un dossier de demande de rachat de trimestres auprès de la Mutualité sociale agricole, après le 1er janvier, ont vu leur dossier mis en attente, faute de texte actuellement en vigueur.
Or une telle situation est pénalisante pour ceux de nos concitoyens qui souhaitaient pouvoir bénéficier de cette mesure, tout à fait justifiée dans son principe parce qu'elle permettait d'anticiper la retraite de personnes ayant commencé à travailler très jeune, parfois à l'âge de treize ans et demi ou quatorze ans, et ce, souvent, dans des conditions pénibles.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur les mesures qui sont éventuellement en préparation à ce sujet, ainsi que sur leur calendrier d'application ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de me permettre de faire le point sur les mesures de préretraite concernant les aides familiaux qui ont souvent commencé à travailler très tôt et qui peuvent racheter ces années pour acquérir la durée de cotisations nécessaires en vue de partir en retraite anticipée. Il s'agissait, vous vous en souvenez, d'une des mesures contenues dans la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Comme vous le soulignez à juste titre, madame la sénatrice, cette mesure a permis à 7 000 de nos concitoyens de partir en retraite avant soixante ans après une très longue carrière agricole, souvent difficile.
Cela étant dit, il est vrai que, à l'origine, les pouvoirs publics ne savaient pas combien d'aides familiaux pourraient procéder au rachat de leurs cotisations. N'étant pas affiliés au régime d'assurance vieillesse agricole avant l'âge de la majorité, le nombre exact de ces non-salariés était, en fait, inconnu.
C'est la raison pour laquelle le premier décret, dont vous avez d'ailleurs rappelé l'existence dans votre intervention, avait une durée de vie limitée. Or, à l'issue de la première période d'application, un nouveau décret devait intervenir pour corriger, le cas échéant, les imperfections constatées.
Nous avons maintenant une meilleure connaissance de la mesure de rachat. Compte tenu de ce constat, un nouveau décret, similaire au précédent, a été préparé, mais, vous avez raison de le souligner, il n'a pas encore été publié.
Cette situation est due au fait que, après deux ans d'application de la loi portant réforme des retraites, une réflexion a dû être menée sur les conditions dans lesquelles certaines modalités de cette loi devaient être mises en oeuvre.
La question s'est d'ailleurs également posée dans d'autres domaines, je pense ici au rachat des années d'études supérieures, comme elle s'est posée pour le rachat des années d'aide familial.
J'ai le plaisir de vous indiquer, madame Henneron, que la question est désormais tranchée et que les aides familiaux pourront racheter leurs cotisations pour partir en retraite anticipée au-delà de la période antérieure du 31 décembre 2005.
Le nouveau décret a déjà été signé par mes soins et j'attends incessamment sa parution au Journal officiel de la République française.

Un grand merci, monsieur le ministre !
Je ne puis que me réjouir des propos rassurants que vous venez de tenir et je suis persuadée que beaucoup de nos concitoyens ayant exercé en qualité d'aide familial seront heureux de savoir que le dispositif destiné à leur permettre de continuer à prendre une retraite anticipée bien méritée n'est pas abandonné.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 961, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, je voudrais attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation catastrophique de la viticulture et sur ses conséquences directes sur la pépinière viticole française.
En effet, ce secteur agricole, déjà touché de plein fouet par les répercussions de la crise viticole sans précédent à laquelle nous assistons et à propos de laquelle j'ai déjà interrogé M. le ministre de l'agriculture à plusieurs reprises, est confronté à une distorsion de concurrence liée, au sein de l'Union européenne, à la disparité des coûts de main-d'oeuvre, cette dernière représentant près de 60 % du prix des produits finis.
Ainsi, le prix de vente d'un plan est passé de 1, 25 euro en 2005 à moins de 0, 80 euro en 2006, les producteurs italiens vendant, pour leur part, à 0, 70 euro. Autre chiffre : si la France exportait entre 30 % et 40 % de sa production en 2004, ce taux sera à peine de 15 % en 2006 !
Dans le même temps, les reports d'invendus vont passer de 15, 70 % à près de 50 %. Je citerai également un autre chiffre marquant qui concerne directement mon département, la Drôme, et celui de l'Ardèche : alors que la filière a procuré 486 250 heures de travail saisonnier ou permanent, seules 200 000 heures de travail sont envisagées !
L'avenir de cette filière, qui était pourtant l'un des fleurons de l'agriculture française, est ainsi gravement menacé.
Face à cette situation, les syndicats de producteurs sollicitent un soutien important de l'État français.
En matière sociale, ils demandent une prise en charge des cotisations patronales ou un allégement à 90 % de toutes les charges patronales, l'exonération des cotisations exploitants pour 2006 et 2007, en matière de chômage technique pour les contrats à durée indéterminée, dont bénéficient les ouvriers agricoles et les employés administratifs, l'application du même taux que l'industrie et les services, avec ou sans convention collective, ainsi que l'exonération de la taxe foncière non bâtie pour 2006 et 2007 .
Sur le plan bancaire, ils souhaitent le report des prêts pour les annuités 2006 et 2007.
Enfin des mesures de soutien sont vivement attendues, à savoir des indemnisations pour les vignes mères de porte-greffe, pour toutes les plantations avec droits effectuées avant 2000, un accompagnement financier pour toute personne qui désire ou qui serait obligée d'arrêter son activité avec radiation de l'Office national interprofessionnel des vins, l'ONIVINS, ou encore le départ à la retraite ou en préretraite, un accompagnement pour destruction des stocks - plants de vigne - afin d'assainir le marché des plants pour toute entreprise ayant diminué significativement ses mises en terre .
De la même façon, ils réclament également des aides à l'investissement pour toute exploitation désireuse de se diversifier dans d'autres activités complémentaires pour combler le déficit structurel ainsi qu'une répartition des aides de la PAC vers les entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre dans les secteurs spécialisés.
Il est bien évident que l'octroi de toutes ces mesures doit s'ajouter au soutien indispensable, mais qui est à ce jour insuffisant, de l'ensemble de la filière viticole.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, si vous entendez réellement poursuivre les efforts entrepris en matière de filière viticole, notamment dans le secteur de la pépinière viticole.
Monsieur le sénateur, vous avez raison d'évoquer ces deux crises, qui frappent les viticulteurs et les pépiniéristes.
Vous savez que le Gouvernement a déjà mis en place des aides d'urgence de trésorerie, des prêts de consolidation, des aides aux coopératives, des mesures dites AGRIDIFF, des préretraites, des dispositions en faveur de distillations exceptionnelles. Je me suis d'ailleurs entretenu hier, à l'occasion du Conseil des ministres de l'agriculture à Bruxelles avec la Commission européenne, des mesures de distillation pour l'année 2006.
Vous n'ignorez pas non plus que ce train de mesures va se trouver renforcé dans les prochains jours, puisque j'ai pris l'engagement, à la demande de M. le Premier ministre, de présenter, avant la fin du mois de mars, un nouveau plan pour la viticulture.
C'est ainsi que de nouvelles aides seront attribuées pour faire face aux situations difficiles. Nous nous attacherons, en outre, à réfléchir en profondeur à l'organisation par bassin ainsi qu'au système d'exportation.
Par ailleurs, monsieur Piras, il convient, me semble-t-il, de favoriser notre adaptation structurelle sur le plan viticole.
C'est la raison pour laquelle figurera également dans ce plan une stratégie nationale de développement pour la viticulture, assortie de mesures d'accompagnement ; nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler puisqu'une question orale avec débat portant sur la crise viticole sera débattue prochainement au Sénat, à la demande de MM. Delfau, César et Courteau.
J'en viens plus particulièrement à la pépinière viticole qui, se situant en amont, est touchée par la crise de la viticulture.
Les syndicats de producteurs sollicitent le soutien de l'État en matière de chômage partiel.
Il est vrai que les salariés peuvent bénéficier du chômage partiel dès lors qu'une entreprise rencontre des difficultés passagères et exceptionnelles ; en contrepartie, les entreprises doivent s'engager à maintenir les emplois.
Ainsi, les salariés qui subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur entreprise soit à la réduction de l'horaire de travail, bénéficient d'une allocation conventionnelle versée par l'employeur et d'une aide de l'État.
La part de l'État peut être portée à 80 %, après accord du trésorier-payeur général ou du préfet, ou à 100 %, après accord du ministère du budget et du ministère chargé de l'emploi.
Dès lors, s'agissant de cette branche professionnelle, une convention de chômage partiel pourrait être conclue avec les représentants de la profession. au niveau tant départemental que national, les entreprises pouvant ensuite adhérer à la convention.
Je suis donc prêt, monsieur le sénateur, à entrer en contact avec les entreprises de la branche, si elles l'estiment nécessaire, pour mettre au point cette mesure,
S'agissant des taxes foncières sur les propriétés non bâties, le ministre du budget et moi-même nous avons adressé aux comptables du Trésor des instructions constantes, afin que soient acceptées les demandes de délais de paiement, de remises de pénalités ou même de déchéance des paiements, lorsque les contribuables sont dans l'impossibilité de payer. Les services fiscaux disposent à cet égard de la plus grande latitude.
Comme je l'avais souligné à Nîmes, en décembre dernier, ces mesures s'appliquent à tous ceux qui connaissent des difficultés, qu'ils soient viticulteurs ou pépiniéristes. La loi de finances pour 2006, votée par la Haute Assemblée, je le rappelle, a prévu qu'ils bénéficieraient d'une exonération de 20 % du montant de la taxe foncière et d'une diminution équivalente du montant des charges des fermiers. Ces mesures ne profitent donc pas seulement aux propriétaires, mais également aux fermiers.
Monsieur Piras, en résumé, toutes les mesures qui concernent les viticulteurs peuvent tout à fait s'appliquer aux pépiniéristes. Si vous le souhaitez, je suis prêt à demander à mon cabinet de recevoir une délégation de pépiniéristes de votre région, en votre présence, afin que nous puissions formaliser ces mesures dans le cadre d'un plan qui ne serait pas seulement le rappel des dispositions existantes ou des mesures envisageables, que j'ai évoquées en vous répondant.

Monsieur le ministre, merci de votre réponse. Je connais votre engagement et votre attention à ces problèmes.
Tout d'abord, je suis satisfait qu'à la suite de votre rencontre d'hier avec vos collègues européens des mesures complémentaires de soutien aux viticulteurs aient été décidées.
Ensuite, sans entrer ici dans les détails, j'engagerai les représentants des syndicats des producteurs en pépinières à vous demander audience, afin qu'un plan susceptible de répondre à leurs revendications soit élaboré.
Sourires

La parole est à M. Didier Boulaud, auteur de la question n° 979, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, vous le savez, rares - ou en tout cas trop peu nombreuses - ont été les communes reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse de 2003, à telle enseigne que le Gouvernement a jugé nécessaire, à juste titre, de mettre en place une procédure exceptionnelle d'indemnisation.
Ainsi, la loi de finances pour 2006 a créé une enveloppe financière de 180 millions d'euros, qui doit être répartie entre les départements, en fonction du nombre des dossiers de demandes d'indemnisation.
Cependant, je crains que cette enveloppe ne suffise pas à indemniser toutes les victimes et suscite, au final, plus de mécontentements que de satisfactions.
Dans la ville que j'ai l'honneur de gérer, ...

... non d'administrer tout au plus, nous n'avons pas bénéficié du dispositif de catastrophe naturelle.
Pourtant, plus de soixante victimes se sont fait recenser par mes services, et d'autres peuvent être encore se manifester. Toutes ces personnes voient leurs domiciles se dégrader, se fissurer, ou même s'affaisser. Aucune d'entre elles ne dispose des moyens suffisants pour financer les travaux nécessaires. Il me semble donc indispensable de faire appel à la solidarité nationale.
Or les démarches administratives de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont d'une telle complexité qu'elles deviennent, reconnaissons-le, un souci supplémentaire pour ces personnes déjà très affectées, qui, par conséquent, attendent de vous un véritable soutien. Je tiens particulièrement à appeler votre attention sur ce point.
Les propriétaires que j'ai rencontrés ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de remplir un dossier de demande d'aide financière aussi exigeant. Ils s'inquiètent déjà de devoir fournir deux devis d'entreprises différentes et déposer leurs dossiers dans des délais aussi courts.
Monsieur le ministre, imaginez, d'une part, les difficultés que rencontrent les soixante victimes pour trouver ces deux sociétés, d'autre part, le travail que doivent accomplir les rares entreprises de bâtiment de notre région pour délivrer ces devis ! Une telle disposition aggrave la situation.
Monsieur le ministre, comment la procédure d'indemnisation sera-t-elle mise en place ? Nos concitoyens s'interrogent sur ses modalités. Qu'adviendra-t-il si les propriétaires concernés ne perçoivent que 5 % ou 10 % du montant des devis produits ? Comment pourront-ils faire face au coût des travaux ?
Je souhaite pouvoir fournir aux habitants de Nevers les explications qu'ils sont en droit de recevoir. Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser les modalités de l'indemnisation qui sera mise en oeuvre pour couvrir la totalité des dépenses supportées par les victimes de la sécheresse de 2003.
Monsieur le sénateur, vous interrogez M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la procédure exceptionnelle d'indemnisation des communes victimes de la sécheresse de 2003, qui auraient été peu nombreuses à se voir reconnaître l'état de catastrophe naturelle.
Toutefois, je le rappelle, le régime des catastrophes naturelles a produit des effets importants, dans la mesure où il a permis l'indemnisation de près de 4 000 communes au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2003.
Si les critères habituellement utilisés avant 2003 pour statuer sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'avaient pas été adaptés à cette sécheresse atypique, puis assouplis à deux reprises, seules quelque 200 communes auraient bénéficié de ce régime.
J'attire votre attention sur ce point. Quel aurait été le thème de votre intervention d'aujourd'hui si nous en étions restés aux critères d'avant 2003 ? Ceux-ci permettaient l'indemnisation de 200 communes. Nous en dédommageons aujourd'hui 4 000. Il me semble tout de même qu'il s'agit d'un progrès !
M. Didier Boulaud acquiesce.
En ce qui concerne le département de la Nièvre, les communes concernées sont rattachées à l'une des trois stations météorologiques de référence, c'est-à-dire à Château-Chinon, Marzy ou Saint-Georges-sur-Baulche, dont deux répondent à l'ensemble des critères définis pour qualifier la sécheresse de 2003. Ainsi, sur 111 communes demanderesses, 48 peuvent être reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2003.
Trente autres communes, je le précise, doivent, au préalable, par une étude de sol, attester de la présence d'argile sur leur territoire. Elles pourraient ainsi bénéficier également de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui porterait à 70 % la proportion des communes reconnues comme telles dans votre département.
Les autres communes peuvent bénéficier de la procédure de solidarité nationale, dotée d'une enveloppe de 180 millions d'euros, à laquelle sont éligibles les propriétaires de 33 communes de la Nièvre. Je puis vous assurer que la direction compétente du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en contact permanent avec un panel représentatif de douze préfectures, suit de très près la mise en oeuvre de cette procédure.
Comme vous l'avez indiqué, certains sinistrés rencontrent des difficultés pour constituer leur dossier, en particulier pour produire les deux devis nécessaires. Par ailleurs, les entreprises du bâtiment refusent, dans certains cas, d'établir ces devis sans avoir réalisé au préalable une étude de sol.
Ce problème a été rapidement signalé. Saisis par M. le ministre d'État, les ministres concernés se sont accordés pour redéfinir l'obligation relative aux devis. Il a été décidé que la production d'un seul document indicatif, qui pourrait comporter une clause de réserve, émise par les entrepreneurs, concernant l'étude de sol, serait acceptée, le dossier pouvant être complété ultérieurement.
C'est pourquoi une lettre circulaire à l'attention des préfets, en date du 16 mars dernier, engage les représentants de l'État à prononcer l'éligibilité des dossiers des particuliers qui ne comprendraient qu'un seul devis, sous réserve qu'un second puisse être produit ultérieurement.
Ainsi, monsieur le sénateur, considérant que la procédure était complexe, l'indemnisation urgente et l'attente des propriétaires longue, nous avons pris cette décision pour ne pas perdre de temps.
Cette disposition devrait faciliter le traitement des dossiers par les préfectures concernées, étant entendu que les préfets ont reçu toutes instructions pour simplifier au maximum les démarches des particuliers. De même, nous avons demandé aux assureurs d'être particulièrement attentifs à cette question et d'accompagner leurs clients tout au long de cette nouvelle procédure.
Quant aux modalités d'indemnisation, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. le ministre de l'intérieur arrêteront les enveloppes d'aide par département, dans la limite des 180 millions d'euros fixés par l'article 110 de la loi de finances pour 2006, et après avoir fixé les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.
Voilà les éléments que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Il est urgent à présent, me semble-t-il, que les particuliers et les entrepreneurs fournissent les devis nécessaires.
Monsieur le sénateur, je vous assure que les préfets ont reçu des instructions, tout d'abord pour simplifier les procédures, ensuite pour accélérer les indemnisations.
Sur cette base, nous répondrons le plus rapidement possible aux demandes, étant entendu que, normalement, le problème devrait être réglé pour 70 % des communes de la Nièvre. Il l'est déjà pour près de 43 % d'entre elles ; en outre, pour 30 % des communes, nous attendons les retours des trois stations météorologiques. Toutefois, en principe, d'après les premiers éléments dont nous disposons, nous devrions compter bientôt 70 % de communes indemnisées dans ce département.
Resteront 30 % des communes de la Nièvre, qui devraient bénéficier de l'enveloppe de 180 millions d'euros, pour autant que les entrepreneurs fournissent aux particuliers, le plus rapidement possible, un premier devis.

Monsieur le ministre, merci de votre réponse extrêmement détaillée, qui sera de nature à rassurer les personnes intéressées, même si, pour l'instant, toutes les communes ne sont pas éligibles
J'insiste sur le cas de Nevers, qui est presque la seule ville du département. Les personnes concernées sur le territoire de ma commune sont, à elles seules, beaucoup plus nombreuses que les habitants de certaines communes éligibles. Il est facile d'affirmer qu'une commune du département de la Nièvre est éligible, quand, en réalité, seules vingt personnes sont indemnisées, pour peut-être cinq maisons. Le cas dont je vous parle concerne soixante maisons à lui seul !
Vous avez évoqué également la question de la nature des terrains. Vos propos sont de nature à me rassurer, parce que le sol de Nevers est très riche en argile. Vous le savez, il s'agit du pays de la faïence, notamment.
Sourires

Nos sols ne manquent donc pas d'argile. Voilà quelques années, lorsque j'ai fait construire un hôpital, il a fallu planter quelque 500 pieux, parce que le terrain était argileux. Il sera, me semble-t-il, relativement facile de prouver la présence d'argile à Nevers !
Monsieur le ministre, merci en tout cas de ces éléments de réponse, qui sont de nature à faire avancer le débat.

M. le président. Monsieur le ministre, j'espère que vous n'oublierez pas non plus Château-Chinon !
Sourires

La parole est à M. Bernard Murat, auteur de la question n° 974, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, sollicité par de nombreux maires de Corrèze qui sont confrontés à des difficultés concernant l'adaptation des réseaux d'eau à la défense incendie, je suis intervenu à moult reprises et j'ai usé de toutes mes prérogatives de parlementaire afin d'évoquer les problématiques liées à cette question et d'inciter les pouvoirs publics à prendre ce dossier à bras-le-corps.
Il s'agit d'un sujet particulièrement important pour l'ensemble des petites communes rurales de notre territoire, en ce qui concerne leurs relations avec les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, et les différents syndicats d'eau. Dans ce domaine, il importe d'apporter des réponses aux multiples interrogations d'ordre technique, opérationnel, juridique et, bien sûr, financier.
Je ne peux donc que me réjouir de l'engagement pris par le Gouvernement de réformer les règles actuellement en vigueur. Définies, pour l'essentiel, par la circulaire du 10 décembre 1951, complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967, elles doivent être révisées, clarifiées, modernisées et, surtout, expliquées aux maires. Cela passe nécessairement par une remise à plat complète de l'ensemble du domaine d'action : conception de la défense incendie, vérification et entretien des points d'eau, responsabilités des différents intervenants, notamment des syndicats d'eau.
En matière de défense incendie, il est bien compréhensible que chaque territoire reçoive les mêmes garanties d'efficacité. Dans cette perspective, un groupe de travail, composé de représentants du SDIS, des administrations centrales et des institutions concernées, vient, enfin, de rendre ses premières conclusions. Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous nous éclairiez aujourd'hui sur les démarches entreprises et la méthode utilisée, que vous nous informiez sur l'état d'avancement des travaux actuellement menés et que vous nous précisiez les axes autour desquels s'articuleront les propositions de réforme. Comme vous nous l'avez indiqué précédemment, ces informations devraient nous être communiquées au mois de juin prochain. Les élus tout particulièrement attendent la mise en oeuvre de mesures claires.
Plusieurs projets de réforme des règles relatives à la défense incendie, notamment en 1977 et en 1996, n'ont jamais abouti. Il ne faudrait pas qu'il en soit de même cette fois-ci. Parlant au nom de tous les élus ruraux, je tiens donc à vous dire que nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour mener à bien ce dossier et, surtout, pour nous donner des directives très claires, simples et pragmatiques. Par manque de compréhension, nous nous retrouvons souvent en conflit avec les syndicats des eaux et, partant, nous avons des craintes quant au respect de l'équilibre financier de notre budget.
Enfin, je souhaite souligner avec insistance le grand intérêt qu'il y aurait à faire également siéger, dans le groupe de travail que vous mettez en place, des représentants de l'Association des maires de France. Ceux-ci pourraient ainsi faire part de leur vécu sur le terrain et vous être utiles pour parvenir à des solutions qui soient mieux acceptées et pour relayer l'excellent travail que vous êtes en train de faire sur ce dossier important.
Monsieur le sénateur de Corrèze, vous l'avez souligné à juste titre, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales suscitent, chez les élus, de nombreuses et légitimes interrogations ainsi que des difficultés de mise en oeuvre.
Cela fait d'ailleurs plusieurs fois que vous appelez l'attention du ministre de l'intérieur sur ce sujet. Le ministre d'État connaît donc la particulière attention que vous portez à ce dossier important pour le développement du monde rural et m'a demandé de vous informer en détail de l'état d'avancement des travaux qui sont actuellement menés pour résoudre ces difficultés.
Comme l'engagement en avait été pris, lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, un projet de réforme des règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales est en cours depuis le début de l'année 2005.
Un groupe de travail, mis en place sous l'égide de la direction de la défense et de la sécurité civiles, et composé de représentants de six services départementaux d'incendie et de secours, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur et de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'équipement, a rendu ses premières conclusions en juin 2005.
La modernisation envisagée passe par une remise à plat complète de l'ensemble du domaine d'action, en ce qui concerne tant la méthode de conception de la défense incendie que la vérification et l'entretien des points d'eau. Les circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967 seront ainsi abrogées.
Le ministre de l'intérieur souhaite inscrire la conception de la défense des communes contre le risque incendie dans le cadre de la décentralisation et de l'évolution des SDIS. À ce titre, une approche départementale et partenariale rassemblant les responsables élus et les techniciens permettrait, en cohérence avec la politique du SDIS et celle de la gestion générale des ressources en eau, d'arrêter des règles mieux adaptées pour lutter contre ce risque, notamment dans les communes rurales. La défense incendie repose sur toutes les capacités en eau mobilisables : réseaux d'eau, citernes fixes, bâches à eau, points d'eau naturels, réseaux d'irrigation agricole, moyens mobiles du SDIS.
Le projet de réforme prévoit ainsi la définition de règles à trois niveaux : un cadre national global fixant les principes essentiels, un règlement départemental de la défense incendie établi en liaison avec l'organisation du SDIS et un schéma communal ou intercommunal de la défense incendie. Ces règles reposent sur une méthode de conception de la défense incendie fondée sur l'analyse des risques.
Monsieur le sénateur, vous venez de souligner que le maire était le mieux placé pour proposer les réponses adaptées au niveau du territoire de sa commune. Or le cadre réglementaire en vigueur jusqu'à présent a été édicté au niveau national : cela laisse supposer que les modalités, notamment techniques, d'implantation des points d'eau doivent être identiques sur l'ensemble du territoire national.
Il est pourtant inconcevable, d'un côté, d'encourager la décentralisation, en réorganisant les SDIS pour leur donner des compétences particulières et en favorisant la création d'intercommunalités, et, de l'autre, de rester « ancrés » dans le respect de règles anciennes et inscrites dans le marbre qui ont été élaborées au niveau national.
Aujourd'hui, il faut faire confiance aux acteurs locaux dans le domaine de la défense contre les incendies, qui suppose l'utilisation de tous les moyens. En effet, les intercommunalités gèrent leurs propres réseaux d'irrigation selon des critères propres, eu égard à leur situation économique, à leur plan d'urbanisme et à la manière dont elles veulent diversifier l'attractivité de leur territoire. Bien évidemment, cela n'aurait aucun sens de ne pas tenir compte de telles spécificités. Si nous avons décidé de confier totalement, à partir de 2008, la gestion des SDIS aux conseils généraux, qui apporteront l'essentiel des financements, nous avons également souhaité que les maires puissent continuer de siéger au sein des conseils d'administration des SDIS. La question a d'ailleurs fait l'objet d'un important débat, ici même, au Sénat.
Nous avons ainsi démontré notre volonté de voir les maires jouer un rôle prédominant dans la lutte contre l'incendie. Acteurs du développement de leurs communes, ils peuvent apporter une contribution importante à la réflexion sur l'organisation des SDIS et sur l'implantation des centres de secours. Ils ont le pouvoir de décider de l'implantation d'un plan d'eau ou de l'aménagement d'un canal d'irrigation, pour développer une zone agricole ou alimenter un nouveau lotissement. Il serait donc complètement ridicule de ne pas inscrire toutes ces décisions dans le schéma des points d'eau mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci doivent en effet pouvoir utiliser toutes les potentialités offertes par la commune pour lutter contre les incendies.
La réglementation actuelle, qui aboutit à une uniformisation de la gestion des points d'eau sur tout le territoire national, n'a donc plus de sens. C'est la raison pour laquelle le ministre a voulu s'appuyer, dans le cadre de la décentralisation, sur la réflexion des maires.
Monsieur le sénateur, s'il ne faut pas baisser le niveau d'exigence en matière de sécurité, il importe, comme vous le souhaitez, d'utiliser des moyens plus diversifiés et mieux adaptés aux contraintes du monde rural.
À ce titre, je le répète, le point de vue des maires doit être prédominant dans la réforme que nous sommes en train d'engager. Vous suggérez que des représentants de l'Association des maires de France puissent siéger dans la commission qui aura à réfléchir à ces sujets au niveau national. Je ne vois que des avantages à votre proposition et je la soumettrai au ministre de l'intérieur.
En tout état de cause, en termes de calendrier, nous devons désormais avancer très vite : avant la fin de l'année 2006, nos travaux doivent donc raisonnablement aboutir, sur la base de l'échange que nous venons d'avoir ensemble.

Monsieur le ministre, nous intervenons souvent dans cet hémicycle pour interroger le Gouvernement sur des questions précises. Nous faisons remonter les problèmes du terrain pour mieux lui en faire comprendre les caractéristiques et pour qu'il soit en mesure de nous apporter les réponses adéquates.
Or, je veux le souligner, c'est véritablement la première fois qu'un ministre, lui-même élu de terrain, évite l'écueil de la réponse de circonstance pour nous proposer, au contraire, les pistes que nous, les élus, sommes en droit d'attendre et pour prouver, ainsi, sa parfaite connaissance du dossier.
Effectivement, monsieur le ministre, il serait bon que les maires soient complètement impliqués dans la procédure en cours. Vous le savez très bien, les informations fournies par les SDIS sont assez techniques et il y a toujours quelques distorsions entre la théorie et la pratique sur le terrain. Ainsi, lorsqu'une entreprise, souvent une PME ou une TPE, désire s'installer sur un territoire rural, les contraintes qu'elle doit respecter en termes de défense incendie obèrent très largement son budget d'investissement. Je connais beaucoup d'exemples, en Corrèze particulièrement, où des entreprises n'ont pas pu s'installer parce que les collectivités ne pouvaient pas répondre à une telle exigence.
Par conséquent, votre réponse va dans la bonne direction. Soyez assuré que nous serons attentifs à vos côtés pour vous aider à relayer ce message d'espoir sur un sujet qui, à l'évidence, perturbe énormément tous les élus locaux.

La parole est à M. François Marc, auteur de la question n° 969, adressée à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, je souhaite interroger le Gouvernement sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement des départements, en particulier sur celle de la péréquation. Comme chacun le sait, c'est lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2005 que le Gouvernement a introduit une réforme de la dotation globale de fonctionnement, ou DGF, et qu'un nouveau dispositif a été mis en place. Nous avions fait remarquer à l'époque que nous ne disposions pas, en tout cas au Sénat, des simulations nécessaires pour pouvoir évaluer correctement les incidences de cette réforme.
À l'issue d'une expérimentation de deux ans, nous pouvons aujourd'hui tirer un certain nombre d'enseignements. Tel est donc le sens de ma question, qui porte sur le cas particulier du département du Finistère.
Ce département est doté d'un potentiel financier par habitant sensiblement inférieur à la moyenne. En effet, alors que la moyenne nationale des départements urbains s'établissait, en 2005, à 549, 77 euros, le potentiel financier par habitant dans le Finistère était de 463, 36 euros.
La mise en place de nouveaux mécanismes de péréquation introduits par la réforme de la DGF, intervenue à partir de 2005, pouvait donc nous laisser croire que ce département, peu favorisé en termes de ressources fiscales, bénéficierait d'un effet correcteur positif. Or, tel n'est pas le cas : le taux de progression de la dotation de péréquation, qui était de 8 % en 2004, n'a ainsi été que de 4, 15 % en 2005 et serait même nul en 2006.
En ce qui concerne l'année 2006, les dotations allouées aux collectivités évoluent en moyenne de 2, 73 % alors que, pour le Finistère, le taux ne sera que de 2 % à périmètre constant, hors régularisation des années antérieures.
Il était sans doute nécessaire de réformer la DGF des collectivités, mais l'on peut s'étonner des conséquences observées en matière de dotation de péréquation. Or cela me semble être en totale contradiction avec la déclaration faite dans cet hémicycle par les ministres concernés, ainsi qu'avec la note envoyée par le ministère de l'intérieur aux collectivités, dans laquelle il est écrit que « la réforme des dotations de péréquation a pour objectif de mieux prendre en compte la richesse réelle des départements et d'améliorer les qualités péréquatrices des dotations ».
Or, incontestablement, ce n'est pas le cas dans le département du Finistère, qui, malgré d'évidentes caractéristiques rurales, a été classé en département urbain, ce qui nous laisse perplexe. De plus, le potentiel fiscal de ce département est largement inférieur à la moyenne, et la péréquation s'établit d'une façon très négative.
Monsieur le ministre, je souhaite connaître les précisions que vous pouvez m'apporter à ce sujet et savoir si, comme il l'avait indiqué aux parlementaires lors du vote de la loi, le Gouvernement envisage de corriger ce dispositif au regard des observations qui ont été faites sur le terrain.
Par ailleurs, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce qui concerne la mise en place des nécessaires améliorations à apporter à la péréquation, et pas uniquement dans le Finistère ?
Monsieur Marc, la loi de finances pour 2005 a réformé la péréquation départementale par la création d'une dotation de péréquation urbaine, la DPU, et l'élargissement de la dotation de fonctionnement minimale, la DFM.
La dotation de péréquation urbaine est destinée à l'ensemble des départements métropolitains dont la densité de population est supérieure à cent habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Selon cette définition, trente-deux départements sont concernés par la dotation de péréquation urbaine en 2005 ainsi qu'en 2006.
Parmi ces trente-deux départements, sont éligibles à la dotation de péréquation urbaine les départements dont le potentiel financier est inférieur au double du potentiel financier moyen des départements urbains. Compte tenu de ces règles, les trente-deux départements urbains sont éligibles à la DPU en 2006.
Le classement en département urbain du Finistère vous préoccupe, mais un grand nombre de départements français font l'objet d'un même classement. Pour ma part, je préside un département dont le territoire est à 15 % urbain et à 85 % rural, mais avec des villes comme Nice, Cannes ou Antibes, il est classé en département urbain.
J'ai effectué récemment un déplacement dans le Finistère, plus d'ailleurs pour son caractère rural que pour son caractère urbain. Néanmoins, les villes de Brest et de Quimper font également partie du département, où elles introduisent une dominante urbaine. Cependant, la ruralité du Finistère mérite une attention toute particulière, j'en conviens, j'ai d'ailleurs défendu un certain nombre de dossiers de pôles d'excellence rurale.
Pour le Finistère, la dotation de péréquation, qui s'élevait à 11 195 685 euros en 2005, progresse de 0, 60 % en 2006, pour atteindre 11 262 965 euros. La dotation de péréquation urbaine de ce département s'établit ainsi à 12, 22 euros par habitant en 2006, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne des trente-deux départements éligibles, qui a atteint pour sa part 12, 05 euros par habitant.
Les attributions sont calculées en fonction d'un indice synthétique de charges et de ressources tenant compte du potentiel financier, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires des aides personnalisées au logement, APL, et de la proportion de bénéficiaires du RMI. L'attribution que perçoit un département reflète donc sa situation en termes tant de ressources que de charges.
Le Finistère occupe ainsi le dix-neuvième rang selon l'indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition de la DPU. Ce rang s'explique par une situation plus favorable que la moyenne des trente-deux départements urbains au regard de la proportion de bénéficiaires d'APL, qui s'élève à 36, 89 % contre 49, 26 % en moyenne pour les départements urbains, et de la proportion des bénéficiaires du RMI, qui est de 1, 33 % contre 2, 04 % en moyenne. Cela a conduit à une progression de sa dotation inférieure à la moyenne.
A contrario, les trois départements les mieux classés selon cet indice, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et le Nord, enregistrent des progressions de dotation supérieures à la moyenne. Cette évolution permet à ces départements d'obtenir un montant de DPU par habitant qui atteint respectivement 12, 62 euros, 13, 25 euros et 14, 73 euros, et donc un montant supérieur à celui du Finistère.
Au-delà de ce constat, le rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la DGF, prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 2005, déposé au Parlement en août 2005, dresse un bilan des mécanismes péréquateurs, notamment de la dotation de péréquation urbaine.
En outre, le Comité des finances locales a prévu, lors de sa séance du 7 février 2006, de réunir un groupe de travail et de réflexion sur les dotations de péréquation départementales, dans le but d'accroître encore leurs effets de redistribution des ressources au profit des départements défavorisés.
Sur la base de ce rapport, les critères vont évoluer au cours de l'année 2006 pour l'élaboration de la prochaine loi de finances.
Telles sont, monsieur le sénateur, les explications que je souhaitais apporter à votre connaissance.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des précisions que vous venez de m'apporter. Je suis heureux d'apprendre qu'une réflexion est engagée sur l'évolution du dispositif.
Toutefois, je tiens à préciser que les dotations de compensation des charges des départements, notamment en matière sociale, évoluent peu dans un contexte très dépressif. Aussi le budget est très difficile à équilibrer et les contribuables locaux sont plus sollicités qu'on ne l'aurait souhaité.
En ce qui concerne le Finistère, j'attire l'attention de M. le ministre, sur le fait que l'État nous doit, pour les années 2004, 2005 et 2006, 67 millions d'euros pour respecter les engagements qu'il a pris compte tenu des charges qui nous ont été transférées.
La moindre progression que par le passé de la dotation de péréquation nous pose des problèmes. Je souhaite vivement que l'on puisse avoir, au-delà des critères que vous avez évoqués et dont je ne conteste pas les résultats d'application, un mécanisme qui améliore la situation des départements comme le Finistère.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 934, adressée à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.

Les difficultés relatives à la gestion des biens de section engendrent encore de très nombreux contentieux, privant bien souvent nos communes rurales de perspectives de développement.
En effet, le transfert aux communes des biens, droits et obligations d'une section de commune continue à créer des contentieux ainsi que de nombreuses inquiétudes non seulement pour les élus, mais aussi pour l'intérêt de nos territoires ruraux, même lorsque depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget de la collectivité
Cette problématique spécifique des biens de section trouve une actualité particulière dans les espaces situés en zone de montagne, où elle concerne la grande majorité des communes.
Ce problème des sections de communes, héritage du Moyen Âge, est très souvent pénalisant, tant pour les finances communales que pour la concrétisation de projets très divers.
Il est temps aujourd'hui d'aller plus loin, de clarifier avec encore plus de netteté la possibilité donnée aux conseils municipaux à répondre à l'intérêt général par la maîtrise des biens de sections non productifs. Je n'évoque ni les biens de sections qui comportent des forêts de valeur, des carrières ou d'autres ressources exploitables.
En effet, les politiques de développement durable se sont poursuivies plutôt dans un cadre régional et décentralisé, l'échelon local apparaissant souvent plus pertinent pour la définition des besoins, la mobilisation des ressources et la programmation des politiques.
Plus récemment, les politiques d'aménagement du territoire ont affirmé cette évolution, à la lumière de la loi relative au développement des territoires ruraux votée le 23 février 2005, permettant ainsi de prendre en compte ceux qui y vivent mais aussi ceux qui y vivront demain.
L'absence de définition claire et précise sur le transfert des biens de section aux communes engendre des contentieux inutiles et générateurs de blocage, limitant considérablement les perspectives d'évolution, et favorisant l'immobilisme, voire l'individualisme ou l'égoïsme.
Monsieur le ministre, merci de nous dire comment le Gouvernement entend répondre à l'appel des communes rurales, face à des situations de plus en plus complexes et sans issue. L'urgence commande une action rapide et efficace pour mettre un terme à des conflits persistants et d'une autre époque.
Monsieur Boyer, votre question sur les difficultés de gestion des biens de section pourrait relever du débat d'initiés tant le statut juridique des sections de communes est original et généralement très méconnu du grand public.
Pourtant, je sais que les problèmes posés par l'existence des sections de communes ne sont pas secondaires pour beaucoup d'élus ruraux, qui sont confrontés à cette survivance juridique plus fréquente que ce que l'on croit puisque près de 27 000 sections de communes ont été recensées au niveau national par la direction générale des collectivités locales en 1999.
À titre d'exemple, votre département de la Haute-Loire, compte 2 872 sections de communes.
Les difficultés auxquelles vous faites référence dans votre question sont connues du Gouvernement. Elles tiennent au cadre juridique complexe, souvent opaque, avec parfois la preuve insuffisante de l'existence des droits, car les titres de propriété ont souvent disparu.
La gestion de ces sections de communes reste lourde et coûteuse puisque, vous le savez, il y a obligation de consulter les électeurs de la section avant toute décision.
Enfin, cette structure si particulière est dans certains cas un frein au développement en raison de l'attitude conservatrice des habitants de la section, qui a pour conséquence directe de morceler le territoire rural et de contrarier son aménagement rationnel.
Vous avez encore raison, monsieur Boyer, de dire que cette situation n'est pas satisfaisante et le Gouvernement, celui-ci comme le précédent, cherche depuis plus de deux ans à trouver des solutions qui concilient les intérêts légitimes des ayants droit et de leurs commissions syndicales, là où elles existent, avec l'intérêt général.
Qu'est-ce qui a été fait ? Le choix constant du Gouvernement a été de faire évoluer le régime des biens des sections de communes en favorisant leur municipalisation. Ce fut le cas en 2004 lorsqu'il a soutenu les trois amendements relatifs aux sections de communes, déposés par le sénateur Michel Charasse et qui ont été adoptés.
Ces nouvelles dispositions assouplissent incontestablement les règles relatives à la désignation de la commission syndicale comme celles qui ont trait aux conditions de transfert aux communes des biens, droits et obligations des sections de communes.
Pour ce qui est des règles relatives à la gestion des biens de sections, vous savez que le Gouvernement a été plus loin lors de l'adoption de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, puisque désormais seul le conseil municipal a compétence pour autoriser la vente des biens de la section, dès lors que cette opération a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public.
Pour autant, le chantier est-il clos ? Non, et il est même vivant. Je suis ouvert et disponible pour examiner de nouvelles propositions de clarification qui permettraient d'aller plus loin dans le cadre de la législation actuelle. Je crois, en effet, que les communes sont souvent fondées à vouloir reprendre à leur compte des territoires qui doivent être valorisés, notamment lorsque ces territoires sont négligés par ceux qui en détiennent les droits exclusifs.
En disant cela, je ne sous-estime pas les résistances qu'une nouvelle évolution des règles applicables aux sections de communes pourrait provoquer. Mais, je le répète, monsieur le sénateur, la recherche d'un équilibre entre le respect de ces droits traditionnels et le souci de l'intérêt général me paraît être à ce prix.

M. Jean Boyer. Monsieur le ministre, je retrouve dans votre réponse des éléments identiques à ceux que vous avez fournis aux orateurs précédents. Comme l'ont indiqué ces derniers, nous apprécions beaucoup vos réponses. Nous savons que vous avez une classe naturelle, une grande détermination et que vous savez faire partager votre conviction. Je vous le dis sans dentelle, même si cette dernière est fabriquée dans la ville du Puy-en-Velay, située dans mon département.
Sourires

Je vous adresse donc mes félicitations et je vous remercie. Vous avez bien compris que la tradition, le passé, valeurs nobles, doivent être respectés, mais qu'en 2006 on doit associer le passé, le présent et l'avenir de nos communes.

La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 947, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Monsieur le ministre, je veux vous rappeler que, par une question écrite publiée au Journal officiel du 14 juillet 2005, j'avais attiré votre attention sur la situation des médecins, français ou étrangers, détenteurs d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne. En ma qualité de président du groupe d'amitié France-Algérie, j'avais été saisi de ce problème par des médecins d'origine algérienne.
En effet, représentant environ 20 % des médecins hospitaliers, les praticiens concernés assurent près des deux tiers des gardes et des urgences, et la plupart d'entre eux exercent depuis de nombreuses années en France.
Internes ou vacataires, ils sont devenus la variable d'ajustement dans les hôpitaux français, mais leurs contrats ne dépassent jamais douze mois et leur rémunération ne représente que 55 % de celle des praticiens hospitaliers.
Insatisfait de la réponse qui m'a été donnée, parue au Journal officiel du 12 janvier dernier, je sollicite donc de votre part, monsieur le ministre, une réponse plus précise et je souhaite connaître vos intentions pour que ces praticiens ne relèvent plus d'un statut professionnel anormal et humainement indécent.
De plus, sur le même sujet, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, vous a déjà demandé, par une lettre en date du 7 mars dernier, quelles mesures vous entendiez prendre dans un délai de quatre mois pour mettre fin aux différentes inégalités de traitement de ces médecins. Vous comprendrez que je ne souhaite pas attendre ce laps de temps. J'espère donc que vous allez m'apporter une réponse dans quelques instants.
Monsieur le sénateur, je vous réponds au nom de M. Xavier Bertrand, qui, ne pouvant être présent ce matin, m'a chargé de vous présenter ses excuses.
Vous appelez son attention sur la situation des praticiens de santé titulaires d'un diplôme délivré hors Union européenne et qui occupent des fonctions hospitalières depuis de nombreuses années dans nos hôpitaux publics.
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, les professions médicales et pharmaceutiques sont réglementées. Elles obéissent à des conditions de nationalité, de diplôme et d'inscription à l'Ordre, prévues par le code de la santé publique. Ce dernier énumère un certain nombre d'exigences, dans l'intérêt des assurés sociaux et des patients que nous sommes tous.
Toutefois, les praticiens à diplôme étranger ont été autorisés, par dérogation aux conditions légales, à exécuter des actes de pratique courante. Ces interventions s'effectuent toujours sous la responsabilité directe d'un praticien de plein exercice.
La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a posé le principe d'une interdiction faite aux établissements publics de santé de procéder à de nouveaux recrutements. Seuls les médecins à diplôme étranger justifiant de fonctions dans un établissement hospitalier public avant la date de publication de ladite loi peuvent continuer à exercer des fonctions hospitalières d'assistant associé ou de praticien attaché associé. Cette loi a été adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin.
Dans le cadre de leur nouveau statut paru au mois d'août 2003, la rémunération de ces praticiens est identique à celle des praticiens attachés qui ont la plénitude d'exercice. En contrepartie de l'interdiction de recrutement, le nombre d'autorisations d'exercice de la médecine a considérablement augmenté, afin d'autoriser des praticiens recrutés avant la loi de 1999 à exercer leur profession.
Dans le même temps, une nouvelle procédure d'autorisation d'exercice a été mise en place. Ainsi, depuis 1972, plus de 11 300 autorisations d'exercice concernant les professions médicales et pharmaceutiques ont été délivrées, dont plus de 9 400 visaient la profession de médecin.
Toutefois, ces très nombreuses autorisations n'ont pas suffi pour régler définitivement le problème. Aujourd'hui, le nombre de praticiens à diplôme acquis hors Union européenne n'ayant pas la plénitude d'exercice et exerçant dans les établissements publics de santé est d'environ 6 700. Plus de 4 400 d'entre eux sont des stagiaires étrangers en formation. Étant en France dans le cadre d'une formation, ils n'ont donc pas vocation à y rester. Les autres praticiens ne se sont pas soumis aux procédures antérieures ou ont échoué à ces procédures.
À cet égard, M. le ministre de la santé et des solidarités a pour objectif d'offrir à ces praticiens à diplôme délivré hors de l'Union européenne la possibilité d'obtenir une autorisation de plein exercice. Cette autorisation doit répondre aux mêmes exigences que celles qui sont requises pour les médecins à diplômes français ou communautaires.
Pour atteindre cet objectif, le ministère de la santé et des solidarités a mis en place, en 2004, la nouvelle procédure d'autorisation, dite « NPA », dont la première session s'est déroulée au mois de mars 2005. Près de 3 000 candidats se sont présentés alors que 200 places étaient offertes. Pour la deuxième session, organisée ce mois-ci, 599 places sont proposées, c'est-à-dire trois fois plus.
Au mois de décembre dernier, le ministre de la santé et des solidarités a annoncé que la loi serait modifiée, afin de permettre aux candidats de se présenter jusqu'à quatre fois aux épreuves écrites de la NPA, au lieu de deux actuellement. Cette mesure leur laissera le temps de parfaire leur qualification afin de satisfaire aux conditions de compétences requises. Par ailleurs, une modification réglementaire permettra aux titulaires de l'autorisation ministérielle de se voir automatiquement qualifiés dans leur spécialité.
Enfin, le ministère étudie la possibilité de simplifier cette procédure pour les professionnels ayant déjà fait l'objet d'une évaluation théorique, selon des procédures antérieures, ainsi qu'une simplification des conditions de passage devant la commission.
Plusieurs articles du code de la santé publique prévoient des dispositions permettant de prendre en compte l'expérience et les services rendus dans les établissements publics de santé français. Ainsi, sous certaines conditions, la commission pourra dispenser les candidats justifiant de fonctions hospitalières effectuées avant les épreuves de vérification des connaissances de tout ou partie des trois ans de fonctions prévus dans le code précité. En outre, la commission examinera la situation de chacun des candidats au vu du rapport d'évaluation établi par le chef de service. Elle appréciera l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

Monsieur le ministre, votre réponse est beaucoup plus complète que celle que vous m'aviez donnée le 12 janvier dernier.
Il est tout à fait normal d'exiger, dans l'intérêt des patients, que les praticiens en question disposent de certaines qualifications. Nous savons toutefois qu'ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité d'un médecin bien installé dans l'hôpital.
Comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, une épreuve a été organisée, à laquelle 3 000 médecins se sont présentés, alors que 200 places seulement étaient offertes. Les 2 800 praticiens qui n'ont pas été reçus continuent à exercer leurs fonctions dans des conditions de travail et de salaire qui ne sont pas tout à fait normales, comme je l'ai souligné précédemment.
J'espère que votre réponse apaisera les inquiétudes - je n'en suis pas certain - qu'ont exprimées ces praticiens.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 949, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Monsieur le ministre, ma question porte sur l'exonération de charges sociales des cotisations de retraites complémentaires obligatoires. En effet, lors de la discussion au Sénat de l'actuel article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement avait demandé et obtenu le retrait de l'amendement n° 2, adopté par la commission des affaires sociales, en contrepartie d'un double engagement : d'une part, les dispositions figurant dans cet amendement devaient être reprises dans une instruction ministérielle et, d'autre part, cette dernière devait être publiée dans les meilleurs délais.
Sur ce dernier point, force est de reconnaître la célérité des services, puisque ladite instruction a été publiée le 24 janvier 2006.
En revanche, alors que l'on s'y attendait, ce texte ne prévoit pas d'exclure également de l'assiette des cotisations sociales les cotisations de retraites complémentaires mises à la charge des employeurs en application d'accords au sens de l'article L. 132-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, monsieur le ministre, pourriez-vous me préciser si vous entendez reprendre cette disposition dans une nouvelle instruction, au moins pour les accords d'entreprise, les accords ratifiés par une majorité de salariés ou les décisions unilatérales antérieurs à la publication de la loi ? Enfin, je souhaite savoir dans quel délai ce texte pourra être publié.
Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. C'est une question techniquement complexe.
Cet article tend à réglementer l'exonération des contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaires obligatoires. Il a pour objet d'éviter que la prise en charge par l'employeur de cotisations normalement dues par les salariés ne bénéficie d'une exclusion d'assiette, ce qui aurait fragilisé le financement de la sécurité sociale.
Lors des débats, la commission des affaires sociales du Sénat avait appelé l'attention du Gouvernement, par son amendement n° 2, que vous évoquez, sur la situation spécifique de certaines répartitions de cotisations entre employeur et salarié, situation qui résultait de périodes antérieures à l'unification des régimes AGIRC et ARRCO.
Le Gouvernement s'était alors engagé à reprendre ces éléments dans les mesures d'application de la loi. À ce titre, la circulaire du 24 janvier 2006 a effectivement apporté les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition.
Ainsi, conformément aux textes régissant l'AGIRC et l'ARRCO, cette circulaire prend en compte les accords de branche ou d'entreprise prévoyant une clé de répartition des contributions entre employeur et salarié différente de celle du droit commun.
Sont concernées les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, ainsi que les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
Le Gouvernement a ainsi pleinement respecté son engagement à l'égard de la représentation nationale tout en sécurisant les ressources de la sécurité sociale.

Monsieur le ministre, vous me dites que la circulaire du 24 janvier 2006 répond point par point aux préoccupations que j'ai évoquées, mais je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet, il avait été promis de prendre en considération par la voie réglementaire les dispositions de l'amendement n° 2, lequel prévoyait que des dérogations en matière de taux de cotisations aux retraites complémentaires obligatoires puissent être soit autorisées par la voie d'accords d'entreprise ou de branche, soit adoptées par un vote majoritaire des salariés concernés ou par la voie d'une décision unilatérale applicable à tous les salariés de l'entreprise.
La circulaire, en réalité, ne permet en rien ces souplesses, à l'exception peut-être pour les cotisations ARRCO établies au 1er janvier 1999.
Or, pour ne parler que du passé, de nombreuses entreprises ont signé des accords d'entreprises postérieurement au 1er janvier 1999, en se fiant à la loi interprétée de façon constante par la Cour de cassation. Elles ont, de plus, interrogé les URSSAF, qui ont confirmé la validité de ce montage.
Par conséquent, la loi de financement de la sécurité sociale a bouleversé l'économie des dispositifs adoptés.
En fait, la situation actuelle revient à taxer les entreprises les plus généreuses socialement. Il eût été souhaitable que les partenaires sociaux restent libres de choisir, tant qu'ils respectaient le principe de faveur, la répartition entre employeur et salarié des taux de cotisation de retraites complémentaires, si, comme il l'affirmait, le Gouvernement souhaitait inciter les partenaires sociaux à la négociation.
C'est pourquoi nous avions proposé cet amendement n° 2 en novembre ; je formule aujourd'hui le souhait que, au moins pour les accords d'entreprise, quelle que soit leur forme, passés avant la date d'application ou même avant la publication du projet de loi, les exonérations de cotisations soient maintenues.
Il en va de la sécurité juridique de la négociation collective.

La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la question n° 966, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le parcours de soins lorsque le médecin traitant désigné par le patient appartient à un cabinet de groupe.
En effet, il est prévu, dans le troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 20 décembre 2005, que « les médecins exerçant la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux peuvent être conjointement désignés médecins traitants ». J'insiste sur le mot « conjointement ».
Or, plusieurs exemples m'ont été rapportés de cabinets médicaux dans lesquels les remboursements de soins sont minorés quand le patient consulte non pas son médecin traitant, mais un médecin pourtant du même cabinet.
Les caisses d'assurance maladie, depuis les dispositions de la loi sur la sécurité sociale du 20 décembre 2005, applicables au 27 janvier 2006, demandent qu'une manipulation d'ordre administrative soit faite sur la feuille de soins électronique, la FSE, lors de la transmission : il s'agit d'indiquer « médecin remplacé » ou code MTR. Le médecin sera, alors, provisoirement considéré comme médecin traitant.
Cette opération active, à caractère purement administratif, alourdit inutilement l'acte des médecins concernés.
Par ailleurs, comme vous le savez, monsieur le ministre, les patients de ces cabinets médicaux de groupe ont pour habitude d'être auscultés indifféremment par l'un ou l'autre des praticiens et ne se souviennent pas toujours lequel d'entre eux a été désigné comme médecin traitant...

..., ce qui rend la manipulation administrative du médecin d'autant plus absurde.
Je vous demande donc d'éclaircir les conditions d'application du troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 20 décembre 2005, et, notamment, d'expliquer dans quelle mesure les caisses d'assurance maladie peuvent prendre de manière autonome des dispositions d'application de la loi qui sont contraires à l'esprit de cette même loi, voire au pur bon sens.
Je vous demande aussi des précisions, d'une part, quant à la pratique des médecins traitants concernés par ces dispositions, et, d'autre part, quant aux droits des patients, qui ne sauraient être pénalisés.
Monsieur le sénateur, vous avez rappelé une règle qui a été adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et qui permet de répondre aux demandes légitimes à la fois des professionnels de santé et des patients, afin que plusieurs médecins exerçant en groupe puissent être conjointement désignés comme médecins traitants. C'est une bonne règle que nul, je crois, ne conteste.
Afin d'accélérer la mise en oeuvre de cette mesure, et ce malgré les difficultés d'ordre administratif que vous avez rappelées, l'assurance maladie a mis en place un dispositif provisoire dans l'attente d'une adaptation de ses systèmes d'information, qui ont été modifiés pour permettre la prise en compte du médecin traitant.
Or, ladite règle n'a été votée que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, c'est-à-dire peu avant la fin de l'année dernière. Cette adaptation, vous en conviendrez, ne pouvait pas être instantanée. Comme l'assurance maladie a voulu faire vite, elle a choisi une formule provisoire. En l'état actuel de mes informations, j'estime qu'il faudra probablement six mois environ pour que le dispositif puisse être complètement au point.
Néanmoins, pendant cette période transitoire, les médecins ont été invités, comme vous l'avez dit vous-même, à signaler leur appartenance à un cabinet de groupe en utilisant, lors de la rédaction de la feuille de soins, la case « médecin remplacé », ce qui n'est pas satisfaisant, je vous l'accorde, mais qui permet de mettre en oeuvre dès maintenant le nouveau dispositif, en la faveur duquel se dessine - je le répète - une quasi-unanimité.
L'assurance maladie travaille à une modification de ses systèmes d'information pour que les médecins exerçant en groupe et désignés conjointement par le patient disposent d'une identification spécifique sur les feuilles de soin. Ce sera chose faite très rapidement, puisque la solution est en cours de finalisation.

Je ne regrette pas d'avoir posé la question ! Je suis très heureux, monsieur le ministre, que vous parliez d'un dispositif provisoire, dont la durée, selon votre estimation, ne devrait pas excéder six mois.
Cela étant, vous savez que le mot « provisoire » ne se traduit pas toujours dans les faits. J'espère toutefois que le Gouvernement sera en mesure de tenir ses engagements et que la sécurité sociale pourra suivre car - je me félicite de ce que vous le reconnaissiez vous-même explicitement - il ne s'agit, en fin de compte, que de répondre à un souci de bon sens, tant il est vrai que, souvent, dans la pratique, le patient est indifférent au nom du médecin qui a signé le document de désignation, justement, peut-être, parce qu'il va consulter dans un cabinet de groupe.
Un médecin qui exerce dans un tel cabinet se considère, d'ailleurs, à juste titre comme médecin traitant de tout patient qui pénètre à l'intérieur dudit cabinet.
Votre réponse va tout à fait dans le bon sens. J'espère que ce système ne sera effectivement que provisoire et ne durera que six mois, et que nous aboutirons à une victoire, en ce sens que, au lieu d'être alourdie, la machine administrative et bureaucratique sera enfin simplifiée. J'ai le sentiment que c'était ce que souhaitait le Gouvernement. Sachez, en tout cas, que c'est ce que souhaitent les parlementaires, mais peut-être plus encore les médecins traitants et leurs patients.

La parole est à M. Gérard Delfau, auteur de la question n° 967, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Je souhaite attirer l'attention de M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, sur les conséquences très graves de la baisse des dotations allouées à la caisse primaire d'assurance maladie - CPAM - de Montpellier en 2005, et sur la légitime inquiétude du conseil d'administration quant au budget pour 2006.
La diminution très importante des crédits, l'an passé, a obligé la CPAM de Montpellier, qui gère avec beaucoup de dévouement et de rigueur 534 000 assurés sociaux, ce qui est considérable, à restreindre de façon significative le nombre d'interventions en faveur des personnes en difficulté.
Cette baisse intervient à un moment où le département de l'Hérault voit augmenter encore le nombre de ses habitants, alors que tous les indicateurs sociaux sont alarmants : chômage, RMI, personnes en situation de handicap, montant des loyers et prix du foncier, notamment, sans parler de la crise de la viticulture et de la paupérisation qu'elle engendre, même si - je le sais bien - les viticulteurs en tant que tels ne dépendent pas du régime de sécurité sociale géré par ladite caisse.
La solidarité nationale devant s'exercer en faveur de ses territoires les plus pauvres et les plus démunis, un rattrapage est nécessaire pour l'ensemble des caisses d'assurance maladie du département.
Je demande donc ce que M. le ministre compte faire pour répondre à cette exigence d'équité.
Vous savez, monsieur le sénateur, que, depuis le 1er janvier 2005, un dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé par un crédit d'impôts est géré au plan national, ce qui signifie que le nouveau dispositif, qui a, d'ailleurs, été encore amplifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, permet de gérer à cet échelon les aides qui sont accordées à ceux de nos compatriotes qui n'ont pas un revenu suffisant pour acquérir par eux-mêmes une couverture complémentaire de santé et qui ont néanmoins un revenu trop élevé pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle.
Désormais, pour l'acquisition d'une mutuelle, par exemple, par une personne âgée, la prise en charge a doublé, grâce aux mesures prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Vous n'avez pas voté cette loi, monsieur le sénateur, mais vous avez participé aux débats et pu constater cette grande avancée sociale, adoptée par la majorité du Sénat comme de l'Assemblée nationale.
Permettez-moi de vous dire que vous comparez des éléments qui ne sont pas comparables. En effet, avant la mise en place de ce régime national, très favorable, c'étaient les caisses primaires, sur leur budget d'aide sociale facultative, qui finançaient les aides individuelles aux familles n'ayant pas les moyens de s'offrir une couverture complémentaire santé.
Ce dispositif existe désormais au plan national ; dès lors, les crédits correspondant aux situations antérieures à ce grand progrès social n'ont donc plus à être abondés dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Par conséquent, si l'enveloppe de crédits d'aide sociale vous semble avoir diminué à première vue, en réalité, les bénéficiaires de cette enveloppe reçoivent davantage de crédits qu'autrefois, grâce à la formule du crédit d'impôt adoptée par le Parlement en 2004 et renforcée en 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a bénéficié, en 2004, d'une enveloppe d'un montant de 1 687 594 euros, dont 921 484 euros au titre de l'enveloppe non affectée et 766 110 euros pour le dispositif local d'aide à la mutualisation, remplacé depuis par le dispositif national d'acquisition d'une complémentaire santé.
En 2005, cette même caisse primaire d'assurance maladie a bénéficié d'une dotation globale d'un montant de 1 441 794 euros, en diminution apparente, mais avec une très forte augmentation de l'enveloppe non affectée, puisque celle-ci est passée de 921 484 euros à 1 399 000 euros.
Ces crédits ont d'ailleurs été consommés à hauteur de 75 %, contre 70, 09 % l'année précédente. Il reste donc, au titre de l'extinction du dispositif local d'aide à la mutualisation, remplacé par le dispositif national d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, une somme de 42 686 euros.
Si l'on considère les chiffres à champ constant, étant donné l'ajustement effectué afin de tenir compte de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé par le crédit d'impôt, non seulement la dotation d'action sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier n'a pas diminué, mais elle a très fortement progressé en 2005 par rapport à 2004, puisque sa part consacrée aux aides individuelles a augmenté de 51, 8 %.
Tels sont, monsieur Delfau, les éléments que je tenais à vous donner afin de contribuer à votre bonne information.

Nous allons écouter la réponse de M. Gérard Delfau, sous l'oeil énigmatique de nos collègues de Mayotte et de Wallis-et-Futuna, qui ne disposent peut-être pas du même régime...
La parole est à M. Gérard Delfau.

Nous le savons, monsieur le président, il reste encore beaucoup de progrès à faire en matière d'égalité sur l'ensemble du territoire français.
Monsieur le ministre, il est vrai que je n'ai pas voté le texte de loi auquel vous avez fait allusion, justement parce qu'il y avait entre nous un désaccord de fond. Je souhaite que cela soit bien établi.
Je ne suis pas opposé, sur le principe, à ce qu'un dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé soit développé au niveau national, mais, quand il s'appuie sur le crédit d'impôt, on voit immédiatement quelles sont les catégories de population qui risquent de ne pas en bénéficier !
Par ailleurs, s'il est vrai qu'il faut toujours individualiser la solidarité, il est en même temps nécessaire de conserver un échelon de proximité. De ce point de vue, les caisses primaires d'assurance maladie de Montpellier et de l'Hérault font un travail remarquable. Je ne souhaite donc pas que cet échelon local disparaisse, remplacé par un dispositif national ne disposant pas de la même capacité à atteindre les personnes vraiment concernées ou celles qui n'effectuent pas les démarches nécessaires.
Vous nous dites, monsieur le ministre, que la dotation pour 2005 progresse considérablement. Je vous rappelle cependant que nous assistons aussi à une augmentation considérable de la démographie et de la pauvreté, ce qui doit contribuer à pondérer vos propos.
Pour le reste, vous allez indiquer très prochainement, je l'espère, aux caisses primaires le montant des dotations qui leur seront allouées. J'examinerai alors de nouveau la situation avec le président et le conseil d'administration de la CPAM.
Nous ferons le point à la fin de l'année. Si cela s'avère nécessaire, je profiterai d'une nouvelle séance de questions orales pour vous interroger sur ce sujet, monsieur le ministre, afin que nous puissions déterminer, dans le cadre du Parlement, si nous devons nous satisfaire complètement ou non de ce dispositif, et s'il faut ou non l'amodier.

La parole est à M. Robert Hue, auteur de la question n° 973, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'avenir de l'hôpital public dans notre pays. En effet, la situation est grave, alarmante, pour ne pas dire parfois dramatique.
Avec le groupe CRC, je me suis opposé au budget pour 2006, tant sont lourdes de conséquences les coupes claires et inquiétantes qui ont été effectuées dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Des centaines d'emplois sont menacés et certains établissements envisagent même - tenez-vous bien ! - une cessation de paiement.
Et pourtant, aucune solution concrète susceptible d'apporter un peu d'air frais n'est inscrite sur votre feuille de route !
Ainsi, dans mon département du Val-d'Oise, le service des urgences de l'établissement hospitalier Victor-Dupouy, situé à Argenteuil et qui emploie 2 200 personnes, ne reçoit pas moins de 60 000 patients par an, d'après les derniers chiffres connus.
Je parlais à l'instant de cessation de paiement. : avec 12 millions d'euros de déficit cumulé, l'hôpital Victor-Dupouy n'en est peut-être malheureusement pas loin. Cette situation financière est intenable à court terme et le conseil d'administration, qui doit statuer sur le budget pour 2006, ne cesse d'être repoussé.
Le budget de 2005 avait déjà été l'occasion d'entériner un plan drastique de réduction des dépenses de fonctionnement, pesant lourdement sur les activités de cet établissement.
Cette situation inédite de sous-financement des hôpitaux se traduit par une atteinte à la dernière variable d'ajustement touchable : les personnels.
Ces derniers voient déjà les heures supplémentaires s'accumuler et les plannings non respectés. Le déficit d'infirmières - il en manque soixante à l'hôpital d'Argenteuil - et de manipulateurs radio, notamment, est criant, alors même que tous les départs prévus ne seront peut-être pas remplacés.
Enfin, je souhaite évoquer la question du ménage dans les hôpitaux, activité privatisée depuis peu, ce qui n'est pas sans représenter un danger en matière d'hygiène, et notamment d'infections nosocomiales, tout au moins si la formation de ces personnels privés n'est pas garantie.
Monsieur le ministre, comment ne pas s'alarmer lorsqu'il est porté atteinte à ces secteurs majeurs que sont la santé publique et l'hygiène, au motif de faire des économies que, pour ma part, je soupçonne d'être peu créatrices de moyens budgétaires supplémentaires ?
À ce propos, je vous signale que j'ai interrogé il y a un an, le 8 mars 2005, l'agence régionale d'hospitalisation sur les difficultés qu'engendre, en accentuant les inégalités territoriales, la tarification à l'activité. Or je n'ai reçu à ce jour aucune réponse, ce qui est inacceptable.
Une partie de cette tarification, à hauteur de 46 %, devait être consacrée au fonctionnement des hôpitaux : où en est-on, monsieur le ministre ?
Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour redonner à l'hôpital et à son personnel, dont le sens de la responsabilité et du dévouement est exceptionnel, les moyens de remplir leur mission de service public, sans que soit remis en cause le droit à la santé et à la protection sociale ?
Monsieur le sénateur, s'il y a bien un point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est pour rendre hommage au dévouement du personnel hospitalier qui, jour après jour, au chevet des malades, assure dans nos hôpitaux des soins de qualité.
Ce personnel a d'autant plus de mérite que sa charge de travail a été notablement aggravée par l'application particulièrement désordonnée de la réforme des 35 heures à l'hôpital, dans les années qui ont précédé les élections présidentielle et législatives de 2002.
À cette époque, d'ailleurs, les budgets hospitaliers n'augmentaient pas davantage que dans la période actuelle.
Je tiens en effet à vous rappeler, au-delà de la situation de l'hôpital d'Argenteuil, qu'en 2006 le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'hôpital, voté par le Parlement, s'établit à 3, 44 %, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros supplémentaires qui seront versés par l'assurance maladie aux établissements de santé.
Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur. Le Gouvernement, qui est engagé dans l'application du plan Hôpital 2006, plan d'investissement sans précédent en faveur de l'hôpital, poursuivra cet effort national reposant sur la solidarité.
Le centre hospitalier d'Argenteuil a dû faire face depuis plusieurs années, de même que plusieurs établissements de la région d'Île-de-France, à des tensions budgétaires importantes : fin 2003, les reports de charges s'élevaient à 7, 25 millions d'euros.
Pour ces raisons, un contrat de retour à l'équilibre a été signé au mois d'octobre 2004 entre l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Île-de-France et cet établissement. Ce contrat a permis d'apporter une aide budgétaire de 10 millions d'euros sur la période 2004-2007, dont 7, 25 millions d'euros au titre du report des charges et 2, 75 millions d'euros au titre de l'accompagnement des activités développées au sein du centre hospitalier.
Le contrat de retour à l'équilibre repose sur deux objectifs : l'augmentation de l'activité par réduction de la durée moyenne de séjour des patients, qui est encore longue au centre hospitalier Victor-Dupouy, et l'ouverture de nouvelles activités, accompagnées financièrement par l'agence régionale de l'hospitalisation dans le domaine de la médecine gériatrique et polyvalente.
En contrepartie de cette aide, qui ne couvre pas la totalité de l'impasse budgétaire cumulée, l'hôpital s'est engagé à réaliser des économies en réorganisant de façon plus optimale la prise en charge des patients.
Les efforts réalisés par cet hôpital en 2004 et 2005, avec l'aide de l'agence régionale de l'hospitalisation, ont permis de réduire le déficit cumulé. En effet, la progression de l'activité, de 7 % en 2005 et d'environ 4 % sur les premiers mois de l'année 2006, se traduit par une augmentation des recettes issues de la tarification à l'activité, qui contribue à rééquilibrer le budget du centre hospitalier.
Cette augmentation d'activité devrait se poursuivre avec l'impact des lits ouverts en 2005 et 2006, en particulier en médecine gériatrique, en médecine générale et en oncologie.
Quant au service des urgences de l'hôpital Victor-Dupouy, il a été entièrement reconstruit et a ouvert ses nouveaux locaux en 2003. L'État a poursuivi le soutien apporté à cette activité essentielle pour les patients puisque, en 2005, au titre du plan d'urgence, le centre hospitalier d'Argenteuil a bénéficié de 190 000 euros pour ouvrir vingt lits et d'un poste et demi de praticien hospitalier pour renforcer le service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR, ainsi que l'activité des urgences.
Je tiens donc à vous confirmer, monsieur le sénateur, que le Gouvernement veille à assurer la continuité du fonctionnement du centre hospitalier d'Argenteuil, comme de tous les établissements de santé, dont les moyens vont continuer à s'accroître, pour le service de nos concitoyens.

Monsieur le ministre, votre réponse ne me rassure pas.
Comme vous l'avez dit d'emblée, nous sommes d'accord pour reconnaître le travail exceptionnel effectué tous les jours et sans relâche par les praticiens et les personnels hospitaliers.
Cependant, les chiffres que vous donnez ne me rassurent pas et vous ne montrez pas très concrètement à ces personnels votre attachement à ce que l'hôpital, à Argenteuil comme ailleurs, retrouve l'essor nécessaire en tant que service public. Vous évoquez un contrat de retour à l'équilibre et l'obtention d'une aide budgétaire de 10 millions d'euros, mais, je le répète, le déficit de l'hôpital porte sur 12 millions d'euros !
Par ailleurs, l'un de vos propos me paraît exceptionnellement grave, mais bien dans l'esprit de votre démarche : l'hôpital d'Argenteuil doit faire des efforts, avez-vous dit, notamment au niveau de la réduction du temps d'hospitalisation. Je suis issu moi-même du monde de l'hôpital et, s'il est évident que nous pouvons gagner du temps sur l'hospitalisation, il est un moment où gagner du temps revient à mettre en réel danger les patients.
Nous ne pouvons accepter que l'hôpital soit géré à coups de calculette par des technocrates qui ignorent son fonctionnement et oublient que, au bout, il y a des malades qu'il faut soigner.
Je ne suis donc pas satisfait, monsieur le ministre, et je rendrai naturellement compte de votre réponse aux personnels hospitaliers et aux élus de mon secteur.

La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 970, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Monsieur le ministre, j'ai appelé à plusieurs reprises votre attention sur les inquiétudes et les préoccupations qui agitent les responsables des établissements et services d'aide au travail, les ESAT, les anciens centres d'aide par le travail ou CAT, malgré l'adoption de la loi du 11 février 2005, voulue par le Président de la République.
Dans un contexte difficile, la diminution notable de la dotation budgétaire 2006, amputée après une délégation initiale afin de financer le « plan banlieues », ne constitue pas une très bonne nouvelle, et c'est une litote. En conséquence, dans ma région, le budget opérationnel de programme « Personnes âgées-Personnes handicapées » a été amputé à hauteur de 5, 32 % après qu'une première délégation de crédits a été attribuée et répartie entre les trois départements.
Cette ponction n'est évidemment pas bienvenue pour les ESAT, alors que de nombreux établissements sont déjà en difficulté en raison d'enveloppes « serrées » depuis plusieurs exercices. À titre d'exemple, des contentieux budgétaires gagnés par des établissements corréziens ne pourront pas être honorés et des actions inscrites au schéma départemental 2005-2009, qui correspondent pourtant à de réels besoins, ne pourront pas être financées.
Les budgets des établissements et services sont déjà fragilisés. Une telle décision ne peut qu'aggraver une situation financière difficile et, en réduisant ainsi les moyens, on risque d'éliminer des structures de travail protégé un grand nombre de personnes handicapées.
Monsieur le ministre, des assurances pourraient-elles nous être données quant au maintien des délégations de crédits initiales, qui étaient déjà insuffisantes compte tenu de l'héritage des exercices antérieurs ? Leur « amputation » est à mes yeux inacceptable. Est-ce bien au secteur « personnes âgées-personnes handicapées » de contribuer, même s'il y a là un vrai problème, au financement des actions en faveur des banlieues ?
Le danger est réel pour les structures de travail protégé. Incertitudes et insuffisances demeurent, notamment, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, s'agissant de l'aide au poste, qui doit à mon avis rester individualisée, et de la participation des établissements aux frais de siège.
Il convient de veiller à conserver intact l'esprit du texte de 2005 et, à cet égard, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse du mois de janvier dernier, dans laquelle vous assuriez que la réforme ne devait entraîner aucune perte de ressources pour les travailleurs handicapés et que, bien au contraire, elle devait améliorer leur situation financière.
Vous assuriez également que, pour ce qui concerne les frais de siège des associations, vous aviez chargé votre cabinet « d'explorer les possibilités d'assouplir les dispositions du décret budgétaire du 29 octobre 2003 ».
Je suis heureux de constater que nous pouvons compter sur votre vigilance, monsieur le ministre. Ce n'est pas dans ma bouche une simple formule, et c'est pourquoi j'interviens encore auprès de vous aujourd'hui.
Comme je vous le disais, le danger est réel et les projets de décret alarment, à tort ou à raison, les gestionnaires des structures du fait des risques qu'ils font peser sur les comptes commerciaux dans une conjoncture économique difficile et alors que les quelques excédents sont destinés à abonder les investissements liés au développement de l'outil de travail et au développement commercial, investissements que les budgets sociaux n'ont à l'évidence pas, eux, vocation à financer.
Si l'on diminue les ressources, déjà insuffisantes, des travailleurs handicapés ou les marges de manoeuvre, déjà sérieusement réduites, des établissements et services d'aide au travail, on se trouvera dans une logique non plus d'intégration sociale mais, en quelque sorte, de « réinstitutionnalisation » des personnes handicapées.
La part prise par les ESAT dans l'économie locale est loin d'être négligeable et leur existence permet à de nombreux travailleurs handicapés une intégration sociale et l'exercice d'une réelle citoyenneté.
La loi du 11 février 2005 n'a de sens que si elle est de nature à améliorer la condition des personnes handicapées. Monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous apporter à un secteur dont vous savez qu'il est en proie à quelques inquiétudes ?
Monsieur le sénateur, vous savez combien je suis attentif à la situation des structures de travail protégé, qu'il s'agisse, d'une part, des entreprises adaptées et, d'autre part, des centres d'aide par le travail, devenus les ESAT. Je suis régulièrement sur le terrain aux côtés des travailleurs handicapés et des gestionnaires de ces établissements : j'étais hier encore à Valenciennes et, vous le savez, je suis venu, il y a quelques mois, en Corrèze, où j'ai pu voir un certain nombre de réalisations.
Nous avons maintenant une grande loi : la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Un immense travail, mené avec les représentants des personnes handicapées, a déjà été effectué, pour qu'elle soit d'application pleine et entière à travers la parution de ses décrets d'application, qu'ils concernent l'accessibilité, la scolarisation des enfants, les maisons départementales des personnes handicapées ou la prestation de compensation du handicap.
Aujourd'hui, le dispositif est en place.
À cette loi s'ajoutent, bien sûr, toutes les mesures prises en faveur de l'emploi.
S'agissant des entreprises adaptées, les nouvelles dispositions relatives à leur financement ont été mises en oeuvre.
J'ai par ailleurs annoncé, voilà exactement un mois, un plan gouvernemental doté de 10 millions d'euros supplémentaires par rapport aux sommes mobilisées les années précédentes pour soutenir les efforts des entreprises adaptées, qui doivent parfois se reconvertir vers de nouveaux marchés et se solvabiliser avec leur clientèle. S'agissant d'entreprises de main-d'oeuvre peu qualifiée, elles subissent effectivement de plein fouet la concurrence internationale et les effets de la mondialisation. Nous devons donc les aider à se tourner vers des marchés plus « captifs ».
Ces entreprises vont ainsi pouvoir conclure des contrats d'objectif avec les directions départementales du travail et de l'emploi. J'ai mis au point le dispositif avec Gérard Larcher, et nos directeurs départementaux en sont maintenant saisis. Chaque entreprise adaptée pourra se voir proposer un contrat d'objectif et, éventuellement, une aide pour faire face aux difficultés du marché et s'y adapter.
S'agissant ensuite des anciens centres d'aide par le travail, devenus, avec la loi, les ESAT, qui sont au coeur de votre question, nous n'avons pas voulu forcer le passage et prendre immédiatement des dispositions sur ce que l'on appelle l'aide au poste, laquelle détermine la possibilité pour les ESAT d'augmenter le niveau des salaires des personnes handicapées qui y travaillent. Plusieurs gestionnaires de ces établissements nous ont en effet fait savoir que les projets tels qu'ils avaient été élaborés risquaient de leur faire perdre des ressources, ce que, bien évidemment, nous ne voulons pas.
Je m'engage donc devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, à ce que les textes, qui sont réexaminés aujourd'hui avec les représentants des associations de personnes handicapées et notamment les gestionnaires de ces établissements, ne puissent en aucun cas faire perdre de ressources aux ESAT.
C'est cette garantie essentielle qu'il fallait commencer par apporter, mais elle n'est pas suffisante : nous devons aussi aider ces entreprises à trouver des débouchés pour leur production. À cette fin, avec le ministre de la fonction publique, Christian Jacob, nous avons saisi l'ensemble des collectivités publiques pour les engager à utiliser les dispositions de la loi de 2005 qui leur permettent, au titre de leur obligation d'emploi des personnes handicapées, de développer la sous-traitance tant avec les ESAT qu'avec les entreprises adaptées. C'est aussi un point que je crois très important.
Cependant, la loi peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Depuis 2002, nous avons mobilisé des moyens importants sur les crédits de l'État pour augmenter le nombre de places en ESAT. Ce sont 14 000 places qui auront ainsi été créées entre 2002 et 2007.
Monsieur Mouly, vous m'avez également interrogé à propos des budgets. Vous savez que l'application de la loi organique relative aux lois de finances a entraîné un certain nombre de nouveautés, ce qui a pu retarder de quelques semaines l'attribution des crédits, mais aujourd'hui la distribution est en cours. Par conséquent, les difficultés temporaires qu'ont pu ressentir certains ESAT sont maintenant pour la plupart derrière nous et elles seront réglées pour l'ensemble des établissements d'ici à la fin de ce mois.
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je suis en mesure de vous apporter. Sachez que l'emploi des personnes handicapées, qui constitue un aspect absolument décisif de la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005, est une question que le Gouvernement suit avec beaucoup d'attention, d'engagement et d'énergie.

Monsieur le ministre, je vous ai interrogé, en pareilles circonstances voilà quinze jours, sur un autre aspect de la mise en oeuvre de la loi de 2005 et je vous ai dit combien j'avais apprécié la teneur de votre réponse, que j'ai diffusée aux associations concernées, lesquelles partagent le sentiment que j'exprimais alors.
La réponse que vous m'apportez aujourd'hui m'amène à vous réitérer mes remerciements, car son contenu est appréciable et, en tout cas pour ce qui me concerne, apprécié. Je la diffuserai également sur le terrain, où je ne doute pas qu'elle recevra le même accueil.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre écoute et de votre travail.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, auteur de la question n° 972, adressée à M. le ministre de la fonction publique.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le devenir incertain des relations entre les agents de la fonction publique et leur employeur, l'État, en matière de protection sociale complémentaire.
Je rappelle que la part sociale de l'État, concrétisée par des subventions aux mutuelles de fonctionnaires, ne cesse de diminuer. Dès lors, le risque pour les fonctionnaires est multiple : tentation du renoncement à la couverture sociale complémentaire, désengagement des mutuelles des risques longs.
La France a été pressée par les injonctions de la Commission européenne de se mettre en conformité avec le droit communautaire, concernant principalement la concurrence, les remises de gestion pour le régime de base, les aides aux activités d'assurances complémentaires de la Mutualité Fonction Publique et de ses mutuelles adhérentes, les mises à disposition de locaux et d'agents.
Le Conseil d'État, de son côté, a rendu en septembre 2005 un arrêt enjoignant l'État d'abroger, dans un délai de six mois, c'est-à-dire avant la fin mars, terme que nous atteignons aujourd'hui, l'arrêté dit « Chazelle », seul cadre juridique des relations entre employeurs publics et mutuelles.
La Mutualité Fonction Publique a quant à elle fait au Gouvernement une série de propositions en adéquation avec le droit communautaire pour adapter le système actuel, tout en respectant les valeurs fondamentales de solidarité qu'elle défend fermement et avec toute l'énergie qu'on lui connaît quand il s'agit de préserver ses adhérents.
Dans un premier temps, le Gouvernement a légitimement voulu disposer d'un état exhaustif des moyens qu'il consacre aux mutuelles de la fonction publique, par le biais d'une enquête menée dans chaque ministère et d'une mission, confiée à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des affaires sociales.
Par la voix du Premier ministre, l'État s'est engagé, depuis, à mettre en oeuvre un nouveau cadre juridique dans le courant de l'année 2006, après concertation avec les partenaires sociaux. Inquiets de leur avenir, les mutualistes de la fonction publique souhaitent que les promesses du chef du Gouvernement aboutissent rapidement et que tout soit mis en oeuvre pour établir un cadre stable et pérenne.
Monsieur le ministre, au-delà des engagements pris pour stabiliser une situation hautement inconfortable et dangereuse, je vous demande de clairement préciser la manière dont ces engagements se traduiront concrètement, ainsi que le calendrier que vous entendez fixer pour les respecter.
Monsieur le sénateur, je voudrais d'abord procéder à un rappel : le statut général des fonctionnaires ne prévoit pas une participation directe de l'État à la protection sociale complémentaire de ses agents.
L'État employeur, toutefois, a toujours participé indirectement à cette protection sociale, soit à travers les aides qu'il apporte aux mutuelles, soit par des mises à disposition de personnels et de locaux, soit par des subventions directes.
Ces aides, vous l'avez évoqué, ont pour fondement juridique l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et un arrêté du 19 septembre 1962, dit arrêté Chazelle.
Rappelons-le, la Commission européenne et le Conseil d'État viennent simultanément de remettre en question ce cadre juridique général. Bien évidemment, ils ne remettent pas en cause la protection sociale complémentaire des fonctionnaires ni le principe de la participation des employeurs publics à cette protection.
Une double mission d'audit, menée conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, a été mise en place afin d'examiner les différentes solutions. Son rapport nous a été remis en décembre dernier. J'ai donc demandé à ce qu'un groupe de travail soit mis en place, ce qui a été fait : sa première réunion s'est tenue le 8 février 2006, sous la présidence de M. Paul Peny, directeur général de l'administration de la fonction publique.
Ce groupe de travail devra permettre de définir un nouveau cadre juridique, adapté à ce contexte. La discussion associera les partenaires sociaux concernés, ainsi que les représentants des mutuelles que vous évoquiez
Comme je l'indiquais encore la semaine dernière devant la Haute Assemblée, le Gouvernement s'est engagé à ce qu'un nouveau cadre juridique soit mis en place avant la fin de l'année 2006. Si une nouvelle disposition législative s'avérait nécessaire, nous avons prévu qu'une période adéquate soit réservée à son examen.
Pour atteindre ces objectifs, nous entretenons des contacts très étroits à la fois avec les représentants des mutuelles et avec les organisations syndicales.

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez fait preuve d'une grande qualité d'écoute lors de la réunion qui s'est tenue le 5 octobre dernier avec les syndicats. Votre écoute et votre souci du consensus ne peuvent que nous réjouir, compte tenu de l'actualité.
Je prends acte de vos engagements. Cependant, il est urgent de régler une situation qui entraîne souvent des inégalités entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, le concours financier des entreprises étant important.

La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 941, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d'appeler votre attention sur les liaisons ferroviaires qui desservent le département du Cher et Bourges, son chef-lieu.
Deux grandes liaisons traversent ce département : un axe nord-sud Paris-Vierzon-Bourges-Montluçon, via Orléans, et un axe est-ouest, Lyon-Bourges-Vierzon-Tours-Nantes.
En ce qui concerne la liaison avec Paris, la partie sud-est, entre Montluçon et Bourges, s'avère en très mauvais état et le parcours entre Bourges et Paris mériterait d'être mieux cadencé, avec davantage de dessertes directes. Elle devrait, en outre, bénéficier d'un meilleur service, avec un matériel rénové, pour éviter les retards quasi-quotidiens qui démontrent les faiblesses de l'organisation.
Il convient, par ailleurs, de noter que Bourges et le Cher ne sont pas reliés au réseau à grande vitesse et, par conséquent, ne bénéficient pas de l'interconnexion centralisée. C'est un handicap majeur, qui porte préjudice au développement économique du département et conduit à un manque d'attractivité.
La recherche de solutions pour un raccordement au réseau TGV interconnecté est une préoccupation constante des milieux économiques depuis l'abandon du projet Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, ou projet POLT.

Il en est de même pour la mise en place de liaisons rapides avec Orly et Roissy.
De plus, depuis plusieurs années, l'axe Lyon-Bourges-Nantes, seule transversale centrale de la France, connaît une diminution de l'offre, la SNCF sectionnant et sectorisant le parcours. En fait, par rapport à ce qui existait il y a dix ans, les trains sont moins nombreux et la durée du trajet est plus longue.
Des trains Corail disparaissent ainsi au fil du temps et sont remplacés, partiellement, par des trains TER lesquels, comme leur nom l'indique, ne sont adaptés qu'au transport régional, entre Saincaize et Tours très précisément. Cette situation est dommageable pour le Cher et ses échanges économiques avec l'est de la France et la façade atlantique.
L'électrification entre Vierzon et Tours est certes en voie de réalisation, mais la décision de principe de poursuivre l'électrification de Bourges à Saincaize doit être confirmée, et, surtout, il faut convaincre la SNCF et Réseaux ferrés de France de moderniser l'itinéraire à l'est, pour relier St Germain-des-Fossés et Lyon.
Il semble cependant que la SNCF reconnaisse un avenir à cette ligne pour le transport de fret, d'autant plus que, à l'échelle européenne, elle peut constituer un axe majeur reliant Turin à Nantes et desservant Lyon, Bourges, Vierzon et Tours.
Aussi souhaiterais-je savoir, monsieur le ministre, quelle politique sera précisément mise en oeuvre pour que le Cher bénéficie d'une logistique ferroviaire moderne, rapide et adaptée, à destination de Paris d'une part, et de Lyon et Nantes d'autre part.

M. le président. M. Pointereau pose toujours d'excellentes questions ! Et on entend plus souvent parler du Cher depuis qu'il fait partie de cette assemblée !
Sourires
Monsieur le sénateur, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de M. Dominique Perben, qui aurait souhaité vous répondre lui-même.
En ce qui concerne l'axe Nantes-Tours-Vierzon-Lyon, le contrat de plan État-région Centre 2000-2006 a permis de poursuivre l'électrification des voies engagée par le XIème plan entre Vierzon et Bourges.
La réalisation de la section Tours-Vierzon, correspondant à l'électrification d'un tronçon d'environ 100 kilomètres de cet axe transversal majeur, permettra d'assurer l'homogénéité de la traction des trains de fret et de voyageurs.
La participation de l'État à ce projet s'est déjà élevée à 5 millions d'euros. Dans le cadre du programme d'accélération décidé par le Gouvernement lors du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars dernier, il a été décidé que 24 millions d'euros seront affectés à cette opération en 2006.
En outre, un programme d'études est inscrit à ce contrat de plan, pour l'amélioration de la section Bourges-Saincaize.
Plus au sud, des travaux de modernisation sont réalisés en Auvergne et Rhône-Alpes. Des travaux d'électrification ont ainsi été lancés entre Saincaize et St Germain-des-Fossés. L'effort sera poursuivi en 2006, puisque près de 16 millions d'euros y seront affectés.
Par ailleurs, des travaux d'infrastructure entre Montluçon et Bourges, inscrits au contrat de plan État-région 2000-2006, devraient permettre d'améliorer le raccordement de l'agglomération de Montluçon à la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, à hauteur de Vierzon.
En ce qui concerne cet axe, les travaux de régénération de l'infrastructure, financés par Réseau ferré de France pour un total de 233 millions d'euros, s'achèveront fin 2006.
De nouvelles rames ont également été mises en service. Les voyageurs bénéficient désormais de conditions de confort et de régularité bien meilleures - sept allers et retours par jour -, comme cela a été souligné par une récente enquête de satisfaction.
Par ailleurs, à la suite de la demande exprimée par les régions Limousin et Centre dans le cadre du comité de pilotage Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la direction TGV France de la SNCF étudie la création d'une liaison TGV aller et retour Brive-Limoges-aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle-Lille, en substitution d'un service Corail existant.
Sous réserve de la signature d'une convention d'exploitation avec les régions concernées, auxquelles il appartient de prendre leur décision en relation avec la SNCF, cette liaison TGV s'arrêterait notamment à Vierzon et pourrait être mise en oeuvre dès 2007.
Vous le voyez, les aménagements de ces lignes contribueront à une amélioration de la qualité du service offert à l'usager.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que M. Dominique Perben m'a chargé de vous transmettre. Il reste à l'écoute des nouvelles suggestions que vous voudrez bien lui communiquer.

Je remercie M. le ministre, mais il ne répond que partiellement à l'ensemble de mes questions.
La situation de la ligne Lyon-Nantes semble évoluer. En revanche, cela ne progresse pas assez rapidement pour la ligne Bourges-Saincaize.
Par ailleurs, un certain nombre d'usagers s'organisent et dénoncent les dysfonctionnements constatés entre Vierzon et Paris. Tous les jours, ils subissent des retards ; ce matin encore, nous étions en retard d'un quart d'heure. De plus, le Téoz a été remplacé par un Corail, comme c'est souvent le cas.
Il est donc nécessaire d'avancer sur cette question. Il faut que le Cher soit un département attractif ; or, sa population est tous les ans en diminution. Quand on parle de désertification, il convient de se donner les moyens de la combattre et de mettre en place des infrastructures adaptées à cette situation.
Si, dans les quatre ou cinq prochaines années, nous n'obtenons pas une liaison à grande vitesse Limoges-Vierzon-Orléans-Paris, j'ai peur que le Cher ne soit laissé pour compte, ce que je ne souhaite pas.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 963, adressée à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler à nouveau l'attention de M. le ministre délégué sur la situation des habitants du quartier de La Source, dans la commune d'Orléans, au regard de la détermination des valeurs locatives qui, vous le savez, servent de base au calcul de la taxe d'habitation et des impôts fonciers qu'ils acquittent.
La réponse qu'a apportée M. Jean-François Copé le 22 décembre 2005 à la question écrite que je lui avais posée n'a en effet correspondu ni à mon attente ni à celle des habitants concernés.
Je veux rappeler que, s'il existe des écarts injustifiés entre les montants des valeurs locatives sur l'ensemble du territoire national, dans le cas du quartier d'Orléans-La Source, ces écarts prennent de telles proportions qu'ils suscitent le très compréhensible mécontentement des habitants.
L'association des habitants d'Orléans-La Source a ainsi établi que le montant de la valeur locative moyenne était, dans ce quartier, égale à « une fois et demi celle du reste de la ville d'Orléans ».
Dans ma question écrite, j'exposais que ces disparités avaient conduit l'administration fiscale, à la demande de deux bailleurs sociaux, à revoir à la baisse pour un certain nombre de logements le coefficient d'entretien, qui, vous le savez, est l'un des paramètres qui permettent de définir la valeur locative. Je faisais valoir qu'il serait logique d'étendre cette mesure à l'ensemble des logements gérés par des bailleurs sociaux dans le quartier d'Orléans-La Source et que, en outre, les mêmes causes étant en oeuvre, il était également logique de l'appliquer à un certain nombre de pavillons.
La réponse que j'ai reçue énonce un certain nombre de règles à caractère général, mais, malheureusement, n'apporte pas de précision quant à la question toute particulière de ce quartier, dont les habitants se trouvent être défavorisés sur le plan de l'équité fiscale.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, monsieur le ministre, si, tout d'abord, vous comptez, en vertu du principe d'égalité, décider l'extension de la révision des paramètres d'évaluation qui a eu lieu à l'ensemble des logements sociaux du quartier même d'Orléans-La Source.
Ensuite, toujours en vertu du principe d'égalité, comptez-vous l'étendre aux pavillons pour lesquels cela apparaît à l'évidence justifié ?
Enfin, je voulais savoir, puisque je ne méconnais pas la complexité de ces questions - d'ailleurs, nul ne la méconnaît -, si vous seriez favorable à l'organisation d'une réunion de travail associant les représentants de votre ministère et les représentants de l'association des habitants d'Orléans-La Source afin de procéder à un travail concret sur la prise en compte du coefficient d'entretien dans la détermination des valeurs locatives des logements de ce quartier, de manière à étudier et à préparer les évolutions qu'appelle en l'espèce la mise en oeuvre effective du principe d'égalité.
Monsieur le sénateur, vous appelez une nouvelle fois l'attention du Gouvernement et de Jean-François Copé sur la situation des habitants du quartier de La Source, à Orléans, au regard de la détermination des valeurs locatives servant de base de calcul à la taxe d'habitation et à la taxe foncière.
Vous estimez que les termes de la réponse à l'une de vos questions écrites ne sont pas satisfaisants et vous souhaitez que, en application du principe d'égalité, la révision des paramètres d'évaluation soit étendue à l'ensemble des logements sociaux du quartier d'Orléans-La Source et à un certain nombre de pavillons du secteur privé. Une telle démarche supposerait que l'ensemble des locaux en question présentent des caractéristiques identiques.
Comme il s'agit essentiellement de questions nécessitant une analyse local par local, ces travaux de mise à jour doivent être menés, si la situation le justifie, au cas par cas, chaque année, en étroite collaboration avec la commission communale des impôts directs locaux.
Lorsque des réclamations portant sur des changements de caractéristiques physiques sont formulées par des propriétaires, organismes sociaux ou propriétaires privés, elles sont communiquées pour avis soit au maire, soit à la commission communale, lorsque le litige porte sur une question de fait. Mais vous savez tout cela !
Dans le cas précis des logements HLM du quartier de La Source, les services fiscaux ont intégralement suivi l'avis de la commission communale des impôts directs de la ville d'Orléans pour procéder au calcul des nouvelles valeurs locatives.
En revanche, les textes ne prévoient pas que les associations de quartier soient consultées dans le cadre de l'examen des changements qui affectent les valeurs locatives foncières.
Cela étant, pour régler définitivement ce dossier et donner suite à votre dernière suggestion, je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'une réunion soit prochainement organisée à Bercy avec les représentants de ce quartier pour explorer les solutions envisageables pour le cas, certes vaste, mais néanmoins particulier, que vous souhaitez évoquer.

Je me rappelle ma visite dans ce quartier de La Source, lorsque j'étais ministre...
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Monsieur le président, nous avions eu le plaisir de vous accueillir dans ce quartier...

... plein de vitalité, plein de promesses et d'avenir, où habite effectivement M. le sénateur Jean-Pierre Sueur - je vous remercie, ma chère collègue, de le souligner ! Mais ce n'est pas pour cette seule raison que j'y suis attaché : vous le savez bien, je suis attaché à tous les quartiers de toutes les communes du département du Loiret, et d'ailleurs de la République française, monsieur le président !
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Vous avez bien voulu reprendre les données du problème et considérer que les disparités sont évidentes puisque, à situation égale à l'intérieur d'une même ville, les impôts locaux diffèrent très fortement en vertu de la valeur locative, notamment du coefficient d'entretien, lequel, je l'indiquais tout à l'heure, entre en ligne de compte pour la définition de cette même valeur locative.
Je suis donc très sensible, monsieur le ministre - et je tiens à vous en remercier -, à la proposition que vous venez de faire d'organiser une réunion de travail à Bercy avec les représentants de ce quartier, réunion qui, je l'espère, sera fructueuse.

La parole est à M. Roger Madec, auteur de la question n° 938, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Nous le savons tous, les voyages scolaires constituent pour beaucoup d'enfants une chance de découvrir une ville, une région ou un pays, en particulier pour celles et ceux que leurs parents, ayant des revenus très modestes, ne peuvent emmener en vacances.
L'autre intérêt majeur de ces voyages est de permettre d'aborder l'enseignement de manière plus ludique et plus vivante et ainsi, bien souvent, de réconcilier un élève avec l'école et de créer un lien nouveau entre l'enseignant et l'enfant.
Pourtant, monsieur le ministre, l'organisation de ces voyages scolaires est de plus en plus malaisée, notamment du fait que les enseignants éprouvent les plus grandes difficultés à obtenir la prise en charge de leurs frais de séjour.
Je rappelle que ces sorties constituent pour eux une charge de travail importante, que ce soit lors de la préparation ou, a fortiori, durant le voyage, pendant lequel l'enseignant est en effet présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre : son engagement est alors total, et il doit faire face à tout type de difficultés. Il paraît donc bien normal qu'il n'ait pas à financer lui-même sa participation à ce séjour, car ce serait là bien mal récompenser le dévouement des maîtres d'écoles ou des professeurs envers leurs élèves et envers le système public de l'éducation nationale.
Pourtant, monsieur le ministre, la situation actuelle est plutôt décourageante pour la communauté enseignante.
Traditionnellement, les transports ou l'hébergement des accompagnateurs étaient offerts par les opérateurs. Le coût global du voyage était négocié avec les voyagistes, puis partagé entre les élèves. Aujourd'hui, le principe de la non-participation des élèves au défraiement des accompagnateurs est appliqué avec rigueur, à la suite notamment des observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine.
Ce principe est juste : ce n'est pas aux familles de subvenir aux besoins des enseignants ou de l'école. Mais son application est problématique, monsieur le ministre !
Au rectorat de Paris comme dans d'autres académies, on renvoie la question du financement des accompagnateurs vers les collectivités territoriales, qui sont de nouveau sollicitées pour prendre en charge des dépenses d'enseignement. Je rappelle au passage que l'État est seul compétent pour les personnels enseignants, et donc pour la prise en charge de leurs frais professionnels.
Il est également demandé aux établissements de puiser dans leurs fonds propres ou de trouver des partenaires pour assurer le financement de ces voyages. Quant à la gratuité offerte aux accompagnateurs par les opérateurs, il leur est recommandé d'y avoir recours avec parcimonie.
Au total, monsieur le ministre, le désarroi dans la communauté enseignante est grand, et de nombreux chefs d'établissement ont déjà limité le nombre de ces voyages pédagogiques. Il suffit d'évoquer le sujet avec eux pour sentir leur malaise et leur déception de devoir dire aux élèves et aux parents : « Non, cette année il n'y aura pas de voyage. »
Plusieurs pistes sont possibles pour enrayer la diminution régulière du nombre des classes de découverte : je pense notamment à l'attribution de crédits spécifiques aux établissements ; à la prise en charge directe par l'État de ces frais au même titre que certains frais de déplacement des enseignants ; à la prise en charge des heures supplémentaires effectuées par les accompagnateurs. À la suite d'un rapport remis à votre prédécesseur, une députée de votre majorité avait également suggéré - en vain -qu'une indemnité forfaitaire leur soit versée.
Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à l'encouragement de ces voyages scolaires, qui contribuent à l'épanouissement de nombre d'enfants et à la qualité de notre enseignement.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous assurer de tout l'intérêt que Gilles de Robien, qui m'a demandé de vous apporter sa réponse, attache à l'organisation des voyages scolaires. Compte tenu des nombreux bénéfices retirés par les élèves de ces expériences éducatives et pédagogiques, il importe, en effet, d'encourager la mise en oeuvre de tels projets.
Les observations émises sur ces questions par plusieurs chambres régionales des comptes, relayées récemment par des circulaires rectorales, ont permis de rappeler certains principes de base devant présider à l'organisation de toute sortie scolaire.
Premièrement, le principe de gratuité des voyages doit prévaloir pour les accompagnateurs, qui, exerçant une mission au service de l'établissement, n'ont pas à supporter le coût d'une sortie s'inscrivant dans le prolongement d'une action d'enseignement. C'est la moindre des choses.
Deuxièmement, les frais relatifs aux accompagnateurs ne sont pas à la charge des familles.
D'une façon générale, les recettes affectées au financement des sorties scolaires doivent être inscrites au budget de l'établissement. En approuvant les modalités de ce financement, le conseil d'administration est appelé à se prononcer, d'une part, sur le montant de la participation des familles, d'autre part, sur l'ensemble du budget consacré au voyage, incluant la prise en charge financière du voyage des accompagnateurs.
En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement, avec l'accord du conseil d'administration, finance tout ou partie des dépenses engendrées par un voyage scolaire sur son propre budget, en particulier sur son fonds de réserve.
Les difficultés apparues dans certains établissements pour l'organisation de voyages scolaires résultent en grande partie de la méconnaissance des différentes modalités auxquelles ces établissements peuvent avoir recours. C'est pourquoi le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche vient de mettre en ligne sur son site « eduscol », à l'intention des enseignants et des chefs d'établissement souhaitant organiser des voyages scolaires, une information à jour portant sur les différentes possibilités de financement des voyages.
Parmi les sources de financement, l'établissement dispose bien entendu des crédits alloués par l'État, qui peuvent être des crédits pédagogiques, des dotations d'aides aux projets, etc. ; il est également envisageable d'avoir recours aux aides attribuées par les collectivités territoriales - communes, conseils généraux, conseils régionaux -, par le foyer socio-éducatif ou d'autres associations de type loi 1901, ou encore aux subventions accordées par des entreprises privées, dans la mesure où celles-ci ne sont pas assorties d'une obligation publicitaire.
Vous voyez donc, monsieur le sénateur, que les moyens de résoudre ces problèmes financiers existent ; ils sont détaillés entièrement sur le site « eduscol » du ministère.

Je me félicite - mais je n'en doutais pas ! - que le ministre porte un intérêt particulier à ce type de voyages, classes de découverte ou classes transplantées, qui sont en effet très positifs pour bon nombre d'enfants issus de couches défavorisées.
Cependant, les propos que je viens d'entendre ne comportent aucune avancée en matière de financement. Il est évident que les établissements peuvent prendre sur leur budget ; mais, pour nombre d'entre eux, il est déjà étriqué. Il reste donc bien difficile de monter ces projets, et je regrette que la réponse ne soit pas plus positive.
J'en prends néanmoins note, et je vous remercie, monsieur le ministre.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la question n° 927, adressée à M. le ministre délégué aux anciens combattants.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelque temps, il est commun pour les responsables politiques de faire état du devoir de mémoire de notre pays, pour calmer ces jeunes qui refusent les discriminations et demandent plus de droits et de respect, notamment pour leurs chibanis !
Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la libération de notre pays a été aussi le fait de la Première armée française, recrutée en Afrique, composée de 200 000 hommes, dont 130 000 « indigènes », c'est-à-dire 110 000 Maghrébins et 20 000 Africains.
Un demi-siècle après, il est intéressant de voir comment sont traités ces hommes que l'état-major français décrivait comme d'excellents combattants, braves et capables des efforts physiques les plus intenses.
Depuis la fin de la colonisation officielle, les anciens combattants et les anciens fonctionnaires d'origine étrangère subissent une inégalité de traitement. Leur pension a ainsi été figée, cristallisée et transformée en indemnité non indexable sur le coût de la vie.
En 1980, près de 700 anciens combattants ont porté plainte et obtenu gain de cause contre la France devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour discrimination raciale.
En 2001, le Conseil d'État a rendu un arrêt condamnant la France à verser au plaignant, un tirailleur sénégalais, Amadou Diop, une pension établie au même taux que celui en vigueur pour les Français et à lui payer les arriérés dus.
En 2005, Tahar Saïm, ancien militaire algérien vivant à Oran avec 76 euros par mois, a obtenu du tribunal administratif de Poitiers la revalorisation complète de sa pension.
Malheureusement, Amadou Diop et Tahar Saïm, à l'instar d'autres anciens combattants, sont morts avant d'avoir pu bénéficier de cette décision des tribunaux.
A travers la loi de finances rectificative de 2002, le Gouvernement a refusé d'appliquer l'égalité de traitement, reconnue par les tribunaux, et il s'est contenté d'une faible réévaluation, supposée fondée sur le taux de parité du pouvoir d'achat.
Dans le journal Libération du 22 février 2006, monsieur le ministre, vous vous félicitiez de cette « vaste opération de rétablissement de l'équité ». Mais cette mesure est une véritable parodie ! Elle ne répare en rien l'injustice faite aux anciens combattants survivants et à leur famille. En effet, sous le fallacieux argument d'équité qu'invoque le Gouvernement, ce n'est rien d'autre qu'une forme supplémentaire et hypocrite de discrimination qui se cache.
Le fait d'aligner le montant des pensions sur le niveau de vie de chacun des pays où vivent ces personnes revient à pratiquer une nouvelle discrimination, tout à fait illégale, rejetant dans l'ombre le principe de l'égalité de traitement avec les frères de combat français.
Tout d'abord, cette réforme, qui est supposée régler le problème des pensions et retraites de ces anciens serviteurs de la France, en utilisant un critère de résidence au moment de la liquidation, aboutit à maintenir une discrimination légale.
Est ainsi perpétuée l'inégalité entre Français et étrangers, mais également entre étrangers de différentes nationalités, ce qui conduit à des situations paradoxales. En effet, la mesure ne vise que les étrangers. Par exemple, un Français vivant au Maroc reçoit le taux français à la différence du Marocain, mais un Sénégalais qui a liquidé ses droits au Sénégal et qui vit en France n'a pas droit au taux français. On voit bien qu'il y a une véritable inégalité.
Cette réforme est donc un leurre. Je citerai quelques chiffres pour que l'on puisse en juger : lorsqu'un ancien combattant français perçoit 100 euros, un ancien combattant sénégalais qui percevait environ 40 euros perçoit désormais, avec la réévaluation, 46 euros, tandis qu'un ancien combattant marocain qui percevait 8 euros en perçoit désormais 14.
Cette situation est inacceptable ! Nous sommes, en effet, bien loin de l'égalité de traitement et de la dignité dues à ces personnes, comme à tout être humain. Où est l'équité dont vous parliez, monsieur le ministre ? D'autant plus que non seulement le critère de parité du pouvoir d'achat est inacceptable dans le principe, mais, dans les faits, les dispositions réglementaires effectivement utilisées ne respectent pas ce critère.
En réalité, les coefficients de parité utilisés, fondés sur le niveau de la vie, sont beaucoup plus faibles et largement plus défavorables que ceux qui sont fondés sur le coût de la vie et qui avaient été prévus par la loi.
D'ailleurs, le tribunal administratif, dans une décision rendue le 4 mai 2005, demande la revalorisation de la pension avec effet rétroactif, et il vous fait au passage une mise en garde : « pas question de lier la revalorisation au pouvoir d'achat ! »
Or vous avez préféré ignorer cette décision, qui rappelle que « seule est légale la stricte égalité de traitement entre anciens combattants français ou étrangers, quel que soit leur lieu de vie ».
Durant la Seconde Guerre mondiale et les guerres coloniales, sans que l'on exige d'eux qu'ils parlent français ou chantent la Marseillaise, et parfois même contre leur accord, les goums marocains, les spahis algériens, les tirailleurs sénégalais et tant d'autres, ont donné leur courage, leur jeunesse et, parfois, leur vie à la France. Alors pourquoi, aujourd'hui, n'est-il toujours pas question d'accorder aux combattants étrangers du Mali ou du Maroc le même niveau de pension qu'aux anciens soldats français ?
Cela fait près de cinquante ans que cette situation injuste perdure, près de cinquante ans que non seulement des familles entières sont plongées dans la misère et le désarroi, mais surtout que ces hommes voient ainsi leur dignité bafouée.
Quant à la France, elle a fermé le dossier à moindres frais, puisque cela lui coûte aujourd'hui 25 millions d'euros par an. Comme seuls les recours individuels sont possibles, le Gouvernement joue le temps, en comptant sur la disparition progressive de ces hommes âgés et dispersés dans le monde, sans moyen d'agir !
Ce déni de droit ne fait que renforcer les injustices connues pendant la période coloniale, mais il révèle aussi qu'un racisme institutionnel perdure.
Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin mettre un terme complet à cette cristallisation et garantir l'égalité des droits en matière de pension et de retraite aux anciens combattants et fonctionnaires étrangers qui se sont mis au service de la France, quel que soit leur lieu de résidence aujourd'hui ?
Quand allez-vous abroger le décret et l'arrêté du 3 novembre 2003, qui maintiennent ces discriminations, et nous proposer un projet de loi visant à supprimer toutes les discriminations faites aux anciens combattants et fonctionnaires étrangers qui ont servi notre pays ?
Que faites-vous pour remédier aux blocages générant des discriminations de fait ? En effet, les neuf dizièmes des personnes concernées ne résident pas en France : pour des raisons d'éloignement géographique, couplées au fait qu'elles sont souvent d'origine sociale défavorisée, qu'elles ont des difficultés avec le langage administratif, et souvent de lourds handicaps liés à leur âge, elles ne disposent pas, dans les faits, de la possibilité d'utiliser les outils de droit, et donc de contester effectivement les décisions discriminatoires et illégales des administrations devant les tribunaux français.
Dès lors, pour ces personnes qui subissent une exclusion de droit et de fait, quels moyens pensez-vous mettre en place, auprès de nos ambassades et de nos consulats, pour faire respecter le droit reconnu dans les arrêts du Conseil d'État ?
Madame le sénateur, vous avez décrit une situation difficile sur laquelle je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'était la situation d'avant 2002, et cela nous a effectivement choqués lorsque nous sommes arrivés aux affaires.
En effet, ces hommes, qui ont combattu pour la France, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui, parfois, sont allés jusqu'au sacrifice suprême, étaient traités de façon « légère », pour ne pas dire plus !
Durant plus de quarante-cinq ans, j'y insiste, tous les gouvernements qui se sont succédé ont ouvert ce dossier et n'ont apporté aucune réponse. Il est à l'honneur du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin d'avoir apporté ces réponses.
Vous dites qu'il n'y a pas eu « décristallisation ». C'est inexact, madame le sénateur. Concrètement, le principe de la décristallisation a été inscrit dès la loi de finances rectificative pour 2002, puis mis en oeuvre par le décret du 3 novembre 2003.
Cette décristallisation a été observée avec la plus grande attention, car nous voulions faire en sorte qu'une autre iniquité ne vienne pas s'ajouter à celles que nous voulions corriger.
C'est ainsi que nous avons décidé, en effet, de recourir à la grille de parité du pouvoir d'achat de l'ONU. Ce mode de calcul permet de garantir aux anciens combattants ou ayants droit concernés un pouvoir d'achat équitable.
Vous avez cité tout à l'heure l'exemple des Sénégalais. Nous ne voudrions pas qu'en opérant une distribution nominale des droits de chacun l'on arrive à une iniquité qui frapperait alors les Français métropolitains.
Si, par exemple, un ressortissant sénégalais, vietnamien ou algérien, avec un taux d'invalidité équivalent à celui de ses camarades français à Paris, peut se procurer 10 kilos de sucre, alors qu'un autre peut s'en procurer 100 kilos, ce n'est pas équitable. C'est donc le pouvoir d'achat qui est important et non pas la distribution nominale, dont on veut nous faire croire qu'elle représente l'égalité.
Ainsi, il a été décidé, premièrement, une décristallisation et une actualisation des trois prestations qui étaient gelées et qui sont : la retraite du combattant, la pension militaire d'invalidité et la pension de retraite.
Deuxièmement, nous avons décidé d'accorder à toutes les veuves la réversion - qui était gelée - des pensions de retraite ou d'invalidité.
Troisièmement, nous avons décidé de permettre une révision des droits pour les pensions militaires d'invalidité en cas d'aggravation des infirmités initialement reconnues et indemnisées comme telles.
Quatrièmement, enfin, nous avons instauré un rappel de quatre ans, tenant compte de la révision de ces prestations.
Il s'agit là, madame le sénateur, d'une vaste opération de rétablissement de l'équité. La première année, 130 millions d'euros ont été consacrés à cette décristallisation, 132 000 prestations ont été concernées et ces indemnités ont profité à 83 000 pensionnés appartenant à vingt-trois pays différents.
Nombreux étaient ceux qui appelaient cette décristallisation de leurs voeux. Vous avez évoqué tout à l'heure la Seconde Guerre mondiale : elle ne constitue pas une spécificité, toutes les générations du feu ont droit aux mêmes règles d'attribution des pensions d'invalidité et des pensions de retraite. Quant aux tirailleurs, ce n'est qu'une subdivision d'arme : ils sont à l'infanterie ce que les spahis sont à l'arme blindée et à la cavalerie.
Nous n'avons donc pas de problème de conscience. Une équité parfaite a été établie, en s'appuyant sur la grille de parité du pouvoir d'achat de l'ONU. Nous aurions souhaité que les gouvernements qui nous ont précédés, notamment avant 2002, établissent cette équité, et nous regrettons beaucoup qu'ils ne l'aient pas fait !

Monsieur le ministre, il s'agit en effet d'une situation difficile qui perdure, que vous avez trouvée ainsi, mais aujourd'hui, en 2006, il est important d'y remédier. Or, la réponse que vous m'avez apportée est tout à fait insuffisante.
Vous nous avez parlé de 130 millions d'euros, mais, pour régler l'ensemble de ces dossiers, nous avons besoin de 1, 83 milliard d'euros.
Vous avez mis en avant le principe de l'équité du pouvoir d'achat. Permettez-moi de relever un certain mensonge, qui justifie la poursuite de discriminations fondées sur des critères tout à fait douteux et contestables.
Prenons le cas du Maroc qui, selon le classement de la Banque mondiale, est le troisième pays d'Afrique pour son niveau de vie, après la Tunisie et l'Algérie. Or les pensions attribuées aux anciens combattants marocains pour la France sont les plus faibles de toute l'Afrique ; d'ailleurs, cette discrimination s'applique aussi aux Marocains qui vivent en France. Il s'agit donc d'une véritable spoliation, qui n'a pas trouvé de solution.
Je terminerai en disant que la mémoire partagée ne pourra être bâtie que si les discriminations et les dénis de justice s'arrêtent. En effet, ces hommes sont un symbole vivant de notre histoire commune, mais pour faire en sorte que cette mémoire perdure et qu'elle soit respectée, nous devons avant tout réussir à appliquer le principe de l'égalité des droits. La France ne pourra pas faire respecter, ni par sa jeunesse ni par les pays étrangers, ce qu'elle ne peut pas porter elle-même, c'est-à-dire les valeurs d'égalité des droits et de traitement.
Il est important, si elle veut faire valoir sa mémoire et sa parole, qu'elle accepte les décisions du Conseil d'État et des tribunaux.

La parole est à M. Robert Laufoaulu, auteur de la question n° 965, adressée à M. le ministre de l'outre-mer.

Ma question porte sur les difficultés rencontrées par le territoire des îles de Wallis-et-Futuna dans la mise en oeuvre du Fonds européen de développement, le FED, en particulier du document unique de programmation, le DOCUP.
Le DOCUP de Wallis-et-Futuna, signé le 16 août dernier, prévoit la mise en oeuvre de quatre projets sous le 9e FED. Les quatre conventions de financement correspondantes n'ont à ce jour toujours pas été signées et la Commission européenne envisage, en outre, de faire basculer deux des quatre projets sous le prochain instrument financier.
Cela est préoccupant à un double niveau.
Tout d'abord parce qu'il s'agirait d'une remise en question profonde du DOCUP quelques mois après sa signature par la Commission européenne.
Par ailleurs, ce serait négatif en termes d'exécution des crédits sous le 9e FED, d'autant que la Commission doit procéder, en 2006, à sa révision à mi-parcours, révision qui sera déterminante en termes de réallocation des crédits entre les pays et territoires d'outre-mer, les PTOM.
Pour mémoire, je tiens également à rappeler que dans le cadre du 8e FED, qui avait été signé en 1999 pour un montant de 768 millions de francs Pacifique, moins de la moitié de la somme avait été déléguée et que le reste a été reporté sur le 9e FED.
Cela illustre bien que les difficultés que nous rencontrons sont récurrentes. Et si elles proviennent partiellement d'une certaine rigidité de la part des services de la Commission européenne, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance patente de fonctionnaires dans les domaines des travaux publics, de l'agriculture et de la pêche, ou encore de l'environnement, est aussi en cause dans les retards d'exécution des fonds européens de développement.
Ce manque de personnel, je l'ai souligné pratiquement chaque année, depuis 1998, lors de mes interventions dans la discussion du projet de loi de finances.
Mais j'en reviens à nos préoccupations immédiates et je demande au Gouvernement de bien vouloir intervenir auprès des services de la Commission européenne afin que la position de Wallis-et-Futuna soit entendue et comprise et que les quatre conventions de financement prévues dans le DOCUP soient signées le plus rapidement possible pour permettre une mise en oeuvre effective des quatre projets.
Monsieur le sénateur, M. François Baroin, ministre de l'outre-mer, vous prie de bien vouloir excuser son absence et m'a demandé de vous transmettre sa réponse.
Le Gouvernement partage votre préoccupation sur cette question importante pour le développement économique de l'archipel.
Le ministre de l'outre-mer a appelé l'attention du commissaire européen, M. Louis Michel, sur ce sujet lors du forum des pays et territoires d'outre-mer du 5 décembre dernier. À cette occasion, il a fait état des difficultés rencontrées, et que vous avez soulignées, dans la mise en oeuvre des fonds européens de développement.
Le commissaire Louis Michel a pris l'engagement d'organiser une réunion tripartite entre les États membres, la Commission et le forum des PTOM en 2006. Il s'agira d'apporter des réponses aux questions soulevées par les collectivités d'outre-mer associées à l'Union européenne et de définir en commun des orientations pour le successeur du 9e Fonds européen de développement.
Le Gouvernement souhaite approfondir les pistes d'amélioration de la mise en oeuvre du FED pour cette période, mais aussi pour la période à venir. Un groupe de travail tripartite a d'ores et déjà été mis en place et s'est réuni pour la première fois le 7 mars dernier.
En ce qui concerne le document unique de programmation du 9e Fonds européen de développement de Wallis-et-Futuna, le Gouvernement souligne l'importance de la réalisation de projets structurants indispensables au développement du territoire. L'État veillera tout particulièrement à ce que ces projets, avalisés par la Commission et figurant dans le document unique de programmation signé le 17 août 2005, soient tous menés à terme sur le 9e Fonds européen de développement et fassent l'objet de conventions de financement le plus rapidement possible.
S'agissant du 8e Fonds européen de développement et du devis programme de clôture dans le cadre du projet « Préservation de la ressource en eau du territoire », la Commission européenne n'a pas encore donné de réponse aux demandes de prolongation. Elle a fait savoir qu'elle souhaiterait que la période d'engagement des crédits s'achève au 31 mars 2006. Il convient donc de poursuivre les échanges avec la Commission dans l'objectif d'une réalisation effective du projet de la collectivité.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement prend devant vous l'engagement d'appuyer vos demandes et d'intervenir auprès des services de la Commission. Il insistera alors sur la nécessité de renforcer la stabilité des procédures et le respect des engagements pris afin de trouver des solutions satisfaisantes dans les meilleurs délais.

Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir remercier M. Baroin de sa réponse, qui est satisfaisante.
Nous comptons sur lui pour défendre nos intérêts, comme nous l'avons fait lors du forum qui s'est tenu à Bruxelles, au mois de décembre dernier.
Permettez-moi toutefois de vous faire part de notre inquiétude, car nos représentants à Bruxelles devaient rencontrer le commissaire en charge du développement dès le mois de février ; or, cette rencontre n'a toujours pas eu lieu.

Je tiens à remercier les sénateurs de Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna qui ont assisté à l'intégralité de la présente séance.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.