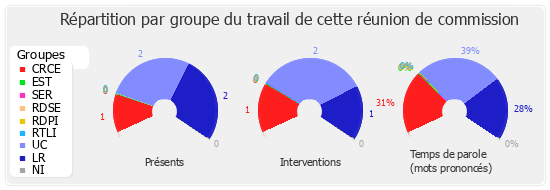Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 22 janvier 2008 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a entendu Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi constitutionnelle n° 170 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.
a indiqué que le présent projet de loi constitutionnelle était le préalable à la ratification du traité de Lisbonne.
Elle a estimé que ce traité permettrait le redémarrage de la construction européenne et constituait une avancée institutionnelle indispensable, l'Europe à vingt-sept ne pouvant fonctionner comme elle fonctionnait à six, à douze ou à quinze.
Elle a expliqué que dans sa décision du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel avait identifié deux séries de dispositions du traité incompatibles avec notre Constitution :
- une première série relative à de nouveaux transferts de compétences affectant les conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Ces nouveaux transferts concernent par exemple la coopération judiciaire en matière pénale ou la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;
- une seconde série relative aux nouvelles prérogatives reconnues par le traité aux parlements nationaux : d'une part, la faculté pour les parlements nationaux de s'opposer à une décision du Conseil européen mettant en oeuvre une procédure de révision simplifiée des traités, d'autre part, les pouvoirs reconnus à chaque assemblée parlementaire dans le cadre du contrôle du respect du principe de subsidiarité.
Elle a jugé cette révision constitutionnelle techniquement nécessaire.
a ensuite présenté le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture le 16 janvier 2008, sans modification.
Elle a indiqué que :
- l'article premier levait, dès l'entrée en vigueur de la loi, les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne ;
- l'article 2 modifiait le titre XV de la Constitution pour tirer les conséquences du traité de Lisbonne, dès l'entrée en vigueur du traité.
Outre des modifications terminologiques résultant de la substitution de l'Union européenne à la Communauté européenne, elle a souligné que l'article 2 :
- réécrivait l'article 88-1 de la Constitution, de façon à ce qu'il autorise l'ensemble des transferts de compétences prévus par les traités ;
- insérait un article 88-6 disposant que si une assemblée estime que le principe de subsidiarité a été méconnu, elle peut en alerter les institutions européennes et déférer, le cas échéant, à la Cour de justice de l'Union l'acte qui lui paraît contraire au principe de subsidiarité ;
- insérait un article 88-7 permettant au Parlement de s'opposer à une décision des institutions de l'Union de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée dans différents domaines.
Enfin, elle a indiqué que l'article 3 procédait à des coordinations.

Remarquant que le projet de loi se limitait à une révision a minima levant les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne, M. Patrice Gélard, rapporteur, a fait le voeu que l'ensemble des dispositions du titre XV de la Constitution puisse être réexaminé lors de la réforme des institutions.
Il a en particulier regretté que le projet de loi maintienne sans modification l'article 88-5 de la Constitution relatif aux nouvelles adhésions, dont la création en 2005 avait répondu à des raisons conjoncturelles.
Il lui a également semblé qu'il serait judicieux de réfléchir à l'insertion dans la Constitution d'une clause générale de participation à l'Union européenne, ce qui aurait pour avantage de ne pas procéder à une révision constitutionnelle préalablement à la ratification de tout traité européen. Il a souligné qu'une telle approche avait été retenue par plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
Il a mis en doute l'intérêt de prévoir, à l'article 88-2 de la Constitution, une disposition spécifique concernant le mandat d'arrêt européen, jugeant que la généralité de la formulation retenue pour l'article 88-1 de la Constitution était probablement suffisante.
Il a ensuite regretté l'emploi, tant par le traité de Lisbonne que par le projet de loi constitutionnelle, de la notion d'« acte législatif européen », qui ne correspond pas à celle d'acte législatif au sens du droit français. Il a souligné que des actes législatifs européens peuvent avoir un caractère réglementaire au sens du droit français.
Concernant l'article 88-5 et l'obligation introduite par la loi du 1er mars 2005 de soumettre à référendum les traités d'adhésion futurs, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que la prochaine réforme des institutions devrait en connaître.
Concernant l'idée d'une clause générale de participation à l'Union européenne, elle s'y est déclarée défavorable au motif que les révisions constitutionnelles ponctuelles permettaient au Parlement de débattre de chacune des avancées de la construction européenne.
A propos de la notion d' « acte législatif européen », tout en concédant qu'elle n'était pas parfaite, elle a fait valoir la nécessité de ratifier rapidement le traité de Lisbonne à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne.

s'est déclarée défavorable à une clause générale autorisant par avance des transferts de compétences. Au contraire, elle a jugé que la solution actuelle permettait de replacer ponctuellement l'Europe au centre du débat public et d'éviter l'adoption en catimini de textes importants.
Elle a estimé que le Conseil constitutionnel aurait dû soulever d'autres motifs d'incompatibilité, notamment la référence au fait religieux, la subordination de la politique étrangère et de sécurité commune à l'OTAN ou la soumission des services publics aux règles de la concurrence.

a déclaré que l'article 88-2 de la Constitution, dont l'objet se limite à protéger les évolutions futures du mandat d'arrêt européen d'un risque d'inconstitutionnalité, devrait prévoir une formulation plus large tendant à préserver l'ensemble du droit dérivé de ce risque.

A propos des objections faites à l'insertion d'une clause générale de participation à l'Union européenne, M. Christian Cointat a répondu qu'une telle clause n'aurait pas pour effet de priver le Parlement d'un débat puisque l'adoption d'une loi autorisant la ratification du traité continuerait à être nécessaire. Il a déclaré qu'une constitution devait être modifiée le moins souvent possible afin de ne pas porter atteinte à sa force symbolique. Enfin, vis-à-vis de nos partenaires européens, il a estimé qu'une clause générale combinée à une réserve constitutionnelle permettrait d'affirmer notre engagement européen tout en fixant des lignes rouges à ne pas franchir.
a indiqué son attachement à ce qu'un débat ait toujours lieu devant le Parlement.

a estimé que les dispositions de l'article 88-2 relatif au mandat d'arrêt européen étaient inutiles.
A propos de la notion de « transferts de compétences », il l'a jugée impropre préférant parler de « partages de compétences ». Il a indiqué que seul le traité de Maastricht avait réellement procédé à des transferts de compétences radicaux, les traités postérieurs ayant surtout aménagé de nouvelles procédures.
a répondu que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée au Conseil était constitutif d'un transfert de compétences portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

s'est déclaré favorable à la solution actuelle consistant à réviser ponctuellement la Constitution pour permettre la ratification des traités contraires à la Constitution.
Répondant à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le traité de Lisbonne était distinct sur le fond et sur la forme du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Concernant les références au fait religieux ou à l'OTAN, elle a expliqué que ces dispositions n'emportaient aucune conséquence juridique pour la France.
Puis, la commission a procédé à l'audition de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi n° 158 (2007-2008) relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dont le rapporteur est M. Jean-René Lecerf.
a tout d'abord présenté les trois volets du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, annonçant que son ambition était de mieux protéger la société dans le respect des droits des personnes :
- l'instauration d'une procédure de rétention de sûreté pour les criminels particulièrement dangereux ;
- l'amélioration du traitement par l'autorité judiciaire des personnes déclarées pénalement irresponsables ;
- le renforcement de l'efficacité du dispositif de l'injonction de soins.
Détaillant le premier volet du texte, elle a souligné qu'il visait à prendre en charge, en fin de peine, les criminels particulièrement dangereux dans un centre socio-médico-judiciaire, ajoutant que ceux-ci seraient avertis le jour de leur condamnation de cette éventualité et qu'ils seraient soumis, dans cette hypothèse, un an avant la fin de leur peine, à un examen de leur dangerosité par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui pourrait saisir, par l'intermédiaire du procureur général, une commission régionale composée de magistrats chargée de rendre une décision motivée, après un débat contradictoire, sur le placement en rétention de sûreté. En cas de décision de placement, d'une durée d'un an renouvelable, ces personnes, a-t-elle précisé, bénéficieraient d'une prise en charge thérapeutique personnalisée dans un centre socio-médico-judiciaire, afin d'apporter les soins nécessaires à ces personnes qui, sans être atteintes de trouble mental, souffrent de troubles graves de la personnalité. Elle a insisté sur le fait que la rétention de sûreté, loin d'être un simple enfermement, visait avant tout à faciliter le retour à la vie civile de l'individu par l'exercice d'activités diversifiées et le concours de professionnels compétents (médecins, travailleurs sociaux et criminologues). A cet égard, elle s'est réjouie que le premier centre de ce type ouvre, à titre expérimental, à l'hôpital de Fresnes, dès le 1er septembre 2008. Après avoir indiqué qu'à l'issue d'une période de rétention de sûreté, les personnes pouvaient être placées sous surveillance électronique mobile ou être soumises à une injonction de soins, et, en cas de manquement à ces obligations, faire l'objet d'une nouvelle mesure de rétention de sûreté, elle a présenté la mise en oeuvre de la loi dans différentes hypothèses :
- en premier lieu, les criminels pour lesquels la rétention de sûreté a été envisagée par la Cour d'assises le jour de leur condamnation pourraient être placés dans un centre socio-médico-judiciaire à l'issue de leur peine s'ils présentent encore une particulière dangerosité ;
- en second lieu, les tueurs et violeurs en série actuellement incarcérés pourraient être placés en rétention de sûreté, même si la condamnation, antérieure par définition à l'entrée en vigueur de la loi, n'avait pas prévu la possibilité de réexamen de leur dangerosité ;
- enfin, les autres condamnés et ceux qui sont actuellement incarcérés pourraient être placés sous surveillance judiciaire mobile à l'issue de leur peine, et en cas de manquement aux obligations résultant de la surveillance, être placés en rétention de sûreté si ces violations traduisent un regain de dangerosité.
a ensuite insisté sur le fait que la rétention de sûreté constituait une mesure de sûreté, prononcée par des juges, dont le seul but est de prendre en compte la dangerosité d'une personne afin d'éviter toute récidive. Elle a déclaré que par cette visée essentiellement préventive, la mesure de sûreté, au même titre que le port du bracelet électronique, ne saurait revêtir le caractère de peine, s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 sur le bracelet électronique ainsi que sur celle de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 5 février 2004, qui a estimé que la « détention-sûreté », analogue à la mesure de rétention de sûreté, ne constituait pas une peine, car elle avait pour objet, non de réprimer une faute, mais de protéger la société d'un criminel.
A contrario, elle a relevé que la procédure d'hospitalisation d'office avait, elle, pour objet d'interner des personnes atteintes de troubles mentaux, généralement reconnues irresponsables pénalement, et non de troubles de la personnalité. Dans ce dernier cas, le criminel présente certes une forme d'aliénation qui requiert un traitement efficace pour prévenir toute récidive, mais la prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire, et non exclusivement psychiatrique. En conséquence, elle a jugé inadaptée la procédure d'hospitalisation d'office pour traiter les troubles de la personnalité.
Abordant le deuxième volet du projet de loi concernant l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a souligné que la procédure ne s'achèverait plus par un non-lieu, ressenti douloureusement par les victimes, mais par une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, rendue après une audience contradictoire devant la chambre de l'instruction et inscrite au casier judiciaire des personnes. Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait prévu que les juridictions puissent décider elles-mêmes de placer en hôpital psychiatrique la personne reconnue irresponsable, elle a souligné que les juges pourraient également la soumettre à des mesures de sûreté destinées à éviter un nouveau passage à l'acte, telles que l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer des victimes. Enfin, le texte vise à simplifier les démarches des victimes tendant à la réparation du préjudice civil, en prévoyant une saisine automatique du juge délégué aux victimes nouvellement créé.
Enfin, évoquant la prise en charge médicale des détenus, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que :
- le refus de se soigner serait désormais assimilé à une mauvaise conduite privant les personnes de remise de peine ;
- l'échange d'informations entre le médecin intervenant en milieu carcéral et le médecin qui suit le détenu à sa sortie de prison serait amélioré ;
- les personnels soignants devraient désormais signaler au chef d'établissement les risques pour la sécurité des personnes dont ils ont connaissance, afin d'éviter que leur responsabilité pénale ne soit engagée du chef de non-assistance à personne en danger.

a souligné l'importance de la réforme présentée par le gouvernement qui touche à des principes juridiques essentiels, avant de regretter qu'elle fasse l'objet d'une déclaration d'urgence et d'estimer qu'un dialogue approfondi entre les deux assemblées aurait été préférable.

a rappelé l'attachement de la commission des lois du Sénat au processus de la navette parlementaire en particulier s'agissant de l'examen des grandes réformes de procédure pénale, l'urgence ne lui apparaissant pas comme la meilleure des procédures. Il a relevé en outre que l'expérience démontre que l'absence de déclaration d'urgence n'implique pas nécessairement qu'un texte ne sera pas examiné avec célérité.

a souligné avoir procédé à nombre d'auditions auxquelles ont assisté de nombreux membres de la commission des lois, qui ont marqué un intérêt prononcé pour les problématiques abordées. Il a observé que, nonobstant les débats soulevés, plusieurs points de consensus en lien avec la notion de dangerosité des personnes détenues s'étaient dégagés, permettant ainsi de mettre en évidence les carences de notre système pénitentiaire et d'esquisser les pistes de réforme du futur projet de loi pénitentiaire.
Il a témoigné avoir pris conscience du très grand nombre de détenus souffrant de maladies mentales graves dans les prisons françaises, certains présentant une réelle dangerosité psychiatrique, facteur de crainte au sein de la population française. Il a souligné la nécessité de mieux distinguer l'abolition de l'altération du discernement, regrettant que dans cette dernière hypothèse -qui joue de facto plus comme une circonstance aggravante que comme une circonstance atténuante- les détenus ne bénéficient pas d'un traitement suffisamment précoce.
Il a ensuite évoqué les carences actuelles de l'évaluation de la dangerosité des personnes condamnées, de leur personnalité et de leurs chances de réinsertion. Le rapporteur a cité l'exemple des Pays-Bas et plus particulièrement du centre Pieter Baan, dont l'approche en termes d'évaluation est beaucoup plus ambitieuse que celle du projet de loi. Il a estimé que le centre socio-médical-judiciaire de sûreté qui doit être mis en place prochainement, à Fresnes, pourrait disposer d'un réel savoir-faire en ce domaine, souhaitant que cet établissement dispose de moyens suffisants pour fonctionner dans de bonnes conditions.
Il a enfin souligné la nécessité que l'évaluation de la dangerosité du condamné intervienne dès le début de l'exécution de la peine. Les soins doivent être prodigués tout au long de la détention, que les détenus soient malades mentaux ou psychopathes, et même si certains psychiatres estiment qu'aucun traitement n'est possible pour cette dernière catégorie de personnes. Tel est d'ailleurs le cas au Canada où les résultats en matière de lutte contre la récidive sont patents.
Selon le rapporteur, le texte ne doit pas faire l'objet d'une analyse manichéenne.
Il n'a pas souhaité formuler d'observation sur la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale introduite par la réforme qui marque un réel progrès au regard du droit en vigueur et sur laquelle la réflexion du ministère de la justice a évolué dans un sens favorable.
A propos de la rétention de sûreté, il a marqué son adhésion quant à l'objectif du dispositif retenu, se déclarant toutefois réservé sur certaines de ses modalités. Il a remarqué qu'à l'occasion de chacun de ses déplacements en prison, le personnel pénitentiaire se déclarait en situation d'identifier, parmi les détenus, des personnes présentant une particulière dangerosité susceptibles, une fois libérées, de porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens.
Il s'est en conséquence interrogé sur les conditions d'évaluation de la dangerosité des détenus, attachant une importance particulière au caractère pluridisciplinaire de cette démarche. L'extension des prérogatives de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par le projet de loi ne lui a pas paru la solution la plus appropriée à cet égard, faisant valoir qu'il s'agit d'un organe administratif qui s'en remet à l'avis de deux experts en psychiatrie -au lieu d'un aux termes du projet de loi initial. Le double regard des experts ne lui a pas semblé garantir le caractère pluridisciplinaire de cette évaluation, laquelle devrait intervenir au terme d'une période d'observation. Il a mis en avant qu'aux Pays-Bas, la pluridisciplinarité est beaucoup mieux assurée.
Il a ensuite jugé nécessaire de clarifier la dénomination de la commission régionale chargée de décider la rétention de sûreté dont les caractéristiques sont celles d'une juridiction plus que d'une commission administrative. Il a fait valoir qu'elle se compose de magistrats, qu'elle statue au terme d'un débat contradictoire durant lequel l'intéressé peut être assisté d'un avocat et que ses décisions sont susceptibles d'appel et d'un pourvoi en cassation. Il a estimé que cette instance doit être qualifiée de juridiction et non de commission, ce qui n'emporte pas de conséquence sur la nature des mesures qu'elle prend.
s'est déclaré particulièrement préoccupé par les problèmes soulevés par l'application immédiate du projet de loi. Il a estimé que pourraient être proposées des alternatives à la solution prévue par l'article 12 du projet de loi, modifié par un amendement du gouvernement et adopté par les députés. Il a indiqué que les magistrats, comme les professeurs de droit entendus, avaient souligné le risque d'inconstitutionnalité du dispositif.
Il a évoqué le risque que la suppression du lien déclaré entre la privation de liberté qu'implique la possible application de la rétention de sûreté et la condamnation prononcée de la cour d'assises pour les personnes qui ont déjà fait l'objet d'un jugement mette notre droit en contrariété avec les exigences issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. Il a relevé que le débat ne réside pas dans la distinction entre une mesure de sûreté et une peine, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme que l'interdiction de la rétroactivité des lois pénales plus sévères dépend davantage de la gravité de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure.
a mis en avant que d'autres dispositifs prévus par le texte, vraisemblablement plus respectueux des principes constitutionnels, permettent d'assurer l'effectivité de la réforme dans des délais rapprochés. Il a en particulier observé que le projet de loi autorise, dès son entrée en vigueur, le placement des criminels condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi sous surveillance judiciaire prolongée, éventuellement assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile et d'une injonction de soins, ajoutant que le manquement à l'une de ces obligations pourra entraîner le placement en rétention de sûreté de l'intéressé dès lors qu'il traduira une forte dangerosité. Il a cité l'exemple d'une personne soumise à l'interdiction de s'approcher d'une école qui manifesterait ainsi une particulière dangerosité si elle enfreignait cette règle au moment des sorties de classe.
Il a indiqué que l'amendement du gouvernement adopté par les députés vise les prédateurs psychopathes particulièrement pervers ayant été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'envisager qu'au-delà de la période de sûreté aucune mesure d'aménagement de leur peine ne soit possible sans un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
a confirmé que les prisons françaises comptaient une forte proportion de détenus affectés de troubles mentaux (20 % de la population carcérale), précisant que les besoins d'accompagnement psychiatrique ne faisaient qu'augmenter. Elle a souligné les efforts accomplis ces dernières années pour remédier à ce constat, évoquant la création programmée de près de 700 places en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), ajoutant que certaines pourraient être plus spécifiquement dédiées à la psychiatrie. Elle a confirmé que certains détenus n'avaient pas leur place en prison. Elle a souscrit au point de vue du rapporteur selon lequel la dangerosité des détenus psychiatriques méritait une évaluation pluridisciplinaire sérieuse. Pour les détenus particulièrement dangereux qui ne sont pas atteints de trouble mental, les soins ne sont pas obligatoires a-t-elle expliqué, citant le cas de Francis Evrard qui avait accepté de se soigner jusqu'à ce qu'il y renonce une fois sa remise de peine obtenue.
La garde des sceaux a souligné que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté créée en décembre 2005 s'appuie sur des professionnels issus d'horizons différents, à savoir des représentants d'associations et de médecins. Elle a en outre mis en avant le caractère très étayé de l'avis de cette instance sur la dangerosité du détenu. A l'instar du rapporteur, elle a estimé que la France pourrait opportunément s'inspirer des modèles hollandais et canadien très efficaces en conditionnant la libération du détenu à l'obligation de soins.
a insisté sur la dimension pluridisciplinaire des commissions chargées de se prononcer sur les mesures de sûreté, chaque intervenant s'efforçant d'inciter les détenus très dangereux à se soigner sans pour autant qu'une obligation de soins ne pèse sur eux.
Elle a jugé que le choix de désigner « commission régionale » l'organe chargé de prononcer la rétention de sûreté se justifiait par le fait que la rétention est une mesure de sûreté.
Elle a estimé que le dispositif permettant de prononcer la rétention de sûreté à l'égard d'une personne dangereuse qui viole une obligation définie dans le cadre de la surveillance judicaire n'est pas suffisant pour lutter contre la récidive des personnes dangereuses jugées avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle a en effet mis en avant qu'une telle mesure ne pourrait être prononcée que sous réserve de respecter le principe de proportionnalité, à savoir que la violation de l'obligation soit particulièrement grave et que le détenu soit particulièrement dangereux. Elle a ainsi plaidé pour le maintien du dispositif du gouvernement adopté par les députés tendant à prévoir l'application de la rétention de sûreté immédiatement après la peine d'emprisonnement pour des individus condamnés pour des faits antérieurs à la loi.

a fait valoir que le projet de loi ouvrait expressément la possibilité d'un placement en rétention de sûreté en cas de manquement à une obligation imposée au condamné après sa libération dans le cadre de la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
lui a répondu qu'un tel manquement ne pourrait conduire à une décision de rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, qu'en cas de tentative de nouvelle infraction ou, tout au moins, à la condition d'être suffisamment grave pour traduire la dangerosité persistante de son auteur. A titre d'exemple, a-t-elle indiqué, on ne pourrait prononcer une mesure de rétention de sûreté à l'encontre d'un individu placé sous surveillance électronique mobile au seul motif qu'ivre, il serait sorti du périmètre qui lui avait été assigné.

Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.
a réaffirmé que le manquement à une obligation de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire ne pouvait à lui seul justifier une mesure de rétention de sûreté, mais devait traduire un regain de dangerosité de son auteur.
Elle a rappelé que l'article 12 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, rendait les nouvelles règles relatives à la rétention de sûreté applicables aux personnes ayant été condamnées avant la publication de la loi à quinze ans au moins d'emprisonnement pour plusieurs crimes.
a précisé que le refus de se soigner d'un détenu tout au long de sa détention serait un élément à prendre en compte, témoignant de la persistance de sa dangerosité. A titre d'exemple, elle a observé qu'au centre de rétention de Melun, sur les 26 détenus jugés dangereux par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, 13 avaient refusé tout soin ou accompagnement. Sur les 106 détenus devant être libérés en 2008 et étant susceptibles de faire l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire, a-t-elle ajouté, entre vingt et trente s'avèrent extrêmement dangereux et devraient pouvoir faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté.

a jugé difficilement concevable que la dangerosité d'un individu puisse justifier qu'une mesure de sûreté soit prononcée à son encontre avant même sa sortie de prison, tandis que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire « prolongée » ne pourrait à elle seule conduire à ce qu'une telle mesure soit également prononcée à son encontre.
a une nouvelle fois souligné que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire ne pouvait à elle seule justifier une décision de placement en rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, et qu'un individu pouvait à l'inverse commettre une nouvelle infraction, par exemple commettre un viol, sans pour autant manquer à ses obligations de surveillance judiciaire.

a estimé qu'en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute mesure privative de liberté devait être ordonnée par une juridiction, qu'il s'agisse d'une peine, d'une mesure de sûreté ou d'une hospitalisation d'office.
a indiqué que la mesure de rétention de sûreté serait prononcée et évaluée chaque année par une commission composée de magistrats dont les décisions pourraient être contestées en appel et en cassation.
Elle a ajouté que les décisions préfectorales ordonnant une hospitalisation d'office pouvaient être contestées devant le juge des libertés et de la détention.

s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les criminels les plus dangereux n'étaient pas condamnés à la réclusion à perpétuité et, lorsqu'une telle condamnation leur était infligée, bénéficiaient par la suite de mesures de réduction de peine ou de libération conditionnelle.
a rappelé, d'une part, que les peines encourues pour certains crimes étaient au maximum de vingt ans d'emprisonnement, d'autre part, que la réclusion à perpétuité ne pouvait être prononcée pour réprimer des délits. Or, a-t-elle précisé, certaines agressions sexuelles ne sont pas des crimes, mais des délits.

a marqué sa préférence pour la version initiale du projet de loi plutôt que pour le texte adopté par l'Assemblée nationale, qu'il a jugé contraire aux conventions internationales auxquelles la France est partie. S'il s'est déclaré favorable à ce que les criminels et les délinquants particulièrement dangereux ne soient pas remis en liberté, il a craint que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme si les dispositions de l'article 12 du projet de loi prévoyant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux auteurs de certaines infractions devaient être adoptées.
Considérant qu'une mesure d'enfermement prononcée à l'encontre d'un individu ayant purgé sa peine constituait, quoi qu'on en dise, une nouvelle peine, il a jugé indispensable qu'elle soit prononcée par une juridiction, sous peine de rendre possible toutes les dérives et tous les abus.
a exposé que la rétention de sûreté ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre d'individus ayant été condamnés pour des infractions d'une particulière gravité.

a appelé l'attention de la ministre et des membres de la commission sur le fait que certains individus pourraient faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté d'une durée plus longue que leur séjour en prison.

Evoquant les dispositions du projet de loi relatives aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, M. Robert Badinter s'est déclaré favorable à la publicité des débats et de l'arrêt de la chambre d'instruction.
En revanche, il a déploré que cette même chambre de l'instruction puisse déclarer « qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés » en même temps qu'elle constaterait son irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Il a en effet fait valoir qu'en cas de pluralité d'auteurs d'une même infraction, cette décision devenue définitive porterait atteinte à la présomption d'innocence des coauteurs de l'infraction, ces derniers pouvant par exemple nier l'existence même de cette dernière, et a rappelé qu'une juridiction d'instruction ne pouvait en principe se prononcer que sur les charges motivant un renvoi devant la juridiction de jugement.
a indiqué que les dispositions proposées s'inspiraient de la procédure applicable au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen.

a fait valoir que la décision de la chambre d'instruction constatant l'existence de charges suffisantes et déclarant l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction était susceptible de devenir définitive, à la différence de la décision ordonnant le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Aussi a-t-il souhaité que la chambre d'instruction ne puisse statuer que sur l'irresponsabilité pénale de l'individu, et non sur les faits qui lui sont reprochés.
a observé qu'il était difficile de demander à la chambre d'instruction de se prononcer sur l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction sans avoir au préalable statué sur l'existence même de cette infraction.

a relevé l'existence de pareils risques de divergences entre la Cour de justice de la République et les juridictions de droit commun appelées à se prononcer sur les mêmes faits.