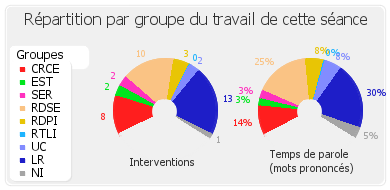Séance en hémicycle du 29 janvier 2015 à 9h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)
- Durée du mandat du président de la république (voir le dossier)
- Débat sur le thème : « la france dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde ? » (voir le dossier)
- Décisions du conseil constitutionnel sur trois questions prioritaires de constitutionnalité
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été invitée à présenter des candidats.
La nomination des sénateurs appelés à siéger au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du groupe du RDSE, de la proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président de la République et à le rendre non renouvelable, présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues (proposition n° 779 [2013-2014], résultat des travaux de la commission n° 93, rapport n° 92).
Je rappelle que nous avions commencé l’examen de ce texte le 18 novembre dernier.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Alain Anziani.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle présentée par notre collègue Jacques Mézard, si elle n’a pas eu les faveurs de la commission des lois, a le grand mérite de provoquer un débat essentiel sur nos institutions.
Quels sont, selon les auteurs de la proposition de loi, les deux défauts majeurs du quinquennat, qui justifieraient le rétablissement du septennat, sous une forme non renouvelable ? La fin du président arbitre et l’affaiblissement de l’action publique.
Ces deux faits, je le reconnais, sont bien réels, mais ils ne me semblent pas liés à la durée du mandat du Président de la République.
La prééminence du Président de la République tient à son élection au suffrage universel direct. La révision constitutionnelle de 1962 a parfaitement atteint son but : faire du chef de l’État la clef de voûte de nos institutions.
Du reste, cette consécration présidentielle instituée par le nouveau mode de scrutin a été parfaitement comprise lors des débats qui ont précédé le référendum de 1962. Gaston Monnerville, président du Sénat, parla à cet égard de « forfaiture ».

D’autres dénoncèrent l’institution d’un régime personnel, à la Salazar, d’autres encore parlèrent de plébiscite…
De son côté, le général de Gaulle considérait que « la nation [devait] avoir, désormais, le moyen de choisir elle-même son Président, à qui cette investiture directe [pourrait] donner la force et l’obligation d’être le guide de la France et le garant de l’État ».
Même si la Constitution de 1958 reconnaît le rôle des partis politiques, elle porte la marque d’une méfiance à leur égard, puisqu’elle place au-dessus d’eux un représentant des Français. L’article 5 de la Constitution consacre le rôle d’arbitre du Président de la République : « Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »
Pour comprendre ces débats de 1962, il faut se souvenir que, en 1958, la France avait connu dix-huit gouvernements en douze ans…
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas seulement ce changement institutionnel qui a bousculé la vie politique française et a conduit à sa personnalisation extrême, pour ne pas dire excessive. Depuis 1965, les Français élisent directement leur président, mais ils le font sous l’œil de la télévision, qui leur montre les visages et les attitudes des candidats. Conjuguée au facteur télévisuel, l’élection au suffrage universel direct a institué un lien direct, personnel, humain entre l’électeur et le candidat. Le même phénomène s’est d’ailleurs produit lors de l’élection présidentielle américaine de 1960, qui a vu John Fitzgerald Kennedy l’emporter sur Richard Nixon.
Si, dans un premier temps, ce lien a sacralisé davantage la fonction présidentielle, il a, dans un second temps – le nôtre –, contribué à sa dégradation. En effet, le Président de la République, hier monarque républicain à l’abri des regards, est devenu un homme comme un autre, dont chacun peut commenter les qualités et les défauts.
Or j’estime, contrairement aux auteurs de la proposition de loi constitutionnelle, que cette personnalisation du pouvoir n’a que peu de rapport avec la durée du mandat. Ainsi, Angela Merkel, en Allemagne, est élue pour quatre ans, et David Cameron, au Royaume-Uni, l’est pour cinq : il serait pourtant difficile de prétendre que l’un ou l’autre souffre d’un manque de visibilité.
Le raccourcissement à cinq ans de la durée du mandat présidentiel a-t-il été influencé par l’air du temps, comme certains orateurs l’ont affirmé au mois de novembre dernier ? Oui, l’air du temps a pesé, comme M. le rapporteur l’a souligné au début de la discussion générale. J’oserai demander : et alors ? Ce que nous appelons l’air du temps consiste à soumettre chacun à l’opinion et au débat. En somme, je dirai, au risque de paraître un peu péremptoire, que l’air du temps est un air démocratique.
Les mandats de longue durée ont été abandonnés dans la plupart des démocraties. Certes, nous pouvons admirer, et même partager, les réflexions de Michel Debré, qui soutenait en 1945 l’idée d’un mandat d’une durée supérieure à sept ans, ou celles du général de Gaulle, qui expliquait en 1964 qu’il aurait préféré un mandat plus long, mais ces réflexions, aussi pertinentes qu’elles aient été à l’époque, sont-elles encore d’actualité ?
En vérité, elles datent d’une période qui ne connaissait pas la cohabitation entre deux pouvoirs aussi légitimes l’un que l’autre, d’un monde où l’information circulait plus lentement qu’aujourd’hui, voire ne circulait pas du tout, d’un univers institutionnel dont la démocratie participative était absente et dans lequel les sondages, plus rares qu’aujourd’hui, mettaient moins souvent à mal la légitimité des gouvernants.
La vérification de la légitimité est un souci constant. Celui-ci, comme le rapporteur l’a fait observer, a conduit le général de Gaulle à en appeler au peuple par la voie du référendum par trois fois, en 1961, en 1962 et en 1969. Dans le dernier cas, le chef de l’État a tiré les conséquences du résultat en abrégeant son septennat. Le même souci de la légitimité a provoqué des tensions à la veille de chacun des scrutins législatifs, qui ont débouché, il est vrai, sur trois cohabitations.
Que les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle me permettent une observation : je crois qu’il y a une grande part d’idéal dans la croyance que le Président de la République, élu pour sept ans, se consacrerait sereinement à son action en oubliant les élections législatives ou locales intermédiaires. Il me paraît évident que, le septennat rétabli, le chef de l’État aurait les yeux fixés sur les scrutins du dimanche et ne pourrait ignorer le verdict des urnes, d’autant que les élections législatives seraient susceptibles de lui imposer une cohabitation. La longue durée d’un septennat n’exclut donc pas que l’action du chef de l’État soit influencée par des échéances plus rapprochées ; elle ne rendrait pas nos gouvernants plus vertueux.
Poussons la réflexion plus loin. Le jugement des Français est quotidien, et ne passe plus seulement par les élections. Cela n’est sans doute pas nouveau, mais ce jugement est désormais public, ce qui l’est davantage. Comment pourrions-nous ignorer la société dans laquelle nous vivons, sa rapidité, sa réactivité et même sa versatilité, qui est une nouvelle règle du jeu ?
Je comprends parfaitement l’argument selon lequel le temps de l’action publique n’est pas le même que celui de l’élection. De fait, aujourd’hui, le titulaire d’une fonction doit répondre de sa politique avant même qu’elle n’ait porté ses fruits. Seulement, cette règle est désormais générale : elle concerne le maire, élu pour six ans alors que les projets municipaux demandent davantage de temps, les acteurs économiques, tenus de rendre immédiatement des comptes à leurs actionnaires et à leurs salariés, et les nations elles-mêmes, qui, face à une crise, ne peuvent attendre aucun répit. Partout, le temps s’est accéléré. Il était donc normal que la démocratie adopte un rythme qui la rende plus réactive.
On ne construit pas une règle constitutionnelle contre le peuple, lequel a changé depuis l’époque du septennat : il veut davantage, plus rapidement et dans une plus grande transparence. Dans ces conditions, je vois mal comment nous pourrions lui expliquer que le Président de la République rendra désormais compte de son mandat non pas dans cinq ans, mais dans sept.
En dépit des propos que j’ai tenus, je partage largement les inquiétudes des auteurs de la proposition de loi constitutionnelle au sujet de la présidentialisation du régime au détriment du Parlement. Cependant, je considère, avec d’autres, que la cause principale de ce phénomène tient à l’incohérence de notre dispositif constitutionnel.
En effet, nous continuons à vivre dans la fiction d’un Président de la République arbitre, au-dessus des partis, tout en sachant très bien qu’aucun président n’a été élu sans le soutien d’un parti majoritaire et qu’un candidat n’a aucune chance d’accéder à la responsabilité suprême s’il ne s’appuie sur un parti fort. Au demeurant, les Français ne se déplacent pas en masse pour élire un arbitre, mais pour désigner un responsable politique auquel ils demanderont directement des comptes.
À la vérité, nous ne sommes pas allés au bout de la logique de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui conduit à la suppression de la fonction de Premier ministre. Nous avons préféré maintenir à la tête de l’État une dyarchie qui est source de discorde, non seulement en cas de cohabitation – songeons à ce spectacle étrange que nous donnons, sur la scène internationale, d’une double incarnation de l’État –, mais aussi en dehors des périodes de cohabitation, comme on a pu le voir avec les binômes composés de Georges Pompidou et de Jacques Chaban-Delmas, de Valéry Giscard d’Estaing et de Jacques Chirac ou de François Mitterrand et de Michel Rocard.
Aller au bout de cette logique suppose de supprimer le droit, pour le Président de la République, de dissoudre le Parlement et la possibilité, pour l’Assemblée nationale, d’adopter une motion de censure, afin d’instaurer une vraie séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.
J’ajouterai, mes chers collègues, que la balle se trouve aussi dans notre camp. Si nous voulons un vrai régime parlementaire, il convient sans doute de revoir, outre la place du Président de la République, le rôle du Parlement. Nous devons privilégier l’élaboration de la loi et l’examen des grandes questions – comme celle que nous abordons ce matin –, nos débats se réduisant pour l’heure trop souvent à une longue suite de monologues à usage personnel et local… Mais c'est là un autre sujet, qui fait aujourd'hui, au sein de notre assemblée, l’objet de travaux dont j’espère qu’ils aboutiront. §

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise de notre système politique et de la démocratie en France s’aggrave de semaine en semaine, sinon de jour en jour.
La Constitution de la Ve République, que le parti communiste français fut la seule organisation à combattre dès l’origine, portait en son sein le germe des dérives auxquelles nous assistons aujourd’hui.
Sur le plan purement constitutionnel, ces dérives sont la personnalisation du pouvoir, la crise de la représentation, la déconnexion entre les citoyens et les lieux de décision.
Bien entendu, cette crise profonde de nos institutions est intimement liée à une situation économique et sociale qui jette par milliers nos compatriotes dans la souffrance sociale, la crainte de l’avenir et, trop souvent, le désespoir.
Cette crise de la politique tient en premier lieu à l’incapacité des dirigeants successifs à répondre aux attentes populaires en matière d’emploi et de qualité de vie. Comment ne pas percevoir que le système, en difficulté, se recroqueville, se protège et rabaisse les exigences démocratiques pour contrer la contestation montante de sa légitimité ?
Les citoyennes et les citoyens veulent plus de pouvoir. Ils veulent reprendre le pouvoir. Ils ne supportent plus les promesses non tenues, les mandats non respectés. La crise du système provient d’une perte de citoyenneté progressive, dans la ville face aux grands choix politiques, mais aussi dans l’entreprise, où la précarité, la flexibilité et la pression du chômage ont fait leur œuvre : les salariés sont désorganisés, le syndicalisme est en panne, la force collective s’est fragmentée.
M. Mézard et les auteurs de la proposition de loi évoquent dans leur texte le « désenchantement des citoyens français vis-à-vis de leurs institutions ». Nous partageons ce constat, mais il fallait, selon moi, rappeler que cette crise provient de la précarité vécue par une part très importante de la population et de la volonté de ceux qui profitent du système de construire des barrières, pour que surtout rien ne change.
La fonction présidentielle et le statut du Président de la République font aujourd’hui débat. Nous fûmes longtemps seuls, au parti communiste français, à nous interroger sur la dérive présidentielle de la Ve République et sur la personnalisation de la vie politique qu’elle induisait. Il aura fallu l’agitation et l’hyperprésidentialisation des années durant lesquelles Nicolas Sarkozy fut au pouvoir pour que cette interrogation se diffuse plus largement dans la société.
L’abandon de ses promesses de campagne par François Hollande amène un grand nombre d’observateurs et de citoyens à s’interroger sur cette fonction qui autorise un homme disposant de pouvoirs considérables à décider, seul, du sort de notre pays, et donc de ses habitants.
Ce renforcement de la fonction présidentielle – c’est l’objet de la proposition de loi dont nous discutons – est la conséquence directe de la réduction de la durée du mandat à cinq ans et de l’inversion du calendrier électoral qui l’a logiquement suivie.
En effet, la durée du mandat présidentiel ayant été alignée sur celle du mandat des députés, il apparaissait logique de soumettre les élections législatives à l’élection présidentielle.
Les partisans de la Ve République ont tiré les leçons des périodes de cohabitation – qui, finalement, redonnaient une place importante au Parlement –, en organisant la soumission pleine et entière de la majorité de l’Assemblée nationale à celui qui l’a menée à la victoire, le Président de la République.
L’élection présidentielle est désastreuse pour notre démocratie. Elle tue le pluralisme en favorisant le bipartisme, elle met en place une médiatisation exacerbée de la vie politique. La conquête du pouvoir devient un objet de communication absolue. C’est l’heure du storytelling : on construit de belles histoires qui s’évanouissent dès l’élection passée. Après « la France qui se lève tôt » et le « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, c’est aujourd’hui l’oubli du « changement, c’est maintenant », de « mon ennemie, c’est la finance », de « moi président, je ne ferai rien comme avant », tout continuant comme avant !

Avec mon groupe, avec mon parti, avec le Front de gauche, je pose la question des pouvoirs du Président de la République, celle de son mode d’élection, et même celle de la nécessité de la fonction.
Nous pensons qu’il faut rompre sans hésitation avec la dérive médiatico-politique à laquelle nous assistons. Supprimer l’élection du Président de la République au suffrage universel est indispensable en vue d’une reprise en main démocratique du pouvoir. Restreindre les pouvoirs du Président de la République en est le corollaire nécessaire. Il faut en finir avec le droit de dissolution de l’Assemblée nationale, avec la nomination du Premier ministre, avec la présence du Président de la République au conseil des ministres, ainsi qu’avec ce pouvoir quasiment monarchique qui lui est dévolu en matière de conduite des conflits internationaux.
Finalement, dans le cadre d’une démocratie repensée, un Président de la République est-il nécessaire ? Ne faut-il pas en finir avec ce reliquat de tradition bonapartiste de concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul homme ?
La proposition de loi de M. Mézard a le mérite de soulever le problème. On ne peut pas continuer ainsi, avec la domination sur nos institutions d’un véritable monarque républicain pour un mandat de cinq ans !
Nous estimons cependant qu’il faut aller plus loin dans la remise en cause du fait présidentiel. Plus généralement, nous pensons qu’une telle remise en cause doit constituer l’un des symboles de l’instauration d’une VIe République démocratique et sociale. Les retouches successives apportées à la Constitution – vingt-quatre depuis 1958 – ne peuvent combler le fossé qui s’est creusé entre le peuple et les institutions. Une assemblée constituante devrait être convoquée pour poser la question démocratique en France.
Citoyenneté dans le pays, citoyenneté dans la ville, citoyenneté dans l’entreprise, prise sur les choix européens : ces sujets doivent se trouver au centre d’une réflexion à conduire d’urgence, avant que la colère, l’exaspération populaire ne mènent à des choix dangereux. L’instauration de la VIe République n’est pas une rengaine ou un mythe ; c’est une nécessité historique.
Bien que ce texte apporte selon nous une réponse trop limitée à l’exigence de changement démocratique qui monte dans notre pays, le groupe communiste républicain et citoyen votera en faveur de son adoption. §

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, après avoir débattu du statut pénal du Président de la République il y a quelques mois, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi de M. Jacques Mézard visant à rétablir à sept ans la durée du mandat présidentiel et à rendre celui-ci non renouvelable. Le Président de la République semble très en vogue ces derniers temps, au moins au sein de notre assemblée…
On l’a dit, si le quinquennat fut longtemps un « marronnier » de la vie politique française, il aura fallu attendre la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 pour qu’il soit instauré, dans un contexte d’ailleurs particulier, puisque le référendum a été marqué par une très forte abstention.
Parallèlement, une loi électorale fut adoptée afin que les élections législatives interviennent deux mois après l’élection du Président de la République et que ce dernier ait donc toutes les chances de pouvoir s’appuyer sur une Assemblée nationale majoritairement de son bord politique pour réaliser son programme.
Toutefois, depuis près de quinze ans, nombreuses ont été les voix à remettre en cause cette réforme, à droite comme à gauche. C’est dans ce mouvement de contestation que s’inscrit le dépôt de la présente proposition de loi.
Les auteurs de ce texte, estimant que l’instauration du quinquennat a eu pour conséquences de mettre fin au statut particulier d’arbitre institutionnel du Président de la République et de dégrader la qualité du débat politique, proposent de rétablir à sept ans la durée du mandat présidentiel et d’interdire l’exercice de deux mandats successifs.
Vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, si je vous dis que les écologistes sont contre tout cumul des mandats, que ce soit – si j’ose dire – dans le temps ou dans l’espace.
Nous avons toujours soutenu l’idée que seule la limitation des mandats dans le temps est susceptible de favoriser une véritable rotation dans l’exercice des responsabilités, et nous souhaitons que les parlementaires et les membres des exécutifs locaux ne puissent pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
Quant à la durée du mandat présidentiel, elle ne nous semble pas être la principale cause du dysfonctionnement de nos institutions. En effet, c’est la tenue des élections législatives en aval de l’élection présidentielle qui aboutit à ce que la campagne électorale soit quasiment permanente et à ce que le président candidat succède bien souvent au candidat à la présidence…
Il nous semble toutefois que la réflexion induite par l’examen de ce texte devrait être beaucoup plus large, et nous amener à prendre position sur le modèle de démocratie que nous souhaitons.
Les écologistes l’affirment depuis longtemps, face aux crises politiques et institutionnelles, il faut refonder profondément nos institutions, à tous les niveaux, pour affronter démocratiquement les temps qui viennent et bâtir ensemble une nouvelle société.
Il faut inventer une VIe République, qui n’aurait pas pour seule vocation de « réparer » la Ve, régime de concentration et de confusion des pouvoirs favorisant l’irresponsabilité et l’immunité des dirigeants, mettant les citoyens à distance de leurs représentants.
Dans la nouvelle République que nous imaginons, la proportionnelle serait généralisée à tous les scrutins afin de tenir compte le mieux possible du poids politique réel des différentes forces et d’assurer une parité effective parmi les élus. Nous prévoyons une refonte du rôle du Président de la République, qui serait garant du bien commun et, en particulier, de la prise en compte par le Gouvernement et le Parlement des exigences du long terme, ainsi qu’une inversion du calendrier électoral, pour que les élections législatives soient indépendantes de l’élection présidentielle et aboutissent à l’élection du Premier ministre – leader du parti ou de la coalition gagnant – par l’Assemblée nationale.
Si, finalement, le groupe écologiste votera contre ce texte
Exclamations sur les travées du RDSE.

… ce n’est pas parce qu’il contient des mesures particulièrement problématiques, mais parce que nous sommes convaincus que c’est le modèle de nos institutions qu’il faut réinventer dans son ensemble. C'est à la construction de la VIe République qu’il faut s’atteler maintenant.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les événements tragiques de ce début d’année ont ouvert une parenthèse d’unité nationale qui devrait trouver un prolongement dans le débat sur la réforme et la modernisation de nos institutions, ou plus exactement sur l’équilibre des pouvoirs, qu’il devient urgent de revoir.
On en conviendra, il existe sinon une unité, du moins un consensus, au sein des forces politiques et citoyennes de notre pays, pour reconnaître qu’il est urgent de changer et de réformer notre système institutionnel.
Plutôt que d’entamer une grande et profonde révision de la Constitution en revoyant la plupart de ses articles, comme le souhaite Mme Benbassa, pourquoi ne pas réajuster sensiblement l’équilibre et le fonctionnement des institutions de la Ve République, en ne modifiant qu’à la marge, par quelques petites touches bien ciblées, notre texte fondamental ? C’est le choix que nous avons fait en proposant d’allonger de deux ans le mandat du Président de la République, d’une part, et de le rendre non renouvelable, d’autre part.
Nous sommes convaincus que l’entrée en vigueur de ces deux seules mesures serait de nature à changer considérablement le fonctionnement de nos institutions et la pratique même du pouvoir, que celui-ci soit exécutif ou législatif.
Aujourd’hui, à mi-chemin du quinquennat présidentiel, que constate-t-on ? L’échéance de 2017 et les stratégies électorales prennent le pas sur le débat de fond et la recherche de l’intérêt général. Le temps de l’action politique est de plus en plus réduit sous la pression du temps médiatique. Ne serait-ce pas une fausse modernité que de croire que tout doit aller vite à l’ère de la mondialisation, alors que les réformes structurelles imposent un temps long ?
Polarisé sur sa propre réélection, un président élu pour cinq ans doit remplir rapidement ses promesses, quitte à spéculer avec imprudence sur l’avenir. À peine élu, on veut inverser ou accélérer des courbes. Comme le disait très justement Flaubert, « l’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent nous échappe.»
Dans ces conditions, un septennat non renouvelable permet finalement d’agir dans la durée et de ne pas être prisonnier de sa propre réélection. La focalisation permanente du titulaire, comme de son gouvernement, sur une probable nouvelle candidature s’efface, donnant plus de force à une vertu cardinale en politique, le courage de l’action. Le courage, cela signifie prendre des décisions impopulaires lorsqu’elles sont nécessaires au pays, à l’intérêt général et aux Français. D’une certaine façon, cela éviterait un quinquennat pour rien, quand ce n’est pas deux si le sortant n’est pas réélu, d’autant que les électeurs sont de plus en plus tentés par l’alternance systématique à l’issue de chaque quinquennat.
Comme l’a dit excellemment Jacques Mézard lors de son intervention à cette tribune pour présenter notre proposition de loi, le quinquennat nuit à la qualité du débat public lorsqu’il conduit le titulaire de la fonction présidentielle à se placer dans la position de candidat à sa propre succession.
Certes, on nous opposera, madame la secrétaire d’État, que, dans la plupart des régimes parlementaires, la durée des mandats n’excède pas cinq ans. Mais la comparaison a ses limites, lorsqu’elle n’est pas faite à l’aune d’un ensemble institutionnel. Le champ comparatif se rétrécit notamment si l’on se réfère au mode d’élection. Seuls quatre pays en Europe élisent leur président au suffrage universel direct. Je prendrai l’exemple de la Finlande, qui a fait le choix de l’élection du président au suffrage universel direct en 1994. Mais le mandat de ce dernier est de six ans et, surtout, la réforme s’est accompagnée d’un fort rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement.
Il s’agit en effet aussi de la question des rapports entre l’exécutif et le législatif, mes chers collègues ! Disons-le, le quinquennat a plutôt consacré l’affaiblissement du Parlement. En calant la durée du mandat présidentiel sur celle de la législature de l’Assemblée nationale, la réforme de 2000 a dénaturé la fonction arbitrale du Président de la République, pourtant affirmée avec force, je le rappelle, à l’article 5 de la Constitution.
Théoriquement responsable de tous les Français, le Président est devenu, de fait, le chef d’une majorité parlementaire, puisque celle-ci est élue dans le sillage de sa propre élection.
Le Président est ainsi lié à une majorité partisane et ne peut plus exercer, comme il le devrait, sa neutralité politique, en se plaçant « au-dessus des partis politiques », alors même que cela peut se révéler indispensable. Il gouverne plus qu’il ne préside. Dans ce cadre, on peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité du Premier ministre.
Aussi l’Assemblée nationale ressemble-t-elle de plus en plus à une « chambre d’enregistrement » des promesses présidentielles suivies, ici et là, de quelques aménagements, quand « les frondeurs » aboient un peu trop fort et que la majorité se rétrécit.
Au mois de novembre dernier, vous nous avez dit en substance, monsieur le rapporteur, que les radicaux avaient la nostalgie du régime parlementaire. Quel mal à cela ? C’est tout notre pays qui est nostalgique, exprimant seulement le souhait d’un véritable équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, comme c’est le cas dans nombre de démocraties. Oui, nous voulons – et nous le revendiquons haut et fort – un président arbitre et un parlement plus indépendant.
Permettez-moi de croire, mes chers collègues, qu’on peut conforter nos institutions sans revenir à la dérive parlementariste de la IVe République et sans en rester à la dérive présidentialiste de la Ve République.
Enfin, il est indiqué à la page 5 du rapport de M. Hugues Portelli – les conclusions de la commission des lois – que la proposition de loi constitutionnelle examinée ce matin ferait réapparaître la cohabitation. Mais celle-ci n’était pas une si mauvaise chose ! D’ailleurs, l’Histoire commence à lui rendre les honneurs qu’elle mérite. Qui plus est, elle est toujours préférable à une cohabitation larvée qui ne dit pas son nom, mais cause bien des dégâts. De surcroît, il n’est point besoin de démontrer que le quinquennat n’a en rien écarté l’éventualité d’une cohabitation, puisque le Président peut toujours dissoudre l’Assemblée nationale, démissionner ou même décéder. Peut-être faut-il en effet rappeler que le titulaire de cette fonction est, lui aussi, mortel !

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme l’a fait la commission des lois au cours de l’examen de la présente proposition de loi, je souhaite remercier ses auteurs, M. Jacques Mézard et plusieurs membres du groupe du RDSE, de permettre au Sénat d’ouvrir le débat sur la présidentialisation et la personnalisation du pouvoir politique sous la Ve République.
Ce texte prévoit en effet que le Président de la République est élu, comme c’était le cas par le passé, pour sept ans au suffrage universel direct et que nul ne peut exercer deux mandats consécutifs.
D’un rôle de représentation et d’influence sous la IVe République, la fonction présidentielle a vu ses pouvoirs considérablement renforcés, conformément à la pensée constitutionnelle du général de Gaulle, énoncée dès 1946 dans le discours de Bayeux.
En effet, la Constitution de 1958, révisée en 1962, marque une rupture dans l’histoire des institutions françaises. « Chef de l’État », le Président de la République retrouve le droit de grâce ; il est « garant de l’indépendance nationale ».
Sans revenir sur chacune des grandes dates qui ont pu marquer l’évolution de la fonction présidentielle depuis 1958, je tiens à rappeler que le passage au quinquennat, adopté en 2000, a été envisagé dans la poursuite de l’objectif engagé par la Constitution de 1958, à savoir le renforcement du rôle du Président, en s’inscrivant dans un contexte politique et médiatique accéléré : le chef de l’État devient chef de la majorité parlementaire, en effaçant en grande partie la fonction de Premier ministre, sauf en période de cohabitation.
C’est pourquoi le rapporteur, M. Hugues Portelli, en a conclu que, compte tenu du système politique français, cette proposition de loi, si elle était adoptée, aurait pour effet d’affaiblir la fonction présidentielle en la déconnectant du rythme désormais accéléré du temps politique.
L’adoption de ce texte créerait les effets négatifs suivants : réapparition de la cohabitation et suppression de toute responsabilité politique en fin de mandat présidentiel.
Précisons tout de même que ce dernier point, à savoir le choix de recourir à un mandat non renouvelable, n’a jamais été justifié dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi constitutionnelle.
Le groupe UMP est favorable au maintien du quinquennat dans son contour actuel, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, à l’occasion de l’examen du texte devenu loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, plusieurs orateurs ont démontré que le passage au quinquennat devait permettre de rééquilibrer les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
À cette occasion, le sénateur Jacques Larché, alors rapporteur de la commission des lois du Sénat, avait précisé que les institutions de la Ve République n’avaient pas été conçues pour un Président de la République élu au suffrage universel direct, tant et si bien que le passage à ce mode de suffrage, sans modification de ses pouvoirs et responsabilités constitutionnelles, avait créé une très forte asymétrie entre le Président de la République et le Parlement, mais également entre le Président et le Premier ministre. Il précisait ainsi : « Les liens entre le Parlement et le Président sont asymétriques : le Président peut dissoudre, mais la motion de censure s’exerce à l’égard du Gouvernement ; le Président ne peut venir s’exprimer en personne devant les assemblées et celles-ci ne peuvent le mettre en cause que devant la Haute Cour de justice. » Il ajoutait : « En dehors de l’élection, le Président n’est donc soumis à un contrôle que de sa propre initiative. »
Le passage au quinquennat visait donc à rationaliser les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Ensuite, il est à noter qu’un septennat conduit à un très fort risque de cohabitation, notamment dans les deux dernières années, compte tenu du décalage de deux ans entre la durée du mandat présidentiel et celle du mandat législatif. Un rééquilibrage s’imposait.
C’est dans ce contexte que la garde des sceaux de l’époque, Mme Élisabeth Guigou, a affirmé : « La cohabitation, si elle reparaît, ne le fera que de manière brève et exceptionnelle. Sa disparition, j’y insiste, n’est pas l’objet de la réforme. Sa raréfaction en sera un effet secondaire mais bienvenu ».
Le quinquennat est selon moi une adaptation nécessaire à l’accélération de l’histoire que nous vivons depuis quelques décennies, avec la multiplication des médias, l’avènement de nouveaux moyens de communication, la mondialisation, et j’en passe. Nos institutions, plus que jamais, doivent être en cohérence avec la société, ses progrès et ses attentes.

Le quinquennat, en donnant la parole à la souveraineté populaire tous les cinq ans – et non plus tous les sept ans –, permet de mieux prendre en compte cette ère nouvelle de diffusion immédiate de l’information. Finalement, il redonne au peuple un peu de sa souveraineté, en lui permettant de faire des choix démocratiques plus réguliers.
Néanmoins, il est important de noter que le passage du septennat au quinquennat en 2000 s’est accompagné d’une profonde réforme institutionnelle touchant au fonctionnement du Parlement, qui s’est vu notamment doté d’une capacité de contrôle accrue du pouvoir exécutif et d’une plus grande autonomie. C’est l’apport décisif de la révision constitutionnelle de 2008.
En effet, loin d’être isolée, la mesure prévoyant le passage au quinquennat s’est inscrite dans une vision plus large de la révision, que dis-je, de l’adaptation de nos institutions à la France d’aujourd’hui.
Il serait donc illogique d’imaginer un retour au septennat, accompagné de surcroît d’une mesure prévoyant que nul ne peut exercer deux mandats consécutifs.
Ne cédons pas, mes chers collègues, aux sirènes d’une nostalgie aussi illusoire qu’anachronique, qui, dans la société française actuelle, ne peut à mon avis tenir ses promesses.
En conclusion, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe UMP du Sénat votera, vous l’aurez compris, contre cette proposition de loi constitutionnelle.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi initiale.
L’article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.
« Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le mot : « procédé », la fin du dernier alinéa de l'article 12 de la Constitution est ainsi rédigée : « qu’à une dissolution par mandat présidentiel. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Je souhaite, avant de défendre cet amendement, donner ma position sur ce débat et rendre hommage au groupe du RDSE, dont la proposition de loi nous permet de réfléchir à l’évolution de nos institutions, même si ce texte, compte tenu de son origine parlementaire, pourrait ne pas prospérer.
D’abord, plusieurs pays de l’Union européenne élisent leur président de la République au suffrage universel, tout en restant des régimes parlementaires, puisque les majorités se font au sein du Parlement. Tel n’est pas toujours le cas en France, le quinquennat et l’inversion du calendrier ayant profondément transformé la vie politique.
Les élections législatives sont en quelque sorte un troisième tour de l’élection présidentielle, le mandat des députés commençant et prenant fin en même temps que celui du Président de la République, à un mois près.
Cela a profondément changé la vie politique. Les partis, le parti socialiste dans un premier temps, l’UMP maintenant, se sont mis à organiser des primaires pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle. Finalement, le débat porte non plus sur les options et les propositions politiques, mais sur le choix du meilleur candidat, sur celui qui semble avoir la plus grande capacité de rassemblement.
C’est peut-être bien pour l’élection présidentielle, mais cela ne l’est pas pour débattre des options politiques nécessaires au pays. In fine, le peuple se retrouve sans choix réel, les propositions des partis demeurant assez floues.
Voulons-nous confirmer cette orientation qui liquide l’efficacité du débat politique en France et qui, force est de le constater, s’inscrit en contradiction avec la nécessaire séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif – en tout cas, celui des députés – procédant totalement de l’élection du Président de la République ?
Certains disent que le monde moderne est un monde rapide. C’est vrai, et c’est l’argument qui avait été avancé pour justifier le passage du septennat au quinquennat. Toutefois, l’action politique qui change la vie mérite encore un engagement sur la durée. Céder à l’immédiateté, c’est faire croire qu’il est possible de mener une action, de changer les choses grâce à Twitter plutôt que par le rassemblement des hommes et des femmes et par l’action.
On ne peut certainement pas valider cette orientation, de même qu’il n’est pas souhaitable que l’engagement citoyen soit simplement un engagement immédiat qui ne s’inscrit pas dans la durée.
Si le monde moderne est rapide, il est également complexe. Comment pouvons-nous imaginer que l’acte citoyen majeur dans notre République serait de confier une fois tous les cinq ans les clés d’un pays à un seul homme et d’évaluer ce dernier au terme de ce quinquennat ? Est-ce l’engagement citoyen que nous attendons des Français ?
Vingt-sept des vingt-huit pays membres de l’Union européenne sont des régimes parlementaires. Seul chef d’État au Conseil européen, le Président français, finalement, exprime des positions sans disposer derrière lui de la force d’une majorité parlementaire l’obligeant à défendre les intérêts de notre pays.
Ce décalage nous empêche aussi de peser résolument sur les évolutions nécessaires de la gouvernance de l’Union européenne, laquelle devrait être plus fédérale. Notre régime présidentiel l’en empêche, nos institutions ne permettant pas à notre pays de prendre toute sa place en Europe, de peser sur son évolution et de mieux défendre nos intérêts.
Par cet amendement, je veux souligner à quel point il est essentiel que le Président de la République ne soit pas le chef d’une majorité, mais ait un rôle d’arbitre. C’est pourquoi nous proposons qu’il ne lui soit possible de procéder à une dissolution qu’une seule fois au cours de son mandat, en cas de crise.

Il eût sans doute été possible de formuler une proposition différente, mais celle-ci nous a paru la meilleure : si le Président veut se garder la possibilité de dissoudre pour le cas échéant trancher une situation de crise, il ne prononcera pas la dissolution de l’Assemblée nationale dans la foulée de l’élection présidentielle.
En conclusion, je veux dire que les événements des 7 et 9 janvier ont, pour certains, montré la force de nos institutions. À mon sens, ils ont d’abord montré la force de notre peuple et son attachement à la République. Si, finalement, le pouvoir exécutif se trouve aujourd’hui renforcé, c’est parce que, pour la première fois depuis bien longtemps, le Président de la République et le Premier ministre ont exercé chacun un rôle différent : l’un comme chef de l’État arbitre et l’autre comme chef de la majorité.
Nous aurions intérêt à fixer mieux ces règles dans nos institutions.

La commission émet un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
Depuis la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 et le passage au quinquennat, l’arme de la dissolution n’a plus été utilisée ; elle ne l’a été qu’au cours des périodes de septennat.

Je me place un instant du point de vue des auteurs de la proposition de loi.
La dissolution, c’est une arme dont dispose le Président de la République en tant qu’arbitre.

C’est ainsi que tout le monde l’a entendu lors des travaux préparatoires de la Constitution de 1958. Le président-arbitre peut être amené à dissoudre en cas de crise parlementaire lorsqu’il ne dispose plus de majorité ou en cas de crise sociale, comme ce fut le cas en 1968.
François Mitterrand y a eu recours à deux reprises, tandis que le général de Gaulle a dissous au lendemain du renversement du gouvernement Pompidou en 1962, ainsi qu’en 1968.
Le Président de la République, en tant que président-arbitre, dispose donc d’un vrai usage du droit de dissolution. Dans le cadre d’un septennat – mandat long –, il n’est pas envisageable que celui-ci puisse être limité dans la mesure où l’on ignore quelles circonstances pourraient survenir.
M. Anziani l’a dit tout à l’heure, la suppression du droit de dissolution serait envisageable dans le cadre d’un quinquennat, les députés étant élus quasiment dans la foulée du Président de la République. En revanche, dans l’hypothèse d’un retour au septennat, cela n’a pas beaucoup de sens.
Pour des raisons qu’a très bien expliquées M. le rapporteur, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Tout d’abord, je remercie Mme la secrétaire d’État de sa présence parmi nous ce matin, présence que je considère comme un geste d’amitié personnelle envers notre groupe. Ces propos liminaires me permettront de taire les réflexions que m’inspire l’absence d’autres ministres compétents en la matière. Cela étant, nous avons désormais l’habitude d’un tel comportement de l’exécutif à l’égard du Sénat…

Voilà, c’est dit !
En dépit des explications de notre excellent rapporteur, qui reste figé sur une position de principe que nous connaissons, nous voterons cet amendement, dont l’adoption tendrait à donner un coup d’arrêt à une certaine hyperprésidence.
Quels sont les termes du débat ? Il est trop facile de prétendre que nous voudrions en revenir à des périodes anciennes : Éliane Assassi, présidente du groupe CRC, a très bien expliqué notre objectif. Rappelons-nous que, pendant plusieurs années, l’ancien président du Sénat, Gaston Monnerville, a annoncé très clairement tout ce qui est en train de se réaliser aujourd’hui, la situation de plus en plus dramatique à laquelle notre pays est confronté.
Aujourd’hui, cela vient d’être rappelé, le régime français est une exception en Europe. Nous sommes le seul pays européen à être en réalité une monarchie républicaine, le pouvoir étant quasi intégralement détenu par un homme, le Président de la République, lequel est entouré d’une haute fonction publique extrêmement élitiste que l’on retrouve partout, y compris sur les bancs du Parlement. Voilà la réalité de ce pays !
Le Parlement, je le dis comme je le pense, est écrasé. La révision constitutionnelle, paraît-il, aurait accru ses pouvoirs ; or nous sommes presque unanimes à considérer qu’il faudrait réduire ou supprimer les semaines de contrôle. Pourquoi ? Parce que les gouvernements, quels qu’ils soient, quelle que soit la majorité en place, ont peu de considération pour les votes du Parlement. De fait, il n’est pas anormal que les deux partis dominants veuillent peu ou prou préserver un système grâce auquel, tous les cinq ans – c’est mieux que tous les sept ans ! –, ils disposent à tour de rôle de tout le pouvoir ! À l’évidence, ils nous en font la démonstration depuis pratiquement vingt-cinq ans. Voilà ce qui a conduit notre régime et notre pays dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Aussi extraordinaire que cela paraisse, alors que l’exécutif méprise le plus souvent le Parlement, en particulier le bicamérisme, il vante par exemple les mérites du Conseil économique, social et environnemental, où il peut nommer qui il veut comme il veut. Voilà ce qu’est devenue aujourd’hui la Ve République !
Évidemment, dire cela n’est pas facile, les médias boboistes parisiens étant toujours déchaînés quand il s’agit de maintenir ce politiquement correct
Ah oui ! sur les travées du RDSE.

qui mène notre pays dans une voie sans issue d’où il faudra le faire sortir un jour autrement – et je le souhaite – que par les mouvements de rue.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe CRC.– M. Jean-Yves Leconte applaudit également.

On nous dit que l’adoption de cette proposition de loi, ainsi que celle de cet amendement, affaiblirait le Président de la République. Eh bien oui ! Et heureusement !

Oui, c’est fait pour !
Nous savons dans quelles conditions et pourquoi est née la Ve République. On nous dit qu’il faut un pouvoir fort ; mais, ce pouvoir fort, c’est déjà la réalité ! C’est d’ailleurs le seul pouvoir !
Comme il est dit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la lignée de Montesquieu, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Qu’a-t-il fait, ce pouvoir fort, depuis 2007, et même depuis 2000 ? A-t-il vu venir la crise ? A-t-il engagé le début du règlement de cette crise ? A-t-il une politique européenne ? On cherche…
Ce pouvoir fort, parce qu’il est ligoté, est devenu un pouvoir faible. Les alternances à la présidence de la République ne changent rien – je ne parle pas des décorations… – parce que, sur le fond, c’est exactement la même politique qui est menée. D’où le désespoir des gens, qui, à force d’être pris pour des ânes, ont parfois des comportements surprenants.
Certains parlent d’une hyperprésidence, d’une monarchie républicaine. Non ! Le mot qui désigne le mieux ce régime, c’est celui de consulat, que Sieyès définissait ainsi : « L’autorité vient d’en haut, la confiance vient d’en bas. »
Du temps du Consulat, c’étaient les grognards de l’Empereur qui menaient au pouvoir ; de nos jours, ce sont les élections, tous les cinq ans, qui permettent d’y accéder. Une fois élus, les parlementaires n’ont plus qu’à entériner les décisions du pouvoir, celui-ci ayant à sa disposition toutes sortes de procédés pour passer outre un éventuel refus.
Et vous trouvez cela génial !
Bien sûr, nous sommes bien conscients que l’adoption tant de cette proposition de loi que du présent amendement ne réglerait pas tout ; elle permettrait néanmoins de revenir sur l’inversion du calendrier électoral et le passage au quinquennat, qui ont aggravé la situation.
Certes, comme l’a dit Yvon Collin tout à l’heure, on ne prend qu’un bout du problème, mais c’est un premier pas pour tenter de faire évoluer les choses dans le bon sens. Il faut donc voter cet amendement et cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Notre groupe souscrit aux propos de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Jacques Mézard. Il est regrettable que nous ne soyons pas plus nombreux dans cet hémicycle à l’occasion de ce débat essentiel, qui porte sur notre pouvoir en tant que parlementaires. C’est cela qui est en jeu, et certains de nos collègues ne le comprennent probablement pas.
Que nous soyons de droite ou de gauche, nous dépendons tous du pouvoir présidentiel. Si un pouvoir aussi fort ne trouve pas face à lui un contre-pouvoir libre dans son mode d’élection – et cette question est soulevée par la proposition de loi du groupe du RDSE –, alors les représentants du peuple que nous sommes continueront à être affaiblis.
La contestation des parlements a toujours existé. Elle est parfois considérée sur le mode humoristique alors que c’est grave. À cet égard, nous devrions être beaucoup plus conscients des enjeux posés à travers ce texte.
Il existe bien d’autres solutions pour essayer non pas d’affaiblir le pouvoir présidentiel, mais de rétablir l’équilibre entre celui-ci et le pouvoir du Parlement. Cette proposition de loi constitutionnelle en est une, et c’est pourquoi les deux tiers de notre groupe – j’aurais aimé l’unanimité sur cette question, mais il y a déjà un progrès – la voteront. En tout cas, je tiens à remercier nos collègues du RDSE. §

Bien que membre du groupe UMP, je suis favorable à cette proposition de loi constitutionnelle.
Tous les orateurs exposent les limites du quinquennat actuel, lequel ne dure en réalité que deux ans : il faut en effet un an pour la mise en place du Président de la République et deux ans pour la préparation de sa réélection. En outre, les sondages qui, tout au long du quinquennat, publient régulièrement la cote de popularité du Président de la République compliquent encore la situation.
Le Président de la République, qu’il soit de droite ou de gauche, est aujourd’hui un monarque. C’est lui qui dirige la France.
Si l’on veut aller au bout du régime présidentiel, il faut alors supprimer le Premier ministre, réduire de façon drastique le nombre de membres du Gouvernement et inscrire ces dispositions dans la Constitution, puisque le pouvoir est concentré entre les mains d’un seul homme entouré de technocrates. Soyons logiques !
En outre – permettez-moi une note d’humour –, le rétablissement du septennat permettrait sur le long terme une réduction du nombre de présidents de la République, et donc une diminution des frais liés aux anciens présidents ! §
Cette proposition de loi présente au moins le mérite de soulever le problème du quinquennat et de susciter la discussion. Quand nous discutons entre nous, nous sommes nombreux à considérer que le quinquennat a atteint ses limites. §

Madame la secrétaire d’État, nous discutons d’un amendement qui vise à restreindre le droit de dissolution du Président de la République. Notre collègue Pierre-Yves Collombat a assumé son souhait de parvenir, par cet amendement, à un affaiblissement des pouvoirs du Président de la République, lesquels, d’après lui, seraient excessifs et auraient tendance à absorber tous les autres pouvoirs.
Je rappellerai tout d’abord que l’exercice du droit de dissolution, par ses effets, n’a pas toujours conduit à un renforcement du rôle du Président de la République. Nous avons ainsi tous en mémoire des dissolutions qui n’ont pas permis au Chef de l’État de disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité conforme à ses vœux. On ne peut donc affirmer que l’exercice du droit de dissolution renforce toujours le Chef de l’État.
J’esquisserai ensuite une autre interprétation du droit de dissolution : cette procédure permet, pour sortir d’une crise, de rendre la parole au peuple, lequel envoie une majorité à l’Assemblée nationale afin que le pays puisse être gouverné.
Au fond, la question n’est pas celle de l’affaiblissement ou du renforcement du pouvoir présidentiel ; c’est bien la démocratie qui est en jeu. Le droit de dissolution est, à coup sûr, un élément qui conforte la démocratie.
On voit mal pourquoi, dans un pays qui a tant de difficultés à résoudre ses problèmes, dans un monde au sein duquel les dangers sont chaque jour plus évidents, il faudrait priver nos institutions d’un instrument donnant au peuple français la possibilité de s’exprimer avec force et de dégager une majorité.
Si nous limitons les possibilités du recours à la dissolution, il sera alors impossible, en période de confusion, c’est-à-dire en l’absence de majorité parlementaire claire, fidèle et unie pour mettre en œuvre une politique, il sera alors impossible, disais-je, de résoudre les difficultés.
C’est la raison pour laquelle il me semble imprudent de restreindre davantage le droit de dissolution. Pour ma part, comme la commission des lois et son rapporteur, je suis tout à fait défavorable à cet amendement.

Je souhaite répondre aux auteurs de la proposition de loi constitutionnelle.
Mes chers collègues, au fond, vous vous trompez de texte. Si votre objectif est de diminuer les pouvoirs du Président de la République, comme vous l’avez indiqué à plusieurs reprises, il convient alors de revoir non pas la durée du mandat, mais le mode d’élection, en proposant dans un nouveau texte la suppression de l’élection du Président de la République au suffrage universel et l’instauration d’un autre mode d’élection. Là, vous serez au cœur du débat.
Si votre objectif consiste à renforcer les pouvoirs du Parlement, il vous faut alors déposer une proposition de loi constitutionnelle visant à supprimer le droit de dissolution, à supprimer le poste de Premier ministre, et surtout, comme dans d’autres pays, à confier l’initiative législative au Parlement et non plus à l’exécutif. Ainsi, vous renforcerez vraiment la démocratie parlementaire.
En l’état, je ne vois pas en quoi la réduction de la durée du mandat aboutira aux objectifs qui sont les vôtres.

Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, je donne la parole à M. Serge Dassault, pour explication de vote.

M. Serge Dassault. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, on nous propose aujourd’hui de rétablir à sept ans le temps du mandat du Président de la République, alors qu’une durée de cinq ans paraît déjà trop longue
Sourires.

Je voudrais formuler une proposition qui rejoint la pratique américaine assez judicieuse des élections à mi-mandat, permettant de savoir si, au bout de deux ans et demi, la majorité a changé ou non. Si la majorité n’a pas changé, le Gouvernement continue son action ; sinon, le Président doit se soumettre à une cohabitation.
Je tiens d’ailleurs à vous signaler que François Hollande avait lui-même demandé, dans son ouvrage intitulé, publié en 2006, l’organisation d’un tel contrôle démocratique à la moitié de la législature. Il préconisait, selon ses propres termes, « un exercice de vérification démocratique ». Je crois qu’il avait raison.
C’est pourquoi je vous proposerai prochainement d’étudier une proposition de loi prévoyant obligatoirement des élections législatives à mi-mandat, afin de vérifier si tout le monde est satisfait et d’éviter toute dérive vers une monarchie républicaine.

Je comprends que les deux partis qui aspirent à voir leur candidat élu Président de la République lors de la prochaine élection présidentielle soient opposés à nos propositions. Mais tout le problème est précisément là : les présidents de la République changent, mais ils mettent en œuvre la même politique et plus personne n’y comprend rien !

Je me rappelle encore, vu mon âge, les diatribes de François Mitterrand sur Le Coup d’État permanent.

Il s’est ensuite accommodé de la situation…
Alain Peyrefitte disait : « La Constitution de la Ve République a été faite “pour gouverner sans majorité”. » C’est vrai !
Pour notre part, nous proposons non pas de régler tous les problèmes – notre proposition, nous en sommes conscients, ne le permettrait pas –, mais au moins de revenir à l’esprit initial de la Constitution de la Ve République, au travers d’un système permettant de fonctionner avec des majorités faibles. Toute la difficulté est que ce système a fonctionné avec des majorités en béton et qu’il y a maintenant un déséquilibre complet.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président de la République et à le rendre non renouvelable.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n°88 :
Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quinze, est reprise à dix heures vingt.

L’ordre du jour appelle le débat sur le thème : « La France dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde ? », organisé à la demande du groupe du RDSE.
La parole est à M. Gilbert Barbier, au nom du groupe du RDSE.

M. Gilbert Barbier, au nom du groupe du RDSE. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le système de santé français est-il le meilleur du monde ? Cette interrogation paraîtra à certains un peu provocatrice, voire indécente. En effet, comment oser remettre en cause cette certitude ancrée dans notre histoire nationale, cette assertion datant du siècle des Lumières, qui, comme l’écrivait Gustave Flaubert, a vu la naissance de la médecine moderne « dans le tablier de Bichat » ?
Sourires.

Par la suite, notre médecine fut développée par Laennec, Bretonneau, Trousseau, Magendie, Claude Bernard, Louis Pasteur, même si ce dernier n’était pas médecin, et bien d’autres encore. Il faudrait citer tous les grands noms de la médecine française qui, depuis, ont maintenu la place de la France dans le maelström mondial de la médecine moderne.
Être les meilleurs du monde, être champions dans quelque discipline sportive ou autre flatte toujours notre orgueil cocardier. Mais ce sentiment n’a pas grand sens dans le domaine si particulier qui nous occupe aujourd’hui, et le pathos ne suffit plus.
Néanmoins, il est plus que nécessaire de s’autoévaluer pour, éventuellement, se remettre en cause sans faux-fuyant. Tel peut être notre rôle de parlementaires.
Cela va sans dire, il ne s’agit pas de faire ici le procès de qui que ce soit, d’autant que, dans cette évolution larvée, dans ce glissement insidieux, dans cette lente dégradation de notre système de santé que je crois percevoir, la responsabilité me semble partagée entre les uns et les autres. Il serait déjà pertinent de le reconnaître et, si je puis dire, d’essayer ensemble d’y porter remède.
Dans un entretien accordé en 1998, Didier Sicard avait bien esquissé une réponse à cette question, en distinguant la médecine, en tant qu’ensemble de soins à la personne, et la santé publique. Il déclarait alors : « La médecine française est fondée sur une relation médecin-malade individuelle, c’est une médecine chère mais une médecine efficace. » Il poursuivait, à propos de la santé publique, en la dissociant du soin, je le répète : « La France est un pays jacobin, qui aime diriger du haut vers le bas, qui aime envoyer des directives aux préfets » – désormais, il faudrait dire : aux agences régionales de santé. « Tout est vécu comme si l’information qui remontait du bas était une information dénonciatrice, policière. » Il ajoutait un peu plus loin : « La France est totalement absente dans le domaine de l’épidémiologie.
Depuis, les réformes se sont succédé, le plus souvent en se contredisant, pour aboutir aujourd’hui à une situation dangereuse : la perte de confiance et le doute de nos concitoyens dans ce qui est le bien le plus précieux de l’individu, la santé.
De nombreuses études, réalisées par des organismes d’horizons les plus variés, aboutissent à un même constat sous des vocables différents : le système est dans une impasse, il est à bout de souffle, il est victime d’une dégradation patente, et j’en passe.
Nombre d’économistes se sont penchés sur les causes de cette dégradation. Il ne servirait à rien de l’ignorer, même si l’on regrette, là encore, l’absence de données épidémiologiques globales.
Certes, on peut s’enorgueillir de quelques pépites de très haut niveau, de centres de recherche et de services de notoriété mondiale, de plusieurs pôles d’excellence dans les domaines les plus sophistiqués de la médecine contemporaine, généralement grâce à une action concertée entre l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, et le milieu hospitalo-universitaire.
Même si des difficultés existent également dans ce domaine, je centrerai mon propos d’aujourd’hui sur la dispense de soins.
Le premier problème, qui, bien sûr, conditionne les autres, affecte le financement de notre système.
Nous sommes pourtant au nombre des pays qui consacrent une part importante de leur PIB à la santé. Y aurait-il donc un mésusage de cet engagement financier ?
Depuis des décennies, les gouvernements successifs courent après un équilibre des comptes et essaient d’endiguer un déficit presque constant, qu’ils pallient par des mesures financières sans pour autant aboutir. Nous ne pouvons plus, année après année, alourdir cette dette transmise aux générations suivantes pour notre propre confort sanitaire. Il faut donc dépenser moins et surtout mieux, ou différemment, quitte à revoir, lors d’un retour à meilleure fortune de notre économie, le mode de financement de la protection sociale en général.
Les bases actuelles reposant sur l’activité sont trop restrictives. Le transfert vers un financement aux bases plus larges est engagé : il doit se poursuivre. Mais, dès lors, se pose une première interrogation, qui fait immédiatement débat : la gestion paritaire est-elle encore adaptée ? Je la mentionne, même si tel n’est pas l’objet de mon propos de ce jour.
Après la création de la sécurité sociale en 1945, les Trente Glorieuses ont permis d’assurer un financement expansionniste de la santé.
Les difficultés se sont fait jour dans les années quatre-vingt, avec la montée du chômage. En 1995, les ordonnances Juppé ont instauré une régulation étatique des dépenses avec la création de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, qui encadre toujours la dépense publique de santé.
Depuis des années, pour limiter les dépenses, il est procédé, budget après budget, à des coups de rabot dans divers secteurs – souvent les mêmes, d’ailleurs. Certes, des économies peuvent être réalisées par ce biais. Mais cette méthode atteint ses limites, et il faut avoir le courage et la volonté politique de reprendre l’ensemble de l’organisation de la dispense de soins.
Cette dispense de soins se divise traditionnellement en deux parties : l’hôpital et la médecine de ville. Abordons celle qui est considérée comme tabou : l’hôpital.
Qu’en est-il ? Par rapport à nos voisins, nous constatons l’existence d’un trop grand nombre d’établissements dans notre pays.
La France dispose de centres hospitaliers universitaires très grands, extrêmement performants, dans la plupart des disciplines. D’autres CHU peuvent exceller dans quelques spécialités mais sont par ailleurs absents de nombreux pans de la scène scientifique internationale.
Aussi, pour exister ou simplement pour subsister, certains services hospitaliers admettent et traitent des patients porteurs d’affections souvent banales, avec, à la clef, un prix de journée excessif. Les hôpitaux généraux ou les établissements privés, de leur côté, se trouvent alors privés d’une activité qu’ils assureraient pourtant à moindre coût.
Je sais que, pour mener à bien la mission d’enseignement qui lui est dévolue, le CHU doit rassembler toutes les pathologies, de la plus simple à la plus compliquée. Mais des stages mieux organisés dans les établissements périphériques ou en cabinet permettraient peut-être de contourner ce problème.
Il faut repenser le rôle du CHU : il doit être un modèle d’excellence pour les spécialités les plus pointues et non un établissement de proximité. En outre, cela dégagerait une économie importante.
S’agissant des hôpitaux généraux, nous savons qu’ils connaissent, et connaîtront dans les années à venir, les plus grandes difficultés, surtout du fait de la pénurie de médecins spécialistes de qualité intéressés par la carrière hospitalière. Depuis des années, les vacances de postes se multiplient dans certaines disciplines. Il est alors fait appel à du personnel médical dont la compétence n’a jamais été vérifiée – pas plus que la validité de leurs diplômes –, sans parler du recours à ces vacataires qui viennent effectuer des remplacements à des tarifs ruineux pour les finances des établissements.
Il faut coûte que coûte pourvoir les postes pour éviter la fermeture des services.
Il est urgent et impératif de mettre en place des commissions de recrutement pour stopper la dégradation du niveau médical et, surtout, pour pourvoir aux chefferies de service.
Les conséquences de cette situation sont évidentes : perte de confiance de la patientèle locale et perte de crédibilité vis-à-vis des médecins généralistes du secteur. La notoriété de l’ensemble de l’établissement en pâtit et le recours à l’hôpital devient un pis-aller.
Nous devons admettre que l’on ne peut pas faire tout partout et le faire bien. Le besoin de proximité est un mauvais argument pour maintenir ici ou là des services à faible activité, de ce fait peu attractifs pour les médecins, compte tenu des perspectives financières qui s’offrent aux meilleurs d’entre eux.
Rappelons le recensement de la qualité des plateaux techniques réalisé par le professeur Guy Vallancien en 2006 : pour cent trente d’entre eux, elle avait été jugée insuffisante, médiocre, voire si faible qu’elle pouvait représenter un danger. Aucune suite n’a été donnée à cette enquête.
Quelle réponse sera apportée, demain, à l’étude toute récente de la Cour des comptes sur la sécurité dans les maternités ? Faudra-t-il attendre d’autres « Orthez » ? Il faut certes se garder des amalgames : nous devons analyser plus finement les causes de ce taux de mortalité périnatale dont notre pays ne peut tirer aucune fierté.
Il faut repenser la cartographie hospitalière en associant réseau public et réseau privé. Malheureusement, l’absence d’open data concernant les informations détenues par l’assurance maladie interdit de mesurer le différentiel de morbidité entre les établissements et les services. Les publications annuelles paraissant dans les hebdomadaires ne permettent pas une évaluation correcte ; celle-ci suppose une analyse de l’ensemble des données détenues par l’assurance maladie. Or on ne les connaît pas !
Chacun le sait bien : la principale inégalité d’accès aux soins n’est pas un problème de territoire, mais de qualité de la prise en charge, qu’elle soit initiale, en urgence ou en différé. Nos concitoyens veulent bénéficier – c’est humain – de la meilleure prise en charge, quitte à faire quelques kilomètres en plus, n’en déplaise aux élus locaux ! §
Cette réforme hospitalière devrait être de grande envergure.
Le président Gérard Larcher évaluait en 2008 à près de 60 000 le nombre de lits d’hospitalisation excédentaires. Depuis, les progrès de la médecine et de la chirurgie ambulatoires permettent de confirmer ce chiffre, voire de l’amplifier. Quelques restructurations ont été effectuées, mais il reste beaucoup à faire.
De nombreuses reconversions pourraient être encore mises en œuvre, même si, en matière de santé, l’emploi local ne peut être une variable d’ajustement du réseau. Il est urgent de repenser la prise en charge des différentes pathologies pour une meilleure efficacité, en s’inspirant du plan cancer, qui fonctionne bien.
On assiste paradoxalement à un recours accru, et excessif, des malades à l’hôpital, particulièrement aux services d’urgence. Cette pratique concernait en 2012, selon la Caisse nationale d’assurance maladie, 650 000 patients, pour une dépense de 2 milliards d’euros. Nous devons donc nous interroger sur la permanence des soins et, en conséquence, sur la démographie médicale et sur les conditions d’exercice.
Il est impossible de développer aujourd’hui les nombreux aspects de ce sujet : numerus clausus, féminisation, mode de vie des professionnels, contrainte d’installation géographique, concentration en maison de santé, rémunérations à l’acte ou à la pathologie, statut du médecin, responsabilité pénale, principe de précaution, gratuité totale ou partielle. Autant de questions qui ne peuvent être traitées ni séparément ni partiellement.
Le problème est bien global. Il s’agit aujourd’hui de faire un choix majeur de société. Le dialogue singulier entre le médecin et le malade doit-il disparaître dans un service de santé public ?
Depuis Hippocrate, la médecine est un art : celui de guérir. Serait-elle devenue une science ? On peut légitimement se poser la question : la formation initiale comporte seize sciences fondamentales, il existe trente-deux spécialités médicales différentes, seize spécialités chirurgicales et encore dix autres qualifications.
Cette emprise des scientifiques sur la médecine a un corollaire : le peu de place laissée aujourd’hui à la clinique dans le cursus initial, c'est-à-dire au contact avec le malade, et pas seulement avec la maladie.
Je cite encore les paroles du professeur Sicard, selon qui les étudiants n’aiment pas la clinique parce qu’« elle leur semble archaïque, elle les oblige à affronter un corps humain avec tout ce que cela peut comporter de gêne de répulsion, de malaise ». Il faut revoir la formation initiale pour que les jeunes médecins apprennent le chemin du dialogue singulier.
Le mot « clinique » vient d’un mot grec qui signifie « lit ». C’est cette formation au chevet du patient qui fait cruellement défaut, même si les examens complémentaires de biologie, d’imagerie ou autres offrent aujourd’hui un appoint diagnostique essentiel et incontestable, mais trop souvent inutile et toujours coûteux.
Reste aussi à introduire dans l’enseignement une initiation à la psychologie. De nos jours, le malade souhaite connaître, pour s’y préparer, le parcours de soins qui l’attend avec les maladies chroniques omniprésentes, qui ont remplacé les pathologies aiguës, maintenant plus facilement maîtrisées.
Les difficultés rencontrées pour être reçu rapidement par un généraliste sont une des causes du renoncement à se soigner ou du recours à l’hôpital. Mais la situation n’est malheureusement pas meilleure lorsqu’il faut faire appel à un spécialiste. Certaines disciplines sont véritablement sinistrées, d’autres très menacées. Pour obtenir un rendez-vous avec un gynécologue-obstétricien, un ophtalmologue, un pédiatre, un cardiologue, entre autres spécialistes, il faut s’armer de patience. Les délais d’attente sont, là aussi, une des causes du renoncement aux soins.
Que dire de la formation médicale continue, sinon qu’il s’agit d’un domaine parfaitement empirique, pratiquement laissé à la conscience professionnelle de chaque médecin et de chaque professionnel de santé ? Aborder ce sujet n’est pas facile, tant le risque est grand de se heurter à des ego, mais il est urgent que les intéressés s’en saisissent et surtout assurent le contrôle et l’évaluation des formations dispensées. Cette responsabilité ne serait-elle pas du ressort du conseil de l’ordre ?
Dans d’autres secteurs, s’il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la réforme de la biologie médicale, force est de constater que la politique restrictive en matière d’autorisation d’équipements lourds d’imagerie retarde la prise en charge et le traitement de maladies graves. Les délais d’attente – près d’un mois dans certaines régions – sont difficilement supportables pour les patients.
Il est un domaine dans lequel nous occupons, hélas ! les marches les plus hautes du podium : la consommation de psychotropes et, d’une manière générale, la consommation de médicaments. La commission des affaires sociales – j’en remercie encore son président – a bien voulu nous charger, Yves Daudigny et moi-même, d’une mission pour essayer d’y voir plus clair. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans quelques mois, mais il est évident que les nouvelles avancées concernant les biotechnologies, les traitements personnalisés, les molécules coûteuses, imposeront inévitablement à notre société des choix économiques.
J’ai insisté sur deux problèmes majeurs de notre système. Il existe toutefois un autre secteur, tout aussi important, qui relève bien de la santé publique et dans lequel, malheureusement, nous ne sommes pas les champions : la prévention.
Notre système de financement de la santé par l’assurance maladie est assez simple : on est malade, on se fait soigner, on est remboursé, ou non. La question qui se pose est bien de savoir qui doit prendre en main la prévention. Comment la financer et comment la pratiquer ? Sont concernés les pouvoirs publics, la sécurité sociale, le monde associatif, peut-être aussi les professionnels de santé, si l’on veut bien leur reconnaître ce rôle. Des actions et des campagnes sont bien menées, et je suis loin de les considérer comme négligeables, mais il y a encore matière à réflexion pour atteindre une plus grande efficacité.
Au-delà de la prévention générale, il faut revoir la situation de la médecine du travail et de la médecine scolaire dans l’ensemble du système de santé. Ces deux pratiques souffrent d’une certaine marginalité, malgré leur potentiel en matière de prévention et de dépistage.
En inscrivant ce débat à l’ordre du jour, le RDSE a souhaité amorcer une réflexion de fond pour que notre système de santé, qui a été longtemps un modèle, puisse retrouver sa grandeur au service de nos concitoyens à l’aube du XXIe siècle. Mais rien ne se fera sans l’association de tous les acteurs : professionnels, institutions publiques ou privées, financeurs, patients, un ensemble dans lequel les pouvoirs publics ont bien entendu leur place ! §

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie le groupe RDSE, et notamment M. Barbier, d’avoir suscité ce débat.
Notre République a placé la santé et la protection sociale au rang des droits imprescriptibles. Le préambule de la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le programme du Conseil national de la Résistance se sont fixé pour grande ambition sociale de transformer en droits quotidiens ce qu’une minorité considérait comme un privilège et accaparait.
La santé est notre bien commun. C’est pourquoi, à la logique dominante du libéralisme à tout prix, nous opposons celle de la justice sociale et de la solidarité.
La santé constitue, pour les citoyens, une préoccupation majeure et ils entendent bénéficier véritablement d’un système solidaire et de qualité.
Notre modèle de sécurité sociale est une construction sociale historique qui répond à de réels besoins, mais qui rencontre des difficultés structurelles, auxquelles nous proposons une réponse alternative : une protection sociale solidaire. Pour nous, et cette vision s’étend bien au-delà de notre sensibilité politique, la santé n’est pas une marchandise.
Selon un sondage de l’institut BVA de février 2014, les Français ont une opinion positive de leur système de protection sociale, tel qu’il est né à la Libération. La sécurité sociale est bâtie depuis 1948 sur la contribution de chacun en fonction de ses moyens et la distribution en fonction de ses besoins. Il ne s’agit pas d’une utopie dépassée !
Ainsi, 64 % de nos concitoyens jugent normal que la France consacre un tiers du revenu national au financement de la protection sociale, et neuf Français sur dix souhaitent que ce système demeure essentiellement public.
Nous retiendrons également que, pour six Français sur dix, la qualité des soins diffère selon les revenus. Ce constat d’une fracture sociale dans l’accès aux soins est partagé par notre groupe, et celui-ci la dénonce inlassablement.
Face au développement des inégalités d’accès aux soins et à la santé, face au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques, à la dégradation de la qualité des soins, à la nécessité d’adapter les prestations aux attentes nouvelles des patients, nous devons travailler à une réponse globale.
Nous n’avons aucun doute quant à la dynamique en cours de privatisation et de libéralisation de notre système de santé. Nous regrettons vivement l’absence persistante d’une véritable rupture de logique depuis le changement de gouvernement.
La question n’est pas tant de savoir si la France a, ou non, le meilleur système de santé au monde – ainsi que le suggérait l’OCDE en 2013 – que de déterminer le niveau de responsabilité des lois d’austérité dans sa dégradation.
Nous nous attarderons donc davantage sur les effets négatifs des politiques d’austérité menées successivement contre notre modèle de santé et sur nos propositions alternatives, visant à garantir une protection sociale de haut niveau.
Jusqu’à présent, le système de protection sociale a difficilement résisté aux cures de réductions budgétaires imposées à la fois par la loi HPST, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’instauration de la tarification à l’activité et la réduction de l’ONDAM – objectif national des dépenses d’assurance maladie.
Il faut casser ces logiques mortifères, en abandonnant la loi HPST ainsi que la tarification à l’activité et en augmentant l’ONDAM. Faut-il rappeler ici que la gauche, rassemblée il n’y a pas si longtemps, partageait ces convictions ?
La politique menée depuis trop longtemps a des effets dramatiques. Le nombre des visites aux urgences a progressé de 75 % entre 1996 et 2011 ; les fermetures et les restructurations d’établissements hospitaliers se sont succédé ; de nombreuses maternités, en particulier, ont été fermées au nom de la rentabilité, et ces fermetures sont allées de pair avec celles de centres d’interruption volontaire de grossesse, ce qui a eu de graves conséquences sur le choix des femmes.
Par ailleurs, les conditions de travail du personnel médical se sont inévitablement dégradées et cette dégradation se poursuit. Nous voyons se déployer une véritable stratégie de transfert des pathologies courantes et des populations solvables vers le système de santé privé, pour ne maintenir dans le secteur public que les pathologies extrêmement coûteuses et les populations les moins solvables.
Aussi, il y a une urgence démocratique à mettre en place un système de santé solidaire alternatif. Notre système de sécurité sociale est fondé sur la mise en commun des cotisations des assurés sociaux. Le déséquilibre financier rencontré par le régime général de la sécurité sociale s’explique principalement par la chute historique de la masse salariale, l’importance du taux de chômage et de la précarité, ainsi que par la financiarisation de l’économie, auxquelles s’ajoute le poids des exonérations et des fraudes massives en matière de cotisations patronales.
C’est pourquoi nous proposons une politique alternative consistant à renforcer notre système de sécurité sociale en le dotant d’un financement plus juste et plus efficace. De nouvelles ressources assureraient à notre système de santé une meilleure « santé » financière, si j’ose dire : il s’agirait, par exemple, de soumettre les revenus financiers des entreprises à cotisation ou de supprimer les exonérations dont elles bénéficient actuellement, mais aussi, bien sûr, de lutter contre la fraude patronale.
Et puis, mes chers collègues, quand allons-nous inscrire dans la loi cette mesure de justice : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Cela procurerait 52 milliards d’euros de ressources supplémentaires à la sécurité sociale !
Lever les freins concernant l’accès aux soins passe, notamment, par la suppression des franchises médicales, véritables droits d’entrée dans notre système de santé. Le groupe CRC est pour un modèle de sécurité sociale permettant la prise en charge des soins à 100 % pour tous les assurés sociaux.
Afin d’assurer une véritable démocratie sanitaire, nous proposons de remplacer les agences régionales de santé par des conseils cantonaux de santé, composés de représentants des professionnels, des élus locaux et des usagers. Ces conseils, coordonnés au niveau régional et national, recenseraient les besoins en termes de santé, valideraient la réponse à apporter sur le territoire concerné et contrôleraient démocratiquement celle-ci.
Une meilleure organisation des établissements de santé est nécessaire pour garantir un accès simple et rapide aux structures et en finir avec les déserts médicaux.
La relance de l’hôpital public est une priorité : elle exige des investissements à la fois financiers et humains.
Surtout, il faut penser santé et accès aux soins en termes de coopération et non pas de concurrence. L’offre de santé doit permettre la prise en charge d’un parcours de santé global et cohérent, articulant la médecine de ville à l’hôpital.
Les centres de santé doivent bénéficier de moyens à la hauteur de leurs missions que sont la délivrance des soins ambulatoires, la prévention, la promotion de la santé, l’éducation thérapeutique, la pratique de l’IVG ambulatoire. Le tiers payant actuellement pratiqué par les centres de santé permet de supprimer les barrières en matière d’accès aux soins et nécessite une meilleure prise en charge par la sécurité sociale.
Le développement d’une médecine ambulatoire de qualité répond à une évolution des attentes des patients et de la technologie. Les centres de santé apportent une solution de proximité, d’accessibilité et de démocratie sanitaire.
Je n’ai pas le temps, ici, de détailler toutes les mesures qu’il faudrait prendre en termes de prévention, d’information, de dépistage et de formation médicale. Je soulignerai simplement qu’il est, à nos yeux, extrêmement important de supprimer les dépassements d’honoraires, afin de réduire les inégalités sociales dans l’accès aux soins.
Enfin, la formation médicale doit être revisitée. En particulier, des mesures incitatives doivent être instaurées pour les futurs professionnels de santé, telles que le financement des études en échange de cinq années de travail dans le service public ou dans les déserts médicaux, comme c’est le cas pour les enseignants.
La France a inventé et fait vivre la sécurité sociale. Aussi, elle ne doit pas se cantonner à se voir décerner une médaille d’or sur le podium international pour son système de santé ; elle doit partager ce modèle avec les autres pays.
Attachés à un internationalisme progressiste, nous devons être porteurs d’exigences au regard de la coopération internationale et contribuer à exporter notre système de santé.
Une nouvelle politique mondiale de santé reste à inventer, fondée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, sur la satisfaction des besoins des populations plutôt que sur la recherche de profits d’une minorité d’actionnaires. §

Très précieux aux yeux des Français parce qu’il repose sur le principe de solidarité envers les plus fragiles et qu’il garantit à chacun l’accès à des soins de qualité, notre système de santé incarne les valeurs humanistes qui sont au cœur de notre pacte républicain.
Selon une enquête réalisée en mai 2014 à la demande de la Fédération hospitalière de France, les Français considèrent que notre système de santé demeure l’un des meilleurs, sinon le meilleur du monde.
En revanche, ils déplorent une mauvaise répartition des médecins sur le territoire et ont le sentiment d’une médecine à deux vitesses. Pour 92 % des personnes interrogées, les patients qui « ont de l’argent ont plus de possibilité de se faire bien soigner » et 74 % d’entre elles estiment que « les innovations et les meilleurs traitements ne sont pas proposés à tous les patients ».
En effet, force est de constater que, aujourd’hui, notre système de santé n’est plus égalitaire et que des millions de personnes en sont progressivement exclues. Trop de personnes renoncent à se faire soigner pour des raisons financières. Ainsi, les dépassements d’honoraires des médecins affectent lourdement les salariés les plus modestes. Cette situation n’est pas tolérable. Nos concitoyens ont le droit de recourir, quelle que soit leur situation sociale, à des soins de qualité.
Un observatoire des dépassements d’honoraires a été mis en place, et le rapport qu’il a publié il y a quelques mois permet de faire le point sur la situation.
Toutefois, les inégalités en matière de santé sont aussi territoriales, car de plus en plus de nos concitoyens, notamment dans les zones rurales, sont touchés par la désertification médicale. Dans nos territoires ruraux, les difficultés d’accès aux soins sont une réalité quotidienne.
Le regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux dans des maisons de santé pluridisciplinaires constitue une réponse précieuse. La loi HPST de 2009, qui autorise les collectivités à prendre en charge les dossiers concernant la santé, est un progrès important, car il permet de développer les maisons de santé, telles que celle que j’ai eu récemment l’honneur d’inaugurer la maison de santé de Loures-Barousse, dans les Hautes-Pyrénées.
S’agissant de ces maisons de santé, il est préférable que le projet immobilier soit conduit par les collectivités territoriales – communautés de communes, communes, voire départements –, afin de favoriser le partage des bâtiments.
Les maisons de santé présentent de nombreux atouts. Elles favorisent le partage du dossier médical et de la patientèle, ainsi qu’un meilleur suivi médical. Avec des médecins et des professionnels paramédicaux ainsi rassemblés, l’offre de soins devient quasi permanente. En outre, ceux-ci, dégagés des problèmes de gestion matérielle, peuvent mettre en place une politique de prévention, essentielle en matière de santé. D’une manière générale, la mutualisation des ressources médicales offre à ces professionnels un certain confort de travail.
Par ailleurs, ces structures sont susceptibles d’attirer les jeunes médecins, dont beaucoup répugnent désormais à s’installer et à exercer seuls dans un cabinet, comme leurs prédécesseurs le faisaient jadis. Du reste, les cabinets individuels sont de plus en plus rares et apparaissent comme relevant d’un modèle quasi dépassé.
Bref, les maisons de santé pluridisciplinaires constituent une réponse précieuse en milieu rural, tant pour les médecins que pour les patients, et participent pleinement à la diversité de notre offre de soins.
Permettez-moi d’évoquer maintenant la question de la féminisation.
La féminisation extrêmement importante de la profession médicale…
Nouveaux sourires.

M. François Fortassin. … ne nuit certes pas à la qualité – les médecins actuels sont d’ailleurs beaucoup plus performants qu’ils ne l’étaient il y a quarante ans –, mais elle réduit le temps passé auprès des malades.
Plusieurs sénatrices s’exclament sur différentes travées.

Les femmes – et c’est tout à leur honneur ! – ne peuvent pas exercer cette profession avec le même détachement que les hommes, qui peuvent consacrer 100 % de leur temps à la médecine. C’est un fait à prendre en compte.
Au-delà des dispositifs actuellement mis en place au sein des agences sanitaires, il faut envisager, dès l’approbation des traitements, d’associer les patients aux processus de décision via des outils d’évaluation au long cours, afin que les traitements correspondent réellement aux attentes.
Les patients doivent pouvoir évaluer eux-mêmes, en termes d’efficacité et d’impact sur leur qualité de vie, les bénéfices des traitements, afin que les investissements supportés par la collectivité nationale soient pertinents pour les personnes qui vivent au quotidien avec la maladie.
Je souhaite également aborder la question de l’insuffisante formation des médecins généralistes en matière de prise en charge des addictions.
Ainsi, en médecine de ville, les prescripteurs de traitements de substitution aux opiacés sont à 98 % des médecins généralistes. Or trop peu de médecins généralistes ont suivi, au cours de leur formation, un module sur les addictions leur permettant, d’une part, de faire une prévention individuelle ciblée et, d’autre part, d’assurer une prise en charge adéquate de leurs patients.
Madame la secrétaire d'État, il nous semble urgent que le projet de loi de santé prévoit la création de modules d’addictologie obligatoires dans le cadre des cycles universitaires d’études médicales, afin que les médecins généralistes, en particulier dans nos zones rurales, disposent de l’ensemble des outils nécessaires à une prise en charge efficace et sécurisée des patients dépendants.

La médecine, qui peut être libérale dans son exercice, doit être soumise à la puissance publique dans son organisation. N’est-ce pas là que le bât blesse ?
Quoi qu’il en soit, demeurons optimistes ! Notre système de santé, s’il n’est pas le meilleur du monde, reste extrêmement performant. §

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur les maternités, commandé par notre commission des affaires sociales et dont les conclusions ne sont pas des plus optimistes. La Cour y révèle qu’en dix ans la France est passée du sixième au dix-septième rang européen en matière de mortalité néonatale. Et ce, alors qu’elle se situe au premier rang en taux de fécondité.
Ce classement illustre bien l’utilité du débat qu’a demandé le groupe du RDSE et qu’a ouvert notre excellent collègue Gilbert Barbier. Je tiens d’ailleurs à les remercier d’emblée au nom du groupe UDI-UC.
Ce que l’on observe à l’échelon des maternités se retrouve-t-il à l’échelon de l’ensemble du système de santé ? Voilà la question ! On peut en effet s’inquiéter de voir nos performances de santé se dégrader relativement à celles des autres pays de l’OCDE.
Au demeurant, le thème de ce débat est aussi le reflet de l’image positive que les Français se font de leur système de santé. C’est ainsi que Jean de Kervasdoué, dans son Carnet de santé de la France 2012, se félicitait d’être français après chaque séjour à l’étranger et de « jouir, de ce seul fait, d’un système d’une telle généreuse qualité ».
Toutefois, la France a-t-elle jamais eu le meilleur système de santé au monde ? C’est aussi la question qu’il faut se poser. Dans l’affirmative, est-il vraiment menacé, voire déjà en déclin ?
Comme premier élément de réponse, je dirai que, si l’état de santé des Français continue de s’améliorer, il progresse moins vite que dans plusieurs autres pays. Le problème viendrait donc moins de la dégradation de notre système que de l’amélioration des performances des autres.
De fait, la France demeure bien classée sur un certain nombre d’indicateurs déterminants : elle se classe au neuvième rang des pays occidentaux pour l’espérance de vie et au troisième rang pour la mortalité par crise cardiaque et accident vasculaire.
De plus, on peut noter que certaines des contre-performances françaises n’ont rien à voir avec la qualité du système de santé puisqu’elles sont directement imputables à notre mode de vie. La France demeure, par exemple, au premier rang pour la consommation d’alcool, et le tabagisme progresse fortement, surtout chez les femmes.
Enfin, juger le système de santé français globalement, c’est faire fi des inégalités socioculturelles et territoriales qui le traversent.
Mais l’exercice est tout de même incontournable. Pour l’accomplir plus avant, il convient de se mettre d’accord sur ce qu’est un bon système de santé et, ensuite, de trouver les données comparatives chiffrées les plus précises.
Je crois qu’un système de santé peut être jugé à l’aune de deux critères. Le premier est le service qu’il rend au patient. Le second est son efficience, c’est-à-dire le rapport entre les moyens engagés et les performances.
Toutefois, les données chiffrées font parfois cruellement défaut, surtout pour disposer d’un benchmarking actualisé. C’est, entre autres raisons, pour cela qu’il nous a fallu commander à la Cour des comptes un rapport sur les maternités.
Cela dit, il semblerait que, du point de vue tant de la qualité médicale du service rendu que de son efficience, notre système de santé bénéficie de substantielles marges d’amélioration.
Ainsi, le dernier rapport du Haut Conseil de la santé publique révèle que la mortalité prématurée des hommes, correspondant aux décès avant soixante-cinq ans, est élevée en France. Cette contre-performance, qui classe notre pays au quatorzième rang sur vingt-six pays de l’Union européenne, s’explique par un autre indicateur alarmant : la France se classe défavorablement pour les cancers, en particulier chez les hommes.
La santé au travail pose aussi problème à en juger par notre mauvais classement en ce qui concerne les accidents au travail.
Qu’en est-il de l’efficience du système, autrement dit du rapport entre ses moyens et ses résultats ? C’est bien simple : la France est le pays européen où la part des dépenses de santé dans le PIB est la plus élevée. Celles-ci représentent 11, 2 % du PIB, près du double d’un pays comme l’Estonie, qui, il est vrai, se situe à l’autre extrémité du classement.
Le problème, c’est que les moyens ne se retrouvent pas là où on les attendrait. Ainsi, en nombre de lits d’hôpitaux disponibles pour 100 000 personnes, la France ne se situe qu’au huitième rang européen, au dix-septième rang pour ce qui est des IRM, au vingtième rang pour les scanners. Pour ce qui est du nombre de médecins en activité et des vaccinations, elle se situe très légèrement au-dessus de la moyenne européenne.
En revanche, la France demeure bien le premier consommateur européen de médicaments. Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a, de longue date, souligné que le poids du médicament dans le PIB était le plus élevé d’Europe.
Le constat n’est pas nouveau : le système de santé français est, juste derrière celui des États-Unis et des Pays-Bas, le plus cher du monde, sans pour autant que le niveau de santé des Français soit à l’aune de ce coût. En effet, je ne vous l’apprends pas, santé et médecine ne sont pas synonymes.
Si les moyens alloués à la santé sont donc bien en décalage avec les résultats, c’est parce que le système souffre d’un certain nombre de dysfonctionnements, qui sont maintenant bien identifiés et que Gilbert Barbier a soulignés. Les réformes successives ont eu pour objet d’y remédier. Je pense en particulier à la création de l’ONDAM, au passage à la tarification à l’activité, à la loi sur le parcours de soins et à la loi HPST. La création des agences régionales de santé, en particulier, a constitué selon moi une avancée notable dans la coordination des moyens.
Mais beaucoup reste à faire. C’est la raison d’être de la prochaine et tant attendue loi de santé, madame la secrétaire d’État. Aura-t-elle les moyens de ses ambitions ?
Sans vouloir déflorer le débat qui nous attend, je constate que certains aspects du projet initial sont encourageants. C’est le cas de toutes les mesures qui tendent à décloisonner le système. Ainsi en est-il de la coordination des parcours de soins complexes, de l’instauration d’un document de liaison entre les services de soins en ville et à l’hôpital, et de la relance du dossier médical personnel. Ces initiatives sont de nature à réduire les actes redondants et inutiles, qui représentent 28 % de l’activité, selon la mission de contrôle et d’évaluation des lois de financement de la sécurité sociale du Sénat, soit une vingtaine de milliards d’économies potentielles. Je retrouve d’ailleurs là, exactement, ce que j’avais proposé en tant que rapporteur général de la commission des affaires sociales au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
S’agissant de l’hôpital, un chantier doit être ouvert d’urgence, qui concerne la carte hospitalière. Le rapport de la Cour des comptes sur les maternités montre bien que sa réforme n’est pas achevée. Il s’agit là d’une question non seulement d’efficience, mais aussi et surtout de sécurité et de qualité du service rendu, car celles-ci tirent aujourd'hui notre système de santé vers le bas.
En matière de médecine ambulatoire, il faut engager une véritable lutte contre la désertification médicale, car les mesures incitatives déjà prises ne l’ont pas fait reculer. Et je n’oublie pas l’accès difficile à certaines spécialités.
Je conclurai en évoquant deux sujets transverses et majeurs : la prévention et la surconsommation de médicaments.
Cela fait maintenant plus de dix ans que la France est censée s’être dotée d’une politique de prévention digne de ce nom. Dans les faits, elle tarde pourtant à faire sentir ses effets. D’où ma question, aussi iconoclaste soit-elle : a-t-on vraiment les moyens de faire de la prévention ou bien celle-ci ne relève-t-elle que d’un vœu pieu ? Il y a au moins un domaine où elle semble possible : celui de l’iatrogénie médicamenteuse.
Cela m’amène au second sujet transverse. Les records que la France bat en matière d’infections iatrogènes sont la conséquence directe de notre culture de la consommation du médicament. Le médicament ne peut plus être considéré comme un produit de consommation courante. La rupture avec cette conception du médicament passe par une éducation du patient et par une rationalisation des prescriptions, voire leur réduction.
Prenons ces directions et peut-être pourrons-nous un jour dire de nouveau que nous avons le meilleur système de santé au monde.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, si la question que nous nous posons aujourd’hui est claire et directe, reconnaissons que la réponse à y apporter n’est pas aussi simple et facile qu’on pourrait le croire.
Nous partons d’un constat indéniable : la France a eu le meilleur système de santé au monde. L’a-t-elle toujours aujourd’hui ? Selon Roger Salomon, qui préside le Haut Conseil de la santé publique, « en matière de santé, la France est aujourd’hui un pays moyen, parfois meilleur que certains, mais pas toujours ».
De son côté, dans son édition 2013 du Panorama de la santé, l’OCDE conclut que le système de santé en France demeure globalement performant et efficace. Tout en ayant engagé des efforts de rationalisation, il continue d’assurer l’une des meilleures prises en charge des coûts de la santé parmi les pays de l’OCDE ; toutefois, il faut noter que la pérennité du système pourrait être menacée par un renouvellement insuffisant de la population médicale.
Pour répondre à la question à l’ordre du jour de notre séance, je pense que nous devons faire une analyse à la fois dans le temps et dans l’espace. La recherche de la qualité fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Pour la mesurer, des normes et des référentiels ont été instaurés. Plus aucun domaine professionnel ne semble y échapper. Mais qu’en est-il de la qualité de notre système de santé ? Toutes les études concordent pour montrer que cette qualité laisse à désirer. Sans aller jusqu’à dire que le choix a sciemment été fait de ne pas dépister l’erreur, il faut s’interroger sur la raison de la persistance de telles insuffisances.
Le soin a toujours été en évolution constante. Cependant, il a connu ces dernières années des changements considérables sur les plans tant technico-économique que spirituel et anthropologique. Les progrès techniques et organisationnels récents l’ont rendu vraiment efficace. Initialement d’essence religieuse, le soin ne se réfère plus aujourd’hui à aucune transcendance. La personne bénéficiaire, pour des raisons médicales ou sociales, était considérée il y a peu comme passive et assistée ; elle est maintenant définie par ses droits et convoquée comme acteur principal du processus de soins.
L’hôpital et les établissements de santé doivent faire face aujourd’hui à de nombreuses mutations, avec des incidences incontournables sur les pratiques des professionnels. Si ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est considérablement accéléré ces dernières années, suscitant au mieux des interrogations, au pis des inquiétudes et des blocages.
Les établissements de soins ont, pendant les Trente Glorieuses, Gilbert Barbier l’a rappelé tout à l’heure, bénéficié d’un développement continu, accentuant leur modernisation et déployant leur plateau technique sans forcément analyser et prendre en considération ce qui est souvent mis en avant par les patients : techniques de plus en plus sophistiquées et invasives, ressenti de déshumanisation, cloisonnement entre services, repli des établissements sur eux-mêmes, morcellement des tâches dû à l’hyperspécialisation.
Depuis quelques années, les pays européens, pour ne prendre que l’exemple de ce qui nous est proche, se trouvent confrontés à la même problématique : ils doivent garantir une offre de soins de qualité, adaptée aux besoins de la population et accessible à tous, dans un contexte de ressources publiques limitées.
L’Europe est à la croisée des chemins, tout au moins en ce qui concerne la politique de santé, que les gouvernements nationaux tiennent fermement dans leurs mains et souhaitent qu’il en reste ainsi. Cette volonté n’est pas surprenante si l’on sait que la santé absorbe désormais environ 10 % du PIB des pays les plus riches. D’ailleurs, de nombreux changements intervenus ces dix dernières années dans les systèmes de santé se sont concentrés sur le resserrement du contrôle économique plutôt que sur la promotion d’une bonne santé. Les ministères des finances ont une forte – oserai-je dire « trop forte » ? – influence sur la politique de santé.
Les différences d’espérance de vie en Europe montrent cependant l’ampleur des enjeux politiques. Nous avons la science et le savoir pour réduire radicalement ce fossé, mais cet effort exige une volonté politique, une organisation et un financement pour engager des actions décisives.
Ainsi, la philosophie du marché qui est au cœur de l’Union européenne aggrave la situation des pays les plus pauvres, au moins à court terme. Ils perdent leurs professionnels de santé qui migrent vers les pays les plus riches pour occuper des postes mieux payés.
Les interventions en santé les plus efficientes, telles que le changement de style de vie, requièrent des investissements de long terme dans d’autres secteurs économiques que ceux de la santé. L’OCDE attribue d’ailleurs la faible espérance de vie dans les pays les plus pauvres à une mortalité plus élevée due à l’appareil circulatoire ou aux cirrhoses, qui reflète des styles de vie caractérisés par l’abus de tabac et la consommation d’alcool. Il faut y ajouter un taux de suicide masculin très élevé.
Le dilemme politique tient à ce que les dépenses de santé ne baissent pas, quand bien même les investissements pour promouvoir de meilleurs modes de vie réussissent et que les citoyens vivent plus vieux. Il reste toujours d’autres années de vie en bonne santé à gagner et des progrès en qualité de vie que les citoyens en meilleure santé sont en droit d’attendre.
En France, comme dans de nombreux pays européens, dans le domaine de la santé, le marché opère de façon imparfaite. Il est généralement adapté pour assurer l’efficience des services de chirurgie programmée, mais beaucoup moins pour fournir des soins d’urgence ou des soins de longue durée pour des patients chroniques. Cet écart risque d’être encore plus marqué avec les transferts de services publics à des prestataires privés, à but lucratif ou non.
Les coûts à court terme et les gains d’efficience peuvent être équilibrés ou moindres, du fait des difficultés induites pour les hôpitaux du secteur public qui se retrouvent à devoir traiter les cas les plus complexes et les urgences.
Le coût des médicaments, que Jean-Marie Vanlerenberghe a évoqué, reste aussi un sujet clé de discussion, alors que la part des médicaments dans les dépenses de santé continue de croître. Si une réponse a consisté à persuader les prescripteurs de se tourner vers le générique, traditionnellement moins cher, l’industrie pharmaceutique affirme que ses coûts sont élevés du fait d’énormes investissements de développement.
En dépit du manque d’enthousiasme pour une politique de santé radicale, il faudra bien se montrer plus offensif en matière de santé publique, par la promotion de modes de vie plus respectueux de la santé, par la prévention et par la protection de la santé des citoyens.
Pour en revenir plus précisément au système de santé français et à son évolution, il me semble essentiel de noter que, si les Français bénéficient d’une des meilleures couvertures maladie au monde, le monde du soin doit, pour rester performant, s’adapter à la nouvelle donne démographique, technique, économique et même spirituelle. Il doit se situer à l’articulation entre le privé et le public, car il touche à l’intime, mais, en même temps, il est pris en charge par la société. Ce défi concerne ainsi les pouvoirs publics, les médias, les associations et les citoyens que nous sommes tous.
La qualité ne se décrète pas, …

… mais elle se mesure – vous le savez bien, madame la secrétaire d’État, puisque vous êtes médecin. Elle est par ailleurs intimement liée à l’évaluation, à toutes les évaluations – celle des outils, celle des traitements et de leur incidence sur l’espérance de vie –, mais la première des évaluations porte d’abord sur les performances des individus et sur celles des structures. C’est d’ailleurs à ce titre que la Haute Autorité de santé avait retenu la mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles, l’EPP, comme un élément majeur de la modernisation du système de santé.
Mes chers collègues, personne n’échappe au débat sur la santé. En France, la maîtrise des coûts du système de santé est désormais un débat récurrent.
La France dépense beaucoup pour sa santé, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ces investissements, a-t-on coutume de dire. Le Haut Conseil de la santé publique relativise cette position. Certes, la part du PIB allouée à la santé en France est élevée, proche toutefois de celle de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique, mais un autre classement stigmatise moins notre pays : les dépenses de santé par habitant, exprimées en parité de pouvoir d’achat, situent la France en sixième position, après le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande et l’Allemagne.
Pourtant, comme la majorité des pays de l’OCDE, la France a adopté une politique de limitation des dépenses, en raison du contexte économique difficile que traverse la majorité des pays dans le monde. Cependant, les dépenses de couverture de santé françaises sont toujours parmi les plus élevées proportionnellement au PIB. La France se situe ainsi au troisième rang des dépenses les plus élevées, derrière les États-Unis et les Pays-Bas.
Une étude qui compare notre pays aux autres pays de l’Union européenne quant à l’état de santé de la population et à l’efficacité du système de santé a été réalisée à partir des indicateurs de santé définis par la Commission européenne et destinés à établir une cohérence dans les données statistiques à l’échelle communautaire.
Ces indicateurs sont établis à partir des éléments fournis par les bases de données internationales et celles d’agences spécialisées dans le cas de thématiques spécifiques. Certes, ils sont clairement définis au niveau de la Communauté européenne, mais comme le rappelle le Haut Conseil de la santé publique, les systèmes d’information qui permettent de les renseigner dans chacun des États ne sont qu’en partie harmonisés.
Par ailleurs, une fréquence plus importante de telle ou telle pathologie peut révéler non pas une situation défavorable, mais au contraire une organisation du dépistage de cette pathologie particulièrement efficace ; d’où la prudence et la vigilance dans l’analyse que recommande le Haut Conseil.
Il n’en demeure pas moins que les conclusions qu’en tirent ces sages sont particulièrement intéressantes. Elles peuvent être classées en deux catégories : les atouts, d’une part, et les faiblesses, d’autre part. Vous me permettrez de les rappeler.
Les atouts de la France sont les suivants : l’espérance de vie des Françaises est la plus élevée ; le taux de natalité est excellent ; des progrès constants et importants ont été réalisés en matière de sécurité routière, même si les chiffres de 2014 sont venus relativiser cette performance ; la mortalité cardio-vasculaire est particulièrement basse par rapport aux autres pays de l’OCDE ; enfin, les hospitalisations sont « courtes ».
Pour ce qui est de nos faiblesses, il faut relever une mortalité périnatale très élevée – la commission des affaires sociales s’est penchée sur ce sujet la semaine dernière –, une mortalité prématurée élevée, le problème constant du tabac, de l’alcool et des drogues, le suicide, qui reste un fléau national, et une fréquence élevée des cancers.
Ces atouts et ces faiblesses montrent quelles doivent être les priorités en termes de santé publique, priorités que l’on aimerait voir clairement et explicitement exprimées avec, en regard, des plans d’action cohérents entre eux. Il faut, là aussi, une vision d’ensemble, qui n’existe pas aujourd’hui, dans le fatras des plans, actions et programmes de santé publique déroulés depuis des dizaines d’années par les différents gouvernements – voire par les différents Présidents de la République –, avec bien souvent un souci plus d’affichage que d’efficacité.
Je ne saurais conclure mon propos sans vous rappeler que, dans quelques jours, nous serons amenés à débattre dans cet hémicycle du projet de loi relatif à la santé. Je n’entends pas intervenir dès à présent sur ce texte qui affiche des objectifs très généraux, trop généraux : comment rassembler tous les acteurs concernés dans une stratégie commune, renforcer la prévention et l’efficacité des politiques publiques, et garantir la pérennité du système de santé ? De tels objectifs semblent pouvoir être approuvés par tous.
Cependant, n’oublions pas qu’une loi dont l’ambition est la « refondation » de la politique de santé a des conséquences directes sur son financement, qui est assuré pour les trois quarts par les caisses d’assurance maladie.
Ce texte, qui cristallise les tensions des professionnels de santé – le monde médical n’a pas connu pareille mobilisation depuis 2009 – porte sur une reprise en main par l’État et son administration de la gouvernance de l’ensemble du système de santé, y compris de la médecine de ville et des médecins libéraux.
Il me semble nécessaire, afin de ne pas pénaliser davantage notre système de soins, d’engager une réflexion pour donner aux médecins généralistes, aux médecins traitants et aux soignants toute leur place dans notre système de soins et améliorer le parcours des patients en ville.
Mes chers collègues, pour conclure mon propos, je voudrais citer Frédéric Bizard, qui précisait dans un récent article : « Comme pour les autres pays développés, le modèle de santé français est le reflet de notre histoire. C’est à partir de nos valeurs que notre système s’est construit. Ce socle est incontestablement dominé par la liberté, de laquelle dépend l’égalité. C’est ainsi que chaque citoyen est libre de se soigner ou de ne pas se soigner, sous réserve qu’il n’altère pas la liberté des autres. […] Ainsi chaque citoyen est libre du choix de son médecin, à lui de s’assurer qu’il soit de qualité. Aucun autre pays développé n’offre ce degré de liberté en rapport avec sa santé. »
Tâchons de garder cette liberté !
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC, ainsi que sur les travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très heureuse de participer aujourd’hui à ce débat, car je crois que notre système de santé est à la croisée des chemins. Ce débat est donc essentiel.
Selon les organismes internationaux, notre système de santé est l’un des plus performants. Par exemple, pour l’OMS, la France a le meilleur système de santé dans le monde. Les Français vivent de plus en plus longtemps – 85 ans pour les femmes, et 78 ans pour les hommes –, …

… malgré une alimentation très riche, à laquelle s’ajoute parfois par une forte consommation d’alcool et de tabac.
L’OCDE a publié également en 2013 son panorama de la santé. Selon ce dernier, le système de santé en France demeure performant et efficace. En effet, il continue d’assurer l’une des meilleures prises en charge des coûts de santé de la population parmi les pays de l’OCDE. Toutefois, toujours selon l’OCDE, la pérennité de notre système pourrait être menacée par un renouvellement insuffisant de la population médicale.
Si 90 % des Français pensent que notre système de santé offre des soins de qualité, 39 % d’entre eux avouent, malheureusement, avoir déjà renoncé à des soins en raison de leur coût. Les Français pensent que notre système de santé doit être amélioré afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la population.
Entre le nombre de personnes renonçant à se soigner par manque de moyens et les inégalités socioprofessionnelles dans l’accès aux traitements, le système français semble être en perte de vitesse. Nous sommes confrontés à un véritable paradoxe : notre système de santé est considéré comme l’un des plus performants, mais notre pays est, Europe de l’Ouest, celui où les inégalités sociales et territoriales sur le plan de la santé sont les plus marquées.
Ces inégalités, auxquelles il faudra apporter des réponses, revêtent plusieurs aspects.
Tout d’abord, l’offre de soins est répartie de façon inégalitaire sur l’ensemble du territoire français, notamment si l’on considère le temps d’accès à un généraliste : globalement, il s’allonge dans les zones rurales, les professionnels se concentrant dans les zones urbaines. Du reste, les déserts médicaux se multiplient, à la campagne mais aussi dans les banlieues.
Dépassements d’honoraires, allongement des listes d’attente, difficulté de trouver un médecin le soir ou le week-end : tel est le quotidien des Français. Bien entendu, les dépassements d’honoraires constituent un obstacle important à l’accès aux soins.
Nous observons également de larges inégalités en matière de santé et de mortalité, inégalités qui, malheureusement, ne font que s’accroître. La France est le pays où les inégalités en matière de santé sont les plus fortes entre les sexes, les catégories sociales et les zones géographiques. Les plus instruits, les membres des professions les plus qualifiées et les ménages les plus aisés bénéficient d’une espérance de vie plus longue et se trouvent en meilleure santé. Les patients issus de milieux favorisés ont 1, 5 à 2 fois plus de chances de guérir que les autres. De même, le taux de prématurité varie du simple au triple en fonction du niveau scolaire de la mère.
Les inégalités apparaissent précocement puisque, dès l’école, on détecte des différences dans la prise en charge des troubles de la vue, des caries dentaires et dans l’apparition du surpoids.
Les inégalités en matière de mortalité selon la catégorie sociale placent également la France en situation peu favorable par rapport à d’autres pays européens comparables. Par exemple, l’espérance de vie d’un ouvrier de 35 ans est inférieure de sept ans à celle d’un cadre.
Selon un rapport de la DREES – direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques –, si l’état de santé des Français apparaît globalement bon, le taux de mortalité prématurée, c’est-à-dire avant 65 ans, reste l’un des plus élevés de l’Union européenne.
Toutes ces inégalités peuvent s’expliquer par une politique de santé principalement axée sur la performance médicale plutôt que sur la promotion de la santé. Notre pays obtient de très bons résultats dans certains domaines – maladies cardiovasculaires, espérance de vie aux âges élevés – mais, comparé à de nombreux pays, il obtient de mauvais chiffres en termes de mortalité prématurée, notamment en raison du manque de prévention et de dépistage.
Ainsi, la politique sanitaire en France demeure, malheureusement, encore trop axée sur le curatif.
Face à toutes ces inégalités, la prévention peut jouer un rôle important. Elle doit devenir une priorité en matière de santé publique.
Par ailleurs, la crise économique que nous connaissons actuellement renforce la nécessité de réfléchir sur ces inégalités et commande la mise en place de politiques publiques permettant de garantir à l’ensemble de la population une certaine égalité en matière de santé.
Telle catégorie de population ne doit pas être, plus qu’une autre, victime de certaines affections, et c’est là tout le rôle de l’éducation sanitaire. De plus, celle-ci serait source d’économies.
Selon les estimations des scientifiques, nous pouvons craindre pour les prochaines années, par exemple, une hausse des maladies chroniques telles que les cancers, le diabète, l’obésité ou les maladies cardiovasculaires. La Fédération internationale du diabète annonce une augmentation de 55 % du nombre de diabétiques en France d’ici à 2025. Une politique de prévention adaptée, menée sur le long terme, permettrait de faire des économies en anticipant sur ces évolutions.
Bien souvent, ces maladies sont devenues la cause de décès prématurés avant 65 ans. Les deux tiers, environ, de ces décès prématurés seraient évitables par une action préventive efficace. Aujourd’hui, certains facteurs de risque sont bien identifiés : tabac, nutrition, alcool, expositions professionnelles, environnement, produits illicites On peut donc mieux appréhender et agir sur ces risques.
La promotion de la santé implique d’intervenir sur l’ensemble des éléments déterminants à cet égard : les conditions de vie, les facteurs héréditaires et les comportements personnels, l’environnement économique, social et culturel.
Les politiques de santé doivent être menées en intelligence avec les autres politiques publiques.
La prévention mérite de devenir une priorité en matière de santé publique. À cet égard, je me réjouis qu’elle fasse l’objet d’un grand volet spécifique dans le projet de loi de santé que nous présentera prochainement Mme la ministre de la santé. Nous devons en effet développer une véritable culture de la santé, en faisant comprendre que celle-ci se bâtit progressivement tout au long de la vie.
Je souhaiterais maintenant évoquer la situation des maternités dans notre pays.
Aujourd’hui, la sécurité des naissances demeure imparfaite dans un certain nombre de situations. En effet, les décrets de 1998, seize ans après leur parution, ne sont pas pleinement respectés.

Ils ne sont pas mis en œuvre dans toutes leurs dimensions.
L’étude de la Cour des comptes met en évidence des insuffisances qui appellent un effort de planification. Nous observons des problèmes d’effectifs. Alors que la démographie des professionnels de la périnatalité est plus élevée que jamais, on relève, paradoxalement, des inégalités territoriales très prononcées, que les évolutions démographiques à venir dans les professions concernées pourraient encore creuser. Il est à craindre que certains établissements, dans certains territoires – territoires ruraux isolés ou territoires urbains concentrant des populations défavorisées – ne s’en trouvent encore fragilisés.
Par ailleurs, la sécurité des prises en charge doit être améliorée. Les décrets de 1998 sont très prescriptifs quant à la sécurité des locaux dans le secteur de la naissance. Or, dans certains établissements, cette sécurité n’est pas toujours garantie. Les décrets de 1998 doivent donc être davantage respectés, car il s’agit d’un enjeu de santé publique important.
Avant de conclure, je veux aborder le sujet des médicaments.
Le déficit de plus en plus important et récurrent de l’assurance maladie est source d’inquiétudes. Or, selon une étude, les génériques coûtent 30% plus cher en France que dans les autres pays européens, avec des pics à 100% pour des antihypertenseurs, pour des antibiotiques ou des produits destinés à traiter des maladies de la prostate. Il faut mettre fin à une telle situation !
Notre système est régulièrement jugé complexe et opaque. En juin dernier, quinze pays se sont adressés à l’industrie pharmaceutique, avec le soutien de la Commission européenne. Dans cette déclaration commune, les signataires, dont la France, affirment que les coûts de ces traitements « sont extrêmement élevés et insoutenables pour les budgets de santé ». Ils demandent aux laboratoires un « compromis adéquat » entre leurs gains et l’accès aux soins.
Il faut une politique européenne commune du médicament.
L’industrie pharmaceutique se défend en justifiant ses marges bénéficiaires par le réinvestissement dans la recherche… Difficile à croire quand moins de 15 % du chiffre d’affaires des laboratoires est réinvesti dans la recherche et le développement et que 20 % à 25 % de ce même chiffre d’affaires est consacré au marketing et à la publicité !
S’agissant du prix des médicaments, la transparence doit être exemplaire et nous avons besoin d’une véritable politique de régulation.
J’ajouterai que nous devons trouver des solutions au problème de rupture de stock de médicaments. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, a dénombré, entre septembre 2012 et octobre 2013, 324 cas de rupture d’approvisionnement et 103 risques de rupture. La France doit alors s’adresser aux usines délocalisées en Inde ou en Chine. Le moindre problème dans la chaîne de production entraîne un retard considérable.
Cette difficulté est accentuée lorsque les laboratoires pharmaceutiques détiennent le monopole d’exploitation. Cette dépendance envers l’industrie pharmaceutique mondiale est d’autant plus inquiétante qu’elle ne fait que s’accentuer. Si 80 % de ces produits étaient fabriqués au sein de l’Union européenne il y a près de trente ans, ce taux a chuté aujourd’hui environ de moitié, ce qui a pour conséquence de compliquer considérablement le contrôle des différents sites et la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production du médicament.
Cette situation est inquiétante, alarmante, et nous devons trouver des réponses.
En conclusion, je dirai que, si notre système de santé est encore très performant, nous devons absolument, pour qu’il le reste, réduire les inégalités sociales, améliorer l’accès aux soins, promouvoir davantage la prévention et réguler le prix des médicaments. Le projet de loi du Gouvernement est donc très attendu, madame la secrétaire d’État.
Notre système de santé est à la croisée des chemins pour et nous devons l’améliorer afin de préparer notre avenir ! §

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier le groupe RDSE d’avoir pris l’initiative de ce débat, qui nous permet de préparer l’examen du projet de loi de santé, dont nous serons saisis dans quelques mois.
Ce débat nous amène également à lever le nez de notre « guidon franco-français » en nous adonnant à la comparaison avec les systèmes de santé d’autres pays.
Avant toute chose, le groupe écologiste du Sénat souhaite saluer la compétence, l’excellence et le dévouement des nombreuses équipes de professionnels de santé qui, parfois dans des conditions très difficiles et quoi qu’on en dise, font vivre dans notre pays un système de grande qualité.
Notre système de santé a été qualifié par l’OMS, dans son rapport sur la santé dans le monde de 2000, comme le plus performant au monde en termes de dispensation et d’organisation des soins de santé. Pour autant, cela ne veut pas dire que tout est acquis. D’ailleurs, ce classement aura bientôt quinze ans et la situation a évolué depuis, chez nous comme ailleurs dans le monde.
Pour aller à l’essentiel dans les six minutes qui me sont imparties, je mettrai l’accent, au nom du groupe écologiste, sur deux points, ce qui me conduira évidemment à passer sous silence de nombreux sujets importants qui sont évoqués ce matin.
Tout d’abord, nous souhaitons à nouveau insister sur les très grandes inégalités d’accès aux soins qui existent encore aujourd’hui en France. Je sais que le Gouvernement y est sensible. En 2013, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, m’avait d’ailleurs confié une mission sur l’accès aux soins des plus démunis, et je note que la ministre des affaires sociales et de la santé s’est très clairement engagée sur l’une des propositions que je faisais, avec d’autres : la généralisation du tiers payant intégral.
Je veux donc saluer sa détermination sur ce point, d’autant que je sais combien les conservatismes sont parfois pesants en la matière. J’espère que ses efforts pour les dépasser aboutiront et qu’une solution consensuelle sera trouvée afin que les médecins de bonne foi, qui ne sont pas idéologiquement opposés au tiers payant – et ils sont nombreux –, mais qui craignent la lourdeur administrative, puissent être rassurés.
J’espère tout autant que le combat pour l’accès aux soins et à la santé des personnes modestes et démunies ne s’arrêtera pas à cette mesure et que la mise en œuvre d’autres de mes propositions sera rapidement envisagée pour simplifier l’accès aux droits, lutter contre le non-recours, endiguer les dépassements d’honoraires ou encore soutenir véritablement les structures tournées vers les populations fragiles.
Comment peut-on accepter que des mesures de simplification soient prises dans tous les domaines par le Gouvernement – et c’est une bonne chose – mais pas dans celui de l’accès aux droits des plus démunis ? Je donnerai un seul exemple : comment accepter que 30 % des bénéficiaires du RSA-socle – en Île-de-France, le chiffre frôle les 40 % ! – ne parviennent pas à faire aboutir leur dossier d’ouverture de droits à la CMU complémentaire, alors que c’est la loi, puisque les plafonds sont identiques ?
Le second point sur lequel mes collègues et moi-même souhaitons insister est celui de la santé environnementale. Dans ce domaine, il nous semble que la France pourrait également se positionner à l’avant-garde.
Le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, agence de l’OMS, a encore rappelé la semaine dernière que la moitié des cancers pourraient être évités.
Plus largement, lorsqu’on sait le fléau que constitue l’épidémie de maladies chroniques aujourd’hui en France –diabète, cancer, etc. –, lorsqu’on sait à quel point ces maladies pèsent sur nos finances publiques, on comprend mal que la santé environnementale ne soit pas encore devenue une priorité !
Cela est d’autant plus incompréhensible que nous sommes souvent tous d’accord sur les constats. Le débat qui a eu lieu en novembre dernier à l’occasion d’une proposition de loi sur le diesel et les particules fines cancérogènes a montré que nous nous accordions à peu près sur le constat. Malheureusement, les actes tardent en la matière !
Certes, depuis le 1er janvier 2015, le bisphénol A est interdit dans tous les contenants alimentaires. Mais combien de temps faudra-t-il attendre encore pour que l’interdiction soit étendue aux autres perturbateurs endocriniens, qui mettent quotidiennement en danger notre santé par leur omniprésence dans notre environnement et par leurs interactions ?
D’une manière générale, il faudrait réfléchir à tout ce qui concerne les pesticides, les nanomatériaux, les résidus de médicaments dans les milieux et autres produits présents dans l’environnement et susceptibles d’affecter la santé. Il nous paraît urgent, et même indispensable, de prendre des décisions en la matière.
Nous espérons pouvoir, à l’occasion du prochain examen du projet de loi relatif à la santé, débattre avec le Gouvernement ainsi qu’avec vous, mes chers collègues, d’un rééquilibrage en faveur de la santé environnementale.
Ce rééquilibrage pourrait passer par un renforcement des moyens des observatoires régionaux de la santé, par l’élargissement de leurs missions en matière de santé environnementale, comprenant notamment le suivi épidémiologique des populations, ainsi que par un accès de toutes et tous à un dépistage gratuit des niveaux d’imprégnation par les toxiques dans le cadre de la santé au travail et des bilans de santé aux différents âges.
Nous regrettons le dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle modifiant la Charte de l’environnement en vue de supprimer le principe de précaution. Nous proposons l’application de ce principe de précaution dans le domaine de la santé via, notamment, une évaluation systématique des impacts sanitaires et environnementaux des politiques publiques et projets de recherche technologique.
Bien d’autres sujets pourraient être abordés, qu’il s’agisse du renforcement de la prévention, de la régulation du prix des médicaments et, plus généralement, de la nécessité absolue de séparer les décisions publiques en matière de santé des pressions exercées par les détenteurs d’intérêts économiques. Si nous traitons ces sujets comme il convient, nous pourrons réaliser d’importantes économies pour les finances publiques.
Nous espérons pouvoir mettre en place, à l’occasion de l’examen du projet de loi de santé, des solutions conjuguant volontarisme politique, pédagogie, éducation populaire et prévention.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Laurence Cohen applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que la France ait disposé et dispose encore d’un bon système de santé, c’est indéniable. Est-il encore le meilleur au monde ? C’est moins sûr...
Le débat de ce matin permettra-t-il, au travers de quelques interventions, de répondre à cette question ? Le défi est de taille, cher Gilbert Barbier, chers collègues du RDSE !
En raison de la situation des comptes sociaux, la question qui se pose à nous est la suivante : comment continuer à assurer aux Français une médecine de qualité, leur garantissant un égal accès aux soins et les traitements les mieux adaptés à leurs pathologies ?
Je souhaite féliciter, à cet égard, le président de la commission des affaires sociales, Alain Milon, pour la qualité de son analyse de notre système de santé.
Notre médecine est fondée depuis longtemps sur le curatif, parfois au détriment du préventif. La médecine se trouve déjà confrontée – et ce sera encore plus vrai demain – à de nombreux défis. Je souhaiterais m’attarder aujourd'hui sur deux d’entre eux, pour nourrir la réflexion.
Le premier défi est celui de la médecine personnalisée. Le sujet a été fort bien traité dans le rapport nos collègues députés Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, fait au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques – OPECST –, paru il y a un an et intitulé : « Les progrès de la génétique, vers une médecine de précision ? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée. »
On le sait, cette médecine personnalisée, même si la définition n’en est pas simple et peut parfois susciter de fausses espérances, bouleverse l’approche classique de la médecine. En effet, la classification en fonction de données génétiques ou moléculaires, en oncologie, notamment, mais aussi dans certaines maladies chroniques, infectieuses ou rares, aura sans aucun doute un impact majeur en termes économiques et bouleversera notre système de santé, qui est par définition solidaire. C’est d’ailleurs l’objet d’un volet du troisième plan cancer.
Cette médecine pose le problème de la recherche française et des moyens qui lui sont alloués. Il ne faudrait pas que, dans ce domaine spécifique, notre pays décroche par rapport à d’autres.
Elle nécessite une évolution dans la formation des personnels de santé. Une réforme des études est nécessaire car, dans de nombreux rapports portant sur des sujets variés et spécifiques, sont souvent pointés des manques en termes de formation, notamment un nombre d’heures dispensées très faible ou nul.

Je renvoie, à cet égard, à la lecture du rapport de notre collègue Jacques Mézard, fait au nom de la commission d’enquête sur les mouvements à caractère sectaire et intitulé « Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger ».
Cette médecine va requérir des adaptations de procédures pour pouvoir disposer de médicaments à un coût moindre.
Enfin, afin d’assurer un égal accès de tous nos concitoyens aux nouvelles thérapies possibles, l’OPECST propose dans son rapport de placer le patient au cœur du dispositif de soins, de lutter contre les discriminations et les inégalités territoriales, d’encadrer la médico-surveillance par voie de télémédecine et d’intégrer les associations de malades en tant que partenaires à tous les niveaux de la chaîne de santé, du diagnostic au prix du médicament.
Ces dernières propositions me permettent de faire la transition avec le deuxième défi que notre pays doit relever en matière de santé, celui de la maladie chronique.
Sur près de 15 millions de patients chroniques, près de 10 millions souffrent d’affections de longue durée – ALD. On estime aujourd’hui le coût des ALD à plus de 65 milliards d’euros par an. Ces 15 % d’assurés sociaux représentent 60 % des remboursements et sont responsables, pour l’essentiel, de la hausse des dépenses de santé.
Souvent complexe, la maladie chronique associe plusieurs facteurs de comorbidité dans le temps. De ce fait, elle nécessite une prise en charge spécifique, pluriprofessionnelle et à long terme.
La question se pose de la capacité des soignants à s’organiser et à travailler en réseau. Cette collaboration entre médecins et autres professionnels de soins n’était pas si naturelle au départ, mais elle se développe.
L’installation des professionnels dans les maisons de santé, soutenues pour nos collectivités locales et de plus en plus nombreuses dans nos territoires, y concourt. La délégation de tâches participe de la même volonté. Je rappelle, à cette occasion, l’excellent rapport de nos collègues Alain Milon et Catherine Génisson, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur ce thème de la coopération entre professionnels de santé.
La prise en charge de la maladie chronique ne doit pas éluder la dimension médico-économique. Pour ce faire, elle doit se fonder sur l’universalité de l’accès aux soins, bien sûr, mais aussi impliquer au maximum le patient dans cette prise en charge de sa maladie.
L’éducation thérapeutique du patient doit être développée. Des services la pratiquent déjà. Il ne suffit plus d’informer le patient, il faut favoriser son autonomie et le sensibiliser à l’observance du traitement. Il s’agit d’un processus permanent, tout au long du processus de soins, et intégré dans les soins.
L’éducation thérapeutique s’adresse aux patients souffrant d’une maladie chronique potentiellement grave, évolutive, dans le cadre de laquelle une bonne prise en charge ou une autosurveillance apporte un bénéfice. Le programme éducatif est donc personnalisé.
Des expérimentations sont en cours en matière d’insuffisance cardiaque, par exemple. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie du malade, d’éviter des rechutes ou des réhospitalisations, toujours coûteuses. Au-delà du bénéfice pour le patient, ce qui est bien évidemment un objectif majeur, l’impact positif sur les comptes sociaux est réel.
En matière de maladie chronique, un télésuivi est également un bon outil en termes de surveillance. S’il représente un coût immédiat, le bénéfice à plus long terme est certain.
Toutefois, des blocages réglementaires existent ; certes, la loi HPST a permis des procédures d’expérimentation dans le cadre des agences régionales de santé, mais nos processus de validation sont stricts, souvent à juste titre. Nous devons cependant être plus innovants pour ne pas rester en retrait dans le domaine de la médecine connectée.
Madame la secrétaire d’État, nous attendons avec impatience le projet de loi de santé. Nous serons attentifs aux propositions faites dans ces domaines plus innovants de la médecine connectée, de la médecine personnalisée et sur la place de la démocratie sanitaire. Répondre à ces défis sans creuser les déficits passera forcément par la définition de priorités, et il ne faudra pas hésiter à le faire sans tabou. Cela passera suppose des choix politiques.
Un débat passionnant nous attend dans quelques mois. Vous pouvez compter sur une implication totale du groupe UMP. §

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la France dispose d’un bon système de santé ; encore faut-il que nos concitoyens puissent y accéder, et donc en bénéficier, quels que soient leurs moyens financiers ou leur situation géographique.
Rappelons que la nation, aux termes de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
Cependant, on constate qu’un certain nombre de nos concitoyens éprouvent des difficultés à accéder aux soins, du fait de leur lieu d’habitation. Ce phénomène n’est pas dû à une pénurie de médecins : la France dispose de suffisamment de médecins, bien qu’il faille nuancer cette affirmation pour certaines spécialités médicales.
Selon l’Atlas de la démographie médicale, au 1er janvier 2014, la France comptait 276 354 médecins, toutes spécialités confondues, soit 1, 6 % de plus qu’en 2013. Cela représente 334 médecins pour 100 000 habitants, ce qui situe notre pays à un bon niveau dans le monde occidental.
Actuellement, 90 630 médecins généralistes sont en activité régulière. Cependant, depuis 2007, le nombre de médecins généralistes est en diminution de 6, 5 %, et cette baisse risque de se poursuivre. En effet, seuls 9, 4 % des étudiants en médecine choisissent d’exercer en médecine générale. Cette population vieillit. Les médecins âgés de plus de 60 ans, susceptibles de partir à la retraite d’ici à 2020, donc dans les cinq ans qui viennent, ne représentent pas moins d’un quart des effectifs.
L’exercice de cette profession a connu des évolutions.
On l’a dit, la profession s’est fortement féminisée. Un grand nombre de médecins travaillent à temps partiel. Les professionnels de la santé souhaitent pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ils ne veulent plus, comme leurs aînés, travailler jour et nuit, sillonner la campagne par tous les temps pour se rendre au chevet de leurs malades. Enfin, les jeunes médecins sont moins séduits par la médecine générale et s’orientent vers d’autres spécialités.
Il convient donc, dans un premier temps, de se poser des questions concernant le numerus clausus, s’agissant notamment des spécialités touchées par une forte baisse du nombre de praticiens.
De plus, certains jeunes peuvent être effrayés à l’idée d’exercer seuls en zone rurale, loin d’un centre hospitalier.
La difficulté d’accès des usagers aux soins médicaux est avant tout due à une répartition inégale des médecins sur l’ensemble du territoire. Certains territoires sont ainsi devenus de véritables déserts médicaux.
Toutefois, la définition de ces zones n’est pas aussi aisée qu’il y paraît : elle dépasse les distinctions entre zone rurale et zone urbaine, nord et sud. Par exemple, l’accès à certains médecins spécialistes peut s’avérer aussi difficile en zone urbaine qu’en zone rurale.
Le droit d’accès aux soins doit être concilié avec une liberté qui nous apparaît comme fondamentale, la liberté d’installation des médecins. Celle-ci constitue l’essence même de cette profession et nous tenons à la préserver.
L’expérience a montré que les mesures coercitives ne permettaient pas d’atteindre le but escompté et ne réglait pas le problème des déserts médicaux. Celui-ci ne pourra pas être résolu en imposant aux médecins de s’installer contre leur gré dans une zone donnée. Sans remettre en cause cette liberté d’installation, ce sont les modes d’exercice de la profession qui doivent être modifiés.
Il n’y a pas de solution miracle, mais, compte tenu de l’évolution de la démographie médicale, nous sommes tenus d’agir. C’est d’autant plus vrai que la population française s’accroît et vieillit, ce qui entraîne une augmentation de la demande de soins.
Les élus locaux que nous sommes savent combien la présence de médecins dans nos communes est un élément d’attractivité essentiel et que le service de santé figure en tête des services plébiscités par nos concitoyens.
Quelles sont les marges de manœuvre qui s’offrent aux élus locaux ?
Les solutions à préconiser diffèrent d’un territoire à un autre. Elles ne peuvent être mises en place qu’en concertation avec les professionnels de santé. Les élus locaux se doivent de les accompagner, de créer sur leur territoire les conditions favorables à l’installation de jeunes médecins. Cela passe, selon moi, par la création de maisons de santé, de pôles de santé, et par le développement des dispositifs de télémédecine.
Les maisons de santé offrent plusieurs avantages.
Tout d’abord, elles permettent aux praticiens qui n’entendent plus travailler de manière isolée et harassante d’exercer au sein d’un groupe de professionnels, qui définissent en commun un projet de santé et décident des modalités d’exercice.
Ensuite, du point de vue des autorités sanitaires, ces structures pluridisciplinaires favorisent l’accès aux soins puisqu’elles permettent une plus large amplitude horaire.
De plus, les médecins devant pratiquer des tarifs conventionnels, elles offrent aux patients un service plus accessible sur le plan financier.
Les maisons de santé sont, en outre, un gage de qualité des soins, car elles favorisent une meilleure coordination des différents soignants pour un même patient.
Elles représentent aussi un moyen d’inciter les soignants à venir exercer dans des territoires défavorisés.
À cet égard, rappelons que l’article 88 du code de déontologie médicale prévoit la possibilité pour un médecin, dans une situation de désertification médicale, de s’adjoindre le concours d’un étudiant en médecine. Cette pratique doit être soutenue, car, souvent, les jeunes médecins ainsi recrutés bénéficient du savoir-faire de médecins aguerris. Cette expérience leur permet de dépasser les préjugés qu’ils pourraient avoir et les incite à rester dans ces territoires.
Je connais particulièrement bien le principe des maisons de santé puisque je vais avoir le plaisir d’inaugurer, dans quelques semaines, un établissement de ce type dans ma commune de Moncoutant. Je vous invite d’ailleurs à vous joindre à nous à cette occasion, madame la secrétaire d’État.
Cette maison de santé regroupera treize professionnels de santé, dont quatre médecins généralistes et deux dentistes. Cette réalisation est née de l’initiative des professionnels de santé eux-mêmes, qui souhaitaient anticiper le départ à la retraite de deux médecins généralistes. Il leur a fallu près de six ans pour mener à bien leur projet. Celui-ci n’aurait pu aboutir sans l’implication forte de l’État, par le biais de l’agence régionale de santé, et de l’ordre des médecins.
Il faut encourager de telles initiatives. Toutefois, leur concrétisation suppose des démarches administratives souvent complexes, notamment lorsque l’on entend bénéficier de fonds européens ; les délais d’instruction sont parfois trop longs au regard de la mobilisation des médecins.
Comment expliquer à un professionnel qui a besoin de s’installer rapidement qu’il faut six ans pour mener un projet à son terme ? Le décalage est grand entre la demande des professionnels et la capacité des pouvoirs publics à se mobiliser. C’est pourquoi je ne peux qu’inviter le Gouvernement à simplifier les démarches administratives pour la réalisation de ces équipements et à développer les procédures de coordination entre les différents acteurs et les financeurs.
Les solutions peuvent être apportées par les professionnels de santé, mais aussi par les pouvoirs publics, à travers des projets novateurs répondant à la pratique moderne de la médecine. §
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à saluer l’initiative du groupe du RDSE et à vous remercier, les uns et les autres, d’avoir suivi ce débat, témoignant ainsi de votre attachement, qui est aussi celui de nos concitoyens, à notre système de santé. Les interventions, d’une grande qualité, ont permis d’en souligner les atouts et d’explorer des pistes d’amélioration.
Notre système de santé, ce sont des professionnels qualifiés et engagés au service de la population, médecins généralistes ou spécialistes de ville, qui reçoivent quotidiennement des dizaines de milliers de patients. Ce sont également des médicaments performants, sécurisés et distribués par un réseau dense d’officines de pharmacie, y compris dans les zones les plus rurales. Ce sont enfin des établissements de santé, des hôpitaux publics répartis dans toute la France, qui déploient une offre de soins diversifiée, grâce à des professionnels engagés dans leur mission au service de tous.
Je profite d’ailleurs de ce débat pour saluer l’ensemble des professionnels français qui participent à la lutte contre le virus Ebola, en France ou en Afrique, ainsi que ceux qui sont intervenus au moment des attentats, au début de l’année.
Notre système de santé est-il le meilleur du monde ? Je résumerai en une phrase ma conviction à cet égard, qui est aussi celle du Gouvernement : notre système de santé est excellent. Et il le restera parce qu’il est capable d’évoluer pour mieux répondre aux besoins des Français.
Le travail de concertation qui a été mené dès 2012 par le Gouvernement a fait ressortir que ce constat était partagé par l’ensemble des professionnels de la santé, mais aussi par les associations de patients ; n’oublions pas, en effet, que le système de soins est d’abord et avant tout fait pour les patients.
C’est sur ce constat que reposent notre stratégie nationale de santé et le projet de loi de santé qui viendra en discussion prochainement au Sénat.
Vous avez été nombreux à le souligner, mesdames, messieurs les sénateurs, notre système de santé fait notre fierté. Il nous est envié à l’étranger, il est une force pour notre pays. N’oublions pas que, si bon nombre de ressortissants étrangers viennent se faire soigner en France et paient pour cela, c’est bien parce qu’ils considèrent que notre système de santé est excellent.
Il n’est évidemment pas parfait, mais il est néanmoins excellent.
Nos concitoyens savent pouvoir compter sur des établissements et des professionnels de santé qualifiés, disponibles et dévoués pour leur offrir des soins de qualité.
L’excellence de notre système de santé tient d’abord au haut niveau de formation et de qualification des professionnels de santé. Les médecins et tous les professionnels de santé qui interviennent auprès des Français bénéficient d’une formation de qualité. Les études de médecine sont parmi les plus longues des études supérieures. Elles sont aussi parmi les plus complètes, incluant une formation pratique qui est unique en son genre, malgré quelques imperfections que M. Barbier a signalées.
Cela me donne l’occasion de dire à M. Fortassin que le niveau de formation est le même pour les femmes et pour les hommes. Rendre les femmes responsables du fait que les médecins souhaitent moins travailler qu’auparavant, c’est sous-entendre que les femmes ne seraient pas capables de la même puissance de travail ou, tout simplement, ne voudraient pas travailler autant que les hommes, …
Je me contenterai de rappeler une donnée factuelle. Quand on additionne en France, pour l’ensemble de la population, le temps de travail et le temps domestique, on relève que les femmes travaillent plus que les hommes et ont moins de temps de loisir.
Cela concerne toutes les femmes en France, qu’elles soient médecins ou non.
Si les études longues sont nécessaires pour acquérir le savoir et former des soignants de qualité, cela ne suffit pas pour assurer la qualité d’un système de soins.
Ce qui fait la particularité du nôtre et son excellence, c’est avant tout son universalité dans l’accès aux soins, vous l’avez souligné, madame Cohen. C’est un système qui accueille et qui soigne tout le monde, sans distinction. Cette universalité est garantie par l’assurance maladie, qui traduit la solidarité à laquelle nous sommes tous attachés. La sécurité sociale, qui fête cette année ses soixante-dix ans d’existence, atténue, à défaut de supprimer, l’injustice des inégalités lorsque la maladie survient. Elle permet de pourvoir aux besoins de santé de millions de nos concitoyens.
Cet accès universel à la santé, principe fondamental de notre République, doit sans cesse être conforté, réaffirmé, défendu. Il l’a été lors de la création de la couverture maladie universelle.
L’excellence de notre système de santé tient aussi à un large accès aux nouveaux traitements, aux essais cliniques, aux nouvelles techniques diagnostiques. C’est loin d’être le cas partout dans le monde. En France, n’importe quel malade peut être inclus dans un protocole d’essai clinique et avoir accès à des techniques extrêmement performantes. Nos établissements de santé possèdent des plateaux techniques de pointe, dotés des dernières avancées technologiques. L’innovation, l’enseignement et la recherche sont au cœur de l’exercice médical à l’hôpital public, en particulier dans les centres hospitaliers universitaires.
L’excellence de notre système de santé est un bien commun de l’ensemble des Français. Il nous revient aujourd’hui de le préserver pour lui permettre de continuer, à l’avenir, de garantir une bonne santé au plus grand nombre.
Comment faire ?
Préserver l’excellence de notre système de santé, c’est d’abord lutter contre les inégalités en matière de santé, vous l’avez tous souligné, mesdames, messieurs les sénateurs. Or ces inégalités sont d’abord liées aux inégalités territoriales. C’est pourquoi la lutte contre les déserts médicaux est une priorité de ce gouvernement. Cette lutte n’est pas facile, les solutions ne sont pas évidentes.
Dès 2012, Marisol Touraine a lancé le pacte territoire-santé, qui donne déjà des premiers résultats. Ainsi, plusieurs centaines de praticiens territoriaux se sont installés et sont rémunérés en fonction de leur lieu d’installation. Des dizaines, voire des centaines de maisons de santé pluridisciplinaires ont été créées, dont les mérites ont été vantés par certains orateurs. Par ailleurs, des centaines d’étudiants choisissent désormais le système des bourses publiques pour s’installer ensuite en zone désertifiée.
Lutter contre les déserts médicaux suppose aussi de trouver l’équilibre entre proximité et sécurité. Nombre d’entre vous l’ont fait remarquer, notamment à propos des maternités, sujet ô combien difficile. Comment conserver des établissements de santé nombreux, au plus près de la population, tout en assurant la sécurité au sein de ces structures, par un nombre suffisant de praticiens et par un exercice des pratiques médicales suffisamment régulier ? Les choix sont faits en fonction des territoires, en fonction des établissements. C’est l’un des axes importants de notre politique.
Ces inégalités peuvent également être liées aux inégalités de revenus. Certains patients renoncent à aller consulter, tout simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens d’avancer le prix de la consultation. C’est aussi l’une des raisons de l’engorgement des services d’urgence. En effet, à l’hôpital, on n’avance pas d’argent, alors que l’on doit le faire chez le médecin.
C’est pourquoi la généralisation du tiers payant n’est pas seulement utile : elle est indispensable si nous voulons préserver l’universalité du droit à la santé. Chacun doit pouvoir consulter son médecin traitant quand il en a besoin.
Ceux qui pensent encore que la généralisation du tiers payant risque d’entraîner une inflation du nombre de consultations se trompent. Cela n’a pas été le cas dans les pays européens qui ont mis en œuvre le tiers payant généralisé, et ce pour une raison très simple : aussi sympathique que soit son médecin traitant, on ne va pas le consulter pour le plaisir ; on le fait parce que l’on est malade.
Lutter contre les inégalités de santé, c’est aussi remettre le patient au centre de l’organisation du système de soins. Cela implique de faciliter le parcours entre médecine de ville et médecine hospitalière, entre les consultations, les rendez-vous d’examen. Cela implique aussi de donner davantage d’informations, de prendre le temps d’expliquer. C’est pourquoi nous avons souhaité diversifier les modes de rémunération des médecins libéraux et prévoir des rémunérations au forfait pour la prise en charge des malades chroniques et pour la prévention. La rémunération à l’acte rend impossible ce temps d’explication.
J’ai bien entendu les propos de plusieurs d’entre vous déplorant la surconsommation de médicaments en France. Précisément, pour prendre le temps d’expliquer qu’il n’est pas nécessaire de prendre un médicament, alors que les patients attendent une réponse immédiate, il faut modifier les modes de rémunération, car la rémunération à l’acte ne permet pas de faire ce travail pédagogique.
Remettre le patient au centre de l’organisation du système de soins, cela passe aussi par l’amélioration de la coopération entre les professionnels. Certes, cette coopération existe déjà, mais elle est perfectible. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du projet de loi de santé.
Pour améliorer notre système de soins, pour lutter contre les inégalités, il faut également améliorer le système de tarification des établissements de soins. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a supprimé la convergence tarifaire entre établissements publics et établissements privés, qui était injuste. C’est aussi pourquoi la ministre de la santé a lancé un travail de concertation pour proposer de sortir, dans un certain nombre de cas, d’une tarification uniquement basée sur le nombre d’actes dans les établissements de santé.
Mieux informer les patients est un autre moyen de lutter contre les inégalités de santé. À cet égard, je vous indique que l’article 47 du projet de loi de santé prévoit l’ouverture des données de santé de l’assurance maladie et des hôpitaux, et ce dans des conditions garantissant l’anonymat. Je ne doute pas, monsieur Barbier, que vous êtes, vous aussi, très attaché à ce principe.
Vous avez évoqué le manque de statistiques sur la mortalité par service. Pour ma part, je pense qu’il faut être extrêmement vigilant sur de telles statistiques, qu’il faut pondérer en fonction du type de patients accueillis. Si l’on classait les établissements, en particulier les services, uniquement en fonction du taux de mortalité, on prendrait le risque non négligeable d’amener les services à sélectionner les patients qu’ils accueillent afin de ne pas afficher de mauvais chiffres. Ils n’accepteraient alors que des patients allant le mieux possible et ne souffrant que d’une seule pathologie. §
Le même biais peut exister concernant notamment les infections nosocomiales. À l’évidence, les patients qui cumulent un diabète et des problèmes cardiaques, qui doivent en permanence porter un cathéter, par exemple, présentent un risque beaucoup plus important de contracter une infection nosocomiale qu’un patient qui est en bonne santé avant son hospitalisation.
Ces statistiques sont utiles, mais il faut savoir les interpréter et les manier avec une extrême prudence.
Lutter contre inégalités de santé suppose, par ailleurs, d’améliorer nos connaissances épidémiologiques et notre système de prévention.
Il faut, bien sûr, combattre les mauvaises habitudes de consommation pour permettre à chacun de vivre en bonne santé. Il faut ainsi empêcher les jeunes de tomber dans l’addiction au tabac. C’est d’ailleurs l’un des objectifs majeurs du projet de loi de santé, qui contient également des dispositions permettant de prévenir la malnutrition et le surpoids en étiquetant mieux les aliments, afin que les consommateurs puissent connaître les risques qu’ils présentent pour leur santé.
Par ailleurs, en matière de connaissances épidémiologiques et de prévention, l’article 42 du projet de loi de santé autorisera la création d’un nouvel institut, lequel ne viendra pas alourdir notre dispositif institutionnel puisqu’il remplacera trois instituts existants : l’Institut de veille sanitaire, l’InVS, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS. L’objectif de la réunion de ces établissements est de simplifier et de rendre plus efficace la veille épidémiologique afin d’apporter les réponses sanitaires appropriées, notamment en termes de prévention.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour conclure, je vous dirai que notre système de santé est et reste notre fierté à tous, comme cela a été dit sur toutes les travées.
Même si vous avez, chacun, évoqué les défauts de notre système de santé, vous avez tous reconnu d’une façon ou d’une autre que nous pouvions en être fiers.
Conforter l’excellence de notre système de santé, c’est lui permettre de continuer à protéger des millions de Français, mais aussi de corriger ses imperfections. Tel est bien l’objectif que nous poursuivons ensemble.
Le Gouvernement compte sur le Parlement, sur le Sénat en particulier, sur vous, mesdames, messieurs les sénateurs, …
… et sur votre sagesse légendaire, bien entendu, pour enrichir et améliorer le projet de loi de santé qui viendra prochainement en discussion devant la Haute Assemblée et qui sera défendu par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
C’est bien là l’essentiel du message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui : vous êtes là, mesdames, messieurs les sénateurs, pour enrichir et améliorer les projets de loi. §

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 29 janvier 2015, trois décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’acceptation des libéralités par les associations déclarées (n° 2014 444 QPC) ;
- l’exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l’objet d’un double usage (n° 2014 445 QPC) ;
- la détention provisoire - examen par la chambre de l’instruction de renvoi (n° 2014 446 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.