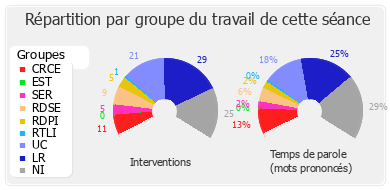Séance en hémicycle du 16 septembre 2015 à 21h30
Sommaire
- Demande d'avis sur un projet de nomination
- Accueil des réfugiés en france et en europe (voir le dossier)
- Modernisation de notre système de santé (voir le dossier)
- Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Mises au point au sujet de votes (voir le dossier)
- Modernisation de notre système de santé
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Francis Delon comme président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission des lois.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe, en application de l’article 50-1 de la Constitution.
La parole à M. le ministre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat souhaité par le Gouvernement sur la crise migratoire que connaît l’Europe et à laquelle notre pays est confronté constitue pour nous l’occasion de convoquer nos valeurs, de réfléchir à ce qu’est la politique de l’Union européenne, mais également de tracer quelques perspectives pour la résolution de cette crise, qui dure depuis de nombreux mois et dont nous avons pu tous ensemble constater, au cours des dernières semaines, à quel point elle était chargée de drames et de tragédies pour des femmes, des enfants, des familles en situation de vulnérabilité en raison des persécutions qu’ils subissent dans leur pays.
Cette crise migratoire est d'abord provoquée par les désordres du monde.
On connaît la déréliction de l’État libyen, qui laisse la Libye entre les mains d’organisations criminelles internationales, notamment de traite des êtres humains. On sait également les sommes que ces organisations prélèvent sur ceux qui fuient leur pays parce qu’ils y sont persécutés, tout en les conduisant d'ailleurs parfois à la mort.
On connaît également la situation en Irak et en Syrie, les crimes perpétrés à la fois par le régime de Bachar al-Assad et par le califat de la haine qu’est Daech. À force d’exécutions, de décapitations, de crucifixions, de traitements inhumains et barbares infligés à des personnes en raison de leur appartenance à des minorités religieuses, les populations sont conduites à des exodes dont on connaît désormais l’ampleur.
La France est engagée en faveur des valeurs humanistes, de tolérance et de respect de l’humanité à travers les actions qu’elle conduit, non seulement en Irak – au sein de la coalition – et en Syrie, mais aussi partout ailleurs, en particulier sur le continent africain, comme en témoigne notre engagement à la fois au Mali et en République centrafricaine.
Et, partout où des femmes et des hommes sont persécutés en raison de ce qu’ils sont, de leur appartenance religieuse et politique ou de leur orientation sexuelle, la France est là pour rappeler les valeurs fondamentales des droits de l’homme et pour répéter le message multiséculaire que les peuples du monde « ont appris à aimer d’elle » – pour reprendre l’expression de François Mitterrand. La France, lorsqu’elle accorde sa protection, est un refuge où la vie peut se poursuivre. La protection que nous devons toujours aux réfugiés inspire la politique de notre pays depuis 1793.
Nous agissons en Irak, en Syrie, en Afrique.
Nous agissons résolument en Europe, et nous agissons également dans notre pays de manière que notre système d’asile et notre politique migratoire soient à la hauteur des enjeux auxquels le monde se trouve confronté.
Nous agissons d'abord en Europe.
Comme le Premier ministre l’a rappelé tout à l'heure avec force à l’Assemblée nationale, la France n’a pas attendu la crise migratoire à laquelle nous assistons depuis plusieurs semaines et qui revêt une dimension tragique pour agir. Dès le 30 août 2014 – il y a donc plus d’un an –, à la demande du Président de la République, je m’étais rendu dans les principales capitales européennes pour essayer de faire partager à mes homologues des pays de l’Union européenne un projet et des propositions susceptibles d’inspirer la politique de celle-ci, c'est-à-dire les propositions de la Commission en matière de politique migratoire.
Quel était le constat et que contenaient ces propositions ?
Nous constations d’abord l’importance des flux migratoires. Près de 200 000 migrants avaient alors déjà franchi les frontières extérieures de l’Union européenne, notamment en Italie, mais pas seulement – certains l’avaient déjà fait en Grèce.
Nous constations aussi qu’il y avait, parmi ceux qui venaient sur notre continent, des personnes relevant du statut de réfugié en Europe, parce qu’elles étaient persécutées dans leur propre pays, mais également des migrants qui avaient fui la misère dans leur pays. Ces derniers venaient pour beaucoup d’Afrique de l’Ouest, à la recherche d’un avenir économique pour eux-mêmes et pour leur famille sur le territoire européen, les passeurs les ayant convaincus que c’était possible.
La France avait tout d’abord proposé d’engager de façon urgente un dialogue avec les pays de provenance des migrants, notamment les pays de la bande sahélo-saharienne, afin que l’immigration économique irrégulière puisse être prévenue plutôt que constatée. Il s’agissait aussi, grâce à la mise en place de centres de maintien et de retour, d’éviter à ces familles, à ces hommes et à ces femmes, de se retrouver entre les mains de passeurs et d’avoir à effectuer le voyage de la mort au cours duquel, en 2014, près de 3 000 femmes, hommes et enfants, ont péri en Méditerranée.
La France avait ensuite proposé de supprimer l’opération Mare Nostrum pour lui substituer une opération sous la maîtrise d’ouvrage de FRONTEX. Cette proposition avait fait l’objet d’une discussion extrêmement animée, mais très riche, avec l’Italie. Si Mare Nostrum, décidée par les seuls Italiens, était une opération humanitaire digne et noble, dont la vertu est d’avoir sauvé des vies, elle avait aussi incité les passeurs à faire monter un plus grand nombre de migrants sur des embarcations de plus en plus nombreuses et de plus en plus frêles, ce qui, au final, avait entraîné plus de sauvetages, mais aussi plus de morts.
C'est la raison pour laquelle nous pensions qu’une opération conduite sous la maîtrise d’ouvrage de FRONTEX était de nature à permettre un meilleur contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne et, dans le même temps, d’armer celle-ci afin de lui permettre de lutter contre les filières de passeurs, ces organisations internationales du crime qui sont de véritables filières de la traite des êtres humains.
Travailler avec les pays de provenance, substituer à l’opération Mare Nostrum une opération sous maîtrise d’ouvrage de l’Union européenne, c'est-à-dire de FRONTEX, lutter contre les filières de l’immigration irrégulière, sauver des vies et, dans le même temps, assurer la protection de nos frontières extérieures : telle était l’ambition que la France proposait aux autres pays de l’Union européenne.
Nous estimions aussi que, dès lors que les flux étaient importants et que cinq des vingt-huit pays de l’Union européenne accueillaient à eux seuls 75 % des demandes d’asile formulées en Europe, il était normal qu’émergent les fondements d’une politique européenne de l’asile afin de permettre une répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre les différents pays de l’Union européenne. Cette troisième proposition devait permettre à l’Europe d’être à la hauteur de sa réputation, d’être fidèle aux valeurs de ses pères fondateurs et d’affirmer celles que la France avait longtemps incarnées. Ainsi, par-delà les différences existant entre ses nations, l’Europe pourrait faire face aux drames humanitaires que nous sentions se profiler.
Nous pensions aussi – c’était notre quatrième proposition – qu’il était important d’organiser, pour ceux qui franchissaient les frontières extérieures de l’Union européenne, un dispositif permettant de distinguer les réfugiés des migrants économiques irréguliers, sous maîtrise d’ouvrage de la Commission, avec la contribution éventuelle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, et de FRONTEX. Il s’agissait de procéder à l’enregistrement de tous et de pouvoir accueillir dès leur arrivée sur le territoire de l’Union ceux qui relevaient de l’asile afin de leur éviter l’errance et un nouvel exode sur les routes européennes. Enfin, il s’agissait de permettre à FRONTEX, dans le cadre d’accords de retour avec les pays de la zone sahélo-saharienne qui auraient pu être signés, d’organiser l’éloignement dans des conditions humaines des migrants relevant de l’immigration économique irrégulière.
Ces propositions ont été formulées sans trêve ni pause par la France au cours des derniers mois, jusqu’à ce que l’Union européenne, après que la France eut mutualisé ses propositions avec l’Allemagne, décide de reprendre un certain nombre d’entre elles et de les soumettre à la délibération du Conseil « Justice et affaires intérieures » et du Conseil européen.
Ces derniers mois, nous avons tout fait pour que le dispositif de solidarité, assorti des conditions de responsabilité que je viens d’indiquer, soit mis en œuvre.
Nous nous sommes réjoui que 40 000 réfugiés puissent être répartis entre les vingt-huit pays de l’Union européenne sur une base volontaire, ce principe ayant définitivement été acté par le Conseil « Justice et affaires intérieures » de lundi dernier. L’Allemagne et nous avons indiqué que nous étions disposés à accueillir 120 000 réfugiés supplémentaires au titre du processus de relocalisation compte tenu de l’ampleur de la crise migratoire, de la nécessité d’être à la hauteur du défi que pose celle-ci et de remplir nos obligations politiques et morales.
Sans surprise, l’importance croissante du flux de réfugiés résultant de l’activité intense des passeurs, mais aussi de la dégradation de la situation internationale et de la situation politique, à la fois en Libye et en Syrie, a conduit le gouvernement allemand à décider, dimanche soir, de rétablir des contrôles à ses frontières, sans pour autant fermer sa frontière avec l’Autriche, de telle sorte que soit garantie la bonne application des règles régissant l’Union européenne, notamment le règlement de Dublin et l’accord de Schengen. En effet, il ne peut pas y avoir de solidarité si les règles qui lient les pays de l’Union européenne les uns aux autres ne sont pas respectées.
J’avais d'ailleurs pris des dispositions similaires voilà trois mois, lorsque nous avions constaté, à la frontière franco-italienne, un afflux de réfugiés qui nécessitait que l’on prît ces mesures de régulation et de prudence – au reste, j’avais été critiqué pour cela. Le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que, si nous devions être confrontés à des circonstances identiques à celles que nous avons déjà vécues, nous prendrions des dispositions similaires.
À cet égard, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous indiquer, par souci de transparence, que les services qui relèvent du ministère de l’intérieur ont d'ores et déjà pris toutes leurs dispositions pour le cas où nous devrions faire face à une situation de cette nature, ce que nous ne souhaitons pas.
La France a donc été constamment à l’action en Europe. Elle l’est encore aujourd'hui, sur le fondement d’une doctrine claire, que le Premier ministre a rappelée tout à l'heure à l’Assemblée nationale et qui se décline en trois principes.
Le premier d’entre eux est la réaffirmation par la France, au sein de l’Union européenne, de la non-négociabilité du statut de réfugié, qui doit être plein, un et entier, à l’instar des principes de la République, et qui doit s’appliquer sur le territoire européen pour tous ceux ayant besoin de protection, d’où qu’ils viennent et quelles que soient leur religion et leurs orientations politiques, dès lors, bien entendu, qu’ils ne sont pas liés à ces groupes abjects qui, en Syrie, sèment la barbarie et la haine.
Comme le Premier ministre, je veux dire ici à la tribune du Sénat que si nous considérions que l’on peut accueillir les uns et non les autres, les chrétiens et non les représentants des autres minorités, nous dérogerions aux principes du droit d’asile.
Pour m’être entretenu avec les représentants des cultes – et notamment avec ceux de l’épiscopat –, je sais qu’il existe, par-delà la sphère publique et politique, un large consensus sur ces valeurs universelles et sur ces principes entre tous ceux qui veulent voir les principes de l’humanité, de la civilisation humaine, les principes humanistes s’appliquer dans leur entièreté.
Ici, à la tribune du Sénat, je tenais à rappeler la nécessité de ne jamais oublier ces principes, dès lors que l’essentiel est en jeu, c’est-à-dire l’avenir de l’humanité.
Nous avons agi en Europe en respectant l’équilibre entre responsabilité et humanité. Nous avons aussi – et vous le savez mieux que quiconque, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque vous avez largement participé aux débats sur ce sujet – agi en France. Face à une crise grave, il ne suffit pas simplement de faire preuve de générosité ou d’affirmer des principes. Il faut être en situation de faire face. C'est la raison pour laquelle la doctrine de la France n’a jamais changé en Europe ; c'est la raison pour laquelle nous n’avons jamais dérogé à l’équilibre entre humanité, responsabilité et fermeté ; c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre au niveau notre système d’asile en France.
Qu’avons-nous fait ? Les travaux conduits à la fois par Valérie Létard et Jean-Louis Tourenne au Sénat, c’est-à-dire à la fois par la majorité et l’opposition, ainsi que par Jeanine Dubié et Arnaud Richard à l’Assemblée nationale, les réflexions menées par les rapporteurs de la loi relative à la réforme du droit d’asile, aussi bien à l’Assemblée nationale – à cet égard, je salue le travail de Sandrine Mazetier et du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas – qu’au Sénat – je salue également le travail du président Philippe Bas et du rapporteur François-Noël Buffet, car nous avons avancé et débattu ensemble –, nous ont permis de mettre notre système d’asile en conformité avec les directives européennes.
Nous avons ainsi réduit la durée de traitement des dossiers des demandeurs d’asile de vingt-quatre à neuf mois. Pour ce faire, nous avons octroyé des moyens significatifs à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA. Plusieurs dizaines d’emplois ont été créés – cinquante, très exactement – et d’autres le seront à suite de la décision d’instaurer un mécanisme de relocalisation – 196 très exactement – au sein de l’OFPRA, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – l’OFII – et des services préfectoraux, du fait de la mise en œuvre, dans les prochains mois, du guichet unique.
Nous avons également décidé de mettre à niveau notre dispositif d’accueil en créant 13 000 places supplémentaires dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, auxquelles s’ajouteront les 5 000 places annoncées par le Premier ministre cet après-midi à l’Assemblée nationale, afin de nous permettre de faire face à nos obligations dans le cadre du processus européen de solidarité, de relocalisation et de réinstallation. Au total, le Gouvernement aura porté à 18 500 le nombre de places en CADA d’ici à la fin du quinquennat, quand il n’en avait été créé que 2 000 sous la précédente législature.
Nous avons également décidé d’améliorer la reconnaissance des droits des demandeurs d’asile devant les instances ayant à connaître de leurs dossiers. Nous avons ainsi inscrit dans la loi le caractère suspensif des démarches effectuées devant le juge dans le cadre de procédures accélérées et autorisé les demandeurs d’asile à être accompagnés de leur conseil lorsqu’ils engagent des démarches auprès de l’OFPRA.
Quel est le résultat de cette loi, sachant que les moyens ont été alloués avant qu’elle ne soit votée ? Nous sommes parvenus à augmenter de 20 % le nombre de dossiers traités cette année et à raccourcir d’autant la durée des délais d’examen. Nous avons donc mis en œuvre un traitement à la fois plus humain et plus rapide, une prise en compte plus exigeante des difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d’asile et, dans le même temps, permis le retour à la frontière de ceux qui ont été déboutés dans des conditions plus simples humainement et administrativement.
Nous avons débattu de ces questions lors de l’examen de la loi relative à la réforme de l’asile. Je veux, là aussi, réaffirmer clairement devant le Sénat les principes qui guident notre action. Si nous voulons pouvoir accueillir en France et en Europe toutes les personnes relevant du statut de réfugié, ceux qui n’en relèvent pas – c’est-à-dire ceux qui ont été déboutés à l’issue de procédures au cours desquelles leurs droits ont été reconnus et confortés – doivent être reconduits à la frontière dans des conditions humainement acceptables. À défaut, il n’y aura n’est pas de soutenabilité de l’asile en France. Raccourcir les délais, c’est aussi permettre une reconduite à la frontière plus aisée des déboutés du droit d’asile.
Un certain nombre de parlementaires ou de responsables politiques indiquent parfois que nous ne reconduisons qu’entre 10 % et 17 % des déboutés du droit d’asile et que les autres restent en France.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le nombre de déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’un éloignement – dans des conditions particulièrement méticuleuses, les services veillant, lors des reconduites, à respecter les principes d’humanité – a augmenté de près de 20 %. Nous entendons, grâce à la loi relative à la réforme du droit d’asile, poursuivre ces efforts. Autrement, encore une fois, notre action ne serait pas soutenable.
Les personnes relevant de l’immigration irrégulière doivent pouvoir être reconduites à la frontière de la même façon. Je donnerai tout à l'heure des chiffres extrêmement précis sur ce sujet. Sachez dès à présent que le nombre des reconduites forcées, les plus difficiles à mettre en œuvre – il n’inclut pas les retours spontanés, comme cela était le cas dans le passé – a augmenté de plus de 13 % l’an dernier et qu’il est passé de 13 000 à 16 000 au cours de la période 2012-2015.
Là encore, notre volonté d’accueillir tous ceux qui doivent l’être n’est pas compatible avec un manque de fermeté vis-à-vis de ceux qui ne peuvent rester sur le territoire national. Il n’est pas d’humanité sans responsabilité, tout comme il n’est pas d’humanité sans application ferme des principes du droit votés par la représentation nationale sur ces questions essentielles.
Nous ne nous sommes pas contentés d’adapter notre système d’asile – avec les résultats que je viens de vous indiquer –, nous avons également souhaité renforcer les moyens alloués aux forces de l’ordre, car il est impossible de lutter contre l’immigration irrégulière et les filières de passeurs si nous ne mettons pas à niveau notre dispositif policier.
À cet égard, la suppression de quinze unités de forces mobiles entre 2007 et 2012 a eu, dans le contexte que nous connaissons, quelques effets collatéraux. Elles nous manquent dans le cadre du plan Vigipirate, alors que le risque terroriste est élevé, qu’il faut sécuriser les frontières et les infrastructures de transport lourdes, à la fois à Calais et à Vintimille, qu’il faut assurer la présence d’unités de forces mobiles dans des quartiers sensibles, ce qui est un facteur de diminution de la délinquance. La disparition de ces unités se traduit par des tensions sur les effectifs du ministère de l’intérieur, lequel se doit, en toutes circonstances, d’être en situation de remplir ses missions régaliennes.
C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, dans la continuité de son action lorsqu’il était ministre de l’intérieur, a décidé, malgré la contrainte budgétaire, d’augmenter les moyens des services du ministère de l’intérieur en charge de la lutte contre l’immigration irrégulière : 500 policiers et gendarmes supplémentaires leur seront affectés chaque année. Par ailleurs, 1 500 fonctionnaires seront affectés à la lutte contre le terrorisme dans le cadre du plan de lutte antiterroriste arrêté en janvier dernier.
Le Premier ministre a indiqué que, face à l’ampleur du phénomène migratoire, 900 policiers et gendarmes supplémentaires seraient affectés aux forces de sécurité dans les deux ans à venir afin de leur permettre de remplir les missions qui sont les leurs en matière de contrôle des frontières et de démantèlement des filières de l’immigration irrégulière.
Sans attendre cette remise à niveau, quels résultats avons-nous obtenu en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de démantèlement des filières ? Depuis le début de l’année, 177 filières ont été démantelées et 3 300 personnes ont été interpellées, dont une grande partie ont été judiciarisées. Cette horde de délinquants, qui relève des filières de la traite des êtres humains, pousse vers la mort des femmes et des hommes en situation de vulnérabilité.
Le nombre d’acteurs de l’immigration irrégulière que nous avons maîtrisés depuis 2014 a augmenté de 25 % – nous avions le même résultat entre 2014 et 2015. Dans la seule ville de Calais – je parle sous le contrôle de la sénatrice Natacha Bouchart –, vingt filières de l’immigration irrégulière ont été démantelées depuis le début de l’année, ce qui représente environ 800 personnes.
Nous entendons poursuivre résolument cette action, sans trêve ni pause. Nous devons combattre tant à l’échelon national qu’à l’échelon européen les filières de l’immigration irrégulière, qui relèvent de la traite des êtres humains.
Voilà ce que nous avons fait au plan national et au plan européen. Je dirai maintenant quelques mots sur ce qu’il reste à faire.
Le projet de loi relatif au droit des étrangers en France permettra au Gouvernement de disposer d’autres outils pour procéder à l’éloignement, dans des conditions humaines, de ceux qui doivent quitter le territoire.
Ainsi, les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire seront clarifiées. Par ailleurs, nous nous dotons d’outils qui nous permettront de convaincre ceux qui refusent de se soumettre aux règles de l’Union européenne de le faire grâce à l’efficacité des processus de judiciarisation.
Je suis convaincu que l’articulation entre la loi relative à la réforme du droit d’asile et le projet de loi relatif au droit des étrangers en France qui vous sera soumis dans les prochaines semaines permettra d’obtenir des résultats.
À quelques jours du Conseil « Justice et Affaires intérieures », d’autres mesures doivent être concrétisées. Là encore, le Premier ministre a eu l’occasion, devant l’Assemblée nationale voilà quelques heures, d’indiquer quelles seraient les priorités de la France. Je les résumerai en quelques mots.
Premièrement, il s’agit de faire en sorte que les hot spots, dont le principe a été acté à l’occasion du Conseil « Justice et Affaires intérieures » de lundi dernier, soient effectivement mis en œuvre dans les prochains jours, sous maîtrise d’ouvrage de l’Union européenne, notamment en Grèce, afin que le processus de relocalisation puisse être enclenché et que la détresse des migrants relevant du statut de réfugié puisse être soulagée dans les meilleurs délais. Pour ce faire – et dès lors que le principe a été acté lundi dernier –, nous avons besoin d’un engagement fort et rapide de la Commission européenne.
Deuxièmement, il est important que Mme Mogherini, la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union européenne, qui est en charge de la négociation des conventions de retour avec les pays de provenance et de la mise en place des centres de maintien et de retour, puisse rapidement conclure les conventions avec les pays concernés. En effet, si les personnes qui, dans les hot spots, ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ne sont pas reconduites dans leur pays de provenance, les dispositifs mis en place à l’échelon européen ne seront pas efficaces. La France exige donc que ces derniers soient mis en œuvre rapidement.
Troisièmement, nous souhaitons que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés augmente sa contribution aux centres de réfugiés situés en Turquie, en Jordanie et au Liban afin d’éviter tout nouveau mouvement de populations qui aggraverait encore la crise migratoire. Cela nous permettrait de disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre, dans des conditions maîtrisées, le processus de relocalisation.
La France a fait part de sa disponibilité pour élaborer un dispositif conventionnel avec la Serbie, ce qui permettra à ce pays de nous aider à maîtriser les flux migratoires. La Serbie accepte en effet l’installation, sur son territoire, de centres intermédiaires où séjourneraient pendant quelques semaines des migrants pouvant prétendre au statut de réfugié et ayant vocation à être accueillis en Europe.
Il faut aussi – c’est notre demande – augmenter les moyens de FRONTEX afin d’assurer la bonne maîtrise des frontières extérieures de l’Union européenne.
Pour ce qui concerne le processus de relocalisation, nous avons clairement dit qu’il ne peut y avoir d’Europe à la carte et que la solidarité ne peut pas concerner les uns, mais pas les autres. L’Europe faillirait si les pays qui la composent ne parvenaient pas, ensemble, de façon solidaire, à mettre en œuvre un principe humanitaire, valeur éminente que les pères fondateurs de l’Union européenne ont placée comme une espérance au cœur des institutions européennes.
Nous devons, sur ce sujet, très politique, qui est parfois même au cœur du débat électoral, être extrêmement rigoureux. Il arrive en effet que certains acteurs politiques se montrent approximatifs, pensant ainsi qu’ils pourront réunir beaucoup de voix. Certaines notions ont ainsi été convoquées de manière étrange récemment. Je pense par exemple – et je le dis sans esprit de polémique, mais plutôt dans un esprit juridique –, au statut de « réfugié de guerre ».
Cette notion est intéressante. Il n’y a pas de raison de ne pas accepter qu’elle puisse être mise sur le métier. Sachant qu’il existe en France deux dispositifs – le droit d’asile, qui est un et indivisible et qui ne distingue pas les réfugiés selon la nature des drames auxquels ils sont confrontés, et la protection dite « subsidiaire », qui permet à ceux qui sont victimes de la guerre dans leur pays, mais qui ne relèvent pas de l’asile parce qu’ils ne sont pas persécutés, de bénéficier d’une protection en France –, il nous semblait que la totalité du champ des possibles auquel des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité peuvent être confrontés était parfaitement couverte.
On m’a alors expliqué que le statut de réfugié de guerre figurait dans une directive de 2001. Or vous pouvez la lire, mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne l’y trouverez nulle part. Vous y découvrirez en revanche le concept de protection transitoire, qui est l’équivalent à l’échelon européen de la protection subsidiaire.
Par conséquent, la proposition de créer un statut de réfugié de guerre ne me choque pas, mais elle est d’une inutilité absolue, car ceux qui pourraient relever du statut de réfugié de guerre en Europe peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de la protection subsidiaire en France. Ce dispositif existe déjà en droit français.
Il n’est jamais mauvais de proposer ce qui existe déjà depuis longtemps et que personne ne conteste jamais puisqu’on s’y est accoutumé. C’est même la meilleure manière de dégager un consensus.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Ce qui est plus étrange, surtout de la part d’un haut responsable politique ayant exercé les responsabilités qui sont actuellement les miennes, c’est de présenter comme totalement nouveau un dispositif qui existe depuis très longtemps et que chacun connaît, dès lors qu’on s’intéresse à ces sujets.
Je pourrais prendre un autre exemple, celui de Schengen. On propose un Schengen II. Pourquoi pas ? J’ai moi-même souvent ressenti la nécessité de faire évoluer Schengen. Ainsi, pour mieux lutter contre le terrorisme, on pourrait procéder, dans le cadre du code Schengen actuel, à des contrôles coordonnés et simultanés aux frontières de l’Union européenne. Parce que les règles l’autorisent, il ne serait ni absurde ni choquant de mettre en place de tels contrôles, à l’instar de ce que font les Allemands ou de ce que j’ai mis en place voilà quelques mois à la frontière franco-italienne.
Je me suis donc interrogé sur ce que serait un Schengen II. Plusieurs déclarations intéressantes m’ont éclairé.
Selon la première d’entre elles, Schengen II serait un Schengen I dont on respecterait les règles ! §Il est rare que des ensembles aussi complexes que l’Union européenne se dotent de règles pour ne pas les respecter. Si Schengen II, c’est Schengen I dont on respecterait les règles, nous n’aurons pas de désaccord manifeste, mesdames, messieurs les sénateurs, si ce n’est avec un ou deux sénateurs que j’aperçois en haut de l’hémicycle.
Ensuite, j’ai entendu dire que Schengen II permettrait des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne, afin que ceux qui ne relèvent pas du statut de réfugié ne puissent pas les franchir.
Lorsque, dans le cadre de Schengen I, on propose la création de hot spots en Italie et en Grèce, que fait-on si ce n’est assurer la protection des frontières extérieures de l’Union européenne en mettant en place des dispositifs permettant de distinguer les réfugiés de ceux qui ne le sont pas ? Par conséquent, si Schengen II prévoit que l’on pourra faire ce que nous faisons déjà dans le cadre de Schengen I, je n’ai pas vraiment de désaccord.
Une troisième proposition est apparue dans Le Figaro la semaine dernière : Schengen II prévoirait le rétablissement de frontières à l’intérieur de l’Union européenne, mais uniquement pour ceux qui ne sont pas européens. Sur ce point, il nous sera plus compliqué de trouver un accord. En effet, si nous mettions en place des frontières intérieures, c'est-à-dire entre nos pays, outre le fait qu’il faudra mettre en œuvre des moyens considérables pour les réinstaurer, à partir de quels critères et selon quelles modalités distinguera-t-on les Européens des autres ? Comment ferons-nous sans les interpeller tous, sans les bloquer tous à la frontière ?
Malgré les progrès réalisés par nos meilleures industries – Morpho, Safran et les autres –, aucun dispositif ne permet aujourd’hui de distinguer les Européens des autres aux frontières.
Ainsi, si la seule modification envisagée pour l’espace Schengen est la mise en place d’un tel dispositif, il faudra discuter longtemps dans cet hémicycle et dans d’autres, notamment au Parlement européen, pour réussir à trouver un accord, sans remettre totalement en cause le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celui du marché intérieur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’espère que le débat que nous aurons ce soir nous permettra de cheminer ensemble. J’ai grand espoir que ce soit le cas, mais une lueur de lucidité me conduit aussi à penser que cet objectif pourrait ne pas être atteint aujourd'hui. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait prêt à revenir la semaine prochaine !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.

J’indique au Sénat qu’il a été décidé d’attribuer, à raison d’un orateur par groupe, un temps de quinze minutes au groupe Les Républicains, ainsi qu’au groupe socialiste et républicain, et un temps de dix minutes à chacun des autres groupes politiques, l’orateur des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.
Dans la suite du débat, la parole est à Mme Esther Benbassa, pour le groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accueil des réfugiés est un devoir incombant aux États démocratiques, qui consolide concrètement le principe démocratique lui-même. Il rappelle aux citoyens de ces États que la démocratie est un mode de gouvernement inégalé, malgré ses défauts. Car c’est bien la démocratie que les réfugiés, persécutés dans leur propre pays, viennent chercher en Europe au péril de leur vie.
Notre pays n’a pas, hélas ! été à la hauteur des principes dont il se réclame. Nos responsables politiques, dans leur grande majorité, n’ont pas su réagir ainsi qu’il convenait, et ont perdu beaucoup de temps dans des tergiversations dont les discours et les actes des derniers mois portent la trace et perpétueront le souvenir devant l’histoire. Cela fut peut-être un peu plus vrai à droite, mais ce le fut aussi quelque peu à gauche.
La comparaison avec l’Allemagne, pour nous Français, est humiliante. Pendant que les dirigeants allemands, portés par un véritable enthousiasme populaire, acceptent de prendre plus que leur part dans l’accueil des réfugiés, pendant qu’outre-Rhin on accueille presque 20 000 personnes en un week-end, les nôtres se contorsionnent toujours au sujet des 24 000 réfugiés qu’ils devraient recevoir en deux ans, comme s’ils étaient, autant qu’une part de notre opinion publique, perméables au populisme nationaliste distillé par le FN et certains segments de la droite dite « républicaine ».
En fait, les petits calculs politiciens ont prévalu sur le devoir de solidarité, bafouant un principe simplement constitutionnel, figurant à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, repris à l’article 53-1 de la Constitution de 1958, à savoir le droit d’asile. Rappelons-nous les polémiques indignes, voilà quelques mois, sur les fameux « quotas » de réfugiés à accueillir.
Il aura donc fallu la photo du petit Aylan Kurdi et l’émotion qu’elle a suscitée pour que notre exécutif envisage officiellement d’accueillir 24 000 réfugiés en deux ans et commence de regarder en face une réalité qui se dessine pourtant depuis des mois. Je n’oublie pas, pour ne parler que d’eux, les réfugiés de La Chapelle.
Je ne sais s’il est encore temps, pour notre exécutif, de sauver son image, de sauver un honneur perdu dans les circonvolutions d’éléments de langage, qui, pendant des mois, ont évoqué certaines pages peu glorieuses de l’histoire de notre pays.
Heureusement, la société civile, elle, a su réagir et se mobiliser avec détermination, mettant en relief l’incurie des pouvoirs publics. Finalement, les Français seraient désormais, semble-t-il, majoritairement favorables à l’accueil des réfugiés, …

… mais les chiffres changent chaque semaine.
Gestion calamiteuse des réalités humaines ; crainte absurde de favoriser la montée du FN, comme s’il n’allait pas monter sans cela. Même lors de sa dernière conférence de presse, le Président Hollande n’a pas su donner toute la solennité qui convenait à ce qui est un virage de dernière minute. C’est vrai, tout le monde n’est pas le Jaurès de la fin du XIXe siècle, appelant à soutenir les Arméniens soumis aux exactions turques.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Même ces derniers jours, l’État n’a fait que déléguer l’organisation de l’accueil aux mairies, sans avoir lui-même rien prévu, ni en termes de sécurité, ni matériellement, et encore moins financièrement. Pendant ce temps, l’Allemagne débloquait 6 milliards d’euros.
Calais reste toujours un point noir, et ce ne sont pas les barbelés et les maigres aménagements concédés qui transformeront ce campement de la misère et de la honte.
On a beaucoup glosé sur les motifs de l’Allemagne : déficit démographique, manque de main-d’œuvre qualifiée, etc. On s’est aussi beaucoup réjoui de ce que l’on présente comme un revirement récent. Je pense surtout que l’Allemagne est en train de réécrire son histoire. Ayant tiré toutes les leçons de son passé nationaliste, raciste et antisémite, elle a d’abord dit par des actes, et pas seulement par des discours : « plus jamais ça ! ». Portée par sa population, elle administre à ses citoyens, notamment à sa jeunesse, une belle leçon. L’histoire n’est pas seulement affaire de « devoir de mémoire ». Elle impose que soient posés des actes donnant du sens à l’existence d’une nation.
En ne redoutant pas l’afflux de populations nouvelles, elle montre en outre une belle capacité à se transformer sans crainte, pendant que, chez nous, la peur de l’étranger continue d’être distillée dans les esprits par tant de politiciens.
L’Allemagne a provisoirement rétabli les contrôles à certaines de ses frontières. S’est-elle ainsi rendue aux arguments des laudateurs d’une Europe forteresse ? Oui et non ! Elle rappelle d’abord à ses voisins européens l’indignité de leur attitude, et tente par ce moyen et quelques autres de les faire enfin fléchir.
La France fut certes un pays d’immigration. Entre un tiers et un quart des personnes qui vivent dans notre pays en serait issu. Reste que, pour l’essentiel, la France ne s’est montrée « accueillante » envers ses immigrés qu’en période de développement industriel, lorsqu’elle avait besoin de main-d’œuvre. Ainsi, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, dont le pays était sorti exsangue, notre pays a massivement accueilli des immigrants. Ceux-ci sont d’abord, alors, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des hommes en âge de travailler qui feront plus tard venir leurs familles ou épouseront des Françaises. Dans les années 1960-1970 vient le tour des Maghrébins – musulmans et non européens, quant à eux –, ce qui finira par changer la donne. Il faut des bras pour une économie en pleine expansion : ce sont les Trente Glorieuses.
Voilà qui a fait de la France un pays d’immigration.
Difficile en revanche de parler sans nuance d’une France « terre d’accueil ». Cet accueil fut souvent hésitant, et différencié selon l’histoire, la religion, la perception des populations accueillies. Je pourrais parler des Arméniens fuyant les massacres dans l’Empire ottoman ; des Juifs, aussi : après l’avènement de Hitler et l’Anschluss, des centaines de milliers d’entre eux cherchèrent à quitter l’Allemagne et l’Autriche. En 1938, les délégués de trente-trois pays se réunirent à Évian. La France, comme la plupart des États conviés, invoqua sans scrupules diverses raisons, notamment économiques, pour ne plus accepter de réfugiés. On connaît la suite : les camps de la mort. En 1939, le gouvernement français à majorité radical-socialiste de Daladier ne sut pas davantage gérer dignement l’accueil des quelque 500 000 Républicains espagnols arrivés à la suite de la prise de la Catalogne. Dois-je rappeler enfin le sort des Harkis, condamnés après 1962 à croupir dans des camps aux conditions indignes ?
Les lenteurs, la désorganisation, ainsi que les craintes qui ont marqué, ces derniers mois, la gestion des flux de réfugiés actuels, s’inscrivent dans le prolongement de cette histoire. Elles sont évidemment liées à la provenance, à la religion et à la couleur de peau des demandeurs d’asile, aujourd’hui majoritairement musulmans, issus du Moyen-Orient et d’Afrique. Le contexte français d’islamophobie, rampante ou déclarée, la confusion entretenue entre « musulmans » et terrorisme, ne sont évidemment pas étrangers à l’attentisme dont a fait preuve l’exécutif.
La France, cette France qu’on nous dit « éternelle », solidaire, humaniste, terre de refuge de tous les persécutés, cette France-là, voici des mois que je la cherche.

Je l’ai certes trouvée, sur le terrain, dans la rue, auprès des associations, auprès de ces citoyens qui se sont mis tout de suite au travail. Mais allons-nous la trouver enfin, cette France-là, au plus haut sommet de l’État ?
Quant à l’Europe, celle des droits humains, je ne la cherche plus. Quelle Europe ? Je vous pose la question.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la violence et la déstabilisation de régions entières provoquent un exode massif de populations désespérées. C’était prévisible.
Les guerres, les crimes odieux de Daech jettent dans des camps de réfugiés inhospitaliers et inadaptés des millions de personnes, qui n’ont ensuite d’autre choix que de prendre les chemins de l’exil.
Les guerres civiles, l’effondrement d’États, la barbarie née de vingt ou trente années de conflits, ont provoqué une crise humanitaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.
Après l’Afghanistan dévasté par la vengeance aveugle menée au nom de la guerre de civilisation par Georges W. Bush ; après l’Irak détruit par une guerre fondée sur une tromperie aux conséquences meurtrières ; après la Libye et la liquidation du dictateur Kadhafi, sans réflexion aucune sur les conséquences désastreuses de cet acte, c’est aujourd’hui le tour de la Syrie, où les errements diplomatiques et les choix stratégiques hasardeux placent Daech, surgi du bourbier irakien, en position de prendre le pouvoir aux portes de la Méditerranée.
Il n’est pas possible de débattre de la situation créée par l’afflux massif de réfugiés sans évoquer la lourde responsabilité des puissances occidentales dans l’évolution de cette partie du monde.
Il n’est pas ici question de repentance, mais nous avons le devoir, à la fois moral et politique, d’assumer nos responsabilités : nous avons la responsabilité de créer les conditions du retour à la paix dans ces zones – c’était l’objet du débat d’hier – et celle de permettre aux victimes de ces conflits de vivre dignement, de pouvoir trouver refuge.
Confrontées à une réalité inhumaine – celle d’un enfant mort noyé sur une plage turque, messager funèbre de tous ceux qui ont déjà péri pour tenter de vivre, de survivre –, des voix fortes et nombreuses se sont élevées, plaidant pour que l’Europe s’ouvre à la solidarité et ne se ferme pas sur ses égoïsmes.
Je n’ai pas l’habitude de citer favorablement Jean-Claude Juncker, mais je ne peux que partager les propos qu’il a tenus mercredi dernier : « Ces gens, nous devons les accueillir à bras ouverts, et cette fois, j’espère que tout le monde sera à bord ». « Le Vieux Continent, poursuivait-il, ne peut accueillir toute la misère du monde. Mais nous avons les moyens de recevoir des réfugiés qui ne représentent que 0, 1 % des 500 millions d’Européens ».
Le pape François, quant à lui, appelle chaque paroisse, chaque chrétien, à accueillir des réfugiés.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

C’est vrai, ou pas ?... Bien !
Je regrette la solitude de Mme Merkel au sein de la droite européenne. Je ne peux comprendre les réticences à remplir ce devoir d’humanité élémentaire – offrir l’asile aux persécutés, quelles que soient leur origine, leur religion, leur couleur de peau – de la part d’hommes politiques comme Nicolas Sarkozy et celles et ceux qui le soutiennent encore.

Mme Éliane Assassi. Il faut isoler, mes chers collègues, Mme Marine Le Pen dans sa xénophobie et son mépris de la dignité humaine : elle révèle son vrai visage à l’occasion de cette crise.
M. Stéphane Ravier s’exclame.

Ne lui en déplaise, la France est une terre d’asile. L’ouverture de notre pays au monde fait partie intégrante de son identité. C’est ce qui fonde la célèbre phrase de Thomas Jefferson : « Chaque homme a deux patries, la sienne et la France ».
Qui peut ignorer l’humanisme qui forge la République ? Faut-il rappeler le Traité sur la tolérance de Voltaire : « Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n’en avons pas assez pour aimer et pour secourir » ? Chacun devrait se remémorer cet ouvrage, socle du siècle des Lumières, et ces mots qui aujourd’hui prennent tout leur sens : « Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ».
Dès 1793, ces idées figurent dans l’article 120 de la Constitution : « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ». Les Constitutions de 1946 et de 1958 ont perpétué cette grande tradition démocratique.
L’asile et l’accueil des réfugiés sont aujourd’hui des exigences du droit international.
L’article 14 de la convention du 28 juillet 1951, plus connue sous le nom de convention de Genève, est clair : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».
Qui, dans cet hémicycle ou ailleurs, peut affirmer sans honte que fuir devant la folie meurtrière de Daech ou de Boko Haram, ou devant la violence quotidienne en Libye, ne justifie pas la mise en œuvre de la convention européenne de Genève – convention étendue au reste du monde en 1967 par l’adoption du Protocole de Bellagio, aujourd’hui complétée et consolidée par la Convention européenne des droits de l’homme ?
Avec un peu de recul, les choses deviennent évidentes : ces réfugiés sont les sœurs et les frères des réfugiés espagnols d’hier, des juifs fuyant les pogroms et la barbarie nazie. Ils sont les sœurs et les frères de ces peuples persécutés, martyrs, qui depuis la nuit des temps fuient la guerre.
La question ne doit donc pas se poser. Il faut les accueillir, sans critère de sélection. C’est notre devoir : le devoir de l’Europe, mais aussi du monde – car il ne faut pas exonérer les États d’Amérique du Nord, ou encore les pays du Golfe, d’un devoir d’asile qu’ils assument bien faiblement au regard de leurs grandes responsabilités dans l’état actuel du monde, et tout particulièrement de ces régions meurtrières.
Regardant un reportage, je me suis dit : « peut-on accepter de continuer à laisser mourir ces gens qui traversent la mer ? ». Une proposition, portée par de nombreuses associations, fait son chemin : il faut assurer la sécurité de ces réfugiés, et leur permettre de parvenir jusqu’à nous en échappant aux passeurs.
Chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui meurt aujourd’hui est une tâche indélébile dans l’histoire de l’Europe.
Monsieur le ministre, la France doit assumer ses responsabilités et assurer la sécurité de ces migrants.
La directive du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, offre un cadre juridique.
Après l’élan de générosité et de solidarité du début du mois de septembre, des divisions apparaissent au sein de l’Union européenne.
Certains États sont depuis des années le théâtre d’une xénophobie croissante. Leur attitude actuelle n’est donc pas une surprise. Refusant le devoir d’humanité, ils refusent également cette obligation internationale qu’est l’accueil des réfugiés.
Ces États chassent et persécutent d’ailleurs déjà certaines minorités, comme celle des Roms, et « produisent » donc eux-mêmes des réfugiés.
Les valeurs affichées par l’Europe sont donc aujourd’hui bafouées. Il faut sévèrement rappeler à l’ordre ces pays que l’Union européenne a accueillis généreusement. L’attitude du gouvernement hongrois n’est pas acceptable : il édifie des murs, fait adopter à la hâte des lois « anti-réfugiés », et commence à appliquer des sanctions pénales à l’égard de ces hommes et femmes, après avoir matériellement fermé sa frontière avec la Serbie.
Voilà ce qu’il faut dire à M. Orban, ainsi qu’au président slovaque, qui n’accepte que les chrétiens : « Ça suffit, l’Europe ne sera pas celle de la xénophobie ! ». Oui, les frontières doivent être rouvertes dans les plus brefs délais au sein de l’espace Schengen !
En France, la société doit se mobiliser. L’État, monsieur le ministre, doit prendre toutes ses responsabilités. Les communes, par leur dimension de proximité, ont certes un rôle prioritaire à jouer. Mais – dois-je vous le rappeler ? – elles sont aujourd’hui étranglées financièrement, et votre annonce d’une ristourne de mille euros par réfugié accueilli apparaît dérisoire par rapport aux besoins de logement, de scolarisation, d’aide alimentaire par exemple.
Monsieur le ministre, cette crise montre bien les limites des politiques d’austérité.
La solidarité mais aussi la résolution de ces crises, par la reconstruction et le développement, nécessitent un nouvel ordre économique. L’élan de notre pays n’est pas celui qu’il devrait être. Accueillir 24 000 réfugiés en deux ans est bien insuffisant, d’autant que la France est déjà bien en deçà de la moyenne européenne pour l’accueil des demandeurs d’asile.
Nous devons faire plus, car nous pouvons faire plus ! Notre pays, qui est la patrie des droits de l’homme, est aussi la cinquième puissance la plus riche du monde !
Ce manque d’élan permet en outre au Front national de diffuser son discours de haine, qui sème le doute dans les esprits d’un certain nombre de nos concitoyens.
Prétendant que la France ne peut accueillir de réfugiés parce qu’elle « n’en aurait pas les moyens », ce parti joue la concurrence entre démunis, entre réfugiés et citoyens français, en usant de raccourcis biaisés, de propagande et d’intoxication, et en proférant les inepties les plus énormes pour tenter de tirer profit de cette situation dramatique.
M. Stéphane Ravier rit.

Quand ce parti dit « craindre que l’afflux des migrants ne ressemble aux invasions du IVe siècle, et n’ait les mêmes conséquences », il place, mes chers collègues, les persécutés de Daech au même rang que les barbares...
Cette manipulation grossière de l’histoire doit être dénoncée, tout comme doit l’être cet argument détestable faisant des Syriens des pleutres, qui devraient retourner combattre dans leur pays, comme les Français ont combattu les nazis.
Leur acolyte de Béziers n’est pas en reste. Sa propagande et son slogan – « vous n’êtes pas les bienvenus ici » – sont une honte pour la France.

Certes, notre peuple souffre de la crise ; mais, comme il l’a montré le 11 janvier dernier, il sait se lever pour la justice et pour la solidarité.
C’est ce chemin d’humanité que doivent suivre les démocraties, et non, comme le souhaitent certains, celui qui consiste à profiter de la situation pour remettre en cause le droit du sol.
Cette crise, mes chers collègues, met en évidence la nécessité de combattre l’anarchie libérale. La mondialisation financière, c’est en réalité la mise en concurrence des peuples et des individus ; et, in fine, c’est la guerre.

Cette gestion cruciale des réfugiés place donc chacun devant ses responsabilités. Pour nous, et pour de nombreux progressistes, le développement et la paix sont les clés de l’avenir. Aujourd’hui, ce sont la générosité, la solidarité et l’humain qui doivent primer.
Oui, je l’affirme à cette tribune : bienvenue à tous les réfugiés !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

La parole est à M. Raymond Vall, pour le groupe du RDSE.
Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au Sénat, cher collègue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est un moment d’émotion pour moi.
Je remercie Mme Assassi d’avoir évoqué certains moments de l’histoire de France. Cela m’a touché. En tant que fils de réfugié politique – ma famille a fait partie des 500 000 Espagnols qui ont traversé la frontière en 1939 –, je suis très fier d’être à cette tribune aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Monsieur le ministre, j’étais parmi les quelque 700 maires ayant répondu à votre invitation samedi dernier. La réunion a été très réussie, à une réserve près : un élu a fait une intervention inadmissible, qui a d’ailleurs été unanimement dénoncée.
À la sortie, le hasard – mais il n’y a pas de hasard ! – m’a fait croiser son auteur, un célèbre élu du Gard, membre d’un parti qui, comme l’a rappelé Mme Assassi, compte deux représentants dans notre hémicycle. Je n’ai pas pu m’empêcher de l’interpeller pour dénoncer le ridicule et le cynisme de son discours. Je lui ai rappelé que j’étais fils de réfugié politique. Sa réponse, cinglante, m’a laissé pantois : « C’est justement parce que des hommes comme toi vont prendre la place des Français que je me bats ! » §J’avoue que je suis resté sans voix. De tels propos n’auraient mérité qu’une seule réaction…

Vous avez raison, monsieur le ministre : le sujet ne se prête ni à la communication ni à l’exploitation politique.

Je conçois que nous soyons dépassés par les événements du Moyen-Orient et que, de ce fait, nous ayons mis du temps à réagir. Mais ce n’est pas à la France de trouver seule des solutions : la réponse doit être européenne. Il est vrai, comme l’a souligné ma collègue, que l’Europe n’a pas toujours été à la hauteur et qu’elle a tardé à répondre.
Pour autant, monsieur le ministre, la réunion que vous avez organisée nous a fait chaud au cœur. Les témoignages que nous avons reçus montrent que la France a réagi. Des maires, des populations, des associations ont pris la mesure du problème, même si c’est peut-être parce que des images terribles ont servi d’électrochoc.
Un certain nombre de mesures ont été proposées, en plus des 1 000 euros d’aide par réfugié. Vous avez annoncé des dispositions concrètes pour mobiliser des logements vacants dans les communes ou augmenter le nombre de centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Des programmes ont été lancés. Tout cela s’est mis en place très rapidement.
Comme vous l’avez rappelé, il s’agit là d’une compétence de l’État. Elle s’exercera dans les conditions que vous avez indiquées. Dans ma ville, lors de réunions, on m’a opposé les difficultés de la vie, le chômage, le manque de moyens des collectivités territoriales… Mais tout cela ne doit pas nous exonérer de faire notre devoir, car, ce faisant, nous n’enlèverons rien au reste de la population.
Notre devoir est de nous engager. Vous avez exprimé votre volonté forte de mobiliser les services de l’État aux côtés des collectivités locales, des citoyens, des associations. C’est essentiel.
Les réfugiés vont-ils rester ? Vont-ils partir un jour ?
M. Stéphane Ravier s’exclame ironiquement.

Ces hommes et ces femmes méritent que nous les aidions, dans ce moment absolument abominable de leur histoire : la barbarie a atteint un niveau que nous pensions ne jamais voir.
J’entends les tergiversations ou les hésitations : certains problèmes économiques pourraient nous empêcher de les recevoir... Il faut se souvenir que la situation économique de la France n’était pas non plus particulièrement brillante en 1939. Pourtant, cela n’a pas empêché notre pays d’accueillir des hommes et des femmes qui se sont ensuite impliqués dans la vie économique. Que serait devenue notre agriculture sans les réfugiés espagnols, italiens ou polonais ? Je rappelle enfin que les hasards de l’histoire ont fait que ces hommes et ces femmes, accueillis dans des camps de concentration, ont été parmi les premiers à rejoindre la Résistance, et qu’ils ont participé à la libération de la France !

C’est tout cela qui fait la force de la France !
Je m’insurge contre ceux qui voudraient porter atteinte à l’image de notre pays, qui est une terre d’asile. Pour moi, notre République, c’est celle de tous les hommes qui ont choisi d’y venir.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Sachez, monsieur le ministre, que nous vous suivrons et que nous vous faisons confiance. Vous pouvez compter sur nous !
Applaudissements sur les mêmes travées.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques décennies, les historiens, politologues et autres spécialistes n’en croiront pas leurs yeux. L’époque que nous vivons servira à n’en pas douter de contre-exemple à ce qu’il conviendrait d’appeler une « bonne politique ».
D’interventions militaires inopportunes, comme en Irak ou en Libye, en déstabilisations des régimes dits « durs », qui font place à une désorganisation plus grande encore, la communauté internationale a permis l’installation des pires criminels, qui gagnent du terrain en cette triste période.
Des guerres, des exodes, des massacres de réfugiés, nous en voyons depuis longtemps ! Ils se perpétuent sous nos yeux, il faut bien le dire, parfois dans la plus grande indifférence.
Nous avons connu beaucoup de mouvements de masse pour fuir la terreur, la misère, la famine et l’absence d’avenir. La France, avec son droit du sol et ses régimes sociaux, a beaucoup accueilli, parfois plus que ceux qui se donnent le beau rôle aujourd’hui…
Alors, que faire ? Certainement pas une politique du coup par coup ou de l’aller-retour ! L’Allemagne, après avoir donné le sentiment d’ouvrir les bras à tout le monde, les a très rapidement refermés, non sans avoir provoqué un appel d’air dont nous ne mesurerons pas encore les conséquences.
En dépit de la complexité des facteurs à l’œuvre, ce qui semble indiqué, c’est une politique globale !
Il faut d’abord combattre la folie. Cela doit être le fait d’une coalition internationale, et non d’un pays seul. Il faut combattre dans les airs et sur le terrain. La barbarie se combat par la guerre, qui doit permettre de reconquérir les terres et de les libérer des bourreaux. La fuite des populations arrange Daech, car elle déstabilise grandement l’Europe, mais aussi parce qu’elle donne à ces groupes la liberté de s’organiser comme ils le souhaitent.
Il faut ensuite organiser, sous contrôle de la coalition, des zones sécurisées, directement sur place ou régionalement, afin de ne pas fragiliser les pays les plus proches, comme le Liban et la Jordanie.
Enfin, il faut avoir une politique humanitaire qui tienne compte de la capacité d’accueil de chaque pays, et non des quotas imposés par les uns contre les autres.
Toute autre politique sera vaine et inefficace. Elle entraînera des rejets dont nous n’avons sûrement pas besoin actuellement sur le plan intérieur.
Il est irresponsable de faire croire que l’accueil de réfugiés par millions dans certaines communes ou certains pays n’aurait pas de conséquences. On voit mal comment nos concitoyens accepteraient sans réagir une augmentation non maîtrisée de la capacité d’accueil dans des départements où le taux de chômage est élevé et où la dépense sociale atteint des seuils insupportables.
Mes chers collègues, je souhaite qu’une politique globale soit mise en œuvre !
Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’urgence de la situation place l’Europe au pied du mur.
La réponse humanitaire que l’Union européenne pourra apporter en accueillant des réfugiés sur son sol, aussi humaine et digne soit-elle, ne s’attaque pas aux causes de l’exode massif.
Seuls un règlement politique des crises syrienne et irakienne et la disparition de Daech constitueront une solution pérenne et permettront aux millions de Syriens ayant fui vers le Liban, la Jordanie, la Turquie, l’Égypte, l’Irak et l’Europe de retourner dans leur pays.
Comme l’a rappelé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état de l’Union, l’heure n’est plus aux atermoiements face à l’urgence et aux dangers. Nous parlons d’êtres humains. Il s’agit de sauver des vies.
La crise résulte d’un contexte international d’une gravité exceptionnelle. Elle appelle une réaction internationale d’ampleur. La communauté internationale doit agir avec fermeté pour éradiquer Daech, afin de pacifier et de reconstruire cette région du monde, et organiser la coalition nécessaire pour atteindre rapidement cet objectif.
Indépendamment de ces conflits, nous sommes aussi appelés à traiter avec humanité les migrations provoquées par la pauvreté et le réchauffement climatique en Afrique.
Certes, la principale cause de l’exode actuel est bien évidemment le conflit dont nous débattons ce soir. Il ne faut toutefois pas occulter le fait que les réfugiés économiques ou climatiques viendront vite grossir les rangs des candidats à l’immigration sur le continent européen si nous ne sommes pas capables de mener une véritable politique de codéveloppement, à l’instar de celle que propose la fondation de Jean-Louis Borloo pour l’électrification du continent africain.
Je rappelle que l’Afrique compte 2 milliards d’habitants. Comment pourraient-ils ne pas songer à venir un jour chez nous s’ils ne sont pas capables de subvenir à leur propre développement ? Accompagnons-les dans le cadre d’un partenariat qui constituerait à tous points de vue une richesse ! D’une part, ce serait valorisant et gratifiant humainement pour les habitants de l’Union européenne. D’autre part, cela favoriserait des échanges économiques entre nous et un continent qui ne demande qu’à se développer ; encore faut-il lui en donner les moyens de façon pérenne.
Un fonds de 1, 8 milliard d’euros existe, mais ce n’est pas de cela dont nous avons besoin. Il nous faut plutôt une véritable stratégie qui s’inscrive dans la durée, avec des axes très précis. Il convient d’aller bien plus loin que nous ne le faisons aujourd'hui. À défaut, nous ne parviendrons pas à résoudre les difficultés qui se présenteront très vite à nous demain. Bien sûr, nous le savons tous, nous devrons mettre l’accent sur l’énergie durable, faire attention aux enjeux climatiques et veiller à la protection de l’environnement. Accompagner l’Afrique dans cette voie nous permettra peut-être d’éviter le deuxième écueil qui se trouve devant nous.
Pour ce faire, notre horizon ne peut être seulement national. C’est en étant tous unis et dans l’Europe, et non au sein d’une Europe qui se disloquerait, que nous parviendrons à construire les nouveaux équilibres de la planète et à gérer les crises qui nous attendent.
L’afflux de réfugiés est un test majeur pour les pays européens, qui révèle une fois de plus les fractures d’une Europe divisée, à l’inverse de ce qu’elle devrait être. Comment mettre en place une politique européenne d’accueil des réfugiés quand 85 % des demandes se concentrent sur cinq pays ?
Le 9 septembre dernier, le président de la Commission européenne a évoqué des pistes intéressantes dans son discours sur l’état de l’Union. Il est indispensable d’établir une liste commune de pays d’origine sûrs à l’échelon européen afin d’unifier les politiques d’asile et de clairement distinguer les pays dont les ressortissants ont besoin d’une protection des autres, qui, eux, doivent repartir. Une telle initiative permettrait également de faire le point sur l’immigration en provenance de certains pays des Balkans, car la plupart des demandes ne relèvent pas de l’asile.
Le mécanisme de relocalisation permanent et contraignant est quant à lui soutenu par l’Allemagne et par la France. Que chacun des pays d’Europe prenne sa part dans l’accueil des réfugiés est une mesure d’équité et de raison. Pour être acceptable par nos concitoyens, l’effort doit être partagé par tous. Une nouvelle réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures » est programmée après l’échec de celle du 14 septembre dernier. Espérons qu’un accord pourra rapidement être trouvé, car il est seul à même de conforter la solidarité européenne.
Le groupe UDI-UC soutient la proposition franco-allemande de créer des centres d’enregistrement, ou hot spots, installés dans les pays d’arrivé – en particulier en Grèce, en Italie, en Hongrie – afin de contrôler l’identité et le statut des migrants, de distinguer dès leur entrée dans l’Union européenne les immigrés économiques des personnes à protéger, et de répartir les contingents de réfugiés entre tous les pays de l’Union.
Cette proposition pourrait être une partie de la solution, à condition de ne pas transformer ces centres en zones de non-droit et de reproduire ce qui s’est passé à Calais. Il faudra intervenir très rapidement – à cet égard, l’OFPRA, ou d’autres, me paraît un outil adapté – afin d’empêcher des embouteillages, lesquels ne manqueraient pas, très vite, de créer des conditions inhumaines et d’entraîner des débordements susceptibles de faire exploser l’initiative.
Les pistes énumérées par l’Europe démontrent, s’il le fallait, combien il est important d’harmoniser la politique d’asile à l’échelon européen. Si nous ne sommes pas prêts à confier les rênes de cette politique à une agence européenne, du moins faudra-t-il que nous révisions le contenu du règlement de Dublin sur le premier accueil et que nous renforcions activement nos actions en matière de politique étrangère, ainsi que notre aide en direction des pays les plus touchés par les conflits.
Pour nous, centristes, la solution ne peut passer que par plus d’Europe et par une solidarité partagée entre tous les pays. C’est la deuxième étape.
Troisième et dernière étape : c’est au niveau national que la solidarité avec les réfugiés doit s’organiser. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire la preuve dans cette crise que le cœur et la raison peuvent cohabiter.
La nouvelle loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile nous donne des moyens nouveaux et permettra de réduire les délais d’examen des demandes. L’OFPRA peut désormais statuer en priorité sur les demandes manifestement fondées, et de manière accélérée pour écarter les demandes injustifiées. Par ailleurs, cette loi permet de lutter contre les filières grâce à l’orientation directive des demandeurs, d’accorder de meilleures garanties aux personnes accueillies et de prévoir une répartition des demandeurs d’asile.
Il revient maintenant à l’État de faire en sorte que la loi puisse être appliquée rapidement, fermement et avec efficacité, car notre dispositif est actuellement « embolisé » par des demandes qui ne relèvent pas de l’asile. Notre capacité à accueillir des réfugiés serait bien plus importante si les personnes déboutées du droit d’asile étaient effectivement reconduites aux frontières – vous l’avez rappelé comme nous tous, monsieur le ministre. Cette année encore, sur 65 000 demandeurs d’asile – soit le volume moyen annuel –, seules 20 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Au total, 40 000 demandes ont donc été rejetées.
Puisque la France accueillera 24 000 réfugiés de plus, l’État doit prendre à bras-le-corps le problème du raccompagnement aux frontières des 40 000 personnes déboutées du droit d’asile chaque année. Celles-ci n’ont pas obtenu de statut, mais elles restent très majoritairement sur le territoire national, où elles s’agrègent d’année en année. Or elles ne sont ni menacées ni persécutées dans leur pays d’origine. Ce n’est pas que nous n’en voulons pas, ce n’est pas que nous sommes inhumains, mais de vrais réfugiés attendent.
J’insiste d’autant plus sur ce point qu’il ne faudrait pas non plus que les Français qui souffrent s’opposent à l’accompagnement et à l’accueil des réfugiés. Il est essentiel que nous puissions montrer à tous les Français que notre pays est aujourd'hui capable d’accompagner ceux d’entre eux qui ont des difficultés en matière d’emploi ou de logement grâce à des politiques de solidarité. On peut faire notre devoir et accueillir des réfugiés, à condition que la loi soit appliquée.
Nous savons qu’il sera difficile de raccompagner aux frontières tous ceux qui sont présents sur le territoire national depuis quelques années, mais nous devons essayer. Il est primordial que nous arrivions à mettre en œuvre des dispositifs tels que le centre dédié d’accompagnement vers le retour, qui fait ses preuves dans l’Est où il est expérimenté, et que nous répartissions sur l’ensemble des territoires régionaux les outils permettant de mieux accompagner les réfugiés et d’accélérer l’instruction des dossiers des personnes devant retourner dans leur pays. Il est en effet plus simple de dire tout de suite à une famille, quand son dossier est instruit en trois mois grâce à la procédure accélérée, qu’on va lui donner les moyens de rentrer dans son pays d’origine que de le faire trois ans après !
Bref, l’OFPRA ne doit pas être concentré à Paris, il doit être régionalisé dans les territoires. Quand l’OFPRA va à Lyon ou à Metz, il parvient à traiter 500 à 600 dossiers en quinze jours alors qu’il lui faudrait sans doute deux ans pour le faire en restant à Paris.

Mme Valérie Létard. Des outils sont disponibles. Nous avons entre nos mains tous les moyens pour relever le défi qui se présente à nous : accueillir les réfugiés avec humanité, conformément à la convention de Genève. Encore faut-il, monsieur le ministre, que l’État, je le répète, mette en œuvre la loi avec fermeté et sans attendre. C’est aujourd’hui ce qui nous fait défaut !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, messieurs les ministres, nous assistons depuis quelques jours à une espèce de surenchère. Qui a l’air le plus ferme ? Qui a l’air d’avoir du cœur ? Comme si l’un était exclusif de l’autre, comme si d’un coup, dans la société française pourtant si fragile, la vérité était simple, claire, unique, uniforme. Personnellement, je ne le crois guère…
(Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Ce n’est pas la République qui leur a offert l’hospitalité. Le droit d’asile est une tradition nationale, c’est la France dans ses profondeurs, indépendamment des régimes politiques !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Il a beaucoup été question du droit d’asile, que d’aucuns ont présenté comme un principe républicain. Or je rappelle que la Monarchie de Juillet a reçu les réfugiés polonais après la révolte de 1830 et que Napoléon III, durant le Second empire, a accueilli les Carbonari italiens avant l’unification de l’Italie ! §
Pour nous tous, l’asile est un droit imprescriptible pour les personnes qui connaissent la douleur, la souffrance, la persécution. La République ne l’a d’ailleurs pas toujours bien pratiqué, quels que soient les gouvernements et leur couleur politique. Mme Esther Benbassa a ainsi rappelé qu’en 1938 le gouvernement français avait refusé de recevoir les réfugiés juifs d’Allemagne. En 1939, c’est dans des camps d’internement que la République a accueilli les Républicains espagnols sur lesquels nous avons entendu un témoignage très émouvant. Ce n’est guère glorieux ! Nous n’avons pas été exemplaires dans le passé au point d’en tirer des leçons.
Monsieur le ministre, personne ne vous dit qu’il faut refuser l’asile aux réfugiés. Personne non plus ne nie la réalité de la guerre. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles, nous suivons tous les informations à la radio et à la télévision.
Mais les choses ne sont pas si simples. Le Gouvernement, comme les représentants parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique, sont certes en charge du droit d’asile, mais ils sont surtout en charge de la société française, de la France et des Français. L’un n’est pas exclusif de l’autre, mais la question se pose : comment préserver l’unité de la nation, le tissu et l’équilibre social sans rester non plus aveugle au drame ? Il faut satisfaire ces deux exigences, faute de quoi nous risquerions d’exclure une part de la nation…
Monsieur le ministre, il n’est pas indécent de rappeler que la situation économique et sociale de la France est plus difficile que celle de notre voisin outre-Rhin. En 2014, l’Allemagne comptait 1, 5 million d’emplois non pourvus contre 250 000 pour la France. L’Allemagne a également une natalité différente – c’est le moins que l’on puisse dire – et des ressources financières différentes. L’Allemagne ne présente pas non plus le déficit français. L’Allemagne n’est pas dans la situation sociale qui est celle de notre pays. L’Allemagne dans le passé, même si la situation est différente depuis quelques années, et le reste de l’Europe n’ont pas consenti les mêmes efforts que nous en matière d’immigration. La France a en effet reçu un certain nombre d’immigrés, qui étaient non pas des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre, mais simplement des immigrés économiques en provenance d’anciennes parties de l’empire et fuyant la misère ou les difficultés. Il ne s’agissait pas alors de droit d’asile.
Je suis d’accord avec ce qu’ont dit très justement plusieurs orateurs, à l’instar de mon amie Valérie Létard : il faut d’abord régler le problème de la guerre. Monsieur le ministre, vous avez été polémique à la fin de votre intervention et essayé de nous mettre en difficulté sur Schengen. À cet égard, dois-je vous rappeler les déclarations de Pierre Joxe hier ou celles d’un certain nombre de députés socialistes ? M. Malek Boutih a notamment tenu des propos qui ne vont pas exactement dans le sens du Gouvernement, preuve qu’on se pose des questions à gauche comme à droite.
Lorsque nous avons examiné la loi relative à la réforme du droit d’asile, vous nous avez annoncé que la France devrait accueillir 9 000 réfugiés en deux ans. Depuis, les choses ont changé. L’Europe nous demande aujourd’hui d’accueillir 24 000 migrants. Soyons réalistes ! Il est désormais question non plus de quotas, mais d’un « mécanisme permanent de répartition » des réfugiés. Or le vice-chancelier allemand a déclaré devant l’assemblée allemande il y a quelques jours que la répartition des 160 000 réfugiés n’était qu’un premier pas et qu’il faudrait procéder à une deuxième puis à une troisième répartition dans les six à neuf mois à venir.
Le Premier ministre a annoncé qu’il faudrait 230 millions d’euros pour accueillir 24 000 personnes. Par conséquent…

Puis-je continuer à m’exprimer ? Je n’ai interrompu personne, et pourtant…
Le Premier ministre a déclaré qu’il faudrait finalement 600 millions d’euros en deux ans pour accueillir les réfugiés. Pourquoi pas ? Le problème est qu’il table sur 24 000 réfugiés. Or si dans le cadre du mécanisme de répartition, nous devions finalement accueillir 50 000, voire 70 000 personnes, il faudra bien dire à la représentation nationale où vous prendrez l’argent. Cet élément n’est pas dirimant, mais la représentation nationale doit le connaître. Le débat budgétaire aura bientôt lieu, et nous voudrions en savoir plus, monsieur le ministre.
D’ailleurs, les Républicains, ces gens qui, par définition n’ont pas de cœur
Sourires

J’avais également proposé la tenue d’une table ronde avec tous les partis d’opposition autour du Gouvernement. Sur de tels sujets, on peut parler, on peut expliquer les difficultés de chacun, on peut trouver des solutions.
Ainsi, j’ai entendu quelqu’un dire – je ne dirai pas qui – qu’il faudrait accueillir 15 000 ou 20 000 personnes en Île-de-France. Or j’ai écrit un rapport il y a peu sur l’hébergement : en Île-de-France, il n’y a plus une place dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile ou dans les centres d’hébergement d’urgence. On a déjà procédé à des réquisitions… §En Île-de-France, il n’y a pas de place !
Vous-même, d’ailleurs, monsieur le ministre, disiez en juin qu’il faudrait évidemment procéder à une nouvelle répartition territoriale des demandeurs d’asile, parce que la situation n’est pas tenable. Ne le niez pas ! Votre projet de loi sur ce sujet prévoit d’ailleurs une nouvelle répartition. À l’heure actuelle, entre 40 % et 50 % des demandeurs sont en Île-de-France, même si d’autres centres existent, notamment – François-Noël Buffet le sait bien – dans la région lyonnaise.
En vérité, monsieur le ministre, il ne faut pas opposer aujourd’hui ceux qui ont du cœur et ceux qui n’en ont pas. Il faut plutôt se demander où en est la société française. Le Premier ministre a tenu il y a quelques jours des propos similaires aux vôtres, non pas sur le sujet des réfugiés, mais de manière plus globale : selon lui, la société française est fracturée, fragilisée.

C’est vous qui le dites, pas nous ! Dans le même temps, vous défendez l’accueil des réfugiés, affirmant qu’il n’y a pas de souci ! Je peux comprendre les réactions humaines généreuses, mais la responsabilité première du Gouvernement est l’équilibre. Il vous faut dire ce que vous voulez faire pour les Français et comment vous pensez qu’une arrivée massive …

… serait ressentie, assimilée par l’ensemble de la population française !
Sincèrement, il n’y a pas d’opposition. Je ne connais pas un Français qui m’ait dit n’en avoir rien à faire et n’avoir ressenti aucune émotion particulière à la vue des images du petit garçon noyé. Personne, apprenant que des bateaux coulent, ne répond : ce n’est pas mon problème !
En revanche, bien des Français, bien des élus me disent ne pas y arriver, faute de logements sociaux, alors que les demandes s’accumulent et que certaines datent d’il y a deux, cinq, dix ans : il n’y a pas de moyens, pas de capacités financières, alors où va-t-on ? Il faut tout de même dire les choses telles qu’elles sont !
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain ; applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Je n’ai interrompu personne ; vous avez le droit d’avoir vos convictions, j’affirme les miennes et je crois savoir que l’opinion publique est plutôt de mon côté.
Les choses sont claires, monsieur le ministre. Le discours du Gouvernement a d’ailleurs beaucoup évolué, tant sur l’accueil que sur la réaction européenne ; je vous entends bien.
J’entends beaucoup d’incantations, de : « il faut ! » – il faut que l’Europe soit unie ! –…

C’est facile à dire ! Il faut le dire aux Polonais, aux Hongrois, aux Slovaques, aux Tchèques…

Quoi que vous disiez, leur opinion ne changera pas pour autant. L’Europe, ce sont des États, et les États peuvent dire non. Une réunion de concertation entre gouvernements européens vient d’ailleurs d’échouer. Une autre va avoir lieu, mais je crois avoir compris, d’après les déclarations des Polonais et des Slovaques, que leur détermination à parvenir à un consensus n’est pas plus forte que la fois précédente.
Alors, que va-t-on faire ? Quand on parle d’un « Schengen II », cela vous fait sourire, monsieur le ministre, mais la vérité, c’est que Schengen finira par exploser complètement. On argue que Schengen autorise le contrôle partiel, temporaire, des frontières. C’est vrai, mais enfin, lorsque chaque État en viendra, chacun de son côté, à contrôler telles portions de ses frontières, pour telle période, il faudra bien reconnaître que le système ne fonctionne plus, de tels contrôles devant rester exceptionnels. La situation présente est fort différente !
Si le système explose, monsieur le ministre, il faudra bien trouver une autre solution et refonder Schengen sur des éléments permettant à tous de se mettre d’accord. Cela vous déplaît qu’on le dise, mais c’est la vérité !
Bien des ministres allemands regrettent aujourd’hui d’avoir créé un appel d’air et avouent ne plus très bien savoir comment faire à présent. Ils ont certes eu raison de s’interroger et de finalement changer leur ligne, mais l’appel d’air a eu lieu. On a beaucoup pleuré, et à raison, et on a beaucoup critiqué la situation en Méditerranée : or maintenant, on a la voie balkanique… La Croatie vient d’annoncer qu’elle était devenue une nouvelle voie terrestre, puisque les autres fermaient. Chacun se demande ce qui se passe, les Français les premiers. On a le sentiment que l’Europe est en train d’exploser sous nos yeux…
Dans ces circonstances, le Gouvernement français évolue avec la situation, ce qui est normal, mais il ne rassure pas vraiment les Français sur ses intentions exactes. 24 000 réfugiés ? Personne n’y croit ! Alors donnez-nous d’autres éléments ! Donnez votre accord pour l’installation de centres à la périphérie de l’Europe ou des zones de guerre. On pourrait y regrouper les demandeurs d’asile, y envoyer des officiers de l’OFPRA pour étudier leurs demandes et ne faire venir qu’après ceux qui seraient admis.
Certes, on peut refuser d’accorder le droit d’asile à des migrants alors qu’ils sont déjà présents sur le territoire national, mais il est ensuite difficile de les raccompagner aux frontières. En la matière, nous sommes très loin du compte, même si je ne conteste pas, monsieur le ministre, que vous faites un effort. Alors qu’il faudrait reconduire entre 40 000 et 50 000 personnes aux frontières, seules 15 000 sont effectivement raccompagnées. Votre effort n’est évidemment pas suffisant, et il le sera d’autant moins si l’on doit recevoir massivement des demandeurs d’asile et des réfugiés.
En somme, monsieur le ministre, oui, il faut refonder Schengen, oui, il faut une autre attitude européenne, oui, il faut l’autorité de l’État, oui, il faut que le Gouvernement français rassure les Français, …

Vous l’avez dit vous-même dans plusieurs de vos interventions dans les mois passés : la société française est effilochée et fragilisée, et nous sommes économiquement et socialement dans une situation très difficile.
Non – et ce n’est pas moi qui le dis mais bien, à ce qu’il paraît, des gens de gauche – : nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde.

M. Roger Karoutchi. Oui, nous avons le devoir d’accueillir ceux qui souffrent et sont persécutés, mais le Gouvernement a aussi un devoir d’équilibre : il doit aussi respecter la volonté des Français et surtout, d’abord et avant tout, l’unité de la nation !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur quelques travées de l'UDI-UC.

La parole est à M. Didier Guillaume, pour le groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur, mes chers collègues, je tiens à remercier le Gouvernement d’avoir organisé ces débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ils portent sur une situation dont tout le monde reconnaît le caractère gravissime. Il est donc bon que la représentation nationale soit consultée et informée à ce sujet. Votre intervention a été claire, monsieur le ministre, et je ne doute pas que les réponses que vous apporterez à nos collègues le seront tout autant.
Nous constatons tous que la société est effilochée et fracturée, et que les Français doutent, mais c’est justement parce que la société est dans cet état que nous devons être non pas des commentateurs de la situation, mais bien des acteurs…
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Nous devons tracer la voie et indiquer là où nous voulons aller !
Le débat a été serein et tranquille ; des opinions totalement différentes se sont exprimées : telle est la force de notre assemblée.
Permettez-moi d’évoquer quelques arguments, quelques convictions qui fondent l’action que le groupe socialiste et républicain souhaite mener.
Nous sommes aujourd’hui partagés entre fierté et honte.
Je suis, nous sommes fiers de la France, fiers de notre pays, fiers de l’idéal que nous portons et qui va conduire la France à accueillir des réfugiés.
Je suis fier de ces Français anonymes qui s’engagent dans leur municipalité en disant : « Nous voulons faire un acte de solidarité et accueillir dignement ceux qui fuient les massacres et la barbarie. »
Oui, nous pouvons être fiers de ces maires et de ces communes solidaires : ils se sont immédiatement engagés, sans faire de comptabilité, sans savoir si 1 000 ou 2 000 euros, ce sera trop ou pas assez. De fait, la vie de femmes et d’hommes étant en jeu, nous ne pouvons pas nous comporter comme des experts-comptables, nous devons faire preuve d’humanité. Je le répète : nous pouvons être fiers de ces communes et de ces maires !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Nous pouvons également être fiers de notre république qui, tout au long de son histoire, n’a jamais hésité à accueillir les réfugiés politiques chassés de leurs pays par les guerres ou les dictatures. Oui, mon cher Raymond Vall, nous sommes fiers d’avoir accueilli des réfugiés espagnols ; les conditions étaient peut-être difficiles, mais vous êtes là et vous êtes aussi la force de notre pays.
Nous pouvons être fiers d’avoir accueilli les boat people…

Rappelez-vous cette période, cette migration immense qui a coloré notre pays.
De la même façon, nous sommes fiers d’avoir accueilli les Arméniens qui fuyaient le génocide de 1915, et que leurs enfants et petits-enfants vivent aujourd’hui en France. Je veux tous les saluer. J’ai également une pensée pour Charles Aznavour, qui, hier soir, à 91 ans, a débuté son concert par sa chanson Les Émigrants, en l’expliquant et en argumentant en faveur de l’accueil des réfugiés.
Quand on est Arménien, réfugié espagnol, petit-fils de boat people, ou un simple républicain ayant la république chevillée au corps, quand on aime la France, on ne se demande pas où nous en sommes, on se dit que, oui, on a le devoir d’accueillir les immigrés, même si cela est compliqué !
Ce sentiment de fierté, nous pouvons tous le partager.
Cela étant dit, et je le dis très tranquillement, très sereinement, nous éprouvons aussi un sentiment de honte. Cette honte, nous l’assumons aussi.
J’ai honte de ce que certains responsables politiques français ont dit. Pour des raisons peut-être objectives, ou tout simplement par posture politicienne pré-électorale, ils s’engagent sur des voies qui ne sont pas dignes de notre nation et de notre république. S’appuyant sur les instincts et les peurs les plus vils, ils veulent choisir les réfugiés en fonction de leur engagement communautaire, de leur religion... Or le droit d’asile ne se découpe pas entre religions ! Il est un et indivisible, comme vous l’avez bien dit, monsieur le ministre.
J’ai honte pour ceux qui comparent l’afflux de réfugiés aux invasions barbares ! Mais enfin, quelle est cette comparaison, et de qui se moque-t-on ?
Je suis abasourdi par la position de certains maires, mais c’est leur choix le plus complet, ils sont responsables dans leur mairie.
Je suis effaré qu’un ancien ministre, un élu de haut rang, ayant lui-même des origines étrangères, ait pu, même si c’était sur le ton de la boutade, et même s’il s’est ensuite excusé, dire ce qu’il a dit sur l’Allemagne, les juifs et les Arabes. Le seul fait qu’il l’ait pensé montre bien que la bête immonde surgit de nouveau dans certains cerveaux.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Je suis tout aussi effaré lorsque j’entends un autre responsable politique comparer l’arrivée des immigrés à une fuite d’eau dans une cuisine.
Si je respecte les positions et les convictions des uns et des autres, je pense que de tels propos entretiennent le doute, la fracture, les divisions et sont source de problèmes.

M. Didier Guillaume. J’en viens maintenant aux propositions que nous souhaitons faire.
Marques d’ironie sur les travées du groupe Les Républicains.

Les propos que je viens de rapporter ne sont pas notre France et ne correspondent pas à notre modèle républicain. Il faut le dire, l’Europe – et la France dans l’Europe – est face à son destin, elle se trouve aujourd’hui à un tournant de son histoire. Cette Europe qui s’est construite au fil des années, qui s’est regroupée, élargie – parfois avec difficultés –, cette Europe dont doutent nombre de nos concitoyens – le référendum de 2005 l’a montré, les dernières élections européennes l’ont confirmé –, cette Europe doit agir, et agir vite, sinon elle sera débordée.
Je tiens à remercier le Gouvernement d’avoir octroyé des moyens supplémentaires à l’OFPRA.
Nous accueillons tous les réfugiés, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent bénéficier du droit d’asile. En revanche, comme vous l’avez très bien souligné, monsieur le ministre, il faut reconduire à la frontière ceux qui n’ont pas à être dans ce pays. Nous devons le dire très clairement. Nous parviendrons d’autant mieux à le faire, mes chers collègues, que ce Gouvernement s’est donné les moyens de procéder à ces reconduites à la frontière, après les baisses d’effectifs et de budget, après la casse dans le service public.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Est-ce assez ? Peut-être pas, mais il faut avancer.
Sur ce sujet, rassemblons-nous, refusons l’opposition stérile, car c’est de femmes et d’hommes qu’il s’agit. Tout le monde a été ému par la photo de ce petit garçon sur la plage. Pourquoi son père, son oncle et son grand-père n’auraient-ils pas le droit de venir en France, s’ils peuvent bénéficier du droit d’asile ?
La France doit agir avec humanisme et fermeté, mais sans naïveté. C’est ce que fait le Gouvernement. Comme l’a confirmé le ministre de l’intérieur, le droit d’asile est un droit fondamental. En outre, depuis que le Sénat a voté très largement la loi relative à la réforme du droit d’asile, nous avons les moyens d’aller un petit peu plus loin.
Je le répète, pour l’Europe, cette situation constitue un tournant. Elle la met face à elle-même.
Mes chers collègues, même si c’est difficile, il faut que la France, par les voix de son Président de la République, de son Premier ministre et de son ministre de l’intérieur, affirme, dans les Conseils « Justice et affaires intérieures » et dans les Conseils européens, que l’Europe entière doit s’organiser, que Schengen n’est pas mort, que l’Europe est forte de son histoire. Si à chaque fois qu’une difficulté surgit, on casse le thermomètre, comment avancer ?
Mettre en place des hot spots, comme cela a été évoqué, permettra de contrôler l’arrivée de migrants à l’extérieur des frontières de Schengen. En revanche, tout migrant en situation régulière et bénéficiant du droit d’asile à l’intérieur de l’espace Schengen peut rester en Europe et repartir dans son pays dès qu’il le décide. Il s’agit là de principes fondamentaux, et c’est pour cela que l’Europe doit s’organiser.
Le Président de la République a annoncé la tenue d’un sommet mondial sur ces sujets. La France seule, l’Europe seule ne pourront pas y arriver : il faut discuter avec les Russes, avec l’Iran, avec les États-Unis. Il faut se réunir pour affronter ensemble la question de la guerre en Syrie, des camps de réfugiés au Liban et en Turquie.
Il ne faut pas faire preuve d’aveuglement ; il faut au contraire ouvrir les yeux.

Imaginons ce qui serait arrivé si nous avions suivi ceux qui étaient favorables au Grexit, c’est-à-dire à la sortie de la Grèce de l’Europe : qu’en serait-il des réfugiés aujourd’hui ? Il faut donc toujours raison garder et chercher à relever les défis, même quand c’est difficile. C’est ce que fait le Gouvernement.
Federica Mogherini, la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a eu raison de poser la question en ces termes : « Si nous refoulons les réfugiés, quel message envoyons-nous au monde ? » Oui, quel message, mes chers collègues ?
La France et l’Europe sont attendues à l’échelon international et doivent avancer. Il faut que les chefs d’État et de gouvernement prennent des décisions.
Les murs et les barbelés n’empêcheront pas les migrants de passer. Cet afflux est terrible et nous savons que nous devons lutter contre les filières clandestines : un tel travail est indispensable. Il faut lutter contre les passeurs, les punir, renvoyer chez eux ceux qui n’ont rien à faire ici, mais accorder le droit d’asile à ceux qui fuient leur pays en guerre et les accueillir.
Je conclurai en rappelant quelques idées simples.
L’arrivée des réfugiés ne changera pas la nature de notre pays, pas plus qu’elle ne remettra en cause notre système social ou ne mettra à mal notre équilibre social. Il faut cesser de faire peur.
Les Français ont compris qu’ils pouvaient accueillir ces réfugiés. Il faut maintenant que tout le monde s’y mette : l’État – il prend ses responsabilités –, les associations, les communes, les élus locaux. Il faut également remercier celles et ceux qui tissent cette toile pour réussir à accueillir les réfugiés.
Monsieur le ministre, je tiens à vous saluer très chaleureusement. Aujourd’hui, grâce à votre hauteur de vue, vous montrez votre capacité à vous saisir de l’ensemble de ces dossiers. Vous représentez la France au plus haut niveau et nous pouvons être fiers de votre présence à ce poste. Je vous le dis avec beaucoup de simplicité, et beaucoup de nos collègues le pensent : vous êtes notre fierté, car vous êtes un véritable républicain, vous défendez la France et avez une vision d’ensemble des actions à mener.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Murmures ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Notre pays a besoin de confiance, pas de suspicion. Il convient de rappeler des principes simples, notamment qu’il faut faire preuve de fermeté face à l’immigration irrégulière. Pour obtenir des résultats, il faut des moyens. Pour être accepté, l’accueil des réfugiés doit être maîtrisé, nous pouvons tous nous accorder sur ce point ; telle est la volonté de ce Gouvernement et de sa majorité. Mes chers collègues de l’opposition, vous ne cessez de répéter que ce n’est pas le cas ; j’espère que le ministre de l’intérieur vous communiquera des chiffres dans quelques instants.
Il faut aussi de la cohérence dans les discours. On ne peut pas céder à tous les populismes, à toutes les démagogies. Ce n’est pas parce que la situation est difficile qu’il faut dire aux Français ce qu’ils veulent entendre. Il nous faut réaffirmer nos valeurs fondamentales tout en répétant que, dans la difficulté, nous ferons en sorte d’assurer l’égalité de tous les ressortissants et de tous les Français sur notre sol.
M. Karoutchi a raison, maîtriser la situation n’est pas simple. C’est la raison pour laquelle plus nous serons rassemblés, mieux nous y parviendrons. Cela suppose un engagement inlassable du Président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement tout entier à l’échelle européenne. La réponse passera par là.
Nous devons rester fidèles à la France, à son histoire et à ses valeurs. Nous avons évoqué tout à l’heure tous ceux qui sont venus en France. L’Europe a été une terre d’accueil, un exemple pour l’ensemble des populations du monde.
Oui, nous voulons continuer à être ce que nous sommes et ne pas changer. Oui, nous voulons réaffirmer des principes simples, notamment que la liberté, l’égalité et la fraternité sont les valeurs fondamentales et cardinales de notre pays. Oui, nous voulons affirmer clairement que la France a un rôle à jouer dans l’Europe. C’est pourquoi, monsieur le ministre, le groupe socialiste et républicain soutient l’action du Gouvernement, en particulier la vôtre, dans ce moment très difficile.
Certains déplorent que le Gouvernement évolue.

Il évolue parce que la situation elle-même évolue. Certains discours qui ont été tenus ici même l’année dernière ne le seraient plus aujourd'hui. C’est parce que la situation devient terrible, dramatique, que le Gouvernement a raison d’évoluer.

Il le fait en conservant ses valeurs, ses orientations. Il a également raison d’affirmer que, grâce à l’action des politiques européennes et nationales, nous parviendrons, à l’intérieur de l’espace Schengen - cette zone ne doit pas être balayée, elle doit être un lieu de prospérité –, à la fois à accueillir les réfugiés dignement, à défendre et à promouvoir nos valeurs et à faire en sorte, demain, de régler le problème de la Syrie et celui de l’Irak, avec la communauté internationale.
Si l’intervention en Irak n’avait pas eu lieu il y a quelques années – la France avait à l’époque adopté une position très claire –, nous n’en serions peut-être pas là aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE. – M. Jean Desessard applaudit également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie tout d’abord l’ensemble des orateurs de la contribution très utile qu’ils viennent d’apporter à ce débat et du caractère respectueux de leurs propos face à ce problème humain. Je partage d’ailleurs la remarque de M. Karoutchi : non, il n’y a pas ceux qui ont du cœur et ceux qui n’en ont pas. Je ne l’ai jamais pensé et j’ai même toujours nourri une certaine prévention à l’encontre de ceux qui, lorsque les situations sont extrêmes et les difficultés humaines très grandes, considèrent que l’exercice parfois narcissisant de la démonstration des sentiments suffit à faire une bonne politique.
La situation est plus complexe et il ne faut effectivement pas dire qu’il faut accueillir des réfugiés si on n’est pas en mesure de le faire. Le devoir moral et politique doit même nous conduire, plutôt que d’exhiber des sentiments ou d’administrer des ordonnances en forme de leçons, à essayer de créer les conditions de la « soutenabilité » de ce que nous proposons et à organiser l’accueil. Tel est bien l’objectif du Gouvernement aujourd’hui. Il ne s’agit pas pour lui de donner des leçons d’humanité, ni de douter des capacités de l’opposition à démontrer son humanité.
Ce n’est pas la capacité des uns ou des autres à faire un geste humanitaire lorsque des situations tragiques surviennent que je conteste. Je conteste les solutions qui sont mises sur la table pour régler le problème.
Je souhaite revenir au fond de l’affaire. Le drame humanitaire est tellement grand, la crise européenne tellement vaste, les problèmes mondiaux à l’origine de cette crise sont tellement complexes que des solutions politiques sont nécessaires.
À l’échelon international, européen, national, la France est dans l’action. On peut contester telle ou telle orientation de sa politique, mais on ne peut pas contester qu’elle cherche des solutions.
Tout à l’heure, monsieur Karoutchi, vous avez affirmé que nous accueillerons 20 000 réfugiés après avoir pris la décision d’en accueillir 6 752. Vous avez souligné l’inquiétude des Français et vous vous êtes interrogé sur la volonté du Gouvernement de répondre à cette question : jusqu’où cela ira-t-il ?
Vous avez raison, la situation sera inquiétante aussi longtemps que l’on ne traitera pas le problème dans sa globalité. Si aucune solution politique ne se dégage en Libye, si la mission de Bernardino León n’aboutit pas à un dispositif qui permette à l’État libyen de jouer son rôle, les mêmes organisations internationales du crime continueront d’agir en Libye et poursuivront leur œuvre funeste en incitant des migrants de plus en plus nombreux à emprunter le chemin de la mort, c’est-à-dire à se diriger vers l’Union européenne.
Il faut donc une solution politique en Libye, comme il en faut une en Syrie. Pendant que nous procédons à ces vols de surveillance, pendant que, comme l’a indiqué le Président de la République, nous frappons les terroristes de Daech, nous devons continuer à travailler pour qu’une solution politique se dégage en Syrie, qui associe les dirigeants actuels les plus modérés et l’opposition modérée pour sortir de cette crise, mais pas Bachar al-Assad.
Des dispositifs européens sont nécessaires pour y parvenir. Il faut un dialogue avec les pays de provenance et la mise en place de centres de maintien et de retour. Cela suppose une approche globale. C’est en agissant sur tous les aspects du problème, en intervenant sur chaque front que nous parviendrons à des solutions permettant de maîtriser le flux. Telle est bien la politique de la France.
Par ailleurs, il nous faut être en mesure de fournir une solution d’accueil à ceux que nous prétendons recevoir. C’est un problème de fond. Valérie Létard, Roger Karoutchi, Éliane Assassi et même Didier Guillaume – alors qu’il soutient le Gouvernement – ont formulé un certain nombre d’interrogations sur notre capacité à faire face.
Je serai extrêmement précis sur ce point : nous n’avons aucune chance d’y parvenir si nous n’organisons pas l’administration de l’État à cette fin. C’était l’objet de la loi relative à la réforme de l’asile. Avant même que ce texte ne soit voté, c’est-à-dire avant le mois de juillet dernier, nous avons mis en place, dans cette optique, un certain nombre de dispositifs au sein de l’administration.
Nous avons ainsi significativement augmenté les moyens de l’OFPRA. Près de soixante emplois ont été créés en deux ans, contre à peine quarante en cinq ans, alors que la demande d’asile – je ne le dis pas pour faire polémique, ce sont des éléments objectifs – a doublé entre 2007 et 2012, comme cela a été à maintes reprises souligné lors de l’examen de la loi relative à la réforme de l’asile.
Monsieur Karoutchi, l’an dernier, la demande d’asile en France a diminué de 34 % ; les chiffres sont incontestables. Elle est étale depuis le début de l’année, mais elle augmentera significativement en 2015 si nous mettons en place des dispositifs de relocalisation. Il nous faut nous y préparer.
Les décisions annoncées par le Premier ministre cet après-midi permettront de créer à l’OFII, à l’OFPRA et dans les préfectures près de 250 emplois, en incluant ceux qui ont déjà été créés. Nous serons ainsi en mesure de mettre en place le guichet unique ou, tout simplement, comme le suggérait tout à l’heure Valérie Létard, d’appliquer la loi, en réduisant substantiellement la durée de traitement des dossiers de demande d’asile.
Toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, ces actions ne suffiraient pas sans création de nouvelles places d’hébergement. À cet égard, nous avons décidé de remettre à niveau les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
C’est ainsi, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous avons créé et budgété, depuis le début du quinquennat, 13 500 places en CADA, quand on n’en avait créé que 2 000 au cours de la précédente législature.
Le Premier ministre a indiqué cet après-midi que, compte tenu du processus de relocalisation dans lequel nous étions engagés, 5 000 places supplémentaires seraient créées, ramenant le nombre total de places créées en CADA pendant la durée du quinquennat à 18 500, là où le rapport de Mme Létard et de M. Touraine préconisait la création de 20 000 places. Il n’en manque donc que 1 500 par rapport à l’objectif que les auteurs de ce rapport avaient fixé. Cela montre que nous sommes engagés dans une véritable remise à niveau du dispositif de l’asile en France.
Enfin, nous avons décidé, au mois de juin dernier, de créer 11 000 places d’accueil supplémentaires : 1 500 places d’accueil d’urgence, 5 000 places dans les logements de droit commun – nous pourrons ainsi permettre à ceux qui ont déjà le statut de réfugié de sortir de l’hébergement d’urgence en CADA et aux Français en situation de précarité d’avoir accès au logement – et 4 000 places supplémentaires en CADA. Mme la ministre du logement, dont je voudrais saluer l’engagement sur ce sujet, a joué, avec son cabinet et ses services, un rôle déterminant pour que ces places soient rapidement créées. La semaine prochaine, nous réunirons le comité de pilotage et nous rendrons compte du travail qui a été fait pour ouvrir ces 11 000 places.
Je précise par ailleurs que le système de relocalisation au niveau de l’Union européenne, nous ne l’avons pas subi, nous l’avons proposé ! Et si nous avons décidé d’accueillir 30 000 réfugiés dans ce cadre, nous ne l’avons pas fait à la dernière minute, parce qu’on nous l’aurait imposé, mais parce que nous avons nous-mêmes conçu ce dispositif de relocalisation. Nous avons inspiré la politique de la Commission et nous nous sommes organisés sur le plan national pour être à la hauteur de l’enjeu.
Je m’adresse là tout particulièrement à Mme Benbassa, qui a raconté ce soir à la tribune de cet hémicycle des choses qui sont totalement contraires à la réalité de ce que nous faisons.
Qu’il s’agisse du nombre de places créées, de l’engagement de la France au sein de l’Union européenne ou de la mobilisation du Gouvernement, notre action est l’exact contraire de ce que vous avez décrit, madame la sénatrice. Mais je comprends que, lorsqu’on théorise à longueur de pages de journaux le « Waterloo moral », à un moment donné, il faut bien trouver des arguments pour alimenter la démonstration. Et comme vous ne trouvez pas d’arguments dans la réalité, il vous faut les chercher ailleurs !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.
Permettez-moi de regretter vivement une telle attitude, car, sur des sujets aussi sérieux, on aurait pu espérer que vous regardiez le travail accompli par ceux qui ne parlent jamais et qui se préoccupent vraiment de la situation des personnes en détresse, plutôt que de prendre des postures pour vous donner le beau rôle ! §Toutefois, vous conviendrez avec moi, madame la sénatrice, que ce n’est sans doute pas la meilleure manière d’avoir les trois minutes qui comptent sur les chaînes d’information !
Du reste, je pense même que, le soir, certains qui ne passent pas à la télévision après avoir fait de telles déclarations parlent aux caméras de surveillance de leur parking pour être sûrs de figurer sur un écran !
Rires et applaudissements sur les mêmes travées. - M. Gérard Longuet applaudit également.
Oh, monsieur Joyandet, la vérité est toujours à la hauteur d’un débat, à plus forte raison lorsqu’il porte sur des problèmes humanitaires ! Les faits, cela compte ! On ne peut pas, sur des sujets de ce type, raconter systématiquement des choses contraires à la réalité, aux actes et aux politiques conduites, simplement pour être certain d’être remarqué. La vérité, cela compte en politique !
Lorsque Pierre Mendès France exigeait « la vérité la plus grande sur les sujets les plus sensibles », il ne dérogeait pas à son rôle, mais se plaçait au contraire au niveau de sa fonction.
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.) À certains moments, il faut être capable de remettre la réalité au cœur du débat, et c’est ce que je voulais faire aujourd’hui en répondant à Mme Benbassa.
Mme Sophie Primas s’exclame.
Il y a eu, sur ce sujet, trop d’approximations, trop de manipulations, trop de contrevérités. À un moment donné, il faut être capable de convoquer les faits et de remettre les choses à leur place. Ce qui n’est pas la hauteur, c’est d’abaisser la politique en se livrant à des approximations, des amalgames, des mensonges et des postures sur des sujets aussi sérieux. §
Mesdames, messieurs les sénateurs, il reste beaucoup à faire sur ces sujets. Nous devons agir dans l’esprit de votre intervention, monsieur Vall, à laquelle j’ai été très sensible, c’est-à-dire avec de la sincérité, de la générosité et de l’engagement.
Au-delà de ce qui nous différencie, je suis convaincu que, avec la volonté de nous conformer à notre tradition et à nos valeurs, nous y parviendrons. Je suis confiant dans la capacité de notre pays et de l’Union européenne à faire face au défi auquel nous sommes confrontés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.

Nous en avons terminé avec le débat sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 6 bis.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1103 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 4623–4 à L. 4623–8 du code du travail sont applicables aux infirmières exerçant dans les services de santé au travail.
La parole est à M. Jean Desessard.

Les infirmières exerçant dans les services de santé au travail sont amenées à exercer de plus en plus de responsabilités. Cependant, leur statut est beaucoup moins protecteur que celui des médecins du travail, ce qui les expose particulièrement aux pressions de leurs employeurs.
Cet amendement vise donc à étendre aux infirmières exerçant dans les services de santé au travail les dispositions de la sous-section « Protection » de la section du code de la santé publique consacrée aux médecins du travail.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 499 rectifié est présenté par MM. Marseille, Maurey et Bockel.
L'amendement n° 1139 rectifié est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 1161 est présenté par M. Bonnecarrère.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »
L’amendement n° 499 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 1139 rectifié.

L’infirmier de santé au travail, IST, contribue à la protection de la santé physique et mentale des salariés sur le lieu de travail, en collaboration étroite avec le médecin du travail. Il participe ainsi à la surveillance de la santé des salariés, prend en charge les soins d’urgence et met en place des actions de prévention. Son rôle est essentiel, notamment en raison de la pénurie des médecins du travail.
Si la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail a été l’occasion de réaffirmer le principe de l’indépendance des médecins du travail, ce principe ne s’applique pas aux infirmiers de santé au travail. Pourtant, l’indépendance professionnelle est un fondement de la relation entre un infirmier et un patient. C’est ce manque que cet amendement tend à combler.

L’amendement n° 1161 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Nous comprenons l’objet de ces amendements, mais il ne semble pas possible de répondre à la demande de leurs auteurs, qui proposent de modifier le code du travail alors que nous travaillons sur le code de la santé publique.
La commission sollicite donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
Il est proposé, dans ces deux amendements, que soit prévu un statut particulier pour les infirmiers et les infirmières qui exercent leur métier dans les services de santé au travail. Or ces professionnels de santé bénéficient déjà d’une indépendance technique. En revanche, ils n’ont pas, c’est vrai, le même statut que les médecins du travail, qui disposent d’un statut de salarié protégé.
En effet, les infirmiers qui exercent dans ces services ne sont pas habilités, contrairement aux médecins du travail, à prendre des décisions individuelles. Par exemple, ils ne peuvent pas prononcer une décision d’inaptitude, décision qui relève du seul médecin.
Ces infirmiers sont, d’une certaine façon, protégés par l’indépendance technique, mais il n’y a pas de raison de les soumettre à un statut de salarié protégé comme les médecins du travail.
C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de m’avoir donné une explication détaillée et compréhensible.
En revanche, madame la corapporteur, votre explication ne me satisfait pas. Dès lors qu’il est question de santé au travail, il y a discussion, car nous sommes à la frontière entre le code du travail et le code de la santé publique. Notre assemblée aura de toute façon à examiner prochainement le code du travail. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? J’ai trouvé, madame la rapporteur, sans vouloir vous offenser, que la réponse de Mme la secrétaire d’État, était plus complète et plus explicite.
Quoi qu'il en soit, je maintiens l’amendement.

Vous admettrez, monsieur le sénateur, que votre amendement, même s’il traite des professionnels de santé, n’est pas relatif à la santé et qu’il ne porte que sur des modifications du code du travail.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 846 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont tenus de noter, le cas échéant, la cause environnementale de la pathologie. Les services des ressources humaines effectuent annuellement un relevé de ces causes. »
La parole est à M. Jean Desessard.

Dans son très bon rapport publié le 15 juillet 2015, la commission d’enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l’air a mis en exergue, de manière consensuelle, la faiblesse du dispositif de santé environnementale dans notre pays, notamment en matière de données exhaustives disponibles.
Ainsi dans sa proposition n° 20, la commission d’enquête préconise-t-elle une évaluation du coût financier de l’absentéisme lié à la pollution de l’air et aux pics de pollution.
Par cet amendement, nous entendons, de manière générale, permettre un meilleur recueil des données.
Dans le cadre des auditions menées par la commission d’enquête, la Direction générale du travail du ministère du travail a indiqué qu’elle ne connaissait pas le nombre de journées d’incapacité temporaire dues à une pathologie liée à la pollution de l’air.
Or la simple mention, sur l’arrêt de travail rempli par le médecin, du fait que la pathologie est liée à une cause environnementale permettra aux organismes d’assurance maladie obligatoire, notamment, d’être mieux à même d’identifier les dépenses liées à des épisodes environnementaux, de ne plus être des payeurs aveugles et de pouvoir mieux anticiper.
Ainsi, dans la mesure où ce projet de loi consacre son chapitre IV aux risques sanitaires liés à l’environnement, il paraît essentiel que ces organismes soient en mesure d’identifier les causes environnementales qui sont à l’origine de certaines pathologies.

Cher collègue, je comprends très bien la préoccupation qui sous-tend cet amendement. Toutefois, je me pose une question pratique : comment les médecins pourront-ils établir par écrit les causes des pathologies qu’ils observeront quand on sait, par exemple, que certaines maladies sont multifactorielles ? Nous savons tous qu’il est particulièrement difficile de déterminer avec certitude les causes exactes et précises d’une pathologie. Une telle disposition nous semble donc vraiment difficile à mettre en œuvre.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, votre objectif est tout à fait louable : l’idée de chercher à évaluer, à partir des arrêts de travail, la part des causes environnementales dans les pathologies, de manière à faire progresser l’épidémiologie de façon globale, procède d’une bonne intention. Mais ce n’est pas ainsi qu’on fait de l’épidémiologie.
Il s’agit d’une discipline scientifique, qui s’appuie sur une méthodologie stricte, laquelle ne peut se réduire au collationnement de simples certificats médicaux sur lesquels aura été cochée une case indiquant l’existence d’une cause environnementale. Il faut mener des études de cohortes et on ne saurait s’en remettre à la subjectivité du médecin qui remplit l’arrêt de travail si l’on veut aboutir à des conclusions fiables sur le plan scientifique.
De surcroît, peut également se poser la question de la confidentialité d’un certain nombre d’éléments figurant sur le certificat d’arrêt de travail.
Mais l’objection principale reste clairement celle qui concerne la validité scientifique de ce type de données. En épidémiologie, on compare la fréquence d’une maladie au sein d’un groupe de personnes exposées à un facteur de risque à celle d’un groupe de personnes non exposées. Il ne s’agit pas de prendre des populations au hasard et de se fonder sur la seule déclaration de médecins qui remplissent des arrêts de travail pour déterminer si des personnes ont été ou non exposées à une pollution.
La finalité d’un arrêt de travail n’est pas de s’inscrire dans une étude épidémiologique, c’est d’ouvrir droit à des indemnités journalières. Ou alors, il faut revoir complètement la façon dont sont conçus les arrêts de travail.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J’adhère totalement à l’argumentation de Mme la secrétaire d'État, tant sur la validité scientifique que sur la confidentialité.
Ce n’est effectivement pas ainsi que l’on conduit des études épidémiologiques, sauf éventuellement à identifier un lieu de travail qui pourrait poser des problèmes en matière de santé environnementale, ce qui suppose alors que soit mise en place une méthodologie d’analyse épidémiologique.
Par ailleurs, sur le sujet de la confidentialité, je souligne que l’arrêt de travail est un document administratif. Dès lors qu’on y introduirait des renseignements personnels sur le travailleur, il y a le risque de violer le secret médical, ce qui pourrait être extrêmement délétère pour le travailleur concerné.
Pour ces deux raisons, que Mme la secrétaire d'État a parfaitement explicitées, cet amendement ne doit pas être adopté.

Madame la secrétaire d'État, je ne comprends pas : si, comme vous l’avez dit au début de votre intervention, mon objectif est louable, il faut se donner les moyens de l’atteindre !
La formidable enquête – à laquelle ont participé l’ensemble des groupes politiques du Sénat – qui a été réalisée a montré l’importance extraordinaire du coût sanitaire de la pollution. Il est estimé à 1 000 milliards d'euros…
Sourires.

Madame la secrétaire d'État, je pourrais admettre que vous me disiez, puisque mon objectif est louable, que ce que je propose est insuffisant, et j’accepterais alors volontiers de rectifier mon amendement. Mais vous ne proposez rien d’autre ! Dès lors, il ne fallait pas me dire que mon objectif était louable, il fallait d’emblée me dire : « Il y a une pollution, les gens s’absentent, on n’y peut rien ! »
Je propose qu’une mention soit portée sur le certificat : « Non, on n’y peut rien ! ». Je propose que le médecin puisse constater que telle personne a été exposée aux pollutions, et vous m’opposez aussitôt le secret médical. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il faut bien, à un moment, qu’on puisse juger si, effectivement, il y a eu pollution ou non, si c’est un phénomène qui se développe.
On peut imaginer un document complémentaire, une petite fiche annexe qui concernerait les atteintes subies à cause de la pollution. Vous pourriez me proposer autre chose ! Or, tout en admettant que ma proposition est louable, que le coût de la pollution est élevé, que le problème est important, vous vous contentez de dire : « On ne peut rien faire ». C’est cela qui est grave !

Cher collègue, ce qui est « louable », c’est votre intention, mais non sa réalisation.
Vous admettrez qu’il n’est pas forcément possible de tout faire. Dans le cas présent, vous voulez demander aux médecins d’apporter des éléments probants sur telle ou telle pathologie qu’ils auraient à observer. Or nous avons tous entendu, ces derniers jours, que les médecins sont déjà complètement débordés. Ils sont peu nombreux, notamment dans certaines parties de notre territoire. Ils disent eux-mêmes qu’ils font plus de travail administratif que de médecine. On ne peut pas augmenter encore la charge qui pèse sur leurs épaules en leur demandant de remplir une case supplémentaire sur un questionnaire concernant la cause environnementale, ou non, de telle ou telle pathologie.
Pour autant, je suis sûre que la conscience des médecins et leurs bonnes pratiques les portent déjà, lorsqu’ils observent un problème récurrent, à en faire état auprès des instances compétentes.

Monsieur Desessard, je ne vais pas revenir sur ce qu’ont dit Mme Doineau et Mme la secrétaire d'État et que je partage entièrement.
J’ajouterai simplement ceci : d’après l’objet de votre amendement, vous envisagez « la simple mention, de la part du médecin, sur l’arrêt de travail que la pathologie est liée à une cause environnementale »... C’est à croire que vous n’avez jamais vu d’arrêt de travail de votre vie ! Un médecin qui remplit un arrêt de travail met le nom du patient, il appose son cachet, il coche le nombre de jours d’arrêt, il précise si les sorties sont ou non autorisées, et c’est tout ! Il n’indique pas la pathologie et ne saurait pas faire de commentaires sur les causes supposées de celles-ci, qu’elles soient environnementales ou non ! Ce que vous proposez n’a rien à voir avec un arrêt de travail !

C’est un certificat médical, à la rigueur, mais ce n’est pas un arrêt de travail !
Par conséquent, outre les motifs qu’ont exposés Mme le rapporteur et Mme la secrétaire d'État pour justifier l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, l’objet de votre amendement est mauvais.

Avec cet amendement, on n’est pas du tout dans la vie réelle !
Premièrement, lorsqu’un médecin établit un arrêt de travail, dans le cas où il s’agit d’un accident de travail, il inscrit un diagnostic. Ce diagnostic est totalement confidentiel ; c’est la moindre des choses !
Deuxièmement, je pense qu’il y a très peu de cas où un médecin, en toute bonne foi, pourra dire que la maladie qu’il diagnostique lorsqu’il établit l’arrêt de travail est causée par l’environnement. Il est exceptionnel qu’une maladie soit exclusivement causée par l’environnement, sauf lorsque survient un accident dans l’entreprise qui engendre une pollution massive, par exemple. Le reste du temps, quand existe une pollution que l’on pourrait qualifier de « normale », telle que la pollution à l’ozone ou celle qui survient en cas de forte chaleur, il est, selon moi, impossible de dire si cette pollution a entraîné la maladie.
Pour conclure sur cette question, je voudrais rassurer M. Desessard.
Sourires.
En France, l’Institut de veille sanitaire est chargé de conduire des études épidémiologiques. De leur côté, les médecins épidémiologistes de la France entière travaillent en permanence. C’est ainsi que quantité d’études cliniques et de cohortes ont été et sont publiées concernant l’impact de l’environnement sur toute une série de pathologies.
Aborder cette question par le biais des arrêts de travail n’est pas de bonne méthode, et cela notamment pour une raison toute simple : on peut très bien être malade du fait de son environnement sans pour autant être en arrêt de travail ! On peut également être malade à cause de l’environnement, tout en n’ayant pas d’emploi, par exemple parce que l’on est femme au foyer. Vous ne prendrez pas en compte toutes ces personnes lorsque vous mènerez des études quantitatives à partir des arrêts de travail !
Que ferez-vous donc avec les chiffres que vous récolterez, dès lors qu’ils ne refléteront pas l’impact de tel ou tel environnement sur telle ou telle pathologie, car vous ne prendrez pas en compte toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n’étaient pas en arrêt de travail à ce moment-là.
Ainsi, vous, sénateur, imaginez que vous soyez malade à cause de votre environnement…
Rires.
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Vous n’aurez pas d’arrêt de travail !
Mêmes mouvements.
Comment fera-t-on alors pour vous prendre en compte dans les statistiques ?

M. Jean Desessard. Il est vrai que les sénateurs absents en ce moment ne sont pas en arrêt de travail !
Sourires.
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. En tout cas, tous ne sont pas absents à cause de l’environnement !
Nouveaux sourires.
Je le répète, votre intention est louable, mais la méthode que vous proposez de retenir n’est pas la bonne si l’on veut réaliser une étude pertinente sur les pathologies induites par l’environnement.
Du reste, les parlementaires ne sont pas là pour établir les protocoles scientifiques d’épidémiologie : c’est le métier des épidémiologistes !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une augmentation du coefficient géographique applicable en Martinique prévu au 3° de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que sur son extension aux actes de consultation externe. Les conséquences financières pour les établissements et professionnels de santé ainsi que pour la sécurité sociale d’une telle augmentation sont notamment examinées.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Il s’agit de faire en sorte que soient examinées les conséquences d’une augmentation du coefficient géographique en Martinique, à la fois pour les professionnels de la santé et pour la sécurité sociale.
En effet, la situation financière des hôpitaux de Martinique se dégrade. Or une étude conduite en Martinique montre que le surcoût de l’insularité est de l’ordre de 30, 4 %, alors que le coefficient géographique n’est que de 26 %.

Cher collègue, on ne doute pas de l’intérêt du rapport que vous demandez, mais vous connaissez la jurisprudence que nous avons adoptée : nous avons émis un avis défavorable sur tous les amendements qui visent à obtenir un rapport supplémentaire. Nous avons été tout aussi rigoureux avec vous qu’avec d’autres.
Monsieur le sénateur, il est en effet extrêmement important de savoir comment adapter le système de tarification à des territoires particuliers comme les outre-mer. C’est déjà ce qui est pratiqué avec la tarification à l’activité qui doit être adaptée à la réalité des coûts, lesquels peuvent être différents selon que l’établissement hospitalier se situe en Île-de-France, dans un département extrêmement rural de la métropole ou dans les outre-mer.
En réalité, il existe déjà un rapport annuel remis au Parlement sur le financement des établissements de santé. Il est tout à fait possible d’y inclure un chapitre consacré au système de tarification dans les outre-mer.
Par conséquent, nous ne voyons pas bien l’intérêt de créer un nouveau rapport spécifique aux outre-mer. Le rapport annuel qui existe déjà permet de vous donner satisfaction. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement.

Mme la secrétaire d'État m’ayant donné l’assurance que les rapports annuels tiendront compte du déséquilibre entre le surcoût de l’insularité et du coefficient géographique dans les outre-mer, je retire cet amendement.
(Supprimé)

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 462 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, Monier, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 587 rectifié est présenté par Mmes Jouanno, Billon et Laborde, M. Guerriau et Mme Bouchoux.
L'amendement n° 710 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4624-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé du travail. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Il s’agit de développer le recueil et la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail, en s’appuyant sur les rapports annuels des médecins du travail.
Une étude de l’ANACT, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, publiée en 2014, démontre que, si le nombre d’accidents du travail a globalement baissé entre 2001 et 2012, il progresse nettement pour les femmes – de 20, 3% – et cela de façon encore plus marquée pour les maladies professionnelles, dont le nombre progresse près de deux fois plus rapidement – de 170 % – pour les femmes que pour les hommes sur la même période.
Or les dispositions actuelles du code du travail ne prévoient pas d’obligation concernant la production de données selon le sexe dans les rapports annuels des médecins du travail. Ainsi, par exemple, les logiciels informatiques des médecins ne prévoient pas de croiser les données recueillies avec le sexe pour synthétiser leurs résultats.
Pour remédier à cette lacune, il convient de modifier l’article L.4624-1 du code du travail, relatif aux missions du médecin du travail.

L'amendement n° 587 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 710.

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 ter tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Aux arguments que vient d’exposer Mme Meunier, et que je fais miens, j’ajouterai quelques considérations.
Il nous semble important de rendre obligatoire la présence de données sexuées dans le rapport annuel du médecin du travail sur les entreprises de son ressort.
Cette disposition présenterait au moins deux avantages : d’une part, elle permettrait d’établir des données statistiques fiables et, d’autre part, elle offrirait aux praticiens sur le terrain un retour d’expérience.
Michèle Meunier vient d’en parler : on sait que les femmes sont plus présentes dans certains métiers, notamment les plus précaires. Ainsi, les services à la personne comptent près de 98 % de femmes. On sait aussi que l’exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles n’est pas la même pour les hommes et les femmes. Toutefois, nous ne disposons pas de base statistique pour mesurer les corrélations et faire apparaître des facteurs précis.

Pourtant, la prévention de ces risques pourrait être grandement facilitée si une telle base existait. Il s’agit donc non d’un gadget, mais bien d’une réponse au besoin d’affiner le retour d’expérience des médecins du travail pour assurer la prise de décision la plus adéquate possible.
De par son rôle et sa position à l’intérieur des entreprises, le médecin du travail, dont la prévention est une des missions centrales, est le mieux à même de collecter ces données, et de s’en servir en retour.
La souffrance au travail est différenciée selon le genre ; il doit donc en aller de même de sa prévention.

Ces amendements visent en effet à rétablir l’article 6 ter tel que l’avait rédigé l’Assemblée nationale.
Pour nous, ces données différenciées selon le sexe ne constituent certes pas un gadget. Toutefois, comme vous le savez, nous avons distingué de manière très rigoureuse ce qui est d’ordre réglementaire et ce qui est d’ordre législatif.
Le rapport annuel est institué par l’article D.4624-42 du code de la santé publique. Cet article renvoie lui-même à un arrêté le soin de définir la forme que doit prendre ce rapport. Ce dispositif relève donc bien du niveau réglementaire ; ce n’est pas à la loi d’inscrire l’exigence d’établir des données sexuées dans les rapports annuels.
Du reste, la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie, que nous avons entendue au cours d’une audition, nous a indiqué qu’une étude plus approfondie de la sinistralité par rapport aux femmes était nécessaire, mais qu’elle serait facilitée par la prochaine mise en place de la déclaration sociale nominative.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les deux sénatrices qui ont défendu ces amendements ont tout à fait raison. En effet, dans tous les domaines, les femmes ont été et restent « invisibles », et les dommages causés par les différents métiers spécifiques aux femmes n’ont jamais été reconnus.
C’est d’autant plus dommageable que, de surcroît, en France, les métiers sont encore sexués. On dit très souvent que les métiers pénibles, par exemple les métiers où l’on soulève des charges lourdes, comme ceux du bâtiment, doivent être réservés aux hommes. Je suis toujours très surprise d’entendre cette affirmation, car 95 % des aides-soignants en France sont des femmes. Or elles sont amenées à soulever des personnes qui peuvent peser plus de quatre-vingts kilos, voire cent kilos ! Elles soulèvent donc des charges lourdes, mais ce travail est invisible parce que, dans les représentations collectives, ce métier n’est pas considéré comme « pénible ».
M. Jean Desessard applaudit.
Il est donc extrêmement important de pouvoir disposer de statistiques sexuées pour montrer combien les accidents du travail sont fréquents chez les femmes. Ils sont même de plus en plus fréquents pour les femmes et de moins en moins pour les hommes.
Cette situation doit nous amener à nous interroger : la prévention n’a-t-elle pas été jusqu’à présent plus efficace pour les hommes, parce que les métiers d’hommes ont fait l’objet d’études plus approfondies dans ce domaine que les métiers de femmes ? Il en va de même pour les maladies professionnelles.
Certaines dispositions relèvent peut-être davantage du domaine du règlement que du domaine de la loi, mais nous devons lutter contre les facteurs qui confinent les femmes dans certains rôles, avec pour conséquence le fait que certains accidents du travail ou maladies professionnelles restent invisibles. Il est donc important que ce principe soit inscrit dans la loi.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. Jean Desessard applaudit.

Je remercie Mme la secrétaire d’État de ses explications. Le groupe socialiste adhère pleinement à ses arguments.
Je souhaite rappeler à Mme la corapporteur que le sujet des données sexuées ne relève pas du domaine réglementaire. Nous avons examiné récemment le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi : nous avons discuté à cette occasion de la nécessité de disposer, dans le rapport de situation comparée, de données sexuées.
Mme la secrétaire d’État a fort justement utilisé le terme d’ « invisibilité » au sujet de la situation des femmes au travail. Qu’il s’agisse des conditions de travail ou de la pénibilité, il est fondamental que l’on puisse disposer de données sexuées et l’affirmation de ce principe ne relève pas du règlement, mais de la loi !
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’être favorable à ces amendements.

Je m’associe aux propos de Mme la secrétaire d’État et à ceux de notre collègue Catherine Génisson.
Depuis le début de cette discussion, les corapporteurs se montrent très attentifs au respect de la délimitation entre le domaine de la loi et celui du règlement, ce qui est bien normal. Cependant, nous abordons un domaine où beaucoup reste à faire pour que progresse l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Sur le plan symbolique, il est indispensable d’inscrire cette nécessité absolue dans la loi, a fortiori dans une loi de santé publique !
Comme l’a dit ma collègue, lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, nous avons pu mesurer l’importance des rapports de situation comparée pour disposer d’un véritable état des lieux.
Enfin, si ce type de mesure relève du domaine réglementaire, c’est au niveau du décret et non pas à celui évoqué par Mme la corapporteur.
Pour toutes ces raisons, il est important que ce principe soit inscrit dans la loi. Ce ne serait pas inutile, car nous sommes encore bien loin de l’égalité.

Je souhaite vivement que l’on fasse une application stricte de l’article 41 de la Constitution. Cela nous éviterait d’être encombrés par ce type de propositions qui relèvent du règlement et non de la loi. Mme la secrétaire d’État a elle-même déclaré qu’il faudrait modifier des arrêtés et a ainsi reconnu cette réalité.
Nous sommes en train truffer nos textes de lois de déclarations verbeuses qui n’ont rien à y faire, alors que toutes ces questions peuvent être réglées par voie réglementaire. Il va falloir opérer un tri pour ne plus passer un temps infini sur des dispositions qui n’ont pas à figurer dans la loi !

Je voulais également rappeler qu’il est temps de simplifier les textes de loi. Dans notre pays, tout le monde se plaint que l’on ne cesse d’ajouter des dispositions inutiles dans la loi…

Dans le cas présent, nous avons une illustration parfaite du travers que je viens de décrire. Cet amendement vient compléter un article qui ne fait pas référence au rapport annuel du médecin du travail, mais à des mesures individuelles. On ajoute donc à un article du code du travail un alinéa sans rapport avec ceux qui précèdent.
Puisque c’est un arrêté du ministre qui définit la manière dont doit être établi le rapport annuel du médecin du travail, la modification est très simple à réaliser, si le Gouvernement en a la volonté. Mais il n’est pas besoin de modifier la loi pour cela !

Mon cher collègue, vous avez tout faux puisque cet amendement tend bien à modifier un article du code du travail !
L’article L. 4624-1 du code du travail traite du rapport annuel du médecin du travail. Avant que la ministre du travail – puisque c’est une femme ! – puisse prendre un arrêté précisant comment doit être établi ce rapport, il faut compléter cet article du code du travail pour y indiquer que ce rapport comporte des données « genrées » !
Nous perdons peut-être du temps en insistant sur l’égalité entre les femmes et les hommes, mais je vous rappelle que, depuis deux jours, nous avons examiné à peine six articles et consacré un temps important à la publicité sur le vin dans un texte relatif à la santé publique. Bravo ! Vous avez modifié la loi Évin pour autoriser la publicité pour le vin ! La commission des affaires sociales aurait pu être mieux inspirée… Et je n’oublie pas non plus le très long débat de cet après-midi sur le paquet neutre et sur le tabac.
Je ne suis pas fumeuse et je ne bois pas. En revanche, je suis une femme et je me bats pour l’égalité entre les femmes et les hommes. S’il faut y consacrer du temps, nous le ferons et nous parlerons de l’égalité entre les femmes et les hommes !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Nous demandons que le rapport du médecin du travail comporte des données « genrées » et nous prendrons le temps qu’il faut pour expliquer que cette question est importante et relève également de la santé publique !
Protestations sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Je ne veux pas prolonger le débat, mais l’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet important. On peut considérer qu’il s’agit de banalités, mais il me semble raisonnable d’adopter cet amendement, y compris pour vous, messieurs !
Je sais bien que les femmes font leur chemin en politique, qu’elles travaillent et que c’est bien ennuyeux. Quoi qu’il en soit, leur présence est maintenant reconnue. Vous tirerez plus de gloire d’un vote en faveur de cet amendement que d’un vote contre !

Je suis surprise du tour que prend ce débat et je me permets de venir à la rescousse de mon collègue Michel Canevet, qui n’en a pourtant pas besoin ! Il n’a jamais dit qu’il ne fallait pas parler de l’égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, il a évoqué un sujet tout aussi important, celui de la sobriété, de la sagesse et de la pureté de la loi, qui ne devrait pas se trouver encombrée d’éléments qui peuvent être abordés dans d’autres textes.
Je souscris donc aux propos de mon collègue. Les femmes qui travaillent ne se sentent pas pour autant méprisées et il ne faudrait pas rouvrir des débats un peu ridicules et indignes de nous.
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain.

Mes chers collègues, nous sommes bien ici pour écrire la loi.
L’article L. 4624-1 du code du travail que vous avez évoqué, ma chère collègue, ne traite absolument pas de la présentation du rapport annuel du médecin du travail, mais des propositions du médecin du travail en matière d’adaptation des postes de travail. La disposition que vous voulez ajouter ne trouve donc pas sa place dans cet article.
La présence dans ce rapport de données différenciées selon le sexe doit être prévue par un arrêté du ministre du travail, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 ter est rétabli dans cette rédaction.
Les sénatrices du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC applaudissent.

Je souhaite répondre à Mme David, qui nous a reproché d’avoir passé trop de temps sur la cigarette, sur le paquet neutre et sur le vin. Dois-je vous rappeler, ma chère collègue, que ces questions sont tout aussi importantes que celle que nous venons d’évoquer ?
Il est intéressant d’examiner le résultat des votes, puisque vous semblez reprocher à la commission, à son président et à ses corapporteurs, de s’être attardée sur certains sujets. Or il n’y a eu que trente-sept voix pour s’opposer à l’amendement sur le vin …

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Trente-trois ? Comme chez le médecin, alors !
Sourires.

Quant à l’amendement tendant à rétablir le paquet neutre, il n’a recueilli que seize ou dix-sept voix favorables.
Le temps que nous avons passé sur ces questions a donc concerné autant les élus de la majorité sénatoriale que ceux de l’opposition. Après discussion, une très large majorité, réunissant divers groupes, a d’ailleurs pu se dégager.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, lors du scrutin n° 247 sur les amendements n° 639 et 1046 portant sur le paquet neutre, M. Pierre Camani a été comptabilisé comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

Lors du même scrutin, Mme Bariza Khiari a été considérée comme s’étant abstenue, alors qu’elle souhaitait voter contre.

Mes chers collègues, acte vous est donné de ces mises au point.
Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin concerné.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 6 ter.

L'amendement n° 1055, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625–3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-3. – Afin d’assurer un meilleur recensement des populations exposées au risque chimique dans le cadre de ses missions, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie les professions caractéristiques et lieux de travail des agriculteurs et salariés, exposés régulièrement aux produits phytosanitaires. »
La parole est à M. Jean Desessard.

Les agriculteurs ne sont pas les seuls travailleurs exposés aux pesticides et susceptibles de tomber malades du fait de ceux-ci. En effet, comme le montrent l’enquête Apache menée par Générations futures, qui a permis de trouver de nombreux résidus de pesticides dans les cheveux de travailleurs agricoles ne manipulant pourtant pas directement des pesticides, ou encore la victoire juridique des salariés de l’entreprise Triskalia, qui ont été intoxiqués par des pesticides, de nombreux travailleurs peuvent être exposés à des produits phytosanitaires.
Par cet amendement, nous proposons d’instaurer le recensement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, des professions et des personnes potentiellement touchées, et cela dans le respect de leur vie privée, ce qui permettrait de mieux détecter et de suivre les métiers à risque, et donc de mettre en œuvre des politiques de prévention plus efficaces.

Mon cher collègue, vous proposez de donner une nouvelle mission à l’ANSES en matière d’identification des professions et environnements exposés aux produits phytosanitaires.
Sourires.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je crains que vous n’en jugiez différemment en entendant la suite de mon intervention…
Nouveaux sourires.

Là encore, la définition des missions de l’ANSES est d’ordre réglementaire puisqu’elle relève de l’article R. 1313-1 du code de la santé publique. Le dispositif proposé n’est donc pas du ressort de la loi. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Je me permets en outre de vous renvoyer au rapport d’activité de l’ANSES de 2014, qui montre que cette agence réalise de nombreuses études sur ces sujets. Vous constaterez que son domaine d’expertise l’amène à produire des données que vous semblez rechercher au travers de votre amendement.
Monsieur le sénateur, une fois de plus, votre préoccupation est parfaitement légitime…
Rires.
… et le Gouvernement la partage. Effectivement, il est extrêmement important de savoir à quoi sont exposés les agriculteurs ainsi que tous ceux qui travaillent dans le secteur de l’agriculture, du fait des produits avec lesquels ils peuvent être en contact.
Cependant, je veux vous rassurer, monsieur Desessard : un travail est déjà en cours sur ce sujet. En effet, Mme la ministre de la santé a déjà saisi l’ANSES sur ce thème pour que nous sachions quelles sont non pas les professions exposées, mais les situations susceptibles d’exposer plus particulièrement les personnes à tel ou tel type de produits. En effet, on peut exercer une profession dans le milieu agricole sans forcément être soi-même exposé. C’est plutôt la situation qui est déterminante.
Un travail de bibliographie a déjà été réalisé dès janvier 2014, et le rapport définitif sur les conséquences de l’exposition aux produits phytosanitaires dans les professions agricoles doit être rendu à l’automne 2015. Il sera en outre régulièrement actualisé.
Aussi, monsieur le sénateur, je pense que vous pouvez retirer votre amendement sans aucun remords. Puisque le travail est déjà en cours à l’ANSES, il n’est pas nécessaire d’inscrire votre proposition dans la loi. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Sourires.

L’amendement n° 1055 est retiré.
Chapitre III
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé
I. – L’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides d’orientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles.
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test. »
I bis. – Après le même article L. 6211-3, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211 -3 -1. – Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d’un test rapide d’orientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6211-3.
« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le personnel mentionné au premier alinéa du présent article peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque ce dépistage s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure et qui s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »
II
Non modifié
1° À l’intitulé, le mot : « le » est remplacé par le mot : « les » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3121-1, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » ;
3° Au 1° du I de l’article L. 3121-2, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « hépatites », il est inséré le mot : « virales » ;
4° Après l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article L. 3121-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121 -2 -2. – Par dérogation au 8° de l’article L. 4211-1, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :
« 1° Les établissements de santé et les organismes désignés en application de l’article L. 3121-2 ;
« 2° Les établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-1 ou de l’article L. 3121-2-1 ;
« 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique détectant l’infection aux virus de l’immunodéficience humaine ;
« 4° Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences et prise en charge. »
II bis (Non modifié). – Au premier alinéa du I et au II de l’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, après le mot : « auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 ».
III (Non modifié). – Après l’article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -1 -18 -1. – Lorsqu’un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l’article L. 1111-5 et à l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d’assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l’ayant droit majeur qui le demande. »
IV
Non modifié
1° Au 1°, les mots : « établissements de santé et les organismes » sont remplacés par les mots : « centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic » ;
2° Le 2° est abrogé.

L'amendement n° 1056, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies auto-immunes peut être réalisé. »
La parole est à M. Jean Desessard.

Hier, nous avons longuement parlé de la maladie cœliaque, ou intolérance au gluten. Je ne reviendrai donc pas sur les chiffres de sa prévalence et de son coût.
Cet amendement vise simplement à encourager le dépistage de cette maladie ou d’autres maladies auto-immunes.

il tend à prévoir que l’arrêté qui précise les conditions de réalisation des TROD définit également les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies auto-immunes, telles que la maladie cœliaque, peut être réalisé.
L’arrêté dont il est question ne vise que les TROD pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles. Le dépistage des maladies auto-immunes est un autre sujet, qui doit être traité dans un autre cadre. Il n’existe en effet à ce jour aucun TROD commercialisé pour le dépistage de la maladie cœliaque, qui est, je le répète, une maladie auto-immune.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable, pour le cas où vous ne retireriez pas votre amendement.
L’avis est défavorable pour les mêmes raisons. Comme vient de l’expliquer M. le président de la commission, il n’existe pas actuellement de test fiable de diagnostic rapide de la maladie cœliaque.
Si vous effectuez une recherche sur Internet, monsieur le sénateur, peut-être trouverez-vous des tests qui sont présentés comme permettant de faire ce diagnostic, mais il n’y en a aucun qui ait fait la preuve de son efficacité au moyen d’études fiables. Il n’y a donc aucune raison « médicale » d’inscrire votre proposition dans la loi.

L’amendement n° 1056 est retiré.
L'amendement n° 1198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
virales
insérer les mots :
, leur traitement post-exposition
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s’agit d’un sujet très technique, que je vais tâcher de vous expliquer en termes simples.

M. Jean Desessard. Nous sommes capables de comprendre, madame la secrétaire d’État !
Rires.
Le traitement post-exposition est un traitement médicamenteux que les médecins sont susceptibles de prescrire quand ils estiment qu’une personne a pris un risque particulier l’exposant au VIH.
Jusqu’à présent, ces traitements sont délivrés dans des centres hospitaliers par des médecins spécialisés, mais également dans les services d’urgence, le besoin de ce type de traitement pouvant survenir au milieu de la nuit ou pendant le week-end. Il faut donc pouvoir avoir accès à des médecins prescripteurs dans ces cas-là.
Avec cet amendement, nous souhaitons permettre aux médecins exerçant dans ces nouvelles structures au nom absolument technocratique de CeGIDD – centre gratuit de d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles –, qui vont regrouper les consultations de dépistage anonyme et gratuit – CDAG – et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles – CIDDIST –, compétents en matière de maladies sexuellement transmissibles, de prescrire ces traitements post-exposition aux personnes venant consulter, et ce pour des raisons pratiques évidentes.
Je précise que ces traitements sont extrêmement efficaces. Depuis qu’ils sont prescrits en France, les études montrent qu’ils ont contribué à diminuer très nettement le nombre de contaminations.
Il est important de faire en sorte que les personnes concernées puissent accéder rapidement à ce type de prescription. En effet, le traitement sera d’autant plus efficace qu’elles pourront commencer à le suivre rapidement après l’exposition. Si elles attendent vingt-quatre heures ou, pis, quarante-huit heures, le traitement ne servira plus à rien.
Il faut donc à la fois qu’il s’agisse de médecins spécialisés en la matière et qu’il y ait un maximum de points de consultation possible.

La commission a évidemment émis un avis favorable sur cet amendement, qui a pour objet de confier aux CeGIDD la fourniture prompte de soins permettant aux personnes victimes d’une transmission de VIH ou du virus de l’hépatite d’être soignées le plus rapidement possible.
Nous souhaiterions seulement avoir l’assurance, madame la secrétaire d’État, que les services des urgences et les hôpitaux pourront, eux aussi, continuer de prescrire ce traitement là où il n’y pas de CeGIDD.

Je souhaite simplement remercier Mme la secrétaire d’État de son explication extrêmement claire sur un sujet très technique.
J’en profite pour demander aux autres intervenants, qu’ils présentent un amendement ou qu’ils donnent un avis au nom de la commission, d’être aussi pédagogues. Par exemple, monsieur Milon, je ne sais pas ce qu’est un « trod »...
Sourires.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 1119 rectifié, présenté par MM. Cornano et Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités préalables selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test, des conséquences d’un résultat positif et de la prise en charge par les différentes structures spécialisées du virus de l’immunodéficience humaine. »
La parole est à M. Jacques Cornano.

L’article 7 du projet de loi prévoit d’accroître la diffusion des TROD, c'est-à-dire des tests rapides d’orientation diagnostique, et des autotests. C’est essentiellement de mon inquiétude au sujet de ces derniers que je voudrais faire part.
L’alinéa 17 du présent article indique qu’un arrêté « précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test, de ses conséquences et prise en charge. »
Mon amendement vise à faire préciser le contenu dudit arrêté.

M. Alain Milon, corapporteur. Je remercie M. Cornano d’avoir explicité ce que sont les TROD, à propos desquels Mme Emery-Dumas s’interrogeait tout à l'heure. Au demeurant, lorsque nous les avons évoqués en commission, elle aurait pu nous demander des précisions : nous n’aurions pas manqué de les lui fournir !
Sourires.

La rédaction actuelle de l’alinéa 17 permet de viser les résultats, non seulement positifs, mais aussi négatifs, pour lesquels un accompagnement est nécessaire.
Mon cher collègue, nous estimons que votre inquiétude est ainsi apaisée. La commission est donc plutôt encline à vous demander le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Monsieur Cornano, l’accompagnement est déjà prévu dans l’alinéa 17. Vous proposez d’ajouter que la prise en charge est effectuée par des structures spécialisées dans le VIH, ainsi que la notion de résultat positif.
Pourquoi le texte ne mentionne-t-il pas le virus de l’immunodéficience humaine ? Dans l’article 7, il est question des « maladies infectieuses transmissibles ». Si nous avons fait ce choix, c’est pour une raison simple : pour l’instant, s’agissant des tests rapides de diagnostic, il en existe un disponible sur le marché qui concerne le VIH, mais toute une série d’autres sont en cours de développement, destinés à d’autres maladies transmissibles, notamment les hépatites virales et, probablement, bientôt, d’autres maladies sexuellement transmissibles.
Ainsi, la mention spécifique dans la loi du VIH aurait pour conséquence d’exclure de fait les accompagnements lors de la réalisation des autres tests destinés aux autres maladies transmissibles, quand ils seront disponibles. C'est la raison pour laquelle la rédaction actuelle fait le choix de mentionner la notion plus générale des maladies infectieuses transmissibles, sans préciser de nom de virus ou de maladie.
Vous avez en fait satisfaction puisque la notion d’accompagnement est, de toute façon, déjà inscrite à l’alinéa 17. Dans ces conditions, vous pourriez retirer votre amendement.

L'amendement n° 1119 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
L'article 7 est adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 238 rectifié sexies, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Cantegrit, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic, Commeinhes et Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Micouleau et MM. Pillet et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport d'évaluation concernant la consommation de médicaments par les personnes âgées et formule des recommandations sur les conséquences qu'aurait la vente de médicaments à l'unité sur cette consommation et sur l'opportunité d'inscrire la déprescription dans les indicateurs de rémunération à la performance des médecins.
La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Mme Deromedi a pris l’initiative de déposer cet amendement, qu’il me revient de présenter ce soir. Cependant, dans la mesure où son objet est de demander un rapport, je sais d’avance quel sort va lui être réservé…
Sourires.

En fait, il faut considérer que ces demandes sont surtout des appels en vue d’obtenir de la part du Gouvernement des précisions quant à ses intentions pour faire en sorte que les préoccupations exprimées soient levées.
Notre collègue s’inquiète de la surconsommation de médicaments. Le sujet n’est pas nouveau puisque nous l’évoquons lors de la discussion de chaque projet loi de financement de la sécurité sociale. La France est championne en la matière ! Chez les personnes âgées, certaines prescriptions peuvent aller jusqu’à vingt et un médicaments pour un même patient.
Comment lutter contre cette surconsommation de médicaments ? Y a-t-il lieu de promouvoir la « déprescription » ?
J’aimerais en tout cas, madame la secrétaire d'État, que vous puissiez nous donner votre sentiment sur cette question et nous dire vos intentions pour aboutir à un résultat qui soit plus satisfaisant en la matière, car il s’agit bien de santé publique.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 329 rectifié est présenté par MM. Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam, Mohamed Soilihi et Patient.
L'amendement n° 394 est présenté par M. Vaspart.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport d’évaluation concernant la consommation de médicaments par les personnes âgées et formule des recommandations sur l’opportunité d’inscrire la déprescription dans les indicateurs de rémunération à la performance des médecins.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Face au constat que vient d’évoquer notre collègue Alain Vasselle, les auteurs de cet amendement proposent de faire de la déprescription pour les personnes âgées une priorité de travail pour la Haute Autorité de santé.
Le rapport demandé répond à un enjeu tant sanitaire, la France affichant une consommation de médicaments par habitant de 22 % supérieure à la moyenne européenne, que financier, puisque 33, 5 milliards d'euros ont été dépensés à ce titre en 2013, dont 90 % sont remboursables par l’assurance maladie.
Cet amendement tend ainsi à inscrire la déprescription pour les personnes âgées à l’agenda gouvernemental et à évaluer l’opportunité d’inclure cette dernière dans les critères de rémunération de la performance des médecins.

L'amendement n° 394 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 238 rectifié sexies et 329 rectifié ?

Lorsque, avec les corapporteurs, nous avons commencé à travailler sur ce projet, nous nous sommes aperçus que de très nombreuses demandes de rapports étaient formulées. Nous avons d’emblée pris une position claire, décidant d’émettre un avis défavorable sur toutes les demandes de rapports.
Je crois que, hier soir, Mme Touraine, qui était à votre place, madame la secrétaire d’État, a été saisie en deux heures et demie de neuf demandes de rapports. Cet après-midi, dans le même laps de temps, nous avons été saisis d’une dizaine de demandes. Ce soir, pour l’instant, nous en sommes à deux. Il y en aura sûrement d’autres avant la fin de l’examen de ce texte, et ils recueilleront le même avis défavorable de notre part.
J’ai dit tout à l’heure en commission, par boutade, qu’au rythme des demandes de rapports, il faudra un jour que le Président de la République nomme dans son gouvernement un ministre des rapports !
Sourires.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons que M. le corapporteur : il ne s’agit pas d’une position de principe à l’égard des demandes de rapports en général.
Je veux m’exprimer sur le sujet précis de la possible toxicité des médicaments – ce que l’on appelle l’iatrogénie –chez les personnes âgées. C’est une question sur laquelle de nombreux experts se sont penchés de façon relativement récente : la Haute Autorité de santé a émis des recommandations qui datent de septembre 2014.
Un plan d’action a été relancé à la fois par la ministre de la santé et par la secrétaire d’État en charge des personnes âgées au moment de la préparation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Ce plan d’action comporte toute une série de mesures pour limiter le recours inadéquat aux médicaments, favoriser les stratégies de soins et d’accompagnement alternatives ou complémentaires chaque fois que cela est possible, aider le médecin à gérer au mieux le risque de consommation inadéquate de médicaments chez les personnes âgées, favoriser l’observance, développer l’accompagnement pharmaceutique et améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour les résidents en EHPAD.
Enfin, je veux préciser que la rémunération sur objectifs de santé publique des médecins inclut déjà des indicateurs qui ciblent spécifiquement la prévention des risques de toxicité médicamenteuse chez les patients de plus de soixante-cinq ans.
Ce que vous signalez à juste titre, messieurs les sénateurs, et qui constitue en effet un enjeu de santé publique extrêmement important, a déjà été pris en compte, à la fois dans la rémunération des médecins et dans les recommandations de bonnes pratiques pour l’ensemble des médecins.
Il me semble donc que les auteurs de ces amendements pourraient les retirer.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 238 rectifié sexies est-il maintenu ?

Je la remercie et je ne doute pas que ma collègue Jacky Deromedi sera enchantée de savoir que le Gouvernement ne reste pas inactif dans ce domaine.
J’espère que les résultats seront au rendez-vous et que nous constaterons, au moment de l’examen d’un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, une baisse de la consommation des médicaments.
Je retire donc l’amendement, madame la présidente.

L'amendement n° 238 rectifié sexies est retiré.
Monsieur Antiste, l'amendement n° 329 rectifié l’est-il également ?

Je partage tout à fait le raisonnement de mon collègue Alain Vasselle.
Nous exprimons manifestement une préoccupation largement partagée puisque, siégeant de part et d’autre de l’hémicycle, nous avons déposé quasiment le même amendement, sans nous concerter.
Nous ne sommes pas systématiquement demandeurs de rapports et je vais retirer mon amendement. Mais, convaincu qu’il faut vraiment trouver une solution à ce problème réel et dramatique – car nous sommes confrontés à des prises de médicaments qui tuent ! –, je proposerai à mon collègue et à la Haute Assemblée de créer une mission ou un groupe de travail pour suivre de très près cette affaire.

L'amendement n° 329 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1120 rectifié, présenté par MM. Cornano et Courteau, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport listant l’ensemble des pistes susceptibles de permettre d’améliorer très fortement l’efficacité de la prévention du virus de l’immunodéficience humaine, en particulier l’opportunité de la délivrance d’une recommandation temporaire d’utilisation au profit du concept de prophylaxie pré-exposition.
La parole est à M. Jacques Cornano.

Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport au Parlement sur les différentes pistes permettant d’améliorer la prévention du VIH à destination de l'ensemble de la population, en particulier les publics dits « vulnérables ». Ce rapport devrait en outre se focaliser sur le dispositif Prep – prophylaxie pré-exposition –, qui est à base de médicaments antirétroviraux destinés à des personnes non infectées et leur permet de recourir à des traitements antirétroviraux pour se protéger du risque de contracter le VIH.
Le cadre d’une RTU – recommandation temporaire d’utilisation – est très spécifique. La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé introduit la possibilité d’encadrer des utilisations en dehors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché – AMM – par des RTU pour des médicaments bénéficiant déjà d’une AMM en France.
Les résultats particulièrement bons des dernières études et l’autorisation, depuis 2011, d’un dispositif similaire aux États-Unis notamment plaident pour la délivrance d’une RTU.

Je serai une fois de plus très bref, car je suis persuadé que Mme la secrétaire d’État nous apportera des éléments d’information importants sur la prévention du VIH.
La commission des affaires sociales est en surdosage, non de médicaments, mais de rapports !
Sourires.

Certes, on peut toujours prévoir des compléments d’information. Mais de nombreuses études sont publiées un peu partout, notamment sur le VIH, dont il suffirait de lire les conclusions.

Il n’est donc pas nécessaire de demander systématiquement des rapports au Gouvernement, qui a certainement d’autres chats à fouetter.
Monsieur le sénateur, votre préoccupation est partagée par le Gouvernement.
La prophylaxie pré-exposition consiste à délivrer de façon préventive des médicaments, habituellement prescrits dans le cadre d’un traitement curatif contre le VIH, à une personne séronégative qui sait qu’elle risque de contracter le VIH, dans l’objectif d’éviter une contamination. Ces traitements ont clairement fait la preuve de leur efficacité, ainsi que l’attestent plusieurs études internationales publiées.
Le dossier, qui a été instruit, est entre les mains des scientifiques de l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’ANSM, l’ex-Agence du médicament, auxquels il revient désormais de décider si l’utilisation de ces médicaments est possible en France, selon le système dit de recommandation temporaire d’utilisation.
Il n’est donc pas utile, dans ces conditions, que le Gouvernement rende un rapport sur ce sujet purement scientifique. C’est à l’ANSM de dire, au vu des études internationales publiées, si ces médicaments apportent ou non un bénéfice.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Non, madame la présidente, je vais le retirer.
Je souhaitais sensibiliser mes collègues au travail qui est réalisé en France, et notamment dans les outre-mer - Guadeloupe, Martinique, Guyane -, où il n’a rien à voir avec les études qui sont réalisées ailleurs sur le sujet. J’aurai l’occasion d’y revenir.
(Supprimé)

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° 27 rectifié quinquies est présenté par MM. Mouiller, Calvet, Fouché et Commeinhes, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Lefèvre, Cambon, Chaize et Huré, Mme Des Esgaulx, MM. Grand, Morisset, Chasseing, B. Fournier, Laménie et Mandelli, Mmes Mélot et Lamure et MM. Pellevat, Genest et Darnaud.
L’amendement n° 125 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L’amendement n° 463 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet et Monier, MM. Delebarre, Carvounas et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 712 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 933 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. »
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié quinquies.

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 bis, tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale et dont l’objet était de mettre fin à la discrimination que subissent les homosexuels et les bisexuels masculins en matière de don du sang.
Depuis 1983, les hommes qui déclarent avoir eu, au cours de leur existence, des rapports sexuels avec un autre homme sont frappés d’une contre-indication permanente au don de sang. Cette contre-indication trouve son origine dans le questionnaire que doit remplir chaque donneur potentiel et qui permet ainsi, aujourd’hui, d’écarter du don une personne en raison de sa seule orientation sexuelle.
La question de la transfusion sanguine est au carrefour de deux enjeux essentiels : recueillir des produits sanguins en quantité suffisante pour venir en aide aux receveurs, tout en réduisant au maximum les risques de contamination de ces derniers.
La discrimination que subissent les homosexuels et les bisexuels masculins en raison de leur orientation sexuelle n’est plus acceptable. Pour des raisons d’égalité devant la loi, mais également pour répondre à des impératifs de santé publique, ce sont les pratiques sexuelles du donneur, et non son orientation sexuelle, qui doivent être prises en compte.
Nous proposons, par conséquent, que les contre-indications se basent sur les éventuels comportements à risque, et non sur l’orientation sexuelle ou l’appartenance à un groupe d’individus. Le questionnaire destiné à chaque donneur devrait être modifié en ce sens.
Tel est l’objet de cet amendement, qui affirme le principe selon lequel nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 125 rectifié bis.

D’ordinaire, je suis plutôt favorable à la suppression d’articles et j’encourage les initiatives prises en ce sens. En l’occurrence, ma position est différente.
La rédaction actuelle de l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique conduit à stigmatiser un certain nombre de publics. Cet amendement tend à éviter toute stigmatisation.

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 463.

La question du don de sang par les hommes homosexuels est depuis longtemps débattue au sein du Parlement. C’est, je tiens à le préciser, le groupe UDI de l’Assemblée nationale qui a pris l’initiative de mettre fin à la discrimination qui touche les hommes homosexuels ou bisexuels. Je souligne que cet amendement a été adopté par les députés à l’unanimité.
En commission, les corapporteurs ont invoqué de fausses raisons pour supprimer cette importante avancée sociale. Ils fondent en effet leur argumentation sur le fait que, aux termes de l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique, seules les contre-indications médicales peuvent justifier le refus opposé à une personne qui souhaite donner son sang.
Or un arrêté du ministère des affaires sociales du 12 janvier 2009, sur lequel s’appuie l’Établissement français du sang, dispose clairement que les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang.
Cet interdit ne vise donc pas seulement les comportements sexuels à risque entre hommes, comme le laissent entendre les corapporteurs.
En réalité, il est profondément discriminatoire puisqu’un homme ayant des rapports sexuels protégés avec un autre homme tombe sous le coup d’une interdiction permanente, quand un homme ayant un rapport sexuel non protégé avec une femme tombe sous le coup d’une interdiction de quatre mois, alors même que ce dernier comportement représente plus de risques pour la sécurité transfusionnelle.
L’idée sous-tendue est clairement que la population homosexuelle aurait un comportement sexuel beaucoup plus débridé que la population hétérosexuelle, ce qui est non seulement discriminatoire, mais totalement infondé.
Comme vous l’aviez dit avec force à l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État, ce qui importe, ce sont les comportements sexuels et non l’orientation sexuelle. Sur le plan éthique, cela n’a pas du tout le même sens, et nous nous honorerions à rétablir cet article.
J’ajoute que, dans un arrêt du 29 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a clairement énoncé qu’il était nécessaire que la France mette en place un dispositif moins contraignant, ce qui suppose la suppression de la contre-indication permanente pour les hommes homosexuels souhaitant donner leur sang.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 712.

Je partage les propos de mes collègues : il est très important que le Sénat adopte amendements, car il est profondément injuste et discriminatoire qu’une catégorie de population soit exclue du don de sang.
Nous savons qu’un long questionnaire doit être rempli par les donneurs avant de donner leur sang. Au sein du groupe CRC, nous considérons qu’il ne doit pas être possible d’interroger les donneurs sur leur orientation sexuelle. Seule la préoccupation liée à la sécurité sanitaire doit intervenir en matière de don de sang.
J’espère que l’ensemble du Sénat approuvera le rétablissement de cet article, et cela me paraît tout à fait possible à en juger par la diversité politique des signataires de ces amendements identiques.

L’interdiction de donner son sang visant les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes est en vigueur depuis 1983. Elle serait fondée sur une plus forte présence du VIH dans cette population et sur l’existence d’une « fenêtre silencieuse » de dix jours durant lesquels le virus est indétectable dans le sang collecté.
Cet amendement tend à mettre fin à cette discrimination. La Cour de justice de l’Union européenne estime d’ailleurs que la France devrait modifier sa réglementation en matière de don de sang et trouver le moyen de ne pas en exclure systématiquement, et à vie, les hommes homosexuels.
Des études menées à l’étranger ont montré qu’une réglementation perçue comme moins discriminatoire améliore la sincérité des donneurs sur leur comportement sexuel avant le don, et donc la sécurité du don du sang.
Je souhaite, à l’instar de mes collègues, que le vote visant à rétablir l’article 7 bis soit le plus large possible.

L’amendement n° 1178 rectifié, présenté par M. Raison, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être exclu du don du sang en raison du fait qu'il a été transfusé. »
La parole est à M. Michel Raison.

C’est avec beaucoup de prudence que je présente cet amendement, qui est avant tout destiné à me permettre d’obtenir une réponse. J’ai en effet reçu quelques transfusés qui s’étonnent de ne pas pouvoir donner leur sang. Je suppose que cette interdiction s’explique techniquement, mais cette explication n’a pas été communiquée aux personnes concernées.
Ces transfusés, dont la vie a été sauvée grâce à des donneurs de sang, souhaiteraient pouvoir à leur tour donner le leur sang. Dans le même temps, ils s’inquiètent, se demandant si le sang qui circule dans leurs vaisseaux n’abrite pas quelque virus et s’ils ne sont pas toujours, même après de nombreuses années, en période d’incubation.
En fonction de la réponse qui me sera apportée, je choisirai de retirer, ou non, mon amendement.

Tous ces amendements visent à rétablir l’article 7 bis, qui a été introduit par l’Assemblée nationale, puis supprimé par la commission des affaires sociales.
Les cinq amendements identiques reprennent la rédaction adoptée par les députés, qui dispose que l’orientation sexuelle ne peut constituer un motif d’exclusion du don de sang.
Mes chers collègues, il faut être très clair sur les raisons qui ont motivé cette suppression par notre commission : il ne s’agit en aucun cas d’une opposition de fond. Nous sommes tous convaincus que les seules limites susceptibles d’être apportées au don de sang résultent d’exigences liées à la sécurité sanitaire des receveurs. L’orientation sexuelle ne peut constituer un motif valable d’exclusion du don de sang. Telle a été la position constante des corapporteurs durant le mois de juillet, et encore ce matin.
Cependant, tout est déjà prévu dans la loi. L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique, que l’article 7 bis venait compléter, dispose en effet : « Nul ne peut être exclu du don du sang en dehors de contre-indications médicales. »
Partant de ce constat et tenant compte des éclairages apportés par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale, la commission n’a pas jugé nécessaire de compléter l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique. Le problème que l’article 7 bis visait à résoudre, bien que réel, ne relève pas du niveau de la loi. Les contre-indications sont définies par un arrêté ministériel, et ce sont elles qui sont prises en compte dans le questionnaire que doit remplir chaque donneur potentiel.
La véritable question est donc celle des évolutions à apporter à l’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang : nous pourrons changer la loi autant que nous le voulons, si l’arrêté et le questionnaire demeurent en l’état, le problème que nous tentons de résoudre restera entier.
Comme l’a indiqué la ministre de la santé à l’Assemblée nationale, les dispositions de l’article 7 bis « n’apportent rien au droit, tel qu’il peut se décliner, aucune sécurité juridique [...] car tout relève du domaine réglementaire ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Mme Marisol Touraine ! Elle ajoutait : « ces amendements n’ont pas vocation à transformer par eux-mêmes les questionnaires. […] L’enjeu essentiel, vous le savez, c’est que le questionnaire évolue : s’il n’évolue pas ou s’il est simplement indiqué une déclaration de principe, certains seront satisfaits, mais, au fond, les choses n’auront pas changé. »
C’est d’ailleurs bien à une réévaluation de la réglementation actuelle que la France a été encouragée par la Cour de justice de l’Union européenne, le 29 avril dernier, dans le cadre d’une question préjudicielle. La Cour estime que « si l’exclusion prévue par la réglementation française contribue à réduire au minimum le risque de transmission d’une maladie infectieuse aux receveurs et, partant, à l’objectif général d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, le principe de proportionnalité pourrait ne pas être respecté ».
Voilà les raisons, de forme et non de fond, qui ont justifié que la commission supprime l’article 7 bis.
Au bénéfice de ces observations et dans l’attente d’éclairages complémentaires du Gouvernement sur les suites qu’il envisage de donner à cette question d’ordre réglementaire, je propose que nous nous en remettions à la sagesse de chacun dans cette assemblée.
En ce qui concerne l'amendement n° 1178 rectifié, la commission a également émis un avis de sagesse. Il tend à supprimer la contre-indication permanente visant les personnes transfusées. Le commentaire est le même que pour les amendements précédents.
Contrairement au rapporteur, j’aurai un avis tout à fait différent sur les amendements identiques, d’une part, et sur l’amendement de M. Raison, d’autre part.
La série d’amendements identiques porte sur une mesure extrêmement importante sur le plan symbolique. Cela fait des années qu’une catégorie de population est discriminée en matière de don de sang. Je veux bien entendre que, sur la forme, certains éléments relèvent davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif, mais il est important que le Parlement puisse se prononcer sur la discrimination qui touche les hommes homosexuels dans notre pays.
Il s’agit là d’un vote extrêmement important qui, je n’en doute pas, sera relayé dans la presse demain matin. Réfléchissez à votre vote, car c’est une question de société fondamentale !
Mouvements divers.
Bien sûr qu’on ne vote pas pour la presse, mais, je le redis, c’est une question de société très importante. Il s’agit d’une revendication des hommes homosexuels, qui sont discriminés depuis des années en matière de don de sang.
Il faut absolument montrer qu’il n’y a plus de discrimination sur cette question dans notre République. L’avis du Gouvernement est donc favorable sur cette série d’amendements identiques.
Pour ce qui concerne l’amendement de M. Raison, la situation est totalement différente. En l’espèce, la question n’est pas d’ordre symbolique, mais repose sur des réalités purement scientifiques.
Dans l’état actuel de la science, nous savons détecter si le VIH est présent dans les produits issus de personnes transfusées, à quelques réserves près, en particulier si la contamination a eu lieu la veille. Désormais, nous savons traiter les produits de telle façon que, même si les virus connus – VIH, hépatite B ou C, etc. – n’ont pas été détectés, ils puissent être éliminés.
En revanche, il y a peut-être des agents infectieux indéterminés que nous ne connaissons pas encore. L’histoire récente nous a montré qu’il fallait aussi prendre en compte les prions. Il peut exister d’autres agents infectieux transmissibles par le sang et les produits sanguins, donc par les transfusions, qui n’ont pas encore été détectés et qui ne donnent pas de symptômes pendant une durée éventuellement assez longue.
Les personnes transfusées sont d’ailleurs bien informées des risques, qui ne sont pas nuls, mais encore inconnus. On ne peut pas dire de façon absolument formelle qu’elles n’ont pas été contaminées par un agent infectieux inconnu dans l’état actuel de la science. C’est donc la prudence qui nous a conduits à rendre les personnes transfusées non éligibles au don de sang.
Aucun élément scientifique nouveau ne nous permet de revenir actuellement sur cet état de fait. Par conséquent, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

Je n’ai pas l’habitude d’intervenir de nouveau après que le Gouvernement a donné son avis. Mais là, honnêtement, madame la secrétaire d'État, je suis scandalisé que vous nous demandiez d’imaginer comment notre vote sera perçu dans la presse demain matin. Je ne trouve pas normal que vous puissiez tenir ce genre de propos sur un vote aussi important que celui-ci !
Cela fait trois ans que votre majorité est au gouvernement. La loi aurait pu être changée avant si vous l’aviez voulu. Et, sans aller jusque-là, vous auriez pu modifier simplement le règlement pour faire en sorte que les hommes homosexuels soient directement admis au don de sang. Si cela n’a pas été fait, c'est peut-être parce que la presse ne l’avait pas encore demandé…
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Mme la secrétaire d'État a eu une parole malheureuse en parlant de l’effet que pourrait produire notre vote dans la presse. J’attendais plutôt qu’elle nous confirme que l’arrêté était pratiquement signé. Du reste, si le nouvel arrêté avait été pris quand le problème que nous évoquons a commencé à se poser, c'est-à-dire voilà déjà plusieurs années, la polémique serait éteinte depuis longtemps !
Vous dites, madame la secrétaire d'État, qu’il suffit que le Sénat vote ces amendements identiques, mais, si vous ne modifiez pas l’arrêté qui fixe les critères figurant sur la fiche que remplissent les candidats au don du sang, les choses ne vont pas changer.
Nous espérions que vous nous diriez qu’un vote des assemblées n’était pas nécessaire, mais que le Gouvernement allait modifier l’arrêté fixant cette exclusion, plutôt que de nous parler des retombées dans la presse.
Sur la question des transfusés, il y a un cas particulier auquel il faudrait réfléchir : celui des autotransfusés. Lorsqu’elles viennent donner leur sang, certaines personnes indiquent qu’elles ont été transfusées, mais ne peuvent pas démontrer qu’il s’agissait d’une autotransfusion. On leur interdit donc de donner leur sang, alors même qu’elles pourraient parfaitement le faire. Or les autotransfusions sont de plus en plus fréquentes. Là, le problème à résoudre est purement technique : la presse n’a rien à y voir…

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. Je pense que votre propos était de montrer qu’il s’agissait d’un véritable sujet de société.
Pour avoir été médecin examinateur – à l’époque, on parlait de « centres de transfusion » –, je peux vous dire que les donneurs sont extrêmement sensibles au fait que l’on accepte ou non leur sang. Ils ont été traumatisés lorsque, après le drame du sang contaminé, les contre-indications au don du sang se sont multipliées.
Les années passant et la science évoluant, nous avons évidemment « relâché » ces contre-indications. Aujourd'hui, cette question est importante sur le plan sociétal ; quand la disposition sera votée, l’arrêté sera évidemment modifié.
Dès lors que nous considérons, et nous l’avons dit avec force, qu’il faut prendre en compte les comportements sexuels et non l’orientation sexuelle, nous ferons une grande avancée dont nous pourrons être fiers collectivement et, je l’espère, unanimement. Nous prouverons ainsi que nous sommes dans une logique de non-discrimination entre donneurs de sang au regard de la vie que chacun choisit de mener en fonction de son orientation sexuelle.

Comme je ne suis pas biologiste, je souhaiterais qu’un point soit éclairci : si le receveur peut être contaminé par un virus qu’on ne connaît pas encore aujourd’hui, c'est bien parce que le donneur en est porteur. Pourtant, celui-ci continuera à donner son sang alors que le transfusé, lui, ne le pourra pas !

J’ai cosigné, dans cette série d’amendements identiques relatifs au don de sang, celui qui émane de mon groupe. Cependant, M. le corapporteur vient de nous expliquer que notre vote n’aura pas de conséquence parce que c'est au niveau réglementaire qu’il faut changer les choses. J’entends bien les propos de Mme la secrétaire d'État sur la portée symbolique de notre vote et sur l’effet dans la presse demain. Toutefois, selon moi, la loi est destinée à faire non pas œuvre symbolique, mais œuvre utile.
Je ne voterai donc pas ces amendements.
Applaudissements sur le banc de la commission.

Mme la secrétaire d'État s’est peut-être expliquée de façon quelque peu maladroite, mais il est plus d’une heure du matin…

Vous êtes bien indulgente… Vous l’auriez moins été s’il s’était agi d’un orateur de notre groupe !

Madame la rapporteur, je vous écoute quand vous intervenez, alors je vous prie de faire de même lorsque c’est moi qui m’exprime !
Ce n’est pas cela qui doit déterminer notre vote.
Selon moi, le vote que nous allons émettre ce soir est extrêmement important. Nous sommes confrontés à une discrimination qui dure depuis des années. Il est fondamental que, en tant que parlementaires, nous puissions nous prononcer contre cette injustice, afin qu’il y soit concrètement remédié.
Compte tenu des explications de Mme la ministre, je ne peux pas douter que l’arrêté suive. Je pense donc que les choses iront de pair. Il me paraît par conséquent nécessaire que nous votions cette disposition ensemble ce soir, car cela constituerait un signe politique de la représentation parlementaire.
Il faut en effet que nous marchions sur nos deux pieds, si j’ose dire : il faut ainsi que le nécessaire soit fait au niveau réglementaire, mais il faut aussi que le Parlement s’inscrive dans une logique de non-discrimination à l’égard d’un groupe donné.
C’est pourquoi j’appelle la représentation parlementaire à voter cet amendement.

Nous savons tous que le Sénat est reconnu pour la qualité de ses travaux législatifs. Donc, face à la question qui nous est posée ce soir, les rapporteurs de la commission ont naturellement pris le temps d’analyser la situation ; leur connaissance nous a ainsi permis de mettre en relief la difficulté juridique que nous devons collectivement résoudre.
Il y a bien deux sujets : d’une part, le message qui doit être à mon avis envoyé au travers de notre vote modifiant le texte législatif et, d’autre part, l’engagement formel du Gouvernement de modifier l’arrêté en question, puisque, sans cette modification, notre vote ne servirait à rien.
Il faut donc un engagement mutuel du Sénat et du Gouvernement, de sorte que la difficulté juridique soulevée par la commission soit clairement réglée.

Nous parlons d’une disposition datant de 1983, soit au moment de l’éclosion de l’épidémie du sida. Or cette décision, lorsqu’elle a été prise, constituait à mon avis non pas une discrimination d’ordre social, mais plutôt une prévention sanitaire.
Les choses ont totalement changé depuis lors, et je pense qu’aucun d’entre nous, quelle que soit sa sensibilité, ne souhaite que ces discriminations perdurent ; nous sommes tous d’accord, il faut que cela s’arrête puisque la peur sanitaire n’existe plus. Il convient donc de faire cesser cela et de donner à l’extérieur une image d’unanimité.

Ensuite, cela doit être suivi d’effet.
Personnellement, je ne sais pas ce qu’il faut voter ; lors de l’examen en commission, j’avais été convaincu par le rapporteur et par l’argument développé par Mme Touraine à l’Assemblée nationale.
L’image que nous renverrons dans les médias ne me semble pas être le problème ; il s’agit bien plutôt de l’image que nous donnerons à notre société.

Il faut donc une décision unanime visant à mettre fin à cette situation, ainsi qu’un engagement du Gouvernement pour que ce soit suivi d’effet ; convenons-en, nous ne sommes plus à l’époque où cette disposition était d’actualité.
Je veux apporter quelques précisions puisque des questions supplémentaires ont été posées.
En premier lieu, l’autotransfusion n’est pas une contre-indication au don du sang ; la contre-indication n’existe que lorsque l’on a été transfusé à partir d’un donneur différent.
En deuxième lieu, pour répondre à la remarque de M. Raison, il s’agit d’une question d’épidémiologie. Si un individu porteur d’une pathologie infectieuse inconnue à ce jour donne son sang, il transmet cette pathologie au receveur sans qu’on le sache ; alors, vous avez raison, celui-ci n’aura pas le droit de donner son sang tandis que le donneur originel pourra continuer à donner le sien.
Pourquoi le receveur n’en a-t-il pas le droit ? Parce qu’il y aura, dans les faits, non pas un, mais environ dix receveurs. Or, autoriser les receveurs à donner leur sang aboutirait à augmenter de façon exponentielle la contamination potentielle. Ainsi, en épidémiologie, il existe des règles simples : quand on n’est pas sûr à 100 % que quelqu’un n’a pas une maladie infectieuse transmissible, on ne multiplie pas la contamination potentielle. C’est pourquoi les transfusés ne peuvent donner leur sang, en tout cas dans l’état actuel des connaissances, c'est-à-dire tant qu’on n’est pas capable d’éliminer formellement toute pathologie infectieuse de façon définitive.
En troisième lieu, s’agissant de la position du Gouvernement à propos du questionnaire précédant le don du sang et notamment de la question sur l’orientation sexuelle, j’indique qu’un travail est actuellement en cours au ministère en vue d’élaborer un nouveau questionnaire ; cela se fait en concertation avec l’ensemble des associations et des acteurs concernés au sens large : donneurs, receveurs, ou encore monde sanitaire. La ministre de la santé ne décidera donc pas seule de ce qui doit figurer dans ce questionnaire ; elle le fera avec les professionnels et les associations de patients.
L’objectif est que ce questionnaire ne soit plus discriminatoire et n’interdise plus aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de donner leur sang. Ce travail arrivera à son terme au cours de l’automne, en novembre prochain, et l’arrêté sera donc modifié conformément à son résultat.
Voilà pour le travail des professionnels et des associations de patients sur le sujet. En revanche, ce dont il est question ce soir, c’est de votre avis, à vous, parlementaires ! Je reconnais avoir été probablement maladroite en évoquant la réaction de la presse demain matin ; en revanche, imaginez l’image que vous donnerez à la société tout entière !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Si, c’est une question d’image ! Souhaitez-vous envoyer un message d’opposition du Parlement au don de sang par les homosexuels hommes ? Certes, vous pourrez toujours expliquer qu’en réalité la mesure n’est pas de nature législative, mais c’est ainsi que ce sera compris ! Telle est la réalité que je tente de vous faire saisir !
Je comprends parfaitement vos réticences : vous ne votez pas en fonction de l’image que vous renvoyez ; mais c’est pourtant à la question suivante que vous êtes amenés à répondre : qu’en pense le Parlement ? Êtes-vous pour ou contre ? Telle est la décision que vous êtes amenés à prendre ce soir.
Je ne parle plus des médias, j’ai été claire à ce sujet. Je dis que c’est une question relative à la société dans laquelle vous voulez vivre : souhaitez-vous vivre dans une société qui discrimine ou qui ne discrimine pas ? Telle est à mon sens la question qui vous est posée. Vous avez le droit de ne pas être d’accord, …
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. … mais c’est une vraie question de société. C’est pourquoi je vous la pose en ces termes.
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Madame la secrétaire d’État, j’entends bien ce que vous venez de nous dire ; vous essayez de rattraper un peu vos propos sur notre image dans les médias ; mais pour ma part, je n’ai jamais voté en fonction de cela, et ce n’est pas ce soir que je commencerai !
En outre, en essayant de rattraper vos propos initiaux, vous tenez des propos tout à fait contraires à ceux de Mme Touraine à l’Assemblée nationale ; mais je suppose que vous les lui répéterez.
Toutefois, je pense sincèrement que de tels propos, qui me choquent profondément, ne sont pas à la hauteur du débat.

Madame la secrétaire d’État, sans vouloir polémiquer, je veux vous faire part de mon incompréhension et de mon indignation. Je trouve que le ton sur lequel on nous pose les questions est moralisateur, accusateur, et laisse penser que les assemblées prennent leurs décisions en fonction de l’humeur des journalistes et des émotions.

Mme Françoise Gatel. Si, c’est ainsi qu’on nous parle ! Je veux bien comprendre que votre propos a dépassé votre pensée, madame la secrétaire d’État, mais il faut tout de même avoir une certaine considération pour le Sénat : nous pouvons avoir, en notre âme et conscience, des opinions extrêmement différentes. Il n’y a pas, d’un côté, les bons penseurs et, de l’autre, les mauvais penseurs. Ce type de discours, que l’on entend depuis un moment dans cet hémicycle à travers l’examen du projet de loi de santé, est intolérable et inadmissible.
Applaudissements sur certaines travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 27 rectifié quinquies, 125 rectifié bis, 463, 712 et 933.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, l'article 7 bis est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 1178 rectifié n'a plus d'objet.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné 67 amendements au cours de la journée. Il en reste 866.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 17 septembre 2015 :
À dix heures quarante :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015) ;
Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 653, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 654, 2014-2015) ;
Avis de M. Jean-François Longeot, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 627, 2014-2015) ;
Avis de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 628, 2014-2015).
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze et le soir : suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 17 septembre 2015, à une heure quarante.