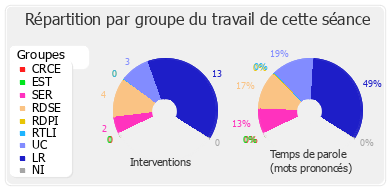Séance en hémicycle du 19 octobre 2016 à 22h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission des lois a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

L’ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport d’information Eau : urgence déclarée, demandé par la délégation sénatoriale à la prospective, et sur les conclusions du rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, demandé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. (Rapports d’information n° 616 et 807, 2015-2016.)
La parole est tout d’abord aux orateurs de la délégation et de la commission qui ont demandé ce débat.
La délégation sénatoriale à la prospective a souhaité utiliser les deux écrans situés de part et d’autre de l’hémicycle pour projeter une présentation illustrant les interventions de ses représentants – c’est une première dans l’hémicycle, mes chers collègues !
La parole est donc à M. le président de la délégation sénatoriale à la prospective.

Au-delà, je voudrais vous faire part du choc que nous avons ressenti au sein de la délégation lorsque nos collègues Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach ont présenté leurs conclusions.
À première vue, en France, l’eau ne paraît pas constituer un problème essentiel. À cet égard, on évoque plutôt l’énergie, la pollution, les transports ou d’autres sujets encore. Nous avons généralement le sentiment que la France n’est pas un pays désertique, même si nous pouvons connaître des périodes de sécheresse. Pourtant, au fil des ans, les déséquilibres climatiques, l’utilisation renforcée de l’eau et l’épuisement de la ressource sont à l’origine d’un certain nombre de difficultés, que les rapporteurs vont naturellement évoquer devant vous, et qui commencent à relever de l’urgence.
Des textes sur l’eau ont déjà été adoptés et je n’imagine pas une nouvelle loi dans les mois qui viennent. Pourtant, il va bien falloir, de nouveau, prendre à bras-le-corps le problème de l’eau, car, aujourd’hui, ce sujet est insuffisamment traité.
Je n’en dirai pas plus, si ce n’est pour regretter que le débat se déroule à une heure si tardive. J’aurais préféré qu’il soit organisé en fin d’après-midi, ce qui aurait permis à un plus grand nombre de collègues d’y assister. Mais ainsi va l’actualité du Sénat, et je ne doute pas que, entre les images projetées sur les écrans et les propos des rapporteurs, les sénateurs présents ce soir seront in fine aussi inquiets que nous de l’avenir de l’eau en France.

La parole est à M. Henri Tandonnet, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective.

Je remercie tout d’abord le président Roger Karoutchi d’avoir accepté que la délégation à la prospective étudie le sujet de l’eau, sous l’angle de l’adaptation au changement climatique et des conflits d’usage.
Notre rapport est un signal d’alarme que nous voulons actionner pour attirer l’attention sur une évolution plus que préoccupante.
En effet, le dérèglement climatique emporte des conséquences extrêmes dans le domaine de l’eau. Qui dit crise climatique, dit crise aquatique. Le niveau des mers s’élève et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes.
La France n’est pas épargnée par ce phénomène. On le constate déjà dans le Sud-Ouest : l’Aquitaine n’est plus le pays des eaux. Les relevés de températures témoignent d’une progression de deux degrés par rapport aux années soixante-dix, et il est à prévoir une hausse globale comprise entre deux et cinq degrés à l’horizon 2100.
Il en résultera un effet de ciseaux, c’est-à-dire une hausse de la demande en eau et une réduction de la ressource.
De nombreuses activités requièrent des quantités d’eau importantes, au premier rang desquelles l’agriculture et la production d’énergie. Suivent ensuite l’industrie, la consommation des ménages, ou encore les loisirs. Ces usages entrent en compétition avec la ressource, mais aussi avec le maintien du bon état écologique des cours d’eau.
Pour ces usages, l’eau est alors retirée de son milieu naturel. La ressource va diminuer et les conflits d’usage vont se cristalliser.
Le risque d’une pénurie durable et générale d’eau sur l’ensemble du territoire peut être écarté, mais pas celui d’une baisse notable de la ressource à certains moments et dans certaines zones. Nous ferons face à des périodes de fort stress hydrique, mais aussi à des inondations de plus en plus fréquentes. Plus que de conflits, nous pouvons parler de pics d’usage.
C’est pourquoi nous devons anticiper pour ne pas subir, et trouver des pistes pour préparer l’avenir.
Aujourd’hui, la politique de l’eau reste marquée par une vision très écologiste, autrement dit par le souci constant de la préservation du bon état des eaux et du bon écoulement de celles-ci. Cet aspect qualitatif est certes essentiel, mais il est grand temps de prendre en compte l’aspect quantitatif, qui est lié à cette qualité. La simple gestion de la ressource existante ne suffira pas à répondre aux périodes de crise qui vont s’accentuer, et aux conflits d’usage.
Nos propositions doivent, d’abord, donner la priorité à toutes les actions de gestion économe de l’eau, et, ensuite, garantir des quantités d’eau pour couvrir nos besoins supplémentaires.
L’une de nos priorités absolues concerne la population : les eaux domestiques et l’alimentation.
Notre indépendance alimentaire est strictement liée à la disponibilité d’eau pour l’agriculture, les besoins en matière d’irrigation étant liés à ceux de l’alimentation. En cela, il ne faut surtout pas opposer les ménages et l’agriculture qui ont des intérêts communs au maintien du bon état de la ressource.
Les consommateurs doivent prendre conscience que les aliments représentent des quantités d’eau importantes, du point de vue tant de l’élevage que des productions agricoles. Sans eau, pas de nourriture !
Nous pouvons appeler cela de l’eau virtuelle : c’est la quantité nécessaire pour produire des biens de consommation, sans que le consommateur final, souvent, en connaisse l’ampleur.
La France est aujourd’hui virtuellement importatrice d’eau. En 2007 – seules les données de cette année sont actuellement disponibles pour l’établissement de ce calcul complexe –, 8, 4 milliards de mètres cubes d’eau ont été importés de l’étranger, de pays souvent fragiles, eau qui est nécessaire pour produire les biens et services importés par la France.
Rien ne sert de se priver de nos ressources pour l’agriculture si nous devons importer d’autres pays plus fragiles des produits pour satisfaire nos besoins alimentaires. L’incidence écologique est alors encore plus pénalisante.
Dans ce contexte, et pour toutes ces raisons, il me paraît plus qu’urgent de ne pas penser que la meilleure gestion de l’existant suffira et de créer des réserves destinées à capter l’eau lorsqu’elle est abondante, sans risque pour l’écosystème, pour la restituer pendant les périodes de crise, et d’encourager la recherche.
Notre rapport est une alerte face à l’urgence de s’adapter au changement climatique. Si nous réagissons, l’eau sera non pas le problème, mais plutôt la solution à la crise climatique.
Applaudissements.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, dans le cadre de ce travail commun mené avec Henri Tandonnet, je veux à mon tour souligner le fait que notre pays, contrairement à ce que sa situation géographique laisse à penser, est, lui aussi, exposé au risque de pénurie d’eau.
Il est temps de se montrer réaliste. Aujourd’hui, n’en déplaise à certains, le dérèglement climatique n’est plus contestable, l’élévation des températures moyennes est sans équivoque et l’ère du climato-scepticisme est révolue. Nous savons d’ores et déjà que la France métropolitaine ne sera pas épargnée.
Les études montrent que notre pays devrait connaître des étés affichant jusqu’à cinq degrés supplémentaires d’ici à la fin du siècle et souffrir plus souvent d’épisodes climatiques extrêmes, du type inondation ou tempête.
À cet égard, balayons ensemble un certain nombre d’idées reçues. Ce ne sont pas les régions méditerranéennes qui seront les plus touchées, car elles peuvent compter sur les milliards de mètres cubes stockés, notamment par les grandes retenues constituées, voilà longtemps, dans les Alpes. Plus préoccupante, en revanche, est déjà la situation du Midi aquitain, notamment du bassin Adour-Garonne, en raison de la disparition des glaciers des Pyrénées et du faible nombre d’ouvrages de retenue. On nous dit aussi que le bassin Seine-Normandie, qui alimente des millions de nos concitoyens, serait particulièrement vulnérable.
Devant la gravité de la situation, si la prise de conscience des élus, en particulier des élus locaux, va croissante, grâce aux récentes études de prospective, celle de la population reste insuffisante, voire quasi nulle. À l’évidence, il y a urgence à mener un effort de pédagogie et de sensibilisation pour promouvoir une politique d’économie d’une ressource qui constitue un bien commun. Rappelons en effet une réalité qui s’impose à nous, mais que nous oublions souvent : la ressource en eau ne se crée pas, elle se gère.
Et l’on peut agir ! Par exemple, une source de gaspillage avérée résulte de la déperdition d’eau dans les réseaux d’adduction : de 20 % du débit en moyenne, cette déperdition peut dépasser les 40 % en milieu rural. Renforcer la surveillance et l’entretien des réseaux de distribution serait déjà œuvre utile. De même, et les membres de la délégation y ont été sensibles, prenons la mesure de l’incidence, sur la consommation d’eau, de l’implantation des canons à neige ou de l’arrosage des golfs dans les zones où la ressource est comptée.
Sensibiliser la population est un impératif, mobiliser la recherche, tant publique que privée, en est un autre.
Avec Veolia, Suez environnement, ou bien encore la Saur, nous avons la chance que des entreprises françaises, réputées mondialement, et qui réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires à l’international, investissent massivement en matière de recherche et développement sur l’eau.
Car, oui, il est possible d’accroître la ressource en mobilisant une eau que l’on pensait perdue. Je pense notamment à la technique de réalimentation des nappes phréatiques, ou bien encore à la réutilisation des eaux usées traitées, à laquelle d’autres pays ont recours, y compris pour la consommation humaine ou animale, mais qui soulève, chez nous, il est vrai, des résistances particulières. Quelle est votre position à ce sujet, madame la secrétaire d’État ?
Bien sûr, toutes ces solutions ont un coût, ce qui suppose d’opérer des choix politiques dans le contexte de redressement des comptes publics que nous connaissons. J’en viens donc à la question suivante : quelle gouvernance voulons-nous pour l’eau ?
Si l’on dénonce souvent le millefeuille territorial, qui complexifie nos politiques, la gestion de l’eau, en France, en constitue une parfaite illustration.
Historiquement, elle a été l’une des premières politiques publiques vraiment décentralisées. L’organisation en agences de bassin reste pertinente, mais force est de constater que sa mise en œuvre révèle de singuliers paradoxes. À vouloir mettre tout le monde autour de la table, ce qui est louable, on aboutit à une technocratisation des structures, du type comités de bassin et agences de l’eau, dans lesquelles l’on parle beaucoup, mais où l’on décide peu. Nous péchons presque par excès de démocratie locale, les élus locaux finissant par être dépossédés des décisions qui les concernent. Se produit ainsi, de manière insidieuse, une sorte de recentralisation rampante. Ce sont souvent les techniciens qui ont les commandes, et non les élus.
L’effort de sensibilisation et la volonté de mobilisation passeront par une réflexion sur l’organisation. Dans le respect du cadre européen, la problématique de l’eau doit pouvoir être intégrée dans des projets de territoire, pour promouvoir les procédures participatives, concertées et efficaces, dont nous, et plus encore les générations futures, avons besoin.
Applaudissements.

La parole est à M. Rémy Pointereau, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable m’a chargé de dresser un bilan de l’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, la LEMA, qui fête ses dix ans.
Vous êtes nombreux à vous souvenir du vote de cette grande réforme, qui a restructuré l’organisation de la politique de l’eau en France. Il s’agit aujourd’hui de confronter au temps de la loi celui du réel. En tant que législateur, il est de notre devoir d’évaluer les normes que nous avons votées et de présenter des recommandations adaptées.
Vous connaissez mon attachement à la simplification des normes, et l’inflation normative est un sujet d’actualité, qui nécessite une vigilance sans cesse renouvelée, non seulement sur les lois que nous votons, mais aussi sur les réglementations déjà en vigueur. C’est pourquoi j’ai inscrit ce bilan de la loi sur l’eau dans le droit fil des travaux que je mène au sein de la délégation aux collectivités territoriales sur la simplification des normes.
Lors de la présentation du rapport en commission, plusieurs collègues, notamment Annick Billon et Évelyne Didier, que je salue, ont émis le souhait de pouvoir prolonger le débat en séance publique. Je remercie donc le président Hervé Maurey, ainsi qu’Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach, auteurs du rapport intitulé Eau : urgence déclarée, d’avoir demandé l’inscription d’un tel débat à l’ordre du jour du Sénat.
C’est pour moi un signal fort et symbolique, puisque ces deux rapports se complètent et apportent deux éclairages essentiels, d’une part, sur les difficultés de la gestion de notre ressource en eau aujourd’hui, d’autre part, sur la nécessité de préparer l’avenir.
Au moment de son adoption, la loi de 2006 visait deux objectifs principaux : premièrement, moderniser le dispositif juridique de la gestion de l’eau qui reposait sur les lois de 1964 et de 1992 ; deuxièmement, atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, notamment l’obligation de résultat pour parvenir à un bon état écologique des eaux en 2015.
La LEMA comprend 102 articles, dont les plus importants, vous vous en souvenez, tendent à reconnaître un droit à l’eau pour tous, à réformer le régime d’autorisation des installations ayant une incidence sur l’eau, ou encore à modifier le régime dit « du débit affecté ». Je ne vous citerai pas tous ces articles, mais, lors des débats en séance publique de 2006, nous avions souligné l’importance de ce texte pour les élus et les collectivités territoriales, dont les responsabilités sont lourdes en matière d’eau potable et d’assainissement.
Cette importance est toujours d’actualité. En effet, comme en 2006, j’ai pu me rendre compte, au fil des soixante auditions que j’ai menées et de mes déplacements, à quel point l’eau constitue une ressource unique, au centre de nombreuses activités humaines sur nos territoires.
L’enjeu réside donc dans les potentiels conflits d’usages entre ces différentes activités. Quelle hiérarchie faut-il donner à ces usages ? Quelle articulation faut-il trouver sur le terrain ?
Dans ce contexte, dix ans après le vote de la loi, le bilan de son application est mitigé. J’ai perçu, au fur et à mesure de mes travaux, un double sentiment chez ceux qui ont eu à appliquer le texte que nous avons voté.
D’un côté, un attachement aux grands principes et à l’équilibre de ce dernier. Il est vrai que la loi de 2006 a permis d’améliorer la qualité de l’eau et les pratiques qui s’y rattachent. Ces améliorations sont aussi le fruit des efforts considérables des industriels, des agriculteurs et des élus.
Mais d’un autre côté, les mêmes regrettent une mise en œuvre trop complexe : pour beaucoup, la loi n’a pas suffisamment anticipé les réalités du terrain et a apporté des contraintes supplémentaires.
Un grand nombre de mesures sont, aujourd’hui, soit mal appliquées, soit mal mises en œuvre, en vertu d’une interprétation parfois trop idéologique.
J’ai également pu constater de vraies différences selon les territoires, ce qui montre la grande latitude donnée à l’interprétation de la loi par les services qui prennent les décisions locales. C’est notamment flagrant en ce qui concerne l’application du principe de continuité écologique. Cet exemple illustre parfaitement, selon moi, le manque de pragmatisme et de discernement qui peut transformer un principe voté par le législateur en une situation parfois aberrante sur le terrain.
Ainsi, l’effacement des seuils est la solution appliquée quasi systématiquement pour mettre en œuvre ce principe, alors même qu’elle n’est pas forcément la plus adaptée. Les études sur lesquelles s’appuient les services pour prendre ces décisions sont souvent contestables et les philosophies varient d’un département à l’autre. Or l’effacement des seuils met les propriétaires de moulin dans des situations souvent intenables ; ils sont parfois amenés à devoir financer des passes à poissons, dont le coût peut atteindre 300 000 euros…
MM. Jean-Noël Cardoux et Charles Revet approuvent.

Les propositions que la commission a adoptées entendent remédier à ces difficultés. Elles s’inscrivent dans les quatre thèmes principaux que nous avons identifiés au sein de la loi : la gestion qualitative de l’eau ; la gestion quantitative de la ressource ; la simplification des procédures et l’allégement des normes ; enfin, la planification et la gouvernance.
En matière de gestion qualitative de l’eau, la commission a souhaité interdire la pratique de la surtransposition des directives européennes. Comment, par exemple, évaluer nos résultats en matière de qualité de l’eau, si l’on change le thermomètre en cours de route en ajoutant sans cesse des critères supplémentaires ? Nous souhaitons que la loi s’en tienne aux directives européennes, et pas plus !
Notre rapport préconise aussi de garantir le financement des agences de l’eau, dont les missions doivent rester concentrées sur la biodiversité aquatique. Le principe fort, selon lequel l’eau paye l’eau, ne peut être remis en cause !

Comme l’Association des maires de France, nous nous opposons aux ponctions opérées sur les agences de l’eau au profit du budget de l’État, encore 175 millions d’euros cette année !
Pour ce qui est de la mise en œuvre du principe de continuité écologique, nous préconisons, dans notre rapport, de privilégier des solutions locales, au cas par cas, qui associent l’ensemble des acteurs.
Quant à la gestion quantitative de l’eau, l’une des principales propositions contenues dans ce rapport concerne le soutien financier aux collectivités territoriales pour lutter contre les fuites sur les réseaux d’eau. On doit en effet déplorer un volume de fuites qui s’élève à un milliard de mètres cubes par an dans les réseaux d’eau potable, ce qui signifie que 20 % de l’eau traitée et mise en distribution est perdue ! Cela représente près d’un tiers des prélèvements en eau destinés à l’irrigation, dont on sait qu’elle est souvent contestée.
N’oublions pas que l’eau est devenue une assurance et un outil de sécurité pour l’agriculture et les agriculteurs – ils en ont bien besoin en ce moment –, …

… non pas tant pour produire plus, mais surtout pour diversifier davantage, à l’heure où la politique agricole commune demande d’éviter la monoculture.
Il est aussi souligné dans le rapport l’urgence qu’il y a à clarifier et à sécuriser juridiquement les organismes uniques de gestion collective, qui ont été créés par la LEMA. Aujourd’hui, seuls deux organismes sont titulaires de l’autorisation unique pluriannuelle. Or le dispositif transitoire d’autorisations temporaires de prélèvement d’eau arrive à son terme.
Concernant la simplification des procédures et l’allégement des normes, il est également préconisé de simplifier au maximum les autorisations dites « loi sur l’eau », ainsi que les procédures de nettoyage des rivières et des fossés, dont l’utilité a, tristement, été mise en avant par les récentes crues du mois de juin dernier. Les contraintes normatives ont posé de tels problèmes à certains propriétaires, agriculteurs et élus qu’ils ne veulent plus nettoyer les fossés, par crainte des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, ou ONEMA. Ceux-ci devraient plus agir par pédagogie que par répression. Et il convient d’ailleurs de clarifier leurs missions liées à la police de l’environnement. Par exemple, doivent-ils être armés ?

Autre point de simplification, je pense qu’il est important de raccourcir les délais d’instruction des dossiers de création de réserves, qui doivent d’ailleurs être encouragées, et de les sécuriser juridiquement.
Enfin, sur le volet gouvernance, outre la simplification des schémas d’aménagement et de gestion des eaux – ils font souvent aujourd’hui plus d’une centaine de pages… –, il faut améliorer la représentativité et les équilibres entre les différents acteurs au sein des instances de bassin. Une bonne base de ce rééquilibrage serait une répartition prévoyant un tiers de consommateurs et associations, un tiers de collectivités et un tiers d’utilisateurs industriels et agricoles.
Quant à la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, la GEMAPI, je sais que les positions sont différentes sur ce sujet, mais je crois que l’échelon intercommunal n’est pas adapté, dans la mesure où il ne correspond pas aux bassins versants. Au-delà de cette complexité, la compétence GEMAPI risque également de ne pas être mise en œuvre, faute de moyens à disposition des intercommunalités pour la financer.
Nous préconisons donc dans notre rapport que la GEMAPI soit prise en main par un acteur plus puissant : l’État, les régions ou les agences de l’eau.
Pour conclure, je tiens à vous informer, mes chers collègues, que je déposerai, avant la fin de l’année, une proposition de loi, ainsi qu’une proposition de résolution, reprenant les vingt-huit propositions formulées dans ce rapport. Deux textes qui, je l’espère, permettront d’agir avec discernement et pragmatisme en matière de gestion de l’eau !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-François Longeot applaudit également.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Henri Tandonnet, pour le groupe UDI-UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà dix ans, la LEMA, qui répondait aux exigences de la directive européenne, exprimait déjà l’intention de prendre en compte l’adaptation au changement climatique. Depuis, le dérèglement climatique n’a fait que progresser et il s’accentue.
Mes propos viseront à insister sur certaines recommandations, qui me paraissent aujourd’hui essentielles.
La première d’entre elles consiste à économiser l’eau et à éviter le gaspillage, que ce soit au niveau de la consommation des ménages ou par l’investissement nécessaire pour améliorer l’état des réseaux, afin de limiter au maximum les fuites. On l’a vu, ces fuites représentent un tiers des prélèvements en eau destinés à l’irrigation.
En agriculture, nous devons promouvoir l’irrigation de précision, par exemple, en adaptant les apports d’eau aux besoins de la plante par le biais de sondes.
La deuxième recommandation tend à se préoccuper de la constitution de réserves, puisque la bonne gestion de la ressource ne suffira pas.
Dans cette perspective, il est primordial de consolider la recherche et, pour ce faire, de s’appuyer sur la compétence des entreprises françaises, notamment en ce qui concerne la réutilisation des eaux usées – sujet sur lequel les avancées sont nécessaires.
Une autre piste est celle de l’agro-écologie, qui repose sur une utilisation optimale de la ressource et des mécanismes naturels. Il s’agit ainsi de promouvoir une meilleure gestion du sol, de façon à éviter les phénomènes d’érosion et à favoriser la capacité à retenir l’eau par la recomposition de l’humus.
Nous devons également penser à la reconstitution des nappes phréatiques, ou encore à la création de réserves d’eau en période d’abondance, lesquelles permettent, en particulier, de maintenir le bon état écologique des cours d’eau.
Cette question soulève d’ailleurs le problème des réserves hydroélectriques. Alors que l’on sollicite le renouvellement des concessions, n’aurait-il pas fallu, au préalable, madame la secrétaire d’État, réfléchir au partage de ces réserves, préemptées en amont ?
Enfin, c’est sur la façon dont il faut appréhender le partage commun de la ressource qu’il est urgent de travailler. Je suis un peu en désaccord, sur cette question, avec Rémy Pointereau. Je pense que l’organisation autour des agences de bassin est pertinente. Et si les résultats se sont fait attendre par rapport aux objectifs, c’est la gestion bien trop centralisée de ces bassins qui est à remettre en cause. Je préconise de donner un véritable pouvoir aux comités de bassin et d’organiser une gestion décentralisée par bassin et sous-bassin territorial.
Par ailleurs, la compétence GEMAPI me semble être une bonne piste, car, sur le terrain, il faudra croiser les politiques agricole, d’urbanisme et de gestion des milieux aquatiques pour adapter la ressource aux besoins et mobiliser tous les acteurs autour d’un projet territorial partagé et non imposé.
Je souhaite, maintenant, aborder une question qui inquiète actuellement les entreprises de la filière de l’eau.
Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, les entreprises françaises spécialisées dans ce domaine sont reconnues internationalement et décrochent de nombreux marchés à l’étranger.
Ces acteurs se regroupent dans des pôles de compétitivité à vocation mondiale et dialoguent avec des clusters nationaux dans des pays tels que les États-Unis, la Corée du Sud, les Pays-Bas ou Singapour. Or le Gouvernement est en passe de réduire considérablement le nombre de pôles de compétitivité à vocation mondiale, en les régionalisant. Cela signifie que ces pôles vont perdre leur capacité d’influence à l’international, sans parler de la baisse des moyens qui leur seront octroyés.
La filière des entreprises de l’eau est nationale. Aujourd’hui, les pôles de compétitivité à vocation mondiale coordonnent l’action des différents acteurs de l’ensemble du territoire pour répondre aux appels d’offres à l’étranger. Une régionalisation n’aurait donc aucun sens et nuirait aux missions de structuration nationale et internationale. Il existe un risque réel que les pôles sortent de leur logique de filière industrielle pour devenir un simple outil de la région.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de relayer cette inquiétude auprès du ministère de l’économie, qui est chargé de ce dossier, pour que les pôles à vocation mondiale liés à l’eau ne soient pas régionalisés.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – M. Roger Karoutchi applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, quand on lit avec attention les deux rapports rédigés l’un par MM. Tandonnet et Lozach, l’autre par M. Pointereau – rapports qui se complètent d’ailleurs parfaitement –, on perçoit en filigrane les fondamentaux de la chaîne décisionnelle, fondamentaux que vous connaissez tous : la loi, son esprit, son interprétation et son application…
Et, dans le domaine de l’eau, la responsabilité de ces items est bien partagée entre l’État, voire l’Europe, le législateur et les maîtres d’ouvrage. Du coup, on assiste très logiquement à des peurs, des incompréhensions, des tensions, voire des conflits, qu’ils soient d’usage ou administratifs.
Aussi permettez à un vieux militant de l’eau de formuler trois ou quatre réflexions très ciblées. Je dis « vieux militant », parce que, lorsque j’étais en responsabilité, de l’eau, j’en avais partout : beaucoup en dessous et beaucoup au-dessus… C’est ainsi que, toutes les lois, obligations et contraintes en la matière, je les ai pratiquées, endurées et subies… Et les noms d’oiseaux attribués aux gens de la DIREN, puis de la DREAL, ont longtemps émaillé mes relations avec l’État… C’est souvent la règle du jeu !
Fort de cette expérience, certaines réflexions sont pour moi des évidences.
Première évidence : dans le domaine de la gestion de l’eau, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire ! C’est-à-dire qu’on ne peut pas vouloir une implication plus forte des collectivités locales et, en même temps, demander le transfert de la GEMAPI aux agences de l’eau ou à l’État.
La taxe GEMAPI est un outil financier de solidarité territoriale que nous avons réclamé pendant des années. Nous, les acteurs locaux, qui protégeons les champs captants, subissons les inondations et assumons la gestion des polders ! Éloigner la gestion de la GEMAPI des acteurs locaux ou locorégionaux serait une ineptie !
Et puisque nous évoquons les financements, laissez-moi vous faire une suggestion. Généralisons les contrats de ressources, ces quelques centimes ajoutés au prix du mètre cube d’eau potable qui sont reversés intégralement à la collectivité qui fait des travaux de protection d’un champ captant ! Quelques centimes le mètre cube, mais sur un grand volume, cela peut aider au remboursement des emprunts. Et là, tous les consommateurs payent; pas seulement ceux qui habitent au-dessus du champ captant, où l’on puise l’eau potable.
Deuxième évidence : les agences de l’eau sont des partenaires indispensables pour les maîtres d’ouvrage, sur le plan tant technique que financier.
Or les objectifs de la directive-cadre sur l’eau ne sont pas irréalistes, les effets du changement climatique s’imposent à nous chaque jour et certaines régions ont accumulé les handicaps – d’ailleurs, il faut bien l’avouer, il reste beaucoup à faire…
C’est pourquoi, il n’est pas de bonne politique de ponctionner financièrement les agences pour alimenter le budget de l’État, sous prétexte qu’elles ont de bonnes trésoreries.
Approbations sur les travées du groupe Les Républicains.

Ensuite – avouons-le, madame la secrétaire d’État ! –, jouer les alchimistes, en transformant une partie des taxes sur l’eau en impôts indirects, c’est financièrement très subtil, mais moralement indéfendable.
Alors, que l’on modifie les compétences des agences, oui ! Qu’on leur demande d’être encore plus offensives, oui ! Elles y sont prêtes et elles assumeront ! Mais pas de ponction systématique ! En plus, on peut aisément reconnaître que, bien gérer pour être finalement ponctionné, c’est quand même frustrant et très démotivant…
Troisième évidence : la loi doit rester ambitieuse et les contraintes doivent nous obliger à faire. Je sais qu’en disant cela, je risque de m’attirer les foudres de nombreux élus ou de certaines professions. J’ai moi-même beaucoup râlé, mais tout le monde a le droit, dans le domaine de l’eau, d’avouer certains débordements…
Sourires .

Pourquoi cette recommandation ? Simplement parce que la pratique montre que l’eau fait rarement partie des urgences et que les priorités, pour des raisons politiques ou financières, sont souvent ailleurs. En outre, un tout-à-l’égout, ça coûte cher, c’est bon pour la nature, mais ce n’est pas payant électoralement parce que ça ne se voit pas…

Enfin, pour nombre de personnes, l’eau est un élément inépuisable et réparable, ce qui – nous le savons tous – est entièrement faux. Et si le gendarme législatif ou réglementaire n’était pas là pour rappeler à l’ordre, les choses seraient bien souvent remises à plus tard.
Alors, dans le domaine de l’eau, le processus est clair : il faut transformer l’obligation en prise de conscience, la prise de conscience en devoir et le devoir en réussite.
Quatrième et dernière évidence : pour ce qui concerne l’eau, il n’est pas interdit d’être inventif et audacieux ; en plus, il est fortement recommandé d’avoir le sens pratique et de faire beaucoup de pédagogie.
Inventif en matière d’aménagement du territoire et urbain.
Audacieux du point de vue des nouvelles techniques et technologies pour se séparer de tous les produits résiduels, qui empoisonnent notre environnement avant de nous empoisonner, nous.
Pragmatique quant à l’usage des eaux usées ou des eaux de pluie.
Et très fortement pédagogique, parce que les gens auront toujours du mal à comprendre que l’on fasse des restrictions budgétaires sur tout, tout en dépensant des sommes colossales pour réaliser des passes à poissons… Réaction naturelle et compréhensible !
Approbations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Alors, mes chers collègues, l’eau est un bien collectif. Et puisqu’il y a danger et urgence et puisque l’eau est malade, c’est bien collectivement que nous devons rédiger l’ordonnance. Et, très honnêtement, on lui doit bien cela !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue à mon tour l’opportunité, saisie par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, d’un tel débat sur la ressource en eau, dix ans après l’adoption de la loi sur l’eau, un an après la signature de l’accord de Paris, quelques jours avant la tenue de la COP 22, à Marrakech, et quelques mois avant des échéances politiques majeures.
Pour Nizar Baraka, président du comité scientifique de la COP 22, il s’agit d’« encourager nos pays respectifs à s’engager, de manière forte, dans les secteurs liés à l’économie verte et également à l’économie bleue, afin de profiter des opportunités qui y sont associées en termes de croissance et d’emploi ». Car l’un ne va pas sans l’autre !
Comme le martèle très justement le rapport de MM. Tandonnet et Lozach, « la crise climatique est une crise aquatique ». À l’heure où 40 % de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable et où des crises climatiques se traduisent par des alternances de périodes de sécheresse et d’inondations et entraînent les mouvements migratoires que nous pouvons constater, le temps est effectivement venu d’une responsabilité partagée, en vue d’une gestion raisonnée et durable de la ressource hydrique.
Je suis, à ce titre, ravi que le projet de loi « Acte II de la loi Montagne », qui a été adopté hier par l’Assemblée nationale à la quasi-unanimité, ait intégré, parmi ses objectifs majeurs et dès l’article 1er, l’usage partagé de la ressource en eau.
Cet usage partagé doit tout d’abord continuer à privilégier une gestion de qualité. En 2006, la France s’était engagée à atteindre, en 2015, le bon état écologique de deux tiers de ses masses d’eau de surface. La trajectoire est vertueuse, mais nous ne sommes pas encore parvenus à des résultats totalement probants.

Faut-il pour autant casser le thermomètre sous prétexte que la fièvre est trop élevée ? Je ne le crois pas !
La ressource en eau n’est pas une ressource comme une autre et l’exigence de qualité doit perdurer.
Les marges d’économies existent. Cela suppose, à n’en pas douter, une gouvernance beaucoup plus fine, mieux coordonnée et plus réactive.

Je souhaite, à ce titre, qu’une intervention rapide en faveur de l’entretien des réseaux puisse être une priorité systématique au sein des documents de planification – schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et contrats de milieux –, y compris par un fléchage beaucoup plus important des subventions des agences de l’eau. Je souhaite aussi l’application d’une TVA à taux réduit pour tous les travaux concourant à la réduction de la perte hydrique.
J’ai noté vos inquiétudes, monsieur le rapporteur, sur le sort des fonds de trésorerie des agences de l’eau et les prélèvements correspondants. Même si les agences remplissent à ce jour leurs missions, elles pourront sans doute être mieux mobilisées au service de l’entretien des réseaux.
L’Institut national de la consommation expose une réalité, qui constitue un enjeu de taille : « Tout au long des 850 000 kilomètres de canalisations du réseau français d’alimentation en eau potable, un quart de l’eau mise en distribution serait perdu à la suite de fuites. »
Élu de montagne, comme beaucoup d’entre vous, mes chers collègues, et, à ce titre, aux avant-postes des signes du changement climatique, je suis aussi sensible à des mesures pragmatiques et de bon sens pour la prévention des catastrophes hydriques, comme les inondations ou les sécheresses.
Deux chantiers me paraissent indispensables. Il nous faut d’abord mener une réflexion sur des possibilités accrues d’entretien et de dragage pour certains cours d’eau, de manière à prévenir les inondations, en toute sécurité et dans un cadre donné. Je souhaite, ensuite, que soit menée une réflexion sur la question des débits réservés dans les territoires de montagne affectés par de grandes variations saisonnières des étiages.
Voilà peu de temps, nous nous sommes fixé des objectifs de réduction de la température terrestre. Des objectifs plus prescriptifs et concertés de réduction de la consommation globale d’eau ne me paraîtraient pas impensables. Il s’agirait d’un changement culturel majeur, qui nécessiterait une sensibilisation, dès l’école, à un usage beaucoup plus modéré de l’eau. §Des enseignants le font déjà et des campagnes nationales d’information pourraient être des atouts indispensables.
Le consommateur y gagnerait, puisque, à terme, les factures seraient allégées. Nos collectivités y gagneraient. Notre économie future, notamment tous les écosystèmes visant à économiser de l’eau, y gagnerait. Notre cadre de vie et celui de nos enfants y gagneraient.
Au Sénat, nous disposons d’un outil majeur pour mettre en œuvre, dès maintenant et sur un territoire donné, des actions concertées permettant d’évaluer cette possibilité : une expérimentation, avec des objectifs chiffrés sur trois ans et des appels à projets correspondants.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe du RDSE. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le débat, qui s’ouvre aujourd’hui grâce au travail des rapporteurs des deux missions considérées, porte sur les mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et sur ce que nous devrions améliorer, corriger, inventer.
Le premier rapport établit un bilan national et le second a pour finalité de proposer des mesures, afin de prévenir la survenance des conflits d’usage de l’eau. Son objet se limite à l’eau douce et n’aborde pas les enjeux géostratégiques. Les propositions émises restent donc limitées à la France, mais le constat d’urgence, que nous partageons sans réserve, dépasse largement nos frontières. D’ailleurs, le rapport de la délégation à la prospective évoque le lien, désormais incontestable à l’échelon planétaire, entre le dérèglement climatique et les tensions sur la ressource en eau.
L’ONU a adopté, dans le cadre de son programme de développement durable, un objectif n°6, qui invite à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». En outre, les travaux de la COP 22 prévoient d’aborder cette thématique plus précisément.
Il est de la responsabilité des États, des collectivités et des entreprises de mettre en œuvre, concrètement et sans attendre, cet objectif à l’échelle nationale, comme internationale, en reconnaissant enfin l’eau comme un patrimoine commun de l’humanité, un bien commun supérieur pour l’ensemble du vivant.
Or face à l’ampleur de la tâche et à l’urgence vitale, un long chemin reste à parcourir.
Ainsi, d’après les chiffres donnés par les Nations unies, 663 millions de personnes dans le monde sont encore privées d’eau potable et au moins 1, 8 milliard d’individus utilisent une source d’eau potable contaminée, notamment par des matières fécales – la catastrophe actuelle à Haïti montre les ravages sanitaires d’une telle situation.
Plus de 80 % des eaux usées résultant des activités humaines sont déversés dans les rivières ou à la mer sans aucune dépollution et, chaque jour, 1 000 enfants meurent de maladies, pourtant faciles à prévenir en améliorant les conditions d’assainissement et d’hygiène.
Aujourd’hui, la pénurie d’eau affecte plus de 40 % de la population mondiale, et ce pourcentage devrait augmenter. Plus de 1, 7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins fluviaux, où l’utilisation de l’eau est supérieure à la quantité disponible et se fait également au détriment des écosystèmes.
Comme le décrit le rapport de la délégation à la prospective, le dérèglement climatique accélère ces phénomènes et crée de nouvelles tensions sur l’eau et la biodiversité. Le stress thermique pour les populations de poissons ou les phénomènes d’eutrophisation et d’évaporation inhérents à l’augmentation de la température et qui risquent d’accentuer la concentration des sels dans les sols ne constituent que quelques exemples. La liste est longue des maux auxquels nous devons nous préparer.
C’est pourquoi nous vous rejoignons sur le réalisme dont nous devons faire preuve, comme sur la solidarité qui doit guider nos actions.
Mais après la lecture des propositions, au moment de l’action, je formulerai quelques réserves.
Tout d’abord, quelques remarques liées aux propositions de la mission d’information sur le bilan de l’application de la loi de 2006.
Pour ce qui concerne la gestion qualitative de l’eau, nous dénonçons, comme vous, le prélèvement par l’État sur le fonds de roulement des agences de l’eau. Il serait d’ailleurs bon que cette position soit réaffirmée chaque année, quel que soit le gouvernement en place… J’écouterai avec attention les propos qui seront tenus l’année prochaine sur ce sujet…
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Nous pensons également qu’il est utile de privilégier des solutions locales pour associer l’ensemble des acteurs à la concertation.
Dans sa contribution annexée au rapport de la délégation à la prospective, l’Association des maires de France signale, à juste titre, la difficulté née de la réforme territoriale, qui impose un cadre territorial et administratif, alors que les élus locaux prônaient une rationalisation des services de l’eau et de l’assainissement.
Il faut absolument prendre en compte les facteurs physiques géographiques de la qualité et de la proximité de la ressource en eau.
Pour ce qui concerne la gestion quantitative de l’eau, vous avez raison, monsieur Lozach, la ressource ne se crée pas, elle se gère ! Or l’état des réseaux est préoccupant : 25 % de l’eau prélevée n’arriverait pas à l’usager et, dans certains secteurs, ce pourcentage est encore plus élevé. Connaître les réseaux, les réparer et les entretenir entraîne des coûts, que les collectivités ne peuvent pas supporter seules.
Et si la vente d’eau génère des bénéfices, alors ceux-ci doivent financer ce qui, pour nous, doit être un service public !
Nous sommes évidemment favorables à un soutien financier aux collectivités pour financer l’assainissement et lutter contre les fuites sur les réseaux d’eau potable, ainsi qu’à la mise en place d’un plan d’action visant à acquérir une connaissance approfondie de ces réseaux, afin de rechercher et réparer les fuites ou renouveler les conduites.
Je dirai maintenant quelques mots sur ce qui, à mon sens, manque dans les propositions.
D’une part, les rapports évoquent la question des pollutions diffuses. À ce sujet est cité le rapport d’évaluation de la politique de l’eau établi par Anne-Marie Levraut au mois de septembre 2013 et rappelé que la moitié des masses d’eau sont dégradées du fait de pollutions diffuses d’origine agricole : utilisation de nitrates ou de pesticides. Mme Levraut concluait son rapport par cette phrase : « L’enjeu est de passer d’une multitude d’actions curatives à une approche préventive cohérente et à la bonne échelle, tirant ainsi les conséquences de la reconnaissance d’un cycle de l’eau unique au bénéfice de tous les usages. »
Mais voilà, les propositions qui devraient en découler restent timides. Certes, des progrès doivent être relevés, comme en témoigne l’application de la directive Nitrates, mais on constate également des rendez-vous manqués.
Un exemple récent : lors de l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité, le parlement français n’a pas voulu interdire la culture des plantes tolérantes aux herbicides. Pourtant, dès 2011, un rapport de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, et du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, sur cette question, commandé par les ministres de l’agriculture et de l’écologie, notait que l’emploi de ces variétés tolérantes aux herbicides conduisait mécaniquement à des teneurs plus élevées des molécules chimiques dans les eaux et augmentait le risque d’atteindre les taux limites réglementaires pour la potabilité.
D’autre part, le rapport de la délégation à la prospective note à propos de l’eau virtuelle, c’est-à-dire la quantité d’eau nécessaire pour produire des biens de consommation, que « c’est une notion importante, car elle est de nature à modifier les ordres de grandeur du commerce international » et que la négliger reviendrait à déplacer nos problèmes sur les pays qui sont déjà en difficulté. Nous sommes en accord avec cette affirmation. L’économie mondialisée déplace effectivement nombre de problèmes vers les pays les plus pauvres et les populations les plus vulnérables. C’est la raison pour laquelle il faut développer une économie circulaire de proximité, respectueuse, de fait, de l’environnement et des hommes. L’économie de l’eau en est le cœur.
Enfin, je regrette que le droit à l’eau pour les plus démunis n’ait pas été évoqué dans les rapports. Tout le monde n’a pas accès à l’eau potable en France. C’est une réalité que nous devons combattre avec détermination.

C’est aux collectivités locales qu’incombe cette responsabilité, et il faut les y aider.
Pour conclure, je tiens à saluer le travail utile et intéressant réalisé dans le cadre de ces deux rapports complémentaires qui nous permet de poursuivre notre réflexion sur des sujets aussi essentiels.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en 2010, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies reconnaissait que le droit à l’eau potable est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme. Or, aujourd’hui, 700 millions de personnes dans le monde ne disposent pas d’un accès à une eau propre et salubre.
Les experts du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, et la communauté scientifique s’accordent sur une hausse globale des températures qu’il est impératif d’anticiper. En France, la situation sera assez paradoxale : nous connaîtrons à la fois plus d’inondations et plus de sécheresses, car l’augmentation des températures accroît l’évaporation au niveau des sols et la transpiration par les plantes. Les conflits d’usage s’intensifieront lors des périodes de pénurie de la ressource, alors que ces usages sont tous aussi légitimes les uns que les autres.
À partir de ces constats et de ces travaux, il est impérieux d’adapter la gestion de l’eau au changement climatique. Les rapports de nos collègues Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach, d’une part, et Rémy Pointereau, d’autre part, participent pleinement à la nécessaire sensibilisation sur ce sujet.
Nous avons la chance de disposer d’outils de prospective, tels que les projets Aqua 2030 ou Explore 2070, et de connaissances scientifiques sur les évolutions de l’état quantitatif et qualitatif de l’eau. Aucune excuse ne pourrait donc justifier l’inertie, alors que l’absence de prévention en la matière est très coûteuse.
Il faut le dire, la consommation française en eau est inférieure à la moyenne européenne. Des progrès réels sont intervenus, grâce aux changements de comportements et à la généralisation d’appareils électroménagers plus économes. Toutefois, les rapporteurs nous rappellent qu’il faut intégrer l’eau virtuelle nécessaire à la production des biens de consommation importés. Notre pays serait ainsi importateur net de 8, 4 milliards de mètres cubes d’eau par an.
Bien sûr, les progrès technologiques doivent nous permettre de faire face à une pénurie d’eau, mais ils ne peuvent pas tout. Le stockage de l’eau pour constituer des réserves, la désalinisation de l’eau de mer à base d’énergies renouvelables ou la réalisation de grands ouvrages structurants ont un coût non négligeable.
Pourtant, les économies d’eau sont encore possibles. Des marges de manœuvre existent et le rôle des collectivités territoriales est ici essentiel, à condition de leur donner les moyens qui correspondent à leurs responsabilités.
Si l’on se fonde sur la consommation nette de la ressource en eau, puisqu’une partie de l’eau prélevée retourne dans le milieu, le secteur agricole représente 50 % de la consommation totale. L’agriculture sera touchée par le changement climatique, alors qu’elle a la noble tâche d’assurer l’indépendance alimentaire de notre pays. Toutefois, comme cela a été dit, le potentiel d’amélioration est important pour ce secteur.
La qualité des sols, fortement dégradée, doit être améliorée. Pour citer Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l’ONERC, « un sol sain, un sol riche en matière organique est aussi un sol vivant, un sol qui reçoit mieux l’eau, qui la stocke mieux, qui en garde davantage ».
L’État doit accompagner l’ensemble des acteurs et investir dans une agriculture plus durable grâce à la réduction des intrants avec de nouvelles pratiques agricoles, l’irrigation de précision, les fermes connectées, la permaculture ou encore les fermes verticales. De nombreuses initiatives voient le jour un peu partout, y compris dans notre pays !
Pour ce qui est de l’eau potable, le problème des fuites sur les réseaux a été identifié de longue date. Cela représente un gaspillage moyen de 25 % de l’eau prélevée, jusqu’à 50 % de fuites dans certaines zones rurales.
Les départements de l’Ardèche, du Morbihan, du Lot – le mien –, de Lot-et-Garonne – celui d’Henri Tandonnet – et de Tarn-et-Garonne sont d’ailleurs les plus concernés par un prix de l’eau élevé. Les raisons sont identifiées : un habitat dispersé, des contraintes géographiques et des réseaux très étendus.
Or le prix de l’eau, s’il demeure encore inférieur à celui pratiqué chez nos voisins européens, augmentera du fait des évolutions réglementaires nécessaires pour atteindre les objectifs de la directive européenne du 23 octobre 2000.
Madame la secrétaire d’État, il est urgent de garantir la couverture des coûts du service de l’eau, qui comportent 80 % de coûts fixes, et de dégager de nouvelles sources de financement pour que la hausse des prix ne pèse pas excessivement sur les consommateurs.
La gouvernance de la politique de l’eau est également à repenser. La multiplicité des acteurs rend le système opaque, à tel point que l’on ne sait plus qui fait quoi, mais cela n’est pas une particularité française. Nous considérons que la « crise de l’eau » est avant tout une crise de gouvernance. Or, dans le contexte de la réforme territoriale, je m’interroge sur l’accompagnement technique et financier qui doit être accordé aux collectivités, notamment aux communes rurales.
C’est la raison pour laquelle la ponction de l’État sur les fonds de roulement des agences de l’eau depuis la loi de finances pour 2015, et qui s’élèvera à 175 millions d’euros l’an prochain, est source d’incompréhension et constitue un très mauvais signal. Le Gouvernement a-t-il pris la mesure de cette situation découlant d’un déficit de financement, pour reprendre les termes utilisés par l’OCDE ?
Sur cette question, comme sur beaucoup d’autres, évoquées dans mon intervention et approfondies dans les rapports de nos excellents collègues, nous attendons des réponses précises de la part des services de l’État, des réponses à la hauteur des enjeux. Cela nous paraît, bien entendu, couler de source !
Sourires. – Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaiterais tout d’abord féliciter nos collègues Henri Tandonnet, Jean-Jacques Lozach et Rémy Pointereau pour la qualité de leurs travaux, qui ont le mérite d’ouvrir la réflexion et d’avancer un certain nombre de pistes d’action.
Sur cette question cruciale de la gestion de la ressource en eau, je voudrais insister sur trois enjeux dans mon propos.
Le premier est relatif à la nécessaire consolidation des agences de l’eau dans leur financement et leurs missions, alors que leur capacité d’action se trouve actuellement remise en cause. Je fais en effet allusion, comme de nombreux orateurs qui m’ont précédé, au prélèvement de 175 millions d’euros sur le budget des agences de l’eau prévu pour 2015, 2016 et 2017.

Vous allez l’entendre répéter à de nombreuses reprises, madame la secrétaire d’État !

Cette ponction arbitraire n’est pas acceptable, car c’est oublier que les agences de l’eau prélèvent des redevances auprès des usagers pour financer des actions d’intérêt général et qu’elles jouent un rôle stratégique au cœur des enjeux actuels de gestion équilibrée de la ressource en eau. Ce prélèvement est une véritable rupture du contrat de confiance.
Elle n’est pas acceptable non plus lorsque l’on connaît les besoins des collectivités territoriales pour l’entretien des réseaux et en matière de travaux d’assainissement.
Je citerai un seul exemple : dans le bassin Rhin-Meuse, pour 360 millions de mètres cubes d’eau prélevés tous les ans par les collectivités et les réseaux de distribution d’eau potable, 90 millions de mètres cubes sont perdus en raison des défaillances des réseaux. C’est un véritable gâchis, surtout si l’on pense aux travaux qui auraient pu être réalisés si l’État n’avait pas effectué ce prélèvement, du point de vue de la préservation de la ressource en eau, mais également du point de vue de l’activité économique.
En ce sens, la proposition de notre collègue Rémy Pointereau d’interdire le prélèvement par l’État sur le fonds de roulement des agences de l’eau me paraît extrêmement pertinente.
Autre enjeu que je souhaiterais souligner : l’importance de concentrer les missions des agences de l’eau sur la biodiversité aquatique selon le principe fondateur de notre politique de l’eau, rappelé par notre rapporteur : « l’eau paie l’eau ».
En ce sens, je veux redire mon opposition ferme au parti pris opéré dans la récente loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : la contribution financière versée par les agences de l’eau à la future Agence française pour la biodiversité n’a pas vocation à être affectée à des missions autres que la préservation de la biodiversité aquatique et la mise en œuvre des objectifs fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE.
Le second enjeu majeur que je souhaite évoquer concerne notre capacité à définir une vraie politique de l’eau offensive et à anticiper les aléas climatiques en valorisant nos richesses hydrauliques.
Ne l’oublions pas, la France a la chance de pouvoir se prévaloir d’une pluviométrie exceptionnelle sur l’ensemble des territoires, même s’il est n’est pas toujours équilibrée au long de l’année. Nous vivons un véritable gâchis, parce que nous n’avons pas l’ambition ni la capacité de constituer des réserves d’eau au moment où la pluviométrie est abondante pour mener ensuite une véritable politique économique, une politique d’équilibre de la ressource en eau, une politique pour l’agriculture, mais aussi une politique pour la production énergétique, qui contribuerait à la lutte contre le réchauffement climatique.
Récemment, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, s’est prononcé sur le sujet : il recommande que l’État organise les moyens de financements nécessaires, au sein des programmes des agences de l’eau et de l’Europe, pour atteindre de 70 % à 80 % de concours publics pour les retenues de substitution.
Il nous faut inscrire la politique nationale de l’eau dans la modernité. J’en viens donc au troisième enjeu qui me tient à cœur : la nécessité de capitaliser sur la recherche et l’innovation et de surmonter les barrières psychologiques et réglementaires.
Je veux, en effet, être optimiste : l’époque est formidable ! Nous assistons à l’émergence de nouveaux process industriels, notamment dans le secteur agroalimentaire. Par exemple, lorsque l’on sèche du lait, on est capable aujourd’hui de récupérer 70 % de l’eau d’un litre de lait. Malheureusement, madame la secrétaire d’État, la réglementation n’autorise pas la réutilisation de cette eau à des fins alimentaires, parce qu’elle ne provient pas d’un réseau. C’est un véritable gâchis quand on pense aux millions de mètres cubes d’eau qui pourraient être produits grâce à ces améliorations !

Deuxième exemple, en l’espace de dix ans, certains industriels ont réduit de 50 % la consommation d’eau pour leurs fabrications. Là encore, il y a des enjeux de modernisation et d’investissement absolument fabuleux !
Je terminerai mon intervention en rappelant la nécessité de recentrer la politique de l’eau sur les territoires et les acteurs locaux, en misant sur les solutions pragmatiques et adaptées à chaque réalité de terrain.
Actuellement, la commune reste le mode d’organisation dominant, particulièrement en assainissement collectif : en 2013, deux ans avant la promulgation de la loi NOTRe, la moitié des communes seulement avaient transféré toutes leurs compétences en eau et assainissement à l’échelon intercommunal. Faisons donc confiance à la proximité : le projet de retirer aux communes la gestion de l’eau est véritablement une erreur !
De même, le patrimoine énergétique hydraulique n’est pas suffisamment exploité, alors qu’il permet, en zone rurale, de créer une source de revenus complémentaires et de lutter contre le réchauffement climatique et la dépendance énergétique de la France.
Enfin, il est urgent de placer à nouveau notre confiance dans les maires, les acteurs de terrain, les agriculteurs notamment qui, forts de leur connaissance des territoires et des techniques de production, sont porteurs de solutions multiples. Oui, l’eau est une urgence déclarée afin d’en faire une chance pour la France !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur le banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la suspension des travaux parlementaires qui a suivi la publication, en juillet dernier, du rapport d’information de notre collègue Rémy Pointereau, m’a donné l’occasion de conduire en Vendée une réflexion avec les responsables des commissions locales de l’eau et de Vendée Eau, syndicat départemental de l’eau potable.
Agir avec pragmatisme et discernement concernant la gestion de l’eau est une approche qui a fait l’unanimité. Je me permets de vous faire part de quelques points de ma réflexion concernant la gestion qualitative et la gouvernance de l’eau.
La directive-cadre sur l’eau de 2000 fixe les objectifs de préservation et de restauration de l’état des eaux superficielles, douces et côtières, et pour les eaux souterraines. Néanmoins, les paramètres d’évaluation et de mesure – plus communément le « thermomètre » – évoluant tous les ans, les efforts réalisés ne peuvent plus être appréciés à leur juste valeur. Il faut impérativement conserver les objectifs, mais laisser aux acteurs de terrain le choix des paramètres plus adaptés aux réalités des milieux aquatiques.
S’agissant des pollutions diffuses, pour « renaturer » les cours d’eau, il est indispensable d’associer à la réflexion et aux actions l’ensemble des acteurs économiques, agricoles – propriétaires et exploitants – et non agricoles.
S’agissant des moyens financiers, le fonds de garantie « boues » de la loi sur l’eau doit être conforté, mais en faisant évoluer sa destination vers des solutions alternatives telles que les zones filtres plantées de roseaux ou la valorisation des boues en biogaz.
En outre, les moyens dédiés à la protection des captages doivent aussi être renforcés.
Il s’agit, premièrement, des aides de l’agence de l’eau destinées à accompagner les collectivités territoriales dans l’exercice de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et les agriculteurs dans la réduction substantielle des intrants.
Deuxièmement – j’anticipe le débat sur la loi de finances pour 2017 –, il convient de renoncer au prélèvement opéré sur le fonds de roulement des agences de l’eau. Je tiens à dénoncer cette pratique, car la politique de l’eau et la préservation de la biodiversité exigent le maintien des moyens alloués, provenant d’ailleurs à 85 % d’un prélèvement sur les factures d’eau des consommateurs.
L’objectif de continuité écologique impose un travail concerté et partagé impliquant les services de l’État dès les phases de concertation. La politique de la chaise vide à ce stade, pour balayer a posteriori un programme d’actions et ses moyens techniques choisis, n’est plus acceptable.
Pour nous projeter dans un avenir plus serein et pleinement efficace, nous devons mettre en place une gouvernance qui, au sein de toutes les instances, intègre l’ensemble des acteurs et reconnaisse leurs compétences respectives, instaure des relations basées sur la confiance et non la défiance, favorise le retour d’expériences entre bassins versants et renforce le rôle des syndicats de rivière en lien avec les commissions locales de l’eau.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur le banc des commissions.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour le groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le thème du débat qui nous réunit ce soir est un sujet vital, parce qu’il engage l’avenir de notre planète tout autant que celui de l’humanité.
L’accès à l’eau et la gestion durable de cette ressource sont des défis mis à l’épreuve d’un réchauffement climatique de plus en plus prégnant.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’approvisionnement de l’ensemble de la population mondiale en eau potable demeure un défi de taille, alors que, dans le même temps, les activités humaines, l’agriculture en particulier, sont soumises à des contraintes de plus en plus fortes.
Le débat que nous avons aujourd’hui sur les conclusions des rapports de nos trois collègues, que je tiens, à mon tour, à féliciter pour la qualité de leur travail, me donne opportunément l’occasion d’évoquer plus en détail ce second aspect.
Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, le fait que notre discussion intervienne à la suite d’une période de sécheresse inédite dans notre pays ne relève nullement du hasard de calendrier. L’évidence scientifique est aujourd’hui démontrée : à l’avenir, ces épisodes sont voués à se multiplier.
Dans mon département, la Dordogne, comme partout en France, les agriculteurs ont été gravement impactés par cette sécheresse. Le déficit pluviométrique s’est établi à 80 % en juillet et à 70 % en août, entraînant la publication de plusieurs arrêtés de restriction. La filière céréalière, l’élevage, mais également la trufficulture, ont été particulièrement touchés et vont devoir gérer les conséquences de productions en baisse.
Ce constat global est, vous en conviendrez, mes chers collègues, préoccupant. Il ne doit toutefois pas nous condamner à la résignation et nous devons y puiser les enseignements pour préparer l’avenir et anticiper les évolutions, notamment climatiques.
Le dixième anniversaire de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la LEMA, que nous fêtons justement cette année, nous donne l’occasion d’établir un premier bilan qui doit déboucher sur des conclusions précises. S’il est vrai que cette loi a posé de bonnes bases dans la gestion de l’eau et ouvert la voie à des pratiques environnementales plus vertueuses, son application et sa mise en œuvre laissent encore à désirer à bien des égards, en particulier en ce qui concerne l’agriculture.
Les organisations agricoles et les exploitants que j’ai pu rencontrer cet été dans mon département plaident en faveur d’évolutions que nous leur avions promises voilà déjà dix ans. De même, les élus locaux, que nous représentons, sont eux aussi demandeurs d’une modification de la législation en vigueur, peu lisible et peu adaptée aux spécificités locales.
Aussi, il est à mon sens indispensable d’améliorer la gestion quantitative de l’eau, notamment concernant ses usages agricoles. Cette amélioration devra passer par une meilleure mise en œuvre des organismes uniques de gestion collective, les OUGC, dont les périmètres sont souvent incohérents avec la logique de la ressource elle-même, et dont le statut, peu clair, est juridiquement fragile.
Par ailleurs, l’augmentation des moyens de stockage, grâce à la création d’un nombre de réserves en eau adapté aux besoins de chaque territoire, est également un enjeu crucial. Prévue par la LEMA, la réalisation de telles réserves relève souvent du casse-tête pour les promoteurs de ces projets. Or cette solution permet de sécuriser non seulement l’alimentation en eau des animaux, mais aussi l’irrigation des cultures, tout en maintenant un étiage satisfaisant des cours d’eau, indispensable à la préservation de la vie aquatique.
Sans être pour autant l’unique remède, les réserves de substitution et retenues collinaires sont une alternative efficace aux prélèvements en milieu naturel en période de sécheresse.
Le bon sens et le pragmatisme doivent prévaloir sur ce sujet, et force est de constater que, depuis la levée du moratoire sur le financement de ces retenues par les agences de l’eau en 2013, les choses ont bien peu évolué. Comment ne pas évoquer la lourdeur de la réglementation ou la longueur des délais d’instruction des dossiers ?
Aussi, à mes yeux, l’allègement de la législation, la simplification des démarches, le recalibrage des études d’impact et une meilleure coordination des financements ne doivent pas être des sujets tabous, mais bien des objectifs.
Il en est de même pour les procédures de nettoyage des rivières ou de classement des cours d’eau : la lisibilité et la simplicité des démarches doivent prévaloir, afin d’assurer de meilleures relations entre agriculteurs et services de l’État.
Dans le même temps, la préservation de l’environnement doit rester une priorité, de même que la mise en place de pratiques agricoles plus économes en eau.
Je voudrais, enfin, dire un mot sur les moulins et installations hydroélectriques qui jalonnent les cours d’eau de notre pays. Ces ouvrages sont très nombreux dans mon département et, aujourd’hui, ils sont en danger, car leurs propriétaires sont confrontés à la nécessaire préservation de la continuité écologique des cours d’eau. Ils n’ont pas toujours les moyens de s’y adapter, alors même qu’ils répondent aux objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique.
Tels sont les éléments, mes chers collègues, que je souhaitais apporter à ce débat.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, chacun mesure que l’eau constitue une ressource unique et stratégique. Dix ans après l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, je voudrais remercier nos rapporteurs d’avoir dressé un état des lieux éclairant leurs recommandations.
Beaucoup a été dit avant moi sur le bilan d’application mitigé de la LEMA. Je souhaite insister sur le problème de la « surtransposition » française des directives européennes, mais je pense aussi aux dispositions contenues dans des textes non dédiés à l’eau, mais qui exercent un effet collatéral, comme les Grenelle de l’environnement, dans leurs versions I et II, la GEMAPI et la loi sur la biodiversité. Certaines dispositions, notamment celles du Grenelle de l’environnement, sont plus contraignantes que les objectifs fixés par la loi-cadre.
La France a classé bien trop de rivières et donc d’ouvrages, près de 15 000, dans un délai bien trop court d’aménagement obligatoire. Ces chiffres manquent de réalisme par rapport à ce qui se pratique ailleurs, ou par rapport aux capacités d’évaluation de chaque ouvrage dans des conditions correctes et au financement disponible.
Je voudrais aussi évoquer les classifications de rivières. La loi a imposé aux propriétaires d’ouvrages, en particulier de moulins, de nouvelles obligations qui suscitent souvent de fortes tensions sur le terrain, en raison de leur caractère impraticable ou exorbitant.

Or les aménagements de continuité écologique ont également des coûts non négligeables. Les particuliers ne peuvent pas assumer de telles charges, pas plus que les petites exploitations.
Cette situation pose la question du financement public. Soit on solvabilise la réforme en garantissant son financement public quasi total dans le programme d’intervention des agences de l’eau, soit on déclasse certaines rivières à enjeux mineurs pour revenir à un nombre de chantiers plus raisonnable à traiter.
Concernant la coordination des acteurs de l’eau et la planification au niveau des bassins, le cadre juridique est parfois étriqué, constitué d’obligations, et la coercition peut entraîner des crispations, là où seuls l’incitation et le volontariat pourraient permettre de surmonter les difficultés.
S’ajoute à cela un facteur aggravant : la centralisation excessive de la politique de l’eau au niveau de l’État, et surtout de ses services déconcentrés. Comment ne pas évoquer ici les conditions d’interventions parfois ubuesques des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA ? Quel maire n’a pas vécu ces situations étranges, où il est informé que tel petit fossé est en fait considéré par l’agent de l’ONEMA comme une rivière, avec toutes les contraintes associées ? Ces situations sont très symptomatiques d’un État qui nous accompagne de moins en moins, à l’exception des administrations de contrôle qui, elles, se maintiennent et, parfois, se renforcent.
Comment ne pas évoquer non plus l’exercice de la future compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ou GEMAPI, par les intercommunalités, dont la date d’entrée en vigueur a été heureusement repoussée par le Sénat ? On charge ainsi la barque des intercommunalités, en aggravant leurs charges financières. En outre, le choix de l’échelon intercommunal pour l’exercice de cette compétence obligatoire nouvelle n’est pas forcément le plus adapté, dans la mesure où ses limites ne correspondent pas nécessairement à celles du bassin versant.
Enfin, se pose, encore et toujours, la question du financement. Chacun se souvient des dernières lois de finances où un prélèvement dit « exceptionnel » a été opéré sur les budgets des agences de l’eau, au nom de la « contribution au redressement des finances publiques », également invoquée pour réduire les concours aux collectivités locales.
Je souscris donc aux recommandations qui visent à interdire ce prélèvement opéré par l’État sur les fonds de roulement des agences de l’eau afin de garantir un financement stable de la politique de l’eau. Ce devrait être une règle d’or ! Au lieu de quoi, le principe selon lequel « l’eau paie l’eau » a été régulièrement bafoué et une partie du produit de la redevance est venue alimenter le budget de l’État, ce qui dénature cette redevance, devenue de fait un impôt.
Il est piquant de voir que ce qui a été reproché aux collectivités locales pendant vingt ans est pratiqué aujourd’hui par l’État, alors que les collectivités doivent investir massivement dans le renouvellement des réseaux. Ces pratiques financières ont parfois pour conséquence que ces dernières doivent réviser leur politique d’accompagnement à la baisse.
Enfin, il faut réconcilier politique de l’eau et politique agricole. Depuis longtemps, ces deux politiques ont été pensées de façon dissociée, sans cohérence, sans objectifs communs.
Tout le monde s’accorde, en général, pour reconnaître qu’il faut cesser d’opposer les défenseurs de l’environnement au monde agricole. Pourtant, la révision en cours de l’arrêté du 12 septembre 2006 réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires instaure de nouvelles zones non traitées, non seulement le long des cours d’eau, et ce jusqu’à cinquante mètres dans certains cas. En l’état, des millions d’hectares seraient ainsi retirés de la production agricole en France.
Comment ne pas évoquer ici l’abandon du projet de Sivens ? On y trouve un condensé de tous les travers de l’État, avec la gestion chaotique d’un projet qui a mis quarante ans à mûrir avant d’aboutir à sa phase opérationnelle, mais qui a avorté du fait des revirements de l’État, au mépris de la volonté des élus locaux et des assemblées locales, malgré les multiples rejets des requêtes en tous genres et après que les opposants eurent épuisé les voies de recours ouvertes – non sans en avoir abusé –, sans oublier les occupations illégales de terrains sans droit ni titre…
Pourtant, la création d’ouvrages de stockage hivernal aurait permis de compenser la baisse des débits d’étiage. Elle était indispensable pour le développement des projets de territoire et des projets agricoles en particulier. Autant de projets agricoles avortés, alors que, dans cette zone, l’agriculture est l’activité économique principale. Depuis, plus rien !
En définitive, nous nous trouvons avec un État pitoyable, affaissé et déconsidéré dans l’exercice de sa compétence et de son autorité, sans parler de l’arrêté du 24 décembre 2015 qui enterra le projet définitivement. Il n’y a plus rien à ajouter, sinon à constater le gâchis et le précédent fâcheux ainsi créé.
Madame la secrétaire d’État, vous pouvez constater que la politique de l’eau n’est pas un long fleuve tranquille et que nous attendons de l’État qu’il soit un facilitateur, et rien d’autre !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur le banc des commissions.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour le groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je ferai quelques réflexions concernant le rapport de notre collègue Rémy Pointereau sur la gestion de la ressource en eau, dix ans après la loi du 30 décembre 2006.
Je ne veux pas opposer les usages, sans nier les conflits importants qui peuvent voir le jour. Sur le point emblématique de la continuité écologique, des tensions et des incompréhensions que la mise en œuvre de la politique publique peut susciter, le Gouvernement a choisi de favoriser le dialogue et la souplesse.
En effet, les préfets ont reçu instruction de ne pas consacrer trop d’énergie sur les éléments les plus bloquants et de favoriser la pédagogie en faisant connaître les exemples réussis de cette politique. Sur ce point, il faut mettre en lumière le fait que la patience est indispensable pour ne pas crisper les différents protagonistes ; nous devons rappeler que les activités et les aménagements humains peuvent, dans la très grande majorité des situations, être conciliés avec les exigences écologiques.
À côté des difficultés et des critiques que j’ai exprimées dans ma précédente intervention, la plus grande diversité de représentation dans les instances de bassin – comité de bassin, commissions locales de l’eau, conseils d’administration des agences de l’eau – permise par la loi sur la biodiversité est un progrès, en réponse aux critiques de 2015 de la Cour des comptes. Dans le même temps, l’élargissement des missions des agences de l’eau, ainsi que l’exercice concerté des pouvoirs de police, administrative ou judiciaire, de l’eau et de l’environnement par l’Agence française de la biodiversité permettra, je l’espère, une meilleure prévention et une gestion plus équilibrée des conflits d’usage.
Concernant la récente compétence GEMAPI, les intercommunalités devront se saisir de ce nouvel outil afin de le rendre performant et adapté. Sa mise en œuvre doit faire l’objet, dans l’idéal, d’un dialogue et d’un accompagnement de la part de plusieurs acteurs majeurs de la politique de l’eau, dont l’État et les agences de l’eau, mais sans pour autant retirer le pouvoir des mains des élus locaux.
De même, les projets de territoire devraient devenir un élément de référence de la mise en œuvre, au niveau local, de la politique de l’eau, en prenant soin d’intégrer les réalités de chaque territoire et l’ensemble des usagers. Typiquement, la question des projets de stockage et l’encadrement du cofinancement des agences de l’eau par l’instruction du Gouvernement du 4 juin 2016 est, à mes yeux, un moyen d’avancer sur ce sujet de manière raisonnée.
Pour conclure, les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés au niveau tant européen que national ne devraient pas faire l’objet d’une remise en question. C’est notre tâche que de permettre la poursuite sur les décennies à venir d’une politique de gestion et de protection de la ressource en eau durable. C’est notre exigence de ne pas rabaisser ces nécessaires prétentions ; c’est aussi notre devoir d’impliquer l’ensemble de nos concitoyens, car notre avenir n’est pas construit seulement pour quelques-uns.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la délégation, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je me réjouis que nos collègues de la délégation sénatoriale à la prospective aient décidé d’inscrire la problématique de l’eau à leur programme.
En effet, chacun connaît l’importance de la ressource en eau, que l’on se trouve en France ou dans le monde.
L’augmentation de la population, couplée au dérèglement climatique, rend d’autant plus pertinents les travaux de notre assemblée. Aussi, je remercie nos collègues Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach de la qualité de ce rapport. Leur travail met en évidence combien ce bien est précieux, puisqu’il est essentiel à la vie, et combien ses enjeux sont stratégiques.
Longtemps, nous avons cru que l’eau était abondante et inépuisable. Pourtant, dans mon département des Hautes-Alpes l’eau est un enjeu important depuis fort longtemps. Sa gestion a fait l’objet, sur plusieurs générations, d’une rigueur et d’un pragmatisme qui a permis d’irriguer les cultures et de développer l’élevage au moyen d’un système de canaux très performants.
Le barrage de Serre-Ponçon, mis en service en 1960, et ses 1 300 millions de mètres cubes d’eau permettent, d’une part, d’irriguer et, d’autre part, de produire de l’énergie.
Toujours qualifié de « château d’eau de la Provence », le département des Hautes-Alpes se trouve pourtant dans une situation très délicate eu égard aux obligations réglementaires qui ont depuis longtemps relégué le « bon sens paysan » au profit d’une surréglementation et de très nombreuses contraintes.

Si l’on peut se réjouir de la mise en œuvre d’un cadre réglementaire qui a permis au fil du temps d’apporter des réponses en matière d’usage de la ressource, de protection de la santé publique ou d’utilisation de l’énergie hydraulique, les récentes dispositions issues de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n’ont pas été mises en œuvre sans provoquer de nombreux problèmes.
Je voudrais, d’ailleurs, revenir sur l’excellent travail effectué par notre collègue Rémy Pointereau, auteur d’un rapport d’information établissant le bilan de l’application de la LEMA et intitulé Gestion de l’eau : agir avec pragmatisme et discernement.
Si, consécutivement à cette loi, il convient de se réjouir de l’amélioration de la qualité de l’eau, on peut cependant regretter des difficultés liées à sa mise en œuvre.
C’est pourquoi, dans le prolongement d’un état des lieux que nous pouvons qualifier de « préoccupant », nous devons saisir l’opportunité de nos travaux pour formuler de nouvelles propositions en matière de gestion de l’eau en France.
La réforme des classements des cours d’eau en les adossant aux objectifs de la directive-cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE doit faire l’objet d’une révision, en particulier s’agissant de la liste 2.
Les anciens classements ont été remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes arrêtées par le préfet coordonnateur. Autant la liste 1, établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, devrait peu évoluer, il n’en est pas de même pour la liste 2.
Cette liste concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique. Les travaux de restauration doivent être réalisés sur les ouvrages faisant obstacle à la continuité biologique et sédimentaire.
Dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire dans le bassin Rhône-Méditerranée, ce classement a été très pénalisant et le mode de calcul est bien éloigné de la réalité.
Toutes ces décisions apparaissent trop souvent comme arbitraires. C’est le cas, notamment, de l’obligation du débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Le seuil actuel n’est pas tenable pour les irrigants, qui sollicitent un retour au débit réservé de un quarantième au lieu de un sixième actuellement.
La spécificité du territoire, notamment le caractère montagnard, n’a pas été prise en compte. L’entretien et le nettoyage des cours d’eau sont tellement complexes que les collectivités préfèrent parfois ajourner un projet tant sa mise en œuvre relève de l’exploit. Pourtant, la récurrence des phénomènes d’érosion et d’inondation nous conduit à redoubler de vigilance.
Il existe aussi de véritables difficultés à concilier les intérêts de tous les usagers. Il semblerait, notamment, que les fédérations de pêche soient souvent à l’initiative de recours contentieux très pénalisants pour les projets soumis à la loi sur l’eau, dont les délais sont déjà trop longs.
Autre sujet de préoccupation, celui des fontaines. La taxe demandée aux communes est jugée « disproportionnée » par les maires puisque l’eau n’est pas prélevée, mais est simplement détournée.
Sur ce sujet, comme sur d’autres, il convient de rechercher des solutions au cas par cas, au plus près des territoires. Tenons compte de la spécificité des territoires et faisons confiance aux élus locaux !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le président de la délégation à la prospective, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’ensemble de vos travaux et recommandations formulées dans vos deux rapports consacrés à l’eau. Je vous remercie également de la clarté de votre présentation initiale.
Au travers de vos deux rapports, vous avez rappelé que la gestion de l’eau constituait un enjeu majeur. Le Gouvernement est pleinement mobilisé sur le sujet. Vous avez souligné que nous considérons souvent l’eau comme une évidence. L’eau est là, elle a toujours été là et l’on imagine par conséquent qu’elle sera toujours là. Il est donc important d’user de pédagogie vis-à-vis des usagers pour mieux leur faire comprendre que la ressource en eau doit être gérée et qu’il faut anticiper.
L’urgence est bien de construire des politiques de l’eau dont la priorité est l’adaptation au changement climatique.
C’est une priorité nationale et mondiale portée par notre gouvernement et par la ministre, Ségolène Royal, présidente de la COP 21, qui a introduit cette question dans les débats internationaux.
Le 2 décembre 2015, une journée entière a été consacrée à cette problématique, avec la signature du Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères par plus de cent cinquante organisations. La France a des atouts à faire valoir en ce domaine, une expérience solide, des savoir-faire, en particulier – j’y reviendrai, car le sujet a été beaucoup abordé – dans le domaine de la gouvernance et de la concertation avec tous les usagers. Jean-Yves Roux et Jean-Jacques Lozach l’ont rappelé, il est nécessaire de faire preuve de pédagogie pour éviter les conflits d’usage.
M. Tandonnet l’a souligné, les entreprises françaises sont performantes. Elles doivent pouvoir être confortées. Lors de son voyage en Iran en août dernier, Ségolène Royal a commencé à prendre des contacts afin de faire valoir nos expertises.
La COP22 sera l’occasion de rendre compte des premiers résultats produits par l’accord de Paris, de donner les solutions et de fixer un nouvel agenda pour l’action à poursuivre.
Je reprendrai quelques-uns de vos constats. Les travaux scientifiques soulignent plusieurs points s’agissant de la situation française.
Tout d’abord, ils établissent une tendance à la baisse du débit des cours d’eau ainsi qu’une forte diminution de la recharge des nappes. Une année sèche comme celle nous connaissons en 2016 pourrait devenir en 2070 une année normale. Toutes les régions structurellement déficitaires pourraient voir leur déficit s’aggraver. De nouveaux déséquilibres seraient susceptibles d’apparaître sur des bassins actuellement non touchés. Les besoins en eau d’irrigation pour l’agriculture augmenteraient de 40 % à 65 % et ne pourraient plus être totalement couverts sur la plupart des régions, à l’exclusion des bassins alpins de l’Isère et de la Durance, de la vallée du Rhône et des contreforts pyrénéens.
Que faisons-nous ? Nous établissons des schémas, car il est important de pouvoir organiser : il ne s’agit pas de déposséder qui que ce soit de ses prérogatives, comme le craint M. Pointereau, mais il est essentiel de développer une vision d’avenir et une stratégie. Cela passe par la mise en œuvre d’une politique la plus proactive possible dans les bassins hydrographiques. C’est la raison pour laquelle cette question a été reprise dans tous les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux adoptés à la fin de 2015 dans chaque bassin.
De plus, à la demande de Ségolène Royal, l’ensemble des comités de bassin élaborent un plan d’adaptation au changement climatique, à l’instar de celui du bassin Rhône-Méditerranée adopté en 2015. Il ne s’agit pas uniquement de plans techniques : ils ont vocation à permettre de prévoir l’avenir.
Ces plans de bassins traitent à la fois de la gestion de la rareté de l’eau et de la prévention des inondations.
Vos rapports font un certain nombre de propositions, notamment en termes de gouvernance et de pilotage territorial de l’adaptation, en concertation avec toutes les parties prenantes.
Ils soulignent, à raison, que la boîte à outils pour l’adaptation aux effets du changement climatique doit se construire maintenant.
Les choses ont commencé à se mettre en place. Vous ne pourrez que constater l’honnêteté intellectuelle dont j’ai fait preuve.
Depuis le début des années 2000, le ministère de l’environnement a mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la résilience des territoires et des activités sur des sujets tels que la gouvernance, l’observation, la connaissance, la prévision ou l’accompagnement des acteurs.
En matière d’efficacité de la gouvernance de la politique de l’eau, outre les structures classiques – comité de bassin, commission locale de l’eau –, la priorité aujourd’hui est d’encourager et d’accompagner la mise en œuvre d’organismes uniques de gestion collective qui sont destinés à répartir une ressource en eau limitée.
MM. Poher et Gremillet, ainsi que Mme Billon, ont soulevé la question de la gouvernance. Je propose que nous sortions du débat relativement récurrent qui consisterait à opposer les agglomérations, les intercommunalités et les communes. C’est l’élue locale que je suis encore qui vous le dit !
Nous avons aujourd'hui à gagner en efficacité dans nos politiques publiques. C’est pourquoi, parfois, pour permettre une vision plus globale et une mise en œuvre opérationnelle, il est intéressant de confier des compétences aux EPCI tout en ne dépossédant pas les communes. La loi NOTRe a réformé les compétences des collectivités, a confié la gestion de l’eau et de l’assainissement aux EPCI afin de limiter le morcellement de cette compétence et faire émerger des services d’eau plus robustes techniquement et financièrement.
L’enjeu est la gestion durable du patrimoine. Nous savons bien parfois que, à l’échelle des communes les plus petites, il est difficile de mettre en place une ingénierie technique et financière. Je suis convaincue que cela contribuera à la mise en œuvre opérationnelle d’actions visant à prévenir les fuites d’eau dans les réseaux et à lutter contre elles.
Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a introduit une nouvelle compétence, dont vous nous avez tous beaucoup parlé, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ou GEMAPI.
Le Gouvernement ne méconnaît pas les inquiétudes et les questions que la mise en place de cette nouvelle compétence peut susciter. Il a entendu la demande d’obtenir du temps et de différer la mise en œuvre de cette compétence. Il s’agit, malgré tout, d’une des plus grandes réformes depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, touchant à la fois au domaine de l’eau et intégrant les risques naturels d’inondation. Ces dispositions permettront d’améliorer la cohérence territoriale en tenant compte de l’amont et de l’aval, tout en renforçant les solidarités entre les territoires.
Vous avez souligné un certain nombre de freins en matière d’adaptation. Vous avez été une majorité à aborder les questions du prélèvement de l’État sur le fonds de roulement des agences de l’eau. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un prélèvement sur les années 2014 à 2017, répondant à la nécessité de contribuer à l’effort de redressement des comptes publics. Tous les opérateurs ont été concernés. C’est un effort réel de solidarité qui a été demandé. La période 2014-2017 passée, il n’y aura nulle raison de prolonger le dispositif plus avant.
Vous avez désigné comme frein la difficulté d’articuler les échelles de décisions locales et nationales : l’adaptation d’une économie locale s’insère souvent dans un système de filières et d’interactions dépassant le niveau du territoire concerné.
Vous avez également relevé la difficulté d’adaptation avec de nombreux acteurs qui n’ont pas tous les mêmes calendriers.
Par ailleurs, il faut distinguer ce qui relève du changement climatique de ce qui relève de l’activité humaine. Cela ajoute un niveau de complexité au diagnostic et donc aux solutions à apporter.
Enfin, toute adaptation a un coût : il faut en préparer le financement.
C’est le nerf de la guerre, monsieur le sénateur !
Face à ces difficultés, le Gouvernement développe des politiques et des financements ambitieux.
Jamais ! C’est la solidarité nationale qui parle !
En matière de gestion quantitative de l’eau, les agences de l’eau mettent en place des plans d’action pour acquérir des connaissances plus approfondies des réseaux, réduire les fuites et renouveler les conduites.
Ce sont entre 100 millions et 200 millions d’euros qui ont été ou qui vont être consacrés à cette problématique pour la période 2015-2017.
En matière de gestion qualitative, la France a l’obligation de répondre aux objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau.
Notre pays n’a pas atteint ses objectifs en 2015 du bon état écologique, principalement en raison de l’insuffisance des résultats au titre de la continuité écologique des cours d’eau et de la dégradation des masses d’eau dues aux pollutions diffuses d’origine agricole. J’ai entendu l’attachement que vous avez manifesté à l’égard du patrimoine et de l’histoire. Je rappelle que, en ce qui concerne la restauration de la continuité écologique, l’État apportera bien une réponse au cas par cas, se fondant sur une analyse. Il n’y a donc pas de priorité à l’effacement. Ségolène Royal l’a souligné clairement : il importe de développer une vision globale et d’étudier chaque situation dans son cadre local, en lien avec les élus locaux.
Ces priorités de gestion qualitative ont été remises au cœur des programmes d’intervention des agences de l’eau, révisés en 2015.
Enfin, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est venue renforcer cette politique afin d’améliorer la gestion des cours d’eau en définissant pour la première fois – c’est un aspect important – les cours d’eau et en élargissant le champ d’intervention des agences de l’eau.
J’ai entendu vos réserves sur le principe selon lequel « l’eau paie l’eau ».
Nous avons tout intérêt à ce que les agences de l’eau puissent se pencher sur l’ensemble de la biodiversité. C’est une opportunité pour la politique en faveur de la biodiversité que de lui faire bénéficier du savoir-faire des agences de l’eau !
L’eau, la nature et la mer paieront l’eau, la nature et la mer ! Il s’agit d’un élargissement de champ, mais qui permet de prendre le problème dans toute sa globalité à travers un élargissement des compétences et des types de financement.
Les moyens sont là, monsieur le sénateur !
Les agences de l’eau deviennent sur le terrain l’interlocuteur de toutes les parties prenantes, dont les collectivités locales, pour le financement de l’ensemble des volets relatifs à l’eau et à la préservation des ressources naturelles.
Enfin, en matière d’autorisation unique pour les projets soumis à la loi sur l’eau, les procédures ont été simplifiées.
Tout à fait !
Le Gouvernement a lancé en 2015 une cartographie des cours d’eau pour distinguer cours d’eau et fossés. Les exigences environnementales qui s’y appliquent sont en effet différentes. Le Gouvernement a défini, en concertation avec les acteurs de l’eau et du monde agricole, des guides d’entretien des cours d’eau.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Enfin, nous avons voulu alléger les procédures de mise en œuvre des organismes uniques de gestion collective, comme les obligations en matière d’études préalables – ce point a été évoqué dans vos interventions – pour l’obtention de l’autorisation unique de prélèvement.
D’ailleurs, la plupart des autorisations ont été délivrées cet été, à la suite de l’instruction donnée par Ségolène Royal aux préfets de ne pas refuser les dossiers incomplets, ce qui prouve que le Gouvernement est parfaitement à l’écoute des élus locaux.
Je rappelle que les agences de l’eau cofinancent un certain nombre de projets au profit des collectivités, avec un budget de 2, 5 milliards d’euros.
Pour essayer de répondre à toutes les questions, je reprendrai rapidement deux points.
Je rappelle à Mme Didier que, en matière de pesticide, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit l’interdiction des néonicotinoïdes à partir de 2018. Le Gouvernement a également élargi l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses.
J’ai entendu les inquiétudes exprimées par Rémy Pointereau au sujet des agents de l’ONEMA et de leur façon d’intervenir. Nous sommes tous attachés au respect de la loi, que le Parlement fixe, et des règlements, que les Gouvernements successifs mettent en place, et convaincus de la nécessité d’une régulation : il serait compliqué de laisser la nature seule s’exercer.
Les agents de l’ONEMA ont comme mission principale de favoriser les conditions de dialogue et de pédagogie, ce qui répond à votre inquiétude.
Les armes sont indissociables des missions de police administrative. Les modèles choisis sont toutefois peu ostentatoires. Je ne doute pas que chacun aura à cœur que leurs travaux s’effectuent dans de bonnes conditions.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes face à un moment important de prise de conscience, ce que rappellent les deux rapports que vous avez présentés avec une grande énergie. Il s’agit d’un moment important pour notre société ; il est essentiel que les usagers de notre pays se saisissent également de cette question.
J’espère que ce débat y aura contribué. Les avis se sont largement exprimés et ont éclairé l’ensemble de ces thématiques. Je tenais à vous en remercier, car nous avons encore devant nous des solutions innovantes à soutenir, qui contribueront également à la performance économique de notre pays.
Plus que tout, nous aurons à nous adapter aux changements climatiques et au développement de nos territoires.
Soyez assurés de la mobilisation du Gouvernement – j’ai compris que nul n’en doutait ici
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
– et de sa volonté de produire des résultats rapides et concrets, tout en s’appuyant sur l’intelligence des territoires. C’est le sens des réformes que nous avons adoptées : prendre le bon échelon pour résoudre les problèmes tels qu’ils sont, et pas tels qu’on les imaginerait, c'est-à-dire s’appuyer sur les communes et les élus locaux pour mettre en œuvre des politiques d’agglomération ambitieuses qui permettront de régler réellement les problèmes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Nous en avons terminé avec le débat sur le rapport d’information Eau : urgence déclarée et sur les conclusions du rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Philippe Bas, Christophe-André Frassa, Mmes Jacky Deromedi, Anne-Catherine Loisier, MM. Didier Marie, Jérôme Durain, Mme Cécile Cukierman ;
Suppléants : MM. Jacques Bigot, Henri Cabanel, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mmes Marie Mercier, Catherine Troendlé et M. Alain Vasselle.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 20 octobre 2016, à quatorze heures trente : débat sur les conclusions du rapport d'information de la commission des affaires économiques sur la situation de la filière équine (n° 692, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 20 octobre 2016, à zéro heure dix.