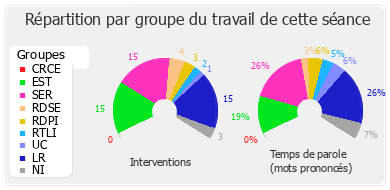Séance en hémicycle du 2 mai 2019 à 21h45
La séance
La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, présentée par M. Jérôme Durain, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Marc Daunis, Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain (proposition n° 384, rapport n° 446).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jérôme Durain, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, le 21 avril dernier, des hommages ont résonné tout autour du globe pour pleurer le décès de Polly Higgins. Cette avocate écossaise s’était fait connaître pour son combat acharné en faveur de la reconnaissance de l’écocide. L’écocide, à savoir la destruction d’un écosystème, est un concept discuté depuis plusieurs dizaines d’années dans le champ juridique international.
Quelques pays l’ont intégré dans leur législation nationale, à l’image du Vietnam, particulièrement marqué par la catastrophe de l’agent orange.
De Paris à Nairobi, de New York à Sydney en passant par Bangkok, les citoyens du monde entier, en grande majorité des jeunes, se mobilisent pour exiger des gouvernements qu’ils agissent enfin, ou plutôt qu’ils accélèrent leurs efforts, contre le dérèglement climatique.
Tandis que les rapports alarmants s’accumulent – un jour sur le climat, l’autre sur l’extinction des espèces –, c’est bien la jeunesse qui se montre la plus responsable en tirant le signal d’alerte. À nous, responsables politiques, d’entendre ce cri d’urgence. À nous d’apporter des réponses concrètes, en nous montrant à la hauteur des attentes des citoyens et des enjeux du XXIe siècle. Toutes les solutions ne se situent pas dans le champ législatif, mais c’est bien en votant des lois aux philosophies nouvelles que nous pourrons accompagner la société civile dans ce combat qui nous occupera pour les décennies à venir, à savoir la sauvegarde de la planète.
Trop longtemps, nous nous sommes reposés sur l’idée selon laquelle les êtres humains étaient assez intelligents et assez raisonnables pour maîtriser eux-mêmes leurs dérives et préserver la planète. Une telle logique témoigne d’un orgueil démesuré. Elle nous a condamnés à l’inaction en matière environnementale.
La proposition de loi du groupe socialiste et républicain entend précisément rompre ce cercle vicieux. Elle vise à poursuivre et à punir les crimes les plus graves, qui portent atteinte de manière irréversible à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty, en inscrivant dans le droit pénal la reconnaissance du crime d’écocide.
La notion d’écocide marque l’interdépendance entre les écosystèmes et les conditions d’existence de l’humanité. Le terme d’écocide s’inscrit dans le prolongement direct de la Charte de l’environnement, qui proclame dans son préambule que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».
L’article 1er du texte définit l’écocide comme « le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population ».
Les exemples ne manquent pas pour illustrer les conséquences extraordinairement néfastes que peut avoir l’activité humaine sur la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune et de la flore.
La criminalité environnementale est en croissance. Quoi de plus normal ? Un kilo de corne de rhinocéros peut valoir plus cher qu’un kilo de cocaïne, et fait courir moins de risques aux personnes impliquées. En ce sens, il me paraît bienvenu de redéfinir l’échelle des valeurs protégées. À quelles valeurs la société attache-t-elle une importance toute particulière ? Placer l’atteinte irréversible à l’environnement parmi les crimes les plus graves aurait valeur d’exemple.
Avec cette proposition de loi, le groupe socialiste souhaite poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement permettant de lutter rigoureusement contre la criminalité environnementale et de punir sévèrement les auteurs de ces actes.
Le Sénat a su, par le passé, être précurseur sur les questions environnementales, notamment en faisant adopter la notion de « préjudice écologique » grâce à une proposition de loi déposée par notre collègue Bruno Retailleau. Il s’agit maintenant d’aller plus loin dans le combat pour la préservation de la planète. Avec l’examen de cette proposition de loi, je vous invite, mes chers collègues, à dépasser les logiques partisanes et à faire preuve de responsabilité collective. N’attendons pas qu’une nouvelle catastrophe écologique survienne pour légiférer !
Cette proposition de loi ne revendique aucune perfection législative. Rares sont d’ailleurs les initiatives parlementaires à pouvoir s’en prévaloir !
Certains, comme Mme la rapporteure, ont reproché à ce texte un manque de précision. D’autres observateurs, que vous avez reçus, madame la rapporteure, jugent au contraire qu’il corsèterait trop le champ d’application de l’écocide et ne serait pas applicable. J’aurais beau jeu de renvoyer ces deux avis divergents dans leurs cordes pour prétendre à une forme d’équilibre législatif…
Mais les sénateurs socialistes connaissent la nécessité d’aboutir à des lois largement acceptées pour être efficaces. Aussi, je répondrai aux critiques par une main tendue, tant vers la droite de l’hémicycle que vers Mme la secrétaire d’État.
Madame la rapporteure, chers collègues de la majorité sénatoriale, le préjudice écologique cher à M. Retailleau avait exigé plusieurs années de discussion et de navette parlementaire pour aboutir. Certains parmi vous ont pointé les progrès que notre législation peut encore accomplir en matière de protection de l’environnement. Dans notre département, madame Mercier, la population avait été choquée par les faibles peines auxquelles avaient été condamnés les responsables de la pollution de la décharge de Montchanin, dont les origines remontent à 1979. La semaine dernière, le pays entier s’est ému de voir Vinci polluer de manière très significative la Seine dans le cadre d’un chantier du Grand Paris. Que risque Vinci ? 75 000 euros d’amende ! Voilà pourquoi nous devons revoir, dans notre pays, l’échelle des peines pour ce qui concerne la criminalité environnementale.
Dans mon esprit, la pollution provoquée par Vinci est grave. Elle ne constitue pas pour autant un écocide, qui a vocation à incarner le pire du pire en matière de criminalité environnementale. J’espère d’ailleurs que la qualification d’écocide sera utilisée le moins souvent possible. Le but, c’est que les peines encourues soient dissuasives.
Plusieurs conceptions de l’écocide s’affrontent. Nous avons échangé avec Mme Esther Benbassa, Mme Sophie Taillé-Polian a signé ce texte, et des collègues de plusieurs groupes ont déposé des amendements. Plusieurs partis défendent, chacun avec sa sensibilité, le concept d’écocide au niveau européen dans le cadre des prochaines élections des eurodéputés.
Nous avons aussi entendu les remarques de Mme Valérie Cabanes, juriste reconnue en la matière, qui souhaiterait objectiver l’atteinte irréversible à l’environnement en s’appuyant sur le concept de limites planétaires. Mme Cabanes, dont l’engagement et la technicité juridique au service de la reconnaissance du crime d’écocide sont indéniables, s’est exprimée à l’ONU le 22 avril dernier à l’occasion de la journée de la Terre.
D’autres considèrent au contraire que le droit français existant est suffisant. C’est sans doute la vision défendue par le Gouvernement et l’administration, mais des intervenants reconnus pour leurs compétences en droit de l’environnement nous ont fait part de leur scepticisme quant à cet état de fait. Même après l’adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, des progrès sont attendus.
Notre groupe a d’ailleurs, en la matière, d’autres propositions à avancer ; en témoignera notamment une proposition de loi que Mme Bonnefoy déposera prochainement.
Mes chers collègues, les lacunes de notre arsenal juridique encouragent le jeu mortifère de la destruction de l’environnement. Nous nous abstenons de combler ce vide, alors même que nous avons pleinement connaissance des agissements de criminels ou d’entreprises malveillantes.
En prenant l’initiative, nous pouvons ouvrir la voie à d’autres pays et à la conclusion de traités internationaux. Rappelez-vous, mes chers collègues, ce qui nous était expliqué, il y a deux ans à peine, à propos de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères : on nous avait dit qu’elle placerait l’entreprise France en faillite et qu’elle obérerait les intérêts économiques de nos champions nationaux. Elle est aujourd’hui prise en exemple en Suisse, en Allemagne et au niveau européen. Surtout, elle contribue, à son niveau, à améliorer les conditions de travail dans les usines textiles du Bangladesh.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement nous répondra probablement – je le comprends, même si j’espère encore me tromper – qu’il n’est pas prêt aujourd’hui à faire entrer l’écocide dans le droit pénal national. Je ne partage pas cet avis, …

… mais je le respecte.
Pour autant, madame la secrétaire d’État, seriez-vous prête à vous engager personnellement pour rejoindre, à nos côtés, la mobilisation générale en faveur de la reconnaissance du crime d’écocide lancée par des juristes, des ONG, des parlementaires, des citoyens ? Nous attendons de vous que vous appuyiez, à votre niveau, cette mobilisation. Nous vous en remercions par avance.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après avoir organisé, en 2015, la COP21, qui a abouti à la conclusion des accords de Paris, notre pays accueille cette semaine, au siège de l’Unesco, des scientifiques et des diplomates issus de plus de cent trente pays chargés d’évaluer l’état de la biodiversité.
Qu’il s’agisse du climat ou de la préservation de nos écosystèmes, le même constat alarmant peut être formulé : les activités humaines entraînent une telle dégradation de notre environnement naturel que c’est non seulement notre bien-être à moyen et à long terme qui est menacé, mais notre survie même.
À ces enjeux globaux s’ajoutent des pollutions plus localisées : nous nous souvenons tous de la marée noire de l’Erika, en 1999, qui avait souillé les côtes bretonnes ; nous connaissons le problème du déversement de boues rouges en Méditerranée ; nous avons entendu parler, tout récemment, de rejets de béton dans la Seine par un grand groupe de bâtiment et travaux publics.
Face à ces multiples atteintes à l’environnement, la France s’est progressivement dotée d’un arsenal législatif étoffé : dès les années 1970, nous avons adopté des dispositions relatives aux installations classées et avons introduit dans notre législation le principe « éviter-réduire-compenser », dit ERC, qui implique d’éviter, dans toute la mesure du possible, les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée, afin de compenser les atteintes qui n’ont pu être empêchées.
Plus près de nous, en 2016, la réparation des atteintes à l’environnement a franchi une étape importante, comme l’a rappelé M. Jérôme Durain, avec l’inscription de la notion de préjudice écologique dans le code de l’environnement, sous l’impulsion de Bruno Retailleau. Nous travaillons bien sûr dans le cadre défini par la Charte de l’environnement, qui affirme, dans son article 1er, le droit pour chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé.
Nos collègues du groupe socialiste et républicain proposent aujourd’hui d’aller plus loin en inscrivant dans notre code pénal un nouveau crime d’écocide, dont la définition s’inspirerait de celle du génocide.
Selon les termes de la proposition de loi, le crime d’écocide serait constitué en cas d’action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème et ayant pour effet de porter atteinte, de façon grave et durable, à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.
Ce crime serait puni d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 7, 5 millions d’euros, éventuellement assorties de peines complémentaires. Le montant de l’amende serait multiplié par cinq lorsque l’infraction est commise par une personne morale.
Le texte prévoit également de sanctionner la provocation à l’écocide – il s’agit de punir les instigateurs, et pas seulement les exécutants – ainsi que le fait pour un groupe d’individus de préparer un écocide.
En outre, par analogie avec le génocide, le crime d’écocide serait déclaré imprescriptible.
La commission des lois comprend les intentions des auteurs de la proposition de loi et elle partage leur volonté de sanctionner fermement les atteintes à l’environnement.
S’agissant d’un texte de droit pénal, nous devons néanmoins être attentifs au respect de certaines conditions tenant à la précision et à la clarté de la loi pénale, qui sont des exigences de nature constitutionnelle.
Or les travaux que j’ai menés au nom de la commission ont montré que la rédaction de ce texte souffrait de trop d’imprécisions pour que l’on puisse déterminer en toute rigueur à quelles situations il trouverait à s’appliquer.
D’une manière générale, le texte n’opère pas de distinction entre activités légales et illégales : il donne l’impression qu’une entreprise dont l’activité dégraderait l’environnement pourrait être poursuivie quand bien même elle se conformerait scrupuleusement à toutes les prescriptions réglementaires en vigueur.
Tel qu’il est rédigé, le texte n’indique pas clairement si la dégradation de l’environnement doit être le but recherché par les auteurs de l’infraction ou s’il peut s’agir d’une conséquence de leur activité, ce qui couvrirait un champ beaucoup plus large.
La proposition de loi fait en outre référence à des notions qui paraissent bien floues : comment apprécier les limites d’un écosystème ? Qu’entend-on par « atteinte grave et durable à l’environnement » ? Que vise la référence aux conditions d’existence d’une population et comment déterminer les contours de cette population ?
Outre cette critique interne, il convient de s’interroger sur l’apport de ce texte au regard des dispositions de droit pénal de l’environnement déjà en vigueur.
Il ne nous semble pas qu’il existe aujourd’hui de lacune dans notre droit positif qui rende indispensable la création de ce crime d’écocide : nos services de contrôle et nos tribunaux disposent de tous les outils juridiques pour sanctionner les atteintes à l’environnement commises sur notre territoire.
Le code de l’environnement comporte déjà de nombreuses incriminations pénales qui permettent de sanctionner, par exemple, les rejets polluants en mer, les atteintes au patrimoine naturel ou à la conservation des espèces, la pollution des eaux, le rejet dans l’atmosphère de substances polluantes ou la mauvaise gestion des déchets.
Par ailleurs, des incriminations pénales plus générales peuvent être utilisées pour réprimer les atteintes à l’environnement lorsque des individus en sont victimes, par exemple le délit d’atteinte involontaire ayant entraîné la mort ou celui de mise en danger de la vie d’autrui.
Je souligne également que les pouvoirs publics ont à leur disposition une palette de sanctions administratives qu’ils peuvent utiliser pour mettre un terme à des infractions environnementales : un exploitant peut être mis en demeure de se conformer à ses obligations, sous peine de sanctions financières, sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge pénal.
Dans ce contexte, notre commission est arrivée à la conclusion que l’introduction dans notre droit d’une nouvelle incrimination de portée générale, aux contours assez flous, ne s’imposait nullement. Il nous paraît préférable de mobiliser d’autres outils pour renforcer la protection de l’environnement, à l’échelle internationale et dans le cadre national.
À l’échelle internationale, la France pourrait par exemple œuvrer en faveur de la conclusion d’un traité définissant un socle de sanctions, lesquelles seraient ensuite déclinées dans le droit interne de chaque État partie, afin d’encourager ceux dont la législation environnementale est la moins développée à se rapprocher des meilleurs standards. Une telle approche serait cohérente avec les réflexions développées au sujet de l’écocide par certains universitaires, qui appellent de leurs vœux une évolution du droit international.
Dans notre pays, nous pouvons certainement renforcer les moyens de contrôle afin que nos règles environnementales soient mieux respectées. Sur ce point, le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, adopté par le Sénat le 11 avril dernier, contient des mesures techniques intéressantes, avec notamment le rapprochement de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l’environnement.
Je signale également qu’une mission conjointe du ministère de la justice et du ministère de la transition écologique a été lancée en 2018 pour améliorer l’application du droit de l’environnement, notamment en renforçant la formation des magistrats et en mettant à l’étude une meilleure spécialisation des juridictions dans la protection de l’environnement et de la biodiversité. C’est aussi grâce à des mesures pragmatiques de ce type que l’on peut faire avancer les choses.
Il nous appartient de mobiliser une palette d’outils pour avancer ensemble sur le chemin de la transition écologique : fixer des normes plus exigeantes en matière de protection de l’environnement, utiliser le levier fiscal pour orienter les comportements, financer des programmes de recherche pour développer des technologies vertes, etc.
Voilà quelques pistes qui montrent que l’on peut être réservé concernant la reconnaissance d’un crime d’écocide sans être partisan de l’immobilisme en matière environnementale.
Au total – vous l’avez compris, mes chers collègues –, la commission des lois vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi. Si nous sommes conscients de l’urgence qu’il y a à agir sur le terrain de la protection de l’environnement, nous ne sommes pas certains que la solution proposée par les auteurs de ce texte soit techniquement aboutie, ni même que l’aggravation de la répression pénale soit l’orientation à privilégier dans ce domaine.
Nous nous réjouissons néanmoins de l’opportunité que nous donne l’examen de ce texte de débattre dans l’hémicycle de cet enjeu crucial qu’est la protection de l’environnement. Je suis convaincue que de nos échanges émergeront des propositions qui viendront enrichir la réflexion du Gouvernement au moment où s’annonce une mobilisation nationale pour l’emploi et les transitions.
Pour finir, je ferai miens les mots de Marshall McLuhan, inventeur du concept de village planétaire : « Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre ; nous sommes tous des membres de l’équipage. »
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jérôme Durain, pour commencer, merci : merci pour cette proposition de loi qui nous donne l’occasion d’aborder un enjeu essentiel, qui me tient particulièrement à cœur, celui de la préservation de nos écosystèmes, du futur de notre planète, et donc de l’humanité.
Il est d’autant plus opportun que nous en débattions aujourd’hui que, comme le soulignait Mme la rapporteure, la réunion de l’IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, a lieu actuellement ici, à Paris, sur l’initiative du Gouvernement, à l’invitation de la France. Je me réjouis donc de pouvoir évoquer ce sujet en détail avec vous, ici, ce soir.
Monsieur le sénateur Durain, en inscrivant la question de la reconnaissance du crime d’écocide à l’ordre du jour de votre assemblée, j’imagine, ou plutôt je sais, que vous avez eu l’occasion de parcourir le travail de Polly Higgins, et je voudrais me joindre à l’hommage que vous lui avez rendu. Je tiens d’ailleurs à souligner ici à quel point elle fut une juriste vraiment remarquable. Elle a consacré la majeure partie de ses cinquante années d’existence à tenter de convaincre son pays et la communauté internationale de la nécessité d’inscrire le crime d’écocide dans notre droit international. Et le fait que nous en parlions ici ce soir montre combien ce genre d’idées, qui peuvent d’abord paraître surprenantes, finissent peu à peu par s’imposer comme nécessaires.
Dans l’une de ses prises de parole, Polly Higgins utilisait, pour rendre compte de son opinion sur le sujet, une image que je trouve intéressante : prenez une pièce ; côté pile, vous avez les droits de l’homme, et, côté face, les responsabilités de l’homme. Les uns ne peuvent aller sans les autres, et inversement. Or notre droit fondamental est le droit à la vie. Et celui-ci ne peut être garanti si la perte de cette même vie n’est pas elle-même criminalisée. Le droit à la vie va donc de pair avec le fait d’assumer la responsabilité de ne pas tuer.
C’est non seulement la question de la protection d’une vie qui se pose, mais celle de la protection de notre qualité de vie et de toutes les vies qui s’épanouissent sur Terre et doivent pouvoir continuer à le faire. Ainsi le droit de bénéficier d’un environnement sain va-t-il de pair avec la responsabilité de ne pas détruire ce même environnement, pour soi et pour les autres.
En prolongeant le raisonnement, la reconnaissance du crime d’écocide s’impose donc, pour Polly Higgins. Cette reconnaissance pénale acterait notre reconnaissance d’un droit à la vie qui serait un droit de la Terre, protégeant les écosystèmes qu’elle héberge et les services vitaux qu’elle nous rend ; elle signifierait aussi que nous assumons notre responsabilité dans sa dégradation.
En la matière, en effet, nous savons ; et les réunions de l’IPBES continuent de faire la lumière sur ce qui se passe actuellement.
Ce point, justement, me semble être le point crucial des échanges que nous aurons aujourd’hui : la reconnaissance de notre responsabilité à l’égard de la Terre.
Dans ces conditions, un pays peut-il assumer seul une responsabilité attachée aux droits et aux responsabilités de tant d’autres ? Je crois que non. Mais cela ne doit pas dédouaner la France de ses propres responsabilités. En la matière, nous disposons déjà d’un arsenal robuste. À l’échelle internationale, nous œuvrons en faveur d’un droit de l’environnement plus protecteur encore ; nous sommes en particulier extrêmement mobilisés – le Président de la République l’est lui-même – s’agissant du projet de pacte mondial pour l’environnement dont, j’en suis sûr, vous avez tous ici plus qu’entendu parler.
La lutte contre la criminalité environnementale est une préoccupation constante du Gouvernement. Vous le savez : nous nous appliquons à la renforcer.
Je vais vous donner un exemple, parmi beaucoup d’autres – madame la rapporteure, vous l’avez vous-même évoqué – : le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, qui est en cours d’examen, renforce considérablement les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement – c’est le but.
Je pense également à la mission confiée, le 16 janvier dernier, par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire et par la garde des sceaux au CGEDD, le Conseil général de l’environnement et du développement durable, et à l’IGJ, l’Inspection générale de la justice, pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement. Cette mission va notamment nous permettre d’évaluer l’intérêt d’une spécialisation des magistrats chargés de la répression des atteintes à l’environnement.
Il est vrai, en effet, que notre législation ne comporte pas, aujourd’hui, d’incrimination générique susceptible de s’appliquer à des atteintes à l’environnement d’une extrême gravité. Nous disposons néanmoins d’une palette efficace de sanctions et de dispositifs de contrôle, de nature administrative aussi bien que pénale, ainsi que d’incriminations spécifiques – je pense par exemple au terrorisme écologique, à la pollution maritime, aux atteintes à l’environnement commises en bande organisée.
Par ailleurs, comme vous le savez, dès lors que les atteintes à l’environnement ont des conséquences pour les populations, certaines incriminations de droit commun relevant du code pénal sont déjà applicables : homicide, blessures involontaires, mise en danger.
Aujourd’hui, au regard notamment des exemples qui figurent dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, il me semble que le caractère transnational des faits qualifiés d’écocide justifierait l’adoption d’un corpus juridique international préalablement à la création d’incriminations nationales. Tel est d’ailleurs l’un des objectifs du pacte mondial pour l’environnement que défend le Gouvernement au sein de l’ONU, en mobilisant des États du monde entier.
J’attire également votre attention sur le fait que, rédigée de la sorte, la proposition de loi ne tranche pas les questions de compétence susceptibles de se poser – je pense par exemple à son application dans l’espace.
La définition de l’incrimination qui y est proposée est par ailleurs plutôt imprécise, s’agissant de surcroît d’une qualification criminelle. Qu’entend-on par « destruction partielle » ? Quel périmètre donner à un écosystème ? Ces questions sont fondamentales ; nous devons continuer à y travailler collectivement. D’ailleurs, la tenue prochaine de la COP15, qui aura lieu en Chine, nous donne aussi l’occasion de continuer à travailler sur ces notions qu’il nous faut préciser et impérativement aborder à l’échelle internationale.
En outre, dans sa présente rédaction, le texte apparaît assez flou – je ne le dis pas de façon péjorative. Il pourrait, me semble-t-il, trouver à s’appliquer à des activités qui sont parfaitement légales, tant il manque parfois de précision : par exemple, de grands projets d’infrastructures susceptibles d’entraîner la dégradation d’un écosystème ou la modification des conditions d’existence d’une communauté sans que cette dégradation ou cette modification soient suffisamment définies et détaillées. Nous pourrions alors nous trouver dans une situation qui serait source d’insécurité juridique.
Cela dit – je tiens vraiment à y insister –, nous restons ouverts à la poursuite des réflexions sur ce thème, notamment dans le cadre de la mission conjointe du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la justice, qui vise à renforcer le dispositif pénal en matière de criminalité environnementale.
Qu’il s’agisse d’un renforcement des incriminations existantes ou d’une réflexion sur la notion d’écocide au niveau international, nous serons attentifs et actifs, car, comme je vous l’assurais en introduction, le Gouvernement a placé la préservation de notre biodiversité et de nos écosystèmes en haut de la liste de ses priorités. C’est là – je conclurai ainsi, comme j’ai commencé – une des raisons pour lesquelles nous tenions tant à accueillir l’IPBES en France, et l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si heureux de le faire.
Je vous remercie de votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, et me réjouis d’avance des débats à venir.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, comme vous, madame la secrétaire d’État, le groupe Union Centriste se réjouit de l’ouverture, ce soir, sur l’initiative de notre collègue Jérôme Durain, de ce débat sur les questions environnementales.
Comment resterait-on insensible lorsqu’une ONG comme le WWF annonce que, en cinquante ans, 60 % des vertébrés auraient disparu de la planète ? Nous sommes bien entendu tous attachés à ce que notre planète soit un lieu où l’on puisse bien vivre, préservé des risques environnementaux.
Cela dit, il nous incombe de regarder de près la proposition de loi qui nous est présentée par nos collègues du groupe socialiste. Celle-ci appelle un certain nombre d’observations. Si nous sommes tous d’accord pour agir, la question des modalités de cette action reste ouverte. Il faut s’assurer, en particulier, que les rédactions retenues soient telles que l’on puisse réellement s’appuyer sur elles pour conduire des actions, et que nos compatriotes – je veux dire l’ensemble de ceux qui entreprennent – ne soient pas laissés dans le doute ou mis en difficulté dès lors que leur bonne volonté ne serait pas mise en cause.
J’ai par exemple lu attentivement la définition du mot « écocide » donnée dans le Larousse : « destruction totale d’un milieu naturel ». Telle n’est pas tout à fait la rédaction retenue dans le présent texte. Il semble au groupe Union Centriste que cette rédaction contient un certain nombre d’imprécisions et pâtit d’un manque de clarté qui risquerait d’avoir des effets extrêmement néfastes.
C’est pourquoi nous devons être particulièrement mesurés. De ce point de vue, la proposition de notre rapporteur, qui suggère de laisser la réflexion se poursuivre sur ce sujet, nous semble empreinte de bon sens, car, si nous partageons tous l’objectif des auteurs de ce texte, il faut néanmoins que la terminologie employée soit la plus précise possible et prête le moins possible à contestation.
Prenons des exemples qui nous aideront à circonscrire de manière concrète les conséquences possibles de l’adoption d’un tel texte.
Imaginez ainsi, mes chers collègues, les conséquences, pour nos amis des montagnes, de la construction d’un barrage : celle-ci perturbe l’écosystème de manière extrêmement forte. Ceux qui sont pour les énergies renouvelables trouveront un tel projet tout à fait nécessaire et indispensable ; ceux qui sont attachés à la préservation du milieu naturel et à la biodiversité, et qui veillent à ce que rien ne se passe dans notre pays, argueront au contraire du fait que la construction du barrage, par les effets qu’elle risque d’avoir sur l’écosystème, est particulièrement préjudiciable à l’environnement, et pourrait donc, à ce titre, être reconnue comme un écocide, ce qui ne manque pas de nous interpeller.
Autre exemple : le propriétaire d’un boisement décide de l’abattre – dans un boisement, il y a bien sûr de la vie. Tous ceux qui sont attachés au bois vont manifester leur mécontentement ; ceux qui sont pour le renouvellement forestier ou qui plaident pour qu’une partie de ces terrains soient destinés à l’alimentation humaine trouveront au contraire positive la destruction du boisement. Dans quel sens, alors, faudra-t-il interpréter les textes ? On voit bien le problème.
Quant aux questions maritimes, en tant que Breton, élu du Finistère, j’y suis particulièrement sensible. Nous avons connu de nombreuses catastrophes maritimes : je pense au naufrage du Boehlen, en 1976 ; à celui de l’Amoco Cadiz, en 1978, au large de Ploudalmézeau, qui a beaucoup marqué les esprits, via notamment le combat de notre ancien collègue sénateur Alphonse Arzel pour obtenir juste réparation ; à celui de l’Erika, en 1999 ; à celui du Prestige, au large du cap Finisterre, en Espagne, en 2002. Vient de s’ajouter à cette liste, tout récemment, le Grande America. Tous ces navires opéraient dans des eaux internationales. Le problème n’est donc pas franco-français ; il est international.
Il nous semble donc, au sein du groupe Union Centriste, que l’approche qui doit prévaloir sur ces questions maritimes est une approche internationale ou, a minima, européenne. À ce titre, cher Jérôme Durain, la période est particulièrement favorable, puisque des élections auront lieu très prochainement pour élire nos collègues députés européens. Voilà donc un sujet dont ils pourraient utilement se saisir. J’ai en effet la conviction, comme tous les membres de mon groupe, que l’Europe peut être un très bon vecteur pour mettre en œuvre des mesures partagées par tous et véritablement protectrices pour tout le monde, évitant tout décalage entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs.
Certains souhaitent que nous soyons en avance sur tout ; je l’entends. Mais j’ai plutôt, quant à moi, la conviction – je la partage, encore une fois, avec les membres de mon groupe – qu’un arsenal juridique doit être mis en place au niveau européen. Un tel arsenal existe déjà, d’ailleurs, au niveau national : je rappelle que les crimes écologiques sont punis par l’article 421-6 du code pénal de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende ; peut-être estime-t-on que ce dernier chiffre est insuffisant ? Il faut, le cas échéant, l’augmenter, ce qui peut se faire très facilement.
Les élections européennes me semblent donc le meilleur moment pour avancer sur ce sujet, et je ne doute pas que la COP15 et les différents événements ou rassemblements intergouvernementaux que Mme la secrétaire d’État a évoqués et auxquels prendra part le Gouvernement seront aussi l’occasion d’élaborer une définition beaucoup plus précise de l’écocide et de trouver l’arsenal répressif adapté aux risques effectivement encourus et aux dégâts effectivement observés. Un tel arsenal devrait avoir une vertu préventive, c’est-à-dire empêcher les méfaits commis à l’encontre de notre milieu naturel, auquel nous sommes particulièrement attachés.
Les sénateurs du groupe Union Centriste, tout en appréciant l’ouverture d’un tel débat, trouvent le sujet encore insuffisamment mature et comptent sur la sagesse du Sénat pour travailler à cette maturation.
Applaudissements au banc des commissions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir tend à insérer dans le code pénal trois nouveaux articles afin de réprimer le crime d’écocide, la provocation au crime d’écocide ainsi que la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un écocide ou une provocation à un écocide.
Il s’agit ainsi, en particulier, d’introduire au sein du code pénal un nouvel article 230-1, qui définirait le crime d’écocide. La définition proposée s’inspire de celle qui figure à l’article 211-1 du code pénal relatif au génocide.
Le crime d’écocide serait constitué par « le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population ».
Ce crime serait puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7, 5 millions d’euros d’amende. Des peines complémentaires pourraient également être prononcées par la cour d’assises. Les mêmes peines seraient prévues pour les deux autres incriminations pénales, sauf dans l’hypothèse où la provocation à l’écocide n’aurait pas été suivie d’effet, le quantum de la peine se trouvant alors réduit.
Pourraient être poursuivies des personnes physiques ou des personnes morales, de grandes entreprises par exemple ; dans cette dernière hypothèse, une peine d’amende, éventuellement assortie de peines complémentaires, serait encourue.
Conformément aux articles 113-2 et suivants du code pénal, ces peines pourraient être prononcées en cas d’infraction commise sur le territoire de la République, mais aussi en cas d’infraction commise par des ressortissants français en dehors du territoire.
En outre, par analogie avec le génocide, le crime d’écocide serait imprescriptible.
On peut s’interroger sur la nécessité d’introduire dans notre législation une nouvelle incrimination, de portée générale, alors que la France dispose déjà d’un arsenal très complet. Les sanctions administratives et pénales existantes permettent aux pouvoirs publics de réprimer l’ensemble des atteintes à l’environnement qui méritent d’être condamnées.
Je partage les conclusions de la rapporteure, notre collègue Marie Mercier, car nous disposons déjà de tout l’arsenal juridique nécessaire pour sanctionner efficacement les atteintes à l’environnement.
Il pourrait effectivement être intéressant, comme l’ont dit Marie Mercier, Mme la secrétaire d’État et d’autres orateurs, de négocier une convention internationale définissant un socle de sanctions, lesquelles seraient ensuite déclinées dans le droit national de chaque État partie, afin d’encourager ceux dont la législation environnementale est peu développée à se rapprocher des meilleurs standards. La France pourrait à cet égard prendre des initiatives au niveau diplomatique.
La sensibilité environnementale est aujourd’hui très prégnante, par le biais de l’école notamment. De nombreuses actions sont menées et le fait de mettre en œuvre de hauts standards en matière d’écologie peut constituer un facteur d’attractivité pour nos régions.
Il y a quelques instants, M. Canevet a pris pour exemple la création d’un barrage hydroélectrique. Si ce texte était adopté, on pourrait effectivement considérer un tel chantier comme un écocide, au motif qu’il porte atteinte à la biodiversité. Mais il est toujours possible de prévoir des mesures compensatoires. De plus, ce barrage permettra d’obtenir un peu plus d’énergie durable : il faut bien examiner les bénéfices et les coûts, surtout quand ces derniers peuvent être compensés.
Je préside, modestement, la commission des routes dans mon département de l’Aveyron : nous aménageons encore de nouvelles routes et, quand nous sommes obligés d’abattre quinze arbres, nous en replantons quarante ou cinquante, en tout cas beaucoup plus que le nombre d’arbres abattus ! À mon sens, nous devons faire preuve de beaucoup de mesure en la matière. Un tel effort est contraignant, mais il va dans le sens de l’attractivité de nos territoires.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la réflexion relative à l’écocide s’est surtout développée dans une perspective internationale ; et l’on voit difficilement comment cette réflexion de portée internationale s’articule avec l’initiative purement nationale qui nous est soumise.
Nous, Français, donnons beaucoup de leçons en matière d’écologie, mais nous représentons 1 % de la population mondiale !
Bien sûr, il faut montrer l’exemple…

… mais, en même temps, soyons logiques et cohérents : travaillons à l’échelle internationale. C’est ainsi que nous pourrons prévenir les écocides.
Par ailleurs, l’introduction dans notre droit d’une nouvelle incrimination de portée générale, aux contours assez flous, ne semble pas s’imposer : notre arsenal législatif actuel permet de répondre à l’ensemble des situations visées.
Pour toutes ces raisons, et même s’ils comprennent les motifs invoqués, les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires ne voteront pas ce texte.
Applaudissements au banc des commissions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, ces dernières années, nous avons pu observer une véritable évolution dans la prise de conscience écologique, à l’échelon tant national qu’international.
En septembre dernier, ce sont des centaines de milliers de Français qui manifestaient pour lutter contre le changement climatique.
Le 8 octobre 2018, nous prenions connaissance du dernier rapport du GIEC, qui nous plaçait face à un diagnostic effrayant : notre planète connaît une hausse des températures de 1 degré depuis l’ère préindustrielle, et le réchauffement climatique progresse désormais de 0, 2 degré par décennie. À ce rythme, la hausse de 1, 5 degré pourrait être atteinte entre 2030 et 2052, avec des conséquences dramatiques pour les systèmes naturels et humains : dérèglements climatiques et multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes ; fonte des glaces et, en conséquence, montée du niveau de la mer ; raréfaction des denrées alimentaires et de l’eau potable ; risques pour la santé ; développement de la pauvreté ; disparition d’écosystèmes entiers.
D’une certaine manière, nous sommes, en outre-mer, à l’avant-garde : nous constatons ces phénomènes en premier.
Cette prise de conscience de l’urgence climatique et environnementale face à laquelle nous nous trouvons est également la conséquence directe des scandales environnementaux qui ont fait l’actualité planétaire.
Les auteurs de cette proposition de loi, auxquels je tiens à rendre hommage, nous révèlent que la criminalité environnementale a tellement augmenté qu’elle est désormais classée au quatrième rang mondial des commerces illicites, après les stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains.
Face à cette hausse des infractions d’atteinte à l’environnement, le présent texte propose la création d’une nouvelle incrimination pénale : le crime d’écocide. Constituerait un écocide « le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population ».
Imprescriptible, ce crime serait puni de vingt ans de réclusion et de 7, 5 millions d’euros d’amende.
La provocation au crime, ainsi que la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un écocide ou sa provocation, seraient punies des mêmes peines, sauf si la provocation n’était pas suivie d’effet. Dans ce dernier cas, le quantum de peine serait plus faible : sept ans de prison et 100 000 euros d’amende.
Mes chers collègues, j’éprouve moi aussi, sans doute comme chacune et chacun d’entre nous, la préoccupation exprimée par les auteurs de cette proposition de loi : lutter plus efficacement contre les atteintes à l’environnement. Mais la rédaction retenue me semble soulever des difficultés juridiques majeures et présenter un risque important d’ineffectivité.
Madame la rapporteure, madame la secrétaire d’État, vous l’avez justement souligné : les termes de cette proposition de loi manquent de précision. Or l’impératif de clarté de la loi pénale est une exigence de valeur constitutionnelle, particulièrement lorsque la peine encourue est si élevée.
D’après ce texte, le crime d’écocide serait constitué dès lors qu’une action concertée « tendrait » à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème. S’agit-il d’une action qui a pour objectif de détruire un écosystème ou, au contraire, d’une action dont la conséquence en serait la destruction ? À ce titre, le caractère intentionnel est déterminant.
De la même manière, la notion d’écosystème n’est pas suffisamment définie. Peut-être aurait-il fallu renvoyer à des notions existant dans le code de l’environnement.
Il est également fait référence aux conséquences de cette infraction, à savoir l’atteinte grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. Mais le caractère durable de cette atteinte s’entend-il par son irréversibilité ? De même, que vise-t-on par l’expression « conditions d’existence d’une population » ? S’agit-il de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité de personnes, ou bien d’un risque ? Enfin, combien de personnes doivent-elles être atteintes pour que l’infraction soit constituée ?
Vous le voyez, un grand nombre d’interrogations essentielles se posent.

Au-delà des difficultés résultant de ces imprécisions, on peut s’interroger sur l’effectivité de la nouvelle répression créée. Les exemples du navire Probo Koala et de la société Texaco, cités dans l’exposé des motifs à l’appui d’une pénalisation en France, renvoient à des faits commis à l’étranger. Or – vous le savez –, en matière criminelle, pour que notre pays puisse se saisir de telles infractions, il faut que l’auteur ou la victime soit un Français ou qu’une convention internationale existe.
Il arrive également qu’un dommage environnemental affecte plusieurs pays. Dans ce cas, quelle serait la juridiction compétente ?
Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable qu’une réglementation internationale voie le jour, d’autant que notre arsenal législatif, tant pénal et administratif que civil, permet déjà de répondre à l’ensemble des situations rencontrées.
S’il ressort des discussions que les poursuites en matière de crimes environnementaux sont rares et que les sanctions sont légères, nous pourrions, comme le propose Mme la rapporteure, encourager les juridictions pénales à se saisir de cet enjeu, pour réfléchir à alourdir certaines peines de façon à les rendre plus dissuasives. La dernière loi de réforme de la justice, défendue par Mme la garde des sceaux, ouvre justement la possibilité de spécialiser certains tribunaux sur des contentieux techniques.
Pour conclure, les élus du groupe La République En Marche approuvent évidemment les intentions sur lesquelles se fonde cette proposition de loi et la volonté de lutter efficacement contre la criminalité environnementale.
L’inscription de ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée a le mérite de prendre acte de la mobilisation de la société et de l’urgence à engager des discussions à l’échelle mondiale. Cher Jérôme Durain, je tiens à vous en remercier, ainsi que les membres du groupe auquel vous appartenez.
Pour ces raisons, tout en veillant à ce que notre pays engage une action dans le domaine diplomatique, nous nous abstiendrons sur ce texte.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, le 14 mars 2019, les associations Greenpeace, Notre Affaire à Tous, la fondation Hulot et Oxfam attaquaient l’État français en justice afin que celui-ci respecte ses engagements climatiques. Cette action devant les tribunaux, intitulée « l’affaire du siècle », avait été précédée d’une pétition lancée le 17 décembre 2018 et signée par plus de 2 millions de nos concitoyens et concitoyennes.
La demande des citoyens et citoyennes se fait forte, et à raison. Les trafics d’espèces protégées ont fait de l’aéroport de Roissy une plaque tournante de la criminalité environnementale. L’utilisation abusive de produits phytosanitaires en faveur d’une agriculture productiviste détruit nos sols et provoque des maladies graves en milieu rural. Les exemples d’actes venant défigurer nos paysages et heurter irrémédiablement nos faunes et nos flores sont innombrables, et, tous conjugués, ils pourraient à terme entraîner la destruction de l’humanité. Aussi est-il nécessaire et urgent de reconnaître le crime d’écocide.
Vous le savez, étymologiquement, « écocide » signifie « tuer la maison ». Se rendre coupable d’un écocrime revient à attaquer la planète, notre foyer à tous. Mon propre parti, Europe Écologie Les Verts, EELV, appelle depuis plusieurs années de ses vœux un tel ajout dans notre législation. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l’initiative de notre collègue Jérôme Durain et du groupe socialiste et républicain, qui vient combler les lacunes du droit pénal environnemental français. En effet, à l’heure actuelle, il n’existe tout simplement pas d’échelle des peines en la matière.
Certes, des contraventions sont prévues pour répondre aux incivilités que commettent certains particuliers, en jetant des détritus ou en braconnant, de même qu’il existe des sanctions administratives à l’encontre de certaines entreprises coupables de délits polluants. Toutefois, parmi elles, le nombre de sociétés mises en demeure reste résiduel. Pour l’heure, il n’existe pas de réponse pénale adaptée à la criminalité industrielle des grandes entreprises, qui bénéficient de l’adage too big to fail.
Pour les catastrophes se déroulant sur notre territoire, comme le naufrage du Grande America en mars dernier, ce texte peut être utile. Il serait même salutaire.
Néanmoins, même si cette proposition de loi était adoptée, que pourrions-nous faire à l’échelle nationale si un nouveau Fukushima se produisait ? Que pourrions-nous faire contre le braconnage de masse des rhinocéros en Afrique, tués pour leurs cornes ? Comment pourrait-on sanctionner Bolsonaro, qui prévoit de bétonner l’Amazonie, poumon vert de la Terre ? Rien de bien concret.
Pour sauver l’environnement, la réponse devrait être transnationale et supranationale. L’écocide mériterait d’être traité au sein d’une chambre spécifique de la Cour pénale internationale, la CPI, comme ce fut envisagé, malheureusement sans succès, lors de la rédaction du statut de Rome en 1998, et comme le préconise d’ailleurs la rapporteure de la CPI dans un document de politique générale datant de 2016.
Cependant, compte tenu des obstacles politiques et de la difficile procédure de révision du statut de Rome, il est essentiel que les États incorporent le crime d’écocide dans leur arsenal juridique interne, afin de frayer la voie à une reconnaissance supranationale de cette criminalité.
Le Vietnam, qui a depuis longtemps adopté une législation en matière d’écocrime, a ainsi pu interdire, le mercredi 10 avril dernier, l’importation du glyphosate sur son sol. À l’instar des « tribunaux verts » en Inde et de diverses institutions spécifiques qui existent en Nouvelle-Zélande et au Chili, la France aurait tout à gagner à se doter de juridictions et d’un parquet spécialisés dans la lutte contre la criminalité environnementale.
Selon le dernier rapport du GIEC, nous n’avons plus que douze ans pour inverser la tendance, avant que les dégâts infligés à notre planète ne soient irréversibles. Les multinationales continuent d’agir en toute impunité : depuis 1999, l’entreprise Monsanto est au fait du caractère dangereux du glyphosate, mais elle n’a pas pour autant freiné ses activités. Si nous ne responsabilisons pas ces géants économiques, les générations futures en paieront le prix.
Le groupe CRCE soutiendra donc évidemment ce texte. Nous espérons que la droite sénatoriale en fera de même. Le centriste Jean-Louis Borloo disait : « Les climato-cyniques ne me font pas rire. » S’il faut être responsable, c’est maintenant !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, « en devenant le premier parlement à déclarer l’urgence climatique, nous pouvons déclencher une vague d’actions venues des parlements et gouvernements du monde entier ».
J’aurais dû citer cette phrase en anglais, et pour cause, elle a été prononcée hier au parlement britannique, qui devient le premier au monde à voter l’objectif d’urgence écologique et climatique, sur proposition des travaillistes. Peut-être pourrons-nous, ce soir, en dire autant.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le présent texte, que le groupe socialiste et républicain est fier de vous présenter ce soir. Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je tiens à saluer notre collègue Jérôme Durain. Je le remercie de porter ce texte et de donner à notre chambre l’initiative de s’intéresser à ce sujet ô combien important, pour aujourd’hui comme pour demain.
Madame la secrétaire d’État, vous nous dites : « Pas ici, pas maintenant. » Mais le contexte actuel de prise de conscience collective face aux atteintes à l’environnement nous oblige à développer notre arsenal législatif, pour créer un véritable droit pénal environnemental. Vous l’avez d’ailleurs admis : pour l’heure, il n’existe pas de dispositif permettant de sanctionner à leur juste mesure les atteintes les plus graves à l’environnement.
Avec ce texte, vous pourrez apporter demain une bonne nouvelle à la réunion de l’IPBES, que vous avez citée trois fois dans votre intervention, d’autant que – vous en convenez – l’urgence climatique et environnementale est bien là.
Chers collègues, à la suite de Jérôme Durain, je répondrai à plusieurs interrogations et critiques.
Tout d’abord, selon l’objection formulée le plus fréquemment, nous proposerions un texte trop flou, potentiellement trop large, qui atteindrait éventuellement la liberté de nos entreprises.
Madame la rapporteure, madame la secrétaire d’État, chers collègues Michel Canevet et Thani Mohamed Soilihi, j’ai bien entendu vos propos : vous saluez notre initiative, vous partagez notre intention, vous dites qu’elle est importante, qu’elle appelle des observations, qu’elle mériterait des précisions. Mais alors, amendez ! Amendez, de grâce, et avançons !

Esther Benbassa l’a fait, tout comme Joël Labbé, et je les en remercie.
À mon sens, ces critiques sont une vue de l’esprit : notre texte vise spécifiquement les actes les plus graves, et les critères pour désigner un écocide y sont clairement délimités. Il s’agit d’une action concertée, qui tend à la destruction ou à la dégradation d’un écosystème et qui porte atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.
D’autres, au contraire, nous ont reproché de présenter un texte trop spécifique au vu de ces critères. Mais, comme l’a rappelé mon collègue Jérôme Durain, il s’agit de réunir au-delà des clivages politiques pour punir et dissuader les auteurs des atteintes les plus graves à l’environnement. Les entreprises ne sont d’ailleurs pas défavorables à une clarification de notre législation pour accroître la sécurité juridique et éviter des distorsions de concurrence.
Cher Michel Canevet, vous citez l’exemple des barrages. Bien sûr, la construction d’un barrage n’est pas un crime ; elle suit une procédure administrative rigoureuse, validée par l’intérêt général. Elle ne risque donc aucunement d’être considérée comme un écocide.
À ce titre, comme Mme la rapporteure l’a répété en commission, vous nous dites que l’arsenal législatif existant est suffisant. Certes, de nombreuses sanctions existent face à une multitude de possibilités d’atteintes à l’environnement et aux écosystèmes. Mais elles s’inscrivent dans une tradition de sanctions administratives, et ces dernières ne sont plus adaptées aux enjeux actuels ni à l’urgence qui se dessine de plus en plus clairement. Les mafias qui se constituent à l’échelle mondiale et qui font de la criminalité environnementale leur business constituent un phénomène nouveau, qui va de pair avec la mondialisation. Esther Benbassa l’a précisé, certains trafics ont pour plaque tournante la France, plus précisément l’aéroport de Roissy : nous sommes donc réellement concernés.
Or ces mafias ne sont pas du tout impressionnées par les peines existantes, tout comme certaines entreprises, qui, ne jurant que par la rentabilité, sont peu soucieuses de respecter la planète. Souvent, les peines en vigueur ne dépassent pas les 75 000 euros d’amende et les deux ans de prison : une bagatelle au vu des enjeux et des puissances financières dont il s’agit !
En outre, peu de moyens sont donnés aux juges pour mener les investigations nécessaires et faire respecter le droit environnemental. En définitive, l’on prononce souvent des peines alternatives. Quant au seuil permettant de pousser les investigations et de perquisitionner, il n’est valable que pour les faits punis d’au moins trois ans de prison.
Dans ces conditions, non seulement le présent texte aura un effet dissuasif, mais il pourra entraîner une véritable prise de conscience. Il nous permettra de mettre le pied à l’étrier pour une révision de la hiérarchie des sanctions et des peines face aux atteintes environnementales.
Notre droit – dois-je vous le rappeler ? – n’est devenu véritablement contraignant et efficace face aux marées noires que lorsque nous avons relevé le quantum des peines après le drame écologique de l’Erika en 1999. C’est alors que l’on a décidé d’imposer des doubles coques aux pétroliers.
Ne soyons pas, une fois encore, à la remorque des événements. Inscrivons-nous dans l’état d’urgence écologique que le Président de la République a décrété la semaine dernière, lors de sa conférence de presse. Madame la secrétaire d’État, avec ce texte, vous avez la possibilité de passer des discours aux actes et peut-être de prendre le contrepied des critiques récentes formulées, dans ce domaine, à l’encontre de votre gouvernement.
On nous dit également que ce ne serait ni le lieu ni le moment de mener ce travail, que la France ne doit pas être le gendarme du monde, que cette problématique ne peut être traitée qu’au niveau international. Mais, à propos des êtres humains, avons-nous besoin d’exemples franco-français pour que le génocide et le crime contre l’humanité soient lourdement punis dans notre droit pénal ?
En matière de protection de l’environnement et du climat, soyons courageux, comme la France a pu l’être en matière de consécration des droits de l’homme ! Soyons les Lumières de cette lutte contre la criminalité environnementale, ouvrons la voie à des changements aux niveaux européen et international.
Le Brésil avait une législation environnementale parmi les plus vertueuses au monde. Or le président Bolsonaro engage une politique de détricotage systématique de cet arsenal vert et prévoit de raser toute une partie du plus gros poumon de notre planète. Et je ne parle pas du président Trump, qui au nom des États-Unis, plus gros pollueur mondial, s’assoit sur les accords de Paris.
Cher Alain Marc, vous relevez que nous ne représentons que 1 % de la population mondiale. Un tel propos me désole… Ce n’est pas là l’image de la France rayonnante, que j’aime et que je défends, comme nombre de nos collègues.
Madame la secrétaire d’État, nous n’avons pas attendu l’existence d’un consensus européen pour être un des pays fers de lance sur d’autres sujets. Je pense notamment au début de taxation des GAFA, dont le Sénat débattra prochainement.
Plusieurs têtes de liste aux élections européennes, dont celle de la majorité gouvernementale, se prononcent en faveur de la taxation des transports aériens, dans la continuité de l’audacieuse législation suédoise, qui a évolué récemment. Or l’on nous disait que la convention de Chicago, signée en 1944, ne nous permettait pas de le faire ! Et, il y a à peine un mois, lors de l’examen du projet de loi relatif aux mobilités, la ministre des transports se prononçait contre cette mesure, lorsque certains d’entre nous l’évoquions.
Sous le dernier quinquennat, un pas en avant avait pourtant été fait au titre des responsabilités collectives en matière environnementale, avec la création du devoir de vigilance. Cette initiative a été lancée en 2017 par Dominique Potier, député de mon département, afin d’étendre la responsabilité des entreprises donneuses d’ordre. Aujourd’hui, elle est reprise par un grand nombre de pays.
Or, madame la secrétaire d’État, je vous rappelle votre pas en arrière au sujet du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytosanitaires. À deux reprises, et à l’unanimité, le Sénat a voté la création de ce fonds, proposée par notre collègue Nicole Bonnefoy. Mais, par deux fois, vous avez refusé de l’inscrire, tout d’abord dans le projet de loi Égalim, il y a exactement un an, puis dans le dernier projet de loi de finances. Nous attendons toujours la traduction législative de ce dispositif.
N’attendons pas une décision internationale : prenez-en l’initiative, avec nous. Songez aux deux côtés de la pièce, que vous avez cités : celui des droits et celui des devoirs. L’urgence climatique exige que nous prenions, ici et maintenant, toute notre responsabilité, à notre échelle, pour reconnaître le crime d’écocide.
Madame la rapporteure, à juste titre, vous avez cité McLuhan : « Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre ; nous sommes tous des membres de l’équipage. » Dès lors, avançons ensemble en ce sens : c’est tout notre honneur d’être un pays fer de lance dans la lutte contre les atteintes infligées à l’environnement. Reconnaître le crime d’écocide, c’est se battre contre un possible écosuicide.
Avec « l’affaire du siècle », alors que des jeunes se mobilisent et marchent partout dans le monde pour le climat, la question environnementale est au cœur des débats.

Le Parlement européen sera assurément conduit à légiférer sur cette question dans les prochaines années.

Notre initiative est à même de déclencher un électrochoc et de faire du crime d’écocide un vrai sujet.
Mes chers collègues, que voulons-nous pour notre avenir et celui de nos enfants ?

Nous ne pouvons nous permettre d’attendre. Ayons le courage de nous engager sur cette question qui dépasse les clivages politiques : c’est notre responsabilité collective. Jacques Chirac…

M. le président. Il faut vraiment conclure, cher collègue, même si vous citez Jacques Chirac !
Sourires.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le président, il s’agit d’une exception !
Nouveaux sourires.

M. Olivier Jacquin. Alors que nous entrons dans l’anthropocène et que la biodiversité subit de nouvelles extinctions massives, notre droit ne doit pas regarder ailleurs, et nous non plus !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à revenir, moi aussi, sur « l’état d’urgence écologique ».
Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué la septième session de l’IPBES, qui a présenté la synthèse mondiale sur l’état de la nature et des écosystèmes. À ce titre, je cite le président Robert Watson : « Les preuves sont incontestables. Notre destruction de la biodiversité et des services écosystémiques a atteint des niveaux qui menacent notre bien-être au moins autant que les changements climatiques induits par l’homme. »
Aussi, et avant tout, je remercie nos collègues socialistes d’avoir inscrit à l’ordre du jour cette proposition de loi, dont le sujet est extrêmement important.
Avec la généralisation de la conscience écologique au sein de la société française, de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour sanctionner plus sévèrement les écocides, atteintes graves à l’environnement. Ces aspirations rejoignent d’ailleurs d’autres attentes exprimées à l’échelle internationale. Il est donc primordial que la France fasse preuve d’initiative en la matière. Ainsi, nous pourrons coaliser les bonnes volontés qui naissent, ici et là, des constats de la mise en péril de l’humanité établis non seulement par de nombreux observateurs scientifiques, représentants de la société civile, mais aussi de nombreuses instances internationales.
Tel est précisément le but du texte que nous examinons ce soir et que, au sein du groupe du RDSE, nous sommes plusieurs à saluer.
Madame la rapporteure, selon vous, le fait de présenter la France comme le gendarme du monde en matière environnementale pourrait se retourner contre nous. À ce titre, vous avez dressé un parallèle avec l’interventionnisme militaire américain.
Mme l e rapporteur manifeste sa circonspection.

Il est des risques qu’il faut savoir prendre lorsque l’urgence à agir nous y pousse. La nécessité de protéger notre environnement s’instille durablement dans les consciences françaises, notamment celles des plus jeunes générations, depuis que les premières alertes ont été lancées.
L’adoption de la Charte de l’environnement de 2005 a été une avancée supralégislative majeure, qui attend des ramifications législatives concrètes, comme celles que propose le texte examiné aujourd’hui. La doctrine a montré comment, faute d’avancées législatives, nos magistrats ont, par exemple, fait évoluer progressivement la jurisprudence relative à la notion de préjudice pour permettre l’indemnisation des préjudices écologiques.
Nous avons entendu les critiques du texte de Jérôme Durain et de ses collègues, mais il nous paraît quelque peu contradictoire de faire le constat de l’urgence à agir, en citant les rapports du GIEC, qui sont terrifiants, et de considérer, dans le même temps, que les normes en vigueur sont suffisantes et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes par le simple renforcement de la formation de nos magistrats ou par l’effet de sanctions, dont on sait aujourd’hui qu’elles ne sont pas assez dissuasives.
Ce texte mérite que nous réfléchissions à des améliorations de rédaction plutôt que de le rejeter en bloc.
Sur le fond, nous souscrivons aux préconisations des directives européennes qui suggèrent que les sanctions pénales n’interviennent qu’en dernier recours, mais nous jouons déjà, depuis plusieurs décennies, le jeu du « droit mou », des dispositifs incitatifs, des sanctions administratives. Nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que l’état de dégradation de la planète est tel qu’il est aujourd’hui nécessaire de passer à la vitesse supérieure et de sanctionner pénalement toutes les atteintes à l’environnement, quelles qu’elles soient.

Il s’agit de repenser totalement l’agencement de notre droit pénal afin d’y intégrer l’environnement en tant que personne propre.
La reconnaissance de l’écocide revêt plusieurs dimensions juridiques, comme nos amendements tendent à le montrer : elle exige, d’une part, l’élargissement de la notion de génocide afin que des actes de guerre reposant sur des atteintes très graves à l’environnement, comme le recours à l’agent orange au Vietnam, puissent être reconnus comme tels et sanctionnés par la juridiction internationale compétente ; elle requiert, d’autre part, le renforcement des peines, mais également des moyens et des périmètres d’action de nos juges nationaux, en cas d’atteintes à l’environnement sur notre sol et au-delà, lorsque ces atteintes emportent des externalités négatives mondiales susceptibles de concerner la santé et la qualité de vie des Français.
Ce deuxième point pourrait être satisfait par la création d’une incrimination nouvelle, que nous proposons de modifier, ou par l’élargissement de dispositions pénales existantes, comme la mise en danger de la vie d’autrui. Il ouvre cependant d’autres débats, dont celui qui concerne les modalités de calcul des amendes par les magistrats afin d’éviter les condamnations symboliques et la censure de la Cour de cassation.
En conclusion, gardons à l’esprit que ce n’est pas l’écologie qui est punitive – j’en ai marre d’entendre cela ! –, mais c’est la société qui doit l’être, quand une majorité en son sein considère qu’un comportement porte atteinte au bien commun, à l’intérêt général, et à celui des générations futures.
Comme le grand débat l’a montré, les citoyennes et citoyens français attendent que nous leur apportions des clés pour agir, et l’action devant le juge pénal en est une.
Enfin, si l’action dans le droit pénal français nous paraît nécessaire, légitime et efficace, il faut également intervenir au niveau du droit pénal international, comme le propose la juriste en droit international, spécialiste des droits de l’homme, Valérie Cabanes : « Ne faudrait-il pas reconnaître un crime international qui puisse protéger l’habitabilité de la Terre de certaines activités industrielles nuisibles au climat, à la biodiversité, à la qualité des sols, à l’approvisionnement en eau potable, à l’océan, à la santé… ? »
À ceux qui considèrent, à juste titre, que la priorité actuelle est à la refondation du pacte social et politique de notre pays, je voudrais dire ma conviction qu’il faut faire de ce sujet un outil pour rebâtir le vivre-ensemble.
Quelle meilleure mise en œuvre du principe de fraternité que l’ambition de travailler à l’amélioration des conditions écologiques d’existence du plus grand nombre ?

M. Joël Labbé. Je vous le dis au nom des générations nouvelles qui ont besoin de renouer avec des projets collectifs : le plus beau projet que l’on ait à mener ensemble, c’est le sauvetage de la planète !
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, force est de constater que les efforts mondiaux pour enrayer le réchauffement climatique et protéger l’environnement ne sont pas suffisants, les collègues qui se sont exprimés avant moi l’ont tous évoqué. En ce sens, le texte proposé a le mérite de nous rappeler l’importance de ce sujet.
Cependant, la France n’est pas en reste dans les engagements écologiques que les États doivent prendre en urgence pour limiter les changements climatiques. Depuis 2005, la Charte de l’environnement est dans notre corpus constitutionnel et la France a joué un rôle primordial dans les négociations ayant mené à la conclusion des accords de Paris pour le climat en 2015.
Plus récemment, le Sénat a adopté, le 11 avril dernier, le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, qui renforce les pouvoirs de police et d’investigation des inspecteurs de l’environnement et des agents commissionnés.
La Cour pénale internationale ne reconnaît pas encore de crimes contre l’environnement en temps de paix, mais a encouragé les législateurs nationaux à se saisir de cette question.
Dans cette perspective, l’initiative engagée par le groupe sénatorial des socialistes est louable et je remercie notre collègue Jérôme Durain pour le travail accompli, mais les contours de cette proposition de loi ne sont pas bien définis et il n’y a qu’un pas à faire pour affirmer que sa finalité serait strictement symbolique. C’est sur ce point que s’appuient les critiques principales que l’on peut lui opposer.
Ce texte pose d’abord des problèmes terminologiques et de définition. Dans son article 1er, l’alinéa 6 propose une définition de l’écocide qui repose sur la réunion de deux éléments : la présence d’une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème et le fait que cette action devrait avoir pour effet de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.
Toutefois, quelle définition juridique correspond au terme d’« écosystème », à l’expression « atteinte à l’environnement », voire « conditions d’existence » ? Notre loi doit être précise et non équivoque, selon l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Or la notion d’écosystème est très large. Je cite sa définition courante : c’est un « ensemble formé par une communauté d’êtres vivants, animaux et végétaux, et par le milieu dans lequel ils vivent. »
Quelles sont donc les limites de l’incrimination, puisqu’il suffit d’une dégradation portant atteinte « de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population » pour être en infraction ? Quelles destructions sont acceptables, quelles sont celles qui seront qualifiées de « graves » ?
La question que je pose ici est de savoir sur quelle évaluation nous devrons nous appuyer pour déterminer une atteinte grave et durable à l’environnement. Quelle échelle de valeurs devrons-nous utiliser ? Il faudrait qu’un acte juridique le précise ou que des articles supplémentaires soient ajoutés à cette proposition de loi.
Je ne vais pas évoquer l’expression « conditions d’existence », qui ne fait également référence à aucune disposition juridique, laissant libre cours aux jugements de valeur et à l’interprétation multiforme du juge. Faisons en sorte qu’une incrimination pour destruction de l’environnement soit suffisamment précise et définie pour être efficace.
En tant que législateurs, nous devons nous assurer de l’expression claire et sans ambiguïté de la loi.
J’en viens donc à mon deuxième point. Cette proposition de loi n’apporte aucun outil juridique véritablement novateur pour la condamnation des infractions à l’environnement. Notre arsenal législatif s’est beaucoup renforcé ces dernières années et permet déjà de réprimer nombre de ces infractions.
La loi sur la biodiversité en vigueur depuis août 2016 a introduit dans le code de l’environnement une définition du préjudice écologique. Depuis cette nouvelle disposition, les atteintes à l’environnement peuvent désormais être indemnisées sur le plan civil.
Le code de l’environnement comporte également des incriminations pénales pour poursuivre et sanctionner des actions polluantes, comme le déversement de substances en mer, l’atteinte aux espèces, la mauvaise gestion des déchets ou le rejet dans l’atmosphère de substances polluantes.
De plus, des incriminations pénales plus larges, qui existent déjà, peuvent être utilisées pour réprimer les atteintes à l’environnement lorsque les individus en sont victimes.
J’ajoute que, dans cette proposition de loi, aucune distinction entre les activités légales et illégales n’est établie. Certaines activités détruisent l’environnement, mais restent dans le cadre réglementaire et légal. Pour illustrer mes propos, je ne citerai qu’un exemple : le projet de mine d’or industrielle en Guyane, soutenu par le Président de la République. L’étude d’impact de 2016, menée par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane, a révélé que l’exploitation de ce gisement provoquerait la destruction de sept hectares de forêt amazonienne et d’habitats naturels, ainsi qu’un fort risque de pollution des cours d’eau.
Il n’est, certes, pas acceptable qu’une impunité soit accordée à certaines entreprises. La destruction d’espèces végétales ou animales protégées est intolérable et, par-delà celles-ci, nous devons également être vigilants concernant la destruction d’espèces non protégées. Pourtant, comme je l’ai évoqué, cette proposition de loi ne permet pas de distinguer les activités légales des activités illégales. L’objectif de ceux qui les pratiquent est rarement la dégradation de l’environnement, mais celle-ci peut en être une conséquence. Doit-on sanctionner de la même manière ces deux cas de figure ? Cela ne me semble ni adapté ni opportun.
Une dizaine de pays ont adopté le crime d’écocide dans leur législation, comme le Vietnam et la Russie, cela s’explique par leur histoire. À ce jour, aucune condamnation notoire ne peut cependant être relevée. J’ajoute que, si mettre l’écocide sur le même plan que le crime contre l’humanité ou le génocide, le crime de guerre et le crime d’agression peut sembler pertinent, le texte tel qu’il nous est aujourd’hui proposé semble, pour le moins, exagéré.
Un contour mal défini pour l’écocide ne permet pas d’engager des solutions efficaces. Placer sans réserve sur le même plan une destruction des espèces et une destruction méthodique de groupes humains reste contestable.
Nous n’avons pas besoin d’un texte symbolique dont la mise en œuvre est impossible. L’enjeu est avant tout international, trop de conditions sont nécessaires et les failles sont nombreuses qui permettent d’échapper à une incrimination efficace.
Cette proposition de loi vise surtout à condamner les actions les plus graves, portant atteinte de manière irréversible à l’environnement. Je fais bien sûr référence au braconnage transnational, …

… au trafic d’espèces, au trafic de déchets polluants. Les exemples évoqués par Jérôme Durain dans son exposé des motifs sont localisés à l’étranger, en Côte-d’Ivoire et en Équateur, et la législation française ne sera en aucun cas en mesure d’y répondre.

Toutes ces activités criminelles relèvent davantage du droit pénal international, car, en l’absence de convention internationale, notre pays ne pourra se saisir de ces infractions que si la victime ou l’auteur en est un citoyen français.

C’est pourquoi, mes chers collègues, en guise de conclusion, je vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi…

En effet !
Monsieur le président, je vous prie de me pardonner d’avoir dépassé mon temps de parole.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et M. Gold, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 211-1 du code pénal est complété par les mots : « par tout moyen, dont l’altération de l’environnement naturel de cette population ».
La parole est à M. Joël Labbé.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’extension des compétences de la Cour pénale internationale au crime d’écocide, tel que la pollution intentionnelle et durable de l’écosystème au Vietnam, par stratégie militaire, afin d’en affaiblir l’ensemble de la population, est une revendication défendue par de nombreux universitaires et qui bénéficie d’un soutien croissant en France et à l’étranger.
Cela nécessite de procéder à la modification en ce sens du traité fondateur de la Cour, et donc de réussir à trouver un consensus au niveau mondial.
La France aurait tout intérêt à se montrer force d’initiative sur le sujet, en commençant par inscrire dans la définition nationale du génocide le fait d’y procéder par des atteintes graves à l’environnement, comme ce fut le cas au Vietnam. Plusieurs décennies après la guerre, l’agent orange produit encore des effets dévastateurs sur les générations actuelles des territoires touchés, où de nombreux enfants développent des malformations importantes.
Notre droit pénal qualifie déjà d’acte terroriste « le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Ce, à condition qu’il se produise « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Ce sont les dispositions de l’article 421-2 de notre code pénal.
Pour autant, et chacun en conviendra ici, il est peu probable qu’un juge qualifie un jour le gouvernement d’un État, a fortiori celui de la première puissance mondiale, d’entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
C’est pourquoi nous proposons de préciser la définition du génocide en complétant le critère « d’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique » par les mots « par tout moyen, dont l’altération de l’environnement naturel de cette population ». Cette précision tend à allonger la dimension temporelle du génocide, dès lors que ce dernier pourrait être regardé comme tel aussi longtemps que l’environnement naturel restera altéré. L’objectif est de dissuader absolument les chefs d’État de recourir à de telles techniques de guerre.

Cet amendement tend à modifier la définition du crime de génocide. Il a le mérite de souligner le lien qui existe entre la survie d’une population et son environnement naturel. La précision proposée semble pourtant superflue sur le plan juridique : le code pénal ne dressant pas la liste des moyens qui peuvent être utilisés pour détruire une population, le fait, par exemple, d’empoisonner un cours d’eau à cette fin pourrait tomber sous le coup de l’incrimination de génocide.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Monsieur le sénateur Labbé, cet amendement vise à ajouter à la définition déjà existante du crime de génocide une référence à la dégradation de l’environnement.
Cet ajout ne respecte toutefois pas le principe constitutionnel de précision de la loi pénale, la notion d’altération de l’environnement naturel étant particulièrement floue, notamment dans la définition de son intensité. S’agit-il d’une altération grave, durable, ou encore, qu’est-ce qu’un environnement naturel ?
En outre, cet ajout ne paraît pas nécessaire, puisque le texte exige une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique sans préciser le moyen employé. Quel que soit ce dernier, l’infraction sera constituée dès lors qu’il s’agira d’une telle atteinte commise en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe déterminé. Votre proposition est donc déjà couverte par la définition même du génocide.
Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.

J’entends les propos de Mme la rapporteure et de Mme la secrétaire d’État, mais cet amendement a également une portée symbolique. En matière diplomatique, la symbolique est beaucoup plus importante qu’en matière législative et disposer d’un tel symbole dans notre arsenal pénal nous rendrait plus crédibles encore sur la scène internationale.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

Je ne m’attendais pas, un 2 mai à vingt-trois heures dix-huit, à ce que notre hémicycle se transforme en casino ! Je vois les piles de jetons s’accumuler sur le pupitre de Mme Catherine Di Folco, ou plutôt les cartes de vote.
J’ai bien compris que la droite sénatoriale s’oppose à cette proposition de loi, et que, comme elle est minoritaire en séance, elle s’apprête à « plomber » notre travail en multipliant les scrutins publics.
Je le regrette. Ce n’est pas la première fois, mais, s’agissant d’un texte aussi important, aussi essentiel pour l’avenir de la planète, vous auriez pu, mes chers collègues, avoir la décence d’être présents en nombre suffisant pour vous y opposer tout en respectant la démocratie dans notre hémicycle.
Vous serez majoritaires par des voies artificielles, nous le déplorons, mais nous ferons notre travail pour défendre les intérêts de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 89 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec et Mmes N. Delattre et Laborde, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ou futur » ;
2° Après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : «, une maladie ».
La parole est à M. Joël Labbé.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très embêté. Il me semble que nous devons terminer à minuit, j’ai des amendements à défendre et si je les défends jusqu’au bout, je crains que nous ne puissions pas terminer l’examen de ce texte, ce dont je serais désolé. Je vais donc aller très vite sur cet amendement.

M. le président. La séance doit être levée au plus tard à minuit trente, vous avez donc largement le temps de défendre vos amendements, mon cher collègue.
Bravo ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Je préfère être vigilant, parce que je sais maintenant qu’un scrutin public sera demandé sur chacun des amendements.
Mieux sanctionner les atteintes à l’environnement est un enjeu crucial des prochaines années. Selon les observateurs, les affaires qui s’y rapportent ne représentent pourtant que 2 % de l’activité des parquets. Compte tenu du faible effet dissuasif des sanctions administratives, d’une part, et des difficultés que rencontre le juge civil à prononcer des dommages et intérêts, d’autre part, il apparaît comme absolument nécessaire de renforcer notre arsenal pénal.
Dans l’attente d’une rédaction satisfaisante de la définition de l’écocide, susceptible de s’appliquer à toutes les atteintes graves et irréversibles à l’environnement, l’adaptation de l’article relatif à la mise en danger de la vie d’autrui pourrait constituer une alternative. On pourrait ainsi étendre son champ d’application aux risques non seulement immédiats, mais futurs, ainsi qu’aux cas ayant donné lieu à une maladie permanente, en plus des mutilations ou des infirmités permanentes.

Cet amendement vise deux objectifs : sanctionner, d’abord, le risque immédiat de mort ou de blessure, mais aussi le risque futur ; ensuite, sanctionner la mise en danger, lorsqu’elle expose à un risque de mort, de blessure, mais aussi à un risque de maladie.
Dans l’objet de son amendement, notre collègue indique qu’il souhaite avant tout ouvrir le débat. Il me semble en effet qu’une réflexion plus approfondie est indispensable avant d’envisager d’élargir le champ d’application de cet article, qui déborde largement la question de la protection de l’environnement.
En visant des risques futurs, en faisant référence au risque de maladie, l’adoption de cet amendement pourrait rendre difficile l’établissement du lien de cause à effet entre le comportement répréhensible et les dommages observés.
C’est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut son avis serait défavorable.
L’amendement qui nous est proposé me semble déjà satisfait dans la mesure où, si l’activité réalisée en violation de la réglementation emporte des conséquences sur la santé des personnes, les chefs de blessures involontaires voire d’homicide involontaire sont déjà applicables. Le point de départ de la prescription se situe alors à l’apparition du dommage – la mort ou la blessure.
Le Gouvernement propose, en conséquence, le retrait de cet amendement.

Monsieur Labbé, avez-vous été convaincu ? Retirez-vous l’amendement n° 2 rectifié bis ?

Pas du tout ! Si l’on écarte la question de la maladie, la modification pourrait se limiter à la seule introduction de la notion de risque futur, parce que celui-ci existe et ce sont les générations futures qui en paient le prix.
C’est pour cela que je me dois de maintenir cet amendement, en espérant que, cette fois, pour gagner du temps, nous soyons appelés à voter à main levée.

Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 90 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et M. Gold, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 218-24 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Le droit pénal de l’environnement doit évoluer pour s’adapter aux conséquences graves que le comportement humain, surtout celui de certaines entreprises peu scrupuleuses, peut avoir sur l’environnement, donc sur les générations futures.
Le présent amendement vise à proportionner le montant de l’amende aux avantages tirés de la commission de l’infraction en matière de rejets de substances polluantes dans les eaux. L’amende serait calculée en fonction du chiffre d’affaires de la personne morale.
Je tiens à attirer votre attention sur les termes utilisés pour la définition de l’incrimination, ceux dont on nous reproche qu’ils ne seraient pas assez précis pour définir l’écocide, ainsi que sur le fait que la faute non intentionnelle est également retenue par le droit en vigueur.
Madame la rapporteure, en ce qui concerne le quantum des peines, vous estimez que les sanctions en vigueur sont dissuasives. Je soutiens le contraire, puisqu’on sanctionne plus aisément des pratiques commerciales trompeuses que des atteintes graves à l’environnement. Les simples arnaques, qui certes doivent être sévèrement punies, le sont ainsi davantage que des faits ayant un effet durable sur la biodiversité et la santé humaine. Notre droit prend donc le parti de renvoyer les responsabilités aux générations futures.
Mes chers collègues, nombreux sont les juristes qui donnent l’alerte sur l’inefficacité du droit pénal de l’environnement. Si la reconnaissance du préjudice écologique a constitué une grande avancée et si les sanctions semblent élevées, ce dispositif n’a pas été efficace pour certaines grandes entreprises qui polluent les mers ou procèdent à des forages et dont le chiffre d’affaires annuel peut atteindre la dizaine de milliards d’euros. Pour elles, ces condamnations ne représentent qu’un anodin accident de parcours, pour lequel, de surcroît, elles ont constitué des provisions.
Notre amendement vise à mettre en valeur un exemple de tout ce qui aurait pu être réalisé dans le cadre de cette proposition de loi, de ce que le législateur peut proposer pour revoir l’ensemble du code de l’environnement en vue d’adapter les sanctions aux réalités des dommages causés et au caractère lucratif des infractions environnementales.

Cet amendement vise à augmenter le quantum des amendes encourues par des personnes morales en cas d’infraction relative aux rejets polluants des navires. Il s’agit de porter ces maxima à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers exercices connus à la date d’effet, l’amende étant fixée en proportion des avantages tirés de la commission de l’infraction.
Si une réflexion pour rendre les peines encourues par les personnes morales en matière d’infractions environnementales plus dissuasives semble intéressante, il paraît nécessaire de réfléchir à l’échelle des peines de manière globale et non en isolant tel ou tel type d’infractions.
Par ailleurs, en matière d’infractions relatives aux rejets polluants des navires, les amendes prévues par le code de l’environnement pour les personnes morales sont d’ores et déjà importantes, puisque leurs montants peuvent atteindre 75 millions d’euros pour les pollutions les plus graves. De plus, ces amendes peuvent être complétées par des dommages et intérêts très substantiels, notamment pour préjudice écologique, ce qui a nécessairement un effet dissuasif pour les entreprises.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement.
Monsieur le sénateur Labbé, votre amendement me semble vraiment intéressant : comme vous, je crois qu’il faut muscler le dispositif pénal du droit de l’environnement national, notamment en rendant les sanctions vraiment dissuasives.
Reste que certaines réserves doivent être émises sur votre proposition. D’abord, cette aggravation ne peut concerner que les personnes morales. Ensuite, il convient de tenir compte du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel en matière de quantum de peine, un contrôle qui porte sur l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Ainsi, dans une décision de 2013, le Conseil constitutionnel a censuré la fixation d’un montant maximal de peine encourue dépourvu de lien avec l’infraction à laquelle il s’appliquait, parce qu’il était fondé sur le chiffre d’affaires.
Je tiens aussi à rappeler, après l’avoir signalé dans la discussion générale, que la mission confiée en janvier dernier par François de Rugy et Nicole Belloubet à l’Inspection générale de la justice et au Conseil général de l’environnement et du développement durable sur la politique pénale en matière environnementale de la France devrait rendre ses conclusions en septembre prochain.
Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je propose que vous retiriez votre amendement et que nous travaillions sur cette question en liaison étroite, d’ici à la remise du rapport et au-delà.

Madame la secrétaire d’État, je vous fais confiance pour que nous travaillions ensemble en ce sens. Je retire donc mon amendement.

L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes Costes et N. Delattre, MM. Labbé et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez, Dantec et Gabouty, Mme Guillotin, M. Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article ; ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.

Le présent amendement, dont nos collègues Josiane Costes et Nathalie Delattre sont à l’origine, vise à réaliser une évolution consensuelle à la suite du constat établi par les auteurs de la proposition de loi sur l’importance croissante de la criminalité environnementale dans les profits des réseaux de délinquance et de criminalité organisées.
Encore relativement méconnue, cette dimension de la criminalité organisée pourrait avoir, à terme, d’importantes incidences sur l’environnement mondial, mais également sur la qualité de vie et la santé des Français, de manière directe ou indirecte. Le sujet est d’ailleurs pris très au sérieux par Interpol, qui a adopté plusieurs résolutions depuis les années 1990 pour combattre ce phénomène dans toutes ses dimensions : criminalité liée à la pêche, criminalité forestière, criminalité liée à la pollution et aux espèces sauvages.
Afin de renforcer nos juridictions dans la lutte contre la criminalité environnementale, il est proposé de permettre à nos magistrats de disposer des moyens d’enquête et d’instruction prévus à l’article 706-73 du code de procédure pénale pour parvenir à sanctionner les délits prévus par le code de l’environnement.
Nous avons conscience que la rédaction actuelle du dispositif comporte quelques imperfections et pourrait être améliorée : d’une part, par le remplacement de l’expression : « lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions précitées » par l’expression : « commis en bande organisée » ; d’autre part, par la suppression des septième et neuvième alinéas de l’article 706-73-1 du code pénal. Cela reviendrait non pas à écraser les dispositions déjà prévues à cet article, mais à renforcer davantage les moyens à disposition des magistrats dans les cas déjà prévus et à étendre le dispositif à tous les délits du code de l’environnement.
Ces évolutions nous paraissent absolument nécessaires pour nous prémunir contre une spécialisation des réseaux de criminalité organisée dans des activités non respectueuses de l’environnement, ce qu’on observe déjà chez certains de nos voisins européens, par exemple en matière de traitement des déchets.

Cet amendement de nos collègues du groupe du RDSE vise à rendre la procédure relative à la délinquance organisée applicable à l’ensemble des délits prévus par le code de l’environnement, dès lors qu’ils sont connexes à un crime ou un délit commis en bande organisée.
Les enquêteurs et magistrats disposent de pouvoirs renforcés en matière de lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Ils peuvent mettre en œuvre des techniques particulières de surveillance, d’infiltration, d’enquête sous pseudonyme, d’interception des correspondances et de sonorisation des véhicules, potentiellement attentatoires à la vie privée. De plus, des règles dérogatoires s’appliquent en matière de garde à vue comme de perquisition.
Il nous paraît hasardeux d’étendre, sans avoir procédé au préalable à une réflexion approfondie, le champ de ces techniques potentiellement très intrusives à des délits aussi nombreux et d’une gravité variable.
J’ajoute que certains délits environnementaux peuvent déjà donner lieu à l’utilisation de ces techniques d’enquête. En effet, l’article 706-73-1 du code de procédure pénale vise notamment les délits d’atteinte au patrimoine naturel et les délits de trafic de déchets, à condition qu’ils aient été commis en bande organisée.
L’adoption de l’amendement ferait disparaître cette dernière exigence, ce qui conduirait à appliquer des techniques et procédures propres à la délinquance organisée à des délits qui n’ont pas été commis en bande organisée. Cela ne nous paraît pas très cohérent.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, elle y sera défavorable.
Madame la sénatrice, je comprends tout à fait l’objectif de votre amendement. Néanmoins, il me paraît présenter un fort risque d’inconstitutionnalité. En effet, son adoption permettrait l’utilisation de techniques spéciales d’enquête comme les IMSI catchers, la sonorisation ou la captation de données informatiques pour les délits prévus par le code de l’environnement, dont certains ne sont sanctionnés que par une peine d’amende. Avis défavorable.

Je regrette, madame la secrétaire d’État, mais vous ne m’avez pas tout à fait convaincue, car, entre le délit individuel et celui commis en bande organisée, il y a ceux qui sont le fait de deux, trois ou quatre personnes, pour lesquels on pourrait peut-être recourir à certaines techniques spéciales. Je maintiens l’amendement.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, il semblerait que nous allions procéder à un nouveau scrutin public. Or, si j’ai bien écouté les orateurs lors de la discussion générale, notre assemblée rejettera majoritairement cette proposition de loi lors du vote sur l’ensemble. Dès lors, tenir un vote solennel sur chaque amendement ne sert absolument à rien. Je propose que nous votions sur les amendements à main levée.
M. Éric Gold applaudit.

Mon cher collègue, vous avez raison en pratique, mais il se trouve que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Si Mme Di Folco retire cette demande ainsi que les autres qui ont été déposées, nous pourrons procéder comme vous le proposez, mais tel n’est manifestement pas le cas. Nous allons donc poursuivre la mise aux voix par scrutin public.
La parole est à M. le président de la commission.

Je comprends très bien la demande de notre collègue visant à abréger les débats, mais je veux lui faire observer qu’il serait très difficile pour notre assemblée de rejeter le texte après avoir adopté tous les amendements. Il y a une exigence de cohérence.
Quant au scrutin public, il ne s’agit pas d’un vote solennel, mais d’un mode de votation qui permet à chacun d’entre nous de prendre ses responsabilités en exprimant son choix sur les amendements.
Comme l’ambition de cette proposition de loi est très importante – nous nous sommes rejoints, les uns et les autres, pour le reconnaître –, il me paraît normal que tous les membres de notre assemblée puissent s’exprimer au travers de ces scrutins publics demandés par le groupe Les Républicains.
Si donc je comprends l’aspect pratique de votre demande, mon cher collègue, je crois que les exigences de cohérence et de responsabilité nous imposent d’aller au bout de ce débat dans des conditions normales. Nous n’adopterions pas des amendements pour ensuite rejeter le texte.

Je me dois de faire observer qu’il s’agit là non pas de débats, mais de procédure.
Je partage tout à fait l’avis du président Bas : c’est un texte important, et il faut prendre ses responsabilités. En l’occurrence, la responsabilité de la majorité sénatoriale aurait consisté à être présente en nombre suffisant dans l’hémicycle pour pouvoir rejeter les amendements à main levée. Chers collègues de la majorité sénatoriale, si l’on considère que le texte est important, il est regrettable d’être aussi peu nombreux !
Marques d ’ approbation sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Pour notre part, nous sommes obligés de nous réfréner, alors que nous aurions beaucoup à dire, pour que notre assemblée puisse aller au bout du travail prévu ce soir. C’est un peu dommage.

Mes chers collègues, il nous reste encore quarante-cinq minutes. En nous concentrant sur l’objet du texte, je pense que nous pourrons arriver à en achever l’examen.
Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 91 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mmes Costes et N. Delattre, MM. Labbé et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez, Dantec et Gabouty, Mme Guillotin, M. Gold, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les crimes et délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, lorsqu’ils sont accompagnés d’atteinte à l’environnement. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Cet amendement vise à instaurer une compétence extraterritoriale des juridictions françaises en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement, indépendamment de la création d’un crime d’écocide au sein du code pénal.
Comme le prévoit la Charte de l’environnement, « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». Il convient donc de doter nos institutions judiciaires des moyens de lutter contre les atteintes à ce patrimoine commun exploitées par des réseaux de délinquance et de criminalité organisées là où elles adviennent, dès lors qu’elles ont des répercussions sur la qualité de vie des générations de Français présentes et futures.

Les auteurs de cet amendement proposent que les juridictions françaises soient compétentes pour juger les personnes résidant habituellement sur le territoire de la République qui auraient commis à l’étranger un crime ou un délit en bande organisée accompagné d’une atteinte à l’environnement.
Actuellement, des poursuites sont possibles pour des faits commis à l’étranger en cas de crime contre humanité ou de crime de guerre, à condition qu’aucune juridiction nationale ou internationale ne demande l’extradition de la personne suspectée.
Je comprends bien l’intention des auteurs de cet amendement, qui souhaitent affirmer la détermination de la France à lutter contre les atteintes à l’environnement, même lorsqu’elles sont commises à l’étranger. Néanmoins, je me dois de signaler les difficultés diplomatiques et pratiques qui résulteraient de l’adoption d’une telle disposition : la France pourrait se voir reprocher de s’ériger en « gendarme du monde » en enquêtant sur des faits commis à l’étranger, qui parfois ne seraient même pas susceptibles de poursuites selon la législation de l’État considéré.
Sans compter la difficulté de rassembler des preuves s’agissant de faits commis en dehors de notre territoire, par hypothèse dans des pays où l’État de droit est mal assuré – sans quoi l’État où les faits se sont produits s’en serait saisi lui-même.
Je crains donc que ce type de mesures ne suscite beaucoup d’attentes, difficiles à satisfaire.
En outre, la référence à des crimes ou délits « accompagnés d’atteintes à l’environnement » manque de précision. Cette formulation très générique risquerait d’ouvrir la voie à des difficultés d’interprétation.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Monsieur le sénateur, je souscris à votre analyse sur la nécessité, que j’ai moi-même soulignée à plusieurs reprises, d’adopter une approche internationale des délits environnementaux. J’ai néanmoins deux réserves sur votre amendement.
D’abord, il ne semble pas conforme aux exigences de précision de la loi pénale.
Ensuite, pour que la compétence extraterritoriale française soit effective, il est nécessaire, comme le prévoit l’article 689 du code de procédure pénale, qu’elle soit adossée à une convention internationale reconnaissant les mêmes infractions. Une telle convention n’existant malheureusement pas, l’amendement n’est pas opérant.
M. le président de la commission des lois opine.

Cet amendement vient des cimes du Cantal, avec Josiane Costes, et des rivages de la Gironde, avec Nathalie Delattre… Comme ce sont elles qui l’ont proposé, je le maintiens.

Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 92 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Après le livre II du code pénal, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« LIVRE II BIS
« DES CRIMES CONTRE L’ENVIRONNEMENT
« TITRE I ER
« DE L’ÉCOCIDE
« Art. 230 -1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.
« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« Art. 230 -2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.
« Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 230 -3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« TITRE II
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 240 -1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
« Art. 240 -2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :
« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »

Nous ne pouvons nier que la présente proposition de loi représente un pas majeur vers la reconnaissance des détériorations massives et durables infligées à la faune et à la flore par les activités humaines. Reste que, comme je l’ai souligné dans la discussion générale, pour que de telles sanctions soient efficaces et effectives, elles devront à l’avenir devenir dissuasives à l’échelle supranationale, en s’incorporant dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, la CPI.
Or pour qu’une telle introduction dans le droit pénal international soit possible, il semble nécessaire de trouver une qualification des crimes environnementaux susceptible de convenir à tous les États membres de la CPI.
En tant qu’historienne, je me suis interrogée sur la sémantique du terme « écocide ». S’agit-il du bon mot ? Celui-ci est-il adapté et proportionné ? Ne rappelle-t-il pas trop la notion de génocide, ce qui pourrait déplaire à certains États, comme l’Allemagne, déjà heurtée, ou l’Arménie ? Ne faut-il pas prendre en compte les sensibilités historiques des nations face à un terme si lourd de sens ? Une telle formule ne serait-elle pas considérée comme susceptible de desservir la lutte contre les préjudices environnementaux, en lui donnant le même seuil de gravité que le génocide ? Ne pourrait-on pas renommer l’écocide, comme Mme Cabanes l’a suggéré, crime contre la sûreté de la planète, expression moins connotée ?
J’ai pris en compte toutes ces considérations et suis finalement arrivée à la conclusion que l’écocide est entré dans le vocabulaire des associations et des experts. On ne peut pas aller contre le chemin parcouru par les mots, qui, comme des cailloux, roulent à leur rythme et font leur chemin.

« L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot par son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce.
« En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. […] On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. »
Cette situation décrite par Lamarck en 1820, nous y sommes ! Les faits sont là qui résultent de notre penchant bien fâcheux : les atteintes à l’environnement sont sans précédent, parce que nous disposons maintenant de moyens bien plus importants que par le passé, et nous faisons courir des dangers à la vie elle-même, par la baisse drastique de la biodiversité et la destruction irréversible des écosystèmes.
Mes chers collègues, nous ne parlons pas de petits méfaits, mais d’actes gravissimes qui, jusqu’à présent, n’ont pas donné lieu à des peines et amendes à la hauteur des conséquences provoquées.
De quoi parle-t-on au juste ? De marées noires, de contamination au chlordécone dans les Antilles, de boues rouges à Gardanne… Des milieux détruits pour des dizaines d’années ! Les personnes qui habitent dans les régions concernées en subiront les effets sur leur santé durant toute leur vie.
Comment se manifeste concrètement l’arsenal juridique actuel ? À la vérité, les sanctions sont inopérantes. L’écocide permettrait d’apporter une réponse sans appel, d’abord par la symbolique du mot, un véritable électrochoc, et ensuite, parce que, le crime étant inédit, la qualification doit l’être aussi.
Si nous attendons une réglementation internationale pour lutter contre ces problématiques, nous attendrons longtemps et il sera trop tard ! Nous devons être précurseurs, il nous revient de lancer l’impulsion – telle est la noblesse de la politique. À nous d’œuvrer pour que ce texte aboutisse !
Madame la secrétaire d’État, profitez de l’opportunité qui vous est donnée d’étoffer le texte, de l’amender, afin que nous puissions avancer.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Corbisez et Dantec et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 230 -1. – Constitue un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement. L’infraction est également constituée lorsque l’auteur des faits ne pouvait pas ignorer qu’ils pouvaient causer une telle atteinte.
« L’auteur ou le complice d’un écocide ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.
La parole est à M. Joël Labbé.

La consécration de l’écocide dans notre droit interne constituerait un symbole fort, qui permettrait à notre pays de plaider en faveur de sa reconnaissance au niveau international. Pourquoi la France, si prompte à accueillir la COP21 et à vouloir aboutir à la signature de l’accord de Paris, dont nous pouvons être fiers, ne pourrait-elle pas rejoindre les pays qui ont déjà introduit une telle notion dans leur droit national ?
Conscients des difficultés d’application qui peuvent se poser dans l’espace, nous avons tenté d’apporter des améliorations à la définition proposée, en la recentrant sur les atteintes à l’environnement les plus graves, celles qui sont irréversibles et étendues au regard du quantum élevé des peines.
Je rappelle de nouveau que la notion d’atteinte à l’environnement n’est pas mieux définie pour les délits prévus par le code de l’environnement en vigueur.
Ainsi, constituerait un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement. L’infraction serait également constituée, lorsque l’auteur des faits ne pouvait pas ignorer qu’il pouvait causer une telle atteinte. Le caractère irréversible du dommage qui ne pourra pas être réparé en nature justifie la forte sanction encourue.
Cette rédaction s’inspire en partie de ce que la juriste Valérie Cabanes propose en guise d’amendement au statut de Rome de la Cour pénale internationale ; l’intention de nuire ne doit pas être retenue en raison des devoirs que nous avons vis-à-vis des générations futures.
L’infraction serait constituée, que l’atteinte soit délibérée ou non intentionnelle, lorsque l’auteur fait preuve d’une imprévoyance consciente.
Pour que ces comportements graves puissent être sanctionnés, il convient d’intégrer la responsabilité pénale de l’auteur, y compris lorsqu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, à l’instar de ce que le code pénal dispose en matière de génocide.
Certes, nous concevons qu’il aurait été nécessaire de réfléchir à la gradation de l’ensemble des sanctions prévues par le code de l’environnement, mais le droit pénal environnemental est, en tout état de cause, insuffisamment dissuasif et très en deçà des conséquences graves que certains comportements ont sur l’environnement. Cela explique la teneur de nos amendements en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’une population
par les mots :
des populations présentes et futures
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Une politique environnementale courageuse suppose de tenir compte de la mise en péril des conditions d’existence des populations futures.
Certains dommages causés par les crimes environnementaux revêtent un caractère irréversible ou de très longue durée, comme dans le cas du chlordécone, un produit insecticide toxique non biodégradable répandu en Martinique et en Guadeloupe dès les années 1970 et qui continue, encore aujourd’hui, de polluer massivement les eaux et les sols.
Ces écocides qui menacent l’équilibre de la planète et la survie de l’humanité auront des conséquences directes sur la santé des générations futures, proches et éloignées.
Prévenir plutôt que guérir, voilà la ligne directrice qui s’impose à nous, responsables politiques ! Nous avons des devoirs et des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Il semble donc fondamental d’insérer le principe de précaution au sein du crime d’écocide – ce principe est déjà reconnu et consacré par le code de l’environnement et la Charte de l’environnement de 2005.
L’ajout de ce principe permettrait la sanction pénale des auteurs au regard des risques encourus de dommages graves et irréversibles à l’environnement, et ce malgré l’absence de certitude scientifique sur ces risques.
Sans modifier l’essence du texte, le présent amendement vise donc à ajouter, dans la définition du crime d’écocide, les populations présentes et futures comme victimes de ces préjudices.

Je vais d’abord répondre à notre collègue Joël Labbé, dont l’amendement n° 5 rectifié propose de modifier la définition de l’écocide, en retenant une définition plus simple que celle figurant dans la proposition de loi initiale : constituerait un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement.
Cette définition manquerait cependant de précision. Qu’est-ce qu’une atteinte grave ou étendue à l’environnement ? Par sa généralité, elle risquerait, en outre, d’entrer en concurrence avec certaines incriminations beaucoup plus précises figurant dans le code de l’environnement et qui répriment la pollution des sols, de l’air ou de l’eau.
L’amendement soulève une autre difficulté : il prévoit qu’une personne pourrait être poursuivie pour écocide, même lorsqu’elle a accompli un acte autorisé ou prescrit par la loi ou le règlement. Il me paraît difficile de faire peser un risque pénal sur quelqu’un qui se serait simplement conformé à ses obligations légales.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 1 rectifié de notre collègue Esther Benbassa et des autres membres du groupe CRCE, il tend à modifier la définition de l’écocide, en précisant que ce crime serait constitué en cas d’atteinte aux conditions d’existence des populations présentes et futures. Son objectif est de mieux prendre en compte le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain et préservé.
Notre commission partage bien sûr cet objectif de protection des générations futures. Elle n’a cependant pas souhaité inscrire dans le code pénal le crime d’écocide pour les raisons que j’ai exposées lors de la discussion générale, qui tiennent notamment au manque de précision de sa définition.
L’amendement proposé ne remédie pas à ce manque de précision et pourrait même rendre l’infraction encore plus difficile à cerner.
Par cohérence, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.
Il me semble que l’incrimination en question n’est pas suffisamment définie – nous en avons déjà parlé – et je ne suis pas certaine que ces amendements ajoutent la précision nécessaire. Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je voudrais soutenir ces deux amendements.
Pour bien comprendre, il faut revenir sur l’utilité de la notion d’écocide. Il s’agit de passer du délit au crime et de fixer clairement qu’il s’agit d’un crime grave contre les générations futures. La mise en place d’une responsabilité pénale doit nous permettre de lutter certes contre les trafics, mais au-delà, contre les activités industrielles légales qui s’avèrent intenables pour la survie de notre planète et de notre espèce.
Il faut arrêter d’autoriser des productions industrielles qui ne respectent pas les limites de notre planète. Il ne faut pas seulement lutter contre les pollutions accidentelles, mais aussi contre les pollutions au jour le jour, qui font disparaître des multitudes d’espèces, qui rendent les seuils de particules dans l’atmosphère intenables ou qui rendent les océans trop acides. Il faut opposer à ce modèle économique fou les limites de la Terre.
Comme cela a été dit, nous devons évidemment travailler au niveau international, mais nous devons aussi agir, dès à présent, à l’échelon national, et ce de manière très large. C’est en agissant déjà sur notre territoire que nous serons plus forts dans les discussions internationales. Si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, comment pourrions-nous justifier de le demander pour tout le monde ?
Nous avons besoin d’une transformation juridique radicale afin de changer de paradigme, car l’appât du gain immédiat au profit de quelques-uns entraîne trop souvent une prise de risque qui touchera tout le monde plus tard.
C’est la fameuse question de la dette écologique, qui est souvent niée, oubliée et toujours sous-estimée. Dans cet hémicycle, nous entendons très souvent parler de la dette financière de notre pays ; certes, elle est très lourde, mais au moins, elle peut être remboursée, ce qui n’est pas le cas de la dette écologique.
Les externalités négatives ne touchent finalement jamais les entreprises qui les induisent. Il s’agit ici de les leur faire payer, mais surtout de les empêcher de les créer, en ne les rendant tout simplement pas rentables. C’est notre responsabilité !
Pour conclure, je ressens une certaine gêne. Je vois des sourires embarrassés, j’entends des remerciements appuyés à l’auteur de cette proposition de loi, Jérôme Durain, qui – entend-on – a si bien fait d’ouvrir une discussion aussi importante pour l’avenir de notre planète ! Et en réalité, peu de sénatrices et de sénateurs sont effectivement présents ce soir pour discuter à fond de ce sujet. Où sont-ils ?

Je souhaite apporter une précision par rapport à ce que vient d’indiquer notre collègue. Le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur l’amendement n° 5 rectifié. En effet, nous avons construit cette proposition de loi sur le principe de l’intentionnalité, c’est-à-dire sur le caractère délibéré du crime. L’approche de Joël Labbé est tout à fait respectable, mais ne correspond pas au cœur de notre texte. C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur son amendement.

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 93 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 94 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et M. Gold, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Le présent amendement est simple, il devrait donc être mis au vote à main levée… Il propose de fixer le montant de l’amende en fonction des avantages tirés de la commission de l’infraction, jusqu’à 10 % – seulement !– du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale pénalement responsable.

Non, je le retire, monsieur le président. Nous gagnerons ainsi du temps…

L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Corbisez et Dantec et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les crimes prévus à l’article 230-1 du même code. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Dans le même esprit que l’amendement n° 9 rectifié bis déjà défendu, le présent amendement vise à accorder une compétence extraterritoriale aux magistrats français en matière de crime d’écocide.
Contrairement à l’amendement précédent, cette compétence serait beaucoup plus vaste, donc nettement plus efficace, puisqu’elle ne se limiterait pas aux atteintes à l’environnement perpétrées par les seules bandes organisées, mais à tous les écocides ici définis.
Madame la rapporteure, nos magistrats n’ont pas seulement besoin de formation pour renforcer leur maîtrise des problématiques environnementales, mais également de moyens supplémentaires pour agir dans l’espace.
Cette mesure mettrait à la disposition de nos concitoyens un instrument puissant à la hauteur des enjeux environnementaux de notre époque.

Nous avons déjà abordé la question de l’extraterritorialité. Par cohérence, la commission des lois est défavorable à cet amendement.

Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 95 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, je vais maintenant mettre aux voix l’article 1er de la proposition de loi. Je vous informe que, si cet article n’est pas adopté, les articles suivants n’auront plus d’objet et ne seront donc pas mis aux voix. Dans ce cas, il n’y aura pas d’explications de vote sur l’ensemble du texte.
La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article.

J’ai entendu avec beaucoup de plaisir les remerciements qui nous ont été adressés. Je tiens donc, moi aussi, à remercier les participants à notre débat.
Je relève quelques bonnes nouvelles, notamment l’annonce par Mme la secrétaire d’État du lancement d’une inspection sur l’idée de créer des juridictions spécialisées en matière d’environnement. Cela va dans le bon sens.
J’observe avec un peu d’ironie, tout de même, que beaucoup d’orateurs se sont réjouis de la tenue de ce débat, tout en souhaitant le refermer assez vite… Beaucoup semblent partager le sentiment de l’urgence écologique, tout en nous conseillant de prendre du temps pour réfléchir – sûrement, le temps… de ne rien faire !
Je constate aussi que, parmi ceux qui ont estimé que ce texte était perfectible, aucun n’a pris le soin de déposer des amendements pour le rendre meilleur !
Je note enfin qu’aucun de ceux qui nous ont dit que cette question relevait du niveau européen n’a pris le soin d’inscrire le sujet de l’écocide dans le programme de la liste qu’il soutient pour les élections européennes qui approchent.
Il y a donc un certain nombre de paradoxes…
Nous nous attendions évidemment aux arguments qui nous ont été adressés.
Le caractère transnational de l’écocide justifierait qu’un pays ne puisse pas agir seul. Or un citoyen français peut tout à fait être impliqué dans des actes relevant d’un crime d’écocide. En outre, tant M. Neyret que la procureure de la Cour pénale internationale invitent les États à inscrire cette notion dans leur droit national.
Plusieurs orateurs ont avancé un certain manque de précision dans la définition de l’écocide, mais n’ont pas pour autant déposé d’amendements…
D’autres ont avancé la robustesse du droit administratif, mais – soyons honnêtes ! – ce droit est bien pataud devant l’agilité de la criminalité environnementale. Aujourd’hui, les infractions sont trop peu poursuivies et les sanctions trop faibles. Beaucoup de pays ont des dispositifs nettement plus solides que les nôtres pour lutter contre ces crimes.
L’échelle des valeurs protégées était au cœur de notre réflexion. Nous souhaitions, par l’intermédiaire de ce crime d’écocide, revoir l’ensemble de la hiérarchie des peines sur les questions environnementales. Nous n’y sommes pas parvenus.
Nous n’avons pas vocation à être le gendarme du monde, mais à répondre à une urgence.

Il faut vraiment conclure, mon cher collègue, si vous voulez que nous ayons le temps de mettre le texte aux voix.

M. Jérôme Durain. Nous avons bien vu avec la question du devoir de vigilance des entreprises mères que, même en ne représentant que 1 % de la population mondiale, nous pouvions changer les choses. Tel est notre objectif avec cette proposition de loi.
M. Olivier Jacquin applaudit.

Je mets aux voix l’article 1er.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 6 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 96 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Au dernier alinéa de l’article 133-2 du code pénal, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».
Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

L’article 1er n’ayant pas été adopté, il n’y a pas lieu de mettre aux voix les articles 2 et 3.
Aucun article n’ayant été adopté, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire.
En conséquence, la proposition de loi n’est pas adoptée.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 7 mai 2019 :
À quatorze heures trente :
Explications de vote puis vote sur la proposition de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l’introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes, présentée par Mme Agnès Canayer et plusieurs de ses collègues (texte n° 215, 2018-2019).
Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du règlement, sur la réforme de la politique agricole commune (PAC) (texte n° 316, 2018-2019).
À seize heures quarante-cinq :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq :
Suite de la proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du règlement, sur la réforme de la politique agricole commune (PAC) (texte n° 316, 2018-2019).
Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l’application et de l’évaluation des lois, présentée par de MM. Franck Montaugé, Jean-Pierre Sueur, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Marc Daunis, Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission n° 449, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 3 mai 2019, à zéro heure trente.
La liste des candidats désignés par la commission des affaires sociales pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. Alain Milon, Michel Amiel, Mme Catherine Deroche, MM. René-Paul Savary, Yves Daudigny, Mme Michelle Meunier et M. Olivier Henno.
Suppléants : M. Stéphane Artano, Mmes Laurence Cohen, Chantal Deseyne, Corinne Féret, Pascale Gruny, Frédérique Puissat et M. Jean-Marie Vanlerenberghe.