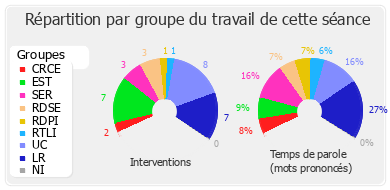Séance en hémicycle du 7 février 2023 à 22h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

La séance est reprise.

La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour une mise au point au sujet de votes.

Lors du scrutin n° 125 sur l’ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, Laurent Lafon souhaitait voter contre, tandis que Catherine Morin-Desailly, Sonia de La Provôté, Michel Laugier et Hervé Maurey voulaient s’abstenir.

Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour une mise au point au sujet d’un vote.

Lors du scrutin public n° 120, mon collègue Philippe Bas souhaitait voter pour.

Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la commission des affaires économiques, sur les conclusions du rapport Compétitivité : une urgence pour redresser la ferme France.
Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.
Monsieur le ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé sa place dans l’hémicycle.
Dans le débat, la parole est à M. Pierre Louault, au nom de la commission qui a demandé le débat.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’agriculture – et de la souveraineté alimentaire, nous aurons l’occasion de vous le rappeler aujourd’hui ! –, mes chers collègues, le rapport que j’ai conduit avec mes collègues Laurent Duplomb et Serge Mérillou expose, à partir de cinq produits – la pomme, la tomate, le blé, le lait et les poulets –, les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de notre pays, puis propose quelques solutions.
Je comparerai la situation de l’agriculture à celle du nucléaire français : à force de maudire un système et une façon de produire, en établissant des règles et en votant des lois doctrinaires et non réalistes, le glissement vers l’impasse était inexorable. En vingt ans, nous sommes passés du deuxième rang mondial des exportateurs à un déficit de production, si l’on excepte les vins et spiritueux. Les agriculteurs baissent les bras, comme EDF le fait depuis dix ans.
Nous avons beaucoup discuté ces dernières semaines de souveraineté énergétique : celle-ci est indispensable, mais tout aussi nécessaire, et peut être encore davantage, est la puissance agricole d’un pays, qui plus est lorsque celui-ci a longtemps été qualifié de « grenier de l’Europe ».
À ce titre, je remercie la commission des affaires économiques et sa présidente, Sophie Primas, d’avoir bien voulu inscrire à l’ordre du jour un débat sur les conclusions de notre rapport sur la compétitivité de la ferme France, document transpartisan qui, une fois encore, tire la sonnette d’alarme sur la compétitivité de notre agriculture et sur sa capacité à exporter ses productions comme à nourrir la population.
Les constats de ce rapport ne font, hélas, pas dans l’originalité, puisque cela fait maintenant une vingtaine d’années que le Sénat alerte sur la pente descendante qu’emprunte notre agriculture. En 2015, déjà, nous discutions une proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir sur la compétitivité de l’agriculture française.
Pourtant, chaque année qui passe contribue à aggraver les déséquilibres maintes fois identifiés, si bien que, monsieur le ministre, il devient impérieux d’agir.
Notre rapport a mis en avant un certain nombre de facteurs contribuant à éroder, voire à miner, la compétitivité de notre modèle français.
Parmi quatre facteurs, j’en citerai deux : premièrement, la hausse des charges des producteurs, en raison des coûts de la main-d’œuvre, des surtranspositions ou encore d’une fiscalité trop lourde ; deuxièmement, la productivité en berne résultant du manque d’investissements, principalement dans l’agroalimentaire et dans l’élevage, pour des raisons que nous ne connaissons que trop bien au Sénat.
Résultat, nos exportations implosent et nos paysans désespèrent : près d’un tiers des légumes sont importés et les deux tiers des fruits le sont également. Et que dire des poulets, lorsque près de la moitié de ceux qui sont consommés dans notre pays ne sont pas français. Ne sommes-nous plus capables d’offrir à nos compatriotes des produits agricoles de grande consommation accessibles à tous ?
Face à ces constats alarmants, nos recommandations n’ont pas vocation à rester lettre morte. Je crois, monsieur le ministre, que vous souscrivez non seulement à nombre des constats, mais aussi à nombre des solutions préconisées dans ce rapport. Travaillons donc ensemble à inverser cette tendance mortifère pour nos agriculteurs, notre compétitivité, nos concitoyens et notre pays.
Vous engagerez-vous, avec le Sénat, à la vigilance la plus absolue quant aux surtranspositions ? Je ne peux pas ne pas penser aux betteraviers, qui, les premiers en Europe et dans le monde, ont dû se passer de produits indispensables, en l’état actuel des connaissances et de la recherche, à leurs cultures.
Quand pérenniserez-vous pour de bon les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE), pour sauver la filière fruits et légumes ?

M. Pierre Louault. Je sais pouvoir compter sur vous, monsieur le ministre, pour travailler avec nous à inverser cette tendance.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tout d’abord, je vous remercie d’avoir organisé ce débat. Il permet de prolonger le travail réalisé dans le cadre de ce rapport, qui pose les enjeux que vient d’évoquer le sénateur Louault.
Monsieur le sénateur, vous avez raison, le sujet de la souveraineté traverse nos pensées, si je puis dire, et notre action politique : la crise de la covid-19, la guerre en Ukraine et un certain nombre d’événements récents, notamment en matière énergétique, sont venus le rappeler avec encore plus de force à ceux qui l’avaient oublié. La souveraineté alimentaire, bien entendu, a toute son importance.
Je vous répondrai en quelques mots.
Premièrement, il me semble que la question de la souveraineté doit être posée au niveau à la fois européen et national.
Deuxièmement, vous mentionnez au détour d’un certain nombre de sujets la capacité d’exportation de notre pays, c’est-à-dire tout à la fois la capacité à subvenir aux besoins de notre population et à reconquérir notre place d’exportateur.
Troisièmement, vous m’interpellez sur la hausse des charges globales, liées au coût de la main-d’œuvre.
Pour ce qui est de la pérennisation des TO-DE, même si le processus n’a pas complètement abouti, nous avons tout de même déjà fait un pas à moyen terme, qui devrait en précéder un autre à plus long terme, pour offrir davantage de visibilité.
Quant à la fiscalité, la loi d’orientation et d’avenir agricoles aura pour objet de la repenser globalement, à l’aune des besoins des agriculteurs et des orientations que nous souhaitons donner.
Quatrièmement, en matière de normes, il existe en effet une propension française qui n’est pas nouvelle. Le génie français – j’ose à peine employer l’expression – consiste à normer quand on a un problème et à surnormer quand d’autres ont déjà normé. Vous avez raison de le dire, il faut que nous soyons collectivement vigilants, car cette tendance nous a parfois échappé au cours des années.
Dès lors que le cadre est européen, je puis comprendre que des normes doivent s’appliquer, même si cela n’exclut pas de poser la question aux frontières. En effet, la concurrence dans notre pays s’exerce très souvent à l’intérieur des frontières : c’est le cas, par exemple, avec les volailles. Il convient donc, chaque fois qu’on réglemente ou qu’on légifère, de veiller à ce que les normes ne soient pas des freins à la compétitivité de la ferme France.

M. le président. La parole est à M. Serge Mérillou, au nom de la commission qui a demandé le débat.
Applaudissements au banc des commissions. – Mme Sophie Primas, M. Franck Menonville et M. Pierre Louault applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, mes chers collègues, Pierre Louault l’a dit avant moi, la situation de l’agriculture française est préoccupante à bien des égards, comme l’a montré notre rapport de septembre 2022.
Je voudrais illustrer cette situation en vous parlant des éleveurs laitiers. J’ai choisi cet exemple parmi les cinq filières qui ont été étudiées dans ce rapport pour démontrer l’étendue de la crise dans laquelle se trouvent nos agriculteurs : 61 % des éleveurs laitiers n’atteignent pas le salaire médian, monsieur le ministre, et un agriculteur sur deux partant à la retraite dans cette filière n’est pas remplacé, avec comme résultante une décapitalisation du cheptel qui a été entamée dès 2005 et qui se poursuit inexorablement !
Pourtant, les prix du lait payés aux producteurs ont augmenté de plus de 40 % en moyenne sur un an dans l’Union européenne, avec une hausse culminant à 46 % en Allemagne.
Quant au prix moyen payé aux paysans français, il n’a augmenté que de 22 %, soit deux fois moins, alors que les charges se sont considérablement accrues, comme vous le savez. Comme toujours, l’agriculteur ou l’éleveur français est celui qui a le plus de difficulté à capter la valeur ; manifestement, les lois Égalim (lois pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) n’ont pas apporté les résultats escomptés.
Il est donc urgent, monsieur le ministre, d’agir pour restaurer la compétitivité de ce que nous qualifions dans notre rapport de « miracle laitier français », tant le modèle familial de la ferme laitière française qui nous est si cher paraît fragile face aux concurrents européens pratiquant une agriculture toujours plus intensive.
Je rappelle que la France est désormais le quatrième importateur mondial de lait. Quand l’Allemagne bâtit sa compétitivité sur ses performances techniques, la France le fait sur la faiblesse de la rémunération de sa main-d’œuvre familiale !
Pourtant, la France est aussi une puissance exportatrice, mais elle a besoin d’un réel soutien de l’État, pour aller conquérir ou reconquérir les marchés tout en protégeant le sien.
Dans le cadre de nos travaux autour du rapport, nous nous sommes rendus en Italie, pour voir comment on faisait par-delà les Alpes. Or, dans ce pays, on assiste à une véritable promotion des produits agricoles nationaux à l’international : quel Français n’a pas, en été, un morceau de mozzarella ou un peu de parmesan dans son réfrigérateur ? Peut-être même qu’il cuisine sa mozzarella avec des tomates italiennes !
Mme Sophie Primas s ’ exclame.

Cette promotion des produits italiens à l’international ne se fait pas uniquement sur le haut de gamme : pour s’en convaincre, il suffit de regarder les ventes de prosecco, un alcool festif et relativement bon marché, qui sont en constante augmentation.
Qu’en est-il donc de notre stratégie à l’export, non pas seulement de nos fleurons nationaux, mais aussi de nos produits de cœur de gamme ?
Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à travailler avec le Sénat sur des solutions pour retrouver de la compétitivité, pour donner de l’air à nos paysans, pour soutenir la conquête de nouveaux marchés et, surtout, pour protéger le marché français des produits venus du lointain, à l’impact environnemental et social trop souvent catastrophique ?
Enfin, à propos des denrées venant de loin, que pouvez-vous nous dire de ce énième accord de libre-échange de l’Union européenne, cette fois-ci avec le Chili, visiblement sans clause miroir, alors que ce pays utilise des antibiotiques facteurs de croissance interdits depuis 2006 en Europe ? Cet accord va-t-il dans le sens de l’histoire ? N’est-on pas encore en train de sacrifier notre souveraineté alimentaire sur l’autel de notre souveraineté énergétique ?
J’ai cru comprendre en effet que le sol du Chili était riche en métaux rares, notamment le lithium, bien utile pour nos batteries…
L’agriculture européenne et française est-elle condamnée à n’être qu’une variable d’ajustement d’accords internationaux aujourd’hui assez massivement rejetés par nos concitoyens ?
Par ailleurs, je m’interroge sur le caractère peu démocratique de la démarche de la Commission européenne, qui saucissonne l’accord pour contourner les parlements nationaux.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et CRCE. – M. Franck Menonville applaudit également.
Monsieur Mérillou, premièrement, le problème des éleveurs laitiers ne relève pas forcément de la souveraineté : pour les matières grasses, nous sommes légèrement déficitaires, mais, pour les matières protéiques, nous sommes puissamment excédentaires, et la France est une grande puissance exportatrice laitière.
Nous devons assumer cette vocation de la France et le fait que nos producteurs laitiers participent de la balance du commerce extérieur de manière positive. En la matière, les données positives sont suffisamment rares pour qu’on les souligne.
Deuxièmement, vous avez abordé le sujet de la rémunération de la filière en amont, qui, je le répète, ne relève pas forcément de la souveraineté.
Nous avons essayé de mettre en œuvre des mesures dans le cadre des lois Égalim 1 et Égalim 2, dont nous n’avons jamais dit, ni moi ni mes prédécesseurs, qu’elles étaient parfaites. Toutefois, il me semble qu’elles ont permis d’avancer sur le sujet, malgré l’effet de retard qu’a subi la filière : les rattrapages que vous évoquez pour d’autres pays européens sont en train d’opérer en France : alors qu’un ou deux opérateurs tardaient à pratiquer les hausses de prix, ils l’ont fait récemment, ce qui est de nature à rassurer les acteurs.
Troisièmement, vous avez évoqué le risque principal dans la filière laitière, qui est lié à la pénibilité du travail : l’activité mobilise, en effet, 365 jours par an, le matin, parfois à midi et très souvent le soir. Il faudra donc réfléchir – nous le ferons avec le Sénat – à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’exercice du métier de producteur laitier, car le risque principal, vous avez raison de le dire, est celui de la décapitalisation, donc, à terme, de la perte de souveraineté.
Enfin, sur l’accord avec le Chili, ni le Gouvernement ni moi-même ne souhaitons faire de l’agriculture une variable d’ajustement. L’enjeu est de reconquérir des marchés. Vous avez mentionné la vocation exportatrice de la France ; on ne peut pas à la fois reconnaître cette vocation et refuser tout dialogue dans la cadre des accords internationaux.
Le sujet principal pour moi est celui des clauses de réciprocité, autrement dit des clauses miroirs, que l’on a tenté d’introduire sous présidence française de l’Union européenne et que l’on doit encore cranter. Nous avons commencé à évoquer le sujet, mais il faut aller plus loin, pour que, dans chaque accord, on puisse prévoir des clauses de réciprocité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce début d’année, les syndicats paysans sont unanimes. L’inquiétude est grande, avec une préoccupation majeure : il est difficile de savoir si nos agricultrices et les agriculteurs pourront vivre de leur travail en 2023.
Les crises récentes nous ont montré l’importance de protéger nos filières du tout-dérégulé. Déjà, en 2021, pendant la crise de la covid, les prix des intrants agricoles ont connu leur plus forte hausse de la décennie : soit 10 % pour les engrais, l’énergie et les lubrifiants, et 11 % pour l’alimentation des animaux.
Il y avait certes tout un contexte : une pression sur les marchés, des stocks et approvisionnements limités, des récoltes de céréales amoindries par les aléas climatiques, les sécheresses et le gel. Mais il y a aussi une inflation artificielle sur le marché de l’énergie qui vient de la spéculation sur les marchés boursiers. On le voit depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie : en plus d’une crise de l’approvisionnement, il y a des profiteurs de crise et il y a du trading.
C’est donc un poste de dépenses qui a augmenté de plus de 370 % entre 2021 et janvier 2022. Là encore, le marché financier impose les lois de la spéculation à des hommes et des femmes qui veulent vivre de leur travail.
Or ce système, le Gouvernement le cautionne. Vous avez refusé de rétablir les tarifs réglementés de vente pour toutes les TPE et PME, dont les exploitations agricoles. Et l’on s’étonne ensuite d’avoir une filière qui se demande si elle passera l’année !
Quant au plafonnement à 280 euros le mégawattheure, soyons sérieux : quand on passe de 42 euros le mégawattheure en 2021 à 280 euros en 2023, il y a de quoi mettre la clé sous la porte.
Monsieur le ministre, vous nous présenterez cette année une loi d’orientation et d’avenir agricoles. Les agriculteurs et agricultrices vous attendront sur toutes ces questions comme sur votre politique commerciale.
En l’espace d’un an, deux traités de libre-échange supplémentaires ont été conclus, l’un avec le Chili – mon collègue l’a dit –, l’autre avec la Nouvelle-Zélande. Je veux bien que l’on fasse une séquence émotion sur le recul de la filière bovine en France, mais rien qu’avec ces deux traités, pas moins de 12 000 tonnes de viande bovine seront introduites sur le marché européen, dopées à des substances interdites dans l’Union européenne.
Ensuite, il faudra dire à nos agriculteurs : « Il va falloir monter en gamme, sinon c’est fini, c’est la retraite anticipée ! » Du moins, si vous leur en laissez une, parce que, avec votre projet de réforme, c’est plutôt le chômage à 50 ans qui les attend…
Votre projet d’agriculture n’est pas celui du groupe communiste, vous l’aurez compris, mais cela n’empêche pas le débat. Toutefois, pour qu’il ait lieu, il ne faut pas tenir des propos en demi-teinte. Il faut assumer que vous défendez des importations venues de l’autre bout du monde, qui font subir une concurrence déloyale à la filière française et aux filières européennes.
Il faut assumer devant la jeunesse du pays, qui s’est mobilisée pour le climat, que vous signez pour des produits qui font le tour du monde, soit 20 000 kilomètres, pour arriver dans nos assiettes ; des produits que l’on sait faire ici avec une meilleure qualité.
Ce n’est pas là seulement le fait de politiques européennes face auxquelles la France serait impuissante. Lors de la signature du traité avec la Nouvelle-Zélande, c’est la France qui exerçait la présidence de l’Union européenne ; c’est la France qui s’est empressée de ratifier l’accord trois semaines avant la fin du mandat du président Macron. Ces accords « nouvelle génération », comme on les appelle, sont en réalité antidémocratiques, et le Parlement n’y a même pas été associé.
D’ailleurs, même pour les accords mixtes, on voit bien que vous n’avez pas envie de débattre. Il y a bien eu au Sénat, vous le savez, monsieur le ministre, une proposition de résolution adoptée à l’unanimité pour que le projet de loi de ratification du Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) soit inscrit à l’ordre du jour de la Haute Assemblée. Cela fait sept ans que l’Assemblée nationale a voté cet accord, alors que, à l’époque, elle n’était qu’une simple chambre d’enregistrement pour le Gouvernement. Et il n’y a toujours rien au Sénat !
En revanche, 90 % des dispositions prévues dans le Ceta s’imposent aujourd’hui à notre économie et à notre agriculture. Voilà sept ans qu’elles s’appliquent, sans un vote, sans bilan, sans recul, autant dire sans rien ! La dernière fois qu’un ministre m’a dit : « Laissez-moi vous emmener dans une exploitation agricole et vous verrez ! », il s’agissait de M. Riester, et j’attends encore… Monsieur le ministre, je réitère ma proposition : si vous trouvez une seule exploitation où le bilan est bon, je viendrai avec vous y passer la journée, sans caméra !
Les agriculteurs et les agricultrices méritent mieux que ce mépris, et il est temps que le débat ait lieu sur la politique commerciale que vous menez en réalité.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Monsieur le sénateur Gay, vous m’interrogez sur la compétitivité, notamment énergique, de la France. Puisque vous mentionnez la loi d’orientation et d’avenir agricoles, il faut différencier les sujets conjoncturels et structurels.
Premièrement, en matière énergétique, si l’on adopte un point de vue structurel à moyen et à long terme, l’enjeu est de pouvoir récupérer, si je puis dire, de la souveraineté, en évitant de dépendre des autres. C’est un long chemin, qui a été ouvert à l’époque du premier choc pétrolier, et je crois que cela fait cinquante ans que des responsables publics disent qu’il nous faut sortir de la dépendance au pétrole. Cela invite à la modestie, du moins en ce qui me concerne.
En tout cas, nous devons continuer à avancer sur ce chemin, de manière à pourvoir nous-mêmes à nos besoins énergétiques. Cela a fait l’objet d’autres débats, y compris dans cette assemblée, mais il est important de le redire, car l’enjeu est celui de la transition vers des énergies moins carbonées, vous le savez tout comme moi.
Deuxièmement, nous avons déployé un certain nombre de dispositifs, dont je sais qu’ils ne sont pas tous parfaits, pour essayer d’amoindrir le choc énergétique tel que nous le connaissons.
Je veux dire un mot des accords commerciaux. Vous me demandez d’assumer la situation : comme vous le savez, j’essaie toujours de le faire, y compris devant vous, et cela a aussi été le cas devant votre commission.
J’assume l’export et j’assume la vocation exportatrice de la France pour la filière porcine, pour la filière laitière, pour la filière vins et spiritueux et pour la filière céréales : ce ne sont pas des filières sans importance. Et si j’assume l’export, j’assume les échanges, donc aussi l’import. Sinon, le jeu ne fonctionnerait pas : les règles ne seraient pas les bonnes si l’on pouvait vendre aux autres sans accepter que leurs produits viennent chez nous.
Vous m’interrogez sur deux sujets.
Le premier, que vous définissez de manière assez juste et qui ne relève pas seulement du ministère de l’agriculture, est démocratique : il faut trouver au niveau européen des règles fixant en toute transparence les termes des accords et leurs avantages pour chacun. De ce point de vue, au niveau national, le gouvernement français ne fait en réalité que respecter les règles qui sont fixées dans les accords internationaux.
Le deuxième sujet porte sur le Ceta : pari tenu, je vous emmènerai dans des exploitations, en particulier laitières, où le bilan est positif, avec zéro importation de viande bovine et d’importantes exportations de produits laitiers vers le Canada. Je vous donne rendez-vous et nous irons ensemble, dans une exploitation laitière, même sans caméra !

Chaque fois que nous débattons des accords de libre-échange, on finit toujours par nous dire que nous sommes contre le marché, que nous voulons nous replier sur nous-mêmes et que l’on ne peut pas exporter sans importer.
Monsieur le ministre, de quand datent les débuts du commerce ? Celui-ci existe depuis la nuit des temps, du moins depuis l’Antiquité. Les hommes commerçaient bien avant que l’on mette en place les traités de libre-échange libéraux au moins-disant social et environnemental.
Personne, sur ces travées, n’invite la France à se replier sur elle-même. Nous voulons commercer avec d’autres, mais avec les mêmes règles du jeu. C’est tout ce que nous disons.
Et donc, ce qui fait débat, c’est que ce que l’on n’admet pas de la part de nos agriculteurs et de nos agricultrices, on le tolère pour des produits qui ont fait quatre fois le tour du monde !
Enfin, j’accepte de venir avec vous, monsieur le ministre. Mais attention ! Vous êtes le troisième à me le dire, après Julien Denormandie et Franck Riester…
M. Marc Fesneau, ministre. Je suis capable de tenir mes promesses !
Sourires.

Les deux premiers n’ont pas tenu parole ; j’espère que vous tiendrez la vôtre !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis près de vingt ans, plusieurs rapports mettent en exergue la dégradation de la compétitivité de notre agriculture et de nos industries de transformation. Le rapport dont il est question aujourd’hui dresse, de nouveau, ce constat alarmant. Si cette situation devait continuer à évoluer de la sorte, notre balance agricole pourrait – cela a été dit – devenir déficitaire.
Ainsi, en vingt ans, la France est passée du deuxième au cinquième rang mondial des exportateurs. En parallèle, les importations de produits ont doublé, jusqu’à représenter la moitié de nos assiettes. Chaque jour, la détresse de nos agriculteurs, de nos exploitants et de l’ensemble des acteurs du monde agricole se fait entendre et s’amplifie.
La question agricole est cruciale, particulièrement dans un contexte géopolitique troublé, puisqu’elle touche à notre souveraineté alimentaire, à notre capacité à produire notre propre nourriture aux conditions que nous choisissons, en toute autonomie.
La compétitivité de la ferme France est mise à mal par trois facteurs.
Le premier est le coût de la main-d’œuvre, plus élevé que celui de ses concurrents. Par exemple, le coût horaire français a augmenté de plus de 50 % entre 2000 et 2020, presque deux fois plus rapidement qu’en Allemagne.
Deuxièmement, la surtransposition des normes accentue les distorsions de concurrence. Pour rappel, l’Union européenne autorise 454 substances actives pour l’agriculture, mais, au niveau national, la France n’en autorise que 309.
Troisièmement, la fameuse stratégie haut de gamme, consistant à atteindre des marchés de niche, plus rémunérateurs, produit de nombreux effets dévastateurs, notamment une baisse de notre potentiel productif et une orientation vers des produits plus onéreux devenant inaccessibles à de nombreux Français. Cela entraîne aujourd’hui une perte sur le marché des produits de cœur de gamme et au développement des importations pour faire face à la demande. Quel non-sens !
Dégringolade des revenus, non-respect des accords de libre-échange, guerre des prix, mitage des terres agricoles, etc. : je m’arrêterai là sur le constat. Pourtant, monsieur le ministre, nous sommes, une nouvelle fois, sonnés par l’absence de tout un sursaut, de tout changement de braquet.
Comme je le rappelais, le 6 octobre dernier, dans une question qui vous était adressée, monsieur le ministre, mais qui est restée malheureusement sans réponse satisfaisante, les difficultés de la filière endivière illustrent parfaitement les problématiques de notre agriculture : baisse des prix, pénurie de main-d’œuvre dans certains bassins et hausse des coûts d’emballage et des besoins en eau.
Ce secteur, comme d’autres, voit sa compétitivité se dégrader face à une concurrence toujours plus forte qui ne s’embarrasse pas du pénalisant carcan normatif que nous imposons à nos agriculteurs.
Nous avions déjà, avec les membres du groupe Union Centriste, tiré la sonnette d’alarme à l’occasion de l’examen des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » lors du dernier projet de loi de finances. Les réponses n’ont pas été à la hauteur.
Un cap, une méthode et des moyens : voilà ce qu’il est urgent de fixer aujourd’hui !
Ce cap doit s’articuler autour de trois priorités très claires.
Premièrement, nous devons faire de la compétitivité-prix de notre agriculture une priorité nationale. Cela passera, très concrètement, par la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de réduction du coût de la main-d’œuvre en s’appuyant notamment sur une baisse des charges sociales par la montée en charge du dispositif des TO-DE.
Deuxièmement, je vous rappelle que notre agriculture est la plus propre du monde.
M. Daniel Salmon s ’ exclame.

Nous devons mettre un coup d’arrêt à la multiplication des charges et des normes pesant sur notre agriculture. Nous devons également garantir un principe de non-interdiction d’une substance active sans alternative et sans accompagnement. La filière betteravière en subit les conséquences aujourd’hui.
Troisièmement, utilisons mieux la marque France. Dans de nombreux secteurs, à l’image de la viticulture, nous bénéficions d’une compétitivité hors prix inégalée en raison du prestige de la marque France et de sa crédibilité qualitative.

Mme Amel Gacquerre. Pour finir, monsieur le ministre, je formulerai un vœu : qu’on agisse maintenant, ensemble, avant qu’il ne soit trop tard.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP . – M. Marc Laménie applaudit également.
Madame la sénatrice Gacquerre, vous parlez d’un cap, d’une méthode et de moyens. Nous devons nous fixer un cap : prendre conscience de la nécessaire reconquête de notre souveraineté. Vous l’avez dit, et le rapport faisant l’objet du débat de ce soir le souligne, c’est non pas depuis cinq ou dix ans, mais depuis vingt-cinq ans que nous avons laissé, structurellement, la ferme France perdre en compétitivité. C’est donc notre responsabilité collective que d’essayer de lui redonner cette perspective, en regardant, filière par filière, ce qu’il est possible de faire.
La méthode, selon moi, c’est celle de la planification. La seule option pour relever ce défi, c’est d’identifier les sujets, comme les impasses phytosanitaires – puisque c’est l’exemple dont il est question –, et les alternatives à proposer pour éviter une interdiction sans solution.
Et cela vaut pour tous les sujets. En particulier, par quoi, dans un certain nombre de filières, les matières carbonées peuvent-elles être remplacées ? Cela vaut en premier pour l’énergie.
Je le répète, c’est avec la planification que nous y arriverons. Lucidement, nous devons savoir où nous voulons aller, sans refuser l’obstacle, mais bien en essayant de le surmonter. Peut-être avons-nous, pendant vingt-cinq ans, essayé de louvoyer entre les obstacles : à la fin, nous nous retrouvons quand même face à un mur, comme celui qu’a évoqué Pierre Louault avec la culture de la betterave. Nous avons besoin d’alternatives.
Les moyens, enfin, sont ceux que nous devons développer, particulièrement par la recherche – je crois beaucoup à la recherche et à l’innovation. C’est par la recherche et l’innovation que nous trouverons des alternatives et des voies différentes. Par exemple, après-guerre, c’est avec la mécanisation et, un peu plus tard, avec les produits phytosanitaires que nous avons réussi à stabiliser notre agriculture et à rémunérer davantage les agriculteurs.
Ensuite, sur la question du haut de gamme et de la montée en gamme, l’un des objets du rapport, je ne partage pas ce point de vue. D’abord, près d’un tiers des exploitations françaises sont sous label et signe de qualité, et elles y trouvent de la rémunération.
M. Philippe Folliot approuve.
Nous avons besoin des appellations d’origine protégée (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et d’autres signes de qualité : vous en avez dans tous vos territoires ! Je ne connais pas un producteur sous signe de qualité qui y renoncerait pour produire dans d’autres gammes.

Sur la montée en gamme, ce que j’ai dit n’entre pas en contradiction avec vos propos : je ne suis pas contre la montée en gamme, mais, ce faisant, nous effectuons un choix qui met de côté ceux qui n’ont pas accès à ces produits-là. Forcément, faire un choix suppose de renoncer à d’autres. Peut-être ce choix a-t-il eu des conséquences démesurées, laissant sur le bord de la route un trop grand nombre de Français qui, aujourd’hui, n’arrivent plus à consommer des denrées produites en France.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, qualité versus quantité : le rapport que nous examinons aujourd’hui opposerait ces deux modèles. Je me refuse à entrer dans ce débat.
Notre agriculture est plurielle : conventionnelle, haute valeur environnementale (HVE), raisonnée, bio, etc. Il y a de la place pour tous.
En revanche, je suis pleinement conscient du contexte qui a conduit à la rédaction de ce rapport : nous ne sommes plus compétitifs. C’est évident, et cela ne date pas d’hier : nous y avons tous notre part de responsabilité. Avec un constat : la ferme France s’affaiblit et s’appauvrit. Les chiffres en attestent : 100 000, c’est le nombre d’exploitations perdues au cours des dix dernières années, avec un taux d’agriculteurs dans l’emploi passé de 7 % en 1982 à 1, 5 % en 2019. Quel jeune va choisir ce métier ? Avec des prix non rémunérateurs et des coûts qui connaissent une hausse exponentielle – a fortiori avec l’augmentation des matières premières –, qui sera tenté ?
Les agriculteurs sont les seuls qui ne décident pas du prix de leurs produits. On le leur impose en faisant fi de tous leurs coûts de production. Cette asphyxie s’ajoute aux éléments exogènes qu’ils subissent de plus en plus durement : aléas économiques, climatiques et sanitaires, dont on parle souvent dans cet hémicycle.
Ils subissent la volonté de la grande distribution. Cependant, on peut agir. En amont, les professionnels doivent avoir des liens directs avec les consommateurs. Connaître l’évolution des goûts, des besoins, construire des stratégies et s’adapter au marché est un minimum. Et pourtant, certaines filières n’ont pas su s’y conformer.
Nos voisins espagnols se sont structurés par secteurs avec des stratégies collectives très efficaces sur les marchés européens. En France, on se concurrence les uns les autres…
Prenons l’exemple des coopératives viticoles, nombreuses en Occitanie, que je connais bien. Sur un même territoire, on est incapable de faire une offre globale, en produisant les mêmes vins : chacun pour soi ! C’est une voie facile pour les cinq négociants qui, de ce fait, jouent de la division des producteurs. In fine, ce sont eux qui fixent les prix et créent une dépendance. Il en est de même, d’ailleurs, pour d’autres filières.
Il est urgent de définir des approches nationales et régionales pour décider de stratégies commerciales et d’image efficientes, car notre agriculture s’inscrit dans un marché mondial où la concurrence est exacerbée. Mais nous ne luttons pas, il est vrai, à armes égales. Les charges sociales et les normes diffèrent et nos agriculteurs pâtissent de ces inégalités.
Dans le rapport, il est question de lourdeurs administratives. Souvent mentionnés par les agriculteurs en difficulté, les formulaires s’accumulent et prennent une large part du temps de travail. Lorsque l’on sait qu’ils travaillent plus de soixante heures par semaine, la simplification, vieux serpent de mer plus qu’acte réel, s’impose vraiment.
Monsieur le ministre, vous défendez vos administrations, c’est naturel. Mais les faits sont là, et les dossiers sont là. Le dernier pour lequel on m’a interpellé date de la semaine dernière : un jeune agriculteur de 26 ans s’est vu refuser plus de 20 000 euros, faute d’avoir remis un formulaire, ou parce qu’il a oublié de cocher une case dans une demande au titre de la politique agricole commune (PAC).
Alors oui, il peut perdre son entreprise et s’énerver. Le droit à l’erreur devrait s’imposer, tout comme la bienveillance devrait être de mise. Cette lourdeur bien caractéristique de la France contribue à notre baisse de compétitivité. Monsieur le ministre, je vous invite à remplir un dossier PAC, à compter les arbres, par exemple.

Cochez les mêmes cases du parcellaire chaque année, alors que vous pourriez n’indiquer que ce qui a changé ! Je l’ai vécu en direct, pendant plus de huit heures.
Une fonctionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault, très impliquée, très humaine, m’a aidé, car il a fallu que je reconstitue mon dossier parcellaire, perdu par les services ! §Elle m’a expliqué que chaque pays membre a son propre logiciel. En Italie, d’où elle est originaire, il est bien plus simple. Pourquoi ?
Que voulons-nous réellement ? Les solutions existent. Certaines sont dans le rapport : mettre fin aux surtranspositions, augmenter les crédits à l’innovation et à la recherche ou encore développer les contrôles. Un exemple : la loi Égalim impose à la restauration collective 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % doivent être bio. Quel en est le bilan ?
La stratégie doit être globale. Quelle vision pour notre agriculture ? Quels enjeux, avec quels moyens ?
Lorsque, avec ma collègue Françoise Férat, nous avons proposé, comme première préconisation de notre rapport sur les suicides en agriculture, de faire de l’agriculture française une grande cause nationale en 2023, ce n’était pas symbolique : c’est au contraire primordial. C’est adresser un signal fort à nos paysans, c’est placer le foncier agricole, la formation, les paiements pour services environnementaux, l’eau ou encore la souveraineté alimentaire comme sujets forts à étudier ensemble plutôt qu’isolément. Le coup par coup nuit à l’efficacité. Les enjeux sont transversaux, les solutions doivent l’être aussi.
M. Pierre Louault applaudit.
Monsieur le sénateur Cabanel, vous évoquez le sujet de la rémunération, auquel nous essayons de répondre avec la loi Égalim. Je ne prétends pas qu’elle est parfaite – vous allez être saisis d’un texte qui complétera un certain nombre de ses dispositions –, mais je pense que nous allons dans le bon sens. Je ne connais d’ailleurs personne qui me dise que tel n’est pas le cas et mes homologues – européens, mais pas seulement – sont intrigués. Ainsi, les Canadiens sont intéressés par la construction du prix à partir du coût de production et de la matière première, c’est-à-dire par l’amont, et non par l’aval.
Nous avons aussi besoin, dans notre dialogue avec nos concitoyens, de ne pas nous laisser embarquer dans le débat inflation versus rémunération. Depuis plus de cinquante ans, on nous explique que ceux qui luttent contre l’inflation défendent une cause nationale. Or cela se fait généralement sur le dos des agriculteurs. En effet, il faut le dire, ces exigences, notamment environnementales, qui nous sont propres, ont un prix. Il faut mener ce combat, qui est une dimension de celui en faveur d’une juste rémunération.
Par ailleurs, vous avez raison, il faut davantage de coopération, entre filières et à l’intérieur de celles-ci. Je regrette parfois que ce ne soit pas davantage le cas. Ce ne sont jamais les filières qui bénéficient de cette situation, mais les tiers, qui en tirent le meilleur parti en termes de rémunérations et de prix.
J’en arrive au droit à l’erreur. Vous m’avez saisi du dossier que vous avez mentionné. Je défends les administrations non pas par principe, mais parce qu’elles accomplissent d’abord la volonté du législateur et du Gouvernement : j’en prends ma part. Rejeter la faute sur les administrations reviendrait à se défausser. Ce « génie français » relève de notre responsabilité collective : à chaque problème, nous créons une réglementation. La « PAC française » est bien plus élaborée que dans d’autres pays, mais c’est parce que nous avons entendu tenir compte de certaines attentes et différences. Nous avons créé un système complexe ; il n’est donc pas étonnant que les règles administratives le soient également. Il faut y travailler et avoir une forme de bienveillance, en expliquant mieux, par exemple, la PAC en cours de déploiement pour 2023. Les agriculteurs ne doivent pas être pris en défaut alors que leur bonne foi n’est pas mise en cause.

M. Henri Cabanel . Vous avez bien compris mon interrogation sur la complexité des règles administratives applicables à l’agriculture. L’administration est là pour nous contrôler, et les agriculteurs l’acceptent. Cependant, elle est aussi là pour nous aider. Lorsque je constate le désespoir d’un certain nombre d’agriculteurs, j’insiste, de nouveau, sur le besoin de bienveillance, à la fois de la part de l’administration et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Les agriculteurs ne sont pas simplement des chiffres dans les tableaux de la MSA : ce sont des femmes et des hommes.
Applaudissements sur des travées des groupes UC et CRCE . – MM. Laurent Somon et M. Franck Menonville applaudissent également.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’agriculture est une chance formidable pour la France. L’épidémie de covid-19 a rappelé son importance stratégique, ainsi que celle des agriculteurs, qui se sont engagés, tout au long de cet épisode de crise sanitaire, pour nourrir les Français alors qu’une partie du pays était à l’arrêt. À l’heure où l’équilibre du monde est déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, la souveraineté alimentaire est désormais non plus une option, mais une nécessité pour la France, qui a été et doit redevenir une grande nation agricole.
Néanmoins, pour atteindre cet objectif, il est indispensable de jeter un regard critique sur l’ensemble de notre politique agricole, de la production jusqu’au consommateur final. C’est tout l’objet du rapport d’information de la commission des affaires économiques réalisé par nos quatre collègues, dont je salue ici le travail. En effet, comment ne pas s’inquiéter lorsque l’on observe que la France se trouve être l’un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent, passant de la deuxième à la cinquième place parmi les exportateurs mondiaux en vingt ans ?
Dans le même temps, et comme le souligne le rapport, les importations alimentaires de la France ont doublé depuis 2000 et représentent, bon an, mal an, plus de la moitié des denrées consommées par les Français.
Notre production de viande bovine est, elle, en net recul. La France a perdu 11 % de son cheptel en six ans seulement, soit 837 000 vaches, et mon département de la Mayenne n’est pas épargné : en dix ans, on est passé de 600 000 bovins à 530 000.
Cette situation est particulièrement inquiétante au regard des importations de viande bovine, qui ont, elles, augmenté de 15 % sur un an, entre 2021 et 2022. Ainsi, un quart du bœuf consommé en France est importé, contre moins de 20 % il y a quelques années.
Bien sûr, comme le souligne également le rapport, de nombreux facteurs entrent en jeu pour expliquer cette situation. Le non-renouvellement générationnel des agriculteurs est problématique : entre 1982 et 2019, leur nombre a été divisé par quatre, passant de 1, 6 million à 400 000.
Le constat étant dressé, il nous faut désormais mettre sur la table les solutions qui permettront de redresser la ferme France et de préserver notre titre de puissance agricole. Nous devons pour cela susciter un choc de compétitivité, qui passe d’abord par la nécessaire simplification des normes applicables aux agriculteurs. Il est indispensable de leur donner de la clarté et de la visibilité sur des normes sanitaires, environnementales et administratives qui ne cessent d’évoluer.
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple récent, l’Union européenne est en train de se pencher sur une révision des normes de commercialisation visant à changer les règles d’étiquetage des modes d’élevage des volailles, ce qui menace désormais la production de volailles fermières, particulièrement présente dans l’ouest de la France.
Pendant ce temps nos accords de libre-échange autorisent l’importation de denrées alimentaires dont les normes de production sont loin des standards européens, avec un coût, logiquement, réduit.
Nous sommes donc en train, d’un côté, d’asphyxier nos agriculteurs sous des normes et des surtranspositions que nous n’exigeons pas des pays hors Union européenne et, d’un autre côté, de créer deux France : une France qui peut s’offrir des produits européens plus chers en raison des normes et une France qui achète et consomme des denrées importées qui échappent à certains contrôles. Cela doit cesser.
Il nous faut aussi engager d’urgence un choc de simplification pour notre agriculture et une révision des accords de libre-échange. Ces deux conditions sont indispensables pour permettre à nos concitoyens de consommer français à un coût compétitif.
Le défi du renouvellement générationnel auquel est confronté notre monde agricole doit également faire l’objet d’une action urgente. Cela passe par le renforcement de l’accompagnement des jeunes agriculteurs, notamment avec la dotation jeune agriculteur (DJA). Les banques doivent également jouer leur rôle en mettant à leur disposition des interlocuteurs véritablement à l’écoute de leurs projets.
Enfin, le dernier chantier est incontestablement celui de l’adaptation de notre agriculture au réchauffement climatique, que ce soit en matière d’utilisation de la ressource en eau ou de gestion des catastrophes naturelles. Il est indispensable de soutenir les agriculteurs qui investissent dans des équipements d’irrigation moins consommateurs en eau et plus performants. Il convient aussi de mieux protéger nos exploitations agricoles dans le cadre du dispositif de catastrophes naturelles. Comme bon nombre d’entre vous l’ont constaté, les grêles ont causé des dégâts importants sur nos cultures au printemps dernier – d’ailleurs, monsieur le ministre, vous étiez alors venu dans mon département. Il est donc de notre devoir d’accompagner et de mieux soutenir ceux qui subissent ces pertes, comme cela a été fait avec la réforme du système d’assurance récolte.
En résumé, il nous faut nous donner les moyens de travailler avec nos agriculteurs à une législation plus équilibrée et à des accords internationaux plus justes. Il y a donc du pain sur la planche, monsieur le ministre !
Monsieur le sénateur, sur le règlement relatif à la commercialisation des volailles, il s’agit non pas d’un sujet sur lequel l’Europe est seule face au reste du monde, mais d’un sujet proprement européen. En effet, un certain nombre d’États membres demandent à réviser ces normes de commercialisation. Nous sommes en train, entre Européens et à l’intérieur des frontières de l’Union européenne, de nous efforcer de préserver le label « élevé en plein air ». En d’autres termes, il s’agit non pas de descendre, mais de monter en gamme.
Nous entendons défendre, dans le cadre européen, notre spécificité, car nous sommes le pays qui a le plus développé la volaille élevée en plein air. Je ne peux pas en dire plus à ce jour, puisque nous sommes dans une phase de négociations, mais notre volonté est de défendre le modèle sur lequel nous nous sommes appuyés pour développer un certain nombre d’élevages.
Je reviens sur les accords de libre-échange. Une considération générale : il s’agit, premièrement, d’affermir la capacité et la vocation exportatrices de notre pays, que nous avons en partie perdues ; deuxièmement, d’obtenir des clauses de réciprocité ; troisièmement, face à certains autres pays européens, aux contraintes normatives comparables, il s’agit d’adopter une politique beaucoup plus offensive sur les marchés extérieurs. Dans ce cadre, nous aurions intérêt à étudier les possibilités de reconquérir des marchés émergents.
Enfin, vous avez mentionné l’installation des jeunes agriculteurs. Je vous prie de m’excuser de le dire quelque peu brutalement, mais le montant de la DJA ne me semble pas être le seul sujet. Tout d’abord, près de la moitié des jeunes qui s’installent n’en bénéficient pas. Se pose donc la question de son ciblage. Ensuite, compte tenu des montants de capitaux à engager, quel que soit le montant de la DJA, il faut rassurer le jeune agriculteur sur son revenu, ainsi que sur ses capacités à rembourser les emprunts et à faire face au dérèglement climatique. Voilà les sujets autour desquels il faudrait plutôt travailler. Dans ce monde déréglé, climatiquement, géopolitiquement, économiquement, il faut s’assurer que le système tienne à trente ans. C’est comme cela que nous installerons de jeunes agriculteurs.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre agriculture façonne le paysage français. Elle fait partie de notre ADN national. Elle est aussi la base de notre patrimoine culinaire, avec ses fromages, ses cultures, ses viandes, ses vins, ses terroirs et sa diversité. Cependant, le constat qu’on peut poser sur l’agriculture française devient préoccupant. Notre collègue Laurent Duplomb, dans son rapport du 28 mai 2019, intitulé La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ?, mettait déjà en évidence le déclin de notre agriculture.
Force est de constater que rien n’a changé, et que la crise actuelle a même renforcé certaines difficultés, notamment dans l’élevage. Notre production stagne, voire recule dans certains secteurs, depuis les années 1990. Nous sommes le pays dont les parts de marché à l’export ont connu les plus fortes baisses depuis 2000, en raison d’une compétitivité qui s’effrite.
En parallèle, nos importations progressent : elles ont plus que doublé en vingt ans, et nous importons aujourd’hui pour 63 milliards d’euros de denrées alimentaires.
Pourtant, notre agriculture dispose d’un potentiel incontestable. En effet, la France est le principal producteur européen, loin devant l’Italie et l’Allemagne. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire d’une telle évolution.
Il est urgent d’agir. Je salue le travail de nos trois rapporteurs, qui soulignent la baisse de compétitivité en dressant quatre constats. Ce travail essentiel et pertinent, qui s’appuie sur la réalité de cinq filières, les a conduits à formuler vingt-quatre propositions.
La période actuelle nous oblige à réaffirmer notre souveraineté alimentaire. Nous devons agir rapidement, car notre autonomie alimentaire est mise en péril. À titre personnel – cela a été évoqué par notre collègue Amel Gacquerre –, je pense que la stratégie de montée en gamme prônée, notamment, par le Président de la République dans son discours de Rungis, ne peut définir à elle seule notre futur agricole. Nous devons être présents sur tous les créneaux et sur toutes les gammes, le haut de gamme comme l’entrée de gamme, pour répondre aux attentes de tous les consommateurs. L’augmentation des importations sur certains produits et le recul du bio sont des signes plutôt clairs. Cette tendance s’est d’ailleurs accrue depuis le début de la crise ukrainienne.
Après la lecture du rapport, j’ai choisi de mettre en lumière un problème qui a été très bien identifié, celui des surtranspositions trop nombreuses et des lois franco-françaises trop strictes. À titre d’exemple, 454 substances actives sont autorisées au sein de l’Union européenne, alors que la France n’en admet que 309. Nous ne pouvons pas nous imposer des règles dont nos voisins s’affranchissent ; nous devons plutôt exiger que les produits que nous importons soient soumis aux mêmes normes que celles qui s’appliquent à ceux de nos agriculteurs.
Il faut donc poursuivre cette harmonisation européenne pour éviter la concurrence intra- et extraeuropéenne, qui nous pénalise. C’est pourquoi il me semble que la deuxième recommandation du rapport, à savoir donner corps au principe de l’arrêt des surtranspositions grâce à une mission confiée au Conseil d’État, est très intéressante.
L’exemple de la filière betteravière illustre bien ce sujet. Ainsi, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient d’interdire la dérogation concernant les néonicotinoïdes. La filière est aujourd’hui dans une impasse technique pour lutter contre les pucerons verts et la jaunisse.
Je rappelle que la France est le premier producteur de sucre de l’Union européenne.
Cet exemple met en évidence, une nouvelle fois, la mise en péril de notre souveraineté par des législations mal adaptées aux réalités des territoires.
Il est absolument indispensable d’élaborer préalablement des études d’impact et de s’assurer de l’existence de solutions alternatives permettant d’éviter les impasses techniques qui fragilisent durablement des filières entières.
Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement, et, bien sûr, vous n’êtes pas comptable de cette situation dégradée. Il faut donner à nos agriculteurs les moyens d’être performants et compétitifs. Nous serons évidemment à vos côtés pour atteindre cet objectif.
Ne faisons pas de notre agriculture ce que nous avons fait de notre industrie ! Il est urgent d’agir !
Les agriculteurs français sont motivés et passionnés ; ils aiment leur métier, mais les surcharges administratives et la complexité de nos politiques publiques en atténuent l’attractivité. Il est important de redonner du sens à cette profession et d’ouvrir des perspectives aux jeunes, pour que nombre d’entre eux acceptent d’exercer ce merveilleux métier et de s’y investir.
Monsieur le ministre, comptez-vous utiliser les recommandations de ce rapport transpartisan comme base de travail pour le pacte et la loi agricoles que vous êtes en train de préparer ?
Applaudissements sur des travées du groupe UC.
Monsieur le sénateur Menonville, je vous remercie pour votre question, d’autant que ce sujet vous tient, comme à vous tous, mesdames, messieurs les sénateurs, à cœur.
Tout d’abord, sachez que je ne suis pas de ces ministres qui encouragent les surtranspositions de directives européennes dans notre droit.
Pour autant, il est vrai que notre pays a toujours eu tendance à considérer qu’il devait être la figure de proue et à la pointe du progrès sur un certain nombre de sujets. Cela fait près de vingt-cinq ans que nous pensons qu’en agissant les premiers, les autres États européens suivront. Sauf que ce n’est généralement pas le cas et que, dans l’intervalle, la France perd en compétitivité ou en souveraineté.
En vérité, ces questions de normes doivent être débattues à l’échelon européen. Quand une décision est prise à ce niveau-là, notre pays, en particulier nos agriculteurs, est en mesure de le comprendre, sous réserve que l’on ait cherché à définir des clauses de réciprocité dans le cadre des accords commerciaux. En tout cas, vous me trouverez toujours à vos côtés lorsque vous aborderez la question dans cette perspective.
La France s’inscrit aussi dans un cadre juridique national – vous avez suggéré un éventuel recours au Conseil d’État. Or j’observe que les principes de précaution et de non-régression ne datent pas d’hier – ils n’ont été prescrits ni par le précédent gouvernement, ni par celui d’avant, non plus que par le gouvernement antérieur. Pour un certain nombre d’entre eux, ces principes découlent de la Constitution. Gardons-nous par conséquent de penser qu’il est facile d’œuvrer en la matière.
En tout cas, chaque fois que l’on saura se convaincre qu’il n’est pas nécessaire de surtransposer et que nous ne sommes pas nécessairement meilleurs que les autres dans tel ou tel domaine, je serai tout à fait disposé à défendre nos intérêts au niveau européen.
Par ailleurs, je suis d’accord avec vous, monsieur le sénateur, au sujet de la montée en gamme de notre agriculture. Il convient de la réussir, car elle permettrait d’assurer une rémunération supplémentaire à près d’un tiers des exploitants agricoles.
Prenons l’exemple de la filière avicole : oui, nous avons besoin de développer de nouveaux élevages de volailles pour garantir la souveraineté alimentaire de notre pays. J’assume pleinement cette idée : on ne peut pas à la fois se plaindre de perdre en souveraineté, d’exporter du CO2 et des pratiques que l’on juge inacceptables, et refuser l’implantation de nouveaux élevages sur notre territoire. Il y aurait là une contradiction majeure que je n’assumerai pas en tant que ministre. En revanche, je le répète, je suis prêt à me battre pour que la France retrouve sa souveraineté agricole.
Autre exemple, …
Je vous répondrai alors tout à l’heure sur la marque France !
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de la compétitivité de la ferme France suppose que l’on se mette d’accord sur la définition même des termes.
Dans le rapport dont nous débattons ce soir, la compétitivité est définie via des prix, des volumes et des coûts de production sur un marché internationalisé.
Or cette définition doit nous interpeller. On ne peut pas continuer à recourir à cette notion de compétitivité pour occulter des réalités multiples qui ont in fine un impact sur des dépenses assumées de façon collective.
Que devient notre compétitivité si l’on intègre le coût caché des pesticides, estimé entre 370 millions d’euros et plusieurs milliards d’euros par an pour la France ? Que devient-elle si l’on prend en compte l’impact des engrais azotés sur le climat, l’eau, les sols ? A-t-elle encore un sens si l’on omet de tenir compte des conséquences des pratiques agricoles sur les pollinisateurs et la fertilité des sols, dont nos cultures dépendent, et d’analyser leurs incidences sur l’emploi ou la qualité nutritionnelle des aliments ?
Nous interroger sur cette fameuse « compétitivité » devrait aussi nous conduire à évoquer les nombreuses subventions publiques, qui mettent le système agro-industriel sous perfusion : rappelons qu’à peine 1 % des 23, 2 milliards d’euros de fonds publics versés chaque année ont un véritable effet sur la réduction de l’utilisation des pesticides.
Certes, nous ne pouvons pas nous affranchir en un jour du marché mondial et de ses règles, mais nous pouvons agir pour mettre fin aux accords de libre-échange, négocier des clauses miroirs et encourager à la fois une régulation des marchés et la relocalisation de notre alimentation.
Alors que de plus en plus de citoyens sont en situation de précarité et sont contraints de fonder leurs choix alimentaires sur les seuls prix, il est de notre responsabilité de garantir l’accès de toutes et tous à des produits sains et durables. À cet égard, le rapport de notre collègue Mélanie Vogel sur la sécurité sociale écologique du XXIe siècle, dont un chapitre portait sur l’alimentation, a permis d’esquisser quelques pistes.
Vous l’aurez compris, pour nous, la solution n’est pas de subventionner encore et toujours la supposée compétitivité d’un modèle agro-industriel à bout de souffle. Il nous faut, au contraire, garantir une véritable compétitivité, incluant l’ensemble des externalités, positives ou négatives, de nos systèmes agricoles.
Je veux insister ici sur la nécessité d’un modèle agricole qui tienne compte de cette notion de performance globale, en termes à la fois de production, d’emploi, de respect de l’environnement, de santé publique et de relocalisation. Je parle évidemment ici, cela ne vous surprendra pas, de l’agriculture biologique.
Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.

Ce mode de production, qui est en difficulté aujourd’hui, demeure pourtant plus que jamais compétitif. Il s’agit d’une production locale, consommée en grande partie localement, qui permet de stocker l’eau dans les sols lorsque nous en avons besoin, pratique indispensable à l’heure où nous faisons face à des sécheresses de plus en plus intenses.
En respectant la saisonnalité, l’agriculture biologique évite aux agriculteurs de chauffer leurs serres, ce qui n’est pas neutre au moment où explosent les prix de l’énergie. Elle leur permet aussi de se passer des engrais azotés, dont le coût a flambé. Ce mode de production est en définitive moins sensible à l’inflation et aux aléas géopolitiques.
Pourtant, face à un ralentissement de la demande, il semble que le Gouvernement ait fait le choix de laisser ce modèle porteur de solutions d’avenir dans la difficulté.
Car ce sont bien des politiques publiques inadéquates qui nous ont conduits à la situation actuelle. Je citerai notamment la promotion du label HVE, qui n’apporte pourtant aucune véritable garantie et qui entretient la confusion sur les atouts de l’agriculture biologique pour l’environnement et la santé.
Je pense aussi à la fin de l’aide au maintien dans le cadre de la nouvelle PAC et, donc, à l’absence de rémunération des services écosystémiques rendus par l’agriculture biologique. Il faut également mentionner le soutien minimal de l’État aux acteurs de la filière, en particulier au travers de l’Agence Bio, dont le rôle d’appui à la demande est pourtant primordial.
Je pourrais continuer longtemps. Aussi, je vous invite à consulter un rapport de la Cour des comptes pointant bien d’autres politiques qui n’ont cessé de pénaliser l’agriculture biologique ces dernières années.
Alors que – ce ne sont que quelques exemples – 489 millions d’euros d’aides à l’achat ciblées sur l’alimentation animale ont été débloqués dans le cadre du plan de résilience et que 270 millions d’aides d’urgence en faveur de la filière porcine conventionnelle ont été mis sur la table, rien n’a été fait pour soutenir l’agriculture biologique depuis un an.

Aujourd’hui, nous constatons que de nombreux agriculteurs cessent de produire bio ou arrêtent leur activité, et que des outils de transformation se perdent. Devrons-nous demain importer du bio, parce que nous aurons laissé une filière entière se désorganiser ?
Ce soir, nous souhaitons vous interpeller, monsieur le ministre, sur la mise en place d’un plan de soutien pour l’agriculture biologique. Il est plus qu’urgent de mettre en œuvre tous les moyens pour aider cette filière, au travers notamment d’aides d’urgence à l’actif et d’un plan ambitieux de communication.
Une partie des financements destinés au développement du bio, comme les aides à la conversion ou le fonds Avenir Bio, pourrait a minima être orientée vers les entreprises et les exploitations en difficulté, dans l’attente de réponses plus structurelles. Le Gouvernement dispose d’une multitude de leviers : qu’attendez-vous pour les actionner ?
Confrontés à l’effondrement de la biodiversité – il est en cours ! –, allons-nous nous mettre la tête dans le sable durant quarante ans, comme nous l’avons fait face au réchauffement climatique ? Certains ici pensent peut-être qu’il y a encore beaucoup trop d’insectes. Ce n’est pas mon cas !
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Monsieur le sénateur, vous avez abordé la notion de compétitivité sous un angle qui vous est propre.
En vous écoutant, je n’ai pas pu m’empêcher de penser – pardonnez-moi, j’espère ne pas vous offenser – que c’est cette manière de voir les choses qui nous a mis dans la situation que nous connaissons actuellement en matière énergétique. En effet, on nous a longtemps expliqué que la solution passait par les énergies renouvelables, et pas par le nucléaire, sans pour autant nous dire un traître mot sur les moyens de parvenir à cette transition.
Vous venez de nous expliquer que la solution consistait à développer l’agriculture biologique et que ce mode de production réglerait tous les problèmes. Monsieur le sénateur, excusez-moi de le dire aussi clairement, mais je refuse que la France se retrouve dans une impasse du même ordre en matière de souveraineté alimentaire.
Il faut tirer la leçon de ce qui s’est passé ces dernières années. Cela ne signifie pas pour autant que je n’ai pas envie – ou qu’il n’est pas nécessaire – de soutenir l’agriculture biologique. Mais, par pitié, essayons de ne pas opposer les systèmes !
Le problème de l’agriculture biologique, c’est la demande.
Protestations sur les travées du groupe GEST.
Vous aurez beau tourner le problème dans tous les sens, rien n’y fera ! Il faut se confronter aux réalités du marché et reconnaître qu’il n’est pas viable de produire des aliments dont les consommateurs ne veulent pas.
Il convient aujourd’hui de réfléchir à une meilleure définition des segments de marché. Cessons d’encourager la filière bio à produire en vain, et travaillons plutôt à trouver le moyen de la rendre attractive auprès des consommateurs. Sinon, on va droit dans le mur !
Monsieur le sénateur, nous ne sommes pas sur une île déserte et on ne peut pas se référer indéfiniment à la seule théorie économique.
M. Ronan Dantec s ’ exclame.
Vous nous avez expliqué que la compétitivité devait se concevoir à l’échelon local. Je suis désolé, mais quand bien même nous serions sur une île déserte, nous vivons dans un monde où il faut bien nourrir les gens, c’est-à-dire les Français, bien sûr, mais aussi les hommes et les femmes qui vivent au-delà des frontières européennes – c’est dans notre intérêt.
Veillons à avoir les deux pieds dans le réel sur un tel sujet.
En tant qu’élu de la région Bretagne, monsieur le sénateur, que me proposez-vous ? Me suggérez-vous de supprimer les aides à la filière porcine ou les aides conjoncturelles à l’achat, qui ont profité tant à l’agriculture biologique qu’à l’agriculture conventionnelle ?
On peut imaginer toutes les ruptures que l’on veut, mais, à un moment donné, il y a des réalités qui s’imposent. À l’heure actuelle, il nous faut encourager la transition écologique de l’agriculture – je l’assume parfaitement –, tout en évitant d’imposer un modèle unique qui nous place dans une impasse en termes de souveraineté.
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.

La réalité première, je vous le rappelle, monsieur le ministre, c’est l’état de la biosphère.

Je suis effectivement élu de la région Bretagne, plus précisément du département de l’Ille-et-Vilaine, où seulement 3 % des masses d’eau sont de bonne qualité. Aujourd’hui, on est obligé de fermer certains ouvrages permettant le captage de l’eau, non pas parce qu’il n’y en aurait plus, mais parce qu’elle est devenue impropre à la consommation à cause du métolachlore et de l’inefficacité des plans antinitrates et anti-algues vertes qui se sont succédé année après année, sans résultat.

On peut continuer à affirmer que le marché est au-dessus de la biosphère, mais je crois que l’on est en train de se faire rattraper par la patrouille !
Malgré toutes les alertes, celles du Giec notamment, je suis triste de constater que les rapports sur le climat ou la biodiversité s’empilent, et que l’on continue d’aller droit dans le mur…
Mme la présidente de la commission s ’ agace.

J’estime que nous sommes déjà dans une impasse et qu’il est temps de se poser les bonnes questions.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec 70 milliards d’euros d’exportations dans les secteurs agricole et agroalimentaire, la France demeure un grand pays d’agriculture. Elle reste le principal producteur européen, loin devant l’Allemagne et l’Italie.
Pourtant, le rapport dont nous débattons ce soir dresse un constat alarmant : la ferme France serait en déclin.
Si nous pouvons être en désaccord avec un certain nombre de préconisations figurant dans ce rapport, je tiens néanmoins à reconnaître et à saluer sa grande qualité. De ce point de vue, je remercie les rapporteurs pour leur travail.
Cela étant, le rapport met en cause la montée en gamme promue par les pouvoirs publics. Elle mettrait en péril notre potentiel productif, rendrait l’alimentation d’origine française inaccessible aux plus modestes, sans pour autant favoriser son exportation, puisqu’on assisterait au contraire à une explosion des importations.
La France serait donc coupable d’avoir sacrifié la compétitivité de son agriculture à sa montée en gamme, coupable de privilégier la qualité de son alimentation à la quantité.
La question que ce rapport semble poser en filigrane est celle, dépassée selon moi, de l’arbitrage entre production de masse et production de qualité, quand il nous faudrait plutôt nous interroger sur les moyens de concilier ces deux objectifs.
Le secteur agricole est aujourd’hui au carrefour de nombreux enjeux, dont on ne peut faire abstraction.
En plus de devoir garantir la souveraineté alimentaire de notre pays, il doit répondre à une exigence croissante de qualité et s’orienter vers des pratiques plus durables et soucieuses du climat. Cela correspond à une attente sociétale forte que le monde agricole aussi bien que politique ne peut ignorer. Mais elle constitue également la condition de la survie et de la pérennité même de la ferme France.
Aussi, dissocier la question des volumes de production de celle de la manière de produire conduirait immanquablement à revenir sur les nombreuses transitions engagées, sans compter qu’en plus de sa compétitivité cela mettrait en péril notre modèle agricole lui-même.
Alors que les contraintes auxquelles sont confrontés nos agriculteurs sont déjà nombreuses, répondre à ces enjeux suppose, il est vrai, d’importants efforts de leur part qui, à défaut d’accompagnement, grèveraient considérablement leur compétitivité.
Car, si l’on demande aux agriculteurs de s’adapter et d’anticiper les bouleversements qu’engendre le changement climatique, c’est avant tout pour leur permettre de les surmonter.
La survie et la pérennité de notre modèle agricole sont au cœur de la politique du Gouvernement.
C’est notamment pour mieux protéger les agriculteurs face à ces changements et à leurs conséquences qu’a été engagée une réforme de l’assurance récolte. Ce sont près de 560 millions d’euros qui sont consacrés à sa mise en œuvre.
Accompagnés, les agriculteurs le sont aussi dans le cadre européen, un niveau qui leur permet non seulement d’emprunter la voie nécessaire des transitions, mais de le faire en préservant leur compétitivité. Un tel cadre sécurise financièrement ceux d’entre eux qui s’inscrivent dans cette démarche.
Je veux souligner, à titre d’exemple, le soutien apporté au développement de l’agriculture biologique par la nouvelle PAC, avec pas moins de 340 millions d’euros alloués en moyenne par an.
Plus largement, l’Union européenne contribue à établir les fondements d’une concurrence équitable entre ses États membres. La France, lors de sa présidence de l’Union européenne, en a profité pour faire de la question de la réciprocité des normes un impératif.
Le rapport dresse donc un bilan juste et sans appel des politiques menées depuis les années 1990, mais occulte le tournant pris depuis 2017 pour renforcer notre agriculture, soutenir nos agriculteurs dans leur transition et préparer la ferme de 2030.
Préparer la ferme France de demain implique d’investir.
Il faut tout d’abord investir pour innover. Avec les plans France Relance et France 2030, plus de 4 milliards d’euros sont dédiés à l’innovation.
Il convient aussi d’investir pour produire en quantité et en qualité : je pense évidemment aux 150 millions d’euros mobilisés dans le cadre du plan Protéines, mais également à la mise en œuvre du plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes, qui doit contribuer à une hausse de la production.
Préparer la ferme France de demain, c’est sécuriser les revenus agricoles et garantir des prix rémunérateurs à nos agriculteurs. Depuis les lois Égalim 1 et 2, nous faisons de la question du revenu agricole une priorité.
Préparer la ferme France de demain, c’est aussi veiller à l’accès de tous, dont les ménages les plus modestes, à une alimentation de qualité. Le « chèque alimentation durable » ou encore les dispositions adoptées dans le cadre de la loi Égalim et de la loi Climat et résilience vont dans ce sens.
Préparer la ferme France de demain, c’est enfin veiller au renouvellement des générations. Cela passe par la formation, le soutien à la transmission et à l’installation, car il n’y aura pas de ferme France sans agriculteur.
Face à ces nombreux chantiers, l’État, plus que jamais, se doit d’accompagner et de soutenir les acteurs dans leur transformation. C’est le sens de l’action que mène la majorité, aux côtés du Gouvernement.
Donc, oui au choc de compétitivité et au soutien aux exportations, mais sans pour autant revenir sur notre ambition, celle de favoriser une agriculture plus innovante, durable et performante.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.
Madame la sénatrice Schillinger, en abordant ces différents sujets, vous avez, au fond, rappelé ce que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis bientôt six ans.
Force est tout d’abord de reconnaître que le chemin pour retrouver notre souveraineté et notre compétitivité est long. L’un d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, a affirmé tout à l’heure que je n’étais pas forcément comptable de la situation. Peut-être, mais je me sens comptable de ce que notre pays a fait depuis trente ans, parce qu’il serait trop facile de ma part de rejeter la faute sur les autres. Il appartient à chacun de faire sa part du chemin.
Je voudrais souligner plusieurs points.
D’abord, vous l’avez mentionné, madame la sénatrice, il faut accorder une place importante à l’innovation, à la recherche et à l’expérimentation. En effet, il est nécessaire de convaincre les agriculteurs que c’est de cette manière que nous trouverons des solutions, des alternatives, par exemple, en matière de transition, aux produits phytosanitaires. C’est la seule voie qui nous permettra d’avancer, d’une part, et de retrouver notre souveraineté et notre compétitivité, d’autre part.
Ensuite, vous avez évoqué la réforme du système assurantiel, qui a été votée ici, au Sénat, et qui fait suite aux travaux que vous aviez conduits. De mon point de vue, ce nouveau dispositif est solide.
Assurer les agriculteurs contre les risques passe non seulement par la mise en place du système assurantiel dont je viens de parler, mais aussi par notre capacité à leur garantir que, dans trente ans, le système que nous mettons en œuvre aura résisté et qu’il permettra de faire face au dérèglement climatique et aux grandes transitions qui sont à l’œuvre. Je pense évidemment à la problématique de l’accès à l’eau ou à celle du changement des pratiques.
Un certain nombre de modes de production vont devoir évoluer avec le réchauffement climatique. Je vous rappelle, monsieur le sénateur
M. le ministre se tourne vers M. Daniel Salmon.
N’oublions pas que l’enjeu principal est de réussir à mener à bien cette transition. Il ne suffit d’ailleurs pas de dire que c’est facile…
Tout à fait, monsieur le sénateur. Je voulais simplement insister sur le fait qu’il faut assumer cet engagement sur la voie des transitions, d’autant que cela implique du temps et un accompagnement des hommes et des facteurs de production.
Pour finir, madame la sénatrice Schillinger, vous avez fait allusion au cadre européen. Je suis favorable à ce qu’un certain nombre de problèmes, notamment lorsqu’ils touchent à notre souveraineté, soit résolus à cet échelon. À l’aune de la guerre en Ukraine et de la crise de la covid-19, je pense en effet que c’est à ce niveau-là que l’on parviendra à trouver des solutions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour notre collègue Jean-Claude Tissot, qui est le chef de file de notre groupe sur les sujets agricoles, et que je remplace ce soir au pied levé, car il est, hélas ! confronté à un drame personnel.
Comme je l’ai dit en introduction, notre rapport dresse un constat sans appel, rappelé par beaucoup d’intervenants : la ferme France décline. Partout sur nos territoires, les agriculteurs nous interpellent, nous font part des difficultés, parfois insurmontables, que rencontrent celles et ceux qui nous nourrissent et ne sont pas rémunérés à hauteur de leur engagement.
Notre agriculture et notre gastronomie sont réputées dans le monde entier. La qualité de nos denrées, notre savoir-faire ne sont plus à démontrer.
Pourtant, à l’heure où le commerce international des produits agroalimentaires n’a jamais été aussi dynamique, nous ne sommes pas au rendez-vous.
Nous sommes le seul grand pays agricole dont les parts de marché reculent quand, dans le même temps, nos importations de produits agricoles explosent. En vingt ans, nous sommes passés du deuxième au cinquième rang mondial en termes d’exportations. Notre excédent commercial résulte pour l’essentiel du seul effet prix de nos exportations, notamment des vins et spiritueux, filière de plus en plus concurrencée.
Mes chers collègues, nous devons nous inquiéter d’une telle situation, d’autant que le contexte géopolitique est tendu et l’inflation galopante. Nous le constatons, le prix des denrées alimentaires s’envole et certaines viennent à manquer.
Plus que jamais, nous devons repenser notre modèle agricole pour tendre vers une pleine souveraineté et ne pas dépendre de l’extérieur pour notre alimentation. Il n’y a rien de pire que les peuples qui ont faim ! Nous devons être en mesure de nourrir convenablement les Français, quelle que soit leur classe sociale.
Nous devons reconnecter l’agriculture avec les attentes des consommateurs. Notre pays, grande puissance agricole, le grenier de l’Europe, en est capable sous réserve d’une réelle volonté politique.
Pour ce faire, il est impératif de réarmer la ferme France en lui donnant les moyens de ses ambitions, les moyens d’être compétitive.
Redevenir compétitif, c’est d’abord redevenir attractif. Aujourd’hui, face aux difficultés financières, matérielles ou techniques, beaucoup d’agriculteurs ne s’en sortent plus. Précarité et agribashing n’incitent pas à l’installation de nouveaux exploitants. En ce sens, les chiffres publiés par la Mutualité sociale agricole ces dernières années sont significatifs et doivent nous interpeller.
Réforme de l’enseignement, du foncier, juste rémunération des agriculteurs ou encore revalorisation des retraites agricoles : les chantiers sont nombreux et les avancées en la matière, pour l’heure, insuffisantes.
Redevenir compétitif implique aussi de revoir nos politiques agricoles. La stratégie insufflée par le Président de la République dans son discours de Rungis, qui ne vise que la seule montée en gamme, ne peut être l’alpha et l’oméga de notre agriculture.
D’autant plus que les agriculteurs ont vu le montant de leurs charges s’envoler, leur fiscalité augmenter et la concurrence mondiale s’intensifier. Ils ont en outre pu constater que le soutien du Gouvernement dans le cadre des accords de libre-échange était pour le moins mitigé.
Faute d’un accompagnement adapté et à la hauteur des ambitions du Président de la République, cette stratégie du « tout montée en gamme » risque d’entraîner notre pays dans une crise de souveraineté alimentaire et de pouvoir d’achat.
Pour faire face à la demande et redonner une dynamique à notre ferme France, nous devons – j’en suis convaincu – réinvestir le marché « cœur de gamme » et booster notre productivité. L’agriculture française est capable de répondre à ces défis.
Nos éleveurs, nos agriculteurs sont responsables et soucieux de produire des denrées de qualité. Faisons-leur davantage confiance et, surtout, donnons-leur un cadre et des outils adaptés : il s’agit de les accompagner face aux nombreux défis auxquels ils doivent faire face.
Adaptation de l’agriculture au changement climatique – c’est le principal défi des dix années à venir –, enjeux environnementaux, gestion de l’eau, concurrence internationale déloyale à cause de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que nous : il est urgent de sauvegarder notre souveraineté alimentaire pour ne pas, demain, être totalement dépendants des aléas géopolitiques, sanitaires ou encore climatiques.
Les trois années que nous venons de traverser ont certes été difficiles, mais elles ont également été riches d’enseignements.
Il est temps de reconquérir, dans tous les domaines, notre appareil productif et de cesser de s’en remettre aveuglément aux sirènes de la mondialisation à tout-va.
Ce rapport n’a pas pour objet d’opposer les modèles agricoles et les agriculteurs entre eux – surtout pas ! Il ne vise pas non plus à opposer l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique, les céréaliers aux éleveurs, l’agriculture dite « productive » – encore faudrait-il définir précisément ce que ce terme recouvre – à une agriculture plus « familiale ».
Il faut produire pour toutes et tous, dans un cadre clair, afin de répondre aux différentes attentes de nos concitoyens et d’avoir une alimentation sûre, locale, de qualité, diversifiée, mais également accessible économiquement.
Ce dernier point est essentiel : chacun de nos concitoyens doit pouvoir manger français tous les jours, et pas uniquement le dimanche. Rappelons-nous que le contenu de l’assiette est le premier révélateur d’inégalités.
Mes chers collègues, pour ce faire, nous devons changer de cap, mais non sans garde-fou.
En tant que corapporteur socialiste d’un rapport transpartisan, j’ai évidemment des divergences avec mes collègues au sujet d’un certain nombre de propositions. Mais c’est là tout l’intérêt de la confrontation des idées. Après tout, quand on reste dans l’entre-soi, il n’en sort jamais grand-chose. Il est toujours intéressant de partager et de comparer les points de vue, pour trouver des accords et avancer.
Pour ce qui est de nos désaccords, je citerai tout d’abord l’évolution du rôle qui pourrait être confié à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
La rentabilité et la compétitivité de notre ferme France ne doivent pas altérer la qualité des produits et représenter un danger pour la santé de nos concitoyens – c’est évidemment la ligne rouge à ne pas franchir.
Il en est de même pour la réduction des coûts de production, qui ne peut prendre la forme d’une détérioration des conditions salariales des travailleurs. Sur ce dernier point, nous avons échangé et trouvé un accord.
Monsieur le ministre, ce rapport transpartisan est une contribution qui me paraît pertinente compte tenu de l’état de notre modèle agricole. L’accueil positif qui lui a été réservé par le monde agricole en témoigne.
Privilégier la montée en gamme grâce à la production sous signes officiels de qualité, comme le bio, les labels, ou encore la production locale est un bel objectif, mais il doit s’accompagner d’une présence de l’agriculture française sur tous les segments du marché. Tel est à mon sens le véritable défi à relever.
Le groupe politique auquel j’appartiens a été à l’origine de nombreuses initiatives lorsque nous étions aux responsabilités. Je pense notamment à l’engagement de Stéphane Le Foll en matière de développement du bio et de l’agroécologie ou encore à celui des sénateurs de mon groupe, depuis des années, en faveur du développement des paiements pour services environnementaux.
J’encourage moi-même ces modes de production, de distribution, de mise en valeur des produits de nos terroirs dans mon département. Nous devons collectivement les promouvoir.
Je l’ai dit, la stratégie de montée en gamme nécessite un accompagnement fort et massif des agriculteurs pour limiter la différence de prix sur les étals. Nous devons viser une démocratisation de ces produits, afin que chacun puisse en bénéficier.
Mais, pour l’heure, monsieur le ministre, la priorité est de nourrir tous les Français et de faire en sorte que chacun d’entre eux ait les moyens de se nourrir ! Or nous ne sommes pas sur la bonne voie.
Rendons à nos agriculteurs la fierté de produire et n’oublions pas que, dans nos départements ruraux, l’agriculture est souvent la dernière activité économique qui exerce, sans contrepartie financière, un rôle irremplaçable dans l’aménagement et l’entretien de l’espace.
Mme la présidente de la commission et M. Pierre Louault applaudissent.
Monsieur le sénateur Mérillou, j’essaierai de répondre dans mon propos conclusif.
Tout d’abord, vous avez raison, rien n’est pire que de ne pas être capable de nourrir son propre peuple. À ce jour, ce n’est pas un sujet qui concerne notre pays, mais il pourrait en aller différemment à l’avenir, en particulier en raison du dérèglement climatique. Par conséquent, nous devons être vigilants, parce qu’il s’agit d’une question essentielle de souveraineté.
Les grandes crises sociales et révolutionnaires – nul besoin de remonter jusqu’en 1789 : les pays situés de l’autre côté de la Méditerranée en ont connu assez récemment – sont souvent le fruit de crises alimentaires.
Ce sujet est important pour la stabilité de notre pays et pour celle des États situés à nos frontières. Nous avons besoin d’assurer notre souveraineté et celle des pays tiers, sans quoi une déstabilisation globale pourrait en résulter. Je suis donc d’accord avec votre propos sur ce point.
Ensuite, vous avez évoqué les attentes et les besoins des consommateurs. Oui, nous devons remédier à la situation d’un certain nombre de nos concitoyens, qui, parfois, ne peuvent pas accéder à une alimentation de qualité ou diversifiée. C’est le travail que nous devons poursuivre au travers du chèque alimentaire ou du chèque alimentation.
Quant aux attentes des consommateurs, vous le soulignez d’ailleurs dans le rapport, celles-ci sont diverses. Nous avons donc besoin de productions également différentes, afin de proposer une offre diversifiée aux consommateurs, allant de l’entrée au haut de gamme, en passant par les produits de moyenne gamme.
Vous reliez stratégie de montée en gamme et signes de qualité. Selon vous, combien d’entre eux – il en existe plusieurs centaines – ont été créés ces cinq dernières années ? Ces signes de qualité ne sont pas une nouveauté : cela fait soixante ans qu’on les développe.
Dans le discours de Rungis, il était indiqué qu’ils permettaient de créer une rémunération. Assumons collectivement – c’est plutôt une fierté – d’avoir porté ces signes de qualité dans notre pays et à l’extérieur de nos frontières, puisque nous avons obtenu leur reconnaissance dans les accords internationaux.
La qualité est une question pour la marque France que nous avons à défendre. Nous avons beaucoup exporté, parce que nous partageons une identité, un patrimoine, une culture et une qualité. Il ne faut pas complètement s’en délester – vous ne l’avez d’ailleurs pas dit –, y compris pour les exportations.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne répéterai pas les conclusions de nos brillants rapporteurs MM. Duplomb, Louault et Mérillou, mais il faut nous rendre à l’évidence : notre excédent commercial agricole s’érode et nous perdons en compétitivité. Le Sénat formule vingt-quatre recommandations afin d’y remédier à l’horizon de 2028.
Heureusement, la France demeure une grande puissance agricole et conserve son rang de principal producteur européen, devant l’Allemagne et l’Italie. Néanmoins, en vingt ans – cela a été dit –, elle est passée du deuxième au cinquième rang mondial.
Je pourrais me satisfaire de cette situation et dire que, finalement, nous ne nous en sortons pas si mal. Mais, monsieur le ministre, ce serait nier plus de vingt ans de travail au Sénat et de rencontres avec les organisations agricoles.
Ce serait nier le rapport parlementaire portant sur le suicide des agriculteurs, rédigé par Henri Cabanel et moi-même.
Ce serait nier, monsieur le ministre, six années de rapports budgétaires et d’auditions, au cours desquelles nous constations une perte de compétitivité des exploitations françaises, due bien souvent à une surtransposition de normes européennes ou à des contraintes que je qualifierai d’« administrato-paperassiales », qui plombent la vivacité de nos fermes.
Pour illustrer mes inquiétudes et mes alertes, je rappelle qu’en 2021, le solde commercial français s’élève à 8 milliards d’euros. Certes, cela correspond à une progression de 3, 4 % par rapport à son niveau en 2019, mais celle-ci est principalement due aux exportations de vins et spiritueux, dont le solde est de 14, 2 milliards d’euros.
Cette filière constitue le fleuron d’un secteur agroalimentaire qui n’arrive pas à valoriser correctement le reste de ses produits. En clair, sans les vins, nous serions déficitaires ! Cela ne choque pas un État surendetté, mais permettez-moi de l’être.
À qui et à quoi attribuer cette perte de compétitivité ? Peut-être à la stratégie du « tout montée en gamme » conduite par votre majorité depuis 2017 ?
Nos rapporteurs citent le « poulet du dimanche ». Ainsi, les Français se tournent vers la découpe et les produits élaborés, dont 16 % seulement proviennent des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (Siqo). Le vaste marché du poulet standard est donc ouvert aux importations et près d’un poulet sur deux est importé, contre 20 % en 2000 !
Je peux citer l’exemple des betteraves, qui se trouvent coincées par la justice européenne ! Mais, rassurez-vous, le Brésil saura nous vendre du sucre pour pas cher, produit dans des conditions déplorables pour l’environnement ou le droit social…
J’évoquerai le coût de la main-d’œuvre, qui est de une à trois fois plus élevé qu’en Espagne, qu’en Allemagne ou qu’en Pologne.
Je pourrais multiplier les exemples de surtransposition des normes européennes. En effet, notre pays se caractérise par la place importante des surtranspositions « politiques », pour lesquelles l’arbitrage politique l’emporte sur le choix d’une transposition mesurée.
D’autres pays se sont également posé cette question. Il en ressort que la majorité des États affichaient une part de normes d’origine européenne plus faible que la nôtre : 14 % pour le Danemark, 10 % pour l’Autriche.
Je vous l’accorde, ce taux est de 39 % pour l’Allemagne – soit ! –, mais pour contrebalancer ce poids, depuis 2015, ce pays surveille l’impact de la législation européenne sur ses entreprises et a adopté le principe du one in, one out pour contenir la complexité. Cette politique aurait permis de baisser les coûts de 3, 5 milliards d’euros depuis 2015. Trois milliards et demi, monsieur le ministre !
Nous n’en sommes pas à notre première interpellation sur ce sujet.
Monsieur le ministre, il vous faut dresser le bilan de vingt années de stratégie agricole. Quels en sont les résultats ? Stoppons le déclassement international, il est encore temps d’inverser la tendance ! Écoutez le Sénat, monsieur le ministre, il est l’écho de la ruralité et de nos agriculteurs !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Henri Cabanel applaudit également.
Madame la sénatrice Férat, je suis également l’élu d’un territoire rural.
Vous me demandez d’écouter la ruralité ; je n’ai aucune difficulté à le faire, puisque je vis aussi quotidiennement que possible – ou au moins chaque semaine – dans ces territoires ruraux.
Vous ne vous satisfaites pas de la situation ? Moi non plus ! Oui, je ne suis pas satisfait de la situation de la ferme France, en termes de souveraineté. Vous l’avez rappelé, depuis des dizaines d’années, on a laissé faire les choses sans regarder dans le détail, sans grande rupture. En réalité, il s’agit d’une tendance assez lourde.
Nous avons donc besoin de redresser la situation. Cela ne sera pas une courbe inversée. Chacun doit œuvrer avec patience et modestie, dans les mois et les années à venir, afin de reconstruire la souveraineté que nous avons perdue.
Vous avez évoqué le fleuron qu’est la viticulture – et le département dont vous êtes l’élue n’y est pas étranger.
De fait, la viticulture est, en apparence, le dernier des fleurons français, mais en réalité, nous en avons plein : à mon sens, la filière animale en est également un, tandis que la filière végétale pourrait aussi en devenir un. Nous avons besoin de renouer avec cette tendance.
Je signale simplement que la viticulture est le seul secteur exportateur à s’être entièrement doté de labels et de signes de qualité. Par conséquent, le signe de qualité peut être un outil intéressant dans une perspective d’exportation, ce que vous connaissez bien dans le département de la Marne.
Le troisième sujet que vous avez évoqué est celui de l’espace européen et des normes que nous nous infligeons, en tant que Français, alors que d’autres ne s’imposent pas les mêmes.
Je l’ai indiqué, nous avons besoin de réfléchir, en tant qu’Européens, avec nos collègues européens, à la façon d’édicter des normes et d’évoluer s’agissant d’un certain nombre de transitions nécessaires.
Nous avons besoin de réfléchir également, à l’échelle de la France, à la question des transpositions, des surtranspositions et de la suradministration, qui a trait à la manière de gérer les politiques publiques.
Je me méfie toujours des ministres qui déclarent vouloir simplifier les dispositifs, parce qu’en règle générale, au bout du compte, la situation est plus compliquée.
Cette réflexion doit donc être menée avec modestie, mais j’emprunterai ce chemin.
Je voudrais également vous remercier du travail que vous accomplissez, afin d’identifier les cas pour lesquels une simplification concrète pourrait intervenir.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au mois de septembre 2022, une journaliste de l’hebdomadaire Le Point écrivait : « La commission des affaires économiques du Sénat tire, pour la énième fois, le signal d’alarme : la “Ferme France” ne va pas bien, elle produit de moins en moins et, pour nourrir le “Peuple France”, les importations explosent ! »
Notre pays, aux terres fertiles, au climat tempéré, aux savoir-faire et à la diversité des produits, a de nombreux atouts pour réussir. Pourtant, notre agriculture va mal et le monde agricole est préoccupé par un certain nombre de points, au nombre desquels figurent les changements réglementaires permanents, ainsi que la pression concurrentielle croissante. La compétitivité de notre agriculture chute et les conséquences sont inquiétantes pour notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de filières souffrent et certains succès cachent bien des problèmes.
Deuxième producteur de lait de l’Europe, la France alimente son marché intérieur avec 58 % de sa collecte, tout en exportant 40 % de sa production, en majorité vers les pays européens. En Normandie, la filière lait détenait un troupeau de 547 000 vaches laitières en 2021.
Pourtant, si les éleveurs maintiennent les produits laitiers sur la scène internationale, c’est au prix de la faiblesse de leurs revenus pour répondre à la guerre des prix.
Ce soi-disant « miracle français » se traduit plutôt par l’expression « filière en danger et désastre annoncé » pour la production laitière. En effet, le manque de trésorerie pénalise les investissements susceptibles d’améliorer la productivité et les revenus.
Des exploitants agricoles, découragés par les revenus faibles, le coût des investissements et les contraintes quotidiennes de l’élevage, arrêtent la production laitière. Ainsi, la Normandie a connu une baisse de sa production de 32 % de 2010 à 2020 et des régions de bocage et d’élevage, comme la Manche, voient leur cheptel bovin diminuer de façon importante.
C’est une situation de plus en plus difficile à supporter pour les producteurs et un point de blocage pour les jeunes candidats à l’installation. Se pose alors le problème de la transmission, sachant qu’un éleveur sur deux est âgé de 50 ans ou plus et que la baisse du nombre d’exploitations laitières est plus importante en France que dans les autres pays européens.
Le nombre d’élevages de porcs a chuté de 40 % en dix ans en Normandie. La filière porcine obéit à des règles de production exigeantes sur le plan technique et très aléatoires sur le plan économique. Le prix de vente fluctue énormément, alors que les charges continuent de progresser. La production porcine française est donc plutôt à la baisse. Dans le même temps, en Espagne, pays premier producteur européen, 58 millions de porcs ont été abattus en 2021.
Dans un autre domaine, la production française de pommes a été divisée par deux depuis trente ans. On en exporte deux fois moins qu’il y a sept ans, alors qu’une pomme sur trois est importée pour être transformée.
La surtransposition des normes nuit également à la compétitivité de l’agriculture française. La France impose des normes plus contraignantes que les directives européennes, ce qui augmente le coût de production. Par exemple, notre pays oblige à un recyclage des eaux issues de la transformation laitière, alors que les pays concurrents sont autorisés à réutiliser ces eaux sans traitement.
L’État français interdit 145 produits phytosanitaires, pourtant utilisés dans l’agriculture des pays concurrents de l’Union européenne. Cela crée une distorsion de concurrence évidente.
Les produits issus de l’agriculture française sont souvent plus chers pour les consommateurs, notamment en raison de l’importance des charges, dont le coût de la main-d’œuvre, qui est plus élevé en France.
Depuis 2017 et son discours de Rungis, le président Macron prône le « tout montée en gamme ». Même si cette stratégie correspond à certains marchés, elle n’améliore pas globalement la situation.
Pour les exportateurs et les consommateurs nationaux, le positionnement français sur les produits haut de gamme ne justifie pas un tel écart de prix avec des concurrents. Les habitudes de consommation des ménages se traduisent, dans les faits, par une réduction des quantités achetées, au regard des prix.
La pomme bio, par exemple, qui revient en moyenne deux fois plus cher que la pomme conventionnelle, est achetée par seulement 21 % des consommateurs. Elle est également difficile à vendre à l’étranger : 38 % des producteurs bio sont alors contraints d’écouler leur surproduction sur le marché conventionnel, ce qui représente une baisse de revenus de 820 euros par tonne.
Nous devons désormais agir avec force pour éviter que notre pays à la terre nourricière ne devienne un pays sans autonomie alimentaire.
Le rapport sénatorial a formulé plusieurs recommandations en ce sens afin, notamment, de maîtriser les charges de production, d’éviter les surtranspositions et de relancer la croissance de la productivité.
Je tiens à saluer la qualité du travail réalisé et je souscris pleinement à ces recommandations. Nous devons absolument engager au plus vite ce choc de compétitivité.
Notre pays manque de stratégie. Or la clé de la réussite des pays qui gagnent est leur capacité à définir une stratégie et un objectif clairs. La compétitivité doit donc être un objectif politique clair.
Nous le devons à notre agriculture, tant cette activité est au cœur de l’avenir de nos territoires, que le Sénat a précisément vocation à représenter !
Madame la sénatrice Gosselin, vous avez évoqué un certain nombre de filières, dont celle de l’élevage, chère au département que vous représentez.
Il est nécessaire de rompre avec une forme d’« élevage bashing » permanent, que nous avons laissé se développer. Nous avons besoin d’élevages en France. Le modèle d’élevage que nous avons construit dans notre pays devrait être observé, car il est à bien des égards vertueux.
Pour aller dans le sens de votre propos, j’entends des personnes parler d’agro-industrie, d’élevage industriel ou de fermes-usines : qu’ils aillent voir ce qui se passe au-delà de nos frontières proches – il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’en Chine – pour étudier de près la réalité des élevages ! Nous devrions plutôt nous féliciter d’avoir le modèle d’élevage qui est le nôtre. C’est un facteur d’attractivité, y compris pour les métiers du secteur.
Il convient de s’attacher au sujet particulier du lait, vous avez raison, mais aussi à la question de la rémunération, à celles des conditions de travail et du portage des capitaux, qui sont assez lourds pour un jeune. De façon plus générale, le système d’élevage a été pensé différemment selon les régions : il est différent pour les Normands, les Bretons et pour les éleveurs du Massif central, chers à M. Duplomb.
Ce n’est pas le même modèle, parce que les constantes paléoclimatiques sont différentes. Par conséquent, ce ne sera pas le même élevage. Nous devons essayer d’y travailler.
Vous vous êtes demandé ce qu’il était souhaitable de faire. À mon sens, la question de la souveraineté est un fil directeur. C’est dans cette direction que nous allons nous engager et je viendrai bien volontiers vous en parler à l’occasion du plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes. Il s’agit de travailler sur la question des produits phytosanitaires, sur leur réduction et les solutions de substitution, qui supposent des investissements pour faire face aux défis de demain, mais aussi sur la question de la main-d’œuvre afin de regagner de la compétitivité.
Il s’agit de retrouver des filières d’excellence et de répondre aux besoins des consommateurs. De cette façon, nous réussirons. Nous devons procéder, secteur par secteur – j’allais dire, presque filière par filière.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en lisant ce rapport, je me suis souvenu des leçons que j’apprenais plus jeune. La France était alors le « grenier à blé » de l’Europe, un pays de cocagne, deuxième exportateur mondial. Aujourd’hui, nous sommes au cinquième rang ! Dans les années 1980, nous comptions 1, 2 million d’exploitations agricoles, contre un peu moins de 440 000 aujourd’hui.
Oui, en 2023, la France est l’un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent, tandis que ses importations alimentaires explosent. Le potentiel productif agricole s’érode d’année en année : baisse du nombre d’exploitations, chute de la surface agricole utile en cultures et plafonnement des rendements. La productivité de l’agroalimentaire, faute d’investissements suffisants, est également en berne.
Nos collègues ont donc passé plusieurs mois à dresser un tableau exhaustif de la filière agricole, mais, point plus intéressant, ils se sont penchés sur les causes et ont donc interrogé l’esprit des réformes successives qui ont conduit notre agriculture à aller aussi mal.
Depuis plusieurs décennies, nous nous sommes habitués à entendre une petite musique jouée par ceux qui vitupèrent notre modèle agricole, pourtant l’un des plus vertueux.
C’est dans ce contexte politico-médiatique qu’en 2017 notre Président a plaidé pour « la montée en qualité, la montée du bio ». Les produits français n’étant plus compétitifs, ils devaient monter en gamme afin d’atteindre des marchés de niche plus rémunérateurs, tandis qu’« en même temps » le marché allait être ouvert aux produits étrangers cœur de gamme. Cette politique agricole à deux faces sera une impasse.
Tels Perrette et son pot au lait, ces décideurs ont rêvé : adieu lait, pommes, tomates, poulet !
Oui, comme Perrette, ces gouvernements successifs ont fini par trébucher sur la réalité : ce modèle était déconnecté des attentes des Français et les contraintes qui pèsent sur lui sont autant de boulets qui l’ont entravé.
C’est ce que démontre ce rapport, très pédagogique, au travers notamment d’exemples tirés de la consommation quotidienne de nos concitoyens.
Prenons l’exemple de la pomme. Voilà dix ans, nous en exportions 700 000 tonnes, et en importions 100 000 tonnes. À ce jour, nous n’en exportons plus que 350 000 tonnes, et en importons 200 000 tonnes… Derrière ces chiffres, ce sont nos pomiculteurs qui se sont adaptés à des contraintes toujours plus coûteuses pour produire la pomme parfaite.
Or, pour la produire, on augmente son coût et les vilaines pommes manquent pour les produits de transformation, comme le jus ou la compote. Les conséquences sont sans appel : produire une pomme française coûte 1, 18 euro contre 53 centimes pour une pomme polonaise.
La consommation régulière de la pomme pourrait donc rapidement être réservée aux consommateurs français les plus aisés, laissant les pommes étrangères, bourrées de substances interdites en France, aux consommateurs les moins aisés et aux producteurs de produits transformés à base de pommes.
Cette politique du « tout montée de gamme » a fait apparaître deux risques majeurs : une déconnexion totale de notre agriculture avec les attentes de nos concitoyens, lesquels connaissent une inflation alimentaire sans précédent, et une crise de souveraineté alimentaire. La guerre russo-ukrainienne nous a rappelé l’importance géostratégique de l’arme agricole. Certes, le ministère de l’agriculture a été renommé en conséquence, mais corriger réellement le tir est maintenant une nécessité.
La stratégie Farm to F ork, qui nous entraîne vers la décroissance, est à rebours de nos besoins et, actuellement, se heurte à la situation géopolitique. À l’heure où nous découvrons le prix de la dépendance énergétique, comment pouvons-nous ne pas doter la France d’une agriculture souveraine et compétitive ? Nous ne pouvons plus nous acheter une bonne conscience environnementale sur le dos de nos agriculteurs : ce serait irresponsable vis-à-vis de nos enfants.
Ce rapport nous donne les clés pour redresser la barre de notre filière agricole. Il serait dommage de passer à côté et de ne pas mettre en œuvre ses préconisations.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.
Monsieur le sénateur, vous avez évoqué plusieurs sujets.
Tout d’abord, pardonnez-moi, mais, dans son discours, le Président de la République n’a pas dit qu’il fallait « tout monter en gamme », mais que la montée en gamme était aussi un objectif et une perspective.
Essayons de ne pas caricaturer son propos. D’ailleurs, depuis trente ans, la tendance collective était plutôt d’aller vers une montée en gamme.
Ensuite, vous avez soulevé un point peu abordé ce soir, en dépit de son importance à mon sens : la compétitivité de nos filières agroalimentaires.
En effet, en raison d’un défaut de rémunération, nous avons un défaut de modernisation. Le ministère de l’économie et des finances, mon collègue Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie, et moi-même travaillons sur le sujet important de l’investissement dans les industries agroalimentaires. Nous devons résorber ce retard en termes de compétitivité.
Par ailleurs, vous avez raison, la crise en Ukraine vient de montrer combien l’alimentation est une arme. Par conséquent, nous ne devons pas faire preuve de naïveté en la matière. La souveraineté alimentaire est une question de souveraineté « tout court ».
Pouvoir nourrir sa population est peut-être la première des souverainetés, comme l’indiquait le sénateur Mérillou.
Ce sujet doit être posé de cette façon, y compris dans le débat public. Ainsi, nous pourrons avancer.
Enfin, je ne suis pas sûr que la question de la souveraineté ne soit pas sans lien avec le défi environnemental.
Le défi climatique, celui des grandes transitions, est aussi un défi de souveraineté. En effet, la particularité du modèle agricole est qu’il est dépendant du climat. Si nous ne sommes pas capables d’adapter notre modèle agricole au dérèglement climatique et de lutter contre ce dérèglement, alors le modèle agricole et la souveraineté alimentaire seront mis en cause.
Il me semble que nous devons tenter de combiner ces deux impératifs, sinon des modèles se retrouveront, de ce fait, dans une impasse.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente de la commission, tout d’abord, je voudrais vous faire part de ma joie de pouvoir débattre, une nouvelle fois, du sujet de la souveraineté alimentaire, et de sa reconquête.
Je voudrais également saluer la qualité du travail réalisé par le Sénat, à l’occasion de ce rapport en particulier, mais aussi plus généralement sur les sujets agricoles.
Mes propos ne relèvent pas de la flagornerie. En effet, je pense que vous avez souvent su poser les termes du débat, avec tout le recul nécessaire, sur des sujets bien plus complexes que la caricature qui en est faite dans un certain nombre de tribunes.
Je salue donc le travail accompli par le sénateur Duplomb, par le sénateur Louault et par le sénateur Mérillou. Ce rapport sur la compétitivité de la ferme France et le débat que nous avons eu ce soir sont, me semble-t-il, utiles pour penser l’avenir de notre agriculture dans une période à la fois de défis – ce qui a été souligné par plusieurs d’entre vous – et marquée par le conflit en Ukraine.
Cette guerre démontre, s’il en était encore besoin – vous en étiez en tout cas, comme moi, convaincus –, combien produire pour nourrir est essentiel.
Ce rapport dresse des constats éclairants sur les politiques menées depuis la fin des années 1990, notamment lorsque ses auteurs évoquent le choix de la stratégie de montée en gamme. Il montre que la perte de compétitivité, à laquelle ce rapport conclut, n’est pas un sujet nouveau. J’évoquerai naturellement dans mon propos les orientations politiques que nous privilégions depuis 2017.
Ensuite, nous pouvons partager certains constats dressés par le Sénat et un certain nombre de solutions. Oui, nous avons perdu des parts de marché à l’international, pour certaines productions, et la tâche est immense pour assurer notre souveraineté alimentaire.
Pour autant, je ne crois pas qu’il faille opposer production de masse – je l’ai déjà dit – et montée en gamme, comme le fait ce rapport, en considérant que la priorité doit aller à l’une à la place de l’autre. Ces deux stratégies doivent être menées de front pour répondre à la demande et aux différents besoins des consommateurs.
Notre mission ne peut pas non plus être de tout produire sur notre sol. Ce n’est d’ailleurs pas le sens de la souveraineté alimentaire, qui repose également sur un équilibre entre les productions – reconnaissons-le – des différentes régions du monde.
Ce ne serait pas réaliste, sachant que l’alimentation est aujourd’hui une affaire de complémentarité, de compensation, d’échanges saisonniers, encore davantage sous le régime des dérèglements climatiques.
L’enjeu réside dans la combinaison des objectifs de production de masse et de montée en gamme de certaines filières spécifiques ; c’est impératif pour maintenir la diversité de nos systèmes agricoles, dont la force est une source de richesses.
L’enjeu, c’est également de combiner l’objectif de souveraineté avec celui d’une production capable de répondre aux besoins des consommateurs.
Il est aussi nécessaire de mener, pour le secteur agricole en particulier, des transitions, que nombre de nos concitoyens appellent de leurs vœux en général. Si nous ne sommes pas en mesure d’adapter l’agriculture aux défis du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et du stockage du carbone dans le sol, alors nous ne pourrons pas garantir notre souveraineté alimentaire.
Il est donc impératif d’accélérer la transition, car un haut niveau d’exigence sera indispensable pour conquérir de nouveaux marchés et répondre à de nouvelles attentes ; sur ce point, demeure la question de la distorsion de concurrence avec les autres États européens qui pourrait résulter de telles mesures.
Je conclurai en rappelant les actions que nous avons menées depuis 2017. En matière de revenus, nous avons mis en place les lois Égalim 1 et 2 – vous avez largement participé à leur élaboration et vous aurez l’occasion d’examiner un nouveau texte prochainement. Elles tracent la voie vers l’inversion de la logique de la construction du prix. Nous ne sommes pas au bout du chemin, mais nous avons soulevé pour la première fois depuis très longtemps la question de la construction du prix – elle doit commencer avec les coûts de production.
Nous avons également accompagné les transitions, à l’occasion du Varenne agricole ; il faut maintenant le concrétiser sur le terrain, notamment en développant l’accès à l’eau.
Je pense également aux adaptations au changement climatique que nous essayons de mettre en place via le plan France 2030.
Par ailleurs, nous cherchons à défendre notre agriculture en tant qu’Européens. Lors de la présidence française de l’Union européenne, nous avons inclus – c’est une première – les notions de réciprocité et de clauses miroirs dans les accords internationaux, alors même qu’elles n’étaient pas demandées dans le débat public. Y recourt-on suffisamment à ce jour ? La réponse est non, mais nous devons œuvrer en ce sens, avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et avec les autres États membres, afin qu’elles puissent s’appliquer. Nous devons nous mettre d’accord avec nos partenaires commerciaux pour qu’un certain nombre de clauses miroirs puissent être défendues et respectées.
Enfin, toute cette réflexion alimentera les débats sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles que je présenterai prochainement. Nous en sommes actuellement à la phase de concertation, au cours de laquelle nous avons abordé l’ensemble des sujets relatifs à la rémunération, aux transitions, aux adaptations, au portage du foncier et des capitaux, à la formation et à l’innovation, etc. Ces sujets participent d’un écosystème, si je puis dire.
On a beaucoup dit que l’agriculture se porte mal – c’est vrai, un certain nombre de secteurs sont en difficulté –, mais quel formidable métier ! Il est porteur de sens et il a l’avenir devant lui, car il touche à notre capacité de produire, de nourrir, de stocker du carbone et de défendre un certain nombre de valeurs qui sont celles de notre territoire.
Voilà ce que nous essaierons de défendre au travers de ce projet de loi à venir.
Applaudissements sur des travées des groupes RDPI, RDSE, INDEP et UC. – Mme la présidente de la commission applaudit également.

La parole est à M. Laurent Duplomb, au nom de la commission qui a demandé ce débat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Monsieur le ministre, ce n’est pas parce qu’on réécrit l’Histoire que cela devient la vérité…
La réalité, c’est que, en 2017, à la tête de la ferme France, il y avait un Président de la République, dont le propos n’est pas tout à fait le même que celui qu’il tient aujourd’hui, comme c’est d’ailleurs le cas sur plein d’autres sujets…
À cette époque-là, je le rappelle, le Président de la République avait tenu, dans son discours de Rungis, un propos très clair. Malheureusement, nombre d’agriculteurs ou de représentants professionnels n’en ont pas compris le sens. Lorsqu’il parlait de montée en gamme, ce cher Président de la République, il partait du principe que nous ne sommes plus compétitifs, qu’il faut donc accepter que des produits viennent de l’extérieur et recentrer notre agriculture sur la qualité.
Monsieur le ministre, dans notre rapport, mes collègues et moi critiquons non pas la montée en gamme ni les produits de qualité, mais la valse à deux temps, à savoir, d’un côté, dire qu’il faut monter en gamme pour conserver une partie de notre agriculture, tout en acceptant politiquement de laisser tomber des pans entiers de notre production ; de l’autre côté, se gargariser de messages tout faits sur l’agroécologie. C’est ça la réalité du discours de 2017 du Président de la République !
Et je ne parle pas du discours de la Sorbonne du même Président de la République, en 2018, qui était quasiment capable de sacrifier la politique agricole sur l’autel du marché européen – c’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un Président de la République parle d’abandonner la politique agricole de son pays. C’est ça la réalité ! Relisez les discours de Rungis et de la Sorbonne, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous verrez que tout ce que je viens d’énoncer s’y trouve !
Monsieur le ministre, la réalité, c’est que la France décline ! Cela s’explique à 70 % par la baisse de productivité.
Quatre grandes causes entraînent cette baisse de productivité. La première, ce sont des charges plus élevées, des coûts de main-d’œuvre 1, 5 fois plus élevés qu’en Espagne, 1, 7 fois plus qu’en Allemagne ou encore 12 fois plus qu’en Pologne ; une concurrence avec le Maroc, où l’heure de main-d’œuvre coûte 70 centimes.
Autre cause : la surtransposition de normes – mes collègues l’ont rappelé sans cesse –, qui vient sans arrêt amplifier la réglementation qui s’applique aux agriculteurs européens, et que la France alourdit encore plus.
La réalité de cette baisse de productivité, c’est aussi la guerre des prix – vous avez essayé de l’endiguer, certes, au moyen des différentes lois que vous avez mises en place, monsieur le ministre –, qui a pour seule conséquence d’empêcher, au bout du bout, les industries agroalimentaires de retirer suffisamment de bénéfices pour pouvoir réinvestir et rester compétitives.
La troisième cause, c’est l’insuffisante protection de l’État. Monsieur le ministre, combien d’exemples – je pense en particulier à la production de la tomate – montrent que nous avons laissé des productions, qui proviennent d’autres pays, remplacer les nôtres ? La tomate marocaine, qui au départ devait être ronde, a évolué vers la tomate en grappe, puis vers la tomate cerise. Résultat : au bout du bout, les seuls Français qui produisent des tomates sont quasiment condamnés à ne produire que des tomates anciennes !

Est-ce là la politique agricole que nous voulons pour demain ?
Le quatrième élément, c’est un climat médiatico-politique catastrophique, comme l’ont dit mes collègues. Lorsque l’on se rend en Italie, pour reprendre l’exemple de Serge Mérillou, on a l’impression de rencontrer 58 millions d’ambassadeurs de l’agriculture italienne ; en France, notre agriculture fait face, sur 67 millions d’habitants, à 30 millions de procureurs ! C’est ça la réalité !
Et de ces quatre phénomènes résultent trois conséquences.
La première, c’est que nous perdons notre souveraineté – tous les exemples nous le révèlent. C’est pour ça que le Président de la République a changé de ton et de termes. Entre 2017 et aujourd’hui, le discours sur la mondialisation heureuse, le multiculturalisme et tout ce qui était vendu comme étant le paradis sur terre, devient, sous l’effet de la covid-19 et de la guerre en Ukraine, un discours sur la souveraineté ; comme par hasard, on redécouvre tous ses avantages ! Un pays qui est capable de produire est un pays qui est en mesure de nourrir sa population.
La deuxième conséquence, c’est que le discours sur la montée en gamme divise les Français en deux : d’un côté, vous avez une partie relativement faible de la population qui a les moyens de se « payer » l’agriculture qu’elle souhaite ; de l’autre, vous avez la plupart des Français, qui sont condamnés à n’acheter que des produits importés, lesquels ne correspondent pas – pour un tiers – à nos normes, monsieur le ministre.
En clair, nous sommes dans une situation qui amplifie ces phénomènes ; au bout du bout, la seule réalité, c’est que, chez nous, nous interdisons et nous mettons dans le corner des productions qui passent par la porte de l’importation, et que nous finissons par manger !
Et s’agissant les accords de libre-échange, les clauses miroirs ne vont pas les changer.

Monsieur le président, si vous me permettez quelques secondes de plus…
Mes chers collègues, savez-vous qu’actuellement la Commission européenne est en train d’instaurer deux types d’accords de libre-échange ? D’un côté, les accords de libre-échange globaux, qui seront soumis au vote des États membres ; de l’autre, des accords de libre-échange intérimaires, où seront traités tous les sujets commerciaux, et qui pourront ne pas être votés. Cela permettra de continuer comme avant !

Mon cher collègue, vous avez dépassé très largement votre temps de parole.
Il faut tenir dans les délais, c’est le règlement.

Monsieur le ministre, j’espère que vous comprendrez enfin qu’il faut faire quelque chose de bien pour notre agriculture.
Il ne suffit pas de le dire ; encore faut-il le faire !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, INDEP et CRCE.

Nous en avons terminé avec le débat sur les conclusions du rapport d’information Compétitivité : une urgence pour redresser la ferme France.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 8 février 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente :
Débat d’actualité sur le thème « Quelle réponse européenne aux récentes mesures protectionnistes américaines ? » ;
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918, présentée par Mme Valérie Boyer, M. Bruno Retailleau et plusieurs de leurs collègues (texte n° 227, 2022-2023).
Le soir :
Proposition de résolution européenne, en application de l’article 73 quinquies du règlement, sur l’avenir de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), présentée par MM. Jean-François Rapin et François-Noël Buffet (texte de la commission n° 298, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 8 février 2023, à zéro heure cinq.