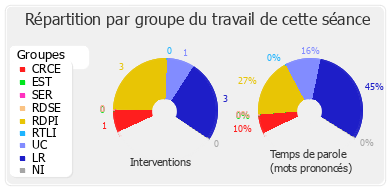Séance en hémicycle du 12 juin 2008 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Par lettres en date du 11 juin 2008, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement déclare l’urgence :
- du projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire (n° 389) ;
- du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi (n° 390).

L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission des affaires économiques sur les propositions de loi présentées par M. Michel Houel et plusieurs de ses collègues et par M. Jean-Claude Frécon et plusieurs de ses collègues, relatives à l’organisation des transports scolaires en Île-de-France (nos 380, 354, 373).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd’hui deux propositions de loi relatives à l’organisation des transports scolaires en Île-de-France : d’une part, la proposition de loi n° 354, dont je suis l’auteur, et, d’autre part, la proposition de loi n° 373, présentée par M. Jean-Claude Frécon et plusieurs de ses collègues socialistes. Je précise d’emblée que les dispositifs de ces deux textes sont rigoureusement identiques.
Je souhaiterais commencer ma présentation en constatant que ce dispositif fait l’objet d’un large consensus, mais qu’il doit être adopté en urgence avant le 1er juillet 2008 afin d’apporter une sécurité juridique aux contrats conclus entre le syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, et les organisateurs locaux.
Le transport scolaire est un service apprécié de nos concitoyens, car il permet à chaque individu d’étudier dans la ville de son choix et pour un coût modeste, quel que soit son lieu d’habitation.
Vous n’ignorez pas que la région francilienne bénéficie depuis longtemps d’une organisation particulière en matière de transports scolaires. Cette particularité a été accentuée par l’acte II de la décentralisation qu’a représenté la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, depuis le 1er juillet 2005, il incombe au STIF de prendre en charge non seulement l’organisation, mais aussi le financement des transports scolaires de la région. Toutefois, il a été prévu une période transitoire de trois ans pendant laquelle l’organisation des services de transports scolaires pouvait continuer d’être assurée par ce que l’on appelle les « organisateurs locaux », c’est-à-dire pour l’essentiel des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Malheureusement, il est rapidement apparu que le STIF était confronté à une triple difficulté.
Tout d’abord, le syndicat ne peut pas subdéléguer ses compétences aux organisateurs locaux, ce qui empêche la création d’une structure efficace à trois niveaux : STIF, départements et organisateurs locaux. De fait, les départements, délégataires de compétences du STIF, ne sont pas en mesure aujourd’hui de déléguer à leur tour celles-ci aux organisateurs locaux. Cette structure contractuelle à trois étages serait pourtant parfaitement adaptée pour l’organisation des transports scolaires dans la grande couronne.
Ensuite, le STIF ne peut pas conclure de conventions de compétences et transférer le personnel correspondant à cause du statut général de la fonction publique. Non seulement il ne dispose pas du personnel qui aurait dû lui être transféré en vertu de la loi de 2004, soit trente-quatre équivalents temps plein, mais en outre, quand bien même ce transfert aurait eu lieu, le statut actuel de la fonction publique aurait rendu impossible de nouvelles mises à disposition ou des détachements de fonctionnaires transférés au STIF au bénéfice des départements.
Enfin, le STIF n’est pas en mesure de renouveler les contrats passés avec les organisateurs locaux, qui arrivent à échéance le 1er juillet 2008, date à laquelle le STIF sera, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours. Cette subrogation entraînerait des conséquences très fâcheuses pour le syndicat francilien et pour les familles d’élèves. Le STIF devrait reprendre directement l’organisation, la gestion et le suivi quotidien d’environ 1 300 circuits spéciaux scolaires, soit 600 contrats de transports, et il serait contraint de mettre en place environ 70 régisseurs locaux, alors qu’il ne dispose que d’une seule personne aujourd’hui, pour percevoir la participation financière acquittée par les familles.
Vous remarquerez, mes chers collègues, que les deux propositions de loi doivent justement permettre de lever ces difficultés en rationalisant l’organisation des transports scolaires et en offrant enfin aux parents d’élèves un véritable service de proximité.
L’article 1er permet aux départements de la région d’Île-de-France de subdéléguer à des autorités organisatrices de proximité, de droit public ou privé, tout ou partie des services de transports scolaires qui leur ont été confiés par le syndicat des transports d’Île-de-France.
L’article 2 prolonge de deux années la période transitoire initiale de trois ans, fixée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, période pendant laquelle l’organisation des services de transports scolaires peut continuer d’être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé en place.
L’article 3 prévoit que, dans le cadre d’une convention passée entre le STIF et un département francilien, les fonctionnaires de l’État qui travaillent dans des services relatifs à l’organisation et au fonctionnement des transports scolaires et qui ont été transférés au STIF puissent ensuite être mis à disposition du président du conseil général sur l’initiative du directeur général du STIF. Cette mise à disposition cesse quand la convention passée entre le STIF et le département arrive à son terme ou si elle dépasse le délai de deux ans relatif au droit d’option du fonctionnaire. Dans ces deux cas, les fonctionnaires concernés sont alors mis à disposition du directeur général du syndicat.
L’article 4 est le symétrique de l’article 3, mais il traite des fonctionnaires de l’État ayant soit opté pour le maintien de leur statut, soit refusé de faire jouer cette option. Dans les deux cas, ils sont placés en détachement sans limitation de durée auprès du conseil général.
La commission des affaires économiques n’a modifié qu’à la marge le dispositif des deux propositions de loi. Compte tenu du consensus politique qui existe sur ce texte élaboré en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et de l’urgence à l’adopter avant le 1er juillet 2008, elle n’a procédé qu’à trois modifications.
Outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer l’expression « collectivités locales » par celle de « collectivités territoriales », la commission a souhaité prolonger de trois ans, et non pas de deux ans, la période transitoire fixée par la loi de décentralisation de 2004 pour les organisateurs de proximité existants. Il convient de laisser suffisamment de temps au STIF pour déléguer une fois pour toutes ses compétences et pour mettre en œuvre sa stratégie en partenariat avec les départements de la grande couronne.
La troisième modification concerne également l’article 2, puisqu’il s’agit de viser dans son intégralité le paragraphe II de l’article 41 de la loi du 13 août 2004. De fait, il convient, d’une part, de conserver l’obligation pour le STIF d’endosser les droits et obligations de l’organisateur local à l’issue de la période transitoire et, d’autre part, d’assurer les transferts financiers du STIF vers les organisateurs de transports scolaires en place.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

La parole est à M. le secrétaire d'État, que nous remercions de venir apporter son éclairage sur ce sujet.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, mon éclairage sera bref, car l’intervention de M. le rapporteur a été très précise.
Tout d’abord, je tiens à remercier le Sénat d’avoir rédigé ces propositions de loi de façon rapide et efficace en se plaçant, M. le rapporteur vient de le rappeler, au-delà de toute logique partisane afin d’organiser de manière plus efficace les transports scolaires en Île-de-France.
Hier après-midi, nous avons reçu, avec M. le Président de la République, les familles endeuillées par le terrible accident qui est survenu sur un passage à niveau en Haute-Savoie. Nous le savons bien, les Français sont toujours émus par les accidents qui concernent les transports scolaires, car il s’agit de la sécurité de nos enfants.
L’organisation des transports scolaires constitue donc un axe important de toute politique des transports. C’est également le moyen de faire en sorte que nos enfants prennent l’habitude d’utiliser les transports collectifs afin d’acquérir ce réflexe lorsqu’ils seront plus grands, surtout à une époque où le pétrole atteint de tels cours.
Je le répète, l’organisation des transports scolaires est importante dans notre société, dans nos régions et, bien sûr, dans la région capitale d’Île-de-France.
Les deux propositions de loi que vous avez présentées, monsieur le rapporteur, répondent aux objectifs visés par le Gouvernement. Comme vous, nous pensons que le dispositif prévu par la loi du 13 août 2004 doit être aménagé.
Vous l’avez rappelé, dans la région d’Île-de-France, la responsabilité de l’organisation et du financement des transports scolaires incombent au STIF depuis le 1er juillet 2005. À cette date, près de 400 organisateurs locaux, principalement des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, s’occupaient des quelque 1 300 circuits de transports scolaires.
Pendant la période transitoire de trois ans prévue par la loi, la plupart de ces organisateurs locaux ont poursuivi leur activité. Aujourd’hui encore, ils demeurent impliqués dans l’organisation des transports scolaires. Je dirais que la qualité de ces organisateurs locaux est d’être sur le terrain et donc de savoir adapter finement les circuits des transports scolaires aux besoins des clients de façon souple et pragmatique.
Je viens d’évoquer le terrible drame qui est survenu sur un passage à niveau. À cet égard, j’ai demandé aux préfets de chaque département de vérifier auprès des présidents de conseil général que les transports scolaires n’empruntent pas les passages à niveau où des accidents ont déjà été déplorés.
La mise au point de circuits de transport est donc un travail très compliqué, qui ne peut être exécuté que finement sur le terrain.
Vos propositions de loi visent, d’ailleurs, à garder cette souplesse d’organisation.
Vous demandez que les départements de la région d’Île-de-France auxquels le STIF souhaite déléguer une partie de sa compétence d’organisation des transports scolaires puissent subdéléguer à leur tour tout ou partie de cette compétence à d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, afin que les services soient gérés localement, au plus près des attentes des usagers.
Bien évidemment, il convient que le STIF conserve une compétence globale en matière d’organisation des transports scolaires en Île-de-France puisqu’il est le mieux à même de coordonner les services spéciaux scolaires et les transports réguliers, ainsi que de favoriser l’intégration tarifaire pour les usagers.
Toutefois, l’exercice de ces responsabilités n’est pas incompatible avec la possibilité de déléguer l’organisation sur le terrain des transports scolaires à des autorités organisatrices plus proches des usagers.
Comme dans les autres régions de France, le département apparaît – je pense notamment à la grande couronne – comme le niveau d’organisation le plus pertinent.
Cependant, l’intervention d’organisateurs locaux, plus proches encore du terrain, doit rester possible. C’est même essentiel pour rendre le fonctionnement des transports scolaires optimal.
Une organisation sur trois niveaux – le STIF, le département, les organisateurs locaux – me semble bien convenir à la région Île-de-France, compte tenu de l’organisation spécifique de ses transports et du très grand nombre d’acteurs impliqués dans les transports scolaires.
Par ailleurs, vous prévoyez, monsieur le rapporteur, la prolongation pour une durée de trois ans de la période transitoire, qui viendra à expiration le 30 juin prochain, d’où la nécessité de légiférer rapidement.
Cette prolongation m’apparaît nécessaire puisqu’elle garantit la continuité du service public pendant la mise en place des délégations de compétences dans ce nouveau cadre juridique.
En l’absence de prolongation de cette période transitoire, le STIF serait subrogé dès le 1er juillet prochain aux droits et aux obligations des organisateurs locaux. À ce titre, il devrait assurer, vous l’avez indiqué, le suivi quotidien des 1 300 circuits spéciaux scolaires.
Il lui reviendrait de gérer les contrats en cours d’exécution, qui sont de l’ordre de 150 contrats, de conclure environ 450 nouveaux contrats avant la prochaine rentrée scolaire et d’encaisser la participation financière des familles. C’est une question de bon sens : le STIF ne pourra pas assurer toutes ces missions pour la rentrée scolaire de septembre 2008 !
Vous proposez d’organiser la mise à disposition des personnels de l’État, ce qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi actuelle et ne modifie pas les droits des fonctionnaires des services ou parties de services qui ont vocation à être transférés au STIF au titre de la compétence des transports scolaires.
Dès la parution du décret, ces agents pourront opter pour leur intégration dans la fonction publique territoriale ou pour leur maintien dans la fonction publique d’État. Dans cette dernière hypothèse, ils seront placés en position de détachement sans limitation de durée.
Dans un contexte où le pétrole est cher, il est indispensable de proposer aux parents une solution de remplacement à la voiture individuelle pour conduire leurs enfants à l’école. Nous devons faire durablement évoluer les habitudes.
La sûreté et la sécurité de ces transports sont très importantes. Nous faisons un effort considérable pour équiper les autocars de ceintures de sécurité. Leur port est obligatoire pour les automobiles depuis 1999. Nous avons également l’intention de mettre en place le plus rapidement possible des éthylotests antidémarrage.
Il faut donc que nous entourions ce transport scolaire d’un grand nombre de garanties et de sécurités.
Au moment même où se déroule à Paris le salon européen de la mobilité, on mesure bien l’importance de toutes ces propositions.
J’ajoute enfin que ces propositions de loi s’inscrivent dans l’esprit du Grenelle de l’environnement.
Le Gouvernement souscrit donc bien volontiers à cette nouvelle organisation des transports scolaires en Île-de-France et remercie la commission du travail qu’elle a réalisé sur ces propositions de loi. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis heureuse de constater que l’on s’intéresse au sort des transports en Île-de-France.
M. le rapporteur a rappelé que, depuis longtemps, l’Île-de-France dispose d’une organisation dérogatoire en matière de transports scolaires par rapport au régime de droit commun applicable dans les autres régions.
Pour toutes les autres régions hors Île de France, la question avait été réglée en 1982, grâce à la loi d’orientation des transports intérieurs, ou LOTI. Toutefois, en ce qui concerne l’Île-de-France, je crois me souvenir qu’une convention avait pu être signée avec l’État donnant compétence au conseil général de l’Essonne, qui est un département de la grande couronne.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit la prise en charge par le STIF de l’ensemble des transports publics en Île-de-France. Vous l’avez rappelé, la période dérogatoire de trois ans s’achevant au 1er juillet 2008, nous étions confrontés à une vraie difficulté.
Je souhaite, une fois n’est pas coutume, remercier le Gouvernement d’avoir accepté d’inscrire à l’ordre du jour prioritaire de notre assemblée l’examen de ces textes.

Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, je vous rappelle que, lors de l’examen en première lecture de la loi de 2004, mes collègues socialistes Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne, et Jean-Yves Mano, alors sénateur de Paris, avaient alerté le Gouvernement, ainsi que le rapporteur, sur la nécessité de donner au STIF la possibilité de déléguer tout ou partie de l’organisation des transports scolaires. Une fin de non-recevoir fut opposée aux amendements qu’ils avaient déposés à l’époque.
Les acteurs de 2004 n’ont plus les mêmes responsabilités en 2008, mais nous les retrouvons aujourd'hui. Notre ancien collègue M. Roger Karoutchi, maintenant secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je le sais, a fait en sorte que nous débattions aujourd'hui de ces propositions de loi.
Le Gouvernement et sa majorité parlementaire tentent de réparer l’erreur d’appréciation qu’ils avaient commise à l’époque. Je me réjouis que, trois ans après l’examen de la loi de 2004, le Gouvernement entende la mise en garde formulée à l’époque par le groupe socialiste.
C’est pourquoi, avec mes collègues, nous avons déposé un texte identique à celui de la commission. Je veux rendre hommage à notre collègue Jean-Claude Frécon, premier signataire de la proposition de loi du groupe socialiste, qui a ardemment travaillé pour alerter le Gouvernement sur l’urgence de cette situation et pour trouver une solution réaliste.
L’article 1er est d’abord son œuvre en tant que président de l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public, l’ANATEEP.
Les deux propositions de loi, comme le mentionne M. le rapporteur, bénéficient d’un large consensus politique. Nous avons la volonté commune de faire enfin entrer la région Île-de-France dans le droit commun en matière d’organisation des transports scolaires.
De plus, monsieur le rapporteur, vous et moi avons un intérêt direct puisque notre département d’élection, la Seine-et-Marne, est particulièrement concerné.

À la lecture du tableau qui figure dans votre rapport, nous constatons que la subdélégation est très importante pour la Seine-et-Marne dans la mesure où ce département dispose du territoire le plus étendu d’Île-de-France et du nombre d’organisateurs locaux le plus important.
Nous savons tous, en tant qu’élus locaux, que les transports scolaires revêtent une importance considérable auprès des parents d’élèves et des maires. Il ne se passe pas d’année sans que nous ayons un conflit à régler avec les organisations de transports locaux, notamment lorsqu’il s’agit de partenaires privés.
La spécificité des départements de la grande couronne peut être prise en compte au travers de ces propositions de loi, car il faut donner une base législative à l’organisation des transports scolaires assurée par les communes, les établissements de coopération intercommunale, les départements, qui prennent des engagements financiers.
Les délégations en cascade peuvent sembler baroques à certains juristes, mais c’est la première fois, me semble-t-il, qu’un texte législatif reconnaîtra le principe de subsidiarité et implicitement le principe de la collectivité chef de file, en l’occurrence le STIF.
Nous avions plaidé pour une telle solution en 2004. Aujourd’hui, nous sommes entendus. De plus, la subdélégation permettra aux parents d’avoir un système plus lisible, donc plus démocratique. Il est difficile de comprendre qui est responsable de quoi en Île-de-France en ce qui concerne les transports scolaires ! L’article 1er vise donc à régler ce problème.
Concernant l’article 2, la nouvelle rédaction proposée par la commission, qui proroge pour une durée de trois ans la période durant laquelle les différentes parties pourront s’organiser pour exercer la compétence « transports scolaires », est sage. Cette disposition, qui permettra aux départements de poursuivre ou d’engager la négociation avec le STIF sur les conditions de mise en œuvre de la délégation, va dans le sens de la recherche de l’efficacité et du respect de la spécificité du territoire francilien.
Il reviendra aux acteurs de ne pas faire traîner les négociations en longueur. Il ne serait pas souhaitable de constater dans trois ans que l’objectif n’a pas été atteint alors que nous disposerons d’une base législative.
Enfin, je souhaite que les articles 3 et 4 – monsieur le secrétaire d'État, vous y avez clairement fait allusion – mettent fin à une situation anormale en ce qui concerne le personnel.
M. Michel Houel l’indique dans son rapport, le STIF « ne dispose pas du personnel qui devait lui être transféré, mais quand bien même ce transfert aurait eu lieu, le statut actuel de la fonction publique aurait rendu impossibles de nouvelles mises à disposition ou des détachements de ces fonctionnaires au bénéfice des départements ».
Je souligne, monsieur le secrétaire d'État, que la situation actuelle est paradoxale. Dans mon département, le conseil général, qui ne dispose pas de jure de la compétence « transports scolaires », met à disposition deux de ses agents, qu’il paie. C’est assez rocambolesque ! Il est indispensable que les dispositions soient prises pour rendre effectifs ces transferts de personnels.
Les articles 3 et 4 ouvriront cette voie dès lors que les conventions de délégation entre le STIF et les départements seront conclues.
Pour terminer, je souhaite que ces propositions de loi achèvent définitivement le transfert de personnels de l’État vers le STIF, dont l’histoire a été compliquée. Je pense notamment aux négociations imparfaites, du point de vue de la région Île-de-France et du STIF, sur les transferts financiers.
J’ai bien relevé dans les débats qui ont lieu en dehors de cet hémicycle, mais qui reviendront devant nous à un moment ou à un autre, le regain d’intérêt que l’État manifeste pour l’Île-de-France.
La loi de 2004 doit aujourd'hui être assumée par tous. La décentralisation a eu lieu, même si elle n’a pas toujours donné les résultats que l’on en attendait. Tous les acteurs sont mis devant leur responsabilité face aux besoins immenses de l’Île-de-France en matière de transports en général et de transports scolaires en particulier.
Il revient maintenant à tous les acteurs de s’impliquer, État, régions, départements et collectivités. Les familles ne feront pas la différence entre ce qui incombe aux uns et ce qui incombe aux autres. Soyons sérieux et engageons nos responsabilités, qu’elles soient financières ou législatives.
En tout état de cause, c’est ce que nous faisons aujourd'hui sur le plan législatif, et je m’en réjouis !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements de la région Île-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions, à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord. »

L'amendement n° 1, présenté par MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé
par les mots :
, syndicats mixtes, établissement d'enseignement, associations de parents d'élèves ou associations familiales
La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je note que la parole ce matin est bien « seine-et-marnaise » !
Sourires.

Après la présentation de M. le rapporteur et après l’intervention de notre collègue Mme Nicole Bricq, chacun d’entre nous aura bien compris la motivation des auteurs des propositions de loi et saisi l’urgence qu’il y a à adopter de telles dispositions avant le 30 juin prochain.
II n’est donc nullement utile que je revienne sur les arguments qui vous ont été présentés pour justifier la prolongation du délai transitoire prévu par l’article 41 de la loi du 13 août 2004.
Ainsi, nous souscrivons sans aucun problème aux articles 2 et suivants des propositions de loi soumises à notre débat.
Notre amendement porte, quant à lui, sur l’article 1er, qui pose le principe de la double délégation.
Si nous sommes favorables à ce principe, nous sommes plus réservés sur les possibles destinataires de cette délégation de compétence, devenant par là même autorités organisatrices secondaires.
En effet, le texte que vous nous proposez dispose que cette délégation peut se faire au profit de personnes publiques ou privées. Nous aurions préféré une énonciation exhaustive des personnes morales de droit privé pouvant être délégataires de l’organisation du service de transport scolaire.
Dans la rédaction actuelle de l’article 1er de l’ordonnance de 1959, modifiée par la loi du 13 août 2004, cette délégation ne peut se faire qu’au profit de personnes publiques ; c’est le cinquième alinéa du paragraphe II. Seule l’exécution matérielle du service peut faire l’objet d’une délégation à une entreprise privée ou à une association ayant passé convention avec l’autorité compétente.
Hors Île-de-France, l’organisation du service peut être déléguée à des personnes morales de droit privé limitativement énoncées dans le code de l’éducation aux articles L.213-11 et L.213-12. Ainsi, les conseils généraux peuvent confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités organisatrices secondaires par délégation du département.
L’objet de cet amendement est donc de rapprocher le régime juridique de l’organisation des transports scolaires en province de celui qui s’applique en Île-de-France.
Nous estimons qu’une définition limitative des personnes morales de droit privé pouvant, par délégation, organiser la desserte des transports scolaires, excluant de fait le secteur marchand, est nécessaire au regard de la dimension d’intérêt général inhérente à cette mission.

Monsieur Billout, permettez-moi tout d’abord de rappeler brièvement l’état du droit en matière de transports scolaires.
Le décret du 4 mai 1973 relatif à l’organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves prévoyait que les services de transports scolaires étaient assurés par les départements, mais qu’ils pouvaient également l’être, à défaut, ou dans la mesure où il en résulterait une moindre dépense totale, soit par les communes et leurs groupements, soit par les établissements d’enseignement, soit par les associations de parents d’élèves et les associations familiales, pour les circuits existants dont elles sont organisatrices à la date du présent décret.
L’article 28 du décret du 10 juin 2005, portant statut du STIF et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, a abrogé ce décret de 1973.
Toutefois, ce même article 28 autorise les organisateurs de transports scolaires à continuer d’appliquer les dispositions du décret du 4 mai 1973 précité pour la conclusion des contrats en vue de la campagne scolaire 2005-2006.
En outre, les contrats conclus avant la publication du décret de 2005 peuvent être poursuivis jusqu’au terme prévu par leur stipulation et ils peuvent même être renouvelés dans la limite de la période transitoire de trois ans, dont nous avons parlé précédemment.
L’expression « personnes morales de droit privé » retenue par les deux propositions de loi me semble préférable à une énumération stricte des personnes autorisées à recevoir délégation de compétences des départements en matière de transports scolaires.
Premièrement, le dispositif des deux propositions de loi a fait l’objet d’une large concertation, et nous devons les adopter en urgence avant le 1er juillet 2008. Nous devons donc agir avec circonspection avant de modifier une disposition. D’ailleurs, à ce sujet, mon cher collègue, nous avons interrogé le STIF, qui nous a confirmé que la formule retenue dans le texte lui convenait très bien.
Deuxièmement, il convient de rappeler que 93 % des organisateurs locaux sont aujourd’hui des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. L’amendement n° 1 ne porte donc pas sur un enjeu majeur.
Troisièmement, l’expression « personnes morales de droit privé » offre une plus grande souplesse au STIF et aux départements pour organiser le transport scolaire. Ainsi, en l’état actuel du texte, toute association qui n’a pas pour objet exclusif le transport de personnes, ce qui est interdit par la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, pourra organiser des transports scolaires.
Enfin, je crois pouvoir vous rassurer, mon cher collègue, en vous disant que, selon les informations dont je dispose, le STIF et les départements franciliens n’ont pas du tout l’intention de déléguer leurs compétences en matière d’organisation des transports scolaires à des sociétés privées commerciales. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une délégation de service public.
C’est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Je veux bien croire qu’il ne soit pas dans l’intention de l’actuel président du STIF de déléguer ses compétences à un organisateur de transports privés, mais les choses peuvent évoluer.

Il me semble donc que, de ce point de vue, la loi ne peut pas être rédigée en fonction des acteurs présents, et qu’il est bon, dans ce secteur, qui est extrêmement sensible, et où l’intérêt général doit absolument continuer à prévaloir, d’encadrer de façon exhaustive les personnes morales de droit privé qui pourraient obtenir cette délégation liée à l’organisation des transports scolaires.
C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
Dans le II de l'article 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ». –
Adopté.
L'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans la région Île-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et un département de la région, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du conseil général.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d'Île-de-France. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » –
Adopté.
Après le III bis de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III ter. - Dans la région Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d'Île-de-France en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d'un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat. » –
Adopté.


Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer l’initiative de notre collègue Michel Houel qui a déposé et rapporté cette proposition de loi sur les transports scolaires en Île-de-France ainsi que celle de nos collègues socialistes, qui ont présenté un texte identique.
Ce texte constitue une réponse simple et consensuelle à des difficultés d’ordre technique et juridique qui sont apparues dans l’organisation des transports scolaires dans notre région en application de la loi de 2004, ainsi que l’ont rappelé les différents intervenants.
Je ne détaillerai pas le dispositif choisi qui consiste, à titre principal, à prolonger la période de transition prévue par la loi. Mais je soulignerai le résultat qu’il permettra d’atteindre, continuer d’offrir à nos concitoyens un service de proximité indispensable afin d’assurer à chacun la capacité de se déplacer pour étudier dans la ville de son choix.
C’est pourquoi j’apporterai tout mon soutien à ce texte en tant qu’élu des Yvelines – en effet, cela ne concerne pas exclusivement la Seine-et-Marne - mais aussi en tant que porte-parole du groupe UMP, qui votera cette proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée.

Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des présents.
Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme la ministre de l’intérieur, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures quarante-cinq.

L’ordre du jour appelle la discussion en troisième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (nos 344, 372).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord d’excuser mon retard. Il était en effet prévu de longue date que je sois entendue conjointement par la commission des finances et la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de règlement du budget de l’année 2007.
Avant d’en venir au projet de loi lui-même, permettez-moi de souligner la qualité des échanges auquel il a donné lieu entre le Sénat et l’Assemblée nationale. À l’heure où, dans le débat sur l’avenir de nos institutions, certains voudraient remettre en cause le bicamérisme, cela montre combien le dialogue des deux chambres est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie et à l’amélioration des textes.
En effet, ce projet de loi a connu de véritables améliorations grâce au travail effectué par les parlementaires des deux assemblées. Je tiens tout particulièrement à saluer le travail du rapporteur de votre commission des lois, Jean-Patrick Courtois, et du rapporteur pour avis de votre commission des affaires économique, Dominique Braye.
Dès le départ, j’ai souhaité – car je pense que c’est de bonne méthode législative – que les projets de décret d’application de ce projet de loi puissent être établis sur la base des premiers débats parlementaires et soient transmis, le plus rapidement possible, avant même la conclusion de ces débats, à tous les sénateurs et députés. C’est seulement ainsi qu’il est possible d’obtenir une vue d’ensemble du dispositif en discussion, dans le respect du partage du travail entre le Parlement et le Gouvernement.
Je ne rappellerai que très brièvement les grands axes de ce projet de loi que vous connaissez déjà parfaitement et qui est fondé sur la responsabilisation des propriétaires et détenteurs de chiens.
En effet, plusieurs accidents survenus au cours des derniers mois ont montré l’insuffisance des dispositions législatives antérieures relatives aux chiens dangereux. Il apparaissait donc nécessaire de franchir une nouvelle étape, celle de la responsabilisation des propriétaires et détenteurs de chiens, tant sur la voie publique – où le droit existant permettait déjà d’exercer un certain contrôle – que dans la sphère privée puisque de nombreux accidents sont survenus dans ce cadre.
La prévention est le préalable nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilisation. Ce texte en organise les conditions, tout en prévoyant de nouvelles sanctions contre les comportements dangereux : c’est la seule façon de rendre effective la prévention.
Aujourd’hui, seuls trois articles restent en débat.
Deux de ces articles, portant sur la prévention des accidents causés par les chiens dangereux, ont été supprimés, en tout ou en partie, par l’Assemblée nationale. Il s’agit, d’une part, du I de l’article 4 bis, qui instaurait une évaluation comportementale obligatoire pour tous les chiens âgés d’un an et répondant à des critères de poids définis par voie réglementaire, et, d’autre part, de l’article 13 bis, supprimé par coordination puisqu’il fixait les modalités d’entrée en vigueur du dispositif créé par le I de l’article 4 bis.
Cette double suppression est en cohérence avec les mesures prévues pour améliorer la prévention : l’instauration d’un certificat vétérinaire obligatoire pour tous les chiens, la création d’un permis de détention pour les chiens dangereux et la formation obligatoire pour les détenteurs de chiens dangereux.
Le dernier article en discussion porte sur le renforcement des sanctions contre les comportements dangereux, corollaire de la responsabilisation. Il s’agit de l’article 5 ter, relatif à la réglementation des activités privées de sécurité, qui précise les modalités de sanction d’un agent cynophile.
D’autres mesures s’inscrivent dans cette perspective. Ainsi, les faits d’imprudence grave pouvant entraîner la mort doivent faire l’objet d’une répression aggravée et graduée. De même, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux doivent donner lieu à une réponse pénale plus efficace, au moyen d’une formation de jugement composée d’un seul magistrat, ce qui permettra d’accélérer les procédures.
Les dispositions restant en discussion se situent, en tout état de cause, dans la cohérence du projet de loi tel qu’il résulte de la navette parlementaire. Je pense que nous sommes parvenus à un texte équilibré, conformément au souhait de votre assemblée.
Pour nombre de Français, les chiens sont des compagnons de la vie quotidienne, mais les chiens dangereux représentent une menace réelle et concrète pour la sécurité de tous nos concitoyens. Nous avons le devoir de permettre à chacun de vivre en toute tranquillité, en toute sécurité et en toute confiance : c’est ainsi que nous pourrons créer une société plus apaisée et plus responsable.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection contre les chiens dangereux, adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 15 mai 2008, nous revient en troisième lecture. Il est donc temps de conclure un débat qui a commencé en octobre 2007, afin que cette loi puisse rapidement entrer en vigueur.
Avant toute chose, madame le ministre de l’intérieur, je voudrais saluer votre engagement en faveur de l’aboutissement de cette réforme, ainsi que la collaboration efficace entretenue jusqu’à aujourd’hui avec mes collègues Catherine Vautrin, rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, et Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat.
Il faut le souligner, le Sénat a fortement influencé la rédaction du texte et, en deuxième lecture, l’Assemblée nationale a, pour l’essentiel, validé la philosophie d’ensemble que nous avons développée dès le départ, avec mon collègue Dominique Braye.
L’Assemblée nationale a ainsi accepté d’encadrer par une qualification professionnelle spécifique l’activité des agents de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens, de faciliter la mise en œuvre du permis de détention des chiens de première et deuxième catégories en excluant les détenteurs temporaires de l’obligation de permis, ou encore, de mieux définir l’objet du fichier national canin. En outre, elle a accepté l’observatoire préconisé par nos collègues du groupe socialiste.
Deux points restent à trancher.
Tout d’abord, à l’article 5 ter, l’Assemblée nationale a complété le dispositif pour préciser les sanctions encourues par un agent de sécurité et de surveillance utilisant un chien qu’il détiendrait dans des conditions inacceptables. Cet agent s’exposerait ainsi au retrait sa carte professionnelle, ce qui est une bonne chose.
Ensuite, l’Assemblée nationale a de nouveau rejeté l’extension de l’évaluation comportementale aux « gros chiens » qui n’appartiennent pas aux catégories de chiens dangereux définies par la loi. En effet, afin de détecter les troubles du comportement chez un chien et d’éclairer le maire dans ses décisions à son sujet, nous avions étendu, sur l’initiative de notre collègue Dominique Braye, le dispositif d’évaluation comportementale à tous les chiens âgés d’un an et répondant à des critères de poids définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
Les députés ont estimé que l’application de ce dispositif serait difficile, mettant en avant le coût de la mesure et l’importance du « stock » existant de chiens susceptibles d’être soumis à évaluation comportementale. J’en prends acte.
Tout comme mon collègue Dominique Braye, je vous demanderai simplement, madame le ministre, de bien vouloir veiller à ce que la tarification des évaluations comportementales demeure raisonnable pour les propriétaires de chiens, car il s’agit d’une condition essentielle pour le succès de ce dispositif. Nous serons vigilants sur ce point dans l’évaluation de l’application de la loi.
Aussi, tout en maintenant mes réserves sur les limites actuelles des catégories de chiens dangereux définies par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, catégories qui doivent évoluer, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter ce projet de loi sans modification.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Férat.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous allons examiner aujourd’hui nous revient en troisième lecture, après avoir été discuté à deux reprises par chacune de nos assemblées.
Largement amendé, ce projet de loi est un texte majeur pour notre législation en matière de chiens dangereux et devient précurseur à l’échelle européenne. Il comble en effet les lacunes de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, pionnière en ce domaine, mais qui a laissé subsister de nombreuses failles dans la législation.
Le projet de loi que nous nous apprêtons à adopter satisfait donc à l’objectif qu’il aurait dû viser dès le départ : responsabiliser les propriétaires de chiens considérés comme dangereux.
Il a le grand mérite d’insister sur la question de la prévention, primordiale pour endiguer la multiplication d’accidents que nos concitoyens ont eu à subir ces dernières années. Il ne néglige pas pour autant les sanctions applicables aux propriétaires de chiens dangereux ; il tend même à les renforcer.
Prévention et répression sont ainsi les deux piliers de ce texte majeur, qui atteint son but grâce à quatre dispositions principales.
Tout d’abord, il s’agit de vérifier la capacité des personnes à détenir des chiens dangereux grâce à une formation spécifique sanctionnée par une attestation d’aptitude. Je rappelle que nous avions présenté, dès l’été dernier, avec mon collègue Yves Détraigne, une proposition de loi tendant à créer un « permis de détention ». En effet, trop de propriétaires de chiens dangereux sont manifestement inaptes à les contrôler, et ces mêmes chiens deviennent, entre leurs mains, des armes d’une extrême dangerosité pour les plus faibles – et pour eux-mêmes !
Il s’agit également d’imposer une évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories, afin d’apprécier a priori la dangerosité potentielle des chiens concernés.
Il est ensuite nécessaire, pour contrôler la population de chiens en circulation, d’encadrer fermement la vente et la cession des chiens dangereux. Il faut en contrôler plus précisément les effectifs afin d’influer sur eux plus efficacement.
Enfin, le texte a largement amélioré la procédure pénale relative aux infractions liées aux chiens dangereux, en coordonnant de nombreuses dispositions jusqu’ici hétéroclites.
Je voudrais également profiter de cette discussion générale, madame le ministre, pour vous interpeller sur un point qu’a soulevé un agent de police municipale et qui gagnerait à être pris en compte dans le décret d’application du texte dont nous discutons.
En effet, pour mettre en œuvre ce projet de loi, de nombreuses catégories de professions vont être chargées de la capture des chiens dangereux. Cette capture suppose le port d’un costume dit « de dressage au mordant », assurant une protection. Il existe un vide juridique à ce sujet, car ce genre de vêtement ne peut être officiellement porté que par les membres d’associations ou de clubs pratiquant cette activité ainsi que par les fonctionnaires de la police nationale, les gendarmes, les douaniers et tous les utilisateurs de chien. Or, à ce jour, aucun texte ne permet à un service de police municipale d’acquérir et de détenir des costumes de ce type. Je vous prierai donc, madame le ministre, de trouver une solution à cette question, dont le règlement semble relativement simple.
Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l’endiguement du « phénomène pitbull » constituera un travail de longue haleine, nécessitant que tous les acteurs de terrain se mobilisent conjointement. Le « risque zéro » n’existe pas, nous le savons bien, mais le risque d’accident peut être considérablement réduit grâce à une politique de formation adaptée et à la menace de sanctions contre la négligence éventuelle des propriétaires.
Si ce projet de loi est adopté – et je ne doute pas qu’il le sera –, la France sera le pays européen le plus en avance sur la question épineuse des chiens dangereux.
Certes, plusieurs points restent en suspens, comme l’extension de la procédure d’évaluation comportementale aux chiens n’appartenant pas aux première et deuxième catégories mais qui, en raison de leur poids ou de leur âge, présentent un risque pour leur entourage. Malgré tout, nous aurons fait un grand pas dans la bonne direction. Le groupe UC-UDF votera donc ce texte, même si des progrès méritent encore d’être accomplis.
Il me reste à remercier et à féliciter nos rapporteurs, mes collègues députés et sénateurs pour leur excellent travail sur ce projet de loi, ainsi que vous, madame le ministre, pour votre implication et votre apport constructif à ce débat parlementaire.
Applaudissements sur le banc de la commission.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici invités à conclure les débats sur le projet de loi relatif aux chiens dits dangereux par un examen en troisième lecture devant la Haute Assemblée.
Au cours de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, les députés ont apporté deux modifications substantielles au texte issu de nos travaux.
Premièrement, les articles 4 bis et 13 bis, portant sur la question centrale de l’évaluation comportementale des chiens pressentis dangereux, ont été supprimés. Je regrette profondément que les dispositions votées ici en deuxième lecture aient été balayées par l’Assemblée nationale.
Je rejoignais totalement les propositions de notre collègue Dominique Braye visant à appréhender la dangerosité potentielle des chiens autrement que par leur seul classement dans les première et deuxième catégories : en effet, en toute rigueur scientifique, ce sont le poids et la puissance de la mâchoire de l’animal qui sont les facteurs déterminants de la gravité de la morsure.
Les arguments de second ordre invoqués par nos collègues députés pour supprimer les articles que nous avions adoptés ne pèsent rien par rapport à ces considérations scientifiques. Souhaite-t-on vraiment réaliser des évaluations comportementales permettant de prévenir effectivement les risques de morsures graves ou se contente-t-on de faire de l’affichage ? Quoi qu’il en soit, nous déplorons fortement ce recul.
Deuxièmement, un article 5 ter relatif aux conditions d’utilisation d’un chien dans le cadre des activités privées de sécurité a été introduit. Cet article valide le dispositif adopté en deuxième lecture au Sénat, en le précisant judicieusement. Notre groupe y est donc favorable.
Au final, on nous demande un vote conforme sur un texte qui reste entaché de sa « tare originelle » : chercher à répondre au diktat de l’urgence médiatique et du compassionnel. Non qu’il ne faille pas penser aux victimes de ces accidents dramatiques, bien au contraire ; cependant, si nous avions véritablement voulu prendre en compte la souffrance de ces victimes, pour la plupart des enfants, nous aurions légiféré sur le sujet dans toute sa complexité, en évitant les raccourcis.
Nous avons bien travaillé et su faire émerger des propositions constructives, au-delà des clivages politiques, ce qui me réjouit profondément. Mais le texte qu’on nous demande d’adopter pose à notre groupe trois problèmes de fond.
Tout d’abord, il reste marqué par la notion de caractérisation génétique. Celle-ci est parfaitement inopérante si l’on souhaite relever le défi des morsures graves : plus de 80 % des morsures mortelles sont le fait de chiens n’appartenant pas aux fameuses première et deuxième catégories. Il en est ainsi des labradors et bergers allemands, qui sont les premiers chiens tueurs dans notre pays, mais ne sont pas visés par les dispositions d’évaluation prévues dans le texte.
Cette caractérisation génétique exclusive est stigmatisante pour les chiens, bien sûr, mais aussi et surtout pour leurs propriétaires. Or chacun sait que le problème de comportement d’un chien n’est pas principalement d’ordre génétique, mais provient de l’éducation qu’il a reçue en termes de socialisation, surtout en bas âge : tel maître, tel chien.
Ensuite, le texte privilégie outrageusement la répression.
Je me dois de le rappeler, la plupart des accidents graves se déroulent dans la sphère privée et, dans ce contexte, la solution au problème que nous avons à traiter – la diminution des accidents par morsures graves – relève d’abord de la prévention et de la sensibilisation des familles et des victimes prioritaires que sont les enfants.
C’est pourquoi notre groupe dénonce l’approche déséquilibrée du texte, qui fait prévaloir la répression des propriétaires des chiens mordeurs.
Ainsi, l’article 8 bis, qui résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement faisant suite à une initiative médiatique du Président de la République, introduit une disposition aggravant encore le caractère répressif du texte, et dont la pertinence s’effondre dès lors que l’on tente de prendre vraiment en compte la réalité du terrain. En effet, madame la ministre, mes chers collègues, je rappelle que les accidents se déroulent essentiellement dans les familles
Enfin, le texte introduit une injustice notoire à l’égard des familles modestes. En supprimant l’excellent article 12 proposé par le Gouvernement, concernant les dispensaires de protection animale, le texte met en péril ces structures associatives qui jouent un rôle pourtant essentiel dans la prise en charge sanitaire d’animaux appartenant à des familles n’ayant pas les moyens de payer les services des vétérinaires libéraux. C’est une question de santé publique, mais aussi de solidarité avec les familles moins aisées, pour lesquelles l’animal de compagnie joue un rôle important. Cette question est d’autant plus sensible que la période actuelle est marquée par la problématique lancinante du pouvoir d’achat.
Pour ces trois raisons de fond, notre groupe pourrait voter contre le texte proposé. Néanmoins, nous souhaitons prendre acte d’une inflexion significative apportée au cours de la discussion en première et deuxième lectures au Sénat : la création d’un Observatoire national du comportement canin, pierre angulaire de la politique de prévention, si nécessaire, que nous appelons de nos vœux.
Nous nous réjouissons en effet de l’adoption définitive de notre proposition tendant à l’instauration d’un tel observatoire. Je rappelle que sa vocation est de centraliser les statistiques liées aux morsures canines et d’élaborer, de façon interdisciplinaire, des outils scientifiques d’évaluation du comportement canin, en vue de coordonner de grandes campagnes de sensibilisation et de formation aux relations entre l’homme et le chien.
Dans une perspective de diminution des accidents par morsures de chiens, de telles campagnes sont absolument prioritaires. C’est pourquoi je salue la constance avec laquelle la Haute Assemblée a défendu cette position, notamment face à la chambre basse.
Ainsi, cet observatoire représente pour notre groupe une avancée notoire, un outil central dans la prévention des morsures : sa création introduit une inflexion sensible du texte dans le sens de la prévention.
À cet égard, veillons à ce que cette structure ne soit pas une coquille vide : en développant effectivement les actions de prévention et de sensibilisation – à l’instar de celles qui sont menées par la Prévention routière –, nous en ferons un outil efficace pour modifier non seulement les comportements des maîtres, mais aussi celui des premières victimes exposées aux morsures de chiens, à savoir les enfants.
je souhaite que, dans la mise en œuvre de cette dynamique, on donne toute leur place aux praticiens exerçant dans le domaine cynophile, comme les vétérinaires comportementalistes, dont je me suis largement inspiré pour mon travail de recherche et de proposition. À cet égard, je tiens à mentionner l’association de vétérinaires comportementalistes présidée par le docteur Beata, Zoopsy, qui conduit de nombreuses recherches et qui est pour nous une véritable mine de propositions.
Madame la ministre, mes chers collègues, sous le bénéfice de l’ensemble de ces considérations, notre groupe a décidé de s’abstenir sur ce texte, qui reste trop marqué, à nos yeux, par une approche excessivement répressive.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement n’ayant pas provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, nous examinons aujourd’hui en troisième lecture le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Afin de ne pas retarder son entrée en vigueur, le rapporteur de la commission des lois, auquel je souhaite redire tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec lui, nous invite à ne pas poursuivre plus avant la navette et à adopter sans modification le texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Madame le ministre, nous avons toutes les raisons de souhaiter, comme la commission des lois, que ce projet de loi soit rapidement appliqué. Grâce à vous, et grâce aussi – je tiens à le souligner – au travail des deux assemblées, il comporte en effet des avancées notables en matière de prévention des agressions canines.
Sans revenir en détail sur des dispositions dont nous avons longuement débattu, je rappellerai très brièvement quelques-unes des avancées du texte.
Ainsi, en application d’une disposition adoptée dès la première lecture, toute cession d’un chien sera désormais subordonnée – vous l’avez rappelé, madame le ministre –, à la délivrance d’un certificat vétérinaire assurant une pleine information de son acquéreur.
Je citerai aussi, naturellement, la nouvelle obligation de formation imposée aux détenteurs de chiens « classés », qui pourra, en tant que de besoin, l’être également aux propriétaires de chiens mordeurs ou de chiens que l’autorité administrative jugerait potentiellement dangereux. Sans doute cette formation sera-t-elle plus succincte qu’il serait nécessaire. Mais nous comptons sur vous, madame le ministre, et sur le Gouvernement pour user pleinement des moyens que nous lui avons donnés pour en contrôler le contenu et la qualité, car nous savons, comme cela a été souligné tout au long des discussions parlementaires, que c’est directement de la qualité de l’information et de la formation des propriétaires de chiens que dépendra l’efficacité de la prévention des accidents.
La création, à l’initiative de l’Assemblée nationale, du permis de détention de chiens dangereux va dans le sens de la responsabilisation des propriétaires, tout en étant cohérente avec les nouvelles obligations qui leur sont imposées. Je me félicite de ce que le Sénat en ait facilité la mise en œuvre en dispensant de l’obtention de ce permis les personnes auxquelles un chien serait momentanément confié par son maître.
On ne peut également qu’approuver l’élargissement du recours à l’évaluation comportementale introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et qui doit être un élément fondamental de la politique de prévention des morsures canines. Il faut se souvenir que la commission des affaires économiques avait souhaité, pour faciliter l’application des mesures prévues, un encadrement de la tarification des évaluations comportementales. Vous aviez préféré, madame le ministre, envisager la fixation d’un prix de référence, solution qui ne semble pas pouvoir aboutir. Même si je sais que tout n’a pas été mis en œuvre pour trouver une solution efficace, acceptée par toutes les parties, je rappelle qu’il reste possible au Gouvernement, s’il en était besoin, de prévoir une réglementation dans les conditions prévues par l’article L. 410-2, alinéa 2, du code de commerce.
Enfin, grâce à l’initiative parlementaire, le dispositif initial du projet de loi a été complété sur deux points importants.
En premier lieu, la légalisation du fichier national canin, la définition plus précise de son objet et la création de l’Observatoire national du comportement canin permettront – et ce n’est pas trop tôt, oserai-je dire – de remédier à la quasi-inexistence de données statistiques et épidémiologiques sur les agressions canines.
En second lieu, le travail commun des deux assemblées a permis d’élaborer un dispositif qui comble une autre lacune, en rendant obligatoire la formation des agents utilisant des chiens dans le cadre d’activités privées de surveillance et de gardiennage et en encadrant les conditions de cette utilisation.
Je me garderai donc, madame le ministre, mes chers collègues, de minimiser les acquis de ce projet de loi.
Pour autant, et bien qu’il représente la quatrième intervention du législateur pour tenter de régler le problème des chiens dangereux, je doute sincèrement que le présent texte apporte à ce problème la solution efficace que nous cherchons depuis bientôt dix ans. Mais je veux insister sur le fait que, si nous avançons sur ce sujet à très petits pas, la responsabilité n’en revient sûrement pas à notre assemblée, et je suis contraint de constater que le « train de sénateur » est beaucoup trop rapide comparé à celui des autres acteurs de l’élaboration de ce projet de loi !
Sourires

Je me permettrai donc, mes chers collègues, de tempérer le jugement favorable que je porte sur ce texte en exprimant un regret et une crainte.
Je regrette, tout d’abord, que notre dialogue avec l’Assemblée nationale s’interrompe avant que nous ayons pu nous mettre d’accord sur une solution permettant de dépasser les limites évidentes de la catégorisation imposée par la loi de 1999, dont tous les acteurs reconnaissent qu’elle n’est pas pertinente. En effet, cette catégorisation est très largement à l’origine de l’inefficacité de ce texte en matière de prévention des agressions canines.
Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale demeure dominé par cette étrange logique qui consiste à focaliser les mesures prévues sur les chiens de première et deuxième catégories, ou plus exactement sur la minorité de ceux-ci dont les détenteurs se sont conformés à la loi, soit environ 185 000 animaux, représentant moins de 2 % de la population canine.
Or, et vous me permettrez de le rappeler une nouvelle fois, madame le ministre, 93 % des morsures recensées et plus de 75 % des accidents mortels répertoriés sont le fait de chiens qui n’appartiennent pas aux catégories définies par la loi de 1999. Pourtant, c’est bien sur ces dernières que le présent projet de loi concentre l’essentiel de ses dispositions. En clair, nous nous apprêtons à adopter des mesures qui concerneront seulement 2 % de la population canine !
Par deux fois, le Sénat a essayé de sortir d’une telle impasse. Comme cela a été rappelé, notre Haute Assemblée avait proposé un dispositif, l’évaluation comportementale obligatoire des gros chiens, dont l’application n’aurait finalement pas été plus compliquée que l’obligation de délivrance d’un certificat vétérinaire pour toute cession d’un chien. Par deux fois, l’Assemblée nationale a rejeté cette mesure, sans jamais d’ailleurs lui opposer d’argument pertinent, comme notre rapporteur l’avait souligné en deuxième lecture.
Par conséquent, l’application des mesures les plus positives prévues par le projet de loi – je pense notamment au permis de détention, à l’obligation de formation et, surtout, à l’évaluation comportementale – sera limitée à seulement deux cas.
D’une part, cela concernera les chiens classés « en situation régulière », c'est-à-dire, comme je viens de l’indiquer, 2 % de la population canine.
D’autre part, le dispositif s’appliquera également aux chiens mordeurs, à condition toutefois que la morsure ait été déclarée. Mais, comme nous le savons tous, mes chers collègues, l’obligation de déclaration des faits de morsures, qui est déjà prévue par la législation antirabique, est fort peu respectée. Ainsi, le nombre des déclarations est de l’ordre d’environ 10 000 par an seulement. Nous avons déjà évoqué les motifs de cet état de fait, et je n’y reviendrai naturellement pas.
Vous l’aurez donc compris, je regrette véritablement que nous en restions là, simplement en raison du jugement de l’Assemblée nationale, au demeurant non étayé, selon lequel la mesure que nous avions proposée serait difficilement applicable et créerait des contraintes excessives aux détenteurs de chiens. Je le déplore, car cela remet en cause l’efficacité même des dispositions que nous allons adopter.
Au regard des avantages que nous pouvions en attendre, une telle « contrainte », l’obligation de faire procéder à un examen vétérinaire, semblait tout à fait mesurée.
Mes chers collègues, nous partageons tous le souci de ne pas imposer de tracasseries et de dépenses inutiles à nos concitoyens et de permettre à ceux d’entre eux qui le souhaitent de bénéficier de la compagnie d’un chien. Mais nous devons également, et c’est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, veiller à ce que la liberté des uns ne mette pas en péril la sécurité des autres.
Imaginerait-on, pour ne pas créer de contraintes aux personnes souhaitant posséder une voiture, de n’imposer l’obtention du permis de conduire et le respect du code de la route qu’à 2 % des conducteurs ou seulement aux automobilistes qui auraient déjà eu un accident ?
Mes chers collègues, je crains donc que, cette fois encore, nous n’atteignions pas l’objectif que nous nous sommes fixé et que nous ne soyons tôt ou tard conduits à remettre de nouveau l’ouvrage sur le métier. À cet égard, madame le ministre, certains esprits caustiques m’ont demandé si la date du cinquième passage devant le Parlement était déjà fixée.
Sourires.

En outre, tout comme ceux qui l’ont précédé, ce texte se heurtera sans doute à des difficultés d’application et de contrôle. Tous les élus locaux qui sont ici le savent.
En revanche, comme je vous connais, madame le ministre, je ne doute pas de votre détermination à surmonter ces difficultés. D’ailleurs, vous pouvez être assurée de notre soutien. Mais nous aurions préféré que vous disposiez des bons outils pour y parvenir, ce qui ne sera pas le cas une fois ce projet de loi adopté.
Pour notre part, nous espérons que nous serons régulièrement informés de l’application de l’ensemble des dispositions relatives aux chiens dangereux, comme le prévoit d’ailleurs l’article 25 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Mais ne nous leurrons pas, mes chers collègues ! Si ce texte, auquel j’apporterai naturellement mon soutien, ne donne pas les résultats escomptés, c’est d’abord à lui-même que le Parlement devra s’en prendre, et c’est nous qui en porterons la responsabilité devant nos concitoyens !
Et, au moment où nous allons conclure nos débats sur ce projet de loi, mais en pensant aussi à ceux que nous aurons bientôt sur la réforme de nos institutions, je suis tenté de citer M. Philippe Séguin, ancien président de l’Assemblée nationale, qui déclarait : « C’est d’abord en chacune et en chacun de nous que se trouvent les réponses aux critiques adressées au fonctionnement de notre système parlementaire. »
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite d’abord saluer de nouveau la qualité du travail effectué par les parlementaires et souligner combien le dialogue que j’ai noué avec eux s’est révélé fructueux.
À cet égard, je tiens tout particulièrement à remercier Mme Catherine Vautrin, rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur ce projet de loi, M. Jean-Patrick Courtois, le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. le sénateur Dominique Braye, ainsi que l’ensemble des parlementaires ayant pris part à ce débat.
Monsieur le rapporteur, comme vous me l’avez demandé, je veillerai, avec la profession vétérinaire, à la modération de la tarification, afin que les familles les plus modestes ne se heurtent pas à un obstacle réel.
M. le rapporteur acquiesce.
Madame Férat, vous avez attiré mon attention sur un vide juridique qui peut poser un réel problème pour les agents de police municipale. Effectivement, le décret du 30 janvier 2004 ne prend pas en compte le cas de figure que vous avez évoqué. Je suis donc décidée à combler cette lacune.
J’en profite d’ailleurs pour saluer l’engagement des policiers municipaux au service de la sécurité des Français. Ces agents sont souvent les premiers à se trouver confrontés aux problèmes dont nous débattons aujourd'hui.
En l’occurrence, nous nous heurtons à une petite difficulté, puisque, s’agissant d’un décret en Conseil d'État, la procédure est nécessairement plus lourde. Aussi, nous pourrions peut-être envisager de déclassifier ce texte : on ne voit pas l’intérêt d’une telle lourdeur juridique pour ce type de problèmes !
Sourires.
Monsieur Muller, il convient tout de même de relativiser la prétendue « urgence médiatique ». Je vous rappelle que ce projet de loi a été déposé au Sénat en première lecture au mois d’octobre, et ce à la suite de faits commis plusieurs mois auparavant. Or nous sommes déjà au mois de juin. Par conséquent, nous avons, me semble-t-il, pris du recul ; nous ne légiférons pas dans l’urgence. Je vous rappelle également que plusieurs accidents, concernant notamment des enfants, ont eu lieu entre-temps. Certains ont occasionné des blessures graves, et il y a même eu des morts ! Dans ces conditions, prolonger à l’excès le délai avant d’agir reviendrait à ne pas assumer notre responsabilité collective, qui est de protéger nos concitoyens, en particulier les plus fragiles d’entre eux.
Certes, monsieur le sénateur, vous avez effectivement soulevé un certain nombre de problèmes de fond, notamment s’agissant des catégories de chiens dangereux. Je connais ces difficultés et nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises. À mon sens, la création, d’ailleurs sur votre initiative, de l’Observatoire national du comportement canin devrait nous permettre d’être plus efficaces et d’adopter un certain nombre de mesures.
M. Jacques Muller acquiesce.
Monsieur Muller, je ne partage pas du tout votre analyse sur un point. En soi, le présent projet de loi n’est pas un texte répressif. Au contraire, il insiste sur la prévention. D’ailleurs, toutes les mesures qu’il vise à mettre en place vont dans ce sens.
Toutefois, nous le savons, pour qu’une politique de prévention soit efficace, il faut que chacun des acteurs concernés fasse preuve de sens des responsabilités. Du reste, ce sera le cas pour l’immense majorité d’entre eux. Mais, s’agissant des autres, si nous voulons que toutes les mesures de prévention prévues par la loi entrent effectivement en vigueur, il faut malheureusement maintenir la menace de sanctions.
Je me suis déjà exprimée sur la question du coût des consultations vétérinaires, et le dispositif s’appliquera.
Par ailleurs, la question du droit, pour les dispensaires vétérinaires, de distribuer des médicaments nous renvoie un autre débat. Il ne nous appartient pas de la traiter lors de l’examen du présent texte. D’ailleurs, ce sujet ne relève pas directement de ma responsabilité. Il s’inscrit dans une perspective plus large, et vous aurez – je n’en doute pas – l’occasion de débattre à nouveau de ce dossier.
Monsieur Braye, je vous remercie d’avoir souligné les avancées significatives de ce texte, dont certaines résultent d’ailleurs de votre intervention. Je pense notamment aux dispositions relatives à la déclaration des morsures. Cela me rappelle d’ailleurs un débat auquel j’ai participé tout à l’heure dans une autre assemblée, à propos des violences intrafamiliales que nous connaissons dans un certain nombre d’endroits. C’est aussi le fait d’en parler qui incitera un plus grand nombre de personnes à déclarer. Il y a donc un véritable travail pédagogique à effectuer.
En l’occurrence, il s’agit de la formation des propriétaires des chiens, de la souplesse de la dispense de permis, de la législation sur le fichier national canin, de l’Observatoire national du comportement canin ou de l’amélioration de la réglementation des agents de sécurité privée, même si ce sujet sera de nouveau abordé, d’une manière plus large, dans la prochaine loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la « LOPSI II ». Les avancées sur tous ces sujets sont significatives.
Par ailleurs, je souhaite rappeler un élément sur la question des catégories de chiens. Les chiens d’attaque et de défense restent les plus dangereux, puisqu’ils sont dressés à cela. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’ils sont tous dangereux, ni qu’il n’y a pas de chiens dangereux parmi les autres catégories. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur.
Enfin, j’ai bien noté les souhaits que vous avez exprimés à propos de l’information et du contrôle du Parlement. Comme vous le savez, j’essaie toujours de répondre aux demandes qui me sont adressées en la matière, car j’estime que la réalité et l’autorité de la loi, c’est la garantie de son suivi. Et, à cet égard, vous pouvez en être assurés : j’assumerai pleinement mes responsabilités.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
I. - Supprimé
II. - Non modifié
L'article 4 bis est adopté.
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l'article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ;
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural. » ;
3° L'article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

Je rappelle simplement que le groupe socialiste est favorable à l’article 5 ter.
L'article 5 ter est adopté.

L’article 13 bis a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la troisième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sans revenir dans le détail sur notre position, je rappellerai simplement, à l’occasion de cette troisième lecture, les reproches que les membres du groupe CRC formulent sur ce texte.
D’abord, même après vous avoir entendue, madame la ministre, je continue à penser que le contenu de ce texte est plus répressif qu’éducatif ou préventif, compte tenu notamment de l’aggravation des peines encourues par les propriétaires de chiens en cas d’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité de la personne. Je rappelle d'ailleurs que cette disposition a été imposée par le Président de la République lors de la première lecture au Sénat.
Ensuite, le dispositif que vous proposez, à savoir le certificat d’aptitude du propriétaire, l’évaluation comportementale du chien et le permis de détention des chiens de première et deuxième catégories, revêt à nos yeux plusieurs inconvénients.
Ainsi, la formation du maître pour obtenir l’attestation d’aptitude ainsi que les visites chez le vétérinaire pour réaliser l’évaluation comportementale du chien vont représenter un coût important pour les ménages, dont le pouvoir d’achat est déjà en berne.
De surcroît, la mise en œuvre de cette formation risque d’être difficilement applicable, en raison de la faiblesse du réseau susceptible de la dispenser et du nombre important de propriétaires concernés.
Dans ces conditions, ce texte sera difficilement applicable.
Au-delà de ces remarques, plusieurs questions demeurent en suspens.
Ainsi, rien n’est prévu pour renforcer le contrôle des quelque 100 000 chiots importés en France chaque année, notamment en provenance des pays de l’Est.
Comment ferez-vous pour procéder aux contrôles préventifs indispensables à l’application effective des nouvelles obligations imposées par ce texte aux propriétaires de chiens, aux agents de surveillance, etc. ?
Au moment où le Gouvernement ne parle que de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, de la maîtrise des dépenses publiques, où allez-vous trouver les moyens pour recruter en nombre suffisant les équipes cynophiles qui font actuellement cruellement défaut ?
Par ailleurs, allez-vous débloquer des moyens supplémentaires pour permettre aux maires, largement mis à contribution, de remplir les nouvelles missions qui leur sont imposées par ce texte ? Toute mission supplémentaire exige en effet une contrepartie financière de l’État.
Comme je l’avais évoqué en première lecture, ne pensez-vous pas qu’une campagne de sensibilisation et d’information s’impose, dans les médias par exemple, afin de prévenir les risques liés à la présence de chiens potentiellement dangereux dans la famille, les lieux publics, etc., et de rappeler les obligations des propriétaires de chiens dangereux ?
En tout état de cause, nous voterons une nouvelle fois contre ce texte, qui est, à l’instar d’autres projets de loi, un texte de circonstance.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté définitivement.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.