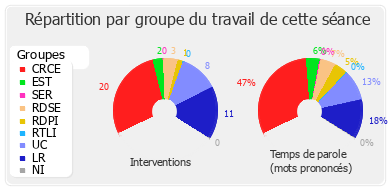Séance en hémicycle du 18 avril 2013 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (texte de la commission n° 515, rapport n° 514).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie hier à l’Assemblée nationale et qui devait examiner les quarante-six articles restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, est parvenue à un accord. Avant de vous en présenter les principaux éléments, je voudrais revenir rapidement sur les travaux du Sénat.
En première lecture, les 11 et 12 février dernier, la Haute Assemblée avait apporté plusieurs modifications.
Je commencerai par le sujet qui a concentré l’essentiel des débats, à savoir la taxe poids lourds.
Le Sénat a d’abord supprimé la prétendue « expérimentation alsacienne », qui avait perdu de sa pertinence compte tenu des retards successifs pris pour sa mise en place. Saisis par ailleurs de multiples demandes d’exonérations diverses et variées, nous avons été, me semble-t-il, raisonnables en n’en introduisant qu’une seule, sur l’initiative de plusieurs de nos groupes politiques, pour les véhicules de l’État et des collectivités territoriales affectés à l’entretien et à l’aménagement des routes. Il nous a en effet semblé quelque peu paradoxal de taxer ces véhicules alors même que la taxe est destinée à assurer en partie le financement de l’entretien des routes. Il est inutile de rappeler que les départements sont déjà très sollicités dans ce domaine, que les routes concernées relèvent de leur compétence ou non.
Le Sénat a également précisé que la liste des routes détenues par les collectivités territoriales faisant partie du réseau taxé pourrait être révisée, à leur demande, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxé.
S’agissant du mécanisme de répercussion, qui était l’objet principal de ce texte, nous avons prévu la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement afin d’en dresser le bilan, et ce pour tenir compte des incertitudes exprimées par certains acteurs concernés. Nous avons également précisé le régime applicable dans le cadre des contrats de location de véhicules avec conducteur.
Quant au reclassement dans la voirie départementale ou communale de ce que l’on appelle les « délaissés routiers », nous avons renforcé les garanties à l’égard des collectivités territoriales en précisant le mécanisme de compensation financière et en retardant l’application du dispositif, afin de laisser au Gouvernement le temps de publier la liste exhaustive des sections de routes concernées.
Dans le domaine du transport ferroviaire, nous avons introduit un nouvel article destiné à renforcer la transparence comptable de la SNCF vis-à-vis des autorités organisatrices de transport, en particulier les régions.
Nous avons également complété le volet maritime de ce texte. À l’article 22 par exemple, concernant le pouvoir de consignation du capitaine de navire, nous avons prévu le cas où le capitaine ne souhaiterait pas séparer l’enfant de ses parents consignés. Nous avons aussi ouvert à la personne consignée la possibilité de communiquer avec le procureur de la République, en plus du juge des libertés et de la détention.
L’Assemblée nationale, de son côté, a également enrichi le texte en complétant quelques dispositions, en précisant certaines formulations et en introduisant de nouveaux articles.
Lors de la commission mixte paritaire, les débats se sont à nouveau concentrés sur la taxe poids lourds, notamment du fait des votes de l’Assemblée nationale. Celle-ci a supprimé l’exonération des véhicules affectés à l’entretien et à l’aménagement des routes, mais exonéré les véhicules à citerne assurant la collecte de lait. Elle a enfin augmenté la minoration applicable aux régions dites « périphériques », en raison, précisément, de leur caractère périphérique.
Les sénateurs membres de la commission mixte paritaire ont exprimé leurs vives réserves sur ces mesures, qui diminuent les recettes de la taxe poids lourds et, partant, l’enveloppe de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, destinée à financer les infrastructures de transport.
Finalement, la commission mixte paritaire a décidé de réintroduire l’exonération pour les véhicules affectés à l’entretien des routes et de maintenir les deux autres mesures votées par l’Assemblée nationale. Je le regrette un peu, mais l’objectif de parvenir à un accord a prévalu sur nos réserves.
J’en viens aux articles introduits par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement ; je n’irai pas jusqu’à dire qu’ils l’ont été de manière cavalière, monsieur le ministre, mais ils l’ont tout de même été de façon un peu précipitée. De fait, le Sénat n’a pas pu les examiner.
Le transfert de propriété de parcelles à Voies navigables de France, ou VNF, et les mesures relatives à l’aérodrome de Hyères sont des mesures ponctuelles qui n’appellent pas de commentaire particulier. Il n’en demeure pas moins que je m’interroge sur la présence de dispositions de ce genre dans un texte législatif.
De même, nous avons compris que le conseil portuaire introduit à l’article 21 ter, sur le modèle du conseil existant pour les grands ports maritimes, répondait à une lacune de notre droit. Une mission doit d’ailleurs prochainement en préciser les contours.
En revanche, nous avons modifié, avec l’accord des députés, l’article relatif à l’expropriation, sur lequel seule l’Assemblée nationale a été consultée, et dans des délais très courts. Après avoir saisi la commission des lois du Sénat, et à la suite d’un échange avec la Chancellerie, nous avons opté pour une nouvelle rédaction, qui paraît plus satisfaisante au regard de notre droit constitutionnel.
Enfin, nous ne sommes pas revenus sur les articles introduits au sujet du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, ou CEREMA. Je vous avouerai que j’avais été un peu surpris, dans un premier temps, de l’ampleur du dispositif. Mais, à la lecture des documents fournis par le ministère, ce dernier apparaît comme le résultat d’un travail engagé voilà plus de deux ans, en lien avec les organisations syndicales, pour améliorer le pilotage stratégique des services techniques, regrouper une dizaine de structures et y associer davantage les collectivités. Nous avons donc fait confiance au Gouvernement sur ce point.
Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire me semble constituer un bon compromis entre les aspirations de nos deux assemblées. Je ne reviens pas en détail sur ses avancées principales, qu’il s’agisse de l’instauration du dispositif qui permettra – enfin ! – la mise en œuvre de l’écotaxe, de l’extension et de l’unification de l’application des conditions sociales de l’État d’accueil pour les gens de mer, qui répond à la question des conditions déloyales de concurrence, ou encore de la simplification des procédures d’expropriation des navires abandonnés. Nous avons longuement débattu de l’ensemble de ces sujets.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à vous prononcer en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC . – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier M. le rapporteur de ses propos. Ce texte, qui nous a beaucoup occupés, est le fruit d’un travail de grande qualité, en particulier dans cette enceinte. Portant sur les différents modes de transport – le maritime, le fluvial, le routier et le ferroviaire –, il a vocation à promouvoir, d’une part, le développement durable, notamment grâce à sa mesure phare, l’écotaxe poids lourds, qui devient effective, d’autre part, une certaine vision du transport de demain.
Nous passons donc, s’agissant de la fiscalité écologique, du principe à la concrétisation.
Sur ce point, le dispositif que je vous ai présenté consiste à organiser le principe de répercussion sur les donneurs d’ordre. Même si celui-ci n’est pas parfait – certains d’entre vous l’ont dit –, il vise en tout cas à rassurer et à sécuriser les rapports entre les chargeurs et les transporteurs, qui, dans les faits, nous l'avons tous constaté, sont déséquilibrés. Toujours est-il que ce dispositif, qui a désormais le mérite d’exister, pourra évoluer à l’avenir. Nous en débattrons à mesure que la loi entrera en vigueur, notamment au sein de la commission du développement durable du Sénat.
Le secteur du transport routier, qui représente 40 000 entreprises et 400 000 emplois, est suffisamment sensible pour que nous prenions toute la mesure de la concertation qui a eu lieu avec l’ensemble des professionnels et mesurions la nécessité de mettre en place une législation qui soit responsable sur le plan tant économique que social.
Vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, le Parlement a accompli un travail important. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens une nouvelle fois à vous remercier sincèrement de la part que vous avez prise dans cette discussion, de votre investissement, de votre appréhension de ces sujets, qui ne sont pas simples. Monsieur le rapporteur, je vous remercie particulièrement pour le travail efficace conduit en commission mixte paritaire.
Après avoir été discuté et amendé par les deux assemblées, le projet de loi a donc été examiné hier en commission mixte paritaire, laquelle est parvenue à un accord sur un texte à mon sens équilibré, ce dont je remercie les membres de la commission.
Certes, vous l’avez indiqué à l’instant, monsieur le rapporteur, il a fallu faire des concessions. Mais ce sont les règles du jeu à ce stade de la procédure. Chacun a fait preuve d’une attitude constructive, ce dont je ne doutais pas. Je salue particulièrement cette volonté d’aboutir, essentielle pour garantir la pleine application du dispositif à une date précise et assurer aux professionnels du secteur routier une certaine visibilité et une forme de sécurité concernant les modalités de sa mise en œuvre.
Je crois en ce texte et en la volonté de chacun de réussir la mise en place fondatrice, dans le domaine des transports, de cette fiscalité écologique.
Je le redis devant vous, la France a beaucoup de retard dans ce domaine, et il est de notre responsabilité commune de le rattraper. Vous vous êtes engagés, notamment lors de la commission mixte paritaire, dans la droite ligne de la position qui a été adoptée à l’unanimité en 2009 lors de l’examen du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Je ne puis que vous en féliciter, mesdames, messieurs les sénateurs, car, en dépit de la difficulté de passer des principes à leur concrétisation, vous êtes restés fidèles aux objectifs fixés, à savoir parvenir à un texte non seulement équilibré, mais surtout opposable et supportable pour nos entreprises.
Je vous l’assure, je serai très attentif, à vos côtés, aux conclusions du rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans un an et demi sur l’application de ce dispositif. Vous l’avez demandé à juste titre, et je vous rejoins pleinement sur ce point. À partir de données objectives, nous pourrons établir un bilan pour ajuster, parfaire le dispositif en fonction de ses effets sur les acteurs de notre économie.
Je l’ai dit brièvement, nombre de secteurs de transport ont été évoqués dans ce projet de loi et plusieurs dispositions y ont été ajoutées ; il est vrai que l’engagement de la procédure accélérée aboutit à un examen rapide, …
… mais cette rapidité était exigée par les conséquences économiques que ces mesures devraient légitimement entraîner sur les secteurs de transport. Là encore, il fallait garantir la clarté pour chacun des acteurs économiques et sociaux.
Nous sommes donc intervenus dans différents secteurs, notamment fluvial et environnemental, afin de simplifier et de rendre opérationnelles les procédures permettant d’intervenir sur des navires abandonnés comportant des risques écologiques et environnementaux.
S’agissant du secteur maritime, ce projet de loi va dans le sens de l’action menée par le Gouvernement depuis son arrivée au pouvoir : la défense de l’économie maritime française. Nous l’avons montré à plusieurs reprises avec des batailles difficiles engagées pour la défense du pavillon français, de l’emploi maritime français dans des dossiers que vous suivez comme Sea France, Brittany Ferries et aujourd’hui My Ferry Link. Mais il en est d’autres qui sont d’actualité. Soyez assurés de ma pleine implication pour défendre ce pavillon français, notamment dans un dossier qui mobilise toute notre énergie : la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ou SNCM, qui est encore confrontée à des décisions concernant son avenir. J’y serai particulièrement attentif.
Je reviendrai maintenant brièvement sur l’article 23, qui a fait débat, pour préciser la position du Gouvernement et la doctrine qui guide notre action.
Au travers de cet article, nous souhaitons éviter que des navires de pavillons étrangers ne viennent opérer sur des lignes nationales dans des conditions sociales parfois inacceptables, en tout cas différentes de celles qui sont imposées au pavillon français, et selon une concurrence déloyale. C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement attaché à cet article dont la lecture doit être la plus précise possible, afin qu’il ne lui soit pas donné une vision et une portée qui dénatureraient à la fois sa réalité, son fondement et la volonté qui le sous-tend.
J’espère, sans trop d’inquiétudes, obtenir une nouvelle fois votre confiance, avant de vous renouveler mes remerciements pour la qualité du travail effectué, qui est annonciateur d’autres échanges entre nous.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats sur ce projet de loi ont été de haute teneur et se sont déroulés dans un climat serein. Je salue l’implication très forte dont vous avez fait preuve et votre grand sens des responsabilités, qui font honneur à la Haute Assemblée !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC . – MM. Vincent Capo-Canellas et Jacques Mézard applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les écologistes ont soutenu ce projet de loi au Sénat et à l’Assemblée nationale, parce qu’il contient non seulement des dispositions tout à fait pertinentes – certes techniques pour certaines, mais de grande importance –, mais surtout des avancées sociales et environnementales que nous tenons à saluer. Aujourd’hui, nous voterons de nouveau en faveur de ce texte, pour toutes les raisons déjà expliquées lors de la première lecture par Ronan Dantec ; notre collègue, dans l’impossibilité d’être présent aujourd’hui, vous prie de bien vouloir excuser son absence.
L’avancée sociale de ce texte à saluer – et vous l’avez souligné, monsieur le ministre – concerne le cabotage maritime qui permet de rétablir les conditions d’une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur en élargissant à tout le personnel navigant, et non pas seulement à l’équipage, les conditions sociales et les conditions de sécurité imposées au pavillon français, et ce sur tous les navires utilisés pour fournir une prestation de service dans les eaux françaises.
Sur le plan environnemental, comment ne pas dire un mot fort sur la mise en cohérence de notre législation avec le droit international concernant la réparation des dommages causés par les marées noires qui ont trop souvent touché notre littoral ?
Le Parlement a amélioré ce texte en adoptant plusieurs mesures tout à fait pertinentes, et nous nous en réjouissons ; il en est ainsi, par exemple, de la demande de rapport sur les conséquences de l’autorisation des 44 tonnes, à propos de laquelle notre groupe a déjà exprimé à plusieurs reprises sa très grande réserve.
Saluons le travail de nos collègues écologistes à l’Assemblée nationale, qui ont vu plusieurs de leurs propositions retenues, telles la création d’un schéma national directeur de la logistique afin d’optimiser les flux de marchandises, d’accentuer la part du transport ferroviaire, fluvial et maritime, de réduire les impacts et de rendre le système économique plus fort et plus efficace, ou la création d’aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les gares réaménagées. Nous nous félicitons de ces avancées.
C’est surtout l’écotaxe poids lourds, mesure phare de ce projet de loi, qui retient toute notre attention.
Le Gouvernement avait annoncé sa volonté de « tenir bon » pour ne pas introduire de nouvelles dérogations ou exonérations sur la taxe poids lourds, et nous l’avons soutenu dans sa démarche. Nous considérons en effet que cette taxe doit être aussi efficace que possible, et nous regrettons que des exonérations aient été votées à la suite de diverses pressions. Nous en avons l’habitude, mais il ne faudrait pas que la portée de ce texte soit affaiblie par des exonérations et autres dégrèvements, comme cela arrive malheureusement trop souvent dans notre pays.
Nous regrettons ainsi, pour deux raisons, la réintroduction par la commission mixte paritaire d’une exonération sur les véhicules publics d’entretien et d’exploitation des routes, adoptée par voie d’amendement au Sénat puis supprimée par l’Assemblée nationale : d’une part, ce n’est pas parce qu’un véhicule est public qu’il ne pollue pas, et il devrait donc se voir appliquer l’écotaxe ; d’autre part, nous considérons que les pouvoirs publics, État et collectivités, ont pour mission d’impulser, de « montrer la voie » de la transition écologique. Leurs pratiques doivent servir d’exemples au secteur privé.
Un problème s’est posé pour trois régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bretagne : alors que leur spécificité était déjà prise en compte dans le projet de loi initial, elles ont obtenu une minoration supplémentaire. La prise en compte de la situation périphérique de ces régions ne devra pas être un frein à la transition.
Si le texte présente de réelles avancées, il nous faudra aller plus loin encore, car notre pays est gravement en retard par rapport aux autres pays européens en matière de fiscalité écologique : il se situe à la vingt-sixième place sur les vingt-sept États membres, ce qui représente, je le rappelle, 20 milliards d’euros de recettes fiscales à prélever pour rattraper la moyenne européenne. Six États européens ont mis en place une écotaxe sur les poids lourds : la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie.
Compte tenu du retard de notre pays en matière de fiscalité écologique, la mise en place de l’écotaxe est donc plus que bienvenue.
La mise en œuvre de l’écotaxe n’est d’ailleurs qu’une première étape ; de nombreuses autres réformes doivent, selon nous, intervenir désormais dans l’instauration d’un système de fiscalité écologique, essentiel pour amorcer la transition écologique dont notre pays a besoin.
Je soulignerai ici quelques pistes, s’agissant du travail qui nous attend.
Sur l’écotaxe elle-même, nous appelons à une montée en puissance progressive du dispositif. Des dérogations régionales existent, comme je l’ai indiqué, ainsi qu’un abattement de 10 % en cas de souscription au système d’abonnement.
Nous pensons ainsi que la taxe devrait progressivement s’appliquer sur les routes qui sont pour l’instant en dehors du dispositif.
Les taux de la taxe seront réévalués annuellement par arrêté ministériel. Nous serons vigilants afin que ces arrêtés traduisent un renforcement régulier de l’écotaxe, pour y intégrer les externalités liées à la route notamment. À ce propos, un projet de loi sera soumis au vote du Parlement dans les prochaines semaines, qui transposera dans notre droit les modifications apportées à la directive Eurovignette en 2011. Cette directive prévoit la possibilité pour les États membres d’intégrer dans le montant des péages dus par les poids lourds les externalités négatives telles que le bruit ou la qualité de l’air. Or le projet de loi que nous allons examiner ne prévoit pas, pour l’instant, la prise en compte de ces externalités. Nous y voyons une occasion manquée de faire appliquer le principe « pollueur-payeur ».
Nous considérons enfin qu’un moyen doit être trouvé pour affecter réellement le produit de la taxe au report modal. Actuellement, en effet, le système prévoit que le produit de l’écotaxe sera versé au budget général de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, qui finance aussi bien les routes que les alternatives à la route. Cela nous semble contraire à l’engagement du Grenelle selon lequel l’écotaxe poids lourds devait financer les politiques de report modal.
Pour conclure, je rappelle une nouvelle fois que nous, écologistes, sommes convaincus de l’absolue nécessité d’une fiscalité écologique juste et pragmatique. Par conséquent, le groupe écologiste se prononcera en faveur de ce texte, considérant qu’il s’agit d’une étape sur la route, sur la voie, et, dirai-je même, sur les voies qui mènent à la transition. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est l’occasion de rappeler comment s’organisent aujourd’hui les rapports de force politiques autour des questions environnementales.
En effet, les considérations environnementales ont pris une place fondamentale dans l’élaboration des politiques publiques auxquelles le législateur participe. Même si les motivations de cette prise de conscience sont parfois quelque peu électoralistes, il n’en demeure pas moins que le caractère durable et respectueux de la nature est désormais un préalable indispensable à toute politique publique. Sur ce point, nous sommes d’accord, je pense.
Si, aujourd’hui, personne n’a le monopole de la conscience aiguë des questions environnementales, certaines approches diffèrent selon la place occupée dans cet hémicycle.
En d’autres termes, même si des antagonismes profonds subsistent sur certains sujets – le cas du nucléaire en est sans doute la meilleure illustration –, la prise de conscience est collective, comme en témoigne le Grenelle de l’environnement, réalisé par le précédent gouvernement.
Les lois dites « Grenelle » se sont révélées ambitieuses, même si certains les ont jugées incomplètes ; toutefois, elles ne se suffisent effectivement pas à elles-mêmes.
Pour cette raison, et comme notre groupe l’a toujours souligné, cette séquence de consultation puis de décision que furent les lois « Grenelle de l’environnement » doit se concevoir comme une étape dans la course vers une appréciation plus affinée des enjeux écologiques et des politiques publiques environnementales.
Or, bien que le texte que nous examinons ne soit pas aussi ambitieux que les lois dites « Grenelle », il doit se concevoir comme une marche, certes plus petite mais tout aussi indispensable que les précédentes lois Grenelle, dont il assure parfois la mise en application concrète.
Quelles avancées le présent projet de loi doit-il permettre de réaliser ?
Avant tout, il convient d’indiquer que la majorité des dispositions présentes dans ce texte sont de nature technique.
Ces dispositions s’attachent ainsi à apporter de nouvelles réponses juridiques à un ensemble de situations qu’en l’état actuel du droit l’État, les collectivités territoriales, les administrations et les opérateurs de l’État ont du mal à appréhender.
Ces situations concernent aussi bien le transport ferroviaire que les transports routier, fluvial et maritime, ainsi que, dans une moindre mesure, le transport aérien.
À cet égard, le présent texte répond parfois à des problématiques purement juridiques, qui – nous devons le reconnaître – se révèlent neutres sur le plan politique.
Néanmoins, si de nombreuses dispositions sont purement techniques, d’autres sont à la croisée des chemins : malgré leur caractère extérieur juridique, elles présentent en effet une dimension politique dans la mesure où elles donnent le pouvoir à des agents de l’État de constater et de verbaliser des infractions et des contrevenants. Ces mesures ont partant un fort caractère coercitif et sécuritaire, ce qui, je ne vous le cache pas, n’est pas pour me déplaire !
En termes de transport ferroviaire, il s’agit de permettre aux agents de la SNCF et de Réseau ferré de France de constater les infractions, et notamment les vols commis sur le réseau. Cette possibilité est donnée par l’article 4. À ce titre, je rappelle que ces vols se chiffrent en dizaines de millions d’euros et qu’ils sont en augmentation constante depuis plusieurs années.
Toujours en matière de lutte contre l’insécurité, et plus précisément contre l’insécurité routière, l’article 9 étend les prérogatives des contrôleurs de transports terrestres.
Ce texte comporte donc bel et bien un ensemble de dispositions à visée sécuritaire. Elles nous semblent, pour la plupart, relever du bon sens et du souci légitime d’accorder à la sécurité toute la place qu’elle mérite dans les problématiques de transports.
Le dernier ensemble de mesures que nous pouvons identifier dans ce projet de loi est, comme je l’ai indiqué précédemment, motivé par des considérations environnementales, chacune d’entre elles tentant ainsi d’apporter une réponse juridique à un problème environnemental.
Ces dispositions partent pour la plupart d’un constat d’impuissance, notamment de l’impuissance des agents de l’État à résoudre une situation qui s’éternise. Sur ce sujet, je songe aux articles 12 et 15 qui permettent, pour le premier, de déplacer d’office des bateaux en stationnement le long des voies fluviales et, pour le second, d’accélérer la déchéance de propriété pour les bateaux abandonnés.
Cela étant, comme je l’ai souligné en introduction, ces mesures s’inscrivent également dans la continuité des lois « Grenelle ».
Dans cette perspective, l’article 16, qui clarifie et distingue d’une part les procédures applicables en cas de marée noire, en vertu de la convention CLC, et d’autre part les procédures applicables dans le régime général des créances maritimes, s’inscrit dans le prolongement des travaux du Grenelle de la mer. Cette mesure permettra de mettre fin aux confusions auxquelles sont confrontés les tribunaux de commerce, qui, pour l’heure, font usage des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général de responsabilité, issu de la convention LLMC, malgré l’arrêt de 1987 de la Cour de cassation. Là encore, cette disposition me semble relever du bon sens.
Cependant, la mesure phare de ce texte est sans nul doute le remplacement non pas de l’écotaxe elle-même mais du dispositif de majoration qui doit répercuter cette écotaxe poids lourds des transporteurs vers leurs clients. Or c’est là que les choses se gâtent, monsieur le ministre !
En effet, l’écotaxe ne peut se concevoir sans ce dispositif de majoration qui traduit le principe du « pollueur-payeur ». Ainsi, la majoration permet de répercuter sur l’acteur économique qui choisit le mode de transport routier la taxe que payera initialement le transporteur.
Ce système se justifie par deux raisons : premièrement, les transporteurs ne sont pas responsables des choix des chargeurs, et notamment de leur choix en faveur du transport routier ; deuxièmement, ils dégagent des marges moyennes trop faibles – environ 1, 5 % – pour pouvoir supporter seuls le coût de la présente taxe.
Personne ne conteste la nécessité de cette majoration, mais l’actuel dispositif qui calquait le montant de la majoration affectée aux chargeurs sur le montant de l’écotaxe devait faire l’objet d’une refonte, que les professionnels appelaient au reste de leurs vœux.
Ainsi, l’actuel système de majoration doit être remplacé par un nouveau dispositif de majoration forfaitaire obligatoire.
De fait, cette disposition est essentielle au bon fonctionnement des entreprises de transport, qui sont souvent des structures petites, voire très petites : 80 % d’entre elles comptent moins de dix salariés. Par conséquent, ces entreprises n’ont pas la possibilité de répondre à la complexité de l’actuel dispositif, dont les modalités de calcul nécessitent des relevés particulièrement précis. Elles pourraient donc se trouver dans l’incapacité de remplir une obligation légale si nous conservons l’écotaxe sous sa forme actuelle.
Le nouveau dispositif voulu par le Gouvernement est – force est de le reconnaître – plus lisible pour les professionnels du secteur, qu’ils soient transporteurs ou chargeurs. C’est déjà un avantage ! En effet, en prenant en compte un taux uniforme s’appliquant à l’intérieur de chaque région, les transports interrégionaux se voyant également fixer un taux unique calculé selon les mêmes principes, les professionnels du secteur pourront mieux anticiper les volumes de la taxe.
De plus, en gardant comme critère d’élaboration des taux les données relatives aux trafics observés et aux itinéraires, à la consistance du réseau soumis à la taxe et aux charges de gestion, ce prélèvement continuera de fonder sa légitimité sur le respect de considérations environnementales.
En conséquence, cette mesure, qui vise avant tout à rétablir la sécurité juridique et fiscale des entreprises du secteur, participera également de la prise en considération de problématiques écologiques en préservant le concept du « signal prix », qui doit permettre d’inciter les demandeurs à se détourner des modes de transport les plus polluants. Or ce n’est pas toujours facile !
Les nouvelles modalités d’application de l’écotaxe permettront également de préserver les ressources dégagées initialement pour financer les infrastructures de transport par l’intermédiaire de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF.
Je tiens à saluer l’accord atteint en CMP, permettant de réintroduire une mesure que le groupe UMP avait défendue, à savoir l’exonération des « véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes ». Il s’agit d’une disposition de l’article 6 ter.
Je salue également le geste accompli en faveur des collecteurs de lait : en tant que sénateur du premier département laitier français, je ne peux pas être totalement insensible à cette question, monsieur le ministre ! Cela étant, vous auriez dû aller beaucoup plus loin. En effet, le lait c’est une chose, mais la prise en compte de la viande et des légumes aurait été préférable encore !

Certes, ce projet de loi apporte des réponses juridiques pratiques à des difficultés rencontrées par l’État et d’autres agents publics. Il tente de faire appliquer une fiscalité écologique élaborée sous la précédente législature – je m’en souviens ! Cependant, certaines dispositions du présent texte suscitent toujours des interrogations.
Je n’oublie pas que j’ai voté, en 2009, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Je n’oublie pas davantage la nécessité d’envisager l’économie avec un certain nombre d’exigences environnementales – c’est une évidence !
Toutefois, l’économie de marché est trop occultée à mon goût. Souvenons-nous de l’approche économique adoptée par nos voisins allemands depuis plus de cinquante ans : l’économie de marché autant que possible, l’État autant que nécessaire !
J’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé dans la discussion de ce projet de loi la marque d’une préoccupation majeure qui devrait nous mobiliser tous : la compétitivité de l’industrie de notre pays. La baisse de l’industrialisation de la France atteint pourtant un seuil critique : l’industrie ne représente plus que 12 % du PIB de la France, soit presque 50 % de moins qu’en Allemagne, qui est notre principal partenaire.
Soyons honnêtes : cette baisse ne date pas d’hier, …

… mais d’avant-hier ! Elle est très antérieure à mai 2012. Reste que le différentiel de compétitivité entre la France et l’Allemagne atteint aujourd’hui un degré tel qu’il affecte jusqu’à l’équilibre du couple franco-allemand.

Je pourrais ajouter un couplet très important sur l’équilibre de ce couple, car il affecte toutes nos décisions en matière européenne.

Certes, le Président de la République, François Hollande, souligne que le couple franco-allemand doit montrer la voie. Mais permettez-moi de me demander sans malice quelle peut être cette voie quand ce couple ne parle pas d’une seule et unique voix ? Voilà un fameux problème !
L’écotaxe proposée par le Gouvernement, appliquée sans discernement, portera directement préjudice à notre tissu de PME et de TPE. Je l’ai déjà souligné lors du précédent débat.
Je suis malheureusement contraint, faute de temps, d’écourter mon intervention. Je dirai donc que, à mon sens, l’esprit du présent texte n’est pas celui de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Comme je l’ai expliqué en première lecture, j’aurais souhaité une approche plus pragmatique qui tolère un certain nombre d’exemptions ; une approche éloignée de l’écologie punitive mais ouverte à une écologie incitative et réformatrice, voire réparatrice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP s’abstiendra. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, deux mois après avoir examiné ce texte en première lecture nous débattons aujourd’hui des conclusions de la commission mixte paritaire.
Pourtant, l’Assemblée nationale a voté ce texte voilà seulement deux jours, et la commission mixte paritaire s’est tenue hier. Nous plaidons, vous le savez, pour rompre avec cette accélération du calendrier législatif qui ne nous permet pas de travailler dans d’excellentes conditions !
Au demeurant, les dispositions du présent texte doivent s’apprécier au regard d’un contexte plus global. Je songe à ce titre à la remise imminente du rapport Bianco et aux évolutions européennes attendues. En effet, les questions de séparation entre les activités de gestionnaire d’infrastructure et d’opérateur, abordées à la marge par ce projet de loi, sont d’une actualité brûlante à travers la proposition de directive dite du « quatrième paquet ferroviaire », présentée en janvier dernier par la Commission. Cette dernière semble vouloir dresser des frontières tellement importantes qu’elles reviennent en réalité à imposer une séparation totale.
Si cette directive n’invalide pas le projet français, force est de constater qu’elle ne l’encourage pas non plus.
Monsieur le ministre, nous espérons que vous prendrez en considération la résolution adoptée par le Sénat le 2 avril dernier, indiquant que la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs en interdisant implicitement « la création de toute entreprise ferroviaire verticalement intégrée », ainsi que la proposition de résolution déposée à l’Assemblée nationale qui va dans le même sens.
La voix de la France doit porter pour permettre de garantir la possibilité de relations poreuses entre gestionnaire d’infrastructure et opérateurs, gage de réalisation mais surtout de réussite de l’unification du système ferroviaire et du futur pôle public.
En tout état de cause, l’intérêt de ce projet de loi réside essentiellement dans l’entrée en vigueur de la taxe poids lourds.
Depuis l’instauration du principe de ce prélèvement, il est prévu que les transporteurs puissent répercuter cette taxe sur les chargeurs. Toutefois, un certain nombre de nos collègues ont estimé que ce principe portait atteinte à la compétitivité des entreprises, notamment dans les zones enclavées.
Nous considérons qu’il s’agit d’un véritable enjeu. Plus largement, la question de l’essor de nos entreprises, et notamment de nos PME, appelle prioritairement une politique d’aménagement du territoire par un maillage des services publics, par la performance de tous les réseaux – y compris le très haut débit –, par la relance du fret ferroviaire, par le dynamisme de la Banque publique d’investissement et par bien d’autres pistes.
Les modalités de répercussion de la taxe poids lourds sont simplifiées par le présent projet de loi, qui se fonde sur une majoration du coût de transport différenciée au niveau régional. Nous sommes en accord avec ce mode de répercussion plus lisible, qui ne change rien ni au volume escompté de rendement ni aux principes devant guider la définition de cette taxe, à savoir son affectation au financement du rééquilibrage modal.
Nous approuvons que cette taxe entre enfin en vigueur après de nombreuses années d’attente, pour être opérationnelle à compter du 1er octobre prochain. Nous approuvons également les évolutions du projet, à savoir une évaluation des conséquences de la mise en œuvre de cette taxe et une définition du caractère évolutif du domaine routier concerné.
Pour autant, plusieurs questions demeurent, selon nous. Alors que la taxe poids lourds devrait rapporter 1, 2 milliard d’euros, son rendement pour la société Ecomouv’, à laquelle la collecte de cette taxe a été confiée par l’ancien gouvernement par la voie d’un contrat de partenariat, se situe à quelque 230 millions d’euros par an sur plus de dix ans, soit plus de 2 milliards d’euros au total, pour un investissement de 600 millions d’euros. Nous préférerions parier sur la performance du service public, en l’occurrence du service des douanes !
Huit cents millions d’euros par an issus de la mise en œuvre effective de cette taxe seront versés à l’AFITF pour le financement des infrastructures. Mais reconnaissons d’ores et déjà que cela ne suffira pas à mettre en œuvre la totalité des projets définis par le Schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, et que cela ne dédouane donc aucunement le Gouvernement de réfléchir aux moyens de renationaliser les concessions autoroutières afin d’apporter de nouveaux financements à l’AFITF.
Il faut notamment repenser les dispositifs fiscaux existants, qui sont particulièrement favorables aux transporteurs. Ainsi, les exonérations de TIPP coûtent chaque année 330 millions d’euros au budget de l’État. Dans ce cadre, le nouvel article 11 bis, permettant l’évaluation des conséquences des autorisations de poids lourds de 44 tonnes, nous apparaît comme le début de la remise en cause de ces derniers. Vous savez que nous avons toujours soutenu qu’ils portaient atteinte au rail en organisant une concurrence déloyale, particulièrement envers les autoroutes ferroviaires.
Permettre le rééquilibrage modal doit également conduire à agir sur le niveau des conditions de travail du secteur routier, qui sont aujourd’hui déplorables. La France doit porter l’exigence d’une harmonisation sociale par le haut à l’échelle de l’Europe. Vous vous y êtes engagé, monsieur le ministre, et nous serons à vos côtés !
Concernant le secteur fluvial, il faut cesser la saignée des emplois publics, alors que la dernière loi de finances a encore supprimé 128 postes dans ce domaine. Permettre l’essor de la voie d’eau, c’est respecter l’engagement pris d’un financement à hauteur de 840 millions d’euros. Pour cela, la réponse apportée par le Gouvernement ne peut résider uniquement dans la valorisation des terrains qui seraient donnés en pleine propriété à Voies navigables de France, ou VNF, mais doit se doubler d’un effort en termes de dotation budgétaire.
Permettre le rééquilibrage modal – et nous y sommes particulièrement attachés –, c’est encore déclarer d’intérêt général le fret ferroviaire et l’activité du wagon isolé.
Toutes ces questions devront être traitées dans la réforme du système ferroviaire, puisque, au-delà des questions de gouvernance, ce sont les missions mêmes du service public qu’il nous faudra redéfinir et renforcer.
Au regard de tous ces éléments, nous voterons en faveur du présent texte, tout en renouvelant notre appel, monsieur le ministre, à être associés à la construction de la future réforme. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.
Comme je l’avais indiqué lors de la discussion ici même, ce texte arrive légitimement à bon port !
Sourires.

Au final, le texte issu de l’Assemblée nationale, au-delà d’un certain nombre de modifications rédactionnelles positives, ressemble fortement au résultat des travaux du Sénat. Au titre des apports utiles, je veux évoquer les précisions bienvenues enrichissant le contenu du rapport prévu à l’article 7, sur les effets de la majoration sur les prix du transport.
Rappelons tout d’abord que nous discutons dans ce texte non pas du principe de l’écotaxe, mais bien des modalités de sa mise en œuvre et de sa répercussion sur les transporteurs. L’évaluation approfondie, prévue par ce rapport, est donc indispensable pour mesurer l’incidence économique de l’écotaxe poids lourds et les éventuels dysfonctionnements ou insuffisances du dispositif de majoration. Souhaitons que ce bilan d’étape prévu puisse rassurer les professionnels, inquiets de la mise en œuvre d’un dispositif, qui, reconnaissons-le, peut paraître complexe à bien des égards.
Depuis l’examen de ce texte par le Sénat, monsieur le ministre, vous avez annoncé deux décisions qui correspondent à nos souhaits : le report au 1er octobre de l’application de l’écotaxe et la mise en place d’une expérimentation à blanc. Nous saluons ces décisions de bon sens, dont le Sénat aurait volontiers pris acte durant les débats.
Quelques mesures nouvelles, introduites par le Gouvernement, ont curieusement fait leur apparition, mais cela n’a pas empêché la commission mixte paritaire de parvenir à un texte commun, chaque chambre faisant un pas en direction de l’autre ; à cet égard, je veux saluer ici la contribution éminente de notre rapporteur.
La commission mixte paritaire a ainsi pu rétablir dans le texte la disposition, proposée par le Sénat et à laquelle les sénateurs tenaient beaucoup, exemptant d’écotaxe les véhicules d’entretien des routes appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.
Logiquement, le texte de la CMP conserve quelques modifications proposées par nos collègues députés. Deux sont majeures, l’une d’elles figurant d’ailleurs au nombre des suggestions émises sur de nombreuses travées de cette assemblée.
Premièrement, afin de prendre en compte la spécificité du transport de la denrée périssable qu’est le lait, les députés ont exclu les véhicules de collecte de lait de l’écotaxe poids lourds, dans la mesure où ces véhicules sont dispensés de chronotachygraphes. Cette mesure aura pour effet de conforter l’activité de la filière laitière. Elle pouvait faire craindre que l’on n’ouvre la boîte de Pandore des exemptions à l’écotaxe, et nous n’avions donc pas tranché en sa faveur. Toutefois, cette exception peut maintenant être validée, car elle se fonde sur la directive européenne Eurovignette qui permet de dispenser de l’écotaxe cette catégorie particulière de véhicules. Saluons cette subtile évolution et souhaitons qu’elle ne conduise pas à un imbroglio juridique !
Deuxièmement, nos collègues de l’Assemblée nationale ont souhaité majorer les taux de minoration de l’écotaxe pour les régions périphériques, afin de réduire l’incidence de la mesure dans ces régions. Ce sujet a donné lieu à un long débat en commission mixte paritaire. Cet aménagement de l’écotaxe pour les régions périphériques et péninsulaires, lié à leurs caractéristiques de production, est en effet discutable, car il réduit d’autant les recettes qui viendront financer l’AFITF. Mais c’est peut-être le prix à payer pour une mise en place rapide de l’écotaxe poids lourds, et c’est cet argument qui a prévalu dans nos échanges en commission mixte paritaire. Nous avions également en tête les débats au Sénat en première lecture, durant lesquels un certain nombre de nos collègues de ces régions s’étaient largement exprimés.
Quant aux autres dispositions, elles ne justifient pas d’opposition de notre part. L’organisation d’une conférence nationale de la logistique ne pourra que nous inciter à réfléchir à l’importante question de l’optimisation des chaînes du transport intermodal, et nous avons compris, monsieur le ministre, que vous aimez bien les débats et les commissions ! §

Si la création du centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, le CEREMA, a été insérée par le Gouvernement de façon un peu cavalière, comme l’a aimablement souligné M. le rapporteur tout à l'heure, nous ne souhaitons pas nous opposer au regroupement et à la rationalisation de divers organismes, qui, nous l’espérons, permettront des économies et un surcroit d’efficacité. Il faudra peut-être vérifier qu’il en sera bien ainsi à l’usage.
Nous avions été favorables à l’adoption de ce texte parce qu’il apportait un certain nombre de réponses techniques attendues par le secteur des transports, et surtout parce que sa principale mesure, la mise en œuvre de l’écotaxe, résulte directement du Grenelle de l’environnement qui avait été voté à la quasi-unanimité sous la précédente majorité.
S’il n’est pas totalement satisfaisant, le système de majoration forfaitaire prévu par le projet de loi comme mécanisme de répercussion de l’écotaxe est sans doute le moins mauvais possible. Il fallait trouver une solution pour permettre l’application rapide de l’écotaxe, initialement prévue pour 2010. Nous devions prendre en compte la spécificité et la fragilité économique des entreprises de transports.
Nous estimons que les objectifs de l’écotaxe poids lourds, cohérents avec les principes du Grenelle de l’environnement, sont bons. L’écotaxe favorise en effet les modes de transport plus vertueux grâce au report modal, et vise à développer une politique des transports plus durable, en apportant un financement pérenne à l’AFITF.
Pour ces raisons, le groupe UDI-UC maintient donc son vote favorable à ce projet de loi.
Cependant, monsieur le ministre, la discussion de ce texte technique, consacré à l’ensemble des modes de transports, s’apparente pour nous à une mise en bouche, et nous avons encore beaucoup d’appétit pour ce domaine des transports §
Nous attendons de discuter des réformes majeures qui doivent maintenant intervenir, et ce débat sera sans doute très différent ! Il devra concerner la réforme du système ferroviaire, bien entendu, mais aussi le chantier du SNIT. Pour le moment, vous avez nommé des commissions et lancé les réflexions. Nous attendons désormais la « mise en pratique » et les réformes de fond !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste, du RDSE et de l’UMP.

Monsieur le président, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier M. le rapporteur de son travail consensuel et M. le ministre de cette capacité d'écoute que nous nous plaisons toujours à lui reconnaître.
Les objectifs de l’écotaxe poids lourds sont louables et légitimes – et bien sûr, nous les soutenons – pour favoriser le report modal et de financer de nouvelles infrastructures de transport. Cependant, les débats autour de l’application de cette écotaxe font apparaître certains doutes et certaines craintes concernant ses effets sur la compétitivité de notre économie, et notamment sur le secteur de l’agro-alimentaire.
Monsieur le ministre, ces préoccupations sont encore plus vives dans les territoires ruraux, pénalisés par l’absence d’alternatives efficaces à la route, comme le rappelait en première lecture mon collègue Alain Bertrand. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avions déposé un certain nombre d’amendements visant à minorer la taxe dans les territoires enclavés.
La question des territoires dans lesquels seule la route permet le désenclavement est en effet systématiquement éludée. Évidemment, dans les régions où l’on bénéficie de routes à quatre voies, d’autoroutes, d’aéroports, de trains à grande vitesse et de fret ferroviaire, on fait face à une situation tout à fait différente ! On peut alors déclamer sur la transition énergétique et sur beaucoup d’autres choses !
Mais en l’absence d’alternative à la route, l’écotaxe sera systématiquement répercutée vers le consommateur final, qui paiera pour un choix qu’il n’aura pas lui-même effectué, ce dernier relevant bien de l’entreprise qui privilégiera en toute logique la route, plus compétitive dans ces cas-là que le fret ferroviaire, trop délaissé.
Pour citer une étude commandée par la SNCF au cabinet Bain & Company, l’écart de prix en Europe entre le mode routier et le fret ferroviaire serait d’environ 25 %, et le déficit du fret ferroviaire pourrait atteindre 5 milliards d’euros en cinq ans. Le rapport prévu par le projet de loi, portant sur les effets de la majoration sur les prix de transport des produits de grande consommation, pourra nous éclairer sur ce point.
Avec ce texte, nous allons adopter des minorations et des exonérations alors qu’aucune expérimentation n’a finalement eu lieu. Les deux exonérations de véhicules, et notamment celle qui concerne les véhicules de ramassage laitier – c’est d’ailleurs une bonne chose pour les producteurs de lait –, révèlent l’absence d’alternative à la route dont vont souffrir certains secteurs de l’économie.
Je me satisfais partiellement de la possibilité de revoir ultérieurement la liste des tronçons de route taxables. J’ai entendu mon collègue Joël Labbé dire qu’il faudrait que toutes les routes le soient ! Il est facile de demander cela depuis une région desservie par tous les modes de transport, alors que, dans certaines régions, il n’existe que des routes nationales où l’on passe à 30 kilomètres à l’heure… Je pense qu’il faudrait enfin s’occuper de l’égalité territoriale ! Il me semble d’ailleurs qu’un ministère en est chargé, encore que je n’aie pas entendu jusqu’ici beaucoup de propositions. Cela étant rappelé, la révision de la liste devra se faire selon la procédure même qui a présidé à son établissement ; j’espère donc que la consultation sera réelle, car ce retour est essentiel.
Je constate, monsieur le ministre, que la région Auvergne, chère à mon cœur, ne bénéficie ni de la minoration de 30 % ni de celle de 50 %, accordées à certaines autres régions. Peut-être est-elle plus proche des autres régions européennes que la Bretagne historique, peut-être n’est-elle pas périphérique… Mais elle reste, hélas ! la région la plus enclavée et donc la plus exposée à l’application de la taxe.
Il y a malheureusement là un manque de cohérence de l’exécutif : bien que défavorable au relèvement de la minoration applicable à ces régions, il a fini par céder, alors que, si l’on en croit les travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, le taux régional applicable à la Bretagne dans la répercussion de la taxe tenait bien compte de la minoration, puisqu’il a été établi à 3, 3 %, au lieu de 5, 5 %. Il semblerait que nous ne disposions pas des mêmes forces de persuasion – je n’ose parler de « forces de dissuasion », même si l’on peut y penser…
M. le ministre et M. le président de la commission du développement durable sourient.

Toutefois, ce texte est indispensable pour clarifier et rendre lisibles les modalités de répercussion de la taxe auprès des chargeurs. À ce titre, il recueille un avis favorable des transporteurs routiers.
Monsieur le ministre, je veux maintenant attirer brièvement votre attention sur le financement de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France, ou AFITF, financement qui nous préoccupe tous. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, si le RDSE est le seul groupe à ne pas être représenté au sein de la commission « Mobilité 21 », ses membres se sentent particulièrement concernés par ce sujet.
Extrêmement préoccupante, la question du financement de l’AFITF nécessite une attention toute particulière de votre part – je sais que vous la lui accordez –, d'abord parce que le report de l’application de l’écotaxe constitue une perte financière pour l’Agence, mais aussi parce que nous craignons que les rentrées d’argent liées à la mise en place de cette taxe n’aboutissent non à un véritable renforcement du financement de l’AFITF, mais bien au résultat contraire. Pour nous, en effet, et nous le constatons tous les jours, le développement de l’offre de transport sans logique d’aménagement du territoire est voué à l’échec.
Par conséquent, monsieur le ministre, nous souhaitons que vous veilliez particulièrement à ce financement.
Nous savons aussi que du financement de l’AFITF dépend celui des programmes de modernisation des itinéraires routiers, les PDMI, que nous considérons comme fondamentaux, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire.
Cela étant, monsieur le ministre, le projet de loi est louable dans son objet, et son adoption constituerait un pas en avant important. C'est la raison pour laquelle les membres du RDSE voteront très majoritairement en sa faveur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, permettez-moi d’emblée de saluer la qualité du travail accompli par notre rapporteur.

Mon intervention portera sur les dispositions du projet de loi relatives aux transports ferroviaire et routier.
Quelques mots, tout d’abord, sur le volet ferroviaire.
Le Sénat a adopté un amendement faisant obligation à la SNCF de transmettre aux régions les comptes d’exploitation des lignes de TER. L’Assemblée nationale a renforcé cette obligation de transparence, en précisant que la SNCF devra fournir chaque année aux régions les comptes d’exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la convention d’exploitation, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant d’apprécier les conditions d’exploitation du transport régional de voyageurs.
Les députés ont aussi renforcé les dispositions de l’article 4, en étendant le champ des catégories d’agents assermentés pouvant constater des infractions sur le réseau, comme les vols de cuivre. Désormais, les personnels habilités pour constater les infractions seront non seulement ceux de la SNCF, mais aussi ceux des entreprises « agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France. »
J’en viens au volet « routier » du projet de loi.
Les conseils généraux avaient été quelque peu échaudés par le volume et par la forme du transfert des routes nationales opéré à la suite de l’adoption de la loi du 13 août 2004. Or le présent projet de loi prévoit, en son article 5, le transfert de routes ou sections de route nationales déclassées aux communes et aux conseils généraux. En première lecture, nous avions été nombreux, tant en commission qu’en séance, à demander des précisions. Ces précisions nous ont été apportées puisque M. le ministre a communiqué la liste exhaustive des linéaires transférés : il s’agit, effectivement, principalement de délaissés.
Les dispositions principales de ce projet de loi figurent à l’article 7 et portent sur l’amélioration du mécanisme de répercussion de l’écotaxe poids lourds.
Dès l’adoption de cette dernière, il avait été prévu de répercuter son paiement sur les utilisateurs de transports de marchandises, c’est-à-dire les chargeurs et les principaux donneurs d’ordres de la filière. Or le mécanisme de répercussion de la taxe avait suscité de vives réserves de la part de l’ensemble des acteurs de la filière.
Monsieur le ministre, vous avez donc fait œuvre utile en procédant à une révision du dispositif et en faisant le choix d’une majoration forfaitaire unique, modulée par région, avec l’objectif de limiter les problèmes de perception et de faciliter les négociations commerciales, dans un cadre plus sécurisé et plus équitable.
Sensible, dans sa majorité, à cet effort de simplification, le Sénat n’avait pas ouvert la voie à des dérogations. Tout au plus avions-nous voté l’exonération pour les véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes. Par ailleurs, nous avions décidé de supprimer l’expérimentation alsacienne, dont la pertinence ne nous semblait plus avérée.
Or, lors de l’examen du texte, les 10 et 11 avril dernier, l’Assemblée nationale a supprimé l’exonération pour les véhicules que je viens de mentionner. En outre, elle a exonéré de l’écotaxe une catégorie particulière de véhicules, à savoir les citernes destinées à la collecte du lait. Enfin, elle a fait le choix d’augmenter les minorations au titre de la périphéricité pour trois régions, faisant passer ces minorations de 25 % à 30 % pour l’Aquitaine et Midi-Pyrénées et de 40 % à 50 % pour la Bretagne.
Je veux cependant rappeler que la taxe poids lourds n’a pas été instaurée pour apporter une réponse aux problèmes économiques de telle ou telle filière touchée par la crise, même si ces difficultés sont bien réelles ! En réalité, nul ne l’ignore, la taxe a été instaurée pour contribuer au rééquilibrage concurrentiel entre les différents modes de transport de marchandises. L’importance de sa mise en œuvre est d'autant plus grande que les recettes attendues sont destinées à l’AFITF pour faire face aux très nombreux besoins dans le domaine des diverses infrastructures de transports.
Toutefois, une nouvelle lecture du projet de loi n’était pas envisageable. Les membres de la commission mixte paritaire ont donc pris acte des modifications apportées par l’Assemblée nationale aux articles 6 quater et 6 quinquies nouveaux, tandis que l’exonération pour les véhicules, propriété de l'État ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, a été réintroduite en CMP, ce qui paraît de bon sens.
Pour ces raisons, le groupe socialiste votera ce texte, même s’il n’apparaît pas aussi équilibré et équitable que celui que le Sénat avait voté en première lecture. Mais, ainsi, l’écotaxe, prévue depuis déjà quatre ans, pourra enfin s’appliquer.
Pour terminer, indépendamment de la mise en place de la taxe poids lourds, je reste très préoccupé par le niveau des recettes de l’AFITF. C’est pourquoi, lors de l’examen du projet de loi en première lecture, j’avais évoqué la question de l’aubaine que pourrait constituer cette taxe sur les routes nationales et sur certaines routes départementales pour les sociétés autoroutières, en favorisant un report de trafic sur leurs réseaux et en suscitant ainsi au profit de ces sociétés des recettes supplémentaires…
Ne serait-il pas opportun de tenir compte de ces probables nouvelles ressources pour faire évoluer la fiscalité applicable à ces sociétés, dont les résultats financiers – vous ne me contredirez pas – sont d'ores et déjà plus que corrects ? Je pense qu’il faudra un jour se poser cette question et y apporter une réponse.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports achève aujourd’hui son parcours sénatorial.
Ce texte vient principalement nourrir le dispositif de l’écotaxe pour les poids lourds de plus de 3, 5 tonnes.
Le principe de cette taxe a été voté dans le cadre de loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », et les parlementaires de toutes sensibilités ont largement souscrit à ses objectifs : participer à la transition énergétique, engager la multimodalité des transports et dégager des moyens financiers pour les infrastructures ferroviaires. Toutefois, malgré une quasi-unanimité sur le principe, le gouvernement précédent n’a pas su, n’a pas pu ou n’a pas voulu proposer un contenu.
Monsieur le ministre, le Gouvernement s’est engagé à combler ce vide, qui devenait de plus en plus préoccupant, puisque les recettes de la taxe, en année pleine, sont estimées à environ 1, 2 milliard d’euros pour l’AFITF.
J’observe que, malgré vos efforts, la mise en œuvre de l’écotaxe aura lieu en octobre, et non en juillet, comme il était prévu initialement. Ce report constitue un manque à gagner qui retarde d’autant le rééquilibrage entre la route et le rail.
Monsieur le ministre, le groupe socialiste vous a soutenu quand vous vous êtes engagé dans l’opération, délicate et complexe, consistant à rechercher un dispositif compréhensible et équilibré. Vous avez su rencontrer, écouter et entendre les organisations professionnelles du transport, permettant à ce texte d’avoir aujourd'hui une bonne résonance et d’être attendu par les acteurs concernés.
Le projet de loi examiné les 11 et 12 février 2013 a globalement été bien reçu dans cet hémicycle, même si les débats ont été parfois vifs, ce qui est bien normal.
Curieusement, parmi nos collègues de l’opposition, certains avaient du mal à intégrer le mécanisme de répercussion de la taxe et son applicabilité et, en commission, d’aucuns ont même tout simplement exprimé leur regret d’avoir voté l’écotaxe sous l’ancienne majorité – chacun s’en souvient.
En janvier et en février, nous avons été interrogés par les transporteurs. Des courriers nous sont parvenus. Même si les organisations professionnelles réagissaient positivement dans les territoires, des inquiétudes émergeaient. Résultant, la plupart du temps, de la méconnaissance du principe de répercussion proposé, ces inquiétudes amenaient à des interrogations, toujours dignes, d'ailleurs, des transporteurs préoccupés. Cette préoccupation est, là encore, compréhensible, les marges étant faibles dans cette profession, et vous y avez répondu, monsieur le ministre, en reportant sur le donneur d’ordre l’essentiel de la charge de l’écotaxe.
Il est intéressant que le Sénat ait voulu éviter de prévoir trop d’exonérations, à l’exception de celle qui concerne les véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité territoriale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes, sur laquelle nous nous étions réunis et que nous avons votée, sous la forme d’un amendement insérant un nouvel article 6 ter.
Toutefois, notre démarche a été contrariée lors des débats à l’Assemblée nationale : nos collègues députés ont souhaité introduire un article 6 quater permettant aux véhicules transportant le lait de ferme en ferme de bénéficier d’une exonération et ont supprimé l’article 6 ter.
La commission mixte paritaire s’est tenue hier matin et le débat – bien mené, d'ailleurs, par notre rapporteur, Roland Ries – m’a conduit à adhérer à la position de nos collègues de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, ceux-ci ayant accepté notre amendement portant création de l’article 6 ter.
Au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, l’augmentation de la minoration de la taxe au titre de la périphéricité a fait débat. Nos collègues députés ont voulu aller plus loin que le 2 de l’article 275 du code des douanes, qui prévoit que les taux kilométriques de la taxe poids lourds « sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l’espace européen ». Ce même article porte cette minoration à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d’autoroutes à péage.
Notre rapporteur a largement évoqué les positions défendues au Sénat et celles de nos collègues de l’Assemblée nationale. Finalement, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues, en votant l’article 6 quinquies, qui augmente les minorations.
Lors de la commission mixte paritaire, j’ai également apprécié la plus grande transparence entre l’autorité organisatrice de transport et la SNCF que permettra l’article 3 bis.
Cette disposition permettra aux régions de connaître plus précisément la comptabilité des trains dont elles ont la responsabilité.
Avant le 30 juin prochain, la SNCF transmettra les comptes d’exploitation, qui retracent la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la convention d’exploitation. Elle fournira les comptes détaillés ligne par ligne et procédera à une analyse de la qualité du service, ce qui est primordial si l’on veut que le service public ferroviaire mobilise de plus en plus l’intérêt de nos concitoyens dans les régions. Chacun le sait ici, la qualité de service, la ponctualité et le confort des voitures sont essentiels.
J’ai aussi apprécié l’initiative du président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, qui a proposé un amendement prévoyant que le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur les conséquences de la circulation des poids lourds de 44 tonnes. Il n’est pas anodin que ce rapport intègre les effets de cette mesure sur le transport modal, au détriment probable du ferroviaire et du fluvial.
J’ajoute que nous exprimons des craintes, largement partagées par nos collègues, sur l’entretien des routes et les dégradations afférentes.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports parvient à son terme. Je me réjouis que la CMP ait abouti à un compromis, lequel, comme je l’ai indiqué précédemment, permettra d’enclencher le dispositif de l’écotaxe dans les meilleurs délais. Aussi, je voterai, avec le groupe socialiste, ce projet de loi tel que l’a présenté notre excellent rapporteur, Roland Ries.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

La parole est à M. le président de la commission du développement durable.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me félicite, moi aussi, du travail qui a été réalisé. J’ai été frappé par le sérieux, la volonté d’aboutir et le sens des responsabilités qui ont présidé à la réunion de la commission mixte paritaire, laquelle est parvenue à un compromis.
À cet égard, je veux, à mon tour, remercier notre rapporteur, Roland Ries, qui a, me semble-t-il, fait preuve d’un grand sens de l’intérêt général, en faisant en sorte de ne pas retarder plus encore la mise en place de l’écotaxe, car l’AFITF a grandement besoin de cette ressource.
Permettez-moi de revenir rapidement sur la question des régions périphériques.
S’il est injuste, il est vrai, que l’Auvergne – notre collègue Jacques Mézard ayant quitté l’hémicycle, je me fais son porte-parole – n’ait pas été retenue, la décision est justifiée pour les trois régions qui ont été intégrées. Le choix ne fut pas facile, mais il a fait partie des concessions opérées dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Globalement, le résultat est équilibré, ce dont je me réjouis. Je tiens à féliciter tous les acteurs de cette marche en avant. Cette décision historique s’inscrit dans le cadre de la transition écologique puisque, pour la première fois, une taxe écologique va être mise en place.
Je veux donc saluer, monsieur le ministre, le sens de l’efficacité et du dialogue dont le Gouvernement a fait preuve pour intégrer les professionnels du transport dans cette forme raisonnable d’application de la taxe.
Par son vote, le groupe socialiste apportera son soutien pour avancer sur ce long chemin – je n’oserai dire : cette longue route ! – qui nous attend.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
L’article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l’organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »
L’article L. 2122-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une entreprise exerce des activités d’exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l’infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d’une part, aux activités d’exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires et, d’autre part, à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. »
L’article L. 2141-11 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d’Île-de-France, est identifiée dans les comptes d’exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
« Dans les conditions fixées par chaque convention d’exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet chaque année, avant le 30 juin, à l’autorité organisatrice de transport, les comptes d’exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la convention correspondante sur l’année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l’autorité organisatrice d’apprécier les conditions d’exploitation du transport régional de voyageurs. »
Au 1° du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, après le mot : « correspondances », sont insérés les mots : «, par la création d’aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré ».
Le dernier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des transports est complété par les mots : « et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l’article L. 2111-9 ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4 du code des transports, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « constitutifs de l’infrastructure gérée par la Régie, en application de l’article L. 2142-3 ».
L’article L. 173-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la région d’Île-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable au Syndicat des transports d’Île-de-France, sur délibération de son conseil d’administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu’ils assurent la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement en matière de transport public de voyageurs. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
I. – L’article L. 123-3 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3 . – Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d’une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l’autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n’a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
« Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d’une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d’État.
« Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement à la date du reclassement entre l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les rémunérations des cocontractants de l’État et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport. »
I. – L’article 285 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, la référence : « et 285 septies » est supprimée ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
b) Au 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces taxes » sont remplacés, deux fois, par les mots : « cette taxe ».
III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au second alinéa de l'article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : «, les véhicules, propriété de l'État ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes ».
Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ».
Le 2 de l’article 275 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 3221-2 est abrogé ;
2° L’article L. 3222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3 . – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur de cette seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;
3° À l'article L. 3242-3, les références : « de l'article L. 3222-1, L. 3222-2 et du premier alinéa de l'article L. 3222-3 » sont remplacées par les références : « des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3 ».
II. – Le I du présent article est applicable :
1°
Supprimé
2° À compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III. – Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les difficultés éventuellement rencontrées par les transporteurs routiers de marchandises et les donneurs d’ordre dans la mise en œuvre de la majoration du prix du transport routier prévue au I du présent article.
Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du transport routier de marchandises, l’évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d’ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur les trajets internationaux.
Il évalue notamment :
1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ;
2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d’autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale et à l’échelle régionale ;
3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ;
4° L’impact de l’entrée en vigueur de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur le report modal.
Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur les prix des produits de grande consommation.
Il présente les modalités d’application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées.
L’article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° La référence : « à L. 3222-3 » est remplacée par la référence : « et L. 3222-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »
Le IV de l’article 270 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »
Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Droits des passagers en transport par autobus et autocar
« Section 1
« Services réguliers
« Art. L. 3115-1. – Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« À l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité, l’application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 3115-2 . – Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 3115-3 . – L’application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article.
« Section 2
« Services occasionnels
« Art. L. 3115-4 . – Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Section 3
« Formation des conducteurs au handicap
« Art. L. 3115-5. – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application de la disposition qui fait l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article. »
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont également accès au poste de conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;
2° L’article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. » ;
3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – La dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l’état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
I. – Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d’office
« Art. L. 4244-1 . – I. – L’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. À l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.
« Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d’office du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants.
« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.
« II. – Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
« Art. L. 4244-2 . – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ».
I. – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 5° Les agents mentionnés à l’article L. 2132-21. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° ».
II. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Au début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;
4° L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-3 . – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »
Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l’État confié à Voies navigables de France en vertu de l’article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre l’écluse de Valenciennes sur l’Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° Commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l’ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° Commune de Rouen, quai d’Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l’île Lacroix, entre le viaduc d’Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;
4° Commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :
a) Allée des Marronniers : l’ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
b) Rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° Commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
a) Rue Berthelot, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
b) Avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° Commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
a) Site des Amidonniers, allée de Brienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
b) Port de l’Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
c) Rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n°133 ;
7° Commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue port Saint-Étienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° Commune d’Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond Pitet : l’ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu’ils fassent l’objet par Voies navigables de France de cessions ou d’apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l’article L. 3211-7 du même code.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1 . – Le présent chapitre s’applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots “le navire”, abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1 . – En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée mentionnés à l’article L. 5141-1, l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.
« En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. » ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchéance des droits du propriétaire
« Art. L. 5141-3 . – Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance font l’objet d’une publicité à l’initiative de l’autorité qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Art. L. 5141-3-1 . – Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4 . – En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« Art. L. 5141-4-1 . – Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 ou par l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 5242-16 est abrogé ;
2° L’article L. 6132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-2. – Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. – Pour l’application de la présente section, les mots : “propriétaire”, “navire”, “événement”, “dommages par pollution” et “hydrocarbures” s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26 . – Le propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122-25.
« Art. L. 5122-27 . – Sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à l’article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès d’un tribunal un fonds de limitation pour un montant s’élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28 . – Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29 . – Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
« Art. L. 5122-30 . – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. – Le II de l’article L. 5123-3 du même code est abrogé.
IV. – L’article L. 5123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-4 . – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme habilité à délivrer les certificats d’assurance en application de l’article L. 5123-3, si celui-ci n’exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – Le II de l’article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l’article L. 5123-2. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est abrogée.
I. – Le 9° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d’équipement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° L’article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L’article L. 218-66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;
c) (Supprimé)
d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6°
Supprimé
7° Le dernier alinéa de l’article L. 713-7 est ainsi rédigé :
« – les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »
III. – Le 2° du I de l’article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. – L’article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et «, les syndics des gens de mer » sont supprimés.
V. – Le 8° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26, la référence : « 1° et 3° à 5° » est remplacée par la référence : « 1°, 3° et 5° ».
3° Le I de l’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
c) Le 4° est abrogé ;
3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, la référence : « 4° » est supprimée ;
4° Au 1° de l’article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. – Le 9° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5123-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 5222-2, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° L’article L. 5243-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Le 4° est abrogé ;
5° Le début de l’article L. 5243-2 est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités… §(le reste sans changement). » ;
6° À l’article L. 5243-2-2, les mots : « contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l’article L. 5243-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
8°
Supprimé
9° Au second alinéa de l’article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
10° Au 3° de l’article L. 5336-5, les mots : « et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° À l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
12° À l’article L. 5548-4, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
IX. – Le 5° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. – L’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. – Le 5° du I de l’article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. »
XIII. – Le onzième alinéa du 3° du A de l’article 14 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ; ».
Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5111-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est également applicable » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou masquer ces marques lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° À l’article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du bateau ».
Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1 . – Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« L’ENQUÊTE NAUTIQUE
« Art. L. 5281-1 . – Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2 . – Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il a connaissance d’un événement de mer, à une enquête administrative, dite “enquête nautique”, qui comporte l’établissement d’un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d’urgence.
« Pour les besoins de l’enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effet ont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d’exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et d’en prendre copie.
« Les modalités d’exécution de l’enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’enquête nautique révèle la commission d’une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d’enquête nautique dès sa clôture. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. » ;
2° L’article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5314-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314 -12. – Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. »
II. – L’article L. 5723-2 du même code est abrogé.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Consignation
« Art. L. 5531-19. – Le capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l’un des critères mentionnés au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
« Avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d’appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de la consignation à l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n’ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de la consignation. »
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l’article L. 5531-19 du code des transports, la référence : « au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande » est remplacée par la référence : « au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL
« CHAPITRE Ier
« Champ d’application
« Art. L. 5561-1 . – Le présent titre est applicable aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État ou à partir d’un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.
« Art. L. 5561-2 . – Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1.
« C HAPITRE II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5561-1 du présent code sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;
« 9° Travail illégal.
« Art. L. 5562-2 . – Un contrat de travail écrit est conclu entre l’armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ou toute autre référence équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
« 5° Les fonctions qu’exerce le salarié ;
« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l’armateur ;
« 9° Le droit à un rapatriement ;
« 10° L’intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3 . – La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur établit un document individuel mentionnant l’indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.
« CHAPITRE III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1 . – Les gens de mer employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le risque maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2 . – L’armateur ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1 . – À bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d’urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l’article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« CHAPITRE V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1 . – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret.
« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
« Art. L. 5565-2 . – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« CHAPITRE VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1 . – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de recruter des gens de mer :
« 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2 . – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives à l’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer indûment employés. »
II. – L’article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
III. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième, trente-septième et quarante-sixième alinéas de l’article 15, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, » ;
2° Après la première occurrence de la référence : « L. 5642-2 », la fin des trente et unième et trente-septième alinéas de l’article 15 est supprimée.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE
Le troisième alinéa de l’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d’État ou aux aéronefs militaires. »
À l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d’industrie du Var sur une partie du domaine public de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l’État à cette date pour la concession relative à l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie dont ils relèvent.
TITRE V bis
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOGISTIQUE
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l’initiative d’organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d’équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d’identifier les priorités d’investissement et de service dans un plan d’action national pour la compétitivité logistique de la France.
Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d’action logistiques intégrés au plan d’action national.
Titre V ter
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPROPRIATION
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’article 15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
2° L’article 15-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-2 . – En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1. »
TITRE VI
MODALITÉS D’APPLICATION AUX OUTRE-MER
I.
Supprimé
II. – L’article 8 entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II bis. – L’article 10 n’est pas applicable à Mayotte.
II ter. – Le 1° du II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – L’article 15 est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l’article L. 5771-1 du code des transports ;
3° À Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Les articles 16 et 17 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement, la référence : « L. 218-1 » est remplacée par la référence : « L. 218-10 ».
VI. – Le III de l’article 18 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 1° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
VIII. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 2° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.
IX. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les 1° à 7° et 11° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
X. – Les articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – À l’article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « du titre V » sont remplacés par les mots : « des titres V et VI ».
XI bis. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
XII. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
5° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-2 ainsi rédigé :
« Art. L 5752-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ;
6° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-1. – Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
« Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer. » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762-3. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
7° Le titre VII est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l’article L. 5771-1 est complété par les mots : «, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
8° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
9° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. »
XIII. – Le livre VII de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l’article L. 5761-1. » ;
2° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le chapitre II du titre III du livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l’article L. 5771-1. »
Titre VII
CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT
Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat.
L’établissement a pour missions :
1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;
2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;
3° D’apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;
4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;
5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;
6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’État, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’État dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
À ces fins, l’État peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics.
À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’État.
Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
1° De représentants de l’État ;
2° D’élus représentant les collectivités territoriales ;
3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement choisies en raison de leur compétence, parmi lesquelles des personnes issues du monde des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
4° De représentants élus du personnel de l’établissement.
Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil d’administration.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés du développement durable, des transports et de l’urbanisme.
L’établissement est doté d’un conseil stratégique, qui prépare les travaux du conseil d’administration en matière de stratégie de l’établissement. Le conseil stratégique comprend, à parts égales, des représentants de l’État et des élus représentant les collectivités territoriales.
Des comités d’orientation thématiques nationaux et territoriaux sont créés. Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d’actions territoriaux. Ces instances prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l’État en région ou dans les départements, des collectivités territoriales et des autres bénéficiaires des productions de l’établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d’administration.
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Sans préjudice des dispositions applicables aux personnels des établissements publics administratifs de l’État :
1° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l’État et sont affectés, à cette date, au centre ;
2° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat. Ils conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leurs précédents contrats ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d’État.
Les fonctionnaires et agents en fonction dans l’établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l’habitation et assermentés conformément à l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique d’établissement public et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement se fait de façon transitoire, jusqu’aux élections qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité organisées en octobre 2011 dans les services constituant le Cérema et dont au moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités techniques de proximité existant dans ces services sont maintenus en fonction pendant cette période.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre.
Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, le groupe CRC souhaiterait intervenir sur les articles 5, 6 ter, 11 bis, 16 et 23.

Ma chère collègue, il n’est pas logique, ni d’ailleurs conforme à nos usages, que des orateurs s’expriment à ce moment du débat sur les articles.
Toutefois, la conférence des présidents n’ayant pas demandé la stricte application du règlement en la matière, je puis, en ma qualité de président de séance, accorder certaines dérogations.
Aussi, je vous propose, ainsi qu’aux quatre autres sénateurs du groupe CRC présents, d’intervenir chacun sur un article, étant rappelé que vous aurez également la possibilité de vous exprimer dans le cadre des explications de vote sur l’ensemble.
Ce compromis vous semble-t-il acceptable ?

Aujourd’hui, l’article L. 121-1 du code de la voirie routière dispose que « le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités ».
À la suite de la loi de décentralisation de 2004, les routes ne répondant pas à ce critère ont été transférées aux départements. Toutefois, il était prévu que « l’État conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal ».
L’article L. 123-3 du code précité indique que « le reclassement dans la voirie départementale ou communale d’une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l’autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n’a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. »
Lorsque l’avis de la collectivité est défavorable, le reclassement peut alors être prononcé par décret en Conseil d’État, mais si et seulement si, ce déclassement est motivé par l’ouverture d’une voie nouvelle ou par le changement de tracé d’une voie existante.
Le présent article prévoit de revoir ces dispositions en facilitant les procédures de déclassement par l’État de routes ou de sections de routes nationales.
L’étude d’impact mentionne de manière limpide que l’objectif de cette mesure « est d’élargir les possibilités pour déclasser des sections de route nationale dans l’hypothèse où la collectivité concernée formule un avis défavorable ».
Pour la mise en œuvre de cette disposition, le présent article prévoit, dans le cas de déclassement de la voirie, que les collectivités reçoivent une compensation financière correspondant aux coûts éventuels de remise en état, de l’ordre de 70 000 euros par kilomètre.
Même si cela concerne un patrimoine marginal, représentant près de 250 kilomètres de route, nous considérons, pour notre part, que cette nouvelle charge incombant aux communes doit être justement encadrée.
Pour ce faire, nous avions proposé en première lecture un amendement, qui avait été, malheureusement, déclaré irrecevable, aux termes duquel cette compensation financière intégrait également une provision pour les charges afférentes à l’entretien de ces routes, sur le modèle de ce qui a longtemps été le cas pour les ouvrages d’art, par le biais d’une soulte libératoire.
En effet, à défaut d’une telle provision, ce transfert de compétence pourrait être un cadeau empoisonné pour des collectivités qui devront en supporter les charges d’entretien, faute de quoi leur responsabilité pourra être engagée.
Cela est d’ailleurs clairement rappelé dans l’étude d’impact, qui indique que « les usagers et tiers devront donc se tourner vers la collectivité dans l’hypothèse de dommages de travaux publics éventuels postérieurs au déclassement ».
Je profite de cette intervention pour vous demander une nouvelle fois, monsieur le ministre – je sais que vous y êtes favorable –, d’inscrire à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale la proposition de loi, adoptée à l’unanimité par la Haute Assemblée, visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, dont on sait maintenant qu’elles représentent une charge explosive pour les collectivités.
Cela étant, et pour l’ensemble des raisons que je viens d’exposer, nous continuons de regretter que les précautions que nous avions alors proposées n’aient pas été inscrites dans ce dispositif.

Alors que nous avions adopté ici même un amendement, déposé par plusieurs sénateurs, dont ceux du groupe CRC, permettant d’exonérer les véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes, l’Assemblée nationale a fait le choix de supprimer cette disposition, dès l’examen du texte en commission.
Pourtant, le rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait estimé, dans son rapport, qu’il s’agissait d’un apport de bon sens, qui constituait l’application directe d’une possibilité d’exonération ouverte par la directive Eurovignette.
Il considérait également avec raison qu’il aurait été quelque peu difficile à admettre que des véhicules communaux ou départementaux soient soumis à l’écotaxe pour des travaux d’entretien des routes locales, voire nationales, dans le cas d’une convention conclue avec l’État.
Les députés ont décidé de supprimer cette exonération, au nom du devoir d’exemplarité des collectivités publiques et en raison de la discrimination qui serait sinon créée entre les collectivités locales propriétaires de véhicules d’entretien et celles qui ont recours à des véhicules appartenant à des cocontractants privés.
Nous estimons, pour notre part, que ces arguments sont difficilement recevables.
D’abord, la discrimination ainsi créée est toute relative, puisque la limitation du champ de l’exonération aux seuls véhicules publics est justifiée : l’inclusion des véhicules appartenant à des entreprises privées aurait affaibli le dispositif légal et introduit une complexité supplémentaire.
Quant à l’exemplarité de l’État, comme des collectivités, nous en avons, mes chers collègues, une vision tout à fait différente.
L’exemplarité consiste non pas à chercher uniquement la symbolique, mais à mener une politique qui permette concrètement de replacer l’intérêt général au cœur des politiques publiques et à tenir les engagements qui ont été pris dans le cadre d’une campagne qui n’est pas si lointaine. Je veux surtout parler de l’engagement n° 54 par lequel un pacte de confiance et de solidarité, garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel, serait conclu entre l’État et les collectivités locales.
Par ailleurs, nous sommes particulièrement satisfaits que l’article 6 ter, un article de bon sens, vous en conviendrez, mes chers collègues, ait été rétabli par la commission mixte paritaire, car cette disposition est attendue par les élus, notamment les conseillers généraux.
Protestations sur les travées de l'UMP.

Aux termes de cet article, le Gouvernement doit transmettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le territoire.
Si nous sommes favorables à une telle évaluation, nous pensons qu’il aurait été opportun de la mener avant de généraliser cette autorisation de circulation à tous les secteurs d’activité sur tout le territoire.
En effet, alors que nous dénonçons depuis plusieurs années l’incompatibilité de la circulation des poids lourds de 44 tonnes avec les objectifs du Grenelle de l’environnement, un décret du 4 décembre 2012 signé par Mme Batho et par vous-même, monsieur le ministre, généralisant la circulation des véhicules de 44 tonnes, est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Or le décret du 17 janvier 2011 n’autorisait la circulation de ces véhicules que pour les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et à partir de 2014 pour les autres secteurs.
Pourquoi ne pas avoir demandé une étude préalable afin d’évaluer l’impact environnemental et socio-économique, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées ?
Il est vrai que, à première vue, charger un peu plus les poids lourds en leur donnant la possibilité de passer à 44 tonnes peut paraître écologiquement logique. Si l’on transporte plus de marchandises par camion, on réduit leur nombre, mais nous savons depuis de nombreuses années que c’est une fausse bonne idée ; pire, une véritable hypocrisie !
En effet, la circulation des poids lourds de 44 tonnes entraîne une détérioration plus rapide des routes. Dans un rapport de 2011, le Conseil général de l’environnement et du développement durable a estimé le surcoût lié à l’entretien des routes entre 400 et 500 millions d’euros par an, une somme d’autant plus importante que le budget consacré en 2013 à l’entretien du réseau routier national non concédé ne permet même pas d’assurer l’entretien et le maintien à niveau du réseau existant.
Notre autre motif de perplexité réside dans le fait que tous, sur quelque travée que nous siégions, nous avons affirmé la nécessité, pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement, de favoriser le report modal de la route vers le ferroviaire en développant des autoroutes ferroviaires. Or comment peut-on souscrire à ces objectifs tout en élargissant une autorisation qui est en totale contradiction avec les finalités des autoroutes ferroviaires ?
Toutes les études réalisées, y compris au plan européen, démontrent que l’augmentation de la charge des poids lourds, en conférant au transport routier un avantage compétitif supplémentaire, provoque une perte de trafic des modes alternatifs plus vertueux. La généralisation du trafic des 44 tonnes est donc bien une mesure contraire aux grandes orientations fixées par les lois « Grenelle » en matière de transports.
Enfin, les coûts externes du transport routier sont aujourd’hui estimés à plus de 80 milliards d’euros : cette somme correspond aux embouteillages, aux nuisances sonores et environnementales ainsi qu’à la dégradation des chaussées et des ouvrages d’art, dont la charge de l’entretien pèse sur l’État et, de plus en plus, sur les collectivités territoriales ; sans compter que les routes à très fort trafic de camions deviennent, comme la route Centre-Europe – Atlantique, la RCEA, que je connais très bien, particulièrement accidentogènes.
Enfin, je vous rappelle que le transport est en France le seul secteur dont les émissions de gaz à effet de serre augmentent, en raison de la croissance rapide des émissions du transport routier ; celui-ci représente encore 90 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et plus d’un quart de ces émissions sont le fait des poids lourds.
Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi, alors que le Gouvernement semble attaché aux enjeux environnementaux, une étude contradictoire n’a pas été commandée avant la généralisation de l’autorisation des 44 tonnes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 16 du projet de loi pose le principe de la responsabilité du propriétaire du navire en cas de pollution par hydrocarbures et prévoit une sanction renforcée en cas de marée noire.
Désormais, le défaut d’assurance sera puni d’une amende de 75 000 euros, au lieu de 45 000 euros, et fera encourir une peine d’un an d’emprisonnement. L’obligation de souscrire une assurance s’imposera aux navires immatriculés dans un port français, mais aussi à tous ceux qui toucheront l’un de ces ports ou une installation offshore située dans nos eaux territoriales.
Cet article constitue sans aucun doute une avancée ; il soulève cependant deux questions.
D’une part, la question se pose de l’effectivité des contrôles dans nos eaux territoriales. Pour assurer la protection de plus de 5 000 kilomètres de frontières maritimes, la douane dispose d’un service de garde-côtes chargés de lutter contre la fraude, la contrebande et les grands trafics et de veiller à la protection du milieu marin, ainsi qu’à la sécurité des personnes et des marchandises.
En ce qui concerne plus particulièrement la protection des mers, des avions spécialisés de télédétection des pollutions marines surveillent les façades maritimes les plus exposées aux pollutions dans le cadre du plan Polmar, afin de repérer les navires qui se livrent à des rejets illicites polluant la mer.

M. Michel Le Scouarnec. L’importance de ces missions nécessiterait de renforcer les moyens humains et financiers. Or il semblerait que le plan stratégique de la douane ne diffère pas beaucoup des anciennes orientations mises en œuvre en application de la révision générale des politiques publiques, qui ont eu pour conséquences, de sources syndicales, la suppression de 400 emplois par an et l’abandon de certaines missions, faute d’autre choix. Il est temps d’emprunter d’autres chemins !
M. Roland Courteau acquiesce.

D’autre part, la question se pose des pollutions émises hors de nos eaux territoriales, mais qui ont de lourdes conséquences à la fois sur le domaine maritime international et sur nos eaux territoriales et nos côtes. Comme le rapport présenté en première lecture le signalait, l’article 16 du projet de loi ne règle pas « le problème des navires qui sombrent dans les eaux internationales et y provoquent des marées noires, le sujet relève du droit de la mer et, dans les eaux internationales européennes, de l’Union européenne ».
Certes, les « paquets » ont fait progresser les règles de sécurité en Europe, par exemple en interdisant les tankers sans double coque ; cependant, dans la répression des actes de pollution, des progrès restent à réaliser.
Nous nous souvenons tous des images apocalyptiques de décembre 1999, lorsque le pétrolier Erika s’est brisé en deux au large de la Bretagne, entraînant une marée noire catastrophique sur plus de 400 kilomètres de littoral.

La justice française s’est heureusement déclarée compétente pour juger le naufrage de ce navire maltais qui a coulé en dehors de nos eaux territoriales, dans la zone économique exclusive où seules les conventions internationales s’appliquent, même si les conséquences sont géographiquement localisées sur les côtes françaises.
Dans le même temps, la notion de « préjudice écologique » a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2012, soit tout de même treize ans après les faits.
L’article 4 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ». Selon nous, il serait très utile d’inscrire cette notion de « préjudice écologique » dans le code civil ; monsieur le ministre, qu’en pense le Gouvernement ?
Un autre problème se pose, particulièrement dans le domaine de la pollution maritime : celui des pavillons de complaisance, qui sont d’excellents écrans pour empêcher la recherche de la responsabilité des pollueurs. Les pavillons de complaisance ne devraient plus pouvoir noyer l’irresponsabilité permanente des compagnies pétrolières, prêtes à toutes les ruses pour se défausser.
M. Jean Desessard acquiesce.

Mes chers collègues, je vous rappelle que l’Erika, qui battait pavillon maltais, appartenait à une société libérienne dont les actions étaient nanties en Écosse ; la gestion technique du navire était assurée par une société italienne, mais, par l’intermédiaire d’une société de droit suisse, il se retrouvait affrété par une société des Bahamas… N’est-ce pas formidable ? Ce n’est d’ailleurs pas tout, puisque, par l’intermédiaire d’une société britannique, le navire était ensuite affrété par une filiale de Total, de droit panaméen !

Il est temps que le préjudice écologique maritime soit mieux défini et que des contraintes soient imposées aux pollueurs pour qu’ils assument les actions nécessaires à la remise en état des sites pollués.
Nous approuvons l’article 16 du projet de loi, mais nous tenions à présenter toutes ces remarques pour qu’il ne soit pas une goutte d’eau dans l’océan !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour une dernière prise de parole sur article.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 23 du projet de loi ne règle toujours pas la question du dumping social au sein de l’Union européenne.
Tant qu’il y aura des pavillons européens de complaisance et que l’on ne promouvra pas, au niveau européen, un pavillon d’excellence s’imposant à tous les navires, des compagnies maritimes continueront de profiter, au détriment des travailleurs et de la filière industrielle maritime, des statuts sociaux les plus bas, des impositions les plus faibles et des normes de sécurité les plus souples.
En réalité, cet article conduit à légitimer le recours à l’emploi de personnels précaires en favorisant l’embauche de travailleurs étrangers détachés en contrat à durée déterminée, dans la droite ligne de la directive Bolkestein. Or nous savons, mes chers collègues, quel est le sort de ces travailleurs ; un rapport de M. Bocquet, qui sera publié prochainement, nous en apprendra plus long sur le sujet.
Permettez-moi de vous présenter plusieurs problèmes qui existent aujourd’hui et que l’article 23 du projet de loi ne résoudra pas.
La SNCM a récemment choisi, pour remplacer l’Île de Beauté, bateau destiné à la vente, d’affréter El Venizélos, sous pavillon grec, sur des lignes régulières entre la Corse et la Tunisie. Autrement dit, des marins français vont naviguer sous pavillon étranger !
De son côté, la société Louis Dreyfus Armateurs, qui a pris le marché sur l’autoroute de la mer entre Gijón et Nantes, bat pavillon anglais et emploie des marins qui ne sont ni français ni même espagnols !
Mes chers collègues, pourrions-nous accepter qu’une entreprise étrangère s’installe en France avec ses propres salariés, soumis aux conditions de travail de leur pays d’origine ? Je ne le crois pas. Imaginez que, sous couvert d’ouverture à la concurrence, une entreprise italienne ouvre des bureaux de poste en France avec des travailleurs italiens : les Français devraient apprendre l’italien pour pouvoir acheter des timbres !
Je pourrais aussi prendre l’exemple des navettes aériennes que, mes chers collègues, vous connaissez certainement pour les emprunter entre votre circonscription et le Sénat.
Sourires.

Imaginez que, dans ces avions, le personnel de bord soit polonais et que les consignes de sécurité soient données en polonais…

Bien sûr, j’extrapole ; nous n’en sommes pas encore là. C’est pourtant ce qui pourrait arriver si nous laissons faire !
Avec les mesures qui sont prévues, les marins français vont finir, à plus ou moins long terme, par regarder les bateaux passer le long des côtes françaises.

On m’objectera que l’article 23 du projet de loi apporte un certain nombre de garanties pour améliorer les conditions de travail des marins ; on peut certes s’en féliciter, mais vous-même, monsieur le ministre, avez admis que, pour que le texte soit eurocompatible, il avait fallu limiter ces améliorations.
De même, on nous dira que vous renforcez les contrôles sur les bateaux, notamment en matière de règles sociales. Nous pourrions nous en satisfaire, si ces contrôles ne devaient pas être réalisés à moyens constants.
Or quelle est la réalité de ces moyens ? Mes chers collègues, figurez-vous qu’aujourd’hui une seule personne est affectée au contrôle des bateaux naviguant sur le bassin méditerranéen ; dans les faits, donc, aucun contrôle n’est assuré. On peut toujours sur le papier renforcer les contrôles, ils ne seront pas effectifs pour autant !
Pour le groupe CRC, le compte n’y est pas. À nos yeux, seul le pavillon français de premier registre peut garantir la survie de toute la filière maritime : celle des gens de mer et des marins, mais aussi de la construction navale. Ce qu’il faut, c’est une volonté politique d’affronter l’Europe et de s’opposer à la logique dévastatrice de la concurrence libre et non faussée. C’est ce qu’attendent les marins français, soutenus par l’ensemble des sénateurs du groupe CRC, dans le cadre du changement promis par le nouveau gouvernement !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’instauration de l’écotaxe vise à favoriser le report modal, c’est-à-dire à encourager le transfert du trafic de marchandises de la route vers le rail, la mer ou les canaux.
Il faut pourtant reconnaître que, dans certaines régions françaises, quand bien même les poids lourds seraient fortement taxés, le report modal serait impossible, tout simplement parce que l’offre de fret, et donc la possibilité d’une alternative, n’existe pas ; dans ces conditions, l’écotaxe sera un nouvel impôt sans effet. C’est à cette contradiction que le Gouvernement est aujourd’hui confronté : mener une politique de report modal efficace nécessite de renforcer l’offre de transport de marchandises par le fer, la mer et les canaux.
Pour que les chargeurs aient recours au rail, il faut également que les réseaux soient performants, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. À cet égard, je vous rappelle que nous demandons depuis plusieurs années au Gouvernement de s’engager dans la voie du désendettement de Réseau ferré de France, afin de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour la régénération des réseaux. Nous avons suggéré de nouvelles sources de financement dans la proposition de loi visant au rétablissement de la confiance et à l’amélioration du dialogue social dans les entreprises de transports, déposée il y a peu.
Il faut aussi rappeler que, quoi que nous fassions, les derniers kilomètres seront toujours parcourus par la route.
L’intérêt de la taxe poids lourds est donc réellement conditionné au périmètre des infrastructures qui sont l’objet de son assiette. Reconnaissons-le : là où elle est pertinente, c’est sur les grands linéaires, où le report modal est pertinent.
Nous adhérons donc au principe de l’évolutivité du réseau taxé afin de tenir compte de la possibilité réelle, pour les chargeurs, de recourir à un mode de transport alternatif. À défaut, cette taxe poids lourd appliquée y compris dans les zones les plus enclavées, où nous avons du mal à dynamiser le tissu des PME, apparaîtrait comme injuste.
De plus, un certain nombre de pays ne signeront pas la charte de l’écotaxe française, de sorte que les transporteurs venant d’autres pays auront un avantage concurrentiel accru. Je vous accorde que ce phénomène ne se produira pas partout, puisqu’en définitive seulement 1 % du réseau routier sera taxé. Reste que nous ne pouvons pas nous permettre que cette taxe, juste dans son principe, se révèle injuste en certains endroits, notamment en Bretagne, ou fortement pénalisante pour certains secteurs, comme l’agriculture et l’agroalimentaire.
Sénateur costarmoricain, il m’appartient ici d’être le porte-parole, d’une part, des élus régionaux et, d’autre part, des professions agricoles et agroalimentaires, et plus particulièrement des PME, qui seront impactées par l’écotaxe.
Le conseil régional de Bretagne, se fondant sur ces constats, a formulé lors de sa session des 7 et 8 février dernier les vœux suivants : les modalités qui seront mises en œuvre devront respecter les acquis obtenus dans les textes législatifs établissant l’écotaxe poids lourds ; le dispositif devra être assorti de mesures d’encouragement pour les transporteurs qui font le choix du transfert modal en mettant leurs camions sur des navires ou sur des trains ; les ports régionaux devront être rendus éligibles aux financements d’État issus des produits de la taxe.
Des aménagements allant dans le sens de la prise en compte des vœux de l’assemblée régionale sont possibles. Ils ont fait l’objet d’échanges avec votre cabinet, monsieur le ministre, lors d’un entretien qui s’est tenu en janvier dernier avec Gérard Lahellec, vice-président du conseil régional de Bretagne chargé de la mobilité et des transports.
Les professions agricoles et agroalimentaires estiment à 2 000 emplois perdus les 40 millions d’euros de taxe envisagés. L’exonération de la RN 164, celle des transporteurs de lait et la minoration liée à la périphéricité montrent combien cette écotaxe peut être dangereuse en Bretagne, au regard de la situation géographique de la région, de la faiblesse des modes alternatifs de transport et des hinterlands.
Chez moi, à Lamballe, le directeur de la Cooperl estime à 3 millions d’euros les pertes, dans un secteur très tendu où la concurrence étrangère déloyale sévit.
Les portiques étant déjà installés - avant même le vote de ce projet de loi !-, je vous demande, monsieur le ministre, d’envisager un moratoire expérimental en Bretagne jusqu’en octobre 2014, afin que l’on puisse mesurer, pendant un an, l’impact de cette écotaxe, sans l’appliquer. Ensuite, nous verrons si une telle mesure est négative ou positive pour notre économie régionale.
L’égalité des territoires ne se décrète pas, elle se construit par des politiques ambitieuses. Nous attendons de ce gouvernement qu’il agisse pour l’intégration des coûts externes de la route et pour le report modal, par la création de l’écotaxe, sans oublier, dans le même temps, le développement du fret ferroviaire et des services publics au sein de tous les territoires de la République, afin de renforcer la présence d’un tissu économique performant et d’œuvrer concrètement pour la réindustrialisation des territoires.
Très favorable au report modal, le groupe CRC votera ce texte. Toutefois, renouvelant l’ensemble des remarques qui viennent d’être formulées par mes collègues, j’insiste sur nos inquiétudes concernant les régions.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Sourires.

M. Joël Labbé . En effet, je serai bref. Convaincus de l’absolue nécessité d’une fiscalité écologique juste et pragmatique et considérant que ce texte marque une étape positive dans la transition du transport de la route vers des modes alternatifs existants, le groupe écologiste se prononcera sur ce texte par un vote favorable.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le financement des transports, auquel les collectivités territoriales prennent une part active, est une question extrêmement importante.
Aujourd’hui, les régions consacrent en moyenne 22 % de leur budget au financement des transports ferroviaires. Il est normal qu’elles disposent de l’ensemble des éléments financiers pour évaluer la réalité des dépenses engagées par la SNCF, comme le précise d’ailleurs l’article 3 bis introduit dans ce texte. Comme l’a dit Jacques Auxiette, il s’agit d’un impératif d’autant plus incontournable qu’aujourd’hui les collectivités continuent d’être asphyxiées.
Vous l’aurez compris, nous sommes particulièrement satisfaits des dispositions prévues par ce projet de loi. Pour autant, nous souhaitons vous alerter, monsieur le ministre – vous constatez que mon groupe multiplie les alertes en la matière, j’espère que vous y serez attentif –, sur un certain nombre de points qui restent en suspens en termes de financement des transports par les autorités organisatrices, notamment les régions. Ainsi, nous nous étions émus de la volonté de confier les trains d’équilibre du territoire aux régions. Apparemment, une telle disposition a disparu des projets de loi portant acte III de la décentralisation.
Nous vous invitons, monsieur le ministre, à plaider en faveur d’un abandon pur et simple de cette mesure, qui constituerait une charge non compensée, trop lourde pour les régions dans le contexte financier que j’évoquais il y a un instant.
Je vous rappelle d’ailleurs, mes chers collègues, que la convention relative à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire avait été signée en 2010 entre l’État et la SNCF. Il s’agissait alors de « garantir la pérennité de ces trains Corail qui irriguent la France, d’offrir aux voyageurs un service public de référence complémentaire des TGV et des TER, de s’inscrire dans les objectifs du Grenelle de l’environnement, d’aménager le territoire et d’irriguer les territoires ruraux dans un souci de cohésion nationale. »
Ces objectifs restent d’actualité.
Monsieur le ministre, je veux insister sur la nécessité d’instaurer un versement transport régional, qui s’appliquerait au-delà des périmètres de transports urbains. Le groupe CRC est particulièrement attaché à une telle mesure.
La mise en place de ce versement transport régional permettrait de doter les régions d’une ressource propre, pérenne, dynamique et provenant du secteur économique, lequel bénéficie du système des transports régionaux. Elle contribuerait, outre les dotations de l’État et les ressources de la billettique, à financer le fonctionnement et les investissements des transports régionaux de voyageurs, qu’ils soient d’ailleurs ferroviaires ou routiers, en fonction des particularités locales.
Si c’est la région qui perçoit cette recette nouvelle, nous estimons qu’il lui revient ensuite de mettre en place une structure de coordination pour l’affectation de cette nouvelle ressource. À cet égard, nous nous inspirons fortement de ce qui se passe en Île-de-France, où les départements, les intercommunalités et les communes sont régulièrement invités à investir en la matière.
En tout état de cause, et alors que de nouvelles baisses de dotations sont annoncées – de l’ordre de 5 milliards d’euros dans les trois années à venir –, nous estimons que le Gouvernement doit agir dans deux directions : maintenir sa responsabilité en termes d’aménagement du territoire au travers des TET et, comme le Président Hollande s’y était engagé, instaurer un versement transport régional.
Nous voterons donc ce texte avec satisfaction, mais en étant particulièrement attentifs aux suites qui pourront lui être apportées. Pour nous, vous l’aurez compris, ce n’est qu’une étape !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

M. Michel Teston . Pour les raisons exposées tant par Jean-Jacques Filleul que par moi-même au cours de la discussion générale, le groupe socialiste votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de l’examen par le Sénat de ce texte en première lecture, j’avais fait valoir que les avantages qui avaient pu être accordés aux régions périphériques ne se retrouvaient pas dans le texte qui nous était soumis, notamment à l’article 7. En son temps, d’ailleurs, M. le rapporteur avait reconnu lui-même qu’il y avait effectivement un problème.
À l’instant, mon collègue Gérard Le Cam a également relevé cette difficulté, faisant allusion à un vœu formulé par le conseil régional de Bretagne que j’avais moi-même proposé à l’assemblée régionale. Pour ma part, je ne retrouve pas dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui ce que la région Bretagne avait exprimé de façon unanime lors du vote de ce vœu. Certes, il y a eu quelques toutes petites avancées, mais le compte n’y est pas ! Par conséquent, je voterai, à titre personnel, contre ce projet de loi.

M. Vincent Capo-Canellas . Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pouvons d’abord saluer la combativité de nos collègues du groupe communiste, dont je perçois qu’elle est sans doute plus dirigée contre le texte suivant que contre le présent projet de loi, mais qu’importe ! C’est la règle du débat parlementaire.
Sourires.

Hier, en commission mixte paritaire, nous avons longuement argumenté nos choix. Ce matin, dans la discussion générale, j’ai rappelé la position de mon groupe, qui votera pour ce projet de loi. Je ne développerai donc pas beaucoup plus avant.
Ce texte est une étape, une suite du Grenelle de l’environnement. Nous souhaitons que le ministre reste vigilant quant à l’application de l’écotaxe. En la matière, le rapport prévu devra permettre de mener une véritable évaluation, afin de répondre aux craintes que les professionnels peuvent parfois légitimement exprimer.
Nous attendons aussi que les différentes mesures techniques qui sont contenues dans ce texte trouvent des prolongements dans une politique des transports affirmée. Nous vous donnons rendez-vous lors des prochains débats qui porteront sur la question non seulement du ferroviaire, mais aussi du schéma national des infrastructures de transport.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’obligation de séparation comptable est d’ores et déjà inscrite dans le code des transports français. En revanche, l’obligation de publication séparée n’apparaît pas explicitement en droit national. Dans ces conditions, et afin d’éteindre les griefs déjà exprimés sur ce point par la Commission européenne et d’éviter l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de la France, vous avez souhaité, monsieur le ministre, inscrire une telle disposition dans ce projet de loi.
Pour terminer ce débat, je souhaite vous alerter sur les enjeux du quatrième paquet ferroviaire, en lien avec la réforme que vous portez, qui doit permettre la réunification de la famille ferroviaire par la création d’un pôle public ferroviaire. Sur cette question, monsieur le ministre, nous sommes vos plus fidèles alliés, tant la séparation entre RFF et la SNCF a entaché, à nos yeux, la performance du système ferroviaire national.
Cependant, la vigilance semble de mise, si l’on considère la première ébauche du quatrième paquet ferroviaire, adopté le 30 janvier dernier par la Commission européenne. Certes, la séparation totale entre entreprise ferroviaire et gestionnaire d’infrastructure a été plus ou moins sortie du jeu. Néanmoins, Bruxelles veut imposer une « muraille de Chine » entre les deux activités, si elles sont réunies dans une même structure. Il faudrait ainsi garder deux entités juridiques distinctes, sans possibilité de flux financier, et témoigner de deux logiques différentes. Il s’agit donc d’une démarche particulièrement hypocrite.
Permettez-moi de vous rappeler à cet égard les termes de la proposition de résolution européenne adoptée par le Sénat le 2 avril dernier : « la rédaction proposée par la Commission européenne […], établissant un espace ferroviaire unique européen, tend implicitement, en son alinéa 5, à interdire la création de toute entreprise ferroviaire verticalement intégrée après l’entrée en vigueur de la nouvelle directive. »
Pour cette raison, le Sénat a estimé qu’en l’état la proposition de directive ne respectait pas le principe de subsidiarité. Nous comptons donc sur le Gouvernement pour agir au niveau européen, afin de permettre une plus grande souplesse dans les relations entre les différentes structures qui pourraient constituer le futur pôle public ferroviaire.
Je dois vous dire également notre inquiétude concernant les dispositions contenues dans le troisième projet de loi portant acte III de la décentralisation, qui entacherait les principes d’unité du réseau ferré national, en permettant aux régions d’en devenir propriétaires. Ainsi, l’article 2 de ce texte prévoit la possibilité de leur transférer la propriété du domaine public ferroviaire qui serait d’intérêt régional. Nous sommes totalement opposés à une telle disposition.
Enfin, je souhaite vous faire part, monsieur le ministre, de notre opposition à l’ouverture à la concurrence, en 2019, du marché national du transport des voyageurs, ouverture qu’aucune directive, aucun règlement n’impose jusqu’à présent. D’ailleurs, il n’est pas neutre que, dans ce cadre, Bruxelles travaille à la révision du règlement européen sur les obligations de service public, dit « règlement OSP », adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2007.
En effet, alors qu’en l’état ce règlement OSP permet de conserver le monopole aujourd’hui confié à la SNCF, la Direction générale de la concurrence souhaite retirer de ce règlement un article autorisant les compensations financières accordées par les collectivités locales aux opérateurs de transport.
Nous vous demandons une nouvelle fois de porter au niveau européen l’exigence d’un moratoire sur les trois premiers paquets ferroviaires, avant tout engagement vers une libéralisation accrue du secteur. Vous devrez également vous montrer extrêmement vigilant pour ce qui concerne la révision annoncée du règlement OSP.
Comme mes collègues vous l’ont dit, ce projet de loi est à nos yeux un premier pas dans la bonne direction. Monsieur le ministre, vous avez pris des engagements : nous vous accompagnerons !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
La parole est à M. le ministre délégué.
Je remercie de leur confiance l’ensemble des sénatrices et des sénateurs des différents groupes. Ce vote vient confirmer la qualité des travaux qui ont été conduits au sein de la Haute Assemblée, qualité que j’ai moi-même saluée à l’ouverture de cette discussion.
Nous avons d’ailleurs tellement d’ambitions en commun sur ces questions de transports qu’il semble difficile que nous nous quittions ainsi ! §Et c’est pour le mieux, car la discussion de ce projet de loi a été l’occasion de tracer les perspectives de rencontres futures pour l’examen d’autres textes, avec votre plein soutien et portés par une vision commune de l’efficacité ferroviaire.
Vous m’avez interpellé sur l’article 23, m’enjoignant d’être le plus précis possible. Je m’en voudrais de priver de ces clarifications ceux qui nous liront, et je sais qu’ils sont nombreux sur les quais de nos ports, notamment nos grands ports nationaux, où le compte rendu intégral des débats publié au Journal officiel est toujours très lu, même s’il n’est que partiellement repris.
Sourires
Sur l’article 23, notre volonté est claire et nous sommes fidèles à nos engagements : il s’agit d’éviter une concurrence déloyale, une détérioration des conditions sociales faites aux personnels des différentes compagnies, notamment les compagnies dont les bâtiments ne battent pas pavillon français.
Cet article, qui traduit notre volonté, a été adopté après avoir été amendé.
Nous avons voulu introduire une obligation : les mêmes conditions sociales devront être appliquées à tous les personnels, quel que soit le pavillon, notamment pour le cabotage ou l’activité dans les mers intérieures. Il est ainsi fait référence à un certain nombre de prestations ou de situations sociales.
Le groupe CRC avait déposé sur cet article 23 un amendement, que nous avons soutenu, faisant référence à un article du code du travail qui traite précisément des travailleurs détachés. Or l’article 23 ne concerne pas le statut des travailleurs détachés. Il traduit simplement notre exigence de voir appliquer de façon égalitaire certaines conditions sociales. Donc, nous rehaussons les obligations, notamment les obligations sociales. Il en est d’autres, notamment en termes de contrôle, auxquelles vous avez d'ailleurs fait référence.
Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationale a souhaité que l’article 23 soit réécrit. Comme nous voulions que cet article 23, qui vise à améliorer les conditions sociales dans le secteur maritime, puisse être adopté, nous avons accepté cette réécriture, d’autant que c’était la rédaction que nous avions initialement proposée. Nous n’avons pas été récompensés de cette ouverture puisque, en l’occurrence, les députés communistes n’ont pas voté la disposition qui était reprise !
Soyez en tout cas rassurés : notre objectif est de pouvoir défendre, en mettant en place un certain nombre de dispositions, le pavillon français là où il est menacé. Vous serez d'ailleurs saisis, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « loi DADUE », de cette avancée nouvelle. Le Gouvernement a beaucoup travaillé afin de permettre l’adoption de la convention maritime de l’Organisation internationale du travail de 2006 et la transposition de ses différentes dispositions. C’est à nouveau l’accent mis sur le droit social et sur un traitement égalitaire.
Vous pourriez considérer que ce n’est pas suffisant, mais c’est une avancée, comme vous l’avez d'ailleurs vous-mêmes souligné. Cela permet de préciser et de fixer une lecture de cet article 23, dont les dispositions sont protectrices pour le pavillon français et pour les marins, qui y sont tout comme nous attachés.
Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, notamment d’avoir considéré que vous étiez des représentants de la nation tout entière et non pas seulement de certaines régions, fussent-elles périphériques. Cette notion de région périphérique mérite, vous en conviendrez, une approche pragmatique, mais nous anticipons peut-être là sur la discussion du schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, qui nous occupera prochainement. Les modes de transports ont en effet toute leur utilité en termes d’aménagement du territoire, et nous y serons attentifs.
Je sais en tout cas que le climat qui règne dans cette assemblée nous permettra d’aborder ces débats dans un esprit d’ouverture et avec le souci de l’intérêt des populations et des territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi (projet n° 489, texte de la commission n° 502, rapport n° 501 et avis n° 494).
Les motions de procédure ayant été repoussées lors de la précédente séance, nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Chapitre Ier
Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

L'amendement n° 1, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
La Nation garantit à toutes et tous, conformément aux principes dégagés dans le programme du Conseil national de la Résistance, l’accès aux soins.
La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Cet amendement tend à poser un principe d’accès aux soins qui est déjà inscrit dans le code de la sécurité sociale. Il n’a pas de portée normative différente ou supplémentaire par rapport aux premiers articles du code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 111-2-1, dont je cite d’abord le troisième alinéa : « L’État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire », puis, le premier alinéa : « La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie ». L’article L.111-1, quant à lui, dispose que la sécurité sociale « assure […] la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ».
Le code de la santé publique contient aussi des dispositions allant en ce sens, notamment en son article L. 1411-1.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
Même avis !
L'amendement n'est pas adopté.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, je sollicite une suspension de cinq minutes environ, pour des raisons d’ordre purement technique.
Exclamations ironiques sur les travées de l’UMP.

M. Philippe Dallier. Il ne suffit pas de signer des amendements, encore faut-il être en mesure de les défendre !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour cinq minutes.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.

La séance est reprise.
L'amendement n° 2, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 précité ; »
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code » sont remplacés par les mots : « et du 13° de l'article 995 du même code ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Sourires sur les travées de l'UMP.

Avant d’aborder l’article 1er, sans doute l’une des dispositions les plus fondamentales de ce projet de loi et sur laquelle nous aurons beaucoup de choses à dire, il nous a semblé important de proposer en préalable l’adoption d’un article additionnel.
Cet amendement devrait recueillir la majorité des voix de gauche, puisque c’est une mesure que différents groupes ont portée en 2011.
Comme vous le savez, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance a été mise en place par l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944.
Jusqu’en 2010, les contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires et responsables » étaient exonérés de cette taxe.
Rappelons qu’un contrat est qualifié de « solidaire » lorsque le bénéficiaire n’est pas soumis à un questionnaire médical et que les cotisations ne sont pas fixées en fonction de son état de santé. Cette exonération était donc une mesure incitative.
Le gouvernement précédent a modifié cette disposition dans la loi de finances pour 2011 et la loi de finances rectificative, en assujettissant désormais ce type de contrat à la taxe sur les conventions d’assurance, la TSCA, dont le taux a été porté à 3, 5 % puis à 7 %.
Le gouvernement de l’époque, outre son obsession de rigueur budgétaire et de réduction des dépenses publiques, justifiait la fin de cette incitation par le fait que cette exonération avait produit son plein effet. En effet, 90 % des contrats d’assurance santé étaient désormais solidaires et responsables : les dispositifs dérogatoires n’avaient donc plus lieu d’être.
Les conséquences sur les patients, notamment en matière d’accès aux soins, du fait de la répercussion de cette taxe sur les tarifs pour les assurés, n’ont évidemment pas été prises en compte par la majorité de l’époque.
La gauche a, quant à elle, fortement dénoncé cette décision, tout comme celle, plus générale, du doublement de la taxe sur les mutuelles.
Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, fustigeait la « double peine » dont allaient être victimes les classes moyennes et les plus modestes de nos concitoyens : « C’est le pouvoir d’achat qui va être atteint, ainsi que l’accès aux soins. »
De nombreuses questions écrites ou orales étaient également posées sur le sujet, notamment par des parlementaires socialistes, pour dénoncer l’injustice de cette mesure et pour rappeler le Président de la République à son engagement de revenir à l’exonération.
François Hollande devait rappeler et préciser cet engagement le 20 octobre 2012 lors du congrès de la Mutualité française : « La refonte de la fiscalité des assurances complémentaires se fera par le biais d’une modulation beaucoup plus forte de la taxe sur les conventions d’assurance afin de concentrer les incitations sur les contrats les plus vertueux en termes d’accès aux soins des populations les plus démunies. Il importera que ces contrats dits “responsables” le soient tous véritablement, c’est-à-dire qu’ils garantissent, sans discrimination d’âge ou de situation de santé, les patients ou les futurs patients. Il ne s’agit donc pas de mettre en place une exonération uniforme sur tous les contrats, mais de s’assurer, dans le cadre de cette révision de la fiscalité sur les contrats et d’une redéfinition des contrats “responsables”, que leur contenu soit amélioré. »
Nous saisissons donc l’occasion de la discussion de ce texte, qui est censé ouvrir de nouveaux droits à nos concitoyens, pour demander que cette exonération, une mesure de justice conforme à ce que porte la gauche depuis plusieurs années, soit de nouveau mise en œuvre.

Cet amendement vise à exonérer de taxe sur les conventions d’assurance les contrats de complémentaire santé.
Cette question relève du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un amendement similaire à celui présenté par Mme Pasquet avait d’ailleurs été déposé et examiné en novembre dernier dans ce cadre.
La commission a dons émis un avis défavorable sur l'amendement n° 2, qui est hors sujet.
Cet amendement soulève une question parfaitement légitime, dont nous avons déjà débattu par le passé – un amendement similaire avait effectivement été déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Par ailleurs, ce sujet est actuellement étudié par le Gouvernement, qui a confié une mission au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Le HCAAM formulera des propositions avant l’été sur l’ensemble du sujet.
En effet, la question doit être examinée dans sa globalité, et pas simplement sur le point particulier, d’ailleurs très important, qui est traité par cet amendement. Madame la sénatrice, vous avez d’ailleurs vous-même évoqué le sujet de manière générale dans votre intervention.
Cette question ne doit pas être abordée à l’occasion de la discussion de ce texte. Le débat parfaitement légitime qu’elle suscite devra avoir lieu, et il aura bien lieu, mais de manière approfondie et dans un cadre global. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement.

Je maintiens mon amendement, qui nous permet de revenir sur une décision injuste.
Ce projet de loi se donne pour ambition, tout du moins affichée, d’ouvrir des droits nouveaux aux salariés. En toute cohérence, il serait donc indispensable de revenir sur cette taxe et de permettre aux assurés de retrouver des droits qu’ils ont aujourd’hui perdus.

Avec cet amendement, le groupe communiste républicain et citoyen met le groupe socialiste devant ses responsabilités.
Chers collègues de la majorité, je vous rappelle que, lorsque nous avions instauré la première taxe sur les contrats responsables, vous y étiez tous opposés ! Je trouve logique que le groupe communiste républicain et citoyen dépose cet amendement, mais nous laissons aux sénateurs de la même tendance le soin de régler cette question entre eux…
Sourires sur les travées de l'UMP.

Je mets aux voix l'amendement n° 2.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 169 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 3, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code précité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Nous souhaitons aborder ici la question importante de l’état de santé des étudiants qui, vous le savez, se dégrade dans notre pays.
D’après les principales conclusions d’une enquête menée par La mutuelle des étudiants et la Mutualité française auprès de plus de 8 000 étudiants et publiée en mai 2012, sont en cause le renoncement aux soins pour un étudiant sur trois et l’absence de médecin traitant pour près d’un étudiant sur cinq. Toujours selon cette étude, les étudiants subissent de plein fouet les reculs de l’assurance maladie et se reportent sur les soins de premier recours, faute de complémentaire santé.
Ainsi, depuis de nombreuses années, la situation sanitaire et sociale des étudiants se dégrade.
Pourtant, avec le passage de 3, 5 % à 7 % du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13, 27 % du montant des cotisations, dont 6, 27 % au titre de la taxe CMU.
Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires, même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social et alors même que l’accès à une couverture complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins.
Notre amendement vise, vous l’aurez compris, à contribuer à remédier à la situation en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les personnes ressortissant au régime étudiant de sécurité sociale.
Cette exonération serait limitée aux seuls contrats responsables régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement tend à exonérer de la taxe sur les contrats d’assurance les contrats de complémentaire santé des étudiants.
Comme pour l’amendement n° 2, il s’agit d’une question qui relève du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là aussi, un amendement similaire avait été déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. L’amendement n° 3 est hors champ de l’ANI.
L’avis de la commission est donc défavorable.

J’indique aux auteurs de l’amendement qu’ils peuvent se référer à un excellent rapport sur la sécurité sociale et la santé des étudiants signé par Ronan Kerdraon et par moi-même. Ils verront que les choses ne sont pas si simples !
Notre rapport a été fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, et a été amplement repris par la presse. Il serait bon de commencer par se référer aux travaux de notre assemblée sur la question…
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Il est facile de balayer d’un revers de main des situations auxquelles nous sommes tout de même régulièrement confrontés !
Outre les aspects que j’ai déjà évoqués, l’étude que je viens de citer révèle une forte dépendance familiale des étudiants : pour 73 % d’entre eux, la famille reste la première source de revenus ; 27 % seulement perçoivent une bourse, attribuée sur des critères sociaux, mais plus du quart sont contraints d’exercer une activité rémunérée en plus de leurs études, afin de subvenir à leurs besoins.
Ainsi, les étudiants ont de plus en plus de mal à faire face aux dépenses de santé courantes – médecine généraliste, gynécologie, notamment – et 92 % pratiquent l'automédication, ce qui devrait nous alerter.
Concernant le bien-être psychique des étudiants, la situation n'est pas plus réjouissante puisque 38 % d’entre eux déclarent avoir éprouvé un « sentiment constant de tristesse et de déprime » au cours de l'année écoulée, 12 % affirmant même avoir eu des pensées suicidaires.
Un tiers des étudiants a déjà renoncé à des soins ! Et ce renoncement concerne surtout les soins lourds mais – comme pour le reste de la population – avec un déplacement vers les soins courants.
De plus, les étudiants sont concentrés dans des villes où les dépassements d'honoraires sont plutôt plus importants que dans le reste du territoire.
Vous l’aurez compris, notre amendement visait à apporter un éclairage particulier sur cette situation qui, je crois, appelle un règlement urgent.

Le rapport d’information que ma collègue Catherine Procaccia et moi-même avons commis met en évidence ce problème. Il va même au-delà, car les préconisations que nous avons formulées dans ce cadre sont destinées au Gouvernement comme aux parlementaires en vue de l’élaboration d’un véritable plan de santé pour les étudiants.
Nous avons interrogé le Gouvernement à plusieurs reprises et, encore récemment, le cabinet de la ministre des affaires sociales. Selon ce dernier, un certain nombre de ces propositions pourraient être incluses dans un plan de santé publique qui comprendrait à la fois un volet pour la santé des jeunes et un volet destiné aux étudiants.
On s’oriente donc dans la bonne direction, même si la situation que vous décrivez, chère collègue, correspond à une réalité à laquelle nous avons été confrontés et que différents rapports mettent en lumière – l’Observatoire de la vie étudiante, par exemple, en a fait état.
Il me semble néanmoins que le texte que nous examinons n’est pas forcément le bon support pour apporter une réponse au problème. Je rejoins tout à fait, à cet égard, notre rapporteur quand il renvoie au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C’est dans ce cadre que nous-mêmes, au groupe socialiste, avions déposé un amendement sur le sujet – cet amendement avait été retiré, car il ne correspondait pas au projet du Gouvernement, dans l’attente du plan de santé pour les étudiants.
Ainsi, le groupe socialiste ne votera pas cet amendement.

Le problème que nous évoquons est tellement grave que les amendements proposés ne sont absolument pas à la hauteur de l’enjeu. Le sujet a été bien exposé dans le rapport d’information du Sénat, mais je voudrais, à cet instant, appeler à nouveau l’attention du Gouvernement sur ce problème de l’assurance maladie des étudiants.
Le Gouvernement doit prendre, au plus vite, des mesures pour réorganiser complètement cette assurance. J’ignore s’il faut, de même, supprimer aussi rapidement que possible les mutuelles qui en ont la charge, mais force est de constater qu’il est quasi impossible, pour un étudiant, de se faire rembourses dans des délais décents, voire de se faire rembourser tout court… Et, pour obtenir une carte vitale par l’intermédiaire d’une mutuelle étudiant, il faut attendre des mois et c’est un véritable parcours du combattant. Il en est de même pour la moindre feuille de soins envoyée à l’une quelconque de ces mutuelles.
La situation ne peut pas durer.
Ce n’est pas une question de taxe, c’est un problème d’organisation de la couverture d’assurance maladie. Faut-il que les étudiants rentrent dans le régime général de la sécurité sociale ? Je l’ignore, n’étant pas spécialiste en la matière, mais je souligne, comme beaucoup d’entre vous, qu’il est urgent de faire évoluer le dispositif.
En attendant, nous voterons contre cet amendement, qui ne résoudrait rien s’il était adopté.
Applaudissements sur quelques travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 4, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l'emploi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les conséquences d’une mesure permettant à tous les étudiants de bénéficier, de droit, d’une aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

L’amendement que nous vous proposons tend à étudier la possibilité d'étendre l'aide au paiement d'une assurance complémentaire aux étudiants.
Le présent élargissement de l’accès aux complémentaires santé est, de notre point de vue, insuffisant pour répondre aux nécessités de la jeunesse étudiante, qui ne doit pas être oubliée.
Qu'en est-il, en effet, des possibilités d'accès des étudiants à la santé ? Ils forment une population toujours plus nombreuse, mais aussi toujours plus nombreuse à renoncer aux soins pour payer ses études.
Cette population n'est pas à exclure de cette discussion sur la sécurisation de l'emploi, car si l’on oublie en effet, dans ce texte, que plus d'un étudiant sur trois complète ses ressources par une activité rémunérée, on oublie également que plus de 600 000 de ces étudiants sont boursiers – bien souvent à l'échelon maximal –, ce qui prouve qu’ils sont précisément victimes de cette crise qui frappe le peuple.
Pour beaucoup d'entre eux, le quotidien, c'est la précarité. Ainsi, selon la LMDE – La Mutuelle des étudiants –, plus de la moitié des étudiants vivent avec moins de 400 euros par mois. Quatre cents euros pour vivre ! Cela fait 400 euros pour se loger, pour manger, pour s'instruire, pour se divertir ! Et combien d'euros reste-t-il pour se soigner ?
Pourtant, nous savons que la santé est un droit pour tous et toutes. Il n'y a pas d'âge qui soit épargné par les nécessités sanitaires. Par exemple, les soins optiques participent évidemment à la réussite d'un étudiant, tout comme les soins dentaires, dont le défaut peut en revanche peser durablement sur la vie du futur salarié.
Ces étudiants qui, pour beaucoup, sont aussi salariés, ont droit à la solidarité nationale. Mais si la couverture complémentaire peut avoir des effets bénéfiques, elle est trop onéreuse pour les étudiants. Toujours selon la LMDE, 29 % d’entre eux ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières.
Nous devons corriger les effets néfastes du désengagement progressif de la sécurité sociale publique concernant la couverture médicale.
Quel message adressons-nous à notre jeunesse, en lui faisant comprendre que se soigner est désormais un luxe ?
Quel message adressons-nous à notre jeunesse en lui disant qu'elle doit choisir entre santé et logement ou entre santé et études ?
Pourquoi s'étonner, dès lors, du nombre croissant de ces jeunes qui quittent notre pays ?
Nous considérons que la solidarité nationale, que nous devons à notre peuple, implique que les étudiants puissent, eux aussi, bénéficier d'une aide à l'assurance complémentaire santé.
Il n'est plus acceptable que la France – cinquième puissance économique du monde – délaisse toujours plus ses jeunes au mépris de la logique la plus élémentaire. En effet, la croissance future se fera grâce à ces jeunes, bien formés et en bonne santé.
Il y va de l'avancement de la société vers la justice et l'équité. C'est le sens de cet amendement.

L’enjeu, tel qu’il est décrit par nos collègues, mérite que nous partagions l’intérêt qu’ils lui portent. Toutefois, l’accord dont ce projet de loi est la traduction ne concerne pas les étudiants, mais seulement les salariés.
Pour cette raison, l’avis est défavorable.
Je dirais, comme le rapporteur, qu’il s’agit d’un sujet extrêmement important. Je pense d’ailleurs qu’il ne faut pas se limiter à la seule question des étudiants et qu’il convient de poser ici, plus généralement, la question des jeunes…
… qui ne sont pas salariés et rencontrent en particulier des problèmes de couverture complémentaire.
Ce sujet a été abordé par le Président de la République au congrès de la Mutualité, où il s’est engagé sur la couverture complémentaire pour tous au 1er janvier 2017 – on en reparlera peut-être lors de la discussion de l’article 1er. Il faut réfléchir aux conditions de cette couverture.
De nombreux travaux ont déjà été conduits et nous sommes maintenant dans une phase opérationnelle. Je pense qu’un rapport supplémentaire n’apporterait pas plus à la connaissance – vous en avez d’ailleurs apporté la preuve, madame Pasquet – de la situation parfois déplorable de ces jeunes.
Nous sommes donc dans l’action et nous vous formulerons une proposition globale au profit de l’ensemble de ceux qui, aujourd'hui, ne bénéficient pas de cette complémentaire santé.
C’est pourquoi je ne peux pas être favorable à votre amendement, madame Pasquet.

Parfaitement, monsieur Dallier, l’amendement tend à demander un rapport, …

… ce qui nous permet aussi d’évoquer la condition des étudiants et de la jeunesse en général, c’est-à-dire de ceux qui sont les travailleurs de demain – du moins je l’espère, pour eux et pour nous, pour leur avenir et pour le nôtre.
Je profite donc de cette explication de vote pour en rajouter
M. Philippe Dallier s’esclaffe

La réalité, c'est que la crise touche nos jeunes de toutes les manières possibles : chômage de masse avec 25 % de demandeurs d'emplois parmi eux, difficultés de plus en plus grandes à trouver un emploi stable après les études...
L'âge moyen du premier CDI n'a cessé d'augmenter, passant de vingt-trois à vingt-sept ans, voire plus, selon certaines estimations. Cette difficulté est renforcée, évidemment, par l'utilisation massive de la jeunesse comme variable d'ajustement lui offrant des contrats courts, des stages – souvent non conventionnés ni rémunérés – et de l’intérim.
Oui, notre jeunesse est de plus en plus confrontée à un mur, celui de l'emploi. Les jeunes ne peuvent plus accepter – ils ont raison ! – de ne pas voir leur formation, leurs compétences, leurs expériences reconnues. La crise qui les atteint se double donc d'une crise de confiance.
Une crise de confiance que nous retrouvons dans les chiffres d'expatriation des jeunes diplômés. Pour l'année 2013, le quota de visas vacances-travail pour le Canada a été écoulé en moins d'une semaine, alors que, deux ans auparavant, il avait fallu un mois…
Cet exil massif de toute une jeunesse formée en France, mais qui ne trouve plus d'avenir dans notre pays, doit nous interpeller. Alors que la plupart de ces jeunes sont fiers d'avoir été élevés à l'école de la République, ils ne trouvent plus ici la possibilité d'exprimer leur potentiel.
Quelle est la raison de cet appel du large ? Eh bien la raison, nous la connaissons tous sur ces travées : nous n'avons plus rien à offrir à ces jeunes. Pourquoi ? Là aussi, nous le savons : la situation des étudiants, économique, sociale et sanitaire, ne cesse de se dégrader.
Elle se dégrade avec le coût des études qui enfle, notamment en raison des frais réclamés par certaines universités. Cette hausse est notamment consécutive à la réforme portée par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, qui a asséché les finances de certaines universités et permis la création, à leurs côtés, d'universités privées ou d'écoles privées dont le seul objectif est la vente d'un diplôme et d'un réseau.
Le coût des études augmente également en raison des difficultés d'accès au logement étudiant. À cet égard, je ne peux que rappeler ici, mes chers collègues, les objectifs du plan Anciaux, qui n'ont jamais été atteints : sur les 50 000 logements nouveaux prévus entre 2004 et 2014, seuls 23 000 ont été construits.
Mais ce qui nous inquiète, mes chers collègues, c'est que cette situation est susceptible d'empirer. Le flou actuel autour de la modification des aides au logement étudiant n'aide pas, en effet, à rassurer les étudiants qui en bénéficient.
Il en va de même des revalorisations des bourses étudiantes, voire de l'instauration d'une allocation d'autonomie, tant réclamées par les associations étudiantes. Elles devraient au moins compenser le plafonnement de la demi-part fiscale.
La jeunesse, qu'elle soit étudiante ou non, a vu sa précarité se généraliser. Elle est la première victime, avec les plus âgés, de la crise économique et sociale que traverse notre pays.
Certes, le Gouvernement a annoncé des mesures et créé le contrat de génération. C’est une réponse nécessaire, bien qu'insuffisante, à la crise de confiance profonde que traverse notre jeunesse et à laquelle nous devons remédier.
Mes chers collègues, cette crise de confiance est gravissime. Elle est générale. Elle est partagée.
Cette crise explique aujourd'hui la situation sanitaire des étudiants, car les premières dépenses dans lesquelles on coupe, lorsqu'on est étudiant, sont bien celles qui concernent la santé : elle devient une dépense de trop, un luxe pour ceux qui n'ont que quelques centaines d'euros pour vivre. Quatre cents euros pour la moitié d'entre eux, nous l'avons déjà dit, c'est trop peu et c'est inacceptable. Pas en 2013 ! Pas en France !
Avec cet amendement, nous proposons d’envoyer un message, un signal, ni plus ni moins. Il est grand temps que la République montre à ses jeunes qu’ils ne sont pas abandonnés. Ils doivent enfin savoir que la solidarité nationale s'adresse également à eux et qu'ils ont leur place dans la France de demain. La solidarité n'est pas qu'un vain mot, elle doit pouvoir trouver son expression dans les faits.

Monsieur le ministre, les propos que vous avez tenus tout à l’heure sont tout à fait justes. Un certain nombre de rapports existent : le rapport Nauche de 1999, le rapport Wauquiez de 2006, celui que Catherine Procaccia et moi-même avons signé…
Par conséquent, tout le monde connaît la situation et les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants : l’accès à la santé, mais aussi, plus largement, l’accès au logement ou l’obligation de trouver un travail pour subvenir à leurs besoins et poursuivre leurs études.
Je fais très largement confiance au Gouvernement et au Président de la République, qui a annoncé des orientations claires et précises, rappelées par M le ministre précédemment.
C’est pourquoi le groupe socialiste, confiant dans ces engagements, votera contre cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 51, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre préliminaire du code du travail devient le chapitre liminaire.
II. - Avant le chapitre liminaire du même code, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Utilité sociale et collective des entreprises
« Art. L1A. - L’activité économique des entreprises de production de biens ou de services, qu’elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, a pour finalités le bien être des producteurs, la sécurité de l’emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens, la préservation de l’environnement. Les choix de gestion des entreprises sont guidés par ces buts qui priment toute autre considération. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Par notre amendement, nous souhaitons rappeler quelques principes qui doivent selon nous guider l’activité économique.
D’une part, la politique économique du Gouvernement devrait se donner pour objectif le bien-être de l’ensemble des travailleurs. C’est l’un des premiers éléments de notre amendement.
On constate aujourd’hui un mal-être croissant au travail. Le travail n’est plus un épanouissement, il devient un lieu de stress pour les femmes et les hommes, et cela pour plusieurs raisons.
Les salariés constatent de plus en plus un décalage entre leurs missions et les moyens qui sont mis à leur disposition pour les accomplir ; c’est vrai dans le privé comme dans le public. Il y a également une dégradation des conditions de travail, ce qui fragilise l’ensemble des salariés.
Le recours aux contrats à durée déterminée et au temps partiel, la multiplication pour les jeunes des stages en lieu et place de véritables embauches, toutes ces pratiques ont des conséquences très inquiétantes sur la santé des salariés. Beaucoup d’entre elles, beaucoup d’entre eux acceptent en silence cette violence économique pour conserver un emploi leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Cette question du mal-être ne doit pas être négligée et nous souhaitons le réaffirmer ici, car le projet de loi que nous examinons légalise la précarisation des conditions de travail. Nous souhaitons nous inscrire dans le préventif ; nous aimerions construire avec l’ensemble des forces de gauche une société dans laquelle le bien-être des personnes soit un objectif premier.
D’autre part, nous souhaitons réaffirmer par notre amendement que la sécurité de l’emploi et la formation doivent être au cœur des politiques économiques.
Le projet de loi ne permettra pas d’accéder à ces objectifs. En effet, en faisant comme si les employeurs et les employés étaient dans une situation d’égalité, alors même que les seconds sont dépendants des premiers, les auteurs du projet de loi font le jeu du MEDEF.
Certains politiques ont la mémoire courte. Le MEDEF, avec Xavier Bertrand, avait imposé la « rupture conventionnelle », dont la caractéristique principale est de n’avoir pas besoin de motif : le consentement formel de l’employé suffit. Or, depuis l’accord de janvier 2008, et la loi d’août 2008, il y a eu un million de ruptures conventionnelles et pas de relance de l’emploi ! C’est la preuve que, lorsque la rupture du contrat est facilitée, lorsque les salariés sont la variable d’ajustement, la sécurité de l’emploi passe à la trappe !
Nous vous demandons donc de voter cet amendement au nom de l’ensemble des femmes et des hommes qui travaillent et de celles et ceux qui sont en recherche d’emploi, parce qu’elles sont, ils sont l’avenir de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Par cet amendement, vous souhaitez définir les finalités de l’activité économique des entreprises autour des notions de bien-être des producteurs, de sécurité de l’emploi, de satisfaction des besoins des citoyens, de préservation de l’environnement.
Ces finalités, nous les partageons tous, mais elles n’entrent pas strictement dans le cadre juridique du texte qui nous est proposé. Pour cette raison, et pour cette raison seulement, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement tend à poser un certain nombre de grands principes, d’ordre plus constitutionnel que législatif. Nous en trouvons d'ailleurs quelques éléments dans la Constitution, en tout cas dans le préambule de la Constitution de 1946.
Donc, cet amendement n’a pas sa place dans un ensemble de dispositions codifiées comme le code du travail. Pour cette seule raison juridique, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Cet amendement n’est pas directement rattaché au texte, mais il en est très proche, car il est plus qu’important de rééquilibrer dans la loi l’application des principes fondamentaux que sont la liberté d’entreprendre, d’une part, et le droit pour chacun d’obtenir un emploi, d’autre part, en précisant les finalités de l’activité économique.
La multiplication des licenciements spéculatifs, abusifs, boursiers, nous rappelle chaque jour la réalité sociale écrasante que connaissent les salariés qui ont travaillé toute une partie de leur vie dans des entreprises et qui se voient remerciés du jour au lendemain. Je pense ici – mais pas seulement, car la liste serait trop longue – aux salariés de Michelin, Total, Alstom, Danone, Renault, Goodyear, PSA Peugeot Citroën, Sanofi, ArcelorMittal ; la liste est longue !
Nous souhaitons, pour notre part, rappeler avec insistance l’utilité sociale et collective des entreprises.
Le Conseil constitutionnel – M. le ministre y a fait référence – a reconnu que la liberté d’entreprendre mais également le droit à l’emploi sont deux principes à valeur constitutionnelle.
Le droit au travail a également été proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, de 1948, en ces termes : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » Ce droit est également garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, en son article 6, texte que la France a précisément approuvé et dont elle doit tenir compte, nous semble-t-il, dans son ordre juridique interne.
De même, la Constitution de 1946 pose que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », droit qui est d’ailleurs repris dans la Constitution de 1958 fondant les bases de la Ve République.
La loi doit donc non seulement respecter les règles internationales, mais aussi ne pas entrer en contradiction avec les règles émanant du corpus constitutionnel. Or, depuis la décision dite « Liberté d’association » du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a procédé à une extension du domaine constitutionnel, puisque s’ajoutent désormais aux articles du texte de la Constitution de 1958 stricto sensu les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée par l’Assemblée constituante le 26 août 1789, ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui proclame les principes politiques, économiques et sociaux considérés comme « particulièrement nécessaires à notre temps ».
Il est vrai que le Conseil constitutionnel donne la primauté à la liberté d’entreprendre, et nous le regrettons, en préférant toujours un dispositif libéral à un dispositif social. Ainsi, dans sa décision du 12 janvier 2002, il censure la nouvelle définition du licenciement économique, considérant qu’elle porte une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre.
, il ne censure pas, au nom du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, pour atteinte excessive au droit de chacun d’obtenir un emploi, la liberté donnée à l’employeur de licencier, à tout moment, pendant deux ans et sans motif, un jeune de moins de vingt-cinq ans recruté par un contrat première embauche.
Enfin, dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil refuse d’accorder une valeur constitutionnelle au principe de repos dominical en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il reconnaît toutefois, dans cette même décision, la valeur constitutionnelle du principe de repos hebdomadaire.
Le projet de loi que vous nous présentez aujourd’hui s’inscrit dans cette tendance, ce que nous déplorons. Il méconnaît, selon nous, trop fortement ce droit à l’emploi, sans pour autant assurer une relance de l’emploi. C’est d’ailleurs en substance ce que disait l’un des membres du bureau exécutif du MEDEF, M. Patrick Bernasconi, qui, devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, se réjouissait de toutes les avancées du texte pour le patronat, tout en ne garantissant pas que celui-ci serait efficace pour créer des emplois !
Et c’est bien là tout l’enjeu : pourquoi demander aux salariés tous ces sacrifices, pourquoi renoncer à leurs droits élémentaires au travail et à la formation, pourquoi oublier leur bien-être, si les salariés restent livrés aux appétits financiers de patrons peu scrupuleux ?
Cet amendement, qui a pour objet de rappeler les principaux objectifs de l’activité économique, nous semble donc plus nécessaire que jamais !

Je mets aux voix l'amendement n° 51.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;
2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre.
II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 911 -7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.
« Art. L. 911 -8 . – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois ;
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. »
II bis (nouveau). – Avant la dernière phrase du I de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7. »
II ter (nouveau) . – Le sixième alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ; »
3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. »
IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des salariés » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;
3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ».
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture.
VI. –
Supprimé
VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».
VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : «, en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »
X
XI
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

L’article 1er, qui fut au cœur de nos débats en commission et des auditions, cristallise des exigences et des revendications souvent contradictoires.
Je voudrais d’abord rappeler quelques statistiques qui éclairent les choix faits par les partenaires sociaux : 33 % des quelque 400 000 personnes dépourvues de couverture complémentaire santé déclarent renoncer à des soins pour raisons financières, contre 15 % de celles qui sont couvertes. Ces chiffres expliquent à eux seuls toute l’importance du dispositif de l’article 1er.
Les partenaires sociaux ont choisi d’inscrire celui-ci dans l’accord national interprofessionnel : il s’agit donc d’un nouveau droit, dont bénéficieront principalement les salariés des petites entreprises, les non-cadres et les titulaires d’emplois précaires.
M. le ministre l’a rappelé tout à l'heure, la mise en place de ce dispositif est concomitante à la réforme engagée par le Gouvernement en vue de généraliser, à l’horizon 2017, une couverture complémentaire de qualité. Je rappelle que le Gouvernement a commandé un rapport sur ce sujet au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
En cet instant, je souhaite, monsieur le ministre, vous interroger sur un point particulier, afin que l’information puisse être complètement partagée : le texte du projet de loi n’étant pas explicite sur ce sujet, pourriez-vous nous confirmer ici que, comme la lecture du code de la sécurité sociale et du code rural semble le laisser à penser, les entreprises agricoles seront également soumises à l’obligation de fournir à leurs salariés une couverture complémentaire santé ?
Je voudrais revenir sur les réactions auxquelles a donné lieu la présentation de cet article 1er au gré des auditions et de nos rencontres avec les représentants des différentes forces vives de nos territoires.
Il faut noter que les études disponibles montrent clairement les avantages des contrats collectifs : ces derniers offrent en moyenne plus de garanties que les contrats individuels et sont moins chers. Les résultats financiers des contrats collectifs sont systématiquement inférieurs à ceux des contrats individuels, même en soustrayant les frais commerciaux de démarchage.
J’en viens maintenant à la clause de désignation, qui a été source de dissensions entre nous. Nous avons tous reçu, dans nos boîtes aux lettres et dans nos boîtes mail, de nombreux courriers à ce sujet. Une lecture approfondie de l’article 1er fait apparaître un point majeur, à l’origine de nombreux malentendus : toute liberté est laissée aux partenaires sociaux pour gérer la prévoyance et la couverture santé comme ils le souhaitent. Dans cette perspective, ils ont le choix entre trois possibilités : laisser aux entreprises le soin de choisir l’assureur, formuler une recommandation ou procéder à une désignation. Dans l’esprit, les termes de l’accord sont donc pleinement respectés ; ce sont bien les partenaires sociaux qui décident, et eux seuls.
Je voudrais également préciser que la clause de désignation n’est pas un outil de contrainte : elle est au contraire au service des partenaires, en ce qu’elle permettra une réelle mutualisation, à un niveau évidemment plus large que celui de la seule entreprise, induisant une diminution des coûts. Elle permettra en outre la mise en place d’actions sociales collectives, de politiques de prévention et de santé publique, ainsi qu’un partage du fardeau lorsqu’une entreprise ne paie plus ses cotisations, ce qui constitue, soit dit au passage, une protection essentielle pour les salariés.
Mes chers collègues, je veux insister sur le fait que ce projet de loi n’apporte à cet égard aucun changement par rapport au droit existant, si ce n’est – cela devrait pleinement rassurer une partie de notre assemblée – qu’il renforce drastiquement les conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats. Autrement dit, au début du processus, tous les candidats potentiels seront sur la même ligne. Est ainsi imposée une mise en concurrence, en cas tant de recommandation que de désignation, qui a encore été renforcée par l’Assemblée nationale. Je le dis avec force, avec ces nouvelles modalités tendant à assurer l’impartialité, nous éviterons les abus qui ont pu être constatés ici ou là.
Je rappelle enfin, pour lever tout malentendu, que la clause de désignation, créée à l’origine sans base législative par les partenaires sociaux, a été jugée parfaitement licite par toutes les juridictions qui en ont été saisies ces dernières années : l’Autorité de la concurrence – lisez bien son dernier avis, en date du 29 mars dernier –, le Conseil d’État, la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne.
Je ne doute pas que nous aurons un débat sur ces questions, mais je souhaitais, à titre liminaire, exposer dans quel cadre j’ai travaillé sur l’article 1er en préparant mon rapport.

Je voudrais répondre tout de suite à la question précise que m’a posée M. le rapporteur.
Le dispositif de ce projet de loi a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, donc notamment à ceux du secteur agricole, en l’absence de dispositions spécifiques dans le code rural. Les représentants de la profession, en particulier la FNSEA, le savent très bien, ce point ayant été clarifié lors d’une réunion tenue en ma présence dans le cadre de la commission nationale de la négociation collective, le 18 février dernier.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi marque un tournant en termes de méthode, avec cette innovation majeure que constitue l’engagement d’une négociation avant l’élaboration de la loi. L’accord national interprofessionnel confirme la détermination du Gouvernement à changer les pratiques et les habitudes, en instaurant le dialogue comme un préalable à la loi.
Le Président de la République avait souhaité que les forces vives de la nation soient mobilisées afin de trouver des solutions nouvelles pour l’emploi. Signé par une majorité d’organisations syndicales et patronales, l’ANI, que transcrit ce projet de loi, est le fruit d’une concertation, d’une négociation et affiche un équilibre global dans la bataille pour l’emploi et contre la précarité.
À travers l’article 1er, nous retrouvons le chemin vertueux et nécessaire de la généralisation de l’accès aux soins pour tous.
En effet, cet article prévoit à la fois la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour les salariés du privé et l’amélioration de la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi, y compris pour le secteur agricole, ce qui constitue une avancée.
Tout ce qui conduit à mieux protéger les salariés est un progrès dont nous devons nous féliciter. Que chaque personne, dans notre pays, puisse accéder aux soins dont elle a besoin, que personne n’ait à renoncer à se faire soigner par manque de moyens, voilà un objectif majeur vers lequel nous devons tendre. Ce projet de loi représente un premier pas vers une généralisation effective de la couverture complémentaire santé. Par la suite, il nous faudra étendre l’application de ce principe à d’autres catégories de la population, notamment aux jeunes qui restent encore aujourd’hui en dehors du système. Des engagements ont été pris en ce sens et des rapports ont été produits sur ce sujet.
Je souhaiterais également que nous demeurions vigilants sur certains points spécifiques découlant de cette généralisation : je pense en particulier à la clause de désignation, aux appels d’offres et à la question des ayants droit.
Malgré tout, je tiens à le redire, cet article constitue une avancée. À partir de 2016, toute entreprise, quelle que soit sa taille, devra permettre à ses salariés de bénéficier d’une couverture santé collective de qualité, conforme à la définition des contrats solidaires et responsables.
Tout cela se fera sur la base de négociations qui débuteront dès le 1er juin 2013 et ce sont 400 000 personnes qui bénéficieront de ce système. Disons-le tout net, c’est là du très bon travail. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la généralisation de la couverture santé complémentaire à tous les salariés constitue une avancée incontestable ; personne n’en disconvient.
C’est sa mise en œuvre, telle que prévue par le présent projet de loi, qui suscite des interrogations, et plus précisément la possibilité ouverte aux branches de « désigner », et non pas seulement de « recommander », un organisme complémentaire auquel toutes les entreprises de la branche devront recourir, y compris celles ayant déjà mis en place une couverture complémentaire : c’est la fameuse clause de désignation, dont vient de parler M. le rapporteur.
Il ne fait pas de doute que, sur ce point, le projet de loi est en parfaite contradiction avec l’accord national interprofessionnel, dont l’article 1er est très explicite : « Les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander […]. » Recommander, et non désigner : on ne peut être plus clair. Le terme « désignation » ne figure, au sein de l’ANI, que dans une note de bas de page relative aux seules branches ayant déjà désigné leur organisme complémentaire ; rien de plus.
Or la clause de désignation introduite par le Gouvernement dans la transcription de l’accord pose problème.
D’abord, sur un plan éthique, la désignation risque de conduire à une reconfiguration brutale, et non souhaitable, de l’offre de couverture complémentaire santé dans notre pays.
On le sait, la désignation favorisera considérablement les instituts de prévoyance, les IP, au détriment des mutuelles et des sociétés d’assurance. Aujourd’hui, sur cinquante et une branches ayant eu recours à la désignation d’un organisme complémentaire, quarante-trois ont désigné un institut de prévoyance. Pourquoi ? Parce que les IP fonctionnent de manière paritaire, suivant le principe de démocratie sociale. En l’occurrence, c’est aux organisations gérant les IP qu’il reviendra de désigner l’opérateur : il y aura un évident conflit d’intérêts, les partenaires sociaux étant à la fois juges et parties.
La question est donc non pas de défendre telle ou telle catégorie d’opérateurs contre telle ou telle autre, mais de légiférer pour assurer la transparence. Le financement des organisations patronales et syndicales doit, lui aussi, être transparent. C’est d’ailleurs le thème du rapport remis voilà quelques mois par le député Nicolas Perruchot.
Ensuite, sur un plan juridique, la désignation, telle qu’organisée par le projet de loi, méconnaît selon nous les règles du droit de la concurrence.
L’avis de l’Autorité de la concurrence le confirme sans aucune ambiguïté : la liberté de choix des employeurs n’est pas totalement exclue par le projet, certes, mais le champ de cette liberté « est limité par la combinaison de deux dispositions ».
En effet, l’article 1er pose la création d’un nouvel article L. 911-7 dans le code de la sécurité sociale « en vertu duquel l’employeur est tenu de mettre en place, par décision unilatérale, une couverture minimale en matière de complémentaire santé, dès lors que, préalablement au 1er janvier 2016, les salariés n’en bénéficient pas par accord de branche ou d’entreprise.
« Par ailleurs, l’article 1er, I. – A, du présent projet de loi impose aux entreprises liées par une convention de branche ou par des accords professionnels d’engager, à compter du 1er juin 2013, une négociation afin de permettre aux salariés qui n’en bénéficient pas d’accéder à une convention collective à adhésion obligatoire en matière de complémentaire santé avant le 1er juin 2016. Ainsi, il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’employeur ne pourra être amené à choisir librement l’organisme d’assurance qu’à défaut de convention ou d’accord de branche préalable. […] Le maintien des clauses de désignation par le présent projet de loi constitue une préoccupation de concurrence. »
Voilà ce que souligne l’avis émis par l’Autorité de la concurrence.
Ces dispositions défavorisent donc le soutien à une diversité de l’offre propre à promouvoir la qualité du service et à exercer une pression à la baisse sur les prix.
En outre, à nos yeux, la désignation est une aberration économique. Elle ne profitera ni aux salariés, dont les cotisations sont susceptibles d’augmenter, ni aux entreprises, qui vont subir un renchérissement de leurs coûts, et donc une perte de compétitivité. On peut craindre la destruction de nombreux emplois sur tout le territoire dans les secteurs des mutuelles et des assurances, en particulier chez les agents généraux, qui risquent d’être les premiers pénalisés.
Par ailleurs, la clause de désignation entraînera des effets pervers pour les non-salariés qui souscriront une complémentaire santé. Les premiers à en pâtir seront, sans nul doute, les retraités et futurs retraités. En effet, priver les mutuelles et les sociétés d’assurance des cotisations de personnes faiblement consommatrices de soins, en ne leur laissant, du fait de leur maillage territorial plus dense que celui des institutions de prévoyance, que la gestion du risque santé d’une population fortement consommatrice, entraînera une augmentation des primes d’assurance des non-salariés, et particulièrement des retraités, ce qui contribuera à précariser davantage la situation de nos aînés.

Alors, pourquoi adopter cette démarche, si ce n’est pour donner satisfaction à certains partenaires sociaux ?
En conclusion, ni les assurés, ni les entreprises, ni les mutuelles et sociétés d’assurance n’ont vocation à être affectés au nom de la sécurisation de l’emploi : on peut malheureusement craindre qu’il ne s’agisse, en réalité, que de sécuriser le financement de certaines institutions…
C’est là pour nous une préoccupation majeure, monsieur le ministre, et les amendements que nous allons présenter tendent à améliorer la lisibilité et la transparence du dispositif. §

Je tiens tout d’abord à remercier vivement M. Daudigny d’avoir bien voulu me céder son tour de parole.
Cela a été dit, le projet de loi que nous examinons transcrit l’accord national interprofessionnel sur l’emploi conclu le 11 janvier 2013 entre un certain nombre de partenaires sociaux. L’article 1er de ce projet de loi est la transposition des articles 1 et 2 de l’ANI.
Celui-ci institue une obligation de mise en œuvre d’un dispositif généralisé de couverture complémentaire santé pour toutes les entreprises de notre pays à compter du 1er janvier 2016. Il précise notamment le calendrier et les modalités selon lesquels les branches, puis les entreprises, seront appelées à négocier et à mettre en place ce dispositif. Permettez-moi de les rappeler, afin d’éclairer la seconde partie de mon intervention.
D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes devront lancer des négociations sur ce point. Elles porteront principalement sur la définition du contenu et du niveau des garanties accordées, sur la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, ainsi que sur les modalités de choix du ou des organismes assurant la couverture complémentaire. À défaut de la conclusion d’un accord de branche avant le 1er juillet 2014, il reviendra aux entreprises de négocier sur ces sujets. En tout état de cause, au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront permettre à leurs salariés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé collective.
Cette mesure constitue, de la part des employeurs, une compensation – et même « la » compensation, selon certains – de l’accord donné par les organisations syndicales signataires à diverses dispositions visant, notamment, à favoriser la flexibilité dans les entreprises.
Je voudrais formuler deux observations à cet égard.
En premier lieu, s’il convient, bien entendu, de se féliciter de la conclusion d’un accord que les partenaires sociaux signataires s’entendent à juger équilibré, permettez-moi néanmoins, monsieur le ministre, de m’interroger sur les charges supplémentaires que cette obligation d’instaurer une complémentaire santé ne manquera pas de faire peser sur les nombreuses entreprises n’en disposant pas à l’heure actuelle.
Était-ce le bon moment pour créer cette contrainte supplémentaire ? Nous le savons, les entreprises ont déjà de gros problèmes de compétitivité-coût. Pour un certain nombre d’entre elles – en particulier les TPE, les artisans, les petits commerces, voire les PME –, les coûts supplémentaires liés à l’instauration d’une complémentaire santé ne feront que dégrader plus encore leur compétitivité.
Certes, je comprends la position des organisations professionnelles de l’artisanat et des PME qui ont accepté de signer cet accord, considérant les difficultés accrues de recrutement, particulièrement de main-d’œuvre qualifiée, que les entreprises qu’elles représentent n’auraient pas manqué de connaître dans le cas contraire. Pour autant, je suis persuadé que, dans le contexte économique actuel, ces coûts supplémentaires ne seront pas sans incidence sur la trésorerie de celles-ci. Je forme le vœu que, in fine, cela ne provoque pas, pour notre pays, des difficultés sociales plus grandes que celles que ce projet de loi vise à combattre.
En second lieu, la coexistence de cet accord national interprofessionnel, a fortiori retranscrit dans une loi, avec le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle pose problème. On me permettra, en tant qu’Alsacien, d’insister sur ce point.
Bien entendu, comme chaque fois, les partenaires sociaux n’ont pas pris en compte, dans leur accord, la spécificité de l’Alsace-Moselle. Il convient donc d’y remédier dans ce projet de loi, pour éviter que les salariés des trois départements de l’Est ne soient désavantagés par rapport à leurs collègues des autres régions, qui bénéficieront d’un pack santé meilleur que ce que prévoit à l’heure actuelle le régime local d’assurance maladie. En effet, alors que, jusqu’ici, le régime local d’assurance maladie offrait de meilleures prestations à ses ressortissants, salariés et ayants droit, que celles du régime général, la mise en œuvre de l’ANI de janvier 2013 aboutira, de fait, à inverser la situation.
Les députés, sollicités sur ce point, ont d’ores et déjà tenu compte de ce problème, en adoptant un amendement qui oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur « l’articulation du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé ». À l’article 1er, ils ont aussi mentionné, pour les négociations à l’échelon des branches, la nécessité de prendre en compte la couverture complémentaire dont sont déjà bénéficiaires les ressortissants de ce régime local.
Pour autant, la question des négociations dans les entreprises elles-mêmes, prévues dans un second temps, n’est pas réglée. Il convient donc de prévoir, pour les négociations à cet échelon, une disposition analogue à celle d’ores et déjà mise en place pour les branches.
En qualité de président de la commission d’harmonisation du droit local d’Alsace-Moselle, j’ai déposé, comme d’autres collègues, un amendement en ce sens, que je souhaite voir adopter le moment venu. §

Un tiers des Français ont déjà renoncé à se soigner. Ce constat terrifiant témoigne de l’impérieuse nécessité de faire de l’accès aux soins une priorité politique, d’où l’importance du présent projet de loi.
Les effets délétères de la crise économique induisent des sacrifices, qui atteignent leur paroxysme quand ils touchent au bien le plus sacré de l’être humain : la santé. Je n’insisterai jamais assez, d’ailleurs, sur le fait que la santé n’est pas une charge, même si elle a un coût ; c’est un investissement, et même le meilleur des investissements, puisqu’il porte sur l’être humain, qui est aussi un producteur de richesses.
À cet égard, il n’est pas anodin de relever le retour de la malaria en Grèce ou la propagation d’épidémies de tuberculose dans plusieurs de nos territoires.
Sans surprise, le renoncement aux soins s’explique majoritairement par des raisons d’ordre pécuniaire. La question du remboursement des soins est donc fondamentale. Depuis plusieurs décennies, les complémentaires santé se sont développées, afin de compléter au mieux les prestations versées par la sécurité sociale.
Devant cette évolution, loin d’être dénuée de sens, j’appelle de mes vœux la poursuite du débat, notamment à l’échelle des départements, sur la place des organismes complémentaires, et en particulier des mutuelles, au sein de notre système de santé. Cela me paraît non seulement d’actualité, mais surtout essentiel, dans la perspective de mettre en place une régulation plus efficace de notre système de protection sociale.
Ainsi, l’article 1er, en imposant l’instauration d’une complémentaire santé collective pour tous les salariés et en améliorant la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi, constitue une avancée majeure dans l’amélioration de l’accès aux soins pour tous.
Pour autant, aussi primordiale soit-elle, cette avancée ne demeure, nous en sommes tous convaincus, qu’une étape en vue de la généralisation de la complémentaire santé à tous les Français. En l’occurrence, je songe aux étudiants, dont près d’un quart n’ont pas de mutuelle, et aux retraités, dont il faudra également se préoccuper. D’ici à la fin du quinquennat, il faudra veiller à instaurer des dispositifs qui permettent à tous de bénéficier d’une couverture santé de qualité.
Par ailleurs, s’agissant des appels d’offres pour la passation de marchés avec les organismes assureurs, les amendements adoptés par l’Assemblée nationale ont été bienvenus ; l’impartialité et l’égalité de traitement sont les conditions sine qua non de l’instauration d’une procédure de mise en concurrence juste et réglementaire.
Cependant, je souhaiterais appeler l’attention de M. le ministre sur deux points.
Premièrement, dans un avis en date du 29 mars, l’Autorité de la concurrence a préconisé que les clauses de désignation ou de recommandation portent « nécessairement sur plusieurs organismes ». Ainsi, sans remettre en cause la clause de désignation, dont l’énoncé, il faut le reconnaître, est un peu sibyllin dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, j’aimerais que le Gouvernement nous fasse connaître son avis sur cette éventualité.
Deuxièmement, en vue de renforcer l’égalité de traitement entre les compagnies d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles, il paraîtrait opportun de faire évoluer la législation ayant trait au régime de coassurance, afin de sécuriser juridiquement cette pratique, aujourd’hui interdite aux mutuelles. Surtout, il faudrait que nous évitions que ne s’instaure la pratique, qui commence pourtant à se faire jour, du bonus-malus dans le domaine de la santé. Selon ce système, ceux qui ont la chance de ne pas être malades verraient leurs cotisations de complémentaire santé diminuer, tandis que ceux qui ont la malchance de l’être les verraient augmenter ! Ce serait là une remise en cause fondamentale du principe de solidarité entre les générations. Il faudra y faire très attention, en particulier au moment de l’attribution des contrats.
Par conséquent, à titre personnel, je me réjouis de la teneur de cet article, qui pose les jalons de la mise en place d’une couverture santé de qualité pour tous.

Toutefois, à l’heure où les sacrifices en matière de santé s’alourdissent, il est important de poursuivre nos efforts. Souvenons-nous du programme du Conseil national de la Résistance, qui visait notamment à « assurer à tous les citoyens des moyens d’existence », cette existence aujourd’hui dramatiquement abandonnée sur les rives du désespoir par un nombre toujours croissant de nos concitoyens. Il nous faut tous lutter énergiquement, ensemble, pour faire face à cette situation.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.