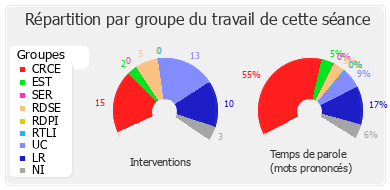Séance en hémicycle du 22 janvier 2014 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à une commission spéciale
- Moratoire sur les fermetures de service et d'établissements de santé (voir le dossier)
- Nomination des membres d'une commission spéciale
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Communication du conseil constitutionnel
- Nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes (voir le dossier)
- Exercice par les élus locaux de leur mandat (voir le dossier)
- Discussion en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 10 du règlement, la liste des candidats présentés par les groupes a été affichée.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe CRC, la discussion de la proposition de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement, présentée par Mme Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues (proposition n° 708 [2012-2013], résultat des travaux de la commission n° 278, rapport n° 277).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Dominique Watrin, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes tous légitimement attachés aux établissements publics de santé. Je ne connais personne parmi nous, qui se soit réjoui un jour qu’un hôpital, une maternité de proximité ou encore un service phare d’un établissement hospitalier ferme ou fusionne, et cela bien évidemment au-delà de nos divergences politiques.
Je pense par exemple à notre collègue Catherine Procaccia qui, avec Laurence Cohen, Christian Favier et la députée Europe Écologie les Verts, Laurence Abeille, s’est mobilisée contre la fermeture annoncée de l’hôpital de santé des armées de Bégin. Je pense encore à l’adoption d’un vœu par le conseil municipal de Paris et son maire, Bertrand Delanoë, s’opposant à la fermeture des urgences de l’Hôtel-Dieu, que j’ai personnellement visitées. Je pense aussi au député socialiste du Cantal, Alain Calmette, qui s’est mobilisé contre le projet de fermeture du service de réanimation du centre médico-chirurgical de Tronquières à Aurillac, ou au député socialiste de l’Orne, Joaquim Pueyo, qui a obtenu ce que nous demandons ici aujourd’hui, à savoir un moratoire sur le fonctionnement du service de radiologie et d’échographie du site hospitalier de Domfront.
La liste pourrait être encore plus longue, si je prenais le temps de mentionner dans le détail celles et ceux, députés, sénatrices et sénateurs, qui, à l’instar de nos collègues Jean-Vincent Placé ou Marie-Noëlle Lienemann, ont proposé l’instauration d’un moratoire sur les fermetures d’établissements. Je pense encore, sans chercher à dresser une liste exhaustive, à notre collègue Aline Archimbaud, qui s’est mobilisée avec nous activement contre la fermeture des urgences de l’Hôtel-Dieu ou contre la fermeture de la maternité des Lilas. Or comment croire que toutes ces luttes locales, portées par les agents, les salariés, les collectifs d’usagers n’auraient pas de lien entre elles ?
Nous avons tous vécu, à un moment ou à un autre, les difficultés, voire l’impossibilité de se faire entendre par ceux qui ont les pouvoirs de décision. Nous avons aujourd’hui la possibilité de nous réunir et de montrer, au-delà de nos divergences politiques, que nos réactions et nos oppositions aux projets de restructuration problématiques dans nos départements ne sont pas des actes égoïstes ou électoralistes, mais qu’elles sont animées par des exigences légitimes en matière d’accès à des soins de qualité, à des tarifs opposables.
En votant cette proposition de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement, vous vous donnerez un outil pour imposer un véritable débat sur les propositions alternatives à tout affaiblissement du service public hospitalier.
Vous-même, madame la ministre, lorsque vous étiez secrétaire nationale du parti socialiste, demandiez, dans un communiqué de presse en date du vendredi 1er avril 2011, « un moratoire sur toutes les décisions de fermeture de services hospitaliers », précisant, ce que nous partageons, « l’hôpital ne peut pas être géré comme une entreprise commerciale ». Malheureusement, depuis, les choses n’ont pas réellement changé, les fermetures ou les regroupements de sites et de services ont continué, ce qui explique que nous soyons encore nombreuses et nombreux, localement, à nous mobiliser ; et pour cause, nous savons toutes et tous les conséquences que ce genre d’événements peuvent avoir : dévitalisation de nos territoires, éloignement des soins, accroissement des inégalités sociales et territoriales en santé et même parfois, émergence de risques sanitaires et médicaux.
Je note d’ailleurs que c’est notamment sur cette base qu’a été votée au Sénat l’expérimentation des maisons de naissance. Les auteurs de cette proposition de loi mettent justement en avant le choix de ne pas accoucher dans des structures de tailles inhumaines et surmédicalisées, argument que nous partageons, même si nous regrettons que le Gouvernement et l’opposition aient fait le choix, au final, de financer sur des fonds publics, devenus trop rares en période d’austérité budgétaire, des structures libérales, pratiquant des dépassements d’honoraires.
Ce n’est pas la conception que nous nous faisons, au sein du groupe CRC, de l’égalité d’accès aux soins. La sélection par l’argent doit être combattue par tous les moyens, et les financements publics doivent être réservés aux seules structures qui appliquent les tarifs opposables et respectent le tiers payant.
Aussi, mes chers collègues, l’adoption de cette proposition de loi nous paraît être non pas, comme nous avons pu l’entendre, une réponse dogmatique, puisque l’exigence d’un gel des restructurations, je viens de le démontrer, a été portée par toutes les tendances politiques, mais en réalité une réponse concrète à une situation d’urgence bien souvent. C’est une réponse immédiate mais temporaire, puisque le moratoire peut prendre fin si l’Agence régionale de santé fait la démonstration explicite que la fermeture du service ou de l’établissement public de santé est compensée par la création d’une offre au moins équivalente, c’est-à-dire qui réponde aux mêmes besoins de soins et respecte le tiers payant et les tarifs opposables.
Ne nous y trompons pas : chaque fois qu’un établissement public, une maternité ou un service hospitalier ferme ou disparaît d’un territoire, c’est systématiquement au profit direct ou indirect des cliniques commerciales ou des professionnels libéraux, qui, eux, pratiquent des dépassements d’honoraires et une discrimination par l’argent.
Je ne reviendrai pas sur la démonstration qu’a faite en commission Mme la rapporteur sur l’absence d’études préliminaires aux mécanismes de fusions pratiqués depuis plusieurs années. Toutefois, comment ne pas rappeler que l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, dans un rapport récent en date de mars 2012, a pointé les risques occasionnés par ces fusions – ce n’est pas nous qui l’inventons – : « L’expérience enseigne, en outre, que les processus de fusion sont en eux-mêmes sources de surcoûts ou de dysfonctionnements ».
Pourtant, en dépit de ce risque et d’autres conséquences importantes pour nos concitoyens, le rythme de ces fusions d’établissements ou de services ne s’est pas ralenti. Toujours selon le rapport de l’IGAS, « sur le seul périmètre des établissements publics de santé, 90 fusions depuis 1995, principalement entre deux établissements de taille petite ou moyenne : en quinze ans, ce sont ainsi 9 % des établissements publics de santé qui ont fusionné entre eux ».
Si l’IGAS considère que « ces opérations ne semblent pas être le fruit d’une politique nationale », nous y voyons, pour notre part, la conséquence directe des politiques de rigueur budgétaire menées depuis plusieurs décennies.
L’instauration d’une tarification à l’activité, destinée à se substituer intégralement aux dotations globales a entraîné une concentration de l’offre de soins dans certains territoires. Selon un rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, sur les quatre pathologies étudiées – accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, chirurgie du cancer du côlon, chirurgie de la hanche –, on note une augmentation de réadmissions à trente jours. La question que l’on doit se poser est la suivante : ne peut-on pas l’imputer au moins pour une part à la T2A, qui incite au raccourcissement des séjours ou à la convergence tarifaire, qui, sous prétexte de réduire les dépenses hospitalières, a eu pour effet d’imposer aux établissements publics de santé les tarifs pratiqués par les cliniques commerciales ? Alors même que, tout le monde le sait, les tarifs des établissements publics de santé et des cliniques lucratives ne sont pas comparables, dans la mesure où les cliniques externalisent certains actes et n’intègrent pas les honoraires des médecins.
Certes, vous avez, madame la ministre, mis officiellement un terme à cette convergence, ce dont je vous remercie, et avez rompu avec la pratique scandaleuse du gel des dotations destinées au financement des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, les MIGAC. Cependant, force est de constater que, dans le même temps, vous avez ordonné une campagne tarifaire de fixation des prix particulièrement austère, peut-être la plus dure menée depuis des années, pesant lourdement sur les budgets des établissements publics de santé.
C’est une réalité, la baisse des tarifs a été plus importante pour les hôpitaux que pour les cliniques commerciales, au point que nous sommes en droit de nous demander si la convergence tarifaire ne continue pas sous une autre forme. Comment ne pas voir aussi que l’insuffisance de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, et les baisses tarifaires poussent à l’accroissement des actes inutiles et redondants justement dénoncés dans un certain nombre de rapports récents ? Là encore, l’austérité budgétaire peut-être contre-productive.
Mes chers collègues, j’ai conscience que cette proposition de loi ne peut à elle seule suffire à stopper l’hémorragie et la « casse » du service public hospitalier auxquelles nous assistons depuis des années.
Bien entendu, il faudrait aller plus loin. Certaines personnes auditionnées par Mme la rapporteur, tout en soutenant le présent texte – je songe notamment aux représentants d’organisations syndicales ou du collectif « Notre santé en danger » – ont regretté qu’il ne soit pas plus ambitieux, qu’il ne mette pas un terme immédiat aux fermetures ou qu’il n’abroge pas la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la loi HPST. D’autres acteurs, comme l’Association des médecins urgentistes de France, l’AMUF, tout en l’accueillant avec satisfaction, auraient souhaité qu’outre l’instauration d’un moratoire il limite quantitativement le nombre de suppression de lits au sein de chaque service.
Je souscris à ces critiques, bien qu’étant, avec ma collègue Laurence Cohen, à l’origine de cette proposition de loi. Je rappelle cependant que l’examen des propositions de loi dans le cadre des niches parlementaires est un exercice particulier, présentant de fortes contraintes : il s’agit de rédiger des textes courts, susceptibles d’être débattus et adoptés en moins d’une demi-journée. En outre – tous nos concitoyens ne le savent pas –, les parlementaires sont soumis au couperet de l’article 40 de la Constitution, qui interdit aux députés et sénateurs d’engager des dépenses publiques supplémentaires.
Compte tenu de ces deux contraintes, cette proposition de loi nous semble – avec d’autres, élus locaux, associations, collectifs d’usagers, organisations syndicales ou ordres professionnels – une mesure d’urgence et une disposition utile.
Ce texte est utile pour les luttes locales auxquelles j’ai fait référence. Ceux qui les mènent trouveront ici un outil pour se faire entendre, pour aboutir à des résultats. Il est utile, bien entendu, pour l’égalité sociale et territoriale en matière de santé. Mais il ne nous dispense pas de mener, collectivement, une réflexion plus large. Du reste, ce débat dépassera sans doute le strict cadre du présent texte et des mesures qu’il contient.
Ayons ce débat ! Au groupe CRC, nous sommes par exemple convaincus qu’il faudrait interdire au plus vite l’exercice libéral au sein des établissements publics de santé. Cette faculté offerte aux médecins d’organiser une sorte de « coupe-file » n’est pas tolérable, puisqu’elle permet aux patients qui en ont les moyens de bénéficier des structures et des interventions des établissements publics de santé sans délai, tandis que d’autres, plus modestes, sont contraints d’attendre !
Par ailleurs, nous sommes convaincus qu’il faut rénover le financement actuel des établissements publics de santé, mettre un frein immédiat au gel des tarifs et ne plus chercher à les aligner sur ceux des cliniques commerciales qui, je l’ai déjà rappelé, sélectionnent leurs clients et leurs actes.
Ce raisonnement nous conduit à exiger que les fonds publics ne soient mobilisés que pour les structures accueillant les patients sans dépassement d’honoraires et appliquant le tiers payant.
Je le dis très clairement : les dotations qui servent à financer les services publics devraient être calculées et pondérées en fonction des réalités sanitaires et sociales des départements. La tarification à l’activité doit, à tout le moins, être associée à des financements spécifiques, via une forme de dotation d’établissement tenant compte des inégalités de santé.
Sénateur du Pas-de-Calais, département auquel appartient le territoire de santé de Lens-Hénin, classé 348e sur 348 – dernier de la classe pour notre pays ! –, où les patients arrivent « cassés » à l’hôpital parce qu’ils ont hélas tardé à se soigner, je suis particulièrement sensible à cette exigence de péréquation positive hospitalière.
À cet égard, je dirai un mot du futur pôle hospitalier de la Gohelle, dont Mme la ministre visitera demain un service.
Les élus communistes, qui ont historiquement soutenu la création d’un centre hospitalier universitaire, CHU, défendent des exigences beaucoup plus fortes que celles qui sont inscrites dans le projet en matière de recherche universitaire.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales, acquiesce.

Affirmer cette ambition avec plus de force permettrait de créer des conditions nouvelles pour fixer des spécialistes sur ce territoire qui en manque cruellement – il accuse un déficit de 30 % en la matière par rapport à la moyenne nationale – alors que c’est là que les besoins sont les plus criants. De surcroît, il serait possible de construire les liens indispensables avec les centres de santé, qui sont au nombre de 120 dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui sont aujourd’hui en déclin faute d’investissements et faute de spécialistes.
C’est ainsi, en renforçant l’accès aux soins de premier recours – parce que ces centres de santé sont ouverts à tous, sans dépassement d’honoraires ni avances de frais – et en développant le lien entre l’hôpital public et les territoires que l’on s’attaquera aux retards de soins, identifiés comme la cause principale des retards de santé par le projet régional de santé du Nord–Pas-de-Calais. Ce faisant, on pourrait même dégager des économies, en limitant le recours aux urgences.
Encore faudrait-il, pour réussir, en avoir la volonté politique et se donner les moyens financiers nécessaires !
S’ajoute une autre problématique : il faut permettre aux établissements de santé qui veulent investir pour se développer ou se rénover de procéder de manière sécurisée. C’est pourquoi nous proposons que les établissements publics de santé soient autorisés à recourir à des emprunts directs auprès de la Caisse des dépôts et consignations plutôt qu’à des crédits exorbitants et risqués sur les marchés financiers – de tels cas se sont produits !
Au-delà, il faudrait remettre à plat la fiscalité pesant sur les établissements publics de santé. Dans la mesure où les cliniques commerciales sont autorisées à récupérer une partie de la TVA dont elles s’acquittent, les hôpitaux devraient pouvoir, pour tous leurs achats, bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5, 5 %.
En outre – c’est sans doute un sujet de désaccord entre nous, madame la ministre –, nous souhaitons que les établissements publics de santé soient dispensés de la taxe sur les salaires, qui constitue tout de même une charge supplémentaire représentant 10 % à 12 % des dépenses de personnel, soit environ 4 % de l’ensemble des ressources hospitalières. Cette imposition est d’autant plus inacceptable que les deux autres fonctions publiques en sont exonérées. Il s’agirait, au surplus, d’une mesure de simplification.
Telles sont les réformes courageuses que nous appelons de nos vœux, et que nous défendrons au titre du futur projet de loi de santé publique.
Je ne reviendrai pas sur la démonstration que j’ai effectuée en préambule. Je le répète simplement, il serait pour le moins paradoxal de s’opposer à la fermeture d’un établissement ou d’un service de santé dans son département sans pour autant voter cette proposition de loi.
Chacun prendra ses responsabilités en son âme et conscience. Je sais que de nombreux collectifs d’usagers sont attentifs à nos travaux. Je songe notamment à ceux des Bluets, des Lilas, de Saint-Mandé, de Vire, de Moutiers, de Valréas, de Dourdan, de l’Hôtel-Dieu, de Sarlat, de Fontainebleau, de Melun, de Concarneau, de Lure ou de Lens, et cette liste n’est pas exhaustive !
Mes chers collègues, malgré le vote survenu en commission des affaires sociales, je n’ose croire qu’il n’y aurait pas de majorité aujourd’hui, dans cet hémicycle, pour défendre le service public hospitalier et garantir l’égalité dans l’accès aux soins. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, cette proposition de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de services et d’établissements de santé ou leur regroupement a été déposée par les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Pourquoi avoir rédigé ce texte ?
Nous sommes partis d’un constat alarmant : depuis les années quatre-vingt-dix, le nombre de lits d’hospitalisation et de services hospitaliers a été considérablement réduit via de multiples décisions, mises en œuvre sans évaluation globale et, le plus souvent, sans véritable concertation.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 1995 et 2005, près de 1 200 recompositions hospitalières se sont succédé en France. Entre 1992 et 2003, 83 000 lits d’hospitalisation complète ont été supprimés, …

… représentant 15 % des capacités installées. Quelque 380 établissements – soit 11 % des établissements existant en 1992 – ont été supprimés ou regroupés. Dans le secteur public, le nombre de lits a chuté de manière beaucoup plus substantielle que dans le secteur privé, en pourcentage comme en volume.
Deux raisons sont fréquemment invoquées pour fermer les services de proximité : d’une part, des motivations financières et, d’autre part, l’idée selon laquelle la sécurité ne serait pas, ou serait insuffisamment assurée dans des « petites » structures.
Or ces deux arguments ne sont guère étayés scientifiquement. Je vais m’en expliquer, en me fondant principalement sur un rapport que l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, a publié en 2012.
Ce document, que l’on ne peut guère qualifier de partisan, dresse un bilan pour le moins mitigé des fusions et regroupements hospitaliers.
Tout d’abord – ce constat est clairement établi –, au-delà d’un certain seuil, la grande taille présente, pour un hôpital, plus d’inconvénients que d’avantages. Comme Dominique Watrin vient de l’indiquer, l’expérience enseigne que les processus de fusion sont, en eux-mêmes, source de surcoûts ou de dysfonctionnements. De fait, ces fusions peuvent constituer de réels gouffres financiers, comme l’illustre clairement le cas du nouveau centre hospitalier sud-francilien.
Ensuite, on n’a jamais conduit la moindre évaluation a posteriori pour déterminer, quelques années après les restructurations, quels en ont été le coût et les bénéfices.
La seconde motivation souvent avancée soulève un enjeu extrêmement important, comme nos débats en commission l’ont montré. Il s’agit de la sécurité et de la qualité des soins.
Des auditions et des débats en commission des affaires sociales est ressortie cette idée : un médecin dirige ses patients là où lui-même irait se faire soigner. Heureusement ! Mais on observe que ce critère dépend surtout du praticien, et non de la taille de l’établissement.
Quand on parle de sécurité des patients – donnée avec laquelle nul n’entend transiger –, il faut faire preuve de la même exigence. Aussi, quelle n’a pas été ma surprise d’entendre, en commission, un de nos collègues affirmer qu’il ne voyait aucun problème à ce qu’une femme accouche dans un camion de pompiers, tout en condamnant avec détermination une maternité au motif qu’elle ne dispose pas de service de réanimation !
Mes chers collègues, je vous rappelle qu’en vertu des décrets « Périnatalité » de 1998, seules les maternités de niveau III sont tenues de disposer d’une unité de réanimation néonatale. Est-ce à dire que toutes les maternités devraient être de niveau III ? Sauf erreur de ma part, nul ne le propose ni ne le souhaite.
À cet égard, j’insisterai sur l’exemple tout à fait emblématique des maternités. Leur nombre a chuté de 60 % en trente ans, baissant de 1 369 en 1975 à 554 en 2008, alors même que le nombre de naissances augmentait de nouveau. Parallèlement, le nombre de lits d’obstétrique a été divisé par deux. Entre 1995 et 2005, 126 maternités ont été fermées. Et je ne parle même pas des conséquences que cette évolution a entraînées sur les centres d’interruption volontaire de grossesse, ou centres IVG. D’après un rapport récent – datant de novembre 2013 – établi par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 130 centres IVG ont été fermés en dix ans.
Dans les faits, une déformation s’est fait jour dans la typologie des maternités : les établissements de niveau II ou III, c’est-à-dire les structures les plus techniques, ont vu leur nombre légèrement progresser, tandis que les maternités de niveau I, censées accueillir la très grande majorité des femmes, celles dont la grossesse est physiologique, sont, elles, passées de 415 à 263 ! Aujourd’hui, les maternités de niveau I ne rassemblent plus, au total, que 34 % des lits disponibles.
Cette évolution est tout bonnement irrationnelle, sur les plans tant financier qu’humain, étant donné que les coûts sont plus élevés dans les maternités de niveaux II et III et que les équipements dont ces établissements sont dotés ne présentent pas une absolue nécessité pour la grande majorité des femmes qui y accouchent.
Bref, la fermeture des « petites » maternités ne peut même pas se justifier par un gain financier éventuel. Surtout, la qualité de la prise en charge a souffert de cette évolution, car, je le répète, la plupart des patientes n’ont pas besoin d’une telle technicisation de l’accouchement. Au lieu d’expérimenter des maisons de naissance au statut juridique flou, pratiquant les dépassements d’honoraires tout en bénéficiant de subventions publiques, il est impératif, aux yeux des sénateurs de mon groupe, de préserver et d’encourager les maternités de niveau I.
Au surplus, les difficultés auxquelles les organismes de tutelle acculent aujourd’hui un certain nombre de maternités – dont celle des Lilas ou encore celle des Bluets – sont l’expression de cette évolution foncièrement négative, puisqu’elle pénalise les organismes qui entendent développer des prises en charge plus humaines.
Concernant l’argument d’une sécurité prétendument meilleure dans les grands établissements, le rapport de l’IGAS est particulièrement éclairant. En effet, il indique que la fixation de seuils minimaux d’activité se révèle, dans la pratique, très difficile. Une étude mentionnée dans le rapport l’illustre clairement : « L’idée largement répandue selon laquelle plus on soigne de malades et meilleurs sont les résultats se heurte à plusieurs démentis ».
Nombre de questions se posent : le volume minimal d’activité requis s’applique-t-il au service dans son ensemble ou aux professionnels eux-mêmes ? Le volume d’activité doit-il être comptabilisé intervention par intervention, par domaine pathologique ou par discipline ? L’expérience antérieure des professionnels est-elle prise en compte, etc. ?
En définitive, les motivations financières et de sécurité avancées pour justifier les fermetures ne résistent pas à une analyse précise de la réalité, d’autant qu’il est prouvé – concernant la sécurité – que l’éloignement dans l’accès aux soins est préjudiciable aux patients, qui renoncent à des soins ou y accèdent trop difficilement.
Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, évoque un seuil de quarante-cinq minutes, dont le dépassement emporte de graves conséquences. L’impact des restructurations sur l’accès aux soins est très important, et des disparités considérables entre les territoires apparaissent en ce qui concerne les temps d’accès à l’hôpital.
Ainsi, dans trois départements, les Alpes-de-Haute-Provence, le Gers et la Lozère, le temps de trajet médian pour une hospitalisation dépasse quarante minutes, ce qui signifie que plus de la moitié des personnes mettent plus longtemps encore à gagner l’établissement ! Encore ces statistiques sous-estiment-elles la durée réelle, en affectant un temps de trajet nul pour les personnes hospitalisées dans leur commune. Dans tous les départements, la question essentielle est celle de la proximité.
Nous devons également prendre en considération les particularités géographiques de notre pays. La France est, notamment, plus vaste que ses voisins, et comporte des zones très denses comme des zones qui le sont très peu ou qui sont isolées. En dehors de la métropole, je pense à la situation de Marie-Galante, en Guadeloupe, où la maternité a été fermée peu avant qu’un cyclone n’empêche tout transfert entre l’île et Pointe-à-Pitre durant plusieurs jours. J’imagine que l’on a alors dit aux femmes qu’elles pouvaient attendre… De même, notre pays n’est pas uniquement constitué de plaines. Pensons aux régions montagneuses, dans lesquelles il est nécessaire de franchir un ou plusieurs cols pour se rendre dans un établissement de santé.
Il nous faut donc réfléchir en termes de densité et de dispersion de la population et, surtout, ne pas nous contenter d’une approche « macro », globale. Nous devons penser au plus proche du territoire et des besoins de santé.
On peut aussi relever que les restructurations hospitalières prennent fréquemment place dans des territoires que l’on peut qualifier de « déserts médicaux ». Un lien évident existant entre la présence d’un hôpital et la démographie médicale, les restructurations constituent ainsi une forme de double peine. Fermer des lits, des services ou des hôpitaux présente donc plus d’inconvénients que d’avantages, au regard même des objectifs affichés, qu’ils soient comptables ou liés à la sécurité des patients.
J’illustrerai ce point par l’exemple des urgences. La diminution du nombre de lits a un impact considérable, que l’on mesure pleinement aujourd’hui, sur le fonctionnement de ces services : un lien existe entre la diminution du nombre de lits et l’augmentation des passages aux urgences, qui ont crû de 75 % en quinze ans, sans rapport avec l’augmentation de la population.
La diminution du nombre de lits perturbe, en elle-même, le fonctionnement des services des urgences, qui doivent batailler pour placer leurs malades dans d’autres services et, finalement, en viennent à devoir les héberger plus longtemps qu’ils ne le devraient. Se dessine alors un cercle vicieux : la baisse du nombre de lits d’aval provoque plus de passages aux urgences et, conjointement, contribue à les engorger.
La situation de l’Hôtel-Dieu est emblématique, en ce sens, et cela permet de comprendre la bataille menée depuis de longs mois par de nombreux syndicalistes, médecins, usagers et élus afin de maintenir un service d’urgence et un hôpital de proximité en plein cœur de Paris.
Madame la ministre, il faut absolument limiter à un certain seuil – on a évoqué 5 %, ce qui me semble raisonnable – le nombre de lits fermés dans un établissement, afin de prévenir les situations d’engorgement que nous connaissons.
Si, en outre, la diminution du nombre de lits peut être justifiée pour certaines spécialités, en raison, par exemple, de l’évolution des techniques médicales, elle ne l’est pas pour les services plus polyvalents, en médecine ou en gériatrie.
Le vieillissement de la population et le développement des polypathologies plaident, au contraire, pour une augmentation de la prise en charge généraliste, ou polyvalente, au sein de l’hôpital. Les prises en charge très spécialisées ne sont pas toujours nécessaires mais, partout, des lits de médecine interne sont indispensables.
Outre ce mouvement de concentration vers de grands établissements éloignés, l’hôpital a subi depuis 2002 une série de décisions, que j’ai largement évoquées en commission, et que je résumerai aujourd’hui.
Une tarification à l’activité a été instaurée de manière hâtive en 2004-2005 sur l’ensemble du champ médecine, chirurgie et obstétrique, alors même que cette modalité de financement est fondamentalement contraire à l’esprit du service public, et présente de nombreux inconvénients.
On nous dit depuis quelques mois que la chirurgie ambulatoire est très peu développée en France. Cependant, les chiffres de l’OCDE démontrent le contraire : la durée moyenne de séjour à l’hôpital est nettement plus faible en France que dans plusieurs autres pays européens, avec 5, 7 jours contre 9, 8 jours en Allemagne, par exemple.
Au-delà de la seule T2A, et de la convergence tarifaire qui l’a accompagnée, une véritable idéologie de la concurrence s’est progressivement imposée, illustrée par l’utilisation de l’expression « hôpital-entreprise » par certains et parachevée par la transformation symptomatique du conseil d’administration en conseil de surveillance, un terme relevant du code de commerce. Surtout, certains estiment contre toute logique qu’il n’existe pas de différence entre les établissements publics et les établissements privés à but lucratif.
Le groupe auquel j’appartiens affirme aujourd’hui, comme hier, que la santé n’est pas une marchandise et que l’hôpital n’est pas une entreprise. Malheureusement, on entend parler maintenant des « parts de marché » pour tel ou tel établissement de santé.
Madame la ministre, alors que vous sembliez partager ce constat lorsque vous étiez avec nous dans l’opposition, ainsi que pendant la campagne électorale de 2012, je ne peux que regretter le faible nombre de mesures prises par ce gouvernement en faveur du secteur hospitalier public.
La convergence tarifaire, si décriée et officiellement abrogée, s’est poursuivie en 2013. Le concept de service public hospitalier, supprimé par la loi HPST, n’a toujours pas été rétabli. Il est temps de le faire, car cela conférerait un sens à une politique de santé publique ambitieuse.
L’amélioration des conditions de travail et du dialogue social à l’hôpital reste également dans les limbes, malgré les multiples rapports que vous avez commandés dans la perspective d’un « pacte de confiance ».
J’évoquerai aussi le scandale de l’exercice dit libéral à l’hôpital. Des praticiens hospitaliers, certes peu nombreux, continuent à engranger des rémunérations complémentaires, parfois extravagantes, en utilisant le nom et les ressources de leur hôpital, et je ne parle pas des différences de traitement entre les patients en termes de délais d’attente, dont nous avons tous entendu parler. Il faut mettre fin à ces pratiques.
Vous me direz que la future loi de santé publique réglera toutes ces questions. Nous l’attendons, toutes et tous, avec impatience, cela a été longuement dit en commission, et je m’associe à l’ensemble de mes collègues qui appellent ce débat de leurs vœux de manière urgente.
Permettez-moi cependant, toute jeune parlementaire que je sois, de rester prudente en entendant dire qu’une loi réglera tous les problèmes !
Face au mouvement de concentration, synonyme d’éloignement des soins, et aux transformations en cours à l’hôpital, notre proposition de loi vise à ménager le temps de la réflexion et à prévenir les décisions irrémédiables, en s’appuyant sur la démocratie sanitaire.
Ce que nous proposons, c’est un moratoire. Je me permets de vous rappeler la définition de ce terme, afin que l’on ne dénature pas notre proposition de loi : « décision d’accorder un délai ou une suspension volontaire d’une action ».
Nous proposons donc de ne permettre la fermeture d’un hôpital, d’un service ou d’un regroupement qu’après un avis favorable de son conseil de surveillance et de la conférence de territoire, sauf si une offre de santé au moins équivalente, en tiers payant, et proposant des tarifs opposables, est garantie à la population concernée. La commission médicale d’établissement et le comité technique devront également être consultés.
Nous entendons ainsi mettre en avant la concertation pour pallier le manque criant de démocratie sanitaire que nous constatons aujourd’hui. Les décisions contradictoires prises successivement par l’Agence régionale de santé concernant le dossier de la reconstruction de la maternité des Lilas sont emblématiques de cette absence de concertation. Je pourrais, hélas ! en multiplier les exemples.
Il ne s’agit donc pas de figer la situation et d’empêcher toute évolution, il s’agit bien de faire émerger les décisions du territoire et des acteurs locaux. Si un projet est pertinent et répond aux besoins de santé du territoire, il n’y a aucune raison pour qu’une décision de regroupement ou de fusion soit rejetée. Il existe des exemples réussis de fusion ; cette proposition de loi ne les aurait aucunement empêchés.
Naturellement, cette mesure ne s’appliquerait pas en cas de risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels ou des usagers, formulation usuellement utilisée dans le code de la santé publique pour définir les situations dans lesquelles la tutelle peut décider de mesures de sauvegarde. Prenons garde, toutefois, que cela ne se retourne pas contre l’intérêt collectif : en privant sciemment les services de personnel ou de moyens, on empêche parfois leur bon fonctionnement, de telle sorte que la fermeture s’impose comme « la » solution, au nom de la sécurité !
Il faut absolument stopper l’hémorragie et se donner le temps de la réflexion pour revenir à un modèle hospitalier plus conforme à notre culture, à notre histoire et aux besoins des patients et de leurs familles. Tel est l’objectif de cette proposition de loi, dont l’objet immédiat est nécessairement affecté par les contraintes législatives et le temps limité qui nous est imparti dans le cadre des niches réservées aux groupes.
Il n’y a pas, d’un côté, les « modernes », qui voudraient faire évoluer l’hôpital en lien avec les progrès technologiques et, de l’autre, les « ringards », accrochés à un fonctionnement dépassé !
Il ne s’agit pas, pour nous, de prôner le statu quo. L’hôpital doit s’adapter aux nouvelles exigences et on ne saurait remonter le temps. Cependant, il ne faut plus poursuivre sur le chemin que tracent depuis une dizaine d’années de multiples décisions éparses prises sans conscience des graves dérives qu’elles étaient susceptibles d’entraîner. Nous devons nous accorder le temps d’élaborer ensemble, avec tous les acteurs de la santé, un nouveau modèle et, à cette fin, cesser de prendre des décisions irrémédiables affectant la vie des patients et l’accès aux soins.
Cette proposition de loi pourrait être qualifiée de principe de précaution ou de mesure de sauvegarde.
Madame la ministre, mes chers collègues, une majorité de la commission a rejeté le texte de cette proposition de loi, avec des arguments divers. Cependant, comme l’a dit mon collègue Dominique Watrin, chacune et chacun d’entre nous, ici, s’est un jour ou l’autre mobilisé pour défendre son hôpital ou tel ou tel de ses services.
Pour illustrer mon propos, je souhaite rappeler que le conseil régional d’Île-de-France a adopté en novembre 2012 un amendement tendant à demander un moratoire sur les restructurations, dans l’attente de la nouvelle loi de santé publique. Son président, Jean-Paul Huchon, et sa vice-présidente en charge de la santé, Laure Lechatellier, se sont personnellement exprimés en faveur de ce moratoire.
Cette proposition de loi est attendue : il est indispensable d’évaluer les politiques publiques qui ont été menées et qui ont conduit le système public hospitalier dans la situation que nous connaissons aujourd’hui.
Contrairement aux propos que j’ai entendus en commission des affaires sociales, et dont vous pouvez prendre connaissance dans le rapport publié, la majorité des personnes auditionnées soutiennent cette proposition : la CGT Santé, le collectif de soutien de la maternité des Lilas, l’Association des médecins urgentistes de France – AMUF –, le professeur Emmanuel Vigneron, le Syndicat de la médecine générale
M. Jacky Le Menn fait un signe de dénégation.

… ainsi que la coordination nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité, dont les membres souhaitaient même que notre texte aille plus loin en interdisant les fermetures, les regroupements, ou les restructurations. D’autres comme la Fédération hospitalière de France – FHF – souhaitent que soit décidé un moratoire différent, s’appliquant aux fermetures de lits en médecine dans les trois cents centres hospitaliers locaux.
Je tiens à votre disposition les différents témoignages répondant à nos débats en commission, ainsi que les nombreux soutiens qui me sont parvenus depuis, en particulier celui du syndicat SUD de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, celui du président de l’Association nationale des centres hospitaliers locaux, celui de médecins, d’urgentistes, d’infirmiers, d’usagers, ou bien encore d’élus. Cette proposition de loi est bien attendue : tous affirment en effet l’urgence de ce moratoire. J’espère qu’ils seront comme nous entendus !
Très bien ! et a pplaudissements sur les travées du groupe CRC . – M. Robert Tropeano applaudit également.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le sénateur, auteur de cette proposition de loi, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il n’y a pas de sujet de plus grande importance que l’avenir de notre hôpital.
Cette question mobilise sur toutes les travées, et dans l’ensemble de la population. À ce titre, madame la sénatrice, vous avez eu raison de rappeler que les parlementaires, en particulier, se placent souvent à la pointe des combats pour la défense de leurs hôpitaux, de leurs services, et, en tout cas, de l’accès aux soins de la population qu’ils représentent. Ce combat est, bien entendu, très fort et parfaitement légitime.
Je veux le souligner, à travers votre proposition de loi – que j’appellerai à ne pas voter –, vous exprimez un attachement extrêmement fort à notre service public hospitalier, et un véritable engagement en sa faveur. C’est une façon de reconnaître à nouveau et de marquer l’excellence qu’incarne ce service public hospitalier. Excellence, bien sûr, en matière de soins et de recherche et d’innovation, mais également dans le domaine social, et je veux insister sur ce point. L’hôpital public permet en effet à chacun d’être pris en charge sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans distinction de revenus ou d’origines.
Il nous appartient de maintenir et de consolider cette excellence, afin qu’elle continue d’être reconnue dans sa diversité. J’ai eu l’occasion d’insister à plusieurs reprises sur ce fait : l’excellence ne peut pas s’apprécier uniquement au regard de la pratique médicale, de la recherche et de l’innovation. Une des marques de fabrique du système de santé français se trouve dans notre capacité à la mettre à disposition de la population.
Au-delà de ces points sur lesquels nous nous retrouvons facilement avec engagement et implication, des divergences existent, qu’il ne s’agit pas de cacher, au travers tant de la présentation de la proposition de loi que de son exposé des motifs, quant à la manière de concevoir l’avenir du système public hospitalier, notamment son organisation.
Même si vous dites vouloir adapter le service public hospitalier aux évolutions de la société, notamment aux besoins de la population, sachez qu’un moratoire aurait un effet strictement inverse, celui de figer les situations, ce qui ne correspond pas aux exigences de la période actuelle.
Monsieur Watrin, vous avez, non pas exhumé – la période n’est pas si ancienne que cela ! –, mais rappelé avec malice que j’avais signé un communiqué lorsque j’étais dans l’opposition, et que je signerais encore aujourd'hui sans difficulté !
Eu égard à la politique d’ensemble, …
… une politique de démantèlement qui remettait en cause la place et le rôle du service public hospitalier, il était absolument nécessaire – c’était une urgence ! – de limiter les dégâts, si vous me permettez l’expression, en coupant le fil des réorganisations enclenchées, d’autant que celles-ci avaient pour unique objet de créer des économies.
Contrairement à ce que vous laissez entendre – vous prenez d’ailleurs soin de rappeler très régulièrement dans vos propos les actions mises en place en faveur de l’hôpital public –, la politique hospitalière a changé depuis mai 2012 : des mesures ont été prises et des orientations nouvelles ont été marquées. C’est précisément parce que le cadre d’ensemble de notre politique est différent qu’un moratoire ne se justifie plus.
Nous ne conduisons pas, comme nos prédécesseurs, une politique de fermeture des hôpitaux. J’ai moi-même souligné l’intérêt que je porte au rapport de l’IGAS que vous avez, tous les deux, évoqué, madame, monsieur les sénateurs, et que j’ai approuvé.
Des restructurations ou des réorganisations qui n’ont d’autre objet que de faire des économies ne répondent pas aux critères d’exigence qui peuvent être les nôtres. Il ne s’agit pas de mener une politique de restructuration systématique, comme si la restructuration en elle-même était porteuse d’éléments bénéfiques. Il ne s’agit pas de fixer, dans notre pays, au travers d’un objectif quantitatif, un nombre de services hospitaliers et d’établissements de santé à ne pas dépasser.
L’objectif du Gouvernement est clairement affirmé : l’offre de santé doit correspondre aux besoins de la population en termes de santé. C’est au regard de cette exigence que nous avons engagé certaines réorientations.
À cet égard, certains exemples témoignent de la rupture avec la politique précédemment suivie.
Tout d’abord, je vous appelle, madame, monsieur les sénateurs, à regarder ce que font nos voisins européens. Les comparaisons internationales mettent toutes en évidence l’importance de l’équipement hospitalier français et des moyens qui lui sont alloués.
Ensuite, les projets de réorganisation engagés ne sont pas téléguidés de manière abstraite au niveau national, sans lien avec les acteurs de terrain. En amont, les instances des établissements publics de santé sont chaque fois consultées. Tous les choix sont définis en fonction d’une évaluation des besoins de santé, qui est notamment conduite par les agences régionales de santé.
En outre, la recomposition de l’offre hospitalière prend aujourd'hui, pour l’essentiel, la forme de coopérations nouvelles entre les établissements. Il s’agit non pas de mettre en avant des fermetures en série de services, ce qui semblait ressortir de vos deux interventions, mais bel et bien de permettre la coopération entre des services, avec précisément pour objet le maintien de la présence d’un service public hospitalier dans des territoires dans lesquels sans une telle coopération cette présence se trouverait menacée.
Madame la sénatrice, il ne suffit pas d’invoquer la sécurité ou l’organisation. Il faut également invoquer la capacité de certains territoires à attirer des professionnels.
Ainsi, un chirurgien ne se demande pas s’il a envie de travailler à la campagne ou en ville ; il a besoin de réaliser annuellement un certain nombre d’actes pour maintenir et garantir sa maîtrise professionnelle.
Quelle réponse peut-on apporter à ces professionnels ? Nous proposons, comme nous l’avons déjà fait dans un certain nombre de territoires depuis un certain temps, de mettre en place des coopérations entre des établissements de référence et des structures de proximité, ce qui permet d’assurer un partage. Ainsi, les professionnels de santé peuvent à la fois réaliser le nombre d’actes nécessaires au maintien de leur qualification et servir y compris des publics éloignés des villes-centres. Ces coopérations ont un objectif qualitatif et de présence dans les territoires.
À cet égard, permettez-moi de rappeler quelques chiffres.
Certains pourraient imaginer que le service hospitalier est aujourd'hui réduit aux acquêts, voire abandonné, ne disposant d’aucun moyen pour fonctionner.
En 2013, nous avons attribué 1, 6 milliard d’euros de plus aux hôpitaux publics. Même si cela s’est fait dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses, il s’agit très concrètement d’une augmentation des ressources des services publics hospitaliers.
Vous avez dit, madame la sénatrice, que vous attendiez toujours la réinscription de la notion de service public hospitalier dans la loi, tout en expliquant d’ailleurs, quelques instants plus tard, qu’il ne suffit pas d’une loi pour changer les choses. Prenons acte du fait qu’il ne suffit pas d’une loi pour changer les choses. Mais je vous indique qu’une loi a d’ores et déjà réinscrit cette notion : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 permet notamment de sanctuariser les ressources affectées aux missions d’intérêt général, ce qui n’était pas possible sans reconnaissance du service public hospitalier.
La suppression de la convergence tarifaire a bel et bien eu lieu, et nous avons la volonté de poursuivre le travail en ce sens, en reconnaissant le service public hospitalier au niveau territorial. Vous le savez, une mission a été confiée à Bernadette Devictor pour préciser les contours de ce que pourrait être ce service public territorial en matière hospitalière.
Comme je m’y étais engagée lors de la discussion parlementaire, des crédits supplémentaires ont été dégelés à la fin de l’année dernière : 90 millions d’euros ont été affectés à l’hôpital public, et ce sans compter les efforts spécifiques, à hauteur de 377 millions d’euros, engagés tout au long de l’année 2013 en faveur de la cinquantaine d’établissements qui avaient des besoins financiers particuliers. Eu égard aux efforts réalisés – ils s’inscrivaient dans une trajectoire de retour à l’équilibre –, il était nécessaire de les soutenir.
Qui plus est, la sécurisation des investissements a été mise en œuvre au travers de la signature – c’est la première fois dans notre histoire ! – d’une convention avec la Banque européenne d’investissement, qui s’engage à financer des établissements publics hospitaliers ou à participer à leur financement. C’est là un point extrêmement positif.
Dans le cadre de la procédure de soutien à l’investissement, quinze établissements ont d’ores et déjà fait l’objet d’une décision favorable à leur projet de réorganisation ou de reconstruction, pour des sommes qui engagent l’État à hauteur de 1 milliard d’euros, ce qui n’est pas négligeable.
C’est la raison pour laquelle on ne peut pas dire, madame la rapporteur, que l’on assiste à la multiplication des cas de fermeture d’hôpitaux, de services hospitaliers ou de maternités de proximité, qui s’apparenterait, pour reprendre vos propres termes, à un véritable plan social. Au contraire, nous menons une politique de maillage du territoire, d’investissements financiers dans les services de proximité, afin de permettre à notre service public hospitalier de s’adapter.
Un moratoire aurait pour effet de contredire la nécessité de l’adaptation de notre service public hospitalier, à la mise en place de parcours coordonnés, adaptés, qui permettent un retour rapide au domicile. À cet égard, on ne peut souhaiter que le retour à domicile soit rapide et considérer dans le même temps que l’ensemble des réponses doivent être trouvées au sein de l’hôpital. Notre service public hospitalier doit également s’adapter aux attentes ou évolutions des besoins des professionnels de santé eux-mêmes, qui ne veulent plus travailler comme avant. À ce sujet, je prendrai pour seul exemple les sages-femmes, qui font l’actualité.
Pour toutes ces raisons, l’offre hospitalière ne peut rester figée : elle doit s’adapter en permanence.
Nous n’avons rien à craindre de cette exigence d’évolution, d’adaptation. La responsabilité politique est d’accompagner ces évolutions, voire de les anticiper, pour améliorer encore et toujours la qualité des soins.
Nous devons donc déterminer nos politiques en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, et non par rapport au nombre d’établissements.
La qualité et la sécurité des soins, l’égalité entre les patients, entre les territoires, la réduction de la durée des séjours, le développement de la prise en charge à domicile, telles sont les priorités que j’ai fixées dans le cadre de la stratégie nationale de santé, et c’est en fonction de ces objectifs que doit se déterminer l’organisation hospitalière.
Cette stratégie porte une vision globale de long terme à l’échelle des territoires, et c’est en ce sens que nous allons poursuivre notre action.
Depuis plus de dix-huit mois, la priorité qui est la mienne est précisément de permettre à chaque Français d’avoir accès à des soins de proximité.
À cet égard, j’ai d’abord renforcé l’organisation territoriale de la prise en charge des urgences. L’engagement présidentiel a commencé d’être mis en place : 100 % de nos concitoyens devront avoir accès avant 2017 à des soins urgents en moins d’une demi-heure. Depuis un an, les résultats sont là : nous avons d’ores et déjà permis à 1 million de personnes supplémentaires d’accéder aux soins urgents en moins de trente minutes.
Ensuite, j’ai mis en place une politique en faveur des services hospitaliers d’urgence, en assurant le financement des besoins des services en tension et en mettant en place une réorganisation au travers d’un programme dit « gestion de lits d’aval », qui doit permettre une meilleure structuration des services d’urgence. Même si les transformations ne peuvent se faire en quelques semaines, ni même en quelques mois, des progrès ont d’ores et déjà été enregistrés.
Par ailleurs, pour garantir l’accès de tous nos concitoyens à nos hôpitaux, j’ai apporté mon soutien à de nombreux établissements isolés, dont la présence est essentielle pour maintenir une offre de proximité. J’ai déjà évoqué cette question à plusieurs reprises. Pour ne citer qu’une seule région – les citer toutes serait long et quelque peu fastidieux ! –, la région Aquitaine, je suis intervenue pour soutenir le centre hospitalier d’Orthez, la clinique mutualiste du Médoc, ainsi que le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, qui auraient progressivement disparu de l’offre de proximité.
En parallèle, je veux vous rappeler que, si vous aviez accepté de débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Mme Gisèle Printz applaudit . – Murmures sur plusieurs travées du groupe socialiste.
… vous auriez constaté, comme l’ont fait les députés, que j’ai proposé une disposition, qui a d’ailleurs été adoptée, prévoyant un financement adapté pour les activités isolées, pour lesquelles la tarification à l’activité n’est pas suffisante.
Enfin, pour adapter l’offre hospitalière aux nouveaux besoins de santé, il nous faut poursuivre le dialogue social. Ce sont plus de 1 million de personnes qui travaillent à l’hôpital public et sont engagées au quotidien. La confiance a été engagée avec la modification de la gouvernance de nos établissements, ce qui est une façon de revenir sur la loi HPST au regard de cette gouvernance. Les instances de représentation des personnels ont été confortées dans leurs prérogatives, et c’est le sens de toute une série de décrets que j’ai signés en septembre dernier, à la suite des travaux menés par Édouard Couty avec l’ensemble des représentants du monde hospitalier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’objectif doit être de maintenir le haut niveau d’excellence du modèle hospitalier français. Pour l’atteindre, nous devons accompagner l’hôpital dans sa transformation. L’immobilisme n’a jamais été un gage de qualité, ni le statu quo une bonne réponse à l’évolution des besoins !
Or la stratégie nationale de santé, qui fait actuellement l’objet d’intenses débats dans tous nos territoires, est précisément animée par l’ambition de prendre en considération l’évolution des besoins de santé, des attentes en matière de santé et, tout simplement, de notre société.
Aujourd’hui, il est urgent de transformer l’hôpital public pour l’adapter et pour le moderniser : c’est pourquoi je vous appelle à ne pas voter la proposition de loi !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord remercier Laurence Cohen et Dominique Watrin, ainsi que l’ensemble des membres du groupe CRC, de nous donner l’occasion de discuter d’une question urgente, douloureuse et très polémique, au plan local comme au plan national : les fermetures de services hospitaliers.
Cette question, nous y avons toutes et tous été confrontés en tant que parlementaires : toutes et tous, en effet, nous avons vécu la fermeture d’un service hospitalier et participé à la mobilisation aux côtés des usagers et des personnels. Parfois, nous avons trouvé cette décision injuste et manqué de moyens de recours ; de fait, on se retrouve souvent très démuni face à un mode de prise de décision très vertical et très peu transparent.
Reste que, selon nous, il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur toute modification ; il ne faut pas davantage figer la carte hospitalière telle qu’elle est ou telle qu’elle a été, en refusant toute amélioration ou toute adaptation aux évolutions des techniques médicales, de la population et des besoins de celle-ci. L’inertie ne saurait constituer une solution en soi !
C’est pourquoi j’apprécie assez que la proposition de loi n’interdise pas les fermetures de service, mais prévoie plutôt un certain nombre de garde-fous.
Plus précisément, elle rend obligatoire l’existence d’une offre de santé au moins équivalente, avec une garantie de tiers payant et de tarifs opposables ; en outre, elle prévoit un avis consultatif obligatoire des commissions médicales et des comités techniques d’établissement concernés ; enfin, elle conditionne la levée du moratoire à un avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire.
En commission, nombre de nos collègues ont estimé que ces garde-fous étaient trop nombreux, de sorte qu’ils risquaient d’entraîner le blocage de tout projet de recomposition hospitalière. Nous en reparlerons.
L’important, pour le groupe écologiste, est de garder à l’esprit un triple objectif : l’accès aux soins, la sécurité et la proximité.
L’accès aux soins doit rester satisfaisant pour tous nos concitoyens, quel que soit leur revenu. À cet égard, je suis bien évidemment très sensible à la garantie d’accès aux soins, avec tiers payant et tarif opposable, que la proposition de loi prévoit.
La sécurité doit être assurée afin que chacun, où qu’il réside, puisse accéder à un plateau technique de très grande qualité.
Quant à la proximité, elle doit être réalisée au moins pour les soins urgents.
Ne nous y méprenons pas : il est clair qu’il faut fermer un service qui mettrait en danger les patients qui y sont admis ; du reste, la proposition de loi le prévoit.
Toutefois, quand j’apprends, à la lecture du rapport de Mme Cohen, que, dans trois départements, plus de la moitié des habitants ne peuvent être hospitalisés en moins de 40 minutes, je suis préoccupée et je pense : dans ces situations aussi, les populations sont en danger !

De même, je partage les interrogations de Mme la rapporteur sur la pertinence des seuils minimaux d’activité, selon l’expression en vigueur, en deçà desquels la sécurité des femmes et des bébés ne serait pas assurée dans certaines maternités. En effet, pour le calcul de ces seuils, le volume d’activité est évalué au niveau du service et non, par exemple, au niveau individuel, ce qui mérite d’être débattu.
Que l’objectif de sécurité doive nous guider est une évidence ; mais il doit être considéré pour lui-même, et non servir de prétexte à des décisions purement économiques.
Selon nous, trouver l’équilibre délicat entre les objectifs d’accès aux soins, de sécurité et de proximité nécessite d’appliquer une méthode : la démocratie sanitaire, à laquelle on accorde aujourd’hui trop peu d’attention.
Encourager la démocratie dans le développement de la stratégie sanitaire suppose de faire primer la transparence et la concertation dans toute décision de recomposition hospitalière. Mettre en place cette démarche ne réclame pas forcément plusieurs années ; cela peut être fait rapidement !
En tant que parlementaire, j’ai vécu certaines situations de réorganisation, aux Lilas et à l’Hôtel-Dieu. Je suis actuellement préoccupée par les interrogations qui entourent l’institut de radiothérapie de hautes énergies de l’hôpital Avicenne de Bobigny.
Je suis d’accord avec Mme la rapporteur lorsqu’elle écrit ceci : « les décisions de fermetures de lits, de services ou d’établissement de santé sont prises, dans une très grande majorité des cas, sans concertation préalable avec les populations – j’ajouterai : les élus locaux – et les acteurs concernés, notamment la communauté hospitalière. L’expérience montre que des ″consultations″ ont bien lieu, mais après que la décision a effectivement été prise ».
Nous, écologistes, l’affirmons très clairement : nous ne pouvons pas voter contre la proposition de loi, parce qu’elle soulève de vraies questions, parce qu’il est urgent de renforcer la démocratie sanitaire et parce que nous ne croyons pas que c’est le rationnement de l’offre de soins, au moyen des numerus clausus et des fermetures de lits, qui comblera le déficit de la sécurité sociale.
Toujours est-il que nous n’aurions pas rédigé l’exposé des motifs de la proposition de loi, ni son dispositif, dans les termes qui sont les leurs. Le temps me manque malheureusement pour être plus précise ; je dirai seulement que nous aurions mis l’accent sur la concertation et sur l’avis de la conférence de territoire.
Sans doute, la proposition de loi n’est pas parfaite ; mais les problèmes de notre système de santé sont trop complexes, et les règles encadrant l’initiative parlementaire trop rigides – je pense notamment à l’article 40 de la Constitution –, pour que nous puissions proposer nous-mêmes une réforme d’ampleur et de portée générale.
Aussi bien, madame la ministre, nous sommes suspendus à la grande réforme de santé que vous annoncez ; même si vous avez déjà commencé à vous attaquer à certaines difficultés, en particulier le problème de la convergence tarifaire, c’est à l’occasion de la discussion de cette réforme que nous pourrons envisager l’ensemble des mesures nécessaires pour conforter l’hôpital public !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mmes Gisèle Printz et Anne Emery-Dumas applaudissent également.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi vise à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement.
L’organisation de l’offre de soins sur le territoire national est depuis longtemps au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, qui tentent de répondre aux besoins sanitaires des Français tout en utilisant le plus efficacement possible les moyens humains et matériels.
En 2008, notre collègue Alain Milon a été chargé par la commission des affaires sociales d’établir un rapport sur l’avenir de la chirurgie en France. Il y démontrait que des inégalités se creusaient – à l’époque déjà – entre territoires et entre spécialités.
Comme la Cour des comptes l’a rappelé dans son rapport public annuel de 2013, les restructurations hospitalières – puisque ce sont elles que vise la proposition de moratoire – peuvent prendre plusieurs formes. En particulier, elles peuvent consister en une réorganisation de services pour adapter ceux-ci à la demande, aux nouvelles technologies et à la démographie médicale, tous facteurs qui évoluent.
Elles peuvent aussi consister en une fermeture de services du fait du non-respect des normes – nous sommes spécialistes de leur modification ! – ou d’une activité trop faible ; dans ce cas, la restructuration peut conduire à la reconversion du site, à un transfert d’activité vers un autre établissement ou à la construction d’une structure neuve regroupant les anciennes activités des établissements fermés.
Plus largement, les restructurations hospitalières tendent à améliorer la qualité de l’offre de soins au meilleur coût, dans une logique de coopération et de partage d’activité entre les établissements d’un territoire de santé.
Comme l’a souligné notre collègue Alain Milon en commission, il n’est jamais simple de fermer un hôpital : ce n’est pas parce que le taux de fuite, signe de la défiance des usagers, est élevé que la population ne se mobilise pas si l’on évoque une fermeture !

Preuve qu’il est difficile d’apporter au problème une réponse standardisée, comme un moratoire.
À propos des restructurations hospitalières, et des hôpitaux de manière générale, je désire présenter quelques observations touchant à trois thèmes importants : la T2A, l’ONDAM et le rapport de l’IGAS.
En ce qui concerne l’hôpital, la réforme de la T2A qui obsède tant la majorité risque de nous ramener dix ans en arrière. Pour limiter les développements abusifs d’activité, le ministère de la santé semble s’orienter vers une réforme de la tarification consistant à instaurer des seuils à partir desquels les tarifs deviendraient dégressifs, au risque de recréer des dotations globales qui ne permettront plus de se fixer sur la performance.
Faudrait-il optimiser l’offre de soins seulement jusqu’à certains seuils ? En vérité, la pertinence de cette réforme est sujette à caution. Soyons pragmatiques : il ne faut pas revenir à la dotation globale, mais adapter la T2A afin d’améliorer le financement des hôpitaux sans pénaliser leurs activités.

Je vous rappelle également que le périmètre de l’ONDAM hospitalier est instable : il englobe principalement les charges des établissements et, contrairement à l’indicateur appliqué aux soins de ville, ne se fonde pas sur une appréciation correcte de l’effet sur les dépenses de la progression ou de la régression de l’activité.
Au sujet du rapport de l’IGAS de février 2013, nous tenons à signaler que les soins d’urgence, comme on l’a déjà fait remarquer, sont accessibles en moins de 30 minutes pour près de 95 % de la population.
Des progrès doivent encore être accomplis, mais il faut aussi considérer que d’autres formes d’hospitalisation se développent de plus en plus. Je pense en particulier à l’hospitalisation à domicile, qui est importante pour la prise en charge du patient, pour son bien-être et pour celui de son entourage ; cette formule mérite vraiment d’être encouragée.
Si la proximité est déterminante dans la prise en charge, n’oublions pas que la qualité du réseau d’organisation des soins l’est tout autant. Or ce facteur, madame la rapporteur, ne me semble pas pris en compte dans la proposition de loi.
Je tiens à insister sur les belles avancées de notre médecine française, qui ont déjà été signalées ; elles structurent l’offre de soins en amont et en aval de l’hospitalisation, permettant d’améliorer et d’adapter au mieux le parcours du patient. De fait, notre système de soins est largement envié par nombre de pays !
Permettez-moi de faire état du point de vue exprimé par Claude Évin dans le journal Libération du 13 janvier dernier. L’ancien ministre des affaires sociales, dont je rappelle qu’il est socialiste, y explique à juste titre qu’il faut revoir les prescriptions médicales inadaptées, mais surtout repenser l’organisation de notre système de santé pour mieux garantir la qualité des services.
Nous pouvons souscrire à un certain nombre de propositions présentées par M. Évin : « introduire plus de prévention, organiser la médecine de premier recours et son articulation avec l’hôpital, travailler au repositionnement même de chacun des acteurs dans l’offre de soins, sortir de l’hospitalo-centrisme, établir une gouvernance plus efficace de notre système de santé au niveau central comme au niveau régional ».
J’ajoute qu’il est indispensable d’opérer la prise de conscience sur laquelle insiste le rapport Couty de février 2013 : il faut une refondation de l’hôpital public pour les années qui viennent. Cette refondation devra être adaptée à notre époque et aux attentes des patients ; elle devra être centrée sur les missions de l’hôpital public, en particulier les soins, le médico-social, la santé publique, l’enseignement et la recherche.
Comme je l’ai dit en commission, les auteurs de la proposition de loi ont omis de traiter des recettes, ce qui est dommage, mais aussi des parcours de soins, des réseaux, de l’ouverture sur l’extérieur et du rôle des 35 heures dans la tarification et l’organisation ; ils ont également ignoré que les hôpitaux locaux comptent plus de lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes que de lits actifs.
Madame la ministre, il faut suffisamment de médecins pour tous les territoires !

À cet égard, la question se pose du numerus clausus ; nous en avons déjà débattu et vous savez qu’elle me tient à cœur. De fait, s’il y a reconnaissance dans les diplômes, il n’y a pas de justice d’accès à la médecine.
Pendant trop longtemps, les gouvernements successifs sont partis du principe que plus les médecins seraient nombreux, plus les coûts pour la sécurité sociale seraient élevés ; aujourd’hui, l’échec de cette idée technocratique est patent.

Nombre de facteurs à prendre en compte auraient dû nous alerter, sur lesquels il faut insister pour faire progresser les choses. C’est pourquoi je les rappelle ici : la féminisation de la profession ; la réduction du temps de travail ; l’évolution des mentalités ; la conciliation réclamée entre vie professionnelle et vie familiale ; l’évolution du secteur médico-social ; la protection maternelle et infantile, ou PMI ; les spécialités, notamment la pédopsychiatrie ; la codification des actes dans les hôpitaux ; l’hyperspécialisation des médecins ; la reconnaissance du handicap ; l’alourdissement des tâches administratives ; la récupération obligatoire des gardes de nuit... et j’en oublie sûrement !
Ce sont autant de facteurs qui auraient dû nous faire réfléchir à ce problème de numerus clausus et nous inciter à prendre davantage nos responsabilités. Il faut former différemment les étudiants et, surtout, leur laisser la liberté d’installation pour que leur vocation, si elle existe, puisse s’exprimer en fonction de l’expérience acquise lors de leurs études.

Quelques mots, enfin, sur l’offre de soins.
Si nous suspendons les fermetures de services ou d’établissements, mes chers collègues, nous bloquons également toute la restructuration de l’offre de soins, ce qui ne va pas dans le bon sens !
L’offre de soins a effectivement besoin de s’adapter à l’évolution des attentes des patients et à celle des modes de prise en charge. L’ambulatoire, par exemple, est un bien pour les patients, et il est démontré qu’à l’échéance de dix ans presque toutes les activités de rhumatologie, notamment, seront réalisées en ambulatoire. Cela signifie que nous ferons des économies, tout en proposant une bonne prise en charge.
Ce qui est important, me semble-t-il, c’est que les services soient adaptés aux besoins – évolutifs – de la population.
En conclusion, cette proposition de loi est trop générique et ne prend pas suffisamment en compte la qualité de la prise en charge.
Ce n’est pas forcément une bonne pratique de « sur-hospitaliser » comme le fait la France. Puisque à l’horizon de 2020 il est prévu une baisse du recours à l’hospitalisation de plus de 10 %, nous ne pourrons pas garder l’intégralité des services. Si nous procédions de la sorte, nous risquerions d’aggraver, encore et toujours, les dépenses de santé, qui, ne l’oublions jamais dans notre réflexion, sont en grande partie payées à crédit. Enfin – faut-il le souligner ? –, la volonté de réduction drastique de la dépense publique – une réduction annoncée de plus de 50 milliards d’euros pour les années à venir – ne semble pas intégrer cette proposition de loi.
Soyons clairs sur un point, c’est bien la qualité des soins qui doit primer, et ce à un coût supportable pour notre société, ce qui implique des fonctions supports partagées, y compris dans les zones périphériques.
Les groupements hospitaliers sont une réponse parmi d’autres, mais, dans les secteurs périphériques notamment, ils sont un gage de stabilité des services sanitaires, ainsi que des services médico-sociaux qui leur sont généralement associés. Je l’ai personnellement expérimenté dans mon département : le regroupement de différentes activités hospitalières au sein d’une structure interdépartementale, ce qui leur permet de partager un certain nombre de fonctions, donne tout à fait satisfaction aux usagers et garantit une stabilité des services offerts à la population.
Cette proposition de loi apporte donc une réponse partielle à une question bien compliquée !

Preuve en est, l’article 1er vise à instaurer une solution générique – le moratoire – et, dès l’article 2, des exceptions à la règle sont proposées.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre cette proposition de loi de généralisation des moratoires. Nous estimons qu’un moratoire ne peut s’imposer que de façon très spécifique, dans des cas bien particuliers. Comme tous ici, nous avons bien entendu le souci de défendre le secteur hospitalier, mais il faut le faire sans figer les situations délicates.
Applaudissements sur les travées de l'UMP . – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme son intitulé l’indique, l’objet de cette proposition de loi de nos collègues du groupe CRC est d’imposer un moratoire à toute fermeture de service ou d’établissement de santé.
J’ai trop de respect pour nos collègues pour ne pas penser que la démarche les ayant amenés à présenter ce texte répond à un état d’esprit généreux, sincère, à la recherche d’une justice sociale, que celle-ci soit verticale – indépendante, donc, de la condition sociale des citoyens – ou horizontale – c’est-à-dire sans lien avec la situation des territoires. Mais je pense franchement que cette proposition de loi ne correspond pas à ce que nos concitoyens sont en droit d’attendre aujourd’hui de l’offre de soins.

Face à cette proposition, une seule question doit nous guider : quel est l’intérêt du patient ? Son intérêt, de toute évidence, est de bénéficier de la meilleure prise en charge possible.
Cela signifie-t-il une prise en charge au plus près du domicile ou une prise en charge de la meilleure qualité médicale possible ? La réponse s’impose d’elle-même : c’est bien sûr la sûreté et la qualité des soins qui doivent primer.
Mais pourquoi opposer proximité et qualité ? Parce que l’évolution de la médecine peut l’imposer dans un certain nombre de cas. Or cette évolution est de grande ampleur : en cas d’infarctus du myocarde, par exemple, il est maintenant préconisé une coronarographie dans les deux premières heures après l’accident cardiaque. Comment ne pas également prendre en compte les avancées diagnostiques et thérapeutiques de l’imagerie médicale, de l’endoscopie, de la cœlioscopie et de bien d’autres techniques ?
Une bonne prise en charge médicale de première intention nécessite donc la constitution de solides plateaux techniques, ce qui implique des regroupements de moyens.
Mais cela suppose aussi une certaine concentration d’activité. Pourquoi ? La qualité des soins dépend aussi, et surtout, de la qualité et de l’expérience des praticiens. Il faut un médecin aguerri et très compétent pour exploiter la coronarographie que j’évoquais à l’instant et il est bien évident qu’un chirurgien réalisant dix opérations de la hanche par semaine sera toujours plus fiable et efficace que celui qui n’en pratique qu’une par mois, parfois moins. C’est pourquoi il est dangereux de maintenir des services qui sont en sous-activité ou même parfois, hélas, ne réalisent pratiquement aucun acte.
Dès lors, il devient impossible de cumuler proximité pour tous et qualité des soins pour tous, ce qui explique la fermeture de certains services ou établissements. Je me suis battu personnellement pour la fermeture de maternités que d’autres élus défendaient par pure démagogie, pétition à l’appui, alors qu’eux-mêmes n’y auraient jamais eu recours pour un membre de leur famille.

Pour cette raison, le moratoire ne peut être une solution adaptée.
D’ailleurs, à son appui, sont invoquées des questions qui, pour importantes qu’elles soient, n’ont pas de lien direct avec la véritable problématique. Ainsi en est-il de la T2A, de l’évolution de l’ONDAM hospitalier et de la situation budgétaire des établissements. Cela témoigne du soupçon avoué selon lequel la véritable raison des fermetures serait purement comptable. Ce serait bien sûr condamnable… Mais, en toute sincérité, je ne le crois pas !
En toute objectivité, on peut constater que lorsqu’il est question de fermer un service ou un établissement, c’est le plus souvent parce que la faiblesse de son activité n’apporte pas au patient la meilleure qualité de soins qu’il est en droit d’attendre.
Le seul véritable enjeu est donc la nécessaire adaptation de l’offre hospitalière à l’évolution de la médecine. Par définition, un moratoire imposant un gel global, une solution générale là où, au contraire, s’impose une approche au cas par cas, ne le permet pas.
Au conservatisme du moratoire, il faut opposer une conception de l’offre hospitalière articulée entre prise en charge de premier recours et prise en charge de soins. Comme je l’expliquais, le premier recours doit être organisé autour de plateaux techniques évolués dans des pôles d’activité concentrée, tandis que l’offre de proximité doit être assurée par des hôpitaux de soins, de post-cure et de rééducation.
Une telle évolution est nécessaire pour que la médecine française reste l’une des meilleures du monde.
Pour toutes ces raisons, notre groupe, dans sa très grande majorité, votera contre cette proposition de loi. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, comme je l’ai souligné en commission des affaires sociales, cette proposition de loi déposée par nos collègues du groupe CRC tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de services et d’établissements de santé ou leur regroupement est, pour notre groupe, une réponse inadaptée à une vraie question, une vraie problématique, celle de la prise en charge des besoins de santé de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national. Cette prise en charge ne peut du reste, tout le monde en convient, se limiter aux seules structures hospitalières.
Le Gouvernement, depuis l’élection du Président de la République, François Hollande, travaille dans cette direction. Le chantier est très vaste du fait, notamment, des défis d’adaptation auxquels notre système de santé doit sérieusement faire face. Je rappelle, à ce niveau, que l’adaptabilité est un principe fondamental du service public. Le service public hospitalier ne saurait y échapper, et c’est tant mieux ! L’offre hospitalière doit s’adapter en permanence car c’est aussi la demande des patients.
Parmi ces défis, soulignons ceux qui sont liés au vieillissement de la population et à la perte d’autonomie, ainsi qu’aux maladies chroniques pour lesquelles la branche maladie de la sécurité sociale consacre environ 65 % de son budget. Ces maladies relèvent, pour reprendre les propos récents des professeurs Bernard Granger et André Grimaldi, d’une « médecine intégrée – biomédicale, pédagogique, psychologique et sociale – et coordonnée entre les professionnels et entre la médecine de ville et l’hôpital ».
Mais il faut aussi tenir compte des progrès scientifiques et des innovations technologiques entraînant des mutations en termes de réponses thérapeutiques à de nombreuses pathologies, ce qui induit des remodelages de services hospitaliers. Je pense, par exemple, aux services de chirurgie vasculaire avec le développement de l’angioplastie. De même, d’une manière générale, la diminution des techniques invasives n’est pas sans incidence sur la structuration et l’organisation de services de soins comme des plateaux techniques.
Enfin, les défis sont liés au rattrapage du retard de notre pays en matière de chirurgie ambulatoire et d’hospitalisation à domicile, et, bien sûr, à la recherche du maximum de sécurité pour les patients et les parturientes.
Comme notre collègue Gérard Roche, par ailleurs médecin aguerri, le disait la semaine dernière en commission – il vient d’ailleurs de le répéter –, ce qui compte en médecine, c’est la qualité, la qualité des actes étant étroitement liée à celle des acteurs les effectuant. J’ajouterai à cela les moyens techniques mis en place, ainsi que la formation initiale et continue de ces acteurs. Ce qui compte enfin, mais cela va de pair, c’est la pertinence des actes exécutés.
Mes chers collègues, on sent bien que, pour répondre à la complexité de ces défis, il ne suffit pas de décréter, de manière brutale, d’ailleurs, un moratoire sur la fermeture de lits d’hospitalisation.
C’est notamment pour faire face à cette complexité, madame la ministre des affaires sociales et de la santé, que vous avez annoncé, en présentant « la stratégie nationale de santé » poursuivie par le Gouvernement, la nécessité de « refonder notre système de santé ». Certaines mesures de préfiguration de cette refondation ont déjà été adoptées dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et d’autres prendront place dans la future loi de santé publique annoncée.
En matière de politique de santé publique, on ne peut pas se contenter d’avoir une vision en silo, terme que j’emprunte volontiers à notre collègue Jean-Claude Lenoir, lui-même l’ayant emprunté à Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement, à propos d’une autre politique tout aussi compliquée à mettre en œuvre.
La vision doit être globale, ce qui accroît les difficultés lorsqu’il s’agit de la transcrire en phases opérationnelles.
Une déclinaison doit effectivement s’opérer au niveau des parcours de soins – du médecin de ville jusqu’à la prise en charge en post-hospitalisation –, de la territorialisation du service public hospitalier, du renforcement des structures existantes et de la création de structures nouvelles au bénéfice de la médecine de premier recours – centres de santé, maisons de santé, etc. – et pour lutter contre les déserts médicaux ruraux, périurbains et, souvent, urbains.
Par ailleurs, l’organisation territoriale des urgences doit tenir compte des spécificités géographiques de notre pays et des habitudes – ou habitus, pour reprendre un terme cher à Bourdieu – culturelles de nos concitoyens : modes de déplacement, lieux d’habitation éloignés des lieux de travail induisant l’accroissement du trafic routier, avec risques d’accidents graves, eux-mêmes également liés à la consommation excessive d’alcool ou à la prise de produits toxiques tels que les drogues, lieux de vacances à la montagne l’hiver, sur le littoral l’été, conduisant à des concentrations fortes de population pendant des périodes de plus en plus fractionnées…
En outre, il convient d’adapter les structures d’hospitalisation, d’hébergement, de soins de cure et de réadaptation et de prendre en considération les réseaux de soins et les spécificités en matière de soins psychiatriques, ainsi que l’évolution des équipements et des plateaux techniques et, souvent, leur implantation voire leur mode de gestion.
Enfin, il est nécessaire de se pencher sur la pénibilité des conditions de travail des personnels non seulement soignants et non soignants, mais aussi médicaux, des structures de soins.
La multiplicité des acteurs concernés et souvent les « conservatismes » à faire bouger signent l’énormité du travail à accomplir. Notre gouvernement et, en premier lieu, vous-même, madame la ministre, vous êtes attaqués avec courage et détermination à cette lourde tâche. §
J’insiste sur le fait que le Gouvernement ne conduit pas de politique de fermeture des hôpitaux. Quand, pour des raisons que j’ai rappelées assez longuement, une recomposition de l’offre hospitalière s’impose, elle prend avant tout la forme de coopérations à objectifs qualificatifs entre établissements, vous venez de le rappeler à l’instant, madame la ministre, et, le cas échéant, de regroupements juridiques sous la forme d’une direction commune ou d’une fusion. Par ailleurs, les instances des établissements publics de santé sont nécessairement consultées sur les projets de remodelage et de restructuration.
Pour revenir plus particulièrement à votre proposition de loi, madame la rapporteur, je souhaite formuler quelques observations supplémentaires.
Premièrement, il m’apparaît surprenant que ce soit surtout au travers du prisme de l’emploi, dont il n’est pas question pour moi de réfuter l’importance, que votre proposition de loi se positionne en priorité pour ce qui concerne la défense de l’hôpital public. On pourrait penser que, justement, parce que l’hôpital n’est pas une entreprise et que la santé n’est pas une marchandise, ce qui est également notre conviction, il ne faut pas se contenter de répondre par une « défense pied à pied de l’existant » aux questions posées par l’obligation de prendre en charge, d’une manière adaptée, les besoins en matière d’hospitalisation de nos concitoyens, lorsque cela est nécessaire.
Ce type de défense conduit trop souvent à nier la nécessité de construire des projets alternatifs, pertinents et cohérents sur le triple plan médical, territorial et financier, cette dernière dimension ne devant pas être occultée si l’on est attaché à la sauvegarde de notre système social, qu’il faut bien continuer de financer nonobstant la sévérité de la crise économique qui frappe notre pays.
Ainsi, votre type de défense, madame la rapporteur, nous paraît décalé.
Deuxièmement, s’agissant de votre critique de la loi HPST, nous en partageons de nombreux volets, ce qui nous avait conduits à l’époque de son examen par le Sénat à déposer plus de 450 amendements, pour en gommer les aspects les plus critiquables, voire les plus dangereux.
La loi de santé publique en préparation aura bien évidemment à connaître de ces aspects et à y apporter des réponses, que, je l’espère, nous adopterons ensemble. En prenant certains décrets, le Gouvernement s’est déjà attelé à cette tâche, vous venez de le souligner, madame la ministre.
Troisièmement, j’en viens, madame la rapporteur, à votre opposition radicale au financement des hôpitaux par la tarification à l’activité, la T2A, dont vous avez fait état en commission des affaires sociales, et qui justifie aussi, m’a-t-il semblé, votre proposition de loi.
Je vous rappelle que la MECSS, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, de la commission des affaires sociales du Sénat a rédigé l’année dernière un rapport d’information intitulé Refonder la tarification hospitalière au service du patient. Ce rapport a été adopté à l’unanimité des groupes politiques du Sénat. Il contient 38 propositions, qui peuvent permettre d’apporter des réponses adaptées à la nécessité d’un financement diversifié de l’activité hospitalière pour chacune de ses facettes. Il n’a pas préconisé de supprimer la T2A – ce serait une erreur – ni de la « fétichiser », ce qui en serait une autre. Elle doit rester un outil à utiliser prioritairement pour le financement d’activités programmées, standardisées, connaissant peu de variabilité de coût, comme mon collègue Alain Milon et moi-même l’écrivions dans ce rapport.
Nous avancions également d’autres propositions concernant ces questions de financement, y compris celles qui ont trait aux investissements immobiliers, l’une des causes principales des lourds déficits relevés par la Cour des comptes pour les CHU et les grands hôpitaux.
Certaines propositions ont déjà été reprises par le Gouvernement. Par exemple, la convergence tarifaire en MCO, médecine chirurgie obstétrique, entre les hôpitaux et les cliniques privées a été supprimée, conformément à ce que nous proposions. D’autres mesures suivront, j’en suis persuadé. Bien évidemment, ce n’est pas le moratoire que vous nous proposez qui résoudra le problème complexe que pose le financement des hôpitaux publics.
En guise de conclusion, je reprendrai quelques observations pertinentes formulées par le nouveau directeur général de l’AP-HP, que nous avons auditionné ensemble, madame la rapporteur : « L’hôpital doit être vivant, il doit pouvoir bouger » ; « l’inertie joue contre l’hôpital » ; « il faut pouvoir fermer des sites, en ouvrir d’autres, rapprocher les équipes » ; et enfin « la vitesse d’adaptation est fondamentale pour le service public hospitalier ».
Pour toutes ces raisons, et parce que le Gouvernement est engagé dans une politique visant à garantir à chaque Français des soins de proximité de qualité sur l’ensemble du territoire, mon groupe votera contre la proposition de loi qui nous est présentée. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, les membres du groupe CRC proposent de décréter un moratoire sur les fermetures d’établissements de santé, le temps de repenser notre modèle hospitalier.
On serait tenté de leur donner raison. Refonder l’hôpital est en effet une nécessité ; encore faut-il poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses !
Or cette proposition de loi évoque, pêle-mêle, l’impact négatif des restructurations sur l’accès aux soins, le sous-financement chronique des hôpitaux, la pression intenable de la T2A, l’arbitraire de la convergence tarifaire, le renoncement au service public et, bien sûr, mère de tous les maux, la loi HPST et sa logique libérale…
Vous vous doutez que je ne partage pas une telle vision, pour le moins idéologique, pas plus que la réponse qui est proposée, à mon sens un peu caricaturale.
D’ailleurs, madame la rapporteur, j’ai une autre lecture du rapport de l’IGAS sur les restructurations hospitalières, que vous avez cité. Certes, il pointe les limites de la trop grande taille de l’hôpital, tout en reconnaissant que l’effet positif d’une augmentation de la taille est particulièrement établi en matière de qualité des soins et d’économies d’échelle pour les plus petits établissements.
Il ne vous aura sans doute pas échappé non plus que, loin de préconiser l’arrêt des fermetures de services, ce même rapport propose de relancer la politique des seuils en chirurgie et en obstétrique, laquelle « à côté des enjeux de qualité, doit aussi mettre en exergue les enjeux d’optimisation des coûts ». Vous l’avez dit, on ne peut guère soupçonner l’IGAS d’extrémisme.
Je reconnais que la politique de restructuration, telle qu’elle a été conduite ces deux dernières décennies, ne s’est pas toujours faite dans la concertation et a manqué de lisibilité pour les usagers. Les élus ont d’ailleurs une part de responsabilité dans ce manque de lisibilité, en confondant enjeux de territoire et d’emploi et enjeux de santé.
Il n’est évidemment pas question de restructurer dans le but unique de fermer des lits à tout prix, mais il importe de prendre en compte l’évolution considérable de la manière de soigner depuis trente ans : la progression des techniques, la réduction des durées de séjour, les modalités de prise en charge, l’hospitalisation à domicile. Vous ne pouvez pas ignorer toute cette révolution bénéfique, avant tout, au patient.
Peut-on aussi vouloir, d’un côté, des équipements de pointe et des équipes médicales entraînées et, de l’autre, un maillage fin d’établissements sur le territoire, quitte à maintenir artificiellement des services ou hôpitaux de petite taille ayant une très faible activité, évoquée par les orateurs précédents ? Il faut sortir de cette contradiction ! Autant la proximité est un impératif s’agissant de l’accès à un médecin traitant et à une réponse sanitaire de première intention, y compris médico-sociale et quelquefois sociale, autant, pour l’accès à un plateau technique, la seule exigence qui vaille est celle de la qualité et de la sécurité.
Soyons pragmatiques, sortir du territoire de proximité pour une hospitalisation spécialisée ne menace en rien l’accès aux soins ! D’ailleurs, en dépit du coût, nos concitoyens – comment les en blâmer ? – souhaitent avant tout pouvoir bénéficier des soins des meilleurs spécialistes de leur pathologie et n’hésitent pas à parcourir des kilomètres pour se faire soigner dans les meilleures conditions.
Peut-on enfin ignorer l’évolution de l’exercice médical, davantage spécialisé, et les graves difficultés de recrutement que rencontrent les structures hospitalières de petite taille ? Aujourd’hui, les jeunes professionnels privilégient dans leur choix la possibilité d’exercer en équipes pluridisciplinaires au sein d’un même établissement.
La loi HPST avait bien des défauts, mais elle a facilité les coopérations intéressantes entre établissements, en rénovant les GCS, les groupements de coopération sanitaire, et en créant les communautés hospitalières de territoire. Ces CHT permettent à des établissements publics, principalement de taille moyenne, de développer une stratégie territoriale commune, largement évoquée précédemment, sur la base d’un projet médical partagé avec d’autres établissements, tout en conservant leur indépendance fonctionnelle. Ces communautés fonctionnent et ont parfois permis de maintenir de hautes compétences sur certains territoires.
En réalité, vous l’avez dit, madame la ministre, la véritable question qui nous est posée aujourd’hui est celle de la place et du rôle de l’hôpital dans notre système de soins. À l’image du monde dans lequel il évolue, l’hôpital public, souvent présenté comme le miroir d’une société, se trouve aujourd’hui écartelé entre des exigences contradictoires. D’un côté, les urgences hospitalières accueillent de plus en plus de personnes âgées ou démunies, nécessitant une prise en charge globale qui dépasse les soins purement médicaux. De l’autre, la médecine hospitalière, pour les soins dits programmés, devient de plus en plus technique, spécialisée et coûteuse.
Alors que faire ? Décréter un moratoire, comme vous le proposez, et réfléchir ? Je crois, mes chers collègues, que nous avons déjà suffisamment réfléchi. Le diagnostic a été posé par de trop nombreux rapports et les pistes ne manquent pas. Il faut maintenant agir !
Vous avez présenté, madame la ministre, la stratégie nationale de santé, par laquelle vous entendez réaffirmer la place du service public hospitalier et inscrire celui-ci dans le parcours de soins. Les lignes sont encore assez floues, et nous attendons avec impatience leur traduction concrète dans cette grande loi de santé publique que vous nous aviez promise pour l’an dernier.
J’aimerais rappeler que l’hôpital n’a pas vocation à être le lieu où convergeraient, par défaut, tous les problèmes qui ne peuvent trouver de réponse organisée en amont ou en aval. L’hôpital est là pour fournir, au bon moment, un apport puissant de compétences cliniques et techniques.

M. Gilbert Barbier. Cela ne veut pas dire que toutes ses compétences doivent être concentrées sur quelques grands plateaux techniques. Les ex-hôpitaux locaux et les centres hospitaliers sans plateau technique peuvent trouver leur place dans une offre de proximité. Leurs missions sont importantes : appui des maisons de santé, participation à la formation des médecins généralistes, lien étroit avec la médecine de ville, gériatrie de premier niveau, médecine polyvalente
Mme Catherine Deroche opine.

C’est bien pour cela qu’il ne faut pas fermer la porte à toute évolution des structures, dont un trop grand nombre a encore besoin d’adaptations, voire de mises aux normes. Ces évolutions doivent pouvoir se faire dans la concertation, avec la qualité des soins pour seule règle. Aussi, très majoritairement, le groupe RDSE ne soutiendra pas votre proposition de loi, madame la rapporteur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Laurence Cohen et Dominique Watrin vous ont exposé largement les raisons pour lesquelles un moratoire nous semble indispensable. Je ne reprendrai pas l’ensemble des arguments en ce sens, mais je veux, par des exemples précis, rendre plus palpable encore l’urgence qu’il y a à adopter aujourd’hui cette proposition de loi.
En effet, certains sont, aujourd’hui encore, tentés de croire que la taille des hôpitaux est une question centrale en matière tant de sécurité que de rationalisation de l’offre de santé. Il fallait en finir avec les hôpitaux de proximité nécessitant des investissements lourds, il fallait donc aller vers des hôpitaux géants, organisés comme des entreprises high tech. Pour autant, ces derniers ne sont pas exempts de toute critique. Ainsi, l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, ou l’hôpital privé issu de la fusion des hôpitaux Ambroise-Paré et Paul-Desbief à Marseille, qui sont des hôpitaux qualifiés d’« européens », permettent, il est vrai, des économies d’échelle, une rentabilisation accrue des matériels comme d’ailleurs des patriciens et des personnels infirmiers. Mais, dans le même temps, ils assèchent l’offre de soins dans un périmètre qui dépasse souvent la limite fixée comme tolérable des quarante-cinq minutes nécessaires à un patient pour se rendre de son domicile à l’établissement qui pourra le prendre en charge.
Malgré ce gigantisme, force est de constater que dans les classements de qualité publiés chaque année par la presse, ils ne brillent pas. Ces classements sont sans doute contestables, mais ils en valent bien d’autres, tels ceux qui ont servi à dénigrer la plupart des hôpitaux de taille modeste implantés sur nos territoires…
Ainsi dans celui du Point, Georges-Pompidou n’est que vingt-septième sur le plan national, sur un éventail de vingt-quatre pathologies, et Marseille, qui fait un beau tir groupé avec la trente-troisième place pour l’hôpital privé Saint-Joseph, la trente-quatrième pour l’hôpital de la Timone et la trente-neuvième pour l’hôpital Nord, attendra le prochain classement pour savoir si l’hôpital privé européen atteindra des objectifs plus ambitieux.

Comment croire qu’une croissance ramenée cette année à 2, 4 % de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, le fameux ONDAM, pourrait déboucher sur une amélioration de l’offre de soins ? La seule « solution » qui reste à la portée des directeurs d’établissement réside dans la compression de la masse salariale, accompagnée des fermetures de services à la rentabilité insuffisante et de nouvelles suppressions de lits.
Dans les Bouches-du-Rhône, tous les hôpitaux publics de proximité sont asphyxiés par les restrictions budgétaires, les déficits parfois virtuels, les plans de retour à l’équilibre. C’est vrai à Aix, à Arles, à Martigues ou à Aubagne, malgré la mobilisation des collectivités territoriales, de leurs élus, qui savent les besoins et les contraintes de leurs populations.
Plus récemment, ce sont les structures psychiatriques publiques Valvert, Montperrin et Édouard-Toulouse qui se sont vu fragiliser et qui ont été contraintes à des choix préoccupants pour l’accueil dans de bonnes conditions des patients dans ces hôpitaux.
Avec un déficit cumulé avoisinant les 300 millions d’euros, une dette de 1 milliard d’euros, pour un budget de 1, 2 milliard d’euros, c’est le centre hospitalier régional de Marseille lui-même qui est désormais menacé.
De restructuration en restructuration, la dimension universitaire fait de plus en plus figure de parent pauvre de la carte hospitalière marseillaise, qui pourrait à très court terme se retrouver avec seulement deux sites CHU, et ce alors que la deuxième ville de France a par ailleurs une tradition reconnue internationalement en recherche médicale universitaire.
Ne croyez pas que je noircisse le tableau : nous avons combattu la volonté de fermer l’hôpital sud Sainte-Marguerite, et il est encore en service. Mais à quel prix ! Il a perdu son service d’urgences, a fermé son service de médecine chirurgie obstétrique, ce dans un périmètre géographique où sont implantées pas moins de vingt-six cliniques privées.
Là aussi, la « rationalisation » profite au secteur privé, dont le développement et la richesse sont pourtant en fait directement dépendants de notre politique publique d’accès aux soins et de leur remboursement par la sécurité sociale.
Mais, comme cela ne suffisait pas, le projet régional de santé a intégré dans ses préconisations la fermeture de l’hôpital de la Conception. Devant le tollé provoqué par cette nouvelle, l’Agence régionale de santé, l’ARS, a fait machine arrière, non sans avoir au préalable fermé le service des urgences.
La création d’une mission de chirurgie ambulatoire confiée à l’établissement de la Conception a servi par ailleurs à un jeu de chaises musicales, avec des lits et des services transférés entre les différents hôpitaux de Marseille, contribuant toujours davantage à la spécialisation au détriment de la pluridisciplinarité.
Le cœur de tous ces changements n’est à l’évidence pas la réponse aux besoins de la population marseillaise.
En revanche, dans ces établissements hospitaliers géants se regroupent les services fermés ailleurs.
Dans le même temps, l’hôpital Nord, qui rayonne sur les quartiers les plus populaires de la ville, lesquels concentrent une population importante souvent confrontée à la précarité dans l’emploi, le logement, l’éducation ou la culture, vient de se voir amputé de son centre d’odontologie et devrait voir – sauf à voter ce moratoire que nous vous proposons – fermer à l’horizon 2016 ses deux unités de chirurgie pédiatrique et ses cinq lits de réanimation pédiatrique. De l’aveu des médecins et des médecins anesthésistes eux-mêmes, cela hypothéquerait l’existence des urgences infantiles et des services de pédiatrie dans le secteur où le nombre d’enfants est le plus important de la ville.
Cette aberration, parmi d’autres, est contestée par la communauté aussi bien médicale que sociale, syndicale ou politique, mais l’ARS, forte de votre soutien, madame la ministre, campe toujours sur une attitude pour le coup dogmatique où le comptable prime les besoins en santé.
Si je disposais de plus de temps, j’aurais pu aussi vous entretenir des menaces qui pèsent sur l’hôpital Beauregard, qui ne dispose toujours pas d’un projet médical, alors que celui-ci aurait dû être mis en œuvre à compter du 1er janvier.
J’aurais pu vous parler des menaces qui pèsent sur les centres de santé du Grand conseil de la mutualité, qui participe largement, à Marseille, à l’offre de soins.
Je pourrais aussi vous parler de la lutte des sages-femmes, de l’inquiétude – des femmes, en particulier – quant au devenir des centres d’IVG.
Voter ce moratoire nous laisserait le temps d’engager enfin un réel débat démocratique dans nos territoires avec l’ensemble des acteurs sur une politique de santé répondant réellement aux besoins des patients, avec des équipes médicales mobilisées et des équipements modernes alliant proximité et excellence technique. Cela nous paraît une sage politique.
Certes, nous mesurons combien cette proposition de loi a un objectif limité au regard de l’enjeu, mais j’ai la faiblesse de penser que le Sénat peut, ici et maintenant, contribuer au changement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et au banc des commissions.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi dont notre collègue Laurence Cohen est rapporteur permet d’engager un débat – ce qui est déjà très bien – sur l’organisation de notre système de santé en posant le sujet des restructurations hospitalières, avec suppression de lits ou non.
Nous sommes nombreux – nous sommes même unanimes – à reconnaître que ce sujet est urgent, qu’il soulève de vraies questions. Cependant, pour beaucoup d’entre nous, la solution proposée semble inadaptée.
En ce qui me concerne, madame la rapporteur, j’adhère à votre rapport quand vous valorisez l’excellence de l’hôpital public – ce qui a d’ailleurs été souligné également par Mme la ministre –, quand vous demandez que soit approfondie la valeur « service public hospitalier » et que soit revue la gouvernance des hôpitaux, ainsi que la nécessité de redonner de la vitalité à la démocratie sanitaire.
La question des restructurations hospitalières est réelle, mais elle doit être intégrée dans une refondation en profondeur de notre système de santé, lequel doit notamment prendre en compte, de manière obligatoire, l’organisation des soins autour des patients, tout en garantissant l’égalité d’accès.
Le soin de premier recours ne peut être dissocié de ce débat.
Beaucoup d’entre nous se sont largement exprimés sur ce sujet et, madame la ministre, vous avez mis en valeur tout ce qui a déjà été fait dans le cadre de la stratégie de santé.
À l’instar de nombreux élus de nos territoires, Mme la rapporteur évoque la fonction d’aménagement du territoire des hôpitaux ainsi que leur rôle d’employeur. Si c’est une réalité et si le sujet de l’emploi hospitalier, en particulier, doit être au cœur de nos préoccupations, ce constat ne doit pas pour autant être un préalable à notre discussion.
L’exigence qualitative de l’offre de soins a été exprimée avec force par toutes les personnes auditionnées. Le représentant du conseil de l’Ordre, parmi d’autres, nous disait qu’il envoyait ses patients là où lui-même souhaiterait être hospitalisé. Le nouveau directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris – Jacky Le Menn l’a déjà cité –, au regard des progrès médicaux, témoigne que l’inertie joue contre l’hôpital et indique que le système de santé doit rester vivant, en particulier le système hospitalier.
La prise en charge des patients évolue beaucoup au regard des progrès de la médecine. Notre collègue Gérard Roche évoquait le changement de cap concernant la prise en charge de l’infarctus du myocarde. Les techniques chirurgicales, grâce notamment aux progrès de l’imagerie médicale, ont beaucoup évolué et ont permis des temps d’hospitalisation souvent beaucoup plus courts, ce qui entraîne de fait la valorisation de la chirurgie ambulatoire, la réorganisation des lits chirurgicaux et, constatons-le, la réduction de leur nombre.
Pour autant, une courte hospitalisation ne veut pas dire que le patient retrouve son autonomie dès son retour à domicile. Des propositions de suivi, en concertation avec les professionnels de santé de premier recours, peuvent être mises en place par des consultations organisées dans les hôpitaux de proximité par exemple.
Nous devons faire preuve d’imagination, d’une grande vigilance concernant ces hôpitaux de proximité, qui peuvent être des lieux d’accueil, de consultation, en amont ou en aval d’actes plus lourds effectués dans des établissements plus spécialisés.
Mes collègues ont également évoqué tout ce qui peut être pratiqué dans ces hôpitaux de proximité. Leurs équipes soignantes doivent pouvoir travailler en étroite collaboration avec les hôpitaux plus importants afin que les progrès médicaux perdurent et que les pratiques médicales puissent s’améliorer continuellement.
Il s’agit en fait de développer des coopérations intelligentes. Madame la ministre, vous y avez consacré une large part de votre intervention.
Par ailleurs, – et cela n’a pas été évoqué – je voudrais souligner, au sujet de la question de l’éloignement entre le lieu de résidence du patient et l’établissement hospitalier de prise en charge, que nous disposons en France d’une médecine préhospitalière de très grande qualité, qu’il convient de conforter en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers, qui sont souvent à nos côtés dans ces occasions.
Madame la rapporteur, l’article 1er de votre proposition de loi traite de la question des regroupements hospitaliers, les communautés hospitalières de territoire, créées par la loi HPST, mais vous avez peu évoqué ce sujet dans votre rapport.
Les communautés hospitalières de territoire doivent pouvoir offrir, sur leur aire géographique d’implantation, une prise en charge globale des patients, mais aussi permettre d’aborder l’excellence. Cela suppose des négociations très approfondies entre les différents acteurs concernés. Le sujet n’est pas aisé : ainsi, un hôpital peut perdre le leadership sur la prise en charge d’une pathologie, celle-ci étant confiée à un hôpital plus performant.
Ces démarches sont nécessaires, elles sont longues, difficiles, mais urgentes à conduire – pour présider une conférence de territoire, je peux vous dire que le sujet est ardu. Elles doivent être abordées en tant que coopération, avec exigence de formation, de permanence des soins et également de recherche.
Dès lors, le moratoire, tel que vous le proposez, madame la rapporteur, n’est pas adapté. En effet, il est important d’avancer. Pour autant, la démocratie sanitaire doit s’exercer. Si le colloque singulier reste la relation essentielle entre le patient et son médecin, prenons en compte l’évolution de notre système de santé vers une médecine populationnelle avec l’intervention de différents acteurs, ce qui nécessite des regroupements pluriprofessionnels ainsi que la prise en compte des questions sociales.
Notre collègue Jacky Le Menn a indiqué que le groupe socialiste ne votera pas cette proposition de loi compte tenu du caractère inadapté de la solution proposée. Pour autant, je vous remercie, madame la rapporteur, d’avoir permis le débat.
Mme Nathalie Goulet s’exclame.

Nous avons le devoir d’exprimer notre exigence de démocratie sanitaire et de ses modalités d’application. En particulier, l’ensemble des personnels hospitaliers doit pouvoir être associé, à côté des autres acteurs, à la discussion en amont avant toute réorganisation.
Une démarche de procédure qualité peut être une piste de réflexion de travail. L’égalité d’accès à des soins de qualité est un droit premier de notre République. Le sujet, madame la ministre, sera traité dans le cadre du projet de loi de santé publique, que nous attendons tous avec impatience. Je connais votre volonté d’élaborer celui-ci dans la concertation. Vous serez demain à Lille pour traiter du sujet, vous serez également présente au centre hospitalier de Lens, dont la situation a été évoquée par notre collègue Dominique Watrin, parce que vous connaissez bien le territoire.
Je voudrais vous dire, madame la ministre, que nous comptons sur votre détermination, sur votre engagement, pour que l’examen de ce projet de loi de santé publique soit rapidement inscrit à l’ordre du jour des travaux parlementaires.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Nous venons d’avoir un débat de qualité. Qu’il me soit permis néanmoins de réagir rapidement à certaines prises de position.
Je dirai à Mme Isabelle Pasquet, qui a inscrit logiquement son intervention dans le prolongement de celles de M. Watrin et de Mme Cohen, que la taille n’est pas un critère. Madame la sénatrice, vous avez beaucoup argumenté autour de cette idée. Selon vous, notre seule exigence serait de supprimer les petites entités au profit de plus grandes. La question du service public hospitalier se poserait donc dans les mêmes termes aujourd'hui qu’il y a quelques années. Dois-je vous rappeler que l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, fait partie du service public hospitalier ? La taille n’a par conséquent pas grand-chose à voir avec l’enjeu.
Vous avez indiqué que cet hôpital était moins bien classé, non pas par rapport à certaines petites structures, mais par rapport à d’autres établissements de taille importante, qui sont tous des CHU concentrant des moyens significatifs. Ce qui est intéressant dans les palmarès que vous citez, qui valent ce qu’ils valent, c’est que l’on retrouve très régulièrement en tête de classement des établissements régionaux.
L’hôpital Georges-Pompidou doit peut-être s’améliorer dans certains secteurs. Quoi qu’il en soit, nous lui devons la première implantation mondiale d’un cœur artificiel…
… grâce à la ténacité et à l’engagement d’un grand serviteur du service public hospitalier, le professeur Carpentier, lequel n’a pas pour autant omis de nouer des contacts avec des industriels et des acteurs de l’innovation capables de développer la prothèse qu’il avait conçue.
Madame la sénatrice, il ne s’agit pas d’opposer les petites structures aux grandes ; là n’est pas le problème dans notre pays. Il s’agit bien plutôt de faire en sorte, dans les territoires qui ne peuvent être évidemment dotés de grandes structures – je pense, notamment, aux zones rurales –, que les petites structures développent les coopérations, comme vous avez été nombreux à le souligner, avec des hôpitaux de référence, afin d’éviter de grands déplacements pour effectuer des actes médicaux quotidiens et aisés ne nécessitant pas une très grande spécialisation.
Madame Archimbaud, je suis extrêmement sensible à l’argument que vous avez mis en avant d’une plus grande démocratie sanitaire. Je suis persuadée que le développement de nos politiques de santé, qu’il s’agisse de santé publique ou d’organisation des soins, implique un renforcement des mécanismes et des structures de la démocratie sanitaire.
La loi qui mettra en place la stratégie nationale de santé, à laquelle je travaille, comportera un pilier explicitement relatif au développement de la démocratie sanitaire. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a évidemment marqué une étape décisive en ce sens. Elle a posé une première pierre - et quelle pierre ! - à l’édifice, puisqu’elle a mis en exergue les droits individuels. Nous devons aujourd'hui développer les droits collectifs, notamment à partir de l’idée de la coconstruction, de la coopération entre les acteurs.
Cela ne signifie pas que les usagers disposeront nécessairement d’un droit de veto, pas plus qu’ils n’auront le dernier mot, mais leurs paroles doivent être entendues et intégrées dans les processus de décision. C’est un point auquel j’attache une très grande importance. En cela, je rejoins Catherine Génisson : la question de la démocratie sanitaire renvoie non pas seulement aux enjeux de santé publique, mais bien à l’organisation du système de soins.
Mettre en avant la prévention, cela signifie que les professionnels de santé, notamment pour la médecine préhospitalière, que je soutiens dans sa démarche, doivent avoir désormais une approche « populationnelle » et ne doivent pas simplement se concentrer sur la relation singulière entre le médecin et son patient.
Les médecins doivent désormais prendre en charge l’évolution en santé publique d’un bassin de vie, d’une population entière. Cela participe aussi de notre approche d’une démocratie sanitaire renforcée.
Monsieur Savary, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt votre intervention, notamment la référence que vous avez faite à une tribune publiée dans un journal du matin, Libération, où Claude Évin mettait en avant les principes de la stratégie nationale de santé, ce qui est bien naturel de la part du directeur général de l’agence régionale de santé de la plus grande région de France.
La mise en œuvre des principes de la stratégie nationale de santé se fera autour du développement de la prévention et de la réorganisation de l’offre de soins. Vous avez parfaitement exposé, monsieur le sénateur, les orientations qui seront celles de la stratégie nationale de santé, au sujet de laquelle vous espérez des précisions. Nous ne manquerons pas de vous les fournir. En tout état de cause, puisque vous approuvez le principe de cette démarche, j’espère que nous pourrons compter sur votre soutien lors de l’élaboration de la loi.
D’ailleurs, cette loi me paraît de nature à susciter autour d’elle un large consensus, car, en matière de santé, nous devrions tous être capables de dépasser les clivages qui nous opposent habituellement, dans cet hémicycle en particulier.
Gérard Roche a raison de mettre l’accent sur la qualité. Au fond, c’est cette exigence qui doit nous guider. La qualité peut être au rendez-vous aussi bien dans les grandes que dans les moins grandes structures, mais aucune d’entre elles ne peut être privilégiée au détriment de la qualité. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner ici même, j’ai été amenée à demander la fermeture, il y a quelques mois, d’un établissement d’Île-de-France qui n’apportait pas toutes les garanties en matière de sécurité et de qualité des soins à nos concitoyens, en l’occurrence, à nos concitoyennes, puisqu’il s’agissait d’une maternité . L’établissement a rouvert ses portes dès qu’il a de nouveau satisfait aux critères de qualité. À l’inverse, j’ai maintenu ouvertes des maternités - je pense en particulier à l’une d’entre elles, dans la Drôme-, qui satisfaisaient aux critères de sécurité, sans toutefois répondre aux exigences habituelles en termes de taille, de nombre d’accouchements ou d’effectifs de professionnels.
Vous le voyez, madame Pasquet, je ne me préoccupe pas uniquement du quantitatif et je prends bien en compte le qualitatif.
M. Jacky Le Menn a parfaitement indiqué les enjeux et les réponses à apporter. Nous avons la volonté de faire vivre le service public hospitalier. Or, justement, un service public vivant doit s’adapter aux réalités de la société. Il s’agit de mettre en exergue la pertinence des soins et des actes, de déterminer des critères de réorganisation tenant compte des mouvements de population, du vieillissement de celle-ci, du développement de certaines maladies chroniques.
C’est dans sa capacité à établir des relations avec les médecins de ville, avec les établissements de soins de suite et avec les établissements médico-sociaux que se joue la vitalité de l’hôpital public. Mettre de plus en plus l’accent sur des soins de proximité n’est pas contradictoire avec la volonté de faire de l’hôpital un lieu de coopération, un lieu de recours. De ce point de vue, Jacky Le Menn a parfaitement souligné les orientations que nous devons suivre.
Enfin, je terminerai en disant à Gilbert Barbier que toutes les questions qu’il aborde se trouvent au cœur de la stratégie nationale de santé, qui doit être approfondie. Actuellement, vous le savez, monsieur le sénateur, de nombreux débats sont organisés dans les régions. D’ici à la fin du mois de février, près de deux cents débats auront eu lieu. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution, dans une démarche démocratique : populations, élus, acteurs de santé, établissements de santé, professionnels. De cette manière, pour reprendre l’excellente formule de Jacky Le Menn, nous parviendrons à trouver cet équilibre qui, par définition, se déplace, entre sécurité, proximité et efficacité.
C’est grâce à la manière dont nous parviendrons à articuler ces exigences toutes d’égale importance, que nous serons capables de répondre aux besoins de la population.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la ministre, ce débat est effectivement très intéressant, qui met l’hôpital, la santé publique et la conception que chacun s’en fait au cœur de nos échanges.
Je profiterai de l’occasion qui m’est offerte pour redire ici, une bonne fois pour toutes, car plusieurs de mes collègues et même Mme la ministre ont déploré cet état de fait, que, si nous n’avons pu examiner en séance le volet « dépenses » du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c’est que tous nos amendements proposant de nouveaux financements pour la santé ont été rejetés.

À partir de là, et puisque les recettes étaient largement insuffisantes par rapport aux besoins de santé, nous ne pouvions accepter de poursuivre plus avant l’examen du texte.
Au sein du groupe CRC, nous assumons cette position, et nous prenons la pleine et entière mesure de notre responsabilité.
Si nous pouvions aboutir, au sujet des financements, à une collaboration de l’ensemble des groupes de la majorité, nous parviendrons peut-être à nous retrouver dans un vote commun.

Certes, plus de 1 milliard d’euros ont été consacrés à l’hôpital public. Néanmoins, le groupe CRC n’est pas le seul à avoir noté que l’ONDAM était dramatiquement insuffisant ; et ce ne sont pas nécessairement les personnes les plus radicales dans leurs propos qui l’affirment : même la Fédération hospitalière de France le relève !
Les moyens accordés aujourd'hui, notamment à l’hôpital, mais pas seulement, sont insuffisants. C’est pourquoi nous continuons à défendre l’idée selon laquelle il faut partir des besoins de la population et des territoires, et y répondre.
Je me réjouis que plusieurs de mes collègues - et vous-même, madame la ministre -, aient insisté sur le bien-fondé de la démarche qui consiste à faire vivre la démocratie sanitaire.
J’attire cependant votre attention sur un point. Dans cet hémicycle, nous sommes tous d’accord quand il s’agit d’accorder la priorité à la qualité des soins, ce qui me semble tout de même un minimum. Quoi qu’il en soit, nous sommes d’accord, c’est déjà très bien ! Néanmoins, quand nous parlons de démocratie sanitaire, nous le faisons après coup. En tant que sénatrice, j’ai été amenée à visiter, comme chacun d’entre nous ici, un certain nombre d’établissements. Tout dernièrement, je me suis rendue à la maternité des Lilas et à l’Hôtel-Dieu, où j’ai entendu des personnels, des usagers, des élus avancer des propositions alternatives afin de sortir des schémas dépassés, ou des schémas du passé, comme vous préférez, et d’inscrire l’hôpital dans le XXIe siècle. Or toutes ces consultations ne sont jamais prises en compte.
Aujourd'hui, les ARS ont la mainmise, leurs directeurs disposent d’un pouvoir exorbitant et il n’y a pas de contre-pouvoir.
Je me réjouis de ce que la nouvelle loi de santé publique prenne en considération ce volet, mais je me demande pourquoi mes collègues, et le Gouvernement, ont peur d’un moratoire. C’est un outil et non un moyen de tout figer, comme certains le prétendent ici !
Aujourd'hui, nous dénonçons tous le numerus clausus, mais les avis n’étaient pas aussi concordants lorsqu’il a été instauré, dans les années soixante-dix, sous Chaban-Delmas et Pompidou, ni quand il a été aggravé au fil des années, quels que soient d’ailleurs les gouvernements.
Aujourd'hui, tout le monde s’accorde pour reconnaître que l’on manque de médecins. Je ne voudrais pas que, demain, contraints à la même analyse cette fois concernant les restructurations et les fermetures de services, nous n’ayons plus qu’à nous lamenter sur les conséquences de ce que nous aurons laissé faire. Bien sûr, je ne sous-estime pas la nécessité des pôles d’excellence, des plateaux techniques performants, dans l’intérêt des patients, notamment de leur sécurité. Mais cela n’est pas en contradiction – vous l’avez dit, madame la ministre – avec des hôpitaux de proximité, dont on a aujourd'hui besoin. En effet, s’il n’y a plus d’hôpitaux de proximité, où les gens iront-ils se faire soigner ?
On peut aussi envisager des équipes médicales mobiles. Les populations ne sont pas les seules à pouvoir se déplacer, les médecins et les équipes peuvent également le faire.
Voilà des points qu’il me semble important de souligner.
En proposant ce moratoire, le groupe CRC ne cherche pas à défendre l’emploi pied à pied. Se définir comme communiste républicain et citoyen n’implique pas d’être complètement figé dans des positions dogmatiques ou de principe. Il faut cesser ces caricatures !
Sur l’ensemble de ces travées, nous sommes tous d’accord – pour le coup, c’est formidable, il y a un vrai consensus ! – sur la nécessité de répondre aux besoins de santé. Peut-être ai-je une oreille sélective, mais j’ai entendu dire – de la part des usagers, des personnels, des élus –, que, pour répondre aux besoins de santé, il fallait des moyens, financiers mais aussi humains.
Lors de mes déplacements en région, à l’occasion de visites d’établissements hospitaliers, j’ai entendu les personnels se plaindre du manque d’effectifs et dire qu’ils n’en pouvaient plus, et ce n’est pas seulement parce que je suis sénatrice du groupe communiste républicain et citoyen, je pense que vous avez tous recueilli les mêmes témoignages, chers collègues.
Alors, certes, l’emploi n’est pas mis en exergue dans le corps de la proposition de loi, mais relisez l’exposé des motifs, et vous verrez que cette préoccupation est bien présente dans notre démarche. Et pourquoi faudrait-il s’en défendre ? L’emploi n’est pas un gros mot, tout de même ! Il faut effectivement des personnels pour faire vivre un système hospitalier digne de ce nom.
Qu’il faille faire preuve d’imagination, d’audace, soit ! Cependant, chers collègues, quand vous soutenez que la question qui est ici soulevée est bonne, ce dont je me réjouis, mais que la réponse apportée est mauvaise, je m’interroge : et votre réponse ? C’est curieux, je ne l’ai pas entendue !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
À compter de la promulgation de la loi n° … du … tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement, et jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée, plus aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire.
La commission médicale d’établissement et le Comité Technique d’Établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence Régionale Santé qui en tire toutes conséquences utiles.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaiterais me faire l’écho d’un exemple concret, celui de l’hôpital de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, car il illustre bien les raisons qui nous poussent, aujourd'hui, à demander ce moratoire.
Certes, le projet de nouvel hôpital public-privé a, heureusement, été abandonné tant il affaiblissait le secteur public. Ce n’est malheureusement pas le cas à Jossigny, où le nouvel hôpital est inauguré demain et où l’excellent service public de radiothérapie va disparaître. Et ce n’est pas le cas non plus pour le futur hôpital de Melun, au sujet duquel nous nourrissons quelques inquiétudes.
Mais, à Fontainebleau, l’affaiblissement de l’offre de soins s’est traduit, dans un premier temps, par la fermeture de quinze lits de chirurgie à la fin de 2011, occasionnant des difficultés incessantes de prise en charge des patients accueillis aux urgences. Des secteurs d’activité sont encore fragilisés ou sont menacés de disparition par le non-remplacement des praticiens, comme en ophtalmologie, en pédiatrie ou en oto-rhino-laryngologie
Aucun effort n’a été observé par les personnels pour recruter des chirurgiens urologues malgré l’importance du nombre des patients relevant de cette spécialité qui consultent à l’hôpital, en général en garde, dans le service des urgences.
Les services de chirurgie voient, chaque jour, se réduire leurs possibilités de répondre à la demande de prise en charge.
En 2013, au centre hospitalier de Fontainebleau, le budget pour les emplois précaires n’a jamais été aussi élevé, alors qu’il faudrait recruter et titulariser pour bénéficier d’équipes stables.
Cette politique à court terme, purement comptable, dégrade la qualité et réduit l’offre de soins. Où se situe le changement de politique ? Apparemment, à Fontainebleau, on le cherche encore…
La situation est grave et, comme dans bon nombre d’hôpitaux, un divorce profond s’installe entre les personnels et l’autorité, qui agit et décide contre eux et contre leur mission de soins.
C’est notamment pourquoi, exaspérés, de nombreux petits praticiens de cet hôpital soutiennent, comme beaucoup d’autres en Seine-et-Marne, d'ailleurs, notre proposition de moratoire, non pour figer la situation, qui est intenable, mais pour avoir le temps de ramener de la sérénité et de redéfinir un véritable projet de service public pour cet hôpital, avec les moyens financiers et humains nécessaires à sa mise en œuvre.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, avant d’en venir à l’article 1er de cette proposition de loi, évoquer certains événements qui se sont déroulés le weekend dernier.
Comme beaucoup de parlementaires et, j’ai envie de dire, comme bon nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes, j’ai été particulièrement choquée par la manifestation organisée dimanche dernier par des militants des mouvements pro-vie, c’est-à-dire, très concrètement, des femmes et des hommes qui veulent refuser aux femmes le droit fondamental de pouvoir décider d’être enceintes ou non, en d’autres termes, le droit de disposer de leur corps, ni plus ni moins !
Cette manifestation fait naturellement écho au débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, mais aussi à ce qui se passe aujourd’hui en Espagne.
En effet, le gouvernement espagnol entend limiter la faculté de recourir aux interruptions volontaires de grossesse aux seuls cas où la femme enceinte fait la démonstration que la grossesse peut mettre en danger sa santé ou sa vie. La loi prévoit également que les jeunes filles mineures ne pourront avorter qu’avec le consentement de leurs parents.
Ces deux mesures, symboliques tout autant que scandaleuses, attestent la conception rétrograde que certains ont des femmes et de leur corps.
En privant les femmes du droit de décider en conscience et en faisant dépendre l’interruption volontaire de grossesse des mineurs du choix de leurs parents, le gouvernement espagnol retire aux femmes la capacité à décider, comme si, après tout, elles n’étaient plus maîtres de leur corps.
Si, en France, nous en sommes loin, les manifestations publiques récentes et les actions « coup de poing », scandaleuses et illégales, menées par des collectifs fanatisés nous rappellent combien il faut être vigilant. Vous avez raison, madame la ministre, de rappeler que la France doit défendre « haut et fort, le droit des femmes à décider ».
Au-delà des déclarations, c’est par les actes que cela doit passer, et il y a urgence à développer les mesures concrètes nécessaires pour rendre effectif le droit des femmes, de toutes les femmes, à accéder à l’IVG. Incontestablement, la mesure adoptée à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est positive, bien qu’elle ne règle pas toutes les difficultés. En effet, des goulets d’étranglement persistent dans certaines zones de fortes demandes à certaines périodes de l’année, notamment lors des congés, qui rendent plus difficile et parfois même impossible l’accès des femmes aux IVG.
Avec mes collègues Laurence Cohen et Brigitte Gonthier-Maurin, j’y vois plusieurs explications.
Tout d’abord, l’acte médical d’interruption volontaire de grossesse reste peu gratifiant pour les équipes médicales. C’est également un acte peu rémunérateur puisque, en dépit de plusieurs revalorisations successives, la tarification de l’IVG instrumentale ne prend en charge qu’une partie du coût réel des interruptions volontaires de grossesse, ce qui décourage, nous le savons, les établissements.
Cela est d’autant plus vrai que, malheureusement, de nombreux centres IVG ont fermé. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a remis, en novembre 2013, un rapport dans lequel il relève que « l’accès à une IVG est parfois problématique ». Est en cause notamment la diminution de l’offre, avec la fermeture, sur les dix dernières années, de plus de 130 établissements de santé pratiquant l’avortement, ainsi que le manque de moyens et de personnels. Le Haut Conseil note aussi l’existence « d’importantes disparités d’accès entre les territoires ».
De fait, pour l’accès à l’IVG, dans notre pays, le désert médical s’étend !
Ce rapport, madame la ministre, contient des pistes intéressantes et souligne l’impérieuse nécessité de « développer une offre de soins permettant aux femmes un accès égal, rapide et de proximité à l’IVG », ce qui, vous en conviendrez, n’est pas tout à fait étranger au contenu de cette proposition de loi. Car seul le service public peut être garant de l’accès de toutes à l’IVG, sans distinction quant au lieu d’habitation ou au statut social.
C’est pourquoi, au nom du droit des femmes à pouvoir conserver la faculté de bénéficier, sur tout le territoire national, d’un droit effectif à l’avortement, je voterai, avec l’ensemble de mes collègues, cet article 1er.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis une élue séquano-dyonisienne. Or la Seine-Saint-Denis est l’un des départements les plus pauvres de France, alors que le taux de natalité y est l’un des plus élevés de notre pays. C’est dire si les besoins en matière de santé sont grands, notamment pour ce qui est des tarifs opposables avec application du tiers payant.
Oui, nous sommes de celles et de ceux qui veulent des actes et il y a des défis à relever en matière de santé !
Aujourd'hui comme hier, la Seine-Saint-Denis n’est pas épargnée par les politiques comptables et financières mises en œuvre par les agences régionales de santé. Certains établissements publics sont durement frappés – je pense particulièrement à l’hôpital Avicenne –, mais des établissements privés le sont tout autant, par exemple l’hôpital européen de La Roseraie, sur lequel je vais revenir dans un instant.
Je voudrais d’abord avoir une pensée pour la maternité des Lilas, déjà évoquée, dont le collectif de défense se mobilisera le 24 janvier prochain afin d’en empêcher la fermeture. Vous le savez, madame la ministre, vous connaissez le dossier, le déficit de cet établissement n’est pas structurel, il est la conséquence – comme l’a justement rappelé mon collègue Dominique Watrin – des consignes données et exécutées par l’ARS.
Mais je pense aussi à l’hôpital européen de La Roseraie, à Aubervilliers, qui vient tout juste de déposer le bilan. Madame la ministre, cette annonce a suscité une véritable émotion parmi le personnel et les patients, bien évidemment, mais, plus largement, parmi la population albertivillarienne et, au-delà, dans la population séquano-dyonisienne.
Au-delà de la dimension sociale, puisque l’établissement salarie quelque 600 personnes, se pose bien évidemment la question sanitaire, à laquelle, madame la ministre, vous devez répondre.
Si la situation est préoccupante en Seine Saint-Denis, elle l’est tout autant dans d’autres départements, comme celui des Hauts-de-Seine. Ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, qui ne peut pas être des nôtres aujourd’hui, m’a indiqué que la fusion des hôpitaux de Beaujon et de Bichat, déjà plus qu’avancée, pourrait, selon toute vraisemblance, entraîner la disparition de 400 à 600 lits.
Cela marquerait un net recul dans l’accès aux soins des populations, d’autant que le schéma qui semble se profiler aujourd’hui, pour parvenir à une telle fusion, passerait par la fermeture pure et simple de l’hôpital Beaujon.
On devine aisément le projet que mûrit la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à savoir – au nom de la fameuse réduction des dépenses – le regroupement au sein de seulement douze structures des trente-sept hôpitaux publics que compte actuellement l’AP-HP.
Nous considérons que cela revient, de fait, à organiser une réduction de l’offre publique de soins de proximité, avec les risques sanitaires que cela peut engendrer.
Madame la ministre, j’illustrerai mes propos par un exemple. Le 4 décembre dernier, un article du Parisien révélait que, à la suite des mesures prises à l’encontre des urgences de l’Hôtel-Dieu, les urgences de Tenon, Saint-Louis, Lariboisière, Bichat, La Pitié-Salpêtrière et Pompidou dépassaient toutes un taux d’occupation de plus de 120 %. Ce taux était de 150 % à Saint-Louis, de 170 % à la Pitié-Salpêtrière, de 185 % à Lariboisière et même de 210 % à Tenon !
Dans ces conditions, c’est bien la qualité des soins et la sécurité sanitaire qui sont remises en cause. C’est pourquoi, dans l’intérêt des populations et des agents publics de l’AP-HP, je voterai en faveur de cet article et de la proposition de loi.
J’ajouterai qu’un moratoire ne se décrète pas. Il ne se décrète pas plus aujourd’hui qu’il ne se décrétait hier. En ce sens, je suppose que, Mme la ministre étant une femme de convictions, son communiqué de 2011 était fondé sur des réalités de fermetures de services hospitaliers et n’avait pas pour objet de faire plaisir à la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité.
Figurez-vous que nous avons, nous aussi, des convictions, que nous défendons d’ailleurs assez bien ! Or il y a encore aujourd’hui des fermetures de services de santé, voire d’établissements : c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette proposition de loi.
Certains orateurs ont parlé de l’adaptabilité, qui serait nécessaire. En disant cela, ils laissent penser, comme Mme la rapporteur l’a d’ailleurs fait remarquer, qu’il y aurait, à droite de l’hémicycle, des parlementaires modernes, et, de l’autre côté, des sénateurs moins modernes, voire ringards…
Comme sénatrice, comme sénatrice communiste et comme présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, je refuse ce genre de propos. Il n’y a pas, d’un côté, les modernes et, de l’autre, les ringards, figés dans leurs dogmes. Revenez sur terre ! Nous sommes au XXIe siècle, Staline est mort depuis longtemps, avant même ma naissance !
Cette vieille rengaine est trop souvent reprise dans cet hémicycle. Cela étant, si elle me met parfois en colère, elle me fait rire, aussi, car elle prouve que ceux qui l’utilisent sont vraiment à court d’arguments.
Alors, non, nous ne sommes pas des ringards. Ce que nous refusons, avec d’autres, c’est la réduction de l’offre de soins, une question qui est – j’en suis désolée, madame la ministre ! – toujours d’actualité.
Si nous demandons un moratoire, c’est tout simplement pour que l’offre de soins de qualité soit effective sur tout le territoire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, j’ai souhaité intervenir dans ce débat parce que j’estime que la pédagogie est aussi affaire de répétition.
Les meilleures intentions ne produisent pas toujours les meilleurs résultats. Nous souscrivons pour l’essentiel aux constats dressés dans l’exposé des motifs de la proposition de loi. De même, nous nous accordons sur les enjeux de la question hospitalière que représentent à la fois l’excellence en matière de soins et l’accès de tous à la santé sur l’ensemble du territoire.
En 2012, les soins hospitaliers ont représenté 46 % de la consommation de soins et biens médicaux, soit le premier poste de dépenses, bien que les séjours hospitaliers ne concernent chaque année qu’environ un dixième de la population.
Nous partageons le constat qui est fait sur la situation des hôpitaux telle que nous l’avons trouvée en mai 2012 : dotations réduites, investissements et endettements incontrôlés, mise en œuvre aveugle de la tarification à l’activité et de la convergence intersectorielle privé-public, « caporalisation » des structures de direction et mise à l’écart des professionnels de santé, découpage du service public hospitalier en missions réparties au gré à gré... Il était urgent d’agir !
C’est ce qu’a fait immédiatement l’actuel gouvernement, qui a décidé, dès novembre 2012, la suppression de ce processus comptable de convergence tarifaire, lequel ignore les différences de cahiers des charges entre établissements publics et privés, qu’il s’agisse des caractéristiques des patients ou de la composition des séjours, mais aussi des actes innovants. Cette décision est qualifiée de « salutaire » dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi.
Dans cette perspective d’accès aux soins, encore faut-il, au-delà, à la fois « réparer » le démantèlement du service public programmé par le précédent gouvernement et répondre aux besoins d’adaptation du système face aux progrès techniques et scientifiques, à l’augmentation des maladies chroniques et au vieillissement de la population.
Ce double défi – consolider le service public hospitalier et l’intégrer dans l’ensemble de notre système de santé – requiert une appréhension globale, décloisonnée et de long terme.
C’est à cette double ambition que répond l’élaboration d’une stratégie nationale de santé, construite sur la solidarité et inscrite dans la durée.
Nul ne le conteste, c'est un vaste chantier, pour le moins complexe, qui prive d’effet toute approche partielle ou univoque. Le Gouvernement a choisi d’agir en même temps sur tous les leviers pour rétablir à la fois le dialogue et la confiance, les équilibres financiers et la notion même de service public hospitalier.
Cela se traduit tout autant par des actions menées sur les coûts, avec le plan « hôpital numérique », la politique du médicament sur les génériques ou le programme PHARE d’achats responsables ; sur les budgets, avec un accès facilité au crédit ou la mise en place d’une stratégie d’investissements encadrée de contreparties de retour à l’équilibre, ou encore sur l’offre territoriale de santé.
Pas plus que le reste, cette dernière ne souffre la simplification : on ne peut se contenter ni d’une défense pied à pied ni d’un objectif de rentabilité de court terme, car tous deux favorisent le recul de l’offre publique au profit de l’offre privée. Les besoins de modernisation et de rationalisation doivent être pesés, territoire par territoire, en concertation avec toutes les parties prenantes. Aucun modèle de rationalité ne s’impose a priori, sinon les exigences de sécurité et de proximité.
Une instruction de la direction générale de l’offre de soins aux directeurs des ARS était annoncée en ce sens concernant les hôpitaux locaux et leur importance dans le champ sanitaire, à la satisfaction – il faut le souligner – de l’Association nationale des médecins généralistes des hôpitaux locaux. Celle-ci estime que cette démarche concertée relève d’« un mouvement plutôt positif ».
Je n’insisterai ni sur la rédaction hasardeuse de l’article 1er de la proposition de loi, qu’il s’agisse tant du champ d’application du moratoire réclamé que de la notion « d’offre de santé au moins équivalente », ni sur son caractère éventuellement inopportun face à certaines situations locales, dont il n’est pas tenu compte.
La notion même de moratoire ne fait pas sens, parce qu’il fallait immédiatement agir et parce qu’un projet de long terme est aujourd’hui construit et à l’œuvre.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je ne peux, avec l’ensemble de mon groupe, que vous appeler à rejeter cette proposition de loi et donc à ne pas voter l’article 1er.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite intervenir au nom de mon collègue Pierre Laurent, sénateur de Paris, malheureusement retenu par d’autres obligations, qui avait prévu d’attirer l’attention du Gouvernement sur la situation de l’hôpital Sainte-Périne, dans le XVIe arrondissement.
Cet hôpital a été à plusieurs reprises le théâtre d’événements dramatiques. Ainsi, en octobre dernier, le corps sans vie d’une patiente a été retrouvé au pied du lit où elle était censée dormir : la septuagénaire avait été étranglée par la ceinture de contention qui devait la maintenir.
Déjà au début de l’année 2013, une patiente de quatre-vingt-douze ans avait été retrouvée morte de froid dans le parc de l’hôpital. La veille, un autre patient atteint de la maladie d’Alzheimer s’était enfui de l’établissement par des portes restées ouvertes. Il avait été retrouvé dans la soirée, dans la rue, à moitié nu.
Les personnels alertent depuis des années sur le manque d’effectifs et les économies qui se font au détriment de la sécurité dans cet établissement.
Madame la ministre, Pierre Laurent vous avait interpellée à plusieurs reprises à ce sujet. Le Conseil de Paris et d’autres élus étaient également intervenus en ce sens. Ainsi Nicole Borvo Cohen-Seat avait, en 2011, interpellé le ministre de la santé de l’époque sur la situation indigne qui prévalait dans cet hôpital gériatrique et que subissaient les personnels et les patients, lesquels pouvaient payaient chaque mois jusqu’à 3 500 euros !
Le fait que cette situation perdure est insupportable. Cela met en lumière de manière crue les conséquences désastreuses des suppressions massives de postes et des restructurations nombreuses que l’AP-HP subit depuis de nombreuses années, entraînant une baisse de la qualité des soins, faute des moyens nécessaires.
Certes, à la suite des événements intervenus à l’hôpital Sainte-Périne, et après les signalements adressés à l’agence régionale de santé d’Île-de- France par les usagers et leurs familles, une mission d’inspection a été mise en place au sein de l’établissement afin de recueillir les éléments qui permettront d’apprécier les conditions de prise en charge des patients et de s’assurer de la sécurité des personnes âgées dépendantes au sein de cet établissement.
Sans préjuger des enquêtes et des procédures en cours, il est toutefois nécessaire que soit décidé un moratoire sur les suppressions de postes et les restructurations à l’AP-HP, la plus emblématique étant celle de l’Hôtel-Dieu. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
La situation de plus en plus inquiétante qui prévaut à l’AP-HP en général, dont l’hôpital Sainte-Périne est l’un des exemples les plus préoccupants, l’exige.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un certain nombre d’arguments avancés contre cette proposition de loi ne nous paraissent pas fondés.
Certains estiment que le texte ne traduit pas de vision globale de la nécessaire réforme du système de santé. Certes, mais il me semble que ce n’est pas le rôle des parlementaires que de proposer une politique générale relative à un secteur entier de l’action publique ; les propositions de loi ont, bien au contraire, vocation à traiter de points précis.
D’autres avancent l’idée que la santé publique est une question tellement complexe qu’un simple moratoire ne peut régler le problème. Nous sommes bien d’accord ! Néanmoins, là aussi, ce n’est pas ce qu’il faut attendre d’une proposition de loi ni d’un parlementaire.
Par ailleurs, le moratoire est souvent présenté comme un dispositif qui engendrera forcément de l’immobilisme et un gel des positions durant des années, sans possibilité d’agir de quelque manière que ce soit. Mais ce n’est pas du tout notre vision des choses !
J’ai entendu la réponse très encourageante de Mme la ministre. Si j’ai bien compris, elle est sensible à l’idée qu’il est nécessaire de développer la démocratie sanitaire, une question qui devrait assez largement être abordée lors du débat sur la future loi de santé publique.
Le groupe écologiste n’aurait pas voté l’exposé des motifs de cette proposition de loi parce que nous ne nous retrouvons pas dans l’analyse qui y est faite. En revanche, nous voterons le dispositif proposé, avec l’idée qu’il pourrait être amendé à l’Assemblée nationale, au moins pour en limiter la durée, afin de ne pas geler les positions.
Pour nous, ce dispositif est un appel à la démocratie dans une période d’inquiétudes, à un moment où les territoires ont besoin que des stratégies sanitaires soient élaborées de façon démocratique.
Madame la ministre, mon collègue Claude Dilain vous a interpellée mardi matin à propos de la fermeture envisagée d’un service de l’hôpital Avicenne, à Bobigny. J’estime que les élus locaux et les usagers doivent être associés à ces décisions. J’ai cité les conférences de territoires, qui aujourd’hui malheureusement ne sont pas très actives. Je ne sais pas si ces conférences sont la bonne formule, mais nous avons en tout cas besoin d’espaces de discussion.
Le groupe écologiste votera donc cette proposition de loi, dans laquelle il voit un appel au développement d’une stratégie de démocratie sanitaire, avec l’idée que le texte pourrait être ensuite amendé par l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.

Je veux remercier Aline Archimbaud qui semble être l’une des rares, avec les membres du groupe écologiste, à avoir compris l’objectif de notre proposition de loi !
Effectivement, celle-ci aurait pu faire l’objet d’amendements. Cela n’a pas été le choix des différents groupes parlementaires, et nous en prenons acte. Mais n’oublions pas la navette, qui sera peut-être l’occasion pour l’Assemblée nationale d’enrichir notre texte. C’est ce qui est arrivé tout récemment à une proposition de loi de notre collègue député Bruno Le Roux, qui a été améliorée par le rapporteur général de la commission des affaires sociales du Sénat.
Mes chers collègues, vous pourriez tout à fait voter notre texte puisqu’il pourra faire l’objet de modifications !
Je fais miens les propos de mon collègue Yves Daudigny sur les valeurs qui fondent un grand service public hospitalier. Néanmoins, les affirmations ne suffisent pas ; arrive un moment où il faut passer aux actes !
Malheureusement, malgré les prises de position du Gouvernement, nous assistons aujourd’hui à la poursuite de la convergence tarifaire, avec d’ailleurs une baisse des tarifs plus importante dans les hôpitaux que dans les cliniques privées. Disons les choses, il s’agit, en réalité, d’une convergence tarifaire « larvée ».
Que faire pour interdire ce genre de pratiques, qui pénalisent l’hôpital public ?
Permettez-moi une dernière remarque. J’entends à nouveau beaucoup parler de la future loi de santé publique. Comme nous sommes encore en janvier, je forme le vœu que ce texte réponde à toutes les questions que nous nous posons dans cet hémicycle. L’ensemble des membres de mon groupe le souhaitent également de tout cœur, et je pense qu’il en va de même pour les personnels, les usagers et les élus.
Cependant, je constate que, pour l’heure, on nous demande en fait de signer un chèque en blanc : on nous invite à ne pas voter la présente proposition de loi en nous promettant que la future loi de santé réglera tous les problèmes, alors même que l’instauration d’un moratoire sur les fermetures ou les regroupements d’établissements de santé constituerait déjà une étape, un outil. Cette attitude me semble quelque peu cavalière !

Je vais mettre aux voix l’article 1er.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Monsieur le président, je veux réagir aux propos de Mme la ministre, qui nous a tendu la perche, et à juste raison, d’ailleurs.
Madame la ministre, vu que votre majorité est particulièrement divisée sur cette proposition de loi, comme elle l’a déjà été régulièrement par le passé, elle le sera probablement sur d’autres textes.
Il me semble que l’expérience des débats sénatoriaux devrait vous inciter à être attentive aux propositions venant d’autres rangs que les vôtres, ce qui permettrait peut-être d’examiner un certain nombre de textes de manière différente et de prendre en compte des arguments par ailleurs tout à fait intéressants.
En revanche, il serait inopportun de détricoter l’ouvrage sans attendre d’avoir dressé le bilan des dispositions votées par le passé.
En ce qui concerne la tarification à l’activité, la T2A, il faudra lui consacrer le temps qu’elle mérite et étudier l’ensemble des différentes propositions avant d’arrêter les décisions.
S’agissant des innovations, je rappelle que nous vous avions déjà soumis des propositions lors de l’examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la domomédecine et la télémédecine du travail. S’agissant de cette dernière, des avancées significatives peuvent être réalisées à bon compte, ce qui permettrait d’améliorer le service rendu aux salariés au titre de cette médecine du travail dont on sait que le nombre de praticiens est particulièrement insuffisant.
Permettez-moi de revenir une nouvelle fois sur le sujet du numerus clausus : il faudra, là aussi, arbitrer entre les propositions existantes.
Pour ce qui concerne l’articulation entre le sanitaire et le médico-social, on voit bien la limite de l’exercice, notamment dans les structures périphériques, avec davantage de lits en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, ou en soins de suite qu’en soins actifs et avec la coexistence de financements complémentaires, de tarifications, de conventions tripartites…
La situation devient tellement compliquée qu’elle nous conduit à avoir des discussions de chiffonniers pour savoir qui paie quoi, au risque, parfois, de faire reculer la pensée, et le service rendu à l’usager !
Répondre aux besoins de l’usager : voilà ce qui importe. L’usager ne devrait pas se préoccuper de la question des responsabilités, laquelle est de notre ressort. Nous devons être attentifs à ces questions et réfléchir tant qu’il le faudra à la suite à leur donner.
Concernant le parcours de santé, nous attendons, madame la ministre, vos propositions.
Pour en revenir au moratoire, malgré la conviction avec laquelle Mme la rapporteur a défendu son texte, dont je comprends bien l’esprit, un certain nombre de préoccupations demeurent. Prenant acte de la division de la majorité, nous maintiendrons, quant à nous, notre vote négatif, parce que nous nous inscrivons dans une stratégie de responsabilité, en espérant que nos arguments seront davantage pris en compte qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention portera non sur le fond, mais sur la forme.
Notre collègue Aline Archimbaud nous annonce qu’elle votera pour le texte parce que, dit-elle, elle en a compris l’esprit. Si je suis son raisonnement, tous ceux qui voteraient contre n’auraient rien compris…
Sourires.

Pour ma part, si j’accepte toutes les prises de position, je réfute totalement ce genre d’arguments !

Je mets aux voix l'article 1er.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste, l’autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Les dispositions mentionnées à l’article précédent ne sont pas applicables aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’Établissement.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé fait application du premier alinéa, ainsi que les voies de recours devant l’autorité administrative.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que, si l’article 2 connaît le même sort que l’article 1e, qui vient d’être rejeté, les explications de vote sur l’article 2 vaudront en fait explications de vote sur l’ensemble.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 120 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Mes chers collègues, les deux articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire, faute de texte à mettre aux voix.
En conséquence, la proposition de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et d'établissements de santé ou leur regroupement n’est pas adoptée.
La parole est à Mme la présidente de la commission.

Je souhaitais remercier l'ensemble des orateurs et des participants, ainsi que Mme la ministre pour sa présence et les réponses qu’elle nous a apportées.
Bien que le travail de la commission n’ait pas abouti à l'adoption de cette proposition de loi, je crois que le débat était au cœur des préoccupations des sénatrices et des sénateurs de la commission des affaires sociales, et vous avez pu entendre, madame la ministre, leur attente vigilante quant au futur projet de loi de santé publique que vous devez nous présenter.
Nous ne manquerons pas ce rendez-vous et, tous et toutes, nous répondrons : « présent », pour être ensemble à l'initiative ou, du moins, pour aboutir à une véritable grande réforme de la santé publique, dont notre pays a grand besoin.

Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame M. Philippe Adnot, Mme Delphine Bataille, M. Michel Bécot, Mme Esther Benbassa, M. Joël Billard, Mmes Maryvonne Blondin, Françoise Boog, M. Jean-Pierre Chauveau, Mme Laurence Cohen, MM. Christian Cointat, Roland Courteau, Jean-Patrick Courtois, Mmes Cécile Cukierman, Catherine Deroche, Muguette Dini, MM. Philippe Esnol, Bernard Fournier, Yann Gaillard, Mmes Mme Catherine Génisson, Marie-Françoise Gaouyer, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mme Chantal Jouanno, M. Philippe Kaltenbach, Mmes Christiane Kammermann, Virginie Klès, Claudine Lepage, Hélène Masson-Maret, Michelle Meunier, MM. Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Mme Gisèle Printz, MM Jean-Claude Requier, Gérard Roche, Mme Laurence Rossignol, MM. Jean-Pierre Vial, Richard Yung, membres de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 22 janvier 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 (Discipline des notaires et de certains officiers ministériels) (2013-385 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe CRC, de la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes et à l’affectation des dividendes à l’agence de financement des infrastructures de transports, présentée par Mme Mireille Schurch et plusieurs de ses collègues (proposition n° 59 [2011-2012], résultat des travaux de la commission n° 276, rapport n° 275).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre réseau autoroutier, qui s’étire sur près de 11 000 kilomètres, est le deuxième d’Europe et le quatrième au niveau mondial. Il assure un maillage dense de notre territoire.
Levier de développement économique et social, de décloisonnement territorial et de sécurité publique, ce réseau est d’abord un patrimoine national qui n’a cessé de s’enrichir et de se développer depuis les années cinquante.
Dès cette époque, il est apparu que les déplacements traduisaient la capacité d’une société à valoriser son territoire, et les autoroutes ont été – elles le sont encore – un outil dont la France s’est dotée à cette fin.
Dès lors, la modernisation des infrastructures de transport a été une constante dont la traduction concrète fut le lancement de grands travaux routiers et autoroutiers, mais aussi ferrés. La politique de grands travaux en faveur de régions comme le Languedoc-Roussillon ou l’Auvergne, par exemple, a illustré cette volonté de désenclavement.
Patrimoine de tous les Français, les autoroutes sont un service public. En effet, selon Léon Duguit, éminent juriste, toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants est un service public. Il ajoute que cette activité ne peut être réalisée complètement que par l’intervention directe ou indirecte de la force gouvernante.
Le rappel de cette définition est, je pense, essentiel. La Cour des comptes et le Conseil d’État ont reconnu ce caractère aux autoroutes. Le Conseil d’État précise que, en l’état actuel, ce n’est pas un service public national du fait de la présence de multiples gestionnaires. Toutefois, en tant que législateur, nous pouvons définir les autoroutes comme service public national et imposer cette définition au juge.
En effet, le maillage de l’ensemble du territoire et l'importance qu’il représente en termes de mobilité et d’accessibilité peuvent légitimer une telle définition. Cela nous renvoie au préambule de 1946, qui énonce que tout service public national doit devenir propriété de la Nation.
Toujours au regard du préambule de la Constitution, il est essentiel de rappeler que les autoroutes constituent, en fait, un quasi-monopole naturel. En effet, les usagers sont captifs et la demande de déplacements plus sûrs et plus rapides est une constante.
En 2010, il y avait cinq fois moins de risques de se tuer sur une autoroute que sur une route départementale, et six fois moins que sur une route nationale. Ce succès se traduit par les chiffres : les autoroutes représentent 25 % de la circulation pour moins de 1 % du réseau asphalté.
Enfin, pour terminer ce tableau introductif, les concessions d’autoroutes constituent une rente dont Hervé Mariton estime dans son rapport qu’elle se situe entre 34 et 39 milliards d’euros sur la durée des concessions.
C’est pourquoi la cession de l’ensemble des participations publiques détenues par l’État dans les sociétés concessionnaires décidée par les gouvernements successifs à partir de 2001 et surtout de 2005 est une faute tout à la fois politique, financière et sociale.
Les autoroutes françaises génèrent plus de 8 milliards d'euros de chiffre d’affaires chaque année et les marges des sociétés concessionnaires d’autoroutes, aujourd’hui totalement privatisées, ne cessent de croître.
En effet, les autoroutes françaises, dont la plupart étaient largement amorties, ont été cédées, en 2005, à trois multinationales du BTP pour la somme de 15 milliards d’euros, au lieu des 22 milliards auxquels les estimait la Cour des comptes… Soit un manque à gagner pour l’État de 7 milliards d’euros !
De plus, en vendant sa participation, l’État a aussi renoncé aux dividendes futurs, quelque 40 milliards de bénéfice d’ici à 2032. Or ces dividendes auraient dû être dédiés au financement d’un important programme d’infrastructures de transport, comme vous le rappellera mon collègue Gérard Le Cam. Ces dividendes sont désormais attribués aux actionnaires des sociétés privatisées, alors que ces derniers ne prennent qu’un risque économique très limité.
Le système est d’autant plus intéressant pour ces sociétés que les recettes se sont envolées : entre 2005 et 2012, le prix moyen du kilomètre a augmenté de 16, 4 %, soit deux fois plus vite que l’inflation ! Ces augmentations ne sont d’ailleurs justifiées ni par l’amélioration des services ni par le développement des infrastructures. De plus, il y a eu une course aux économies synonyme de réduction du personnel.
Ces constats ont largement été relayés par la presse et par différents rapports officiels, voire par des pétitions d’élus et de citoyens.
Pourtant, il serait normal qu’une fois le coût de l’investissement amorti, les tarifs des péages diminuent. Il n’en est rien ! Au contraire, ces sociétés ont procédé à des augmentations de tarifs sur les axes les plus saturés afin de s’assurer un maximum de rentabilité, en dehors de toute autre considération. Bien entendu, ces augmentations sont sans commune mesure avec les charges d’entretien des axes concernés.
Aujourd’hui, l’usager se perd dans une multitude de tarifs qui se trouvent, de façon injustifiée, en augmentation constante.
Le caractère de service public d’une activité n’empêche pas sa privatisation. Ainsi, une activité confiée à une entreprise privée reste publique si elle constitue un service public.
C’est le cas des sociétés d’autoroutes, selon le système initialement conçu en 1955. C’était une certaine forme de privatisation, mais elle était limitée à la fois parce que les sociétés concessionnaires faisaient partie du secteur public – leur capital étant majoritairement détenu par des personnes publiques – et parce que l’activité concédée à ces sociétés restait un service public.
De même, si la cession par l’État de la totalité de ses participations dans les sociétés concessionnaires d’autoroutes a eu pour objet et pour effet de les privatiser au sens organique, elle n’a pas pour autant privatisé le service public assuré par les sociétés. Elles doivent assurer, alors même qu’elles sont entièrement privées, une activité qui reste publique en tant que service public.
J’insiste sur ce point, car ce qui est aujourd’hui une atteinte à ce service public – au-delà de la faute financière qu’a été la cession de 2005 –, c’est l’incapacité de l’État à s’imposer comme force gouvernante.
Certes, les délégataires sont tenus par un cahier des charges signé avec l’État et doivent respecter un certain nombre de contraintes, dont, notamment, l’application des conditions tarifaires. Mais, si la puissance publique continue officiellement à arrêter l’évolution générale des tarifs – en fonction de calculs jugés opaques par la Cour des comptes –, les sociétés d’exploitation pèsent de tout leur poids pour augmenter les tarifs des péages afin de verser à leurs actionnaires de juteux dividendes. Ainsi, selon l’association « 40 millions d’automobilistes », entre 2005 et 2010, les tarifs des péages ont augmenté de 8 % pour Cofiroute et de 11 % pour les Autoroutes du Sud de la France.
Dès 2008, la Cour des comptes avait estimé que le système était devenu trop favorable aux concessionnaires. Malgré cela, année après année, les gouvernements ont continué d’homologuer des tarifs plus que critiquables.
Et rien ne semble changer. La Cour des comptes a rendu public en juillet 2013 un rapport qui dénonce, encore une fois, le système de fixation des tarifs des autoroutes et leurs montants élevés, soulignant le fait que « le rapport de force apparaît plus favorable aux sociétés concessionnaires » qu’aux pouvoirs publics. La Cour relève aussi le manque d’exigence de l’État « en cas de non-respect de leurs obligations par les concessionnaires, qu’il s’agisse de préserver le patrimoine, de respecter les engagements pris dans les contrats de plan ou de transmettre les données demandées ».
Concernant le suivi de la politique d’investissement, il a été souligné que les derniers contrats de plan ne comportent pas de clause permettant à l’État de connaître le coût réel de tous les investissements compensés, ni le budget consacré à l’entretien du patrimoine de l’État, donc du patrimoine commun. Le rapport de l’Assemblée nationale fait ainsi état d'un cadre tarifaire et d'un modèle financier qui, selon ses termes, « n’offrent pas, aujourd’hui, une protection suffisante des intérêts des usagers ».
Encore une fois, les magistrats de la Cour des comptes recommandent de mettre en œuvre des dispositions contraignantes et de réaliser systématiquement une contre-expertise de tous les coûts prévisionnels des investissements.
Mais, pour l’heure, rien n’est fait. L’État renonce à exercer ce qui lui reste d’autorité réglementaire, au détriment de l’usager. Face à ces constats que nous partageons tous dans cet hémicycle, et pour mettre fin à cette situation intenable, nous vous proposons de revenir sur ce choix irresponsable qui devait aboutir à la vente de notre patrimoine autoroutier. C’est le sens de notre proposition de loi.
Faute politique, faute financière, le marché de dupes de 2005 est aussi une grave faute sociale : les sociétés d’autoroute ont une politique systématique qui a conduit à la suppression de milliers d’emplois en CDI et en CDD ainsi que de saisonniers ! En effet, depuis la privatisation, ces sociétés ont massivement réduit leur personnel – de 14 % ! – pour se situer en deçà des 15 000 salariés. Diminution du nombre de salariés, donc diminution des coûts, pour des investissements qui stagnent à 2 milliards d’euros par an…
Alors que les autoroutes françaises ont été bradées, que la fixation du tarif des péages ne répond qu’aux seuls appétits d’actionnaires très éloignés des préoccupations d’utilité publique, alors que les critiques sont de plus en plus nombreuses et virulentes, nous pensons qu’il n’est plus possible de se cacher derrière les erreurs des équipes gouvernementales successives.
Pire, la crise accroît les recettes et le chiffre d'affaires de ces groupes. D’abord, parce que les salariés ou les demandeurs d’emploi sont contraints de se déplacer toujours plus loin pour leur travail ou leurs recherches, le plus souvent en direction des métropoles régionales desservies par le réseau autoroutier. Ensuite, parce que, dans de trop nombreuses régions, la déstructuration du service public ferroviaire et de la SNCF oblige à se reporter sur les autoroutes.
Je le vois dans mon département : face aux dysfonctionnements actuels et à une qualité de service sans cesse dégradée, l’autoroute s’impose devant le ferroviaire entre Montluçon et Paris.
C’est pourquoi nous vous invitons, à travers notre proposition de loi, à rééquilibrer le rapport de force entre l’État, les usagers et les sociétés concessionnaires privées.
Nous souhaitons également rappeler une conception exigeante de la démocratie : les biens « sociaux » doivent être accessibles à tous et la délimitation de leur périmètre est une affaire de choix collectif qui ne saurait obéir à une logique totalement marchande et encore moins capitaliste.
Pour cela, deux solutions se présentent : soit augmenter les taxes sur les sociétés concessionnaires, comme cela avait été envisagé lors de la loi de finances pour 2009, mais cette option avait été abandonnée, soit renationaliser ces sociétés. Tel est le sens de notre proposition de loi, dont l’article 1er prévoit le retour dans le giron de l’État des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Cette seconde option nous semble plus juste, tant la différence est grande, fondamentale, même, entre la rémunération normale et la véritable rente qu’organisent aujourd’hui Vinci et les autres sociétés concessionnaires au détriment des usagers.
Une telle option permettrait de répondre au principe posé par l’article 4 de la loi du 18 avril 1955 selon lequel la perception d’un péage n’est légitime qu’en vue d’assurer la couverture des dépenses liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure autoroutière.
Si nous entendons les critiques qui peuvent être faites sur le coût, pour le budget de l’État, d’une nationalisation des sociétés d’autoroutes, nous ne souscrivons pas au chiffre de 50 milliards d’euros avancé par notre collègue Michel Teston lors de la présentation du rapport de notre éminente collègue Évelyne Didier devant la commission du développement durable.
En effet, aucune étude fiable n’est en mesure de nous éclairer sur le coût d’une telle nationalisation. Je laisse à Évelyne Didier le soin de développer ce point.
Ne reproduisons pas les erreurs du passé, notamment celles du contrat Ecomouv’. Nous avons trop entendu que rien ne pouvait être fait, que l’État se devait de verser un loyer de 20 millions d’euros par mois à Ecomouv’, alors même que des arguments juridiques solides en faveur d’une remise en cause de ce contrat inique existent et que les doutes sur la fiabilité du système mis en place sont loin d’être levés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Sénat enquête en ce moment sur ce contrat.
Nous venons de vous démontrer, monsieur le ministre, mes chers collègues, la faisabilité juridique d’une nationalisation de nos autoroutes. Nous sommes tous d’accord non seulement pour reconnaître le scandale financier qu’a constitué la privatisation, mais aussi pour dénoncer l’incurie de l’État dans la fixation des tarifs des péages et dans le contrôle des investissements.
Si le blocage est d’ordre financier, monsieur le ministre, nous attendons de votre part que vous mettiez tous les moyens nécessaires pour nous fournir des chiffres fiables, sans a priori ; nous sommes prêts à participer à ce travail d’expertise.
Mes chers collègues, nos concitoyens ne nous pardonneront pas une énième reculade. Nous ne pouvons plus privilégier la rémunération des actionnaires des sociétés concessionnaires au détriment de l’intérêt général.
C’est pourquoi je vous demande de ne pas suivre les membres de la commission du développement durable qui ont rejeté notre texte, et vous invite à voter notre proposition de nationalisation des sociétés d’autoroutes. Nos concitoyens nous attendent !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Ronan Dantec applaudit également

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes et à l’affectation des dividendes à l’agence de financement des infrastructures de transports a été déposée le 25 octobre 2011 par notre collègue Mireille Schurch et les membres du groupe CRC. Mireille Schurch vient de nous exposer clairement le contexte et les motivations qui ont présidé à son dépôt.
Le texte est court – trois articles –, et il a pour unique objet de prévoir la nationalisation des sociétés concessionnaires des autoroutes françaises.
Cette proposition de loi répond à un objectif : revenir sur la décision de l’État, qui a cédé ses dernières participations dans les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Permettez-moi de revenir sur les faits.
L’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, a été créée en novembre 2004, à la suite du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 18 décembre 2003, afin de porter la participation de l’État dans le financement des grands projets d’infrastructures ferroviaires, fluviales, maritimes et routières, et de mieux distinguer ces crédits, auparavant noyés dans l’universalité budgétaire.
L’Agence devait alors bénéficier de deux ressources pérennes principales : d’une part, la redevance domaniale due par l’ensemble des sociétés d’autoroutes, publiques et privées, en raison de leur occupation du domaine public ; d’autre part, les dividendes perçus par l’État et par son établissement public, Autoroutes de France, au titre de leurs participations dans trois groupes de sociétés d’économie mixte concessionnaires : Autoroutes du Sud de la France, ASF, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, APRR, et la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, la SANEF.
Ces dividendes devaient constituer la principale source de financement de l’AFITF. Ils ont rapporté 332 millions d’euros en 2005, et cette recette était promise à un dynamisme important.
Le réseau autoroutier était alors quasi achevé, les investissements à amortir de moins en moins nombreux et, par conséquent, les marges des sociétés de plus en plus fortes. En outre, le trafic autoroutier était en augmentation.
La mise en place de l’AFITF a ainsi répondu – en apparence, tout du moins – à une logique de fléchage des crédits vers les infrastructures de transport. Elle devait également favoriser l’insertion de la politique des transports dans une perspective de long terme, fondée sur un développement durable, avec un objectif de report modal clairement affiché.
Cependant, dès le mois de juin 2005, à peine plus de six mois après la création de l’AFITF, le Premier ministre, Dominique de Villepin, annonçait, contre toute attente, la cession de l’ensemble des participations de l’État dans ces sociétés concessionnaires d’autoroutes, faisant ainsi preuve d’une grande incohérence.
D’après le député Hervé Mariton, auteur d’un rapport sur la valorisation du patrimoine autoroutier publié en juin 2005, « la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes est une bonne décision. Elle aide – oblige – à clarifier le rôle de l’État, le prémunissant de la confusion des rôles entre régulateur et détenteur de patrimoine. Elle permet de mobiliser davantage de moyens, et plus vite, pour la menée à bien d’un ambitieux programme multimodal d’infrastructures, et c’est alors un choix favorable à l’aménagement du territoire. Enfin, la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes permettra de développer le projet industriel de ces entreprises, par diversification des activités en France, par développement sur les marchés étrangers. »
Au fond, l’argumentation n’est pas vraiment sérieuse.
On peut douter, par exemple, de la volonté de mobiliser davantage de moyens en faveur du report modal au regard de l’affectation du produit de ces cessions. C’est en effet la poursuite du désendettement du budget général qui l’a emporté sur l’objectif d’un financement pérenne des infrastructures de transport : sur les 14, 8 milliards d’euros issus de la cession, seuls 4 milliards d’euros ont été attribués à l’AFITF !
Examinons ensemble les conséquences de cette décision.
Premièrement, l’État s’est privé d’une ressource importante pour le financement des infrastructures de transport. D’après certaines estimations, le manque à gagner s’élèverait à 37 milliards d’euros d’ici à 2032, date d’échéance médiane de ces concessions autoroutières, soit 1 à 2 milliards d’euros par an qui ne viennent pas alimenter les caisses de l’AFITF.
Les services de Bercy, que j’ai interrogés à ce sujet, n’ont jamais voulu – ou pu – nous fournir la moindre évaluation de ce montant, au motif que « le niveau de versement de dividendes dépend des résultats financiers des entreprises, qui dépendent eux-mêmes pour partie de la structure financière et de la politique de distribution retenues par les actionnaires. Même à considérer que ces résultats seraient demeurés identiques si l’État avait conservé sa participation, l’Agence des participations de l’État ne dispose pas des résultats financiers des sociétés d’autoroutes privatisées, notamment des versements de dividendes à leurs actionnaires - ces sociétés ne sont en effet pas tenues de rendre publics ces éléments ».
Si vous me permettez cette parenthèse, il est à regretter que l’État concédant se préoccupe si peu de la rente dont bénéficient les entreprises concessionnaires. En fait, il agit comme s’il voulait assurer une rentabilité confortable aux concessionnaires. Je n’étais d’ailleurs pas la seule à m’en étonner au sein de notre commission...
Toujours est-il que, de 2006 à 2012, ces entreprises ont enregistré des bénéfices importants : le résultat net d’ASF a augmenté de 15 %, celui de la SANEF, de 8 % et celui d’APRR, de 5 %.
La décision de 2005 a donc constitué une facilité de court terme d’une incroyable inconséquence, d’autant plus critiquable qu’elle a été mise en œuvre – j’attire votre attention sur ce point – sans aucune consultation du Parlement. Or l’État et son établissement public, Autoroutes de France, détenaient plus de 70 % du capital d’APRR et de la SANEF, et la moitié de celui d’ASF !
Deuxièmement, cette opération, contestable dans son principe, n’a pas été réalisée de façon optimale pour l’État, comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public de 2008. L’État n’a fait appel qu’à une seule banque conseil pour les trois opérations d’ouverture de capital des sociétés d’autoroutes, se privant ainsi de la possibilité de disposer de plusieurs avis indépendants de ceux que fournissent les conseils des entreprises.
Par ailleurs, le choix d’un taux d’actualisation « excessivement élevé » a interdit à l’État de valoriser toute la durée des concessions cédées, et donc de tirer le bénéfice patrimonial maximal de la privatisation. Les participations publiques dans ces sociétés ont donc bel et bien été bradées.
Troisièmement, l’État n’a pris aucune disposition pour éviter l’apparition d’une rente tarifaire et protéger les intérêts du consommateur après la cession.
Cette situation, déjà dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport de 2008, est malheureusement toujours d’actualité, puisqu’elle a fait l’objet d’un nouveau rapport spécifique de la Cour des comptes en juillet 2013, sur les relations entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Je ne reviens pas en détail sur un phénomène que nous connaissons tous : alors que la hausse du tarif des péages est en théorie encadrée et limitée, la conclusion de contrats de plan entre les sociétés d’autoroutes et l’État a rendu possibles des hausses tarifaires supplémentaires, dont la justification n’est pas évidente. Ainsi, la hausse des tarifs a été en général supérieure à l’inflation : pour les véhicules légers, par exemple, elle a dépassé en moyenne 2, 2 % par an chez ASF et 1, 8 % chez APRR, alors que l’indice de progression des prix à la consommation hors tabac n’a augmenté que de 1, 6 %.
Cette hausse continue des tarifs est extrêmement préoccupante et ne peut perdurer. J’appelle votre attention sur ce sujet, monsieur le ministre, alors que vous menez des négociations avec les sociétés autoroutières pour réaliser un plan de relance autoroutier dont le montant, nous dit-on, s’élèverait à environ 3 milliards d’euros et qui pourrait encore allonger la durée des concessions...
Je ne peux comprendre une telle mesure. À ce rythme-là, les concessions seront prolongées ad vitam aeternam, garantissant aux sociétés concessionnaires des revenus plus que confortables, sur le dos des usagers !
Au vu de ces éléments, le groupe CRC propose de nationaliser les sociétés concessionnaires d’autoroutes. La proposition de loi ne limite d’ailleurs pas cette opération aux trois groupes de sociétés concessionnaires dans lesquelles l’État détenait des participations en 2005, mais l’élargit à d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes. Au total, ce sont douze sociétés que le texte prévoit de nationaliser. Tel est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi.
L’article 2 précise que cette nationalisation prend effet au bout d’un an à compter de la promulgation de la loi.
L’article trois dispose que les charges résultant de l’application de la loi sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
Réunie le 14 janvier dernier, la commission du développement durable n’a pas été favorable à l’adoption du texte, en particulier pour des raisons budgétaires. La nationalisation de ces douze sociétés et les pénalités à acquitter au titre de la rupture des concessions pourraient en effet représenter plusieurs milliards d’euros ; mais ce coût reste à chiffrer précisément.
La commission a toutefois largement partagé les inquiétudes de votre rapporteur sur le financement non sécurisé de l’AFITF et sur les hausses excessives des tarifs des péages.
Nous n’insisterons pas sur la situation extrêmement préoccupante de l’AFITF aujourd’hui, en particulier depuis la suspension de l’écotaxe poids lourds, nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle. Nos territoires ont besoin que les projets structurants en termes de mobilité et de désenclavement, parfois décidés de longue date, puissent être menés à bien.
Par ailleurs, si la transition énergétique figure effectivement parmi les priorités du Gouvernement, il convient de lui octroyer les moyens nécessaires, notamment en ce qui concerne le report modal.
Les membres de la commission ont aussi appelé de leurs vœux un contrôle plus efficace de la part de l’État sur les tarifs des péages autoroutiers. Nous veillerons à ce que les conclusions de la Cour des comptes soient effectivement prises en compte par le Gouvernement. Le maintien du statu quo serait absolument incompréhensible.
Pour conclure, cette proposition de loi aura donc au moins le mérite de souligner combien les attentes sont fortes dans ces deux domaines : le financement des infrastructures de transport, d’une part, et le retour à une politique de tarification plus juste de la part des concessionnaires, d’autre part.
C’est le sens de la position de la commission qui, tout en ne souhaitant pas l’adoption de la proposition de loi, a voulu que le Gouvernement soit saisi de cette double et vive préoccupation.
Par ailleurs, de nombreux membres de la commission ont souhaité en savoir davantage et ils ont proposé la création d’une mission d’information. Cette question devra être reposée lors d’une prochaine réunion de la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Mme Bariza Khiari remplace M. Jean-Pierre Raffarin au fauteuil de la présidence.

Avant de vous donner la parole, monsieur le ministre délégué, je me permets de vous rappeler que notre temps est contraint et que nous devons interrompre l’examen de la proposition de loi du groupe CRC à dix-huit heures trente.
Mais vous avez la parole, monsieur le ministre délégué.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie pour vos propos. Je vais m’efforcer de répondre aux interrogations que vous avez formulées et au rapport qui vient d’être présenté.
Par cette proposition de loi, Mme Schurch et le groupe communiste républicain et citoyen proposent la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, permettant ainsi de capter des profits que vous considérez – peut-être à juste titre – comme excessifs, afin de les réinjecter au profit l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF.
Cette agence est aujourd’hui effectivement confrontée à une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait de la suspension de l’écotaxe poids lourds. Nous faisons ainsi face à un véritable problème de financement des infrastructures, je ne cesse de le dire.
Je vous remercie d’ailleurs de me donner une nouvelle occasion de le répéter, tout comme lors des débats de grande qualité que nous avons eus à ce sujet l’année dernière et dont j’ai gardé le souvenir.
Aujourd’hui, je ne peux que regretter les conditions dans lesquelles ce dossier a évolué, conduisant à la suspension de la taxe. Je regrette particulièrement le manque de compréhension dont l’initiative a fait l’objet, même si je constate que les esprits semblent évoluer et que nous ne sommes pas dans la résignation. La mission d’information de l’Assemblée nationale nous permettra d’en savoir plus pour la suite.
Madame la sénatrice, madame la rapporteur, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense : je ne peux pas être favorable à votre proposition de loi et je vais vous en expliquer les raisons.
Sourires sur les travées de l'UDI-UC.
Toutefois, à la fois sur le constat et, dans une certaine mesure, sur les perspectives, je ne puis que vous rejoindre.
Tout d’abord, la privatisation des autoroutes, réalisée en 2005 dans des conditions que vous avez très bien rappelées, a évidemment été une erreur ; nous le constatons, nous le regrettons, d’autant plus que nous en subissons encore aujourd’hui les effets.
Ce fut doublement une erreur.
Ce fut d’abord une erreur au regard du patrimoine de l’État lui-même ; vous l’avez souligné.
Alors que les autoroutes françaises ont été construites, pour la plupart, par des sociétés publiques, majoritairement détenues par l’État, pourquoi avoir décidé précipitamment en 2005 de se priver des profits qui commençaient seulement à être dégagés, et ce quand ces profits auraient pu être utiles – ils le seraient aujourd’hui encore - au financement des infrastructures, à l’aménagement et à l’égalité des territoires, thème ô combien cher aux sénateurs et aux sénatrices ?
Je partage votre analyse : il aurait été patrimonialement plus avantageux de conserver la propriété de ces entreprises publiques plutôt que de les vendre, et dans des conditions que nous dénonçons encore, à un prix considéré par la plupart des spécialistes comme très insuffisant.
Ce fut ensuite une erreur au regard de la gestion post-privatisation des contrats. Les contrats de concession des sociétés historiques se sont en effet étoffés au cours des décennies, au fur et à mesure de la construction des autoroutes. Certains d’entre eux concernent aujourd’hui plusieurs milliers de kilomètres.
Comme a pu le démontrer à plusieurs reprises la Cour des comptes, ces contrats sont particulièrement difficiles à gérer pour l’État : signés il y a longtemps, ils correspondaient à une époque où l’exigence juridique n’atteignait pas le niveau de technicité auquel les concessionnaires ont aujourd’hui recours.
Ainsi, avant d’envisager toute privatisation, il eût été préférable, et de bon sens, d’actualiser ces contrats, de sorte que nous ne soyons pas « ligotés », dans nos relations avec les concessionnaires, par des contrats très imparfaits. Dans l’éventualité d’une privatisation, à supposer que le principe en ait été admis, il aurait donc fallu revoir, redéfinir les contrats, les durcir peut-être ou les affiner, mais en tous les cas ne pas mettre l’État dans une situation extrêmement inconfortable, voire inégalitaire, ce dont je puis témoigner. C’est très pénalisant.
Pour autant, pouvons-nous raisonnablement envisager une nationalisation ?
D’une certaine façon, à travers cette proposition de loi, vous posez, au-delà de l’enjeu de la nationalisation, la question du devenir des sociétés d’autoroutes. Vous nous disiez, mesdames les sénatrices, qu’il serait bon d’y revenir, et cette question me paraît légitime.
Pour tout vous dire, je n’ai pas attendu d’être nommé aux responsabilités qui sont les miennes pour me poser cette question et y travailler. Il nous faut d’ores et déjà nous interroger sur l’après. Pour mémoire, les contrats de concession s’arrêteront en moyenne dans dix-sept ans, entre 2027 et 2032.
Pourquoi la nationalisation des autoroutes n’est-elle pas possible ? Pour une raison simple, que vous avez évoquée : l’opération serait extrêmement coûteuse. Compte tenu de la situation de nos finances publiques et des priorités qui en découlent, nous considérons que nous n’avons les moyens ni de racheter aux concessionnaires actuels leurs profits futurs ni de rembourser la dette actuelle, évaluée à elle seule à environ 25 milliards d’euros.
Cette solution nécessiterait plusieurs dizaines de milliards d’euros, 45 milliards d’euros selon les estimations provisoires de la Cour des comptes. Cela n’est pas envisageable compte tenu de la situation des finances publiques et particulièrement au regard des objectifs de redressement budgétaire de la France.
Par ailleurs, s’engager dans cette voie supposerait soit d’acquérir, pour entretenir le réseau autoroutier, de nouvelles compétences, que l’État a perdues, soit de confier par marché à des sociétés privées le soin de gérer le réseau acquis. Cela poserait à nouveau la question de l’équilibre contractuel entre les profits des opérateurs et l’intérêt de l’État.
Compte tenu de ces éléments, je suis aujourd’hui convaincu qu’il n’est pas possible de revenir en arrière. Mais la question n’est d’ailleurs pas tant de savoir s’il faut nationaliser les sociétés concessionnaires – même si je ne peux que vous rejoindre sur certains de vos arguments – que de savoir comment gérer efficacement la période qui nous sépare de la fin des concessions et travailler dès maintenant sur un nouveau modèle qui assure le financement des infrastructures de transport après 2030.
À cet égard, j’ai souhaité confier une mission de réflexion à l’Inspection générale des finances et au Conseil général de l’environnement et du développement durable sur l’avenir des concessions à leur terme, notamment pour savoir si les péages – après la fin des concessions, ils seront perçus par l’État –pourraient être affectés à un établissement public et être mobilisés de façon anticipée, c'est-à-dire dès les prochaines années, pour effectuer des travaux d’intérêt général, sans pour autant alourdir l’endettement public.
C’est la stratégie que j’ai mise en place dès mon arrivée au ministère des transports, de la mer et de la pêche, permettant d’explorer les différentes voies juridiques et financières et anticipant d’autant les politiques publiques que nous souhaitons définir avec les moyens d’aujourd’hui et les réponses nécessaires face à ce qui sera, vous en conviendrez, l’enjeu de demain.
Ainsi, je souhaite vous rendre compte d’un certain nombre d’initiatives prises avec les services du ministère.
Tout d’abord, premier axe, nous avons voulu soumettre le système autoroutier concédé à des exigences nouvelles.
Il faut en effet réajuster certaines taxes pour les mettre au bon niveau.
Comme indiqué dans l’exposé des motifs, il est nécessaire que les sociétés concessionnaires d’autoroutes contribuent le plus efficacement et le plus largement possible au financement des infrastructures de transport.
C’est en partie le cas avec la taxe d’aménagement du territoire, cette TAT qui rapporte 550 millions d’euros à l’AFITF. C’est une piste, mais cette taxe est aujourd’hui répercutée dans les tarifs des péages acquittés par les usagers et ne peut donc être assimilée à un prélèvement sur le résultat des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
C’est en revanche tout à fait le cas de la redevance domaniale. Alors que cette redevance n’avait pas été actualisée depuis longtemps, je l’ai augmentée de 50 % dès 2013, faisant passer son produit de 200 millions d’euros à 300 millions d’euros pour ajuster son niveau aux profits dégagés par le réseau. Ce ne fut pas chose aisée.
Je vous épargnerai le rappel des innombrables discussions, concertations et oppositions que cette évolution a suscitées, et jusqu’au contentieux. J’avais en effet initialement la volonté d’augmenter la redevance de 100 %. Cependant, ce premier projet d’augmentation a fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil d’État au motif que le niveau de prélèvement supplémentaire pour certaines sociétés n’était pas suffisamment justifié par un avantage économique tiré de l’occupation du domaine public. Il sera important de nous tourner à nouveau vers le Conseil d’État pour que soient ajustées certaines considérations.
Ensuite, deuxième axe, il faut limiter les hausses de tarifs.
Dès mon arrivée à la tête du ministère, en mai 2012, des instructions ont été adressées aux services pour contrôler de manière beaucoup plus approfondie les grilles tarifaires. Le rapport de la Cour des comptes a finalement confirmé ce qui était une forme d’intuition ministérielle.
Les tarifs des véhicules légers, par exemple, ont augmenté en moyenne de 2, 24 % en 2011 et de 2, 45 % en 2012. En 2013, l’augmentation s’est limitée à 2 %. En 2014, la hausse sera proche de 1, 15 % en moyenne, dont 0, 33 % lié à la TVA. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, notre vigilance produit ses premiers résultats.
Au-delà de ces actions récentes, l’enrayement des hausses excessives ne pourra se faire, à moyen terme, que par la négociation encore plus serrée des contrats de plan, qui courent sur cinq ans. Ainsi, nous pourrons tirer les tarifs vers le bas. C’est ce que l’ensemble des services du ministère, mon équipe et moi-même tentons de mettre en œuvre depuis dix-huit mois.
Je tiens à vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs, que certaines pratiques ont été abandonnées, comme le recommandait la Cour des comptes – pour ne pas dire qu’elle l’exigeait –, dans son rapport portant sur l’exercice 2009-2012. Nous en avons tiré toutes les conséquences, et poursuivons l’application des préconisations de la Cour. J’en veux pour preuve l’abandon de la pratique dite du « foisonnement », qui consistait à admettre des variations fortes par rapport à un tarif moyen, section par section, et dont le côté un peu nébuleux ne permettait pas de garantir la pleine transparence et la réalité des tarifs.
Nous avons également souhaité que les contrats de plan puissent être négociés dans des conditions plus rigoureuses que par le passé. Par exemple, depuis un an, nous avons fixé des règles claires sur le niveau de rentabilité des nouveaux investissements. À l’avenir, il n’y aura pas de taux de rentabilité interne, ou TRI, qui excède 7, 8 %. Ce faisant, nous allons même au-delà de la recommandation de la Cour des comptes, qui critiquait le TRI adopté pour les contrats de plan récents, supérieur à 8 %.
Une récente mission de l’Inspection générale des finances et de l’inspection générale du ministère des transports a validé nos hypothèses, notre modèle financier, et le bon niveau de TRI pour les projets autoroutiers.
Par ailleurs, j’ai demandé à mes services de vérifier systématiquement la réalité des travaux d’investissement faisant l’objet de contrats de plan et, surtout, de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’investissements de mise en conformité, qui doivent être réalisés par les sociétés au titre de leurs contrats. Tel est le cas, notamment, des contrats de plan avec ASF pour le déplacement de l’autoroute A9, passé en 2013, ou avec APRR pour la liaison entre les autoroutes A89 et A6, en 2014.
Il est enfin fondamental que l’État s’assure du respect par les sociétés d’autoroutes de leurs obligations d’entretien du patrimoine autoroutier, qui doit in fine revenir à l’État. Je rappelle que les sociétés concessionnaires d’autoroutes investissent environ 2 milliards d’euros pour les réseaux, dont 50 % sont affectés au maintien, et 50 % à des nouvelles opérations.
Comme l’a récemment souligné la Cour des comptes, il est essentiel que les infrastructures autoroutières et les ouvrages d’art soient parfaitement entretenus. La qualité d’entretien des ouvrages d’art autoroutiers est une priorité du ministère des transports. À ce titre, environ soixante-dix mises en demeure sont adressées chaque année aux concessionnaires, et elles peuvent avoir de réelles conséquences financières pour eux.
Les processus de contrôle et d’audit des chaussées sont en cours de formalisation. Ils doivent permettre d’atteindre un bon niveau de service, tout en respectant l’économie du contrat.
Il faut également s’assurer du respect par les sociétés d’autoroutes de leurs obligations de concessionnaires. C’est ainsi que, depuis mon arrivée, plusieurs décisions ont été prises, rejoignant toutes les recommandations émises par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013.
D’abord, des indicateurs de performance – relatifs à la qualité du service offert au client, à la surveillance du réseau, aux délais d’intervention, par exemple – ont été peu à peu introduits dans les contrats, assortis de sanctions financières devant permettre d’assurer leur respect.
Pour la première fois, en 2013, des pénalités d’un montant de 1, 5 million d’euros ont été réclamées et payées. C’est dire que la faiblesse passée des services du ministère des transports en la matière, dénoncée par la Cour des comptes, n’est plus d’actualité. Nous avons en effet souhaité mettre en place des méthodes qui nous rendent efficaces.
Ensuite, les contrôles sont plus formalisés, plus réguliers – ils ont lieu une fois par an au moins –, et plus documentés.
Enfin, le ministère n’est pas seul dans les négociations mais s’associe à des experts extérieurs, ainsi qu’aux différents ministères concernés. Cela faisait également l’objet d’une préconisation de la Cour des comptes, préconisation qui aurait pu, d’ailleurs, être perçue comme un peu désagréable à l’endroit de mon administration ; je préfère la prendre pour le signe de la compétence des différents ministères et services de l’État concernés !
Nous avons donc pris l’initiative de mobiliser tous les ministères sur ce sujet.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, nous travaillons tous les jours pour que ces contrats de concession soient exécutés dans les meilleures conditions possible.
Madame Schurch, madame la rapporteur, le débat que nous avons cet après-midi nous fait tourner notre regard vers le passé, vers les décisions malheureuses qui ont été prises alors, mais, dans le même temps, il nous oblige à considérer les exigences d’aujourd’hui, pour mieux préparer le futur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai pu vous en donner quelque illustration, lorsque la volonté politique est là, nous pouvons agir très rapidement. Lorsque la volonté politique est là, nous pouvons rétablir les conditions de la discussion, rééquilibrer les rapports de force, en gardant toujours à l’esprit, lors de nos négociations avec les sociétés concessionnaires, que nous parlons d’un bien de la Nation, qu’il convient de gérer et d’entretenir en tant que tel, car ce patrimoine appartient à tous.
De ce fait, même s’il doit faire preuve de compréhension, il est nécessaire que l’État se montre ferme, exemplaire et exigeant, le tout, bien sûr, sous le contrôle de la représentation nationale. C’est ainsi que j’entends la demande faite par la commission du développement durable du Sénat de création d’une mission d’information sur le sujet.
Tout cela, pourtant, ne saurait suffire. Vous êtes exigeants, mesdames, messieurs les sénateurs ; je ne le suis pas moins. J’aimerais donc pouvoir répondre à certaines questions, que j’anticipe un peu, sur le plan de relance que nous avons évoqué, si toutefois vous m’y autorisez, madame la présidente.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Je tâcherai d’être un peu moins long, pour laisser s’exprimer M. Dantec !
Sourires.
Le plan de relance n’est pas un cadeau, mesdames, messieurs les sénateurs. Il le serait si l’État, le ministère compétent et le ministre à sa tête, qui s’implique personnellement, n’étaient pas exigeants. Nous aurions, alors, le droit d’être inquiets. À ce titre, je signale que, dans le passé, certains plans de relance ont pâti d’avoir été insuffisamment négociés.
Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, les infrastructures vivent, les territoires évoluent ! Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, il convient d’agir, fut-ce par petites touches, en ajoutant ici une liaison entre deux infrastructures, en développant là le réseau, voire en considérant les enjeux environnementaux, par la création d’aires de covoiturage, entre autres améliorations qualitatives. Tout cela est important.
Nous ne pouvons donc pas considérer qu’il est urgent d’attendre dix-sept ans, date de la première échéance, avant de réaliser des investissements supplémentaires.
Leur montant, bien sûr, est important : environ 3 milliards d’euros. Mais ils généreront des emplois ! Pour cela, nous devons nous assurer que les contrats ne sont pas monopolisés par des sociétés qui sont à la fois des entreprises de travaux publics et des concessionnaires d’autoroutes. Ce point, je le souligne, a déjà fait l’objet de négociations avec la Fédération nationale des travaux publics.
Certains soient des adeptes de la concurrence, semble-t-il. Eh bien, faisons en sorte qu’elle soit réelle, ouverte à tous, et notamment aux entreprises de travaux publics de nos territoires, PME comme ETI, qui ont besoin de commandes, besoin d’être associées à ce plan !
Mesdames, messieurs les sénateurs, 1 milliard d’euros de travaux, ce sont 8 000 emplois. Or, je le rappelle, le montant du plan est d’environ 3 milliards d’euros. Il faut donc s’assurer de l’effectivité de la relance sur les territoires, en matière d’emploi comme d’investissement. C’est une exigence que l’État s’assigne à lui-même. Pour cela, nous devrons faire en sorte d’améliorer les infrastructures, et veiller à ce que les règles relatives au TRI, que j’ai évoquées, s’appliquent également dans le cadre du plan de relance.
Bien évidemment, nous agirons sous le regard attentif de la Commission européenne, qui recevra la notification de notre plan dans quelques jours, même si nous l’avons déjà informée de nos travaux.
J’insiste sur notre degré d’exigence en la matière. Nous en avons fait preuve pour les contrats existants, en étant à la manœuvre. Nous en faisons preuve quand, aujourd’hui, nous décidons de réfléchir aux modalités de sortie des concessions, quand nous cherchons à prévoir pour mieux prévenir, quand nous nous posons la question des mécanismes financiers qui permettraient à la France de se doter de moyens d’investissements dans les infrastructures.
L’actualité de l’AFITF me confirme l’impérieuse nécessité de réussir à trouver ces solutions de financement, mais aussi de veiller à ce que la modernisation des infrastructures autoroutières ne puisse pas être interprétée comme un cadeau. Des cadeaux, il y en a eu, peut-être ; ce n’est pas ce qui m’importe. Ce qui m’importe, c’est que nous agissions au profit des usagers, des contribuables et de l’État. C’est du patrimoine national qu’il s’agit, mesdames, messieurs les sénateurs, et il nous revient d’être particulièrement attentifs, et particulièrement exigeants !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Merci, monsieur le ministre délégué, d’avoir respecté le temps imparti.
La parole est à M. Ronan Dantec.

Madame la présidente, monsieur le ministre, que je remercie de m’avoir laissé le temps de m’exprimer, madame Schurch, que je salue en tant qu’auteur de la proposition de loi, madame la rapporteur, mes chers collègues, voilà une proposition de loi qui, compte tenu de l’actualité pour le moins chargée des transports et de leur financement, tombe à point nommé.
Nous soutenons cette proposition de loi sur le fond, parce que la privatisation des sociétés d’autoroute en 2005, cela a été indiqué, fut un véritable scandale ! Le gouvernement de Dominique de Villepin a commis une faute lourde en privant les budgets publics d’une manne financière considérable, et ce au profit de la rente des sociétés d’autoroutes et au détriment du financement des transports.
Selon les projections, l’exploitation des autoroutes aurait pu rapporter plus de 37 milliards d’euros de dividendes à l’État d’ici à 2032, date d’échéance médiane des contrats de concession, somme à comparer aux 14, 8 milliards d’euros obtenus par la privatisation.
En outre, ce produit a davantage servi au désendettement qu’au financement des infrastructures de transports, puisque seulement 4 milliards d’euros ont été attribués à l’AFITF, le reste étant injecté dans le budget général.
Le groupe écologiste soutient donc cette proposition de loi sur le fond : même s’il est peu probable qu’elle soit adoptée – le suspense va durer jusqu’au mois de juin ! –, elle présente l’intérêt de lancer le débat. Nous soutiendrons, d’ailleurs, toute initiative parlementaire visant à approfondir ce sujet et à forger des conclusions partagées sur ces privatisations. Sur ce point, Mme la rapporteur a évoqué la discussion que nous avons eue ce matin en commission.
Plus généralement, les flux financiers et les besoins d’investissement liés aux transports routiers doivent être remis à plat.
Je reviens, très rapidement, sur l’urgence de la mise en œuvre de l’écotaxe pour consolider les budgets consacrés aux transports, préoccupation que nous semblons tous partager.
Le manque à gagner dû à la suspension de cette taxe se chiffre à 800 millions d’euros annuels pour l’AFITF et à 150 millions d’euros pour les collectivités locales. Cette perte sèche remet en cause le financement du report modal, pourtant au cœur des stratégies affichées par l’État.
Nous ne devons donc pas perdre de temps sur le dossier de l’écotaxe. L’État devra trouver les moyens de récupérer des fonds sur les recettes nouvelles que suscitera, pour les sociétés concessionnaires, le report prévisible d’une partie du trafic sur les autoroutes. L’effet d’aubaine lié à ce report, évidemment difficile à calculer, est généralement estimé à une somme comprise entre 250 millions et 400 millions d’euros.
La première des décisions à prendre serait de se doter d’un dispositif de mesure rigoureuse de ce report, peut-être par l’établissement d’une sorte de « point zéro ». A priori, la formule serait acceptée par l’Association des sociétés françaises d’autoroutes, que j’ai auditionnée dans le cadre de la rédaction de mon rapport pour avis sur les transports routiers, remis à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
L’État manque donc d’argent, nous le savons, et la tentation est grande de privilégier des contrats de type partenariat public-privé pour financer les investissements, quitte à faire primer quelque peu le court terme, au détriment du long terme. Ainsi, un plan de relance autoroutier est en préparation : s’agit-il, monsieur le ministre, de prolonger de trois ans des concessions attribuées à trois sociétés sans appel d’offres, en échange de 3, 5 milliards d’euros d’investissements supplémentaires pour une vingtaine d’opérations ?
Je le dis clairement, nous nous opposons à un tel montage financier, qui priverait l’État pour trois années supplémentaires de ressources pérennes d’un niveau très élevé, liées à l’exploitation des autoroutes. Nous ne pouvons pas, au sein de la majorité gouvernementale, affirmer à l’unisson qu’il ne fallait pas privatiser et choisir aujourd'hui de prolonger le système : cela ne me paraît guère lisible politiquement.
Concrètement, d’après ce que nous croyons savoir, ce plan vise à réaliser des opérations de renforcement de la capacité de tronçons existants et de création de nouveaux tronçons autoroutiers pour terminer des opérations de prolongation de réseau concédé ou permettre des interconnexions. On nous dit que ces opérations sont toutes « utiles », mais nous nous interrogeons néanmoins.
À titre d’exemple – ce n’est évidemment qu’une hypothèse, puisque le Parlement ne dispose pas aujourd'hui de la liste des projets concernés –, on évoque une opération de prolongation de huit kilomètres sur l’A40 à hauteur de Nangy ou de Findrol en direction de Thonon, projet qui suscite des craintes au plan environnemental. Qu’en est-il, monsieur le ministre – je n’attends pas obligatoirement que l’on me donne une réponse dès ce soir –, de la préservation de la tourbière de Lossy, qui accueille des espèces protégées en bordure est de la RD 903, au niveau du carrefour des Chasseurs ? Voilà une question tout à fait précise !
Sourires.

Monsieur le ministre, le débat sur cette importante négociation avec les autoroutiers ne doit pas être escamoté, comme ce fut le cas lors des privatisations, sous la droite. Je demande donc que la représentation nationale puisse disposer de la liste des opérations projetées et des données financières du plan de relance autoroutier et qu’un débat transparent associant le Parlement soit engagé avant toute décision de l’État. À défaut, nous serons dans l’incohérence politique.
Je voudrais revenir sur l’objet même de ce plan de relance : obtenir des investissements des sociétés d’autoroutes sur le réseau. Le sévère rapport de la Cour des comptes a déjà été plusieurs fois évoqué. Parmi les opérations du plan de relance, certaines ne pourraient-elles pas relever des obligations contractuelles des autoroutiers ? La question mérite d’être posée. On a beaucoup insisté sur le déséquilibre du rapport de force entre l’État et les sociétés concessionnaires.
On peut aussi s’interroger sur le recours à un autofinancement de ces travaux, par le biais d’une hausse des péages, à concurrence évidemment du niveau des investissements : il ne faudrait pas que les sociétés d’autoroutes en profitent pour accroître leurs bénéfices.
Des solutions existent, me semble-t-il, y compris celle d’aider les sociétés autoroutières à réduire leurs frais de fonctionnement. Ainsi, on sait que la circulation des véhicules de 44 tonnes à cinq essieux cause aujourd'hui une usure accélérée des chaussées. J’ai proposé, dans mon rapport sur le budget des transports routiers, de surtaxer ces poids lourds dans le cadre de la réforme de l’écotaxe. Cela pourrait constituer une mesure dissuasive ou une recette nouvelle pour le financement des transports. Les sociétés d’autoroutes y sont assez favorables.
Outre ces propositions, nous reviendrons au mois de juin sur les modulations des péages selon les normes d’émission Euro.
La question du transport nécessite une approche globale de la part de l’État, qui doit disposer d’une maîtrise forte, en termes de planification des infrastructures et des recettes : péages, écotaxe et autres impôts. La privatisation des autoroutes a contribué au morcellement de ces nécessaires planification et maîtrise politique. Plus tôt on en sortira, plus tôt l’État retrouvera des marges de manœuvre en matière de politiques de transport et pourra mettre en place dans ce secteur la nécessaire transition énergétique sur laquelle se sont engagés le Président de la République et le Gouvernement. §

Mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme du temps alloué à l’ordre du jour réservé au groupe CRC.
Je constate que nous n’avons pas achevé l’examen de la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes et à l’affectation des dividendes à l’Agence de financement des infrastructures de transports.
Il appartiendra à la conférence des présidents d’inscrire la suite de la discussion de ce texte à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat (proposition n° 255, texte de la commission n° 291, rapport n° 290).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième lecture d’une proposition de loi importante, issue des travaux des états généraux de la démocratie territoriale et dont l’objet principal est d’améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux.
Depuis l’examen du texte en première lecture au Sénat, voilà tout juste un an, plusieurs textes importants pour notre vie démocratique ont été adoptés. Je pense notamment à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Demain, il y aura plus de diversité parmi nos élus, qui représenteront mieux la société. Grâce à la proposition de loi de Jacqueline Gourault et de Jean-Pierre Sueur, la vitalité démocratique de notre pays sera renforcée et nos citoyens pourront s’engager plus facilement dans la vie publique.
Nos élus locaux accomplissent une noble et difficile tâche. Chaque jour, ils mettent leur énergie au service de l’intérêt général. Dans une société de plus en plus impersonnelle et dématérialisée, où le lien social se distend, les élus locaux sont les garants de la continuité républicaine. Ils font face à des contraintes de plus en plus lourdes. L’argent public est rare, les normes sont multiples, la demande sociale est croissante…
Le choix de représenter ses concitoyens et de se mettre au service de l’intérêt général, beaucoup le font en conscience, par devoir, mais aussi parfois par défi. Pourtant, nous le savons bien, ce n’est pas un choix facile. Tout le monde ne concourt pas à égalité dans cette grande bataille démocratique.
À cela, il y a d’abord des raisons financières. Faut-il rappeler ici que 80 % des élus municipaux ne perçoivent aucune indemnité ? Leur investissement auprès des habitants, de jour comme de nuit, est bien souvent bénévole. Nous l’avons vu récemment, avec les tragiques événements survenus dans le sud de la France.
C’est un engagement lourd. La majorité des élus, notamment dans les petites communes et communautés de communes, sont obligés de garder une activité professionnelle à côté de leur mandat. Cela explique que les élus soient majoritairement fonctionnaires, statut qui offre la possibilité de retrouver son emploi au terme du mandat, retraités ou membres de professions libérales.
Je trouve choquant d’entendre des candidats à des élections annoncer par avance qu’ils renonceront à leur indemnité s’ils sont élus : c’est envoyer le message que, au fond, les élus n’ont pas besoin d’être rémunérés, en oubliant que certains d’entre eux, amenés à renoncer à leur activité professionnelle, n’ont aucune autre source de revenu que leur indemnité. Une telle attitude ne rend donc pas service à la démocratie, et j’espère que de telles déclarations ne se multiplieront pas. La représentation de nos concitoyens ne doit pas être réservée aux plus aisés, aux héritiers ou aux membres de professions suffisamment rémunératrices pour leur permettre de consacrer bénévolement du temps à l’exercice d’un mandat. La société est complexe, multiple : chacun doit pouvoir accéder aux mandats électifs.
Il nous incombe à tous de souligner que la vie de l’élu n’est pas facile, qu’elle suppose des sacrifices, qu’elle ignore souvent la sécurité et qu’elle est parfois marquée par la précarité.
Dans le climat actuel de défiance qui entoure l’action publique – à cet égard, les résultats de quelques récents sondages sont assez alarmants –, les élus doivent aussi faire face à toutes sortes de suspicions. Parce qu’ils incarnent l’autorité publique, les élus locaux sont en première ligne pour affronter les critiques de leurs concitoyens. Ils doivent donc être exemplaires en tous points, et ils le sont.
Le Président de la République a fait le choix clair d’une refondation profonde de notre vie politique. Nous devons aux Français l’exemplarité. Avec les réformes relatives à la transparence de la vie publique, à la lutte contre l’évasion fiscale, à l’instauration de la parité pour les conseillers départementaux, à la fin du cumul, nous avons déjà beaucoup fait. M. le Premier ministre le rappelait lors du dernier Congrès des maires : « partout où l’échelon communal retrouve les moyens d’agir, c’est la République qui progresse », car le maire est « la démocratie en personne ».
J’aimerais m’arrêter sur l’un des points qui alimenteront nos débats.
Depuis plusieurs années, le Sénat propose de modifier la définition de la prise illégale d’intérêt applicable à toute personne publique, au motif que celle-ci serait encore trop floue. Je sais toute l’importance que la Haute Assemblée accorde à ce sujet difficile, sur lequel elle travaille depuis plus de dix ans. Néanmoins, je tiens à dire ici, au nom de Mme la garde des sceaux et de l’ensemble du Gouvernement, que modifier cette définition n’est sans doute pas la meilleure solution.
En effet, en dix ans, la jurisprudence s’est stabilisée. Un changement législatif aurait pour conséquence immanquable de susciter de nouveaux débats d’exégèse médiatique et de bouleverser la jurisprudence que les élus connaissent bien.
Au-delà, il nous semble que légiférer dans ce domaine est peu lisible pour nos concitoyens. Chaque année, moins de trente condamnations concernent des élus, alors que ceux-ci sont au nombre de 618 384 : c’est très peu, et encore les citoyens ont-ils, dans la majorité des cas, rendu une forme de justice à l’élu mis en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu de protéger les élus contre de prétendues poursuites abusives.
C’est pourquoi le Gouvernement entend être aussi ferme aujourd’hui qu’il le fut lors des précédentes discussions sur ce sujet.

On ne peut pas dire qu’il ait été très ferme contre les abus bancaires ! Avouez que les lois bancaires sont tout de même un peu laxistes !
Ce que je vous propose, c’est de travailler avec les juridictions compétentes pour établir un guide, à partir de la jurisprudence, afin que les choses soient claires pour tous les élus de France. Étant moi-même une élue locale, je crois qu’il est important de savoir à quel moment on doit se déporter et ne pas voter telle ou telle subvention.
Dans ce guide seraient précisés les droits et les devoirs des élus dans le domaine qui nous occupe. C’est à mes yeux la bonne solution.
Plus largement, le texte que nous examinons est le fruit d’un intense travail parlementaire, et le Gouvernement s’est appuyé sur de nombreux rapports pour proposer des avancées sensibles.
L’Assemblée nationale a conforté la vision du Sénat et proposé plusieurs mesures, comme l’instauration d’une charte des élus locaux, que certains d’entre vous approuvent et d’autres non ; nous en débattrons tout à l’heure. En tout état de cause, cette charte n’est pas un élément de droit ; sa valeur est largement symbolique, j’en conviens, mais sa mise en place n’en aurait pas moins de prix en une période où, malheureusement, les élus ne sont pas suffisamment respectés et où leur rôle est mésestimé.
L’Assemblée nationale a aussi créé la possibilité, pour les élus, de se faire rembourser des frais de garde d’enfants. Cette disposition, qui a été introduite par le biais d’un amendement du Gouvernement, vise à améliorer les conditions d’exercice du mandat de ceux qui assument également la charge d’une famille. Que de réunions à 18 heures 30 qui posent problème aux élus par ailleurs parents ! Aujourd’hui, le remboursement de ces frais est logiquement réservé aux conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonction ou aux membres d’exécutifs locaux qui cessent leur activité pour assumer leur mandat. Le Gouvernement a donc souhaité élargir cette possibilité à tous les élus.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la France a besoin d’élus libres et compétents, de femmes et d’hommes de tous horizons, animés par la passion du bien public et capables de créativité et d’initiative.
C’est tout l’objet du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires qui viendra en discussion dans quelques semaines et renforcera l’empreinte des élus locaux sur leur territoire.
Les élus devront et sauront, j’en suis certaine, prendre toutes leurs responsabilités. La présente proposition de loi les y aidera en leur donnant les moyens de bien exercer leurs fonctions.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de l’excellent travail accompli. Je sais que nos positions sont différentes, mais j’aime le débat ! §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de me réjouir que, après qu’une première proposition de loi adoptée le 30 juin 2011 par le Sénat eut été laissée sans suite par l’Assemblée nationale, celle dont nous débattons ce soir en deuxième lecture ait été soumise au vote des députés : le 18 décembre 2013, ils en ont approuvé l’économie générale et l’ont complétée sur plusieurs points.
Le dispositif sénatorial visait à mieux garantir les facilités déjà prévues par la loi pour l’exercice des fonctions électives.
Le Sénat a conforté la démarche des deux auteurs de la proposition de loi, nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, qui se voulaient pragmatiques et réalistes en ciblant les dispositions les plus nécessaires pour endiguer le déclin du nombre des candidatures aux responsabilités locales et maintenir la vitalité et la diversité de la démocratie locale.
Le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée comporte des améliorations sensibles, susceptibles d’élargir le vivier des responsables locaux en favorisant notamment une meilleure conciliation entre fonction élective et activité professionnelle.
Il vise tout d’abord à harmoniser le régime indemnitaire des exécutifs, selon les quatre points suivants.
Premièrement, il prévoit que l’indemnité du maire soit fixée à un taux unique correspondant au taux maximal prévu par le barème de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales.
Deuxièmement, il est proposé que le régime indemnitaire des membres de l’organe délibérant des communautés de communes soit aligné sur celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Troisièmement, il instaure le reversement au budget de la collectivité concernée de la part écrêtée de l’indemnité au-delà du plafond fixé par la loi en cas de cumul de rémunérations et d’indemnités.
Quatrièmement, il exclut de la fraction représentative des frais d’emploi les revenus pris en compte pour le versement d’une prestation sociale sous condition de ressources.
Il s’agit ensuite de mieux protéger les élus salariés, par le biais des neuf dispositions suivantes : extension du congé électif aux communes de 1 000 habitants au moins ; mise en place d’un crédit d’heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants ; élargissement du champ des bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail et à réinsertion dans l’entreprise à l’issue du mandat, et prolongation de la période d’effet jusqu’au terme du second mandat consécutif ; attribution de la qualité de salarié protégé aux bénéficiaires du droit qui n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle ; extension du droit au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences aux adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants ; doublement de la période de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat, pour la faire passer de six mois à un an ; suspension du décompte de la période de validité de la liste des lauréats à un concours de la fonction publique territoriale pour la durée du mandat électif ; ouverture aux titulaires d’une fonction élective locale du dispositif de validation de l’expérience acquise à ce titre pour la délivrance d’un diplôme universitaire ; institution de la faculté, pour les membres des assemblées délibérantes, de constituer un droit individuel à la formation.
La proposition de loi vise, enfin, à encourager la formation des élus locaux, …

… avec l’instauration d’un plancher de dépenses obligatoires pour la formation des membres des assemblées délibérantes, la mise en place d’un dispositif de report des sommes non dépensées une année sur le budget suivant de la collectivité, dans la limite du renouvellement général du conseil, et l’institution de l’obligation, pour les collectivités, d’organiser une formation au cours de la première année de mandat des conseillers municipaux, généraux, régionaux et des conseillers communautaires ayant reçu délégation.
Reprenant une disposition précédemment adoptée par le Sénat, en 2010, l’article 1er A vise à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêt.
Ce dispositif a été modifié par l’Assemblée nationale, qui a introduit dans le texte des propositions formulées par la mission d’information créée par sa commission des lois, sur le rapport des députés Philippe Doucet et Philippe Gosselin. Nous y reviendrons, car nous souhaitons défendre le texte que le Sénat avait adopté à l’unanimité en première lecture. La commission des lois du Sénat a en effet changé son fusil d’épaule ce matin, en revenant à la notion d’« intérêt personnel distinct de l’intérêt général », que notre assemblée avait jugée plus claire que celle d’« intérêt quelconque » figurant actuellement dans la loi.
Madame la ministre, vous avez indiqué que l’on relevait seulement trente condamnations pour plus de 600 000 élus. Cependant, il faut aussi penser à ceux qui ont été inquiétés, entendus par la gendarmerie et dont la vie a été longtemps gâchée. Je connais des cinquantaines de cas de cet ordre, mais j’évoque toujours le même, car il est révélateur : en Saône-et-Loire, un maire ayant fait voter par son conseil municipal une subvention au club de football de sa commune, qui opère à un bon niveau, a été mis en cause pour prise illégale d’intérêt, au seul motif que son neveu jouait dans une des équipes du club ! Au bout d’un an, évidemment, l’affaire a tourné en eau de boudin et le maire n’a pas été condamné, mais sa vie a été gâchée pendant tout ce temps…
Outre plusieurs coordinations rendues nécessaires par les lois promulguées depuis le vote du Sénat – concernant notamment l’attribution de l’indemnité de fonction des maires d’arrondissement de Paris, de Lyon et de Marseille –, les principaux ajouts adoptés par l’Assemblée nationale sont les suivants.
Premièrement, les députés ont institué une charte de l’élu local. Nous avons réduit de moitié, de douze à six, le nombre de ses articles, car certaines stipulations nous semblaient superfétatoires. Par exemple, il n’est pas utile de préciser que « les élus doivent respecter la loi » : c’est tout de même la moindre des choses !
Deuxièmement, l’application du taux unique pour fixer le montant de l’indemnité du maire a été restreinte aux communes de moins de 1 000 habitants.
Troisièmement, le bénéfice du dispositif de majoration des indemnités qui peut être mis en œuvre dans les communes chefs-lieux de canton a été maintenu pour celles d’entre elles qui perdraient cette qualité à la suite de la réforme en cours de la carte cantonale.
Quatrièmement, l’Assemblée nationale a prévu l’insertion obligatoire dans les règlements intérieurs des conseils généraux et régionaux du principe de la réduction du montant des indemnités de leurs membres à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Cinquièmement, les députés ont étendu le droit à suspension du contrat de travail et de la qualité de salarié protégé aux élus des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille.
Sixièmement, ils ont ouvert la faculté, pour les conseils municipaux, d’accorder à l’ensemble de leurs membres le remboursement des frais d’aide à la personne engagés par les élus pour participer aux réunions auxquelles ils sont convoqués ès qualités. Aujourd’hui, le bénéfice de ce mécanisme est réservé aux conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonction. Parallèlement, ce dispositif est étendu aux conseils généraux et régionaux.
Septièmement, l’Assemblée nationale a adopté une modification du mode de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat et instauré une dégressivité de son montant.
Enfin, elle a supprimé les dispositions instituant le droit individuel à la formation pour les conseillers communautaires.
Les députés ont reporté l’entrée en vigueur de certains articles de la proposition de loi au prochain renouvellement général des assemblées délibérantes concernées. Ils ont en outre prévu l’application dans les territoires ultramarins soumis au principe de spécialité législative des dispositions qui, aux termes de leurs statuts respectifs, relèvent de la loi ordinaire.
Sous certaines réserves, le texte proposé mérite d’être approuvé.
Pour la commission des lois, les compléments apportés par l’Assemblée nationale à la proposition de loi constituent généralement des prolongements du dispositif sénatorial.
Elle a, cependant, amendé le texte voté par les députés sur plusieurs points, pour clarifier la rédaction de la charte de l’élu local en la recentrant sur les comportements vertueux et les bonnes pratiques, indépendamment même des prescriptions ou interdictions de la loi ; supprimer l’article 1er bis A, préférant s’en remettre, pour sanctionner l’absentéisme des élus aux travaux de leur collectivité, à la libre décision des assemblées locales, lesquelles, aujourd’hui, ont dans l’ensemble déjà prévu des mesures répressives dans leurs règlements intérieurs ; maintenir les modalités en vigueur de financement du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat ; rétablir la faculté, pour les conseillers communautaires, de constituer un droit individuel à la formation ; ajuster l’extension des dispositions pertinentes de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Cette proposition de loi constitue donc un ensemble d’améliorations notables, visant particulièrement à tenir compte des contraintes professionnelles des responsables locaux. Elle devrait conforter l’engagement des élus, alors que la gestion locale est aujourd’hui complexe et lourde, sous le poids des attentes et des exigences croissantes des administrés.
Au terme de ses travaux, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu’elle a établi pour cette proposition de loi. §

La parole est à Mme la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que Jean-Pierre Sueur et moi-même avons déposée règle des questions très concrètes et fait suite aux états généraux de la démocratie territoriale.
Le code général des collectivités territoriales contient déjà des éléments constitutifs du statut de l’élu local. Ils sont regroupés dans le chapitre intitulé « Conditions d’exercice des mandats » pour chaque strate d’élus, municipaux, départementaux et régionaux. Toutefois, si nous avons déposé la présente proposition de loi, c’est parce que ces éléments se révèlent insuffisants et qu’il faut améliorer la situation des élus.
Pour faire pièce à certaines critiques que j’ai pu entendre, je soulignerai que ce texte répond aux principales attentes des élus, exprimées via des rapports ou même des propositions de loi qui, comme celle dont M. le rapporteur fut le coauteur, n’ont pu aboutir. Nous avons voulu rassembler toutes les mesures qui faisaient consensus et tendaient à améliorer le statut de l’élu.
Pour autant, cette proposition de loi n’est bien sûr pas exhaustive, même si son champ couvre un large spectre de sujets essentiels, notamment le droit d’absence, le droit à la suspension du contrat de travail, la prolongation de l’allocation différentielle de fin de mandat, la protection des élus, l’indemnisation des maires des petites communes, la formation des élus…
Nous souhaitons faciliter l’exercice des mandats locaux, en particulier pour les salariés du secteur privé, car, force est de le reconnaître, une profonde inégalité existe actuellement à cet égard entre ceux-ci et les fonctionnaires, qui disposent de facilités bien plus grandes pour s’organiser.
Au cours de la navette, l’Assemblée nationale a apporté diverses modifications à cette proposition de loi, que M. le rapporteur vient d’énumérer. J’insisterai, pour ma part, sur la création d’une charte de l’élu local. Cette disposition a été débattue assez longuement en commission des lois, ce matin et la semaine dernière, et modifiée par celle-ci. À cet égard, je tiens à saluer l’énorme travail accompli par M. Saugey, qui s’est efforcé de concilier les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour que ce texte ait le maximum de chances d’aboutir. Qu’il en soit remercié !
Sur le fond, la construction d’un statut de l’élu est une entreprise de longue haleine. Alors que l’acte I de la décentralisation commençait à peine à prendre forme, un rapport du sénateur Marcel Debarge, publié en janvier 1982, présentait la création d’un statut de l’élu local comme le complément nécessaire du basculement en cours, c’est-à-dire de la décentralisation.
C’est pourquoi l’article 1er de la loi du 2 mars 1982 indiquait que des lois détermineraient le statut des élus.

Mme Jacqueline Gourault, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. D’ailleurs, hier, en présentant ses vœux aux bureaux des assemblées parlementaires, le Président de la République a estimé que la limitation du cumul des mandats était inséparable de la définition d’un statut de l’élu. Comme on le voit, les grandes lois s’accompagnent d’une évolution du statut de l’élu, ou du moins de la promesse d’une telle évolution.
M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.

Rappelons que des avancées progressives et partielles ont été accomplies. Ainsi, le législateur a organisé les conditions d’exercice des mandats locaux par la loi du 3 février 1992, et il les renforce régulièrement en accordant aux élus un certain nombre de droits et de garanties de base. La présente proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, s’inscrit dans cette logique, dont elle étend quelque peu la portée.
Cette démarche s’est révélée globalement efficace, car elle a permis la création d’un cadre juridique facilitant sensiblement l’exercice du mandat local. Certes, nombreux sont ceux aux yeux desquels il n’existe pas de véritable statut de l’élu, mais un certain nombre d’éléments sont néanmoins en place !

Ces mesures sont adaptées aux réalités de l’exercice des mandats locaux. Par exemple, la modulation du régime des indemnités en fonction du type de responsabilité assumée et de la taille de la collectivité correspond aux besoins effectifs.
En revanche, d’autres dispositions, incontestables dans leur principe, peuvent poser des problèmes d’application. Il en est ainsi de l’extension, à compter du 1er janvier 2013, de la protection sociale à l’ensemble des élus qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors : il s’agit a priori d’un progrès indiscutable, mais elle a été conçue sans véritable concertation avec les associations d’élus, d’où des difficultés de mise en œuvre. En particulier, les indemnités de fonction sont assujetties à cotisations dès le premier euro, alors que la fraction représentative de frais d’emploi ne peut être considérée comme un revenu ; il s’agit plutôt d’un remboursement.
Peut-on d’ailleurs considérer l’indemnité elle-même comme un revenu, alors que la circulaire du ministère de l’intérieur en date du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux rappelle que l’indemnité de fonction allouée aux élus locaux ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque ? Certaines évolutions sont sans doute nécessaires.

Bien entendu, le sempiternel débat entre bénévolat et professionnalisation des élus reste d’actualité.
J’ai l’honneur de présider la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, au nom de laquelle Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet ont rédigé un rapport posant la question de la « professionnalisation des élus ». Ce matin encore, la commission des lois a évoqué cette question, en débattant d’un amendement de M. Collombat, qui n’a pas été adopté.

J’ignore si les Français sont prêts ou non à accepter que les élus, sur lesquels ils se reposent en général avec une entière confiance, ne soient pas entièrement bénévoles. Il est bien difficile de concilier la figure de l’élu local compétent, disponible, indispensable au bon fonctionnement de la décentralisation, avec la nostalgie d’une époque où les élus, auxquels on ne demandait pas de posséder des compétences très larges, étaient issus d’un vivier socialement homogène, celui des notables locaux. C’est là une véritable question !
L’exercice d’un mandat exécutif est très spécifique et ne peut pas prendre la forme d’une carrière organisée. Le métier d’élu est par essence précaire. Il s’exerce différemment selon la taille des collectivités et correspond à des fonctions particulières. On y accède par la voie de l’élection politique. Il n’y a pas de barrière académique, mais la nécessité d’une formation initiale et continue pour l’exercer convenablement a été reconnue, de même que la valeur du savoir-faire acquis au cours du mandat, ce qui a justifié l’extension aux élus locaux du système de la valorisation des acquis de l’expérience.
En résumé, il s’agit d’un « métier » pas comme les autres, …

… sans impératifs de qualifications, sans carrière certaine, sans concours, sans entretiens d’embauche, sans échelons à gravir d’année en année.
Le travail et la réflexion sont encore devant nous pour construire un statut de l’élu local en tirant les leçons des conditions actuelles de la démocratie décentralisée et de la loi relative à la limitation du cumul des mandats. Cependant, la présente proposition de loi apporte sa pierre à l’édifice.
Je conclurai par une réflexion de Vladimir Jankélévitch pouvant s’appliquer au travail persévérant du législateur : « L’entreprise humaine se développe dans un monde de facteurs occasionnels qui à la fois l’entravent et la favorisent. L’homme est l’ingénieur des occasions. »
Mes chers collègues, la proposition de loi que Jean-Pierre Sueur et moi-même vous présentons aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la construction du statut de l’élu local. Madame la ministre, je forme un double vœu : que le Sénat, dans sa sagesse, adopte le présent texte et que sa discussion soit inscrite le plus tôt possible à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, afin que ses dispositions puissent profiter à ceux qui seront élus lors du scrutin municipal de mars prochain ! §

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission des lois.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, au nom de la commission des lois, dont le président, M. Sueur, nous rejoindra tout à l’heure, souligner l’attachement particulier du Sénat à ce texte, qui constitue une amorce de statut de l’élu local.
Au cours des deux dernières semaines, la commission des lois a consacré quatre heures de discussion à cette proposition de loi. En effet, à une très forte majorité, ses membres ont jugé qu’il fallait aboutir à un accord, à la fois avec nos collègues députés et avec le Gouvernement. Notre rapporteur, Bernard Saugey, s’y est employé : je tiens à l’en remercier au nom de la commission des lois.
Pour parvenir à cet accord, la commission des lois compte sur une deuxième lecture devant l’Assemblée nationale et la tenue d’une commission mixte paritaire. Elle vous demande donc instamment, madame la ministre, de ne pas brusquer les choses ce soir et de faire en sorte que la discussion de cette proposition de loi en deuxième lecture soit inscrite le plus rapidement possible à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, afin que le texte puisse être adopté définitivement et promulgué avant la fin du mois de février. Il convient, comme l’a souligné Mme Gourault, qu’il puisse s’appliquer à ceux qui seront élus en mars.

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, je ne puis manquer d’évoquer, en préambule, un sujet connexe à celui qui nous occupe ce soir.
Alors que le présent texte vise notamment à encadrer les indemnités des élus, la banque des collectivités territoriales, Dexia, a décidé d’augmenter de plus de 30 % la rémunération de trois de ses dirigeants, …

… en la faisant passer de 340 000 à 450 000 euros par an, son patron émargeant quant à lui à 600 000 euros annuels. Rappelons que les contribuables ont renfloué à hauteur de 5, 5 milliards d’euros cette banque, qui a perdu 15 milliards d’euros en trois ans !

Je veux bien que les dotations des collectivités locales soient réduites, …

… je veux bien que l’on joue la transparence à outrance, mais dans ces conditions il m’aurait été difficile de passer ces faits sous silence, …

… d’autant que je ne suis pas certaine qu’il en soit fait état demain, à l’occasion des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle également que la banque en question est responsable des emprunts toxiques qui ont empoisonné la vie de nos collectivités locales, lesquelles ne s’en sont pas encore remises.

J’ajoute que Dexia a réduit ses effectifs de 22 000 à 1 300 salariés. Je me devais d’évoquer ce sujet, sur lequel le groupe UDI-UC a publié hier un communiqué !

J’en viens maintenant au texte qui nous est soumis ce soir, un an après sa première lecture, le 29 janvier 2013. Le 18 janvier 2001, déjà, le Sénat avait adopté un texte tout à fait intéressant consacré au statut de l’élu, dont Jean-Paul Delevoye était le rapporteur. Il s’agissait d’un texte complet, concis et parfaitement calibré. Las, il n’a jamais pu franchir le boulevard Saint-Germain pour être examiné par l’Assemblée nationale ! Avec l’appui de Jean Arthuis, Daniel Goulet avait déposé à l’époque plusieurs amendements, visant notamment à assurer la protection de l’élu. Cette question a finalement trouvé réponse dans la présente proposition de loi, du moins en partie, car le problème de la protection du candidat à une élection n’est, lui, toujours pas réglé. J’avais défendu un amendement sur ce point en première lecture, mais, compte tenu de la règle dite « de l’entonnoir », je n’ai pu le déposer de nouveau.
Madame le ministre, le duo de choc Gourault-Sueur a encore frappé §

Mme Nathalie Goulet. … avec ce texte, qui vient compléter notre arsenal juridique. Toutefois, en dépit de l’amitié et de l’admiration indéfectibles que j’éprouve pour Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur
Exclamations amusées.

Ce n’est pas en accumulant les petits textes et les rustines que l’on construit une législation cohérente.
Madame le ministre, cette intervention est dictée par la mauvaise humeur…
Tout ou presque a déjà été dit sur ce texte. Nous redessinons les cantons, nous avons redessiné les intercommunalités, on nous promet l’acte III de la décentralisation, et le Président de la République a annoncé une révision de la carte des régions. Tout cela manque quelque peu de cohérence ! Nous avions d’ailleurs vécu une situation analogue avec l’annonce d’une grande réforme fiscale alors que nous abordions l’examen de la loi de finances.
On dit souvent qu’il faut faire confiance à l’intelligence territoriale, madame le ministre, mais allez-vous laisser les territoires respirer et s’organiser, comme dans la région lyonnaise sous l’impulsion de Michel Mercier et de Gérard Collomb ?
J’ajoute que nous examinons ce texte alors que l’Assemblée nationale vient de voter l’interdiction du cumul des mandats. La présente proposition de loi fait d’ailleurs très judicieusement référence à l’exercice, par les élus locaux, de « leur mandat », au singulier, ce qui est tout de même un très bon signal…
Cela étant, la prochaine suspension d’un mois des travaux du Parlement est destinée, manifestement, à encourager les cumulards : députés et sénateurs candidats à un mandat municipal pourront faire campagne tranquillement ! Cela ne m’apparaît pas non plus très cohérent.
Madame le ministre, de fusions d’intercommunalités mal comprises en découpages cantonaux, de réforme en réforme, on décourage et on démotive les élus.

Je ne dis pas cela pour mon département, où la règle des « ciseaux d’or » ne s’est pas appliquée. D’ailleurs, dans la mesure où aucun conseiller général ou presque ne vote pour moi, je ne suis pas du tout concernée !
Il sera de plus en plus difficile de trouver des candidats aux élections municipales, d’autant que les multiples réformes des modes de scrutin n’ont pas simplifié les choses, bien au contraire : les règles se sont opacifiées, et les élus se trouvent en situation d’insécurité juridique. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir, madame le ministre ! Nos élus, vous l’avez dit, sont compétents, généreux, bénévoles, mais ils sont profondément démotivés.
Quoi qu’il en soit, il faut remercier Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur de cette petite rustine, même si elle ne règle en rien le problème. Nous devons nous attacher à ne pas légiférer par morceaux, car on aboutit à un puzzle totalement illisible. Les élections municipales verront une avalanche de votes pour le Front national, dont nous ne voulons pas !

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte constitue une étape dans l’amélioration de l’exercice de leur mandat par les élus locaux.
La mise en place d’un véritable statut de l’élu est une exigence démocratique maintes fois rappelée par l’immense majorité des élus. Il s’agit en effet d’un outil indispensable à la mise en œuvre de l’article 1er de notre Constitution, aux termes duquel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
Il faut bien le reconnaître, cette égalité affirmée par notre Constitution ne transparaît pas toujours dans nos assemblées locales, communales, départementales et régionales, qui sont loin d’être à l’image de notre société. Malgré les progrès obtenus grâce à l’évolution des modes de scrutin communal et régional, femmes, jeunes, citoyens issus de l’immigration, salariés du privé, ouvriers et employés sont insuffisamment représentés. Le pluralisme est trop souvent absent, sans parler du droit de vote des étrangers non communautaires, qui, malgré les promesses, reste l’arlésienne de cette mandature.

Notre groupe, comme l’ensemble de la gauche, s’est toujours fixé pour objectif de mettre en place un statut de l’élu, afin que chacun, sans condition d’origine ethnique, sociale ou professionnelle, puisse être représenté, voire se présenter pour faire partie des 550 000 élus locaux que compte notre pays et qui constituent le poumon de notre démocratie.
Ainsi, entre deux actes de la décentralisation, poursuivre le débat sur le statut de l’élu nous semble nécessaire. Je salue, à ce titre, la démarche entreprise par nos collègues, même si elle est de portée limitée.
Dans un premier temps, il faut souligner les avancées que permet ce texte : quelles que soient ses limites, il nous semble que nous faisons ici œuvre utile. Eu égard à la loi de décentralisation votée il y a quelques semaines et à celle qui reste à venir, nous sommes incités à aborder l’ensemble des problématiques pour définir un véritable statut de l’élu, codifiant les droits et les devoirs de celui-ci.
Nous saluons les mesures contenues dans ce texte tendant à harmoniser le niveau d’indemnisation des maires. De même, nous approuvons l’attribution d’une indemnité de fonction aux membres de l’organe délibérant des communautés de communes ayant reçu délégation du président. Nous apprécions, en outre, la clarification portant sur la nature fiscale de l’indemnisation des frais d’emploi.
Le deuxième axe de cette proposition de loi vise à faciliter l’exercice d’un mandat par des salariés du privé. Nous ne pouvons que soutenir toute amélioration dans ce domaine, car les difficultés rencontrées par ces citoyens freinent fortement leur engagement dans un mandat électif. Cependant, comme nous l’avions souligné en première lecture, il conviendrait, dans un souci d’efficacité et de lisibilité, que ces dispositions soient également inscrites dans le code du travail, seule référence juridique pour les relations entre un salarié et son entreprise.
La proposition de loi tend, en troisième lieu, à encourager la formation des élus locaux par l’instauration d’un plancher de dépenses obligatoires pour la formation des membres des assemblées délibérantes, d’un dispositif de report des sommes non dépensées d’une année sur le budget suivant de la collectivité, dans la limite du renouvellement général du conseil, et d’une obligation, pour la collectivité, d’organiser une formation au cours de la première année du mandat des conseillers municipaux, généraux, régionaux et des conseillers communautaires ayant reçu délégation.
Nous partageons ces principes et ces exigences, mais, afin de rendre effectif ce droit à la formation des élus, il nous paraît nécessaire, compte tenu du coût des stages de formation et des moyens financiers limités d’un grand nombre de nos communes, d’envisager une forme de mutualisation de ces dépenses. Cela permettrait à tout élu, quelles que soient la taille et la richesse de sa collectivité, d’avoir accès à une formation de qualité. La réflexion sur ce point mériterait d’être poussée.
Nous comprenons toutefois que nos collègues se soient limités à quelques dimensions de la question du statut de l’élu, qu’ils aient cherché à régler des difficultés d’application de mesures déjà prises et à élargir le champ de ces dernières.
Malgré quelques obstacles institutionnels, nous arrivons ainsi, par petits pas, à faire avancer les choses, sans attendre le Grand Soir du statut de l’élu ; je salue le pragmatisme de nos collègues.
Les députés ont aussi, de leur côté, apporté leur pierre à l’édifice, en permettant, par exemple, l’institution d’une charte de l’élu local pour « préciser les normes de comportement que les élus doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions ».
En effet, le statut de l’élu ne saurait être constitué que de droits. Ses devoirs doivent faire l’objet du second volet de notre réflexion, si nous ne voulons pas que le dispositif de ce texte soit perçu comme un ensemble d’avantages supplémentaires octroyés aux élus. Nous saluons, là aussi, la démarche constructive adoptée, même si nous aurions pu souhaiter que cette charte soit mieux équilibrée et fasse état non seulement des devoirs des élus, mais aussi de leurs droits.
S’agissant de la nouvelle définition du champ des poursuites du délit de prise illégale d’intérêt, je me range, madame la ministre, à l’avis de sagesse que vient d’exprimer notre collègue Jean-Pierre Michel : ne bousculons pas ce soir la position adoptée par la commission des lois du Sénat. Toute demande de vote bloqué serait, de ce point de vue, très mal perçue !
En conclusion, mes chers collègues, nous ne pouvons qu’exprimer notre accord avec les objectifs visés au travers de ce texte, en attendant la réforme globale qui instituera un véritable statut de l’élu, dont il est question depuis trente ans.
Cette réforme reste nécessaire, afin que chacun retrouve confiance en nos institutions et soit encouragé à participer plus largement à la vie citoyenne. La restauration de la confiance passera notamment par l’adoption d’un texte précisant clairement l’ensemble des droits et devoirs des élus, en toute transparence. Ce texte devra également revoir nos modes de scrutin, de manière que tous les citoyens soient équitablement représentés dans chacune des assemblées de notre République. Il devra s’attacher à revivifier le débat politique local, et concerner non pas seulement les membres des exécutifs, comme c’est souvent le cas actuellement, mais bien tous les élus, qui font la vraie richesse de notre démocratie.
Enfin, il faudra veiller à garantir aux élus qui gèrent nos collectivités les moyens financiers nécessaires pour mener à bien leurs missions et leurs actions.
Eu égard aux conditions d’examen des propositions de loi, qui interdisent d’envisager de mettre en place des réformes de grande ampleur par ce moyen, et au couperet de l’article 40, qui empêche les parlementaires d’aller au bout de leur démarche, seul un texte du Gouvernement permettra de remédier véritablement aux difficultés rencontrées par nos élus, rappelées très fortement lors des états généraux de la démocratie territoriale organisés au Sénat en octobre 2012.
Je vous engage donc, madame la ministre, à consacrer du temps parlementaire à la discussion d’un projet de loi complet portant sur les sujets que je viens d’évoquer. Dans cette attente, nous saluons les avancées contenues dans le texte qui nous est soumis : le groupe CRC le votera. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mise en place d’un statut de l’élu peut être envisagée de deux manières.
La première, c’est le Grand Soir dont tout le monde rêve : l’élaboration d’un texte exhaustif, qui modifie tout et satisfait toutes les demandes de nos élus locaux en termes de disponibilité, d’indemnité, de protection sociale et de droit à la retraite. C’est une possibilité, qui avait été envisagée en 1982 : on pensait même, alors, qu’un quatrième chapitre pourrait être ajouté au statut de la fonction publique, consacré à une sorte de fonction publique élective. Toutefois, cette idée n’a pas prospéré.
En réalité, ce rêve se heurte à la diversité des situations, …

… entre membres des professions libérales et fonctionnaires, entre actifs et retraités, pour ne prendre que ces exemples. La situation familiale joue également : une personne qui a des enfants rencontre des difficultés particulières pour exercer un mandat. À cet égard, d’ailleurs, le présent texte comporte des avancées : il prévoit que les frais de garde pourront être remboursés sous certaines conditions.
Il m’apparaît donc que nous devons renoncer au Grand Soir du statut de l’élu, pour nous satisfaire d’un texte aux ambitions plus modestes, plus pragmatiques, en revenant ainsi à la pratique mise en œuvre depuis la grande loi de 1982. La loi du 27 février 2002, sous l’impulsion de Lionel Jospin, avait ainsi institué un congé pour campagne électorale, des allocations de fin de mandat et une formation professionnelle.
La proposition de loi présentée par Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault s’inscrit dans cette lignée. Elle ajoute à l’édifice une nouvelle pierre, également travaillée par le rapporteur, Bernard Saugey.
Une dimension importante du texte a trait aux indemnités : il faut faire front contre une vision populiste selon laquelle les élus coûtent trop cher, alors que, d’une part, beaucoup d’entre eux sont bénévoles, et que, d’autre part, le coût total des indemnités est nettement inférieur à 1 % du budget des collectivités territoriales.
Ce texte traite de deux autres points que je qualifierai de sensibles : la prise illégale d’intérêt et la définition d’une charte des élus.
Concernant la prise illégale d’intérêt et la modification envisagée du code de procédure pénale, il existe, me semble-t-il, trois solutions.
La première consiste à en rester à la législation actuelle, qui date, certes, de 1994, mais qui présente l’avantage d’avoir suscité une jurisprudence : celle-ci peut plaire ou déplaire, mais, en tout cas, avec elle, nous savons où nous allons. Cette jurisprudence souligne notamment que, en matière de prise illégale d’intérêt, l’intérêt en cause peut être d’ordre non seulement matériel, mais également moral.
Mais voilà que nos collègues de l'Assemblée nationale ont renversé la table, en introduisant une nouvelle définition : l’intérêt en cause doit être « de nature à compromettre l’impartialité, l’objectivité ou l’indépendance de la personne ».
Personnellement, je le dis franchement, je ne vois que des inconvénients à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Tout d’abord, elle rouvrira un long chapitre en matière de jurisprudence, ce qui créera une incertitude juridique. Nous perdrons tous les repères offerts par la jurisprudence actuelle. Avec cette nouvelle rédaction, nous placerons nos élus locaux en situation de risque. Il faudra que la Cour de cassation définisse ce qu’elle entend par « impartialité », « objectivité » et « indépendance ».

Cela va prendre dix ans ! Pendant ce temps, pour les mêmes faits, un élu local sera condamné à Bordeaux et relaxé à Strasbourg.
Si nous ne voulons pas créer une telle incertitude, n’adoptons pas le texte de l'Assemblée nationale.
La troisième solution, c’est le texte que le Sénat a adopté à deux reprises.

Certes, il n’est peut-être pas parfait, mais il a le mérite de substituer à la notion d’« intérêt quelconque », d’un flou extraordinaire, celle d’« intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».
Pour ma part, je pense que la jurisprudence de la Cour de cassation se calera sur cette dernière notion, un intérêt personnel distinct de l’intérêt général pouvant être d’ordre matériel ou moral. Cette rédaction engendrera moins d’incertitudes que celle de l’Assemblée nationale, c’est pourquoi j’estime que nous devrions voter l’amendement que nous présentera tout à l'heure, à l’article 1er A, notre collègue Pierre-Yves Collombat. C’est la voie de la sagesse, d’autant que la rédaction voulue par le Sénat est issue des états généraux de la démocratie territoriale, qui ont notamment porté sur la question des normes et sur celle du statut de l’élu. Franchement, si elle devait être écartée d’un revers de main, cela ne témoignerait pas d’une grande considération pour le Sénat.

Sur la question de la charte de l’élu local, je suis davantage en désaccord avec certains de mes collègues.
Je le reconnais, la charte de l’élu local, telle qu’elle est prévue dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, peut prêter à sourire. Est-il nécessaire de préciser que les élus doivent appliquer la loi ou se conformer aux règles budgétaires ?... Cela va de soi.

On ne comprend donc pas très bien la portée du texte adopté par l'Assemblée nationale. À cet égard, je veux remercier M. le rapporteur d’avoir récrit cette charte pour la raccourcir.
Cela étant, je suis en désaccord avec ceux de mes collègues qui affirment qu’il ne faut pas du tout de charte. Pour ma part, j’estime que l’idée d’en instaurer une n’est pas mauvaise, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, même si cet argument n’est pas totalement convaincant, une charte de l’élu existe dans plusieurs pays : au Québec, bien entendu, mais aussi en Allemagne.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale s’est dotée – on l’oublie souvent – d’un code de déontologie, qui impose aux députés les devoirs d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité. Pourquoi ce qui est bon pour les députés ne le serait-il pas pour les élus locaux ?
En réalité, instituer une telle charte ne constitue pas une révolution : comme nous le soulignions ce matin encore en commission, elle a pour fonction de rappeler des exigences que certains pourraient avoir négligées ou oubliées.
Du reste, il ne s’agit au fond que d’étendre aux élus une pratique qui prévaut dans nombre de professions.

Ainsi, les architectes, les experts-comptables, les commissaires aux comptes doivent prêter serment d’exercer leur profession avec conscience et probité. Les magistrats, quant à eux, doivent jurer de se conduire en tout de façon digne et loyale, et les avocats d’exercer leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et même humanité.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas nous appliquer à nous-mêmes ce qui est bon pour les autres ? Il ne me semble pas choquant de rappeler que les élus doivent se comporter avec dignité et probité.

En adoptant cette charte dans la formulation retenue par la commission, nous avons plus à gagner qu’à perdre.
Je terminerai mon intervention en évoquant l’une de mes marottes, la formation. Je l’avais dit en première lecture, les élus semblent se croire omniscients. Parce que nous avons reçu l’onction du suffrage universel, nous élus saurions tout sur tout ! Ce n’est bien entendu pas le cas, et il faut donc prévoir une obligation de formation.
Enfin, il convient d’y insister, il serait bon que ce texte soit adopté avant les élections municipales, pour qu’il puisse s’appliquer dès cette année. Dans le cas contraire, certaines dispositions, parfois très importantes, ne s’appliqueraient qu’en 2020, ce qui serait tout de même étrange ! Il importe donc que nos collègues députés nous fassent l’honneur d’accepter d’inscrire deux heures de débat sur cette proposition de loi dans leur ordre du jour, aussi chargé celui-ci soit-il. §

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Daniel Raoul, Claude Dilain, Claude Bérit-Débat, Mme Mireille Schurch, MM. Philippe Dallier, Michel Bécot et Mme Valérie Létard ;
Suppléants : MM. Jean Germain, Jean-Jacques Mirassou, Joël Labbé, Robert Tropeano, Gérard César, Mme Élisabeth Lamure et M. Jackie Pierre.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :
– du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014,
– et du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, déposé sur le bureau du Sénat le 22 janvier 2014.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.