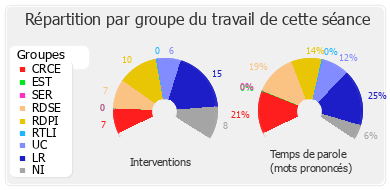Séance en hémicycle du 28 avril 2011 à 9h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste, de la proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le « mitage » de l’impôt sur les sociétés et à favoriser l’investissement, présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (proposition n° 321, rapport n° 428).
Dans la discussion générale, la parole est à M. François Marc, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers et nombreux collègues (Sourires.), la plupart d’entre vous ont probablement entendu parler du célèbre jeu télévisé Qui veut gagner des millions ?, qui est diffusé sur TFI. En restant sur ce registre qui nous est familier, j’aurais pu intituler ce texte : « Comment ne pas laisser filer 10 milliards d’euros ? ».
Chacun a conscience que notre Trésor public aurait bien besoin de cette somme. Le déficit public – 120 milliards d’euros en 2011 ! – s’est en effet dramatiquement creusé ces dernières années.
J’ai écouté hier avec beaucoup d’attention l’intervention de Mme la ministre Christine Lagarde. Cette dernière, à cette occasion, a évoqué les modalités de redressement de notre pays et a indiqué qu’il fallait plus de croissance. Néanmoins, j’ai été stupéfait de l’entendre nous préciser que cette croissance serait « spontanée », puis de l’entendre nous dire que les recettes apparaîtraient « spontanément ». Cette double spontanéité nous amène à nous interroger sur la détermination réelle du Gouvernement à faire face aux nécessités du redressement.
Je me souviens que, lorsque j’étais étudiant, mes ouvrages d’économie citaient Hayek, Smith et surtout Chuang Tzu, qui, 369 ans avant Jésus Christ, écrivait déjà dans un texte taoïste : « Le bon ordre apparaît spontanément lorsque les choses sont laissées à elles-mêmes ».
En définitive, je me demande si nous ne sommes pas face à un laxisme généralisé. Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, à savoir celui des niches fiscales, nous incite à nous poser la question.
La Cour des comptes ne cesse d’ailleurs de nous alerter sur ce point en rappelant que le déficit de la France est pour l’essentiel « structurel » et s’explique, pour au moins 60 milliards d’euros, par les nombreux abattements fiscaux et niches fiscales qui ont été consentis à des particuliers aisés ou à certaines catégories d’entreprises.
Monsieur le ministre, nous subissons depuis 2002 une mauvaise politique fiscale, une mauvaise politique de niches !
Il est clairement établi que, depuis 2002 – et surtout depuis 2007, d’ailleurs –, les lois de finances contribuent à un invraisemblable « mitage » des assiettes fiscales des entreprises, en particulier pour l’impôt sur les sociétés. On compte à ce jour pas moins de 293 dépenses fiscales en faveur des entreprises.
S’agissant du seul impôt sur les sociétés, l’impact cumulé des niches et des régimes de faveur, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, a conduit les entreprises à soustraire 70 milliards d’euros en 2010 aux contributions de l’impôt sur les sociétés « légalement » exigibles en France. On notera que le même manque à gagner fiscal n’était que de 18, 5 milliards d’euros en 2005. C’est dire à quel point la dérive est aujourd’hui avérée. Elle est d’ailleurs totalement insoutenable pour nos finances publiques.
Mais elle est tout aussi insoutenable par l’injustice fiscale qu’elle génère entre les entreprises françaises. Les PME se voient ainsi appliquer un taux réel d’impôt sur les sociétés beaucoup plus élevé que les très grandes entreprises. J’y reviendrai.
La logique républicaine voudrait que chaque entreprise contribue à la hauteur de ses moyens. Mais cette logique est, hélas ! aujourd’hui totalement bafouée.
L’expertise progressivement mise en œuvre en matière d’optimisation fiscale permet aux grands groupes financiers de tirer le meilleur parti des multiples opportunités offertes par les 293 niches fiscales exploitables.
Moins d’impôt sur les bénéfices, c’est plus de dividendes pour l’enrichissement des actionnaires ! Le capitalisme financier sort ainsi grandement gagnant du processus redistributif à la française favorisé depuis 2007.
Devant le constat accablant régulièrement formulé sur ce point par la Cour des comptes, le Gouvernement manifeste aujourd’hui son « émoi ». Mme Lagarde a ainsi déclaré voilà quelques semaines : « L’assiette de l’impôt sur les sociétés est rongée par les niches fiscales ». M. Baroin a même parlé il y a quelques jours de « l’impôt de chagrin ».
Pour sa part, M. Estrosi, ancien ministre chargé de l’industrie entre 2009 et 2010, a découvert tout à coup que le dispositif qu’il avait contribué à mettre en place est assassin pour les PME. Maintenant qu’il est redevenu député, il a déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête en vue de trouver les explications de cette situation d’injustice fiscale.
Si, de tous les bords politiques, on semble convenir que la situation devient inacceptable, il importe à nos yeux que le Parlement donne au plus vite l’impulsion souhaitable afin de corriger l’impact du système excessivement prédateur des niches fiscales. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Afin de tendre vers l’objectif visé, cette proposition de loi a pour objet de limiter le « mitage » de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, d’améliorer la justice fiscale entre les entreprises de différentes tailles et de favoriser le réinvestissement des profits au sein des entreprises.
Le texte proposé comporte trois articles concourant à ces objectifs.
L’article 1er vise à reprendre les préconisations du CPO et à supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé. Ce système ne profite aujourd’hui qu’à cinq groupes français, pour un coût de l’ordre de 450 millions d’euros.
L’article 2 tend à introduire un taux « plancher » d’impôt sur les sociétés réellement acquitté en direction des sociétés de grande taille, qui profitent aujourd’hui d’un cumul considérable de cadeaux fiscaux.
L’article 3 vise à instaurer une modulation du taux de l’impôt sur les sociétés en fonction du taux de réinvestissement et de distribution de dividendes.
À travers ces trois dispositions, somme toute très simples, cette proposition de loi répond à un besoin. Elle se fonde sur une exigence de plus grande justice fiscale et fait suite, comme on l’a vu, à un diagnostic assez largement partagé, quelle que soit notre appartenance politique.
Pourtant, certains nous disent qu’il est urgent d’attendre avant d’agir. Je voudrais répondre dès à présent aux objections, que l’on entend ici ou là, mises en avant pour s’opposer à l’adoption de cette proposition de loi.
Les trois premières objections portent sur des considérations de forme ou un calendrier inapproprié.
J’évoquerai en premier lieu le projet d’une future loi constitutionnelle qui réserverait la matière fiscale aux seules lois de finances. Au regard de cet argument, la présente proposition de loi serait dès lors hors-jeu, si je puis employer ce terme footballistique en cette période où de grands matchs se déroulent.
Sourires.

Pour répondre à cet argument, je ferai appel à un adage connu de tous : « Qui veut noyer son chien l’accuse d’avoir la rage ». On sait très bien que si l’on veut retirer toute responsabilité et tout rôle d’initiative au Parlement, il suffit d’utiliser systématiquement ce type d’argument.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Sénat, en trois semaines de débats, n’a été en mesure de modifier l’affectation que de 350 millions d’euros. Quand on sait que le budget de l’État portait sur 350 milliards d’euros, on voit à quel point les marges de manœuvre du Parlement sont quasi inexistantes en la matière. Si, en plus, on empêche ce dernier d’œuvrer en dehors des lois de finances, on aboutit, comme on le voit très bien aujourd’hui, à une stérilisation totale de l’action législative en matière financière !
Un second argument d’opportunité pourrait nous être opposé. Il s’agirait de considérer que la question d’établissement d’un taux plancher de l’impôt sur les sociétés ne se posera pas dès lors que les niches auront été toilettées ou supprimées.
En fait, on évoque aujourd’hui un délai d’au moins deux à trois ans avant d’aboutir à un toilettage de ces niches fiscales. Faut-il encore attendre tout ce temps ou peut-être encore davantage avant de remédier à l’inégalité fiscale ? Nous ne le pensons pas ! Toutes ces formulations savantes qui consistent à dire « il faudrait que », « peut-être serait-il mieux d’attendre » ne nous paraissent pas les plus appropriées face à la situation d’urgence que nous avons décelée.
De la même façon – c’est le troisième argument de forme de nos contradicteurs –, il paraîtrait opportun d’attendre les retours d’information concernant le projet européen relatif à l’assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés, l’ACCIS.
En réalité, il se dit que l’ACCIS ne serait rien d’autre que la mise sur pied d’une sorte de guichet unique dans le but de simplifier les démarches administratives des sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Europe. La Commission européenne a d’ailleurs précisé que « les États membres conserveraient intégralement leur droit souverain en matière de fixation du taux de l’impôt sur les sociétés » et que, au surplus, l’ACCIS « sera facultative ».
Il est donc difficile, là aussi, d’accepter l’idée que cet argument puisse retarder l’action législative immédiate que nous proposons.
Après ces trois arguments de forme, j’en viens à présent au principal argument de fond, qui est, quant à lui, de nature idéologique. On nous dit en effet que l’introduction par l’article 2 d’un « impôt réel minimum » sur les bénéfices pénaliserait les entreprises françaises et jouerait en faveur des délocalisations de sièges sociaux.
On a souvent entendu l’argument réducteur cher aux libéraux selon lequel le taux de fiscalité d’un pays serait le déterminant absolu de son attractivité économique.
À vrai dire, cette idée reçue ne correspond pas à la réalité des critères de choix des investisseurs internationaux révélée par le baromètre Ernst & Young et par l’ensemble des études, ces investisseurs mettant systématiquement en avant, plus que la fiscalité, le niveau d’infrastructure, la qualité des services publics ou la qualification de la main-d’œuvre.
Le quotidien La Tribune titrait d’ailleurs récemment, à l’issue d’une enquête auprès des entreprises : « Les entreprises de croissance ont besoin de plus d’État ». Or, mes chers collègues, il ne peut y avoir plus d’État si chacun n’apporte pas sa contribution à hauteur des impôts exigibles – je pense en particulier à l’impôt sur les sociétés.
On voit donc clairement que cette proposition de loi fait resurgir le débat sur le bien-fondé de l’interventionnisme public. L’objection majeure opposée à notre proposition de loi est bien de nature idéologique.
Face aux arguments du « laisser-faire » et de la primauté donnée au capitalisme financier, l’intérêt général gagne à mon avis à voir l’arbitrage public prendre sa part aux décisions de réallocation des résultats financiers produits par l’activité économique du pays.
J’observe d’ailleurs avec intérêt que le Président de la République vient, par une déclaration récente, de reconnaître le bien-fondé de cette thèse économique interventionniste après avoir pourtant, toutes ces années passées, méthodiquement appliqué son credo libéral.
Les décisions politiques prises depuis 2007 ont été très lourdes de conséquences : les moins-values de recettes fiscales de l’impôt sur les sociétés sont passées, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, de 18, 5 milliards d’euros en 2005 à 70 milliards d’euros en 2010 ! On peut dès lors considérer que, dans sa politique fiscale, la droite au pouvoir en France a fait usage d’une marge de manœuvre budgétaire de 50 milliards d’euros pour créer et embellir les niches. C’est considérable !
La politique fiscale qui a été pratiquée s’est révélée dispendieuse à l’excès, mais elle a au surplus généré une énorme injustice à l’égard des petites et moyennes entreprises. Les PME françaises ont incontestablement été les parents pauvres, voire les victimes de cette politique fiscale outrancièrement favorable aux sociétés de grande taille.
Doit-on rappeler que les sociétés du CAC 40 sont taxées en moyenne à 8 % sur leurs profits contre 22 % pour les PME, qui ne maîtrisent pas forcément toutes les subtilités du code des impôts ?
Le manque à gagner de rentrées fiscales prive l’État de moyens considérables qui seraient bien utiles pour favoriser une meilleure compétitivité des entreprises et des PME en particulier.
Les entreprises du CAC 40 affichent une santé financière insolente…

… mais elles n’en font guère profiter la France. Elles ont même supprimé 44 000 emplois entre 2005 et 2009 dans l’Hexagone, soit une baisse de 2, 5 % sur cinq ans. Dans le même temps, et malgré la crise de 2009, l’ensemble du secteur privé, composé principalement de PME, a créé 200 000 emplois. Pourquoi donc continuer à punir les PME ? Telle est la bonne question aujourd'hui. Rien n’explique en effet le traitement différé et pénalisant dont elles font l’objet en matière d’imposition sur les bénéfices. L’adoption de la présente proposition de loi donnerait par conséquent un signal important à nos concitoyens, au tissu économique et aux PME.
J’aborderai enfin brièvement l’article 3.
Il a été dit que notre texte traduit une méfiance excessive à l’égard de la pratique des dividendes. Faut-il rappeler que les sociétés du CAC 40 ont distribué 40 milliards d’euros au titre de l’année 2010 ? Les fonds ainsi distribués aux actionnaires font-ils l’objet d’un investissement productif intelligent et participent-ils à la dynamisation de l’économie française ? Rien n’est moins sûr ! On observe la fuite de ces capitaux vers des fonds jouant un rôle dans le capitalisme financier international mais pas forcément dans la création d’emplois en France.
En campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy disait, lors d’un discours à Charleville-Mézières, le 18 décembre 2006, vouloir que « les entreprises qui investissent et qui créent des emplois payent moins d’impôts sur les bénéfices que celles qui désinvestissent et qui délocalisent ». C’est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi. Il nous semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire d’instaurer une différentiation de taux de fiscalité afin que les profits soient réinvestis dans notre pays et y créent des emplois.
Au regard de tous ces enjeux, monsieur le ministre, mes chers collègues, il semble nécessaire de remettre la fiscalité à l’endroit, c’est-à-dire au service de la localisation de l’activité économique sur le territoire et de la création d’emplois. Les PME n’ont pas à être davantage imposées que les grands groupes qui s’adonnent avec délectation, et à notre sens avec démesure, aux pratiques de l’optimisation fiscale.
Le système des niches fiscales, excessivement saboteur, doit être plafonné sans plus attendre. La proposition de loi que nous soumettons au Sénat s’inscrit dans cette exigence.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Yvon Collin applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis particulièrement de rapporter, au nom de la commission des finances, une proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste qui va permettre de débattre de la stratégie de notre pays en matière d’impôt sur les sociétés.
Nous sommes en effet quelque peu focalisés sur l’imposition du patrimoine, qui constituera le cœur du prochain projet de loi de finances rectificative au mois de juin prochain. Or, dans un contexte de mondialisation des activités et des implantations, notre fiscalité des entreprises est soumise à des défis qui concernent peut-être moins directement les citoyens, mais qui sont déterminants pour la création de richesses sur notre territoire. À cet égard, je remercie nos collègues de nous donner une telle opportunité d’échanges et de réflexion.

Dans ce texte, nos collègues se fixent trois objectifs : limiter le « mitage » de l’assiette, rétablir la justice fiscale et favoriser le réinvestissement des profits au sein de l’entreprise. Ils formulent pour cela trois propositions…

… à savoir supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé, créer une sorte d’« impôt minimum » correspondant à un taux effectif d’imposition de 16, 66 % et moduler le taux de l’impôt sur les sociétés, entre 30 % et 36, 66 %, en fonction du niveau des bénéfices mis en réserve ou distribués.
Je ne crois pas que ces mesures constituent une solution adaptée ; elles traduisent cependant un constat : pour tenter de compenser un taux nominal de l’impôt sur les sociétés peu compétitif, nous avons cumulé des dispositifs qui ont progressivement opacifié cet impôt.
La complexité et l’instabilité de l’assiette ont un coût en termes d’attractivité, mais elles peuvent aussi être exploitées par les grandes entreprises. Si l’on en croit les auteurs de la proposition de loi, on aboutirait à une forme de dégressivité pour le moins paradoxale, au détriment des PME.

Il ne s’agit pas d’adopter une vision caricaturale qui érigerait les PME en seules victimes de la « mondialisation fiscale ». Nos collègues soulèvent néanmoins un vrai problème qui appelle désormais un renouvellement de notre stratégie fiscale.
Nous le savons, le taux nominal de l’impôt sur les sociétés en France – il s’élève à 34, 43 % si l’on inclut la contribution sociale – est l’un des plus élevés au monde. C’est une réalité en termes de compétitivité. Depuis une quinzaine d’années, la concurrence fiscale s’est intensifiée en Europe. Elle a d’abord été initiée par les nouveaux États membres et par les États structurellement ouverts comme l’Irlande.
Mais, depuis 2008, la donne a changé puisque deux de nos principaux partenaires européens, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont rejoint le mouvement. Le gouvernement de David Cameron a ainsi récemment décidé de faire passer le taux nominal de l’impôt sur les sociétés de 28 % à 23 % d’ici à 2015.
On pourrait penser que notre pays, grâce à des mesures favorables d’assiette, est en réalité beaucoup mieux positionné que ne le traduit un taux nominal simpliste. Or l’analyse des taux effectifs ou implicites d’imposition, malgré leurs difficultés méthodologiques, aboutit à des résultats assez ambigus.
Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui se fonde sur le taux implicite, estime que la France était plus concurrentielle au niveau européen, du moins jusqu’en 2005. Toutefois, dans son rapport de février dernier sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, la Cour des comptes dresse un constat nettement plus défavorable sur le taux effectif.
Il reste qu’en multipliant les dépenses fiscales notre pays a privilégié la réduction de l’assiette à celle du taux nominal de l’impôt sur les sociétés. Le CPO a ainsi recensé, pour 2010, 293 dépenses fiscales bénéficiant aux entreprises, sur un total de 506 dépenses, pour un coût total évalué à 35, 3 milliards d’euros.
Les niches sont devenues une stratégie fiscale dégradée, par défaut, et nous sommes coresponsables de ce « mitage » de l’assiette. Le résultat, c’est que la fiscalité est devenue incompréhensible et donc affaire de spécialistes.
Ce foisonnement de dépenses fiscales conforte en effet la perception d’une grande complexité et imprévisibilité de notre droit fiscal des entreprises, soulignée dans de nombreuses études. Il encourage également le recours à l’ingénierie fiscale en vue d’exploiter toutes les facultés de minoration de l’impôt. Or ce sont évidemment les grands groupes qui disposent, en interne ou en recourant à des cabinets de conseils, des facultés les plus étendues d’optimisation des subtilités de l’assiette.
Dès lors, le CPO a pu conclure à une dégressivité de l’impôt sur les sociétés : le taux implicite s’élèverait ainsi à seulement 8 % pour les sociétés relevant de l’indice du CAC 40, contre 20 %, par exemple, pour les PME comptant de 50 à 249 salariés. Nos collègues s’appuient en particulier sur ce calcul pour proposer la mise en place d’un impôt effectif minimum de 16, 7 % du bénéfice imposable.
Ces données nécessitent cependant une confirmation. La méthodologie du Conseil des prélèvements obligatoires n’est pas exempte de failles, car elle est fondée sur des chiffres de 2006. Elle se réfère aussi à un taux implicite de nature macro-économique, qui comporte des biais et est beaucoup moins précis que le taux effectif moyen. Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous puissiez nous confirmer que vos services travaillent actuellement sur des données objectives et récentes, qui permettront de corroborer ce constat.
La justice fiscale est un concept aux acceptions variées, mais un impôt sur les sociétés dégressif heurte nos conceptions de l’impôt et de l’équité. Certains de nos collègues députés de la majorité ont d’ailleurs manifesté une préoccupation analogue dans une proposition de résolution.
En première analyse, on peut effectivement être surpris ou choqué par le faible montant d’impôt acquitté en France par certains grands groupes. Il est cependant nécessaire d’aller plus loin et de considérer la situation globale de chaque entreprise. Un faible niveau d’impôt en France peut ainsi être lié aux caractéristiques structurelles du secteur, à un degré élevé d’internationalisation ou à des dispositifs non contestables dans leur principe, tels que des reports de déficits antérieurs ou le régime mère-fille.
En présence d’un groupe international qui ne réalise pas de profits en France, il faut s’interroger sur les raisons qui conduisent à cette situation. S’agit-il plutôt d’activités structurellement déficitaires dans la chaîne de valeur de l’entreprise, de montages permettant de localiser des profits dans des territoires fiscalement moins-disants, de la conséquence d’une trop grande pression fiscale dans notre pays ?
Qu’on le déplore ou non, l’internationalisation des activités entraîne celle des bénéfices ; une comparaison des niveaux d’imposition se produit alors au détriment de la France.
Le recours aux niches fiscales pour orienter les comportements économiques apparaît souvent comme une solution de facilité. Il donne l’illusion de maîtriser des leviers ciblés, mais c’est au prix d’une absence de contrôle des finances publiques. Il laisse une impression de trajectoire budgétaire erratique, sans stratégie définie à l’avance.
Pour autant, il s’agit non pas de supprimer aveuglément toutes les niches au nom de la vertu fiscale – certaines, en effet, confèrent à la France un véritable avantage comparatif –, mais de privilégier une assiette large et un taux raisonnable.

Ce serait une stratégie à revoir. Pour cela, il est indispensable d’établir clairement, en début de législature, une stratégie fiscale pluriannuelle lisible et prévisible pour les investisseurs.
Il est également nécessaire d’évaluer périodiquement le coût budgétaire et l’impact socio-économique des dépenses fiscales bénéficiant aux entreprises, puis de les confronter aux marges de manœuvre budgétaires et à la stratégie annoncée.
La commission des finances privilégie depuis longtemps cette approche, consacrée dans la loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014.
D’ici au 30 juin prochain, le Gouvernement remettra au Parlement une évaluation de l’efficacité et du coût de toutes les dépenses fiscales et sociales en vigueur depuis le 1er janvier 2009 – ce fut l’objet d’une réunion de notre commission, hier matin, sous l’autorité de son président.
Le débat sur la fiscalité des entreprises s’est récemment déplacé vers la politique de dividendes des grands groupes ; celle-ci motive l’article 3 de la proposition de loi dont nous débattons.
Les distributions réalisées par les sociétés du CAC 40 sont régulièrement remises en cause, étant perçues comme trop généreuses. Avec plus de 40 milliards d’euros distribués cette année, le débat a repris de l’ampleur.
Pour ma part, je crois important de ne pas contester le principe même du dividende et d’atténuer la perception d’un « privilège actionnarial ».
La distribution des dividendes participe de la libre gestion de l’entreprise. Elle doit constituer la juste rémunération du risque pris par l’actionnaire.

Elle doit aussi permettre d’attirer de nouveaux investisseurs ou de fidéliser l’actionnariat en période de chute et de volatilité des cours de bourse.
Si l’on examine le ratio de distribution des sociétés du CAC 40, plutôt que le montant global des dividendes, on constate que, cette année, en France, en s’établissant à 46, 7%, il ne se situe pas à un niveau atypique.
Tout est question d’équilibre, de juste mesure entre la rémunération légitime des actionnaires, le financement de l’investissement et l’intéressement des salariés.
Même si nous ne sommes pas totalement maîtres du jeu, car la concurrence internationale est vive, il est vrai que le traitement réservé aux actionnaires peut paraître déconnecté de la réalité économique et sociale, lorsque les entreprises en cause recourent à une politique salariale rigoureuse ou malthusienne. Or les salariés sont, au moins autant que les actionnaires, responsables de la bonne santé financière des entreprises : ils doivent donc naturellement en recueillir les fruits.
Tel est d’ailleurs le sens de l’intervention du président de la République, qui a demandé que soit mis en place un mécanisme permettant de lier l’augmentation des dividendes à une revalorisation des rémunérations. Ce débat, vous le savez, s’ouvrira dans notre hémicycle avant le début de l’été prochain.
Nous sommes tous mobilisés pour accentuer la progression du pouvoir d’achat des salariés de notre pays.
Il n’est d’ailleurs pas établi que cette dernière piste soit la plus efficace. Une indexation automatique entre la progression des dividendes et celle des salaires pourrait en effet entraîner une diminution de l’investissement et de la productivité, et surtout rendre plus difficile, pour les entreprises concernées, le fait de lever des capitaux sur les marchés pour financer leur croissance. Nous aurons l’occasion d’en débattre.
De même, il est difficile d’établir un lien entre la progression des dividendes et le volume des effectifs employés sur notre territoire.
Je veux, pour terminer, formuler quelques observations plus techniques sur les dispositions que nous proposent nos collègues du groupe socialiste. Je crois que, si l’on peut être sensible aux finalités poursuivies, les moyens envisagés soulèvent des difficultés, et pourraient même se révéler contre-productifs.
Le premier article vise à supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé, qui a été créé en 1965 et n’a jamais été remis en cause, malgré plusieurs alternances politiques. Il bénéficie aujourd’hui seulement à cinq groupes, dont deux du CAC 40. Si ce régime peut aujourd’hui sembler moins justifié, compte tenu de son objet initial qui consistait à accompagner le développement international de certaines entreprises, il demeure très encadré, et son coût budgétaire, de près de 400 millions d’euros en 2010, diminue tendanciellement.
C’est ainsi qu’il est accordé sur agrément, en fonction d’engagements précis pris par la société éligible ; compte tenu du caractère intangible de son périmètre pour la durée de cet agrément, il n’est pas favorable en toutes circonstances.
Selon ce que j’ai dit tout à l’heure, la suppression de ce régime ne pourrait être envisagée sans que nous dispositions au préalable d’une évaluation objective, non pas seulement de sa portée budgétaire, mais aussi de son intérêt socio-économique.
L’article 2 vise à introduire une sorte d’ « impôt réel minimum » sur les bénéfices. Cette solution présente des inconvénients économiques et peut faire l’objet de réserves méthodologiques.
À supposer que les calculs du Conseil des prélèvements obligatoires soient confirmés, ce dispositif conduirait l’impôt effectif des plus grandes sociétés à connaître plus qu’un doublement, en passant de 8 % à 16, 66 %. Dans la conjoncture de reprise que nous connaissons, un tel relèvement serait à mes yeux préjudiciable du point de vue de la compétitivité et de la crédibilité aux yeux des investisseurs en capital et en dette.
Ce dispositif impose de plus une vision uniforme et réductrice de la situation fiscale des grandes entreprises. La mise en place d’un impôt minimum conduirait à remettre en cause une partie des avantages fiscaux dont certaines d’entre elles ont pu légitimement bénéficier. De surcroît, sa formulation le rend inopérant et source d’ambiguïtés.
Enfin, l’article 3 reprend une proposition récurrente : celle d’un taux d’impôt sur les sociétés différencié selon le niveau du bénéfice mis en réserve ou distribué. Ce dispositif semble séduisant, mais se heurte à de nombreux obstacles de fond et de forme.
Tout d’abord, il traduit une méfiance que l’on peut juger excessive à l’égard de la pratique des dividendes.
Il suppose également un suivi complexe, sur plusieurs années, des affectations comptables du bénéfice. Cette complexité contribue à expliquer l’échec, entre 1988 et 1992, puis de 1997 à 2000, des deux précédentes tentatives visant à pérenniser en France des dispositifs similaires ; le second dispositif a d’ailleurs été supprimé par un gouvernement soutenu par l’actuelle opposition parlementaire.
Les États de l’Union européenne, en particulier l’Allemagne en 2000, ont écarté ce dispositif. Seule l’Estonie applique un système analogue, sous la forme d’une « taxe de distribution » dont le taux s’élève à 21 %. S’agissant de l’Allemagne, je rappelle que le double taux poursuivait un objectif contraire à celui de la présente proposition de loi, puisqu’il était destiné à encourager la distribution de dividendes.
Les modalités proposées apparaissent en outre bien en deçà des objectifs affichés, puisque le taux d’impôt sur les sociétés de 36, 66 % s’appliquerait seulement au-delà d’un seuil de distribution de 60 %, rarement atteint dans les faits par les grandes entreprises.
Enfin, pour des raisons de doctrine, la commission ne peut pas approuver ces propos dans la mesure où les dispositions fiscales relèvent désormais exclusivement du domaine réservé des lois de finances.

M. Philippe Dominati, rapporteur. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des finances n’est pas favorable à cette proposition de loi. Elle vous invite donc à rejeter chacun de ses articles, et l’ensemble du texte.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et au banc de la commission.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord d’excuser Mme Christine Lagarde, privée du plaisir d’être parmi vous ce matin par un impératif consécutif à une décision du président de la République : un impératif lié, justement, à la mise au point du projet de loi dont vous débattrez très prochainement. Les autres membres de son équipe ayant déjà prévu des déplacements, on m’a demandé de la remplacer aujourd’hui. J’espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Mais, comme vous le savez, le Gouvernement ne parle que d’une seule voix.

Pas tout à fait ! On a cru comprendre, à propos de la prime, qu’il y avait de l’eau dans le gaz !
Je vais essayer de me souvenir que, pendant dix ans, je fus à l’Assemblée nationale le président de la commission des affaires économiques, et que – M. Patriat le sait – nous y avons aussi, pendant des années, abordé les problèmes des entreprises.
Je voudrais commencer par quelques remarques sur la politique économique et fiscale du Gouvernement.
Les questions posées par M. Marc sont légitimes.
Je pense qu’il est en effet légitime, sur le principe, de débattre de la restriction du mitage, de l’amélioration de la justice fiscale et de la manière d’encourager l’investissement.
Je suis heureux de constater que vous souscrivez à une grande partie de la politique du Gouvernement, qui consiste justement à favoriser l’investissement des entreprises. La majorité est en effet convaincue que, en favorisant l’investissement, on favorise l’emploi.
Depuis la crise qui a frappé non seulement la France et l’Europe, mais également le monde entier, l’obsession du Gouvernement est de favoriser l’investissement et le développement des entreprises : nous savons que cette méthode permet – ce n’est pas si facile que cela – de favoriser la création de valeur ajoutée, de richesses, et donc d’emplois.
À vous qui avez permis l’organisation de ce débat, monsieur Marc, je vais essayer de répondre de la manière la plus précise possible.
Mais je voudrais d’abord vous faire remarquer que, si vous parlez avec raison des 293 niches fiscales bénéficiant aux entreprises dans le projet de loi de finances pour 2010, 252 d’entre elles existaient en 1997 et ont continué d’exister jusqu’en 2002 : si le groupe socialiste trouve injuste de procéder de la sorte à l’égard des entreprises, pourquoi avoir laissé subsister toutes ces niches pendant cinq ans ? Depuis 2002, 45 niches ont été créées, quand il en existait 252 à l’époque de M. Jospin, soit une augmentation de seulement 15 %.
Je voulais simplement rappeler, pour la vérité des chiffres et la clarté du débat, qu’il vous faut aussi vous livrer à une introspection afin de savoir pourquoi, à l’époque, vous n’avez pas supprimé ces niches.

Mais combien coûtaient-elles ? Les niches coûtaient 18 milliards d’euros en 2005, elles en coûtent 70 milliards aujourd’hui : 50 milliards de plus !
Il est vrai que le périmètre de certaines d’entre elles a évolué.
Avant d’aborder le détail du débat, je voudrais remercier M. Dominati pour son travail de rapporteur et lui répondre. Je veux aussi saluer la manière dont le président Arthuis a présidé la séance de commission au cours de laquelle le Gouvernement et la majorité ont adopté des positions convergentes.
Vous vous êtes demandé, monsieur le rapporteur, si Bercy travaillait à une évaluation des taux implicites d’imposition. Les chiffres publiés sur le taux effectif, ou implicite, de l’impôt sur les sociétés sont divers et ne concordent pas toujours. Certains sont issus du Conseil des prélèvements obligatoires, d’autres d’Eurostat, d’autres encore de cabinets privés – vous l’avez très justement indiqué.
Il est vrai que les services du Trésor sont en train de passer en revue ces chiffrages, afin d’élaborer – le plus rapidement possible, nous l’espérons – une méthodologie plus efficace et qui se voudrait plus vertueuse.
S’agissant de l’action volontaire entreprise par le Gouvernement en matière de politique économique, je voudrais vous indiquer, monsieur Marc, que tout est fait aujourd’hui pour inciter les entreprises à investir.
À mon sens, certaines des dispositions que nous avons adoptées peuvent en témoigner.
Prenons l’exemple du crédit d’impôt recherche. Chacun en France comme en Europe le reconnaît, il s’agit d’une mesure emblématique de la volonté du Gouvernement de favoriser l’investissement dans les entreprises.
Le crédit d’impôt recherche est un dispositif efficace. Selon les rapports de l’Inspection générale des finances, l’ensemble des études économétriques menées à partir des données françaises ou étrangères aboutissent aux mêmes conclusions : avec un euro de crédit d’impôt recherche, on obtient un supplément de dépenses de recherche privée supérieur à un euro !
C’est donc bien un dispositif efficace ; je n’ose pas dire « vertueux », car personne n’a la vérité révélée en matière de fiscalité, monsieur Marc. D’ailleurs, si j’ai tenu à évoquer tout à l’heure quelques chiffres sur les niches fiscales, c’était pour vous rappeler que nul ne détient la vérité en la matière. Ni vous ni nous !
Nous cherchons tous à améliorer la fiscalité. Nos divergences, réelles, sont de nature idéologique. D’ailleurs, si elles n’existaient pas, on se demande bien pourquoi il y aurait une gauche et une droite !
Précisément, monsieur le sénateur, nous revendiquons notre volonté de soutenir les entreprises ! Pour nous, c’est ainsi que l’on crée des emplois !
De votre côté, vous avez un peu trop tendance à vouloir ajouter des impôts supplémentaires. Le programme du parti socialiste, dont nous avons pris connaissance voilà quelques semaines, en fournit la démonstration. Vous envisagez, je crois, 50 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires. Toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d’impôts… Je ne pense pas que ce soit la bonne manière de stimuler l’investissement et, par voie de conséquence, l’emploi.
À cet égard, il y a effectivement une vraie divergence idéologique !
Les chiffres que j’évoquais voilà quelques instants – un euro de crédit d’impôt recherche permet une augmentation des dépenses de recherche privée supérieure à un euro – démontrent que les entreprises emploient bien l’aide fiscale perçue pour abonder leur budget de recherche et développement, conformément à l’objectif visé.
Dans ce contexte, la réforme du crédit d’impôt recherche pourrait permettre une hausse du produit intérieur brut de 0, 3 point dans les quinze prochaines années. Cela mérite donc que nous y réfléchissions, voire que nous encouragions un tel dispositif. C’est en tout cas la volonté du Premier ministre et du Gouvernement.
Les paramètres fondamentaux du crédit d’impôt recherche issus de la réforme de 2008 ont été conservés dans la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, conformément au souhait du Président de la République et malgré le « rabot » décidé par le Gouvernement.
En effet, nous avons bien décidé d’un « rabot » pour remettre en cause un certain nombre de niches fiscales, monsieur Marc ! Pour autant, nous avons préservé le crédit d’impôt recherche. Nous avons pris un certain nombre de mesures, tout en maîtrisant le coût du crédit d’impôt recherche.
Ce coût a atteint 6, 2 milliards d’euros en 2009, avec la mise en œuvre du dispositif de remboursement immédiat dans le cadre du plan de relance. Il a été ramené à 4, 5 milliards d’euros en 2010 et sera de 2, 1 milliards d’euros en 2011. Je pense que nous pouvons au moins nous accorder sur ce point.
Je voudrais également vous faire part d’une réflexion. Nous nous interrogeons fréquemment sur l’impôt le mieux adapté et l’incitation fiscale optimale. Il faut savoir ce que les expressions « niches fiscales » ou « mitage » de l’impôt sur les sociétés signifient.
Justement, madame Bricq ! Nous considérons pour notre part que l’allégement de la fiscalité favorise les investissements, stimule les entreprises et a fait ainsi progresser la création de richesses. C’est le principe des niches fiscales.
Mais nous nous sommes aperçus – je le reconnais d’autant plus que j’avais moi-même, dans le cadre de mes précédentes fonctions au sein de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, encouragé la mise en place de telles mesures – que certaines dispositions, notamment en outre-mer, occasionnaient des dérives en favorisant la spéculation. Nous les avons supprimées.
Nous devons effectivement faire preuve de pragmatisme en matière de fiscalité. Autant nous considérons qu’il faut stimuler l’entreprise par des dispositifs d’exonération fiscale et, dans certains cas, par ce que vous appelez des « niches », autant nous sommes résolus à remédier aux éventuelles dérives que nous constatons. Dans cette perspective, les suppressions que nous avons décidées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011 ont permis de réaliser plusieurs milliards d’euros d’économies.
Je voudrais à présent aborder la réforme de la taxe professionnelle.
Les auteurs de la présente proposition de loi affirment qu’il faut soutenir l’investissement. Ils ont raison. Mais c’est précisément ce que le Gouvernement fait, madame Bricq.
En effet, la suppression de la taxe professionnelle est une mesure essentielle pour la compétitivité des entreprises industrielles.
Mais vous en aurez la démonstration au fur et à mesure de la mise en œuvre de la réforme !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

M. François Marc, auteur de la proposition de loi. Ça va être la croissance spontanée !
Nouveaux sourires.
Vous ne pouvez pas prétendre que la mesure est mauvaise seulement parce que vous l’avez d’emblée déclarée mauvaise, et ce alors même qu’elle n’a pas encore atteint son application optimale ! C’est pourtant un peu ce que vous faites, madame Bricq.
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent « favoriser l’investissement ». C’est précisément ce que le Gouvernement a fait en 2010 en supprimant en 2010 la taxe professionnelle, qui pénalisait tout particulièrement les entreprises désireuses d’investir, notamment dans l’industrie !
Je vous rappelle que la taxe professionnelle existait entre 1997 et 2002 ; vous aviez alors un formidable champ d’expérimentation ! Que n’en avez-vous profité à l’époque ?
Je dresse simplement un constat, monsieur le sénateur.

La croissance n’a jamais été aussi forte qu’entre 1997 et 2002 ! Elle était à 3 % ! Faites-en autant !
Monsieur Marc, la croissance était liée non pas à des facteurs nationaux, mais à un contexte européen, voire mondial !
Et la croissance aurait certainement été beaucoup plus forte, et les créations d’emplois plus nombreuses, si l’on avait supprimé la taxe professionnelle à l’époque !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale a atteint l’objectif que je viens de rappeler.
Monsieur Marc, la taxe professionnelle était assise – et c’est bien là que résidait le problème – sur les investissements productifs. C’est une charge qui pesait sur la production, donc sur l’emploi ; nous l’avons supprimée. La nouvelle contribution est assise sur la valeur ajoutée, ce qui est tout à fait différent.
L’industrie a été la grande gagnante de la réforme, comme l’a bien montré le rapport d’évaluation sur les effets de la réforme remis en mai 2010 par l’Inspection générale des finances. Je peux vous le faire parvenir si vous le souhaitez, madame Bricq.

C’est inutile, la commission des finances a auditionné hier sur ce point !
Vos interlocuteurs ont donc dû vous confirmer ce que je viens d’indiquer !
Et avec le rapport de l’Inspection générale de l’administration, cela fait deux documents qui démontrent excellemment combien le Gouvernement a eu raison de s’engager sur la voie d’une telle réforme.
Le Gouvernement a également veillé à faire en sorte que les petites et moyennes entreprises – elles représentent l’essentiel du tissu économique français et des créations d’emplois – soient les principales bénéficiaires de la suppression de la taxe professionnelle.
C’est pourquoi la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la fameuse CVAE, a été configurée précisément pour les protéger. En effet, cette contribution n’est pas due par les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros, et il existe un dégrèvement partiel lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 50 millions d’euros. Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros acquitteront une CVAE au taux de 1, 5 %. Si ce n’est pas une mesure qui favorise l’investissement des entreprises, je me demande ce que nous pouvons encore faire, monsieur Marc ! J’attends des propositions très précises de votre part.

Et nous, nous attendons des réponses aux questions que nous vous avons posées !

Vous faites des figures imposées, un peu comme au patinage artistique, mais vous ne répondez pas aux questions !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
M. Patrick Ollier, ministre. Je reconnais que votre présence en impose à toute la Haute Assemblée, monsieur Frimat !
Sourires
Quoi qu’il en soit, vous pouvez constater que le Gouvernement favorise l’investissement.
Vous avez raison de vouloir restreindre le « mitage » de l’impôt sur les sociétés.
C’est bien ce que nous avons engagé dans la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Je ne résiste pas au plaisir de vous demander à nouveau pourquoi vous n’avez pas souhaité corriger plus tôt un dispositif que vous jugez si mauvais.
M. Patrick Ollier, ministre. Mais non ! Depuis que vous n’êtes plus au pouvoir, seulement 43 nouvelles niches fiscales ont été créées ! Vous n’allez pas revenir au pouvoir juste pour 43 niches fiscales !
Souriressur les travées de l’UMP.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Je ne suis pas impatient ; ne vous inquiétez pas !
En 2011, nous avons réalisé un effort sans précédent de réduction des dépenses fiscales, et vous ne pouvez pas le nier. Nous avons préféré la réduction des dépenses fiscales à l’augmentation générale des impôts, que votre formation politique préconise dans son projet pour 2012, monsieur Marc. Et nous avons fait ce choix pour des raisons d’efficacité économique et de justice fiscale : la réduction des niches fiscales va dans le sens d’une réduction des inégalités.
Au passage, j’observe que vous n’avez pas voté…

M. François Marc, auteur de la proposition de loi. Le projet de loi de finances pour 2011 ? En effet, nous ne l’avons pas voté !
Souriressur les travées du groupe socialiste.

C’était pour les emplois à domicile ! Mais vous n’avez rien fait pour réduire les niches fiscales des actionnaires !
Pourquoi n’avez-vous pas voté un texte législatif supprimant des dispositions dont vous prônez la disparition dans votre proposition de loi ? Ce n’est guère cohérent, monsieur Marc ! Si vous teniez tant à supprimer les niches fiscales, il fallait voter le projet de loi de finances pour 2011 !
Vous auriez obtenu satisfaction immédiatement, et cela vous aurait évité de venir nous présenter aujourd'hui une proposition de loi supprimant des dispositions que nous avons déjà abrogées. Un peu de cohérence…
Grâce au dispositif que nous avons adopté, et dont vous n’avez pas voulu, les niches fiscales et sociales seront ainsi réduites de près de 9, 5 milliards d’euros en 2011, de 11, 7 milliards d’euros en 2012, les entreprises contribuant à hauteur de 60 % du total. Vous le voyez, chacun fait un effort.
Il est vraiment dommage que vous n’ayez pas voté notre texte !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Les chiffres sont là, et ils sont têtus.
En 2010, et vous ne l’avez pas rappelé, nous avons obtenu une réduction historique du déficit budgétaire, qui s’est élevé à 7, 7 % du PIB, alors que les prévisions faisaient état d’un taux de 8, 3 %.
Non ! Si la réduction a été aussi forte, c’est grâce à la politique mise en œuvre par le Gouvernement !
Nous avons la volonté de nous engager dans la voie vertueuse des critères de Maastricht et de parvenir à un taux de 3 %, objectif prévu pour 2013.
Je vous répondrai tout à l’heure, monsieur Patriat.
De telles performances ont été permises par une stabilisation des dépenses de l’État en valeur et par la poursuite des réformes structurelles, comme le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, la réduction transversale de 5 % des crédits de fonctionnement et d’intervention des ministères ou l’application aux opérateurs des mêmes règles qu’à l’État.
L’ensemble des acteurs ont pris leur part dans l’effort colossal qui a été entrepris. Et les résultats sont là ! La réduction du déficit budgétaire constatée en 2010 devrait, me semble-t-il, être saluée sur l’ensemble des travées de la Haute Assemblée.
Marques d’ironie sur les travées du groupe socialiste.
D’ailleurs, je suis certain que vous approuvez totalement cette politique dans votre for intérieur. Autrement, vous seriez en contradiction avec la volonté que vous affichez en termes de réduction des déficits publics. Malheureusement, je n’ai pas senti des signes d’encouragement de la part de l’opposition ; vous avez même voté contre les mesures que nous avons proposées !
En outre, le programme de stabilité de la France pour 2011-2014, que vous avez examiné hier soir, confirme la détermination du Gouvernement à poursuivre sa politique de consolidation des finances publiques. Nous prenons les dispositions et faisons voter les textes nécessaires.
Et nous ouvrons les débats qui permettent à chacun de s’exprimer sur une période tri-annuelle, de 2011 à 2014. L’objectif est, me semble-t-il, à la fois ambitieux et courageux. Là aussi, vous pourriez reconnaître les efforts que le Gouvernement réalise en matière de finances publiques et de fiscalité.
Comme M. Baroin l’a très bien expliqué hier soir, nous sommes déterminés à consolider nos finances publiques pour ramener le déficit public à 3 % du PIB en 2013. Et nous en prenons le chemin : nul ne peut le contester.
La trajectoire pluriannuelle de finances publiques est conforme aux recommandations communautaires. Nous respectons les règles européennes. Voilà près de trois ans, on nous affirmait, y compris parfois au sein de notre majorité, qu’il serait impossible d’atteindre un tel objectif en 2013.
L’année dernière, un déficit public de 8, 3 % du PIB était annoncé ; nous sommes parvenus à le limiter à 7, 7 %, et nous allons continuer : nous ramènerons ce déficit à 5, 7 % du PIB en 2011, à 4, 6 % en 2012 et à 3 %, voire moins, en 2013.
Nous envisageons même de le faire passer sous la barre des 2 % du PIB en 2014 ! Ces objectifs sont ambitieux et courageux. Ils démontrent la volonté du Gouvernement de s’engager résolument dans une politique dont il ne déviera pas !
Je le dis aux sénateurs de la majorité, qui nous soutiennent avec constance : nous ne céderons pas, car nous n’en avons pas le droit, aux demandes réitérées d’engager des dépenses publiques supplémentaires au profit de telle ou telle catégorie, aussi généreuses que soient les intentions de leurs auteurs.
La stratégie d’ajustement structurel repose à la fois sur un effort important de maîtrise de la dépense publique et sur la poursuite de la réduction du coût des dépenses fiscales et des niches sociales, conformément aux engagements pris au travers de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Cette loi de programmation, qui s’ajoute au programme de stabilité européen dont le Sénat a discuté hier soir, vous avez oublié d’en parler, monsieur Marc ! Elle est l’un des outils dont le Gouvernement s’est doté pour tenir le cap et respecter les engagements pris par la majorité, que je remercie encore, au nom du Gouvernement, d’avoir souscrit à ce programme pluriannuel ambitieux, qui représente certes une contrainte, mais qui est nécessaire si nous voulons sortir complètement de la crise.
Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe socialiste, ces initiatives du Gouvernement vont tout à fait dans le sens de votre proposition de loi ; je regrette que vous ne le reconnaissiez pas !
Vous le voyez, la stratégie économique du Gouvernement ne consiste pas à se laisser entraîner dans l’impasse du « toujours plus » : toujours plus de dépenses, toujours plus d’impôts, toujours plus de déficits – tendance qui caractérise un peu, et même beaucoup, le programme du parti socialiste pour 2012 !
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Ce n’est pas en s’acharnant sur les entreprises qui créent des richesses et de l’emploi que l’on sortira de la crise, …
… mais en mettant en œuvre au bénéfice de tous une politique équitable de maîtrise des dépenses et d’incitation à la création de valeur. Je le répète, favoriser la création de valeur ajoutée et de richesses permet de créer plus d’emplois !
La France ne vit pas dans un monde fermé. Nous ne pouvons pas raisonner uniquement selon une perspective franco-française ! Il faut bien sûr tenir compte du contexte européen et mondial. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, nous nous sommes engagés dans la voie d’une convergence des politiques fiscales à l’échelon européen.
Il faut saluer, monsieur Marc, l’engagement du Président de la République en faveur de la mise en place d’un gouvernement économique européen, qui favorisera la convergence des politiques économiques européennes, notamment celle des politiques fiscales qui les sous-tendent. Or vous n’en parlez pas ! Pourtant, la décision est en voie d’être prise, sur l’initiative de Nicolas Sarkozy.
M. le rapporteur a évoqué à juste titre le projet de loi constitutionnelle d’équilibre des finances publiques, qui instituera une « règle d’or ». Ce texte, qui sera probablement soumis au Sénat dans la seconde quinzaine du mois de juin, instaurera un « monopole » des dispositions fiscales pour les projets de loi de finances. Par anticipation, monsieur Marc, on pourrait vous objecter que votre proposition de loi ne respecte pas cette future règle constitutionnelle. Cela étant, je reconnais qu’il est encore trop tôt pour vous opposer cet argument !
Je souhaite maintenant formuler quelques remarques d’ordre général sur cette proposition de loi, me réservant d’entrer dans le détail des articles à l’occasion de la discussion des amendements.
Je n’en suis pas sorti, madame Bricq ! Le sujet de notre débat, c’est l’investissement des entreprises, le « mitage » de l’impôt sur les sociétés, l’amélioration de la justice fiscale : je ne m’en suis pas écarté !
S’agissant, tout d’abord, de la philosophie générale de votre proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe socialiste, ce n’est pas le moment d’augmenter l’impôt sur les sociétés. Dans un contexte de sortie de crise, il convient au contraire que le Gouvernement accompagne les entreprises et améliore la compétitivité de la France.
Cela suppose d’aligner nos règles sur celles qui existent chez nos partenaires, lorsque ces dernières répondent à de véritables logiques économiques. En particulier, notre impôt sur les sociétés doit être comparable à celui de nos voisins. Je viens de le dire, le Gouvernement s’attache actuellement à promouvoir une convergence fiscale européenne.
À cet égard, le régime « mères-filles » que vous avez évoqué, monsieur Marc, n’est pas un régime d’aide aux entreprises : il vise à supprimer une double imposition économique. En effet, les bénéfices qui sont distribués par une filiale à sa « mère » ont, par hypothèse, déjà été soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette règle existe chez tous nos partenaires européens, et même au-delà. Elle fait l’objet d’une directive communautaire depuis 2003.
Le régime de l’intégration fiscale, quant à lui, vise notamment à consolider les bénéfices et les déficits des sociétés appartenant à un même groupe. Il s’agit de faire comme si un groupe formait une seule entreprise. Là encore, ce régime n’est pas propre à la France, puisqu’il existe chez tous nos partenaires européens, monsieur Marc. D’ailleurs, comparé à ce qui se pratique chez nos partenaires, le régime français n’est pas particulièrement favorable, puisqu’il est réservé aux filiales détenues à 95 %. À cet égard, la législation fiscale allemande retient par exemple un taux de détention des filiales de 50 %. Le Gouvernement a engagé une réflexion sur les conséquences de telles différences entre la fiscalité allemande et la nôtre, le Président de la République souhaitant leur convergence.
Pour votre part, vous voulez renforcer la spécificité fiscale de la France, en contestant des régimes en vigueur ailleurs en Europe. Ne faudrait-il pas plutôt s’inspirer des meilleures pratiques existant chez nos partenaires ? Je vous invite de ce point de vue à réfléchir à la récente décision du gouvernement de M. Cameron de baisser de quatre points le taux de l’impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement prépare au contraire des dispositions concrètes afin que les bénéfices réalisés par les entreprises profitent aussi aux salariés.
Le Président de la République a ainsi demandé que vous soit soumis un projet de loi prévoyant l’ouverture obligatoire d’une négociation dans les entreprises de plus de 50 salariés en vue du versement d’une prime aux salariés si les dividendes distribués par l’entreprise sont en augmentation. Nous aurons un débat sur ce sujet, monsieur le rapporteur, car nous n’avons pas tout à fait la même vision des modalités de mise en œuvre de cette prime !
En outre, le Gouvernement soutient activement le projet de directive communautaire, que vient de relancer la Commission européenne, visant à harmoniser les règles de l’impôt sur les sociétés au sein de l’Union européenne.
Ce projet présente de nombreux atouts pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et leur permettra de s’implanter dans un autre État sans rencontrer les difficultés auxquelles elles se heurtent aujourd’hui, par exemple en termes de compréhension de la législation fiscale ou de respect des obligations déclaratives. Il s’agira d’un véritable gain en matière de compétitivité. Ce projet constitue, à plusieurs égards, la vraie réponse aux problèmes que vous soulevez, monsieur Marc.
Pour conclure, permettez-moi d’insister à nouveau sur l’attachement du Gouvernement à préserver la compétitivité des entreprises, tout en assurant les conditions de la justice et de l’équité en matière fiscale.
Certaines dépenses fiscales méritent certainement d’être reconsidérées, y compris dans le champ de la fiscalité des entreprises, mais pas de la manière dont vous l’envisagez. Cela ne peut se faire qu’à l’issue d’une revue méthodique des effets budgétaires, mais aussi économiques et sociaux, de chacune de ces dépenses. Ce n’est pas au doigt mouillé, monsieur Marc, que l’on peut décider de supprimer telle ou telle dépense fiscale, par simple souci d’affichage !
Compte tenu de ces explications, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement soit opposé à cette proposition de loi, à l’instar de M. le rapporteur, et vous demande de bien vouloir la rejeter.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc de la commission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’’avais prévu d’exposer le dispositif de notre proposition de loi, rapidement car François Marc l’a déjà fait excellemment tout à l’heure, mais je commencerai par répondre aux propos gênés, laborieux, de M. le rapporteur, et à ceux, très politiques, de M. le ministre.
Il est bon, en cette période de commémorations, de rappeler ces mots, toujours d’actualité, de Jean Jaurès, l’une de nos figures tutélaires : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ;…

… c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. »
Monsieur le ministre, une véritable différence d’approche nous sépare ; il ne faut pas la nier.
L’approche du Gouvernement et d’une partie de la droite consiste à présenter systématiquement la France comme un pays où les taux d’imposition, en particulier celui de l’impôt sur les sociétés, seraient parmi les plus élevés au monde.

C’est un argument politique ! En vérité, notre impôt sur les sociétés est l’un de ceux qui rapportent le moins ! Voilà le « mensonge qui passe » : il consiste à donner à penser que notre fiscalité est très lourde, alors que son rendement est en réalité très faible.
Vous avez développé de nombreux arguments, monsieur le ministre, mais nous n’avons pas entendu de réponse à la question que nous posons : pourquoi les entreprises du CAC 40 ne sont-elles soumises à l’impôt sur les sociétés qu’à concurrence de 8 %, contre plus de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes entreprises ? Pourquoi Total – je ne m’acharne pas sur cette magnifique entreprise ! – ou Vivendi ne paient-elles pas d’impôt sur les sociétés ?

Cette question mérite une réponse, que nous attendons toujours ! L’objet de cette proposition de loi est assez simple. Comme l’a dit M. le rapporteur, elle a le mérite d’ouvrir le débat !
Mais vous vous êtes essentiellement consacré, monsieur le ministre, d’une façon très politique, à défendre le Président de la République. Vous vous êtes d’ailleurs fort bien acquitté de cette tâche : nul doute que vous resterez ministre !
Sourires.

Ce faisant, vous avez proféré un certain nombre de contre-vérités, qu’il m’incombe de relever.
Vous vous targuez d’avoir contenu le déficit à 7 % du PIB. Or, avec un taux de croissance de 1, 6 %, un tel chiffre constitue un record sous la Ve République, si l’on excepte l’année du déclenchement de la crise !

Monsieur le ministre, nous n’avons pas l’obsession de l’impôt, mais celle des recettes. Vous, à l’inverse, votre leitmotiv est « toujours moins de recettes ». Pour compenser, vous êtes obligés de mettre en œuvre une politique de suppression systématique de postes de fonctionnaire, en particulier dans des secteurs tels que l’éducation nationale ou la sécurité, au point que, même dans vos rangs, quelques voix commencent à évoquer une remise en question du dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux…
La suppression de 30 000 postes de fonctionnaire permet d’économiser environ 500 millions d’euros, mais le « mitage » de l’impôt sur les sociétés représente une perte de recettes de 10 milliards d’euros !
M. Jean Desessard applaudit.

M. le rapporteur est d’ailleurs d’accord avec le constat que nous dressons et reconnaît qu’un problème se pose. Toutefois, de manière assez contradictoire, il entonne une ode aux dividendes. Pour ma part, je préférerais entendre chanter les louanges des salariés, dont le travail permet justement la distribution de dividendes aux actionnaires ! Nous ne sommes pas hostiles par principe aux dividendes, mais nous entendons que soit redonnée aux salariés la place qu’ils méritent, car ce sont eux qui produisent les richesses, et non les actionnaires.
Cela étant, je vous sais gré, monsieur le rapporteur, de ne pas nous avoir opposé, pour votre part, la future loi constitutionnelle. Une future loi n’est pas une loi, il ne convient pas de l’invoquer aujourd’hui ! Pour l’heure, nous avons parfaitement le droit, comme l’a dit notre collègue Charles Guené en d’autres circonstances, de faire des propositions en matière fiscale. Je suis d’ailleurs moins sûr que M. le ministre que ce texte nous sera soumis prochainement !

Effectivement !
Monsieur le ministre, il est quelque peu indécent de défendre avec autant d’acharnement une politique fiscale dont l’injustice est unanimement reconnue, qui octroie toujours plus d’avantages aux plus aisés de nos concitoyens, à tel point que l’on dit aujourd'hui du Président de la République qu’il est, plus encore que le président des niches, le président des riches !
Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Il est quelque peu indécent d’exonérer 300 000 contribuables de l’impôt de solidarité sur la fortune alors que plus de 800 000 ménages sont surendettés. La priorité devrait être de se pencher sur la situation de ces derniers, mais le Gouvernement se préoccupe davantage de 300 000 ménages qui ont le malheur d’être redevables de l’ISF parce que leur patrimoine est compris entre 800 000 et 1, 3 million d’euros !
Ces choses devaient être dites, en réponse aux propos très politiques de M. le ministre, qui est ici en service commandé pour défendre la politique gouvernementale. Il est vrai que celle-ci est tellement vilipendée aujourd'hui qu’elle a bien besoin d’être défendue !
Monsieur le ministre, vous n’avez répondu que de manière cursive à nos propositions, qui visent à instaurer davantage de justice fiscale, en rééquilibrant devoirs et obligations des entreprises du CAC 40 à l’égard du pays, d’une part, et en mettant en œuvre un dispositif d’incitation à l’investissement pour les entreprises, d’autre part, reposant sur un système de bonus-malus, afin de récompenser les efforts d’investissement et de sanctionner les distributions excessives de dividendes.
Cette proposition de loi procède d’un constat. Bien que des niches aient été supprimées, les entreprises auraient épargné, d’après les chiffres qui nous ont été communiqués, près de 70 milliards d’euros en 2010, contre 20 milliards d’euros en 2005, grâce à différents dispositifs fiscaux. Nous voulons que l’État retrouve une capacité financière, afin notamment de réduire les déficits des comptes publics.
Le Président de la République est passé maître dans l’art d’annoncer de nouvelles lois. Sa stratégie, c’est « action-réaction » : adepte des lois d’émotion, il l’a mise en œuvre à la suite de nombre de faits divers médiatiques, en présentant chaque fois un nouveau texte. En revanche, le Gouvernement se montre beaucoup moins prompt à l’action et à la réaction quand il s’agit de justice fiscale ! Pourtant, depuis de nombreux mois, il est souligné que de grands groupes ne paient aucun impôt sur les sociétés… Or il est impératif aujourd'hui d’envoyer des signaux de justice aux citoyens, aux consommateurs, aux ménages, aux contribuables, aux petites et moyennes entreprises, qui subissent lourdement les effets de la crise, parfois doublement, du fait de la hausse des prix et du chômage. Alors que le prix du litre d’essence à la pompe bat aujourd'hui des records, Total ne paie toujours pas d’impôt sur les sociétés…
Le courage, c’est de supprimer un certain nombre d’outils aujourd'hui obsolètes, à l’instar du bénéfice mondial consolidé, qui a été mis en place en 1965. Sa suppression est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi. On ne pourra pas faire face aux enjeux de 2020 avec les outils de 1960 ! Lors de la discussion du dernier projet de loi de finances, le Gouvernement s’était opposé à la suppression de ce dispositif, estimant qu’il est « bien contrôlé, semble assez sûr et permet à des entreprises qui ne sont pas forcément de grands groupes de développer leurs activités ». À la lecture de la liste des bénéficiaires, on est en droit de se demander de quelles entreprises il s’agit…
Nous avons déjà abordé le thème du courage en matière fiscale dans cet hémicycle. La suppression du bouclier fiscal a beaucoup trop tardé. Assujettir les groupes pétroliers à une contribution exceptionnelle, comme nous l’avons demandé, serait une décision courageuse. Lorsque j’ai présenté une proposition de loi à cette fin, le Gouvernement a répondu en substance : « Mais enfin, soyez raisonnables ! » Avec quelques années de retard, la création de cette taxe est aujourd'hui annoncée. Il était sans doute urgent… d’attendre !
Le dispositif fiscal dérogatoire n’est pas un dû ; c’est avant tout une dépense publique. Il est difficilement admissible que de grandes entreprises puissent éviter de s’acquitter de leur contribution à la collectivité nationale. Pourquoi tolérons-nous autant de pratiques d’optimisation fiscale outrancière, réservées à quelques-uns ? Comment l’État peut-il accepter qu’on lui fasse ainsi les poches ?
Les Français comprennent mal qu’un champion national comme Total participe aussi peu à « l’entretien de la force publique », pour reprendre les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Non seulement ce grand groupe a licencié des salariés, mais il ne paie pas d’impôt sur les sociétés, alors qu’il réalise – et c’est tant mieux ! – une dizaine de milliards d’euros de bénéfices ! L’impôt sur les sociétés est devenu, selon les propres mots de M. Baroin, un « impôt de chagrin » ! Toutes les entreprises devraient acquitter un minimum d’impôt ! L’État récupérerait ainsi quelque 10 milliards d’euros, et pourrait réduire d’autant les déficits publics. Pourquoi toujours repousser l’échéance ? Nous appelons le Sénat à adopter sans plus tarder cette proposition de loi frappée au coin du bon sens, qui tend à instaurer davantage de justice fiscale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fiscalité est plus que jamais au cœur des questions de politique économique et de justice sociale. Elle sera même, j’en suis sûr, au centre de la prochaine campagne présidentielle, tant le déficit de justice fiscale est grand.
Comme souvent, le Sénat est en avance, le Sénat est précurseur, le Sénat sert de laboratoire d’idées. Nous avons ainsi débattu, voilà plus d’un an, d’une proposition de loi visant à instituer une taxation de certaines transactions financières que j’avais déposée.
Aujourd’hui, nous examinons une proposition de loi, élaborée par François Marc et nos collègues du groupe socialiste, tendant à modifier de façon substantielle le régime de l’impôt sur les sociétés. J’espère pour eux qu’ils auront plus de succès que je n’en ai eu avec ma proposition de loi, et que nous serons cette fois entendus par la majorité sénatoriale. En effet, autant le dire tout de suite, je partage totalement les objectifs visés au travers du présent texte, dont j’approuve le dispositif. Je lui apporte donc mon soutien.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Cette proposition de loi repose essentiellement sur trois dispositifs tendant à l’abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé, à l’introduction d’un niveau plancher d’impôt sur les sociétés effectivement acquitté et à une modification du taux uninominal de l’impôt sur les sociétés, cela en fonction de l’affectation du résultat de certaines entreprises.
Véritable serpent de mer fiscal, la question de l’efficacité de l’impôt sur les sociétés, en termes de rentrées fiscales pour l’État, et de son équité, en termes de progressivité de ses taux, n’en finit pas d’être soulevée.
Cet impôt a vocation à déterminer la principale contribution des entreprises aux charges financières de l’État. Calculé en fonction des bénéfices réalisés chaque année, son taux de droit commun, longtemps établi à 50 %, est fixé à 33, 33 % depuis le 1er janvier 1993. Cette diminution participait à l’époque d’une démarche partagée d’harmonisation au sein de l’espace communautaire.
En 2008, il faut s’en souvenir, cet impôt rapportait dans les caisses de l’État plus de 52 milliards d’euros, soit près de 17 % des gains fiscaux annuels. Ce n’est pas rien, surtout dans un contexte budgétaire marqué par des pics de déficit à répétition !
La proposition de loi n’a nullement pour objet d’alourdir les taux existants, de remettre en cause l’attractivité de la France dans le concert des nations européennes, ni même de taxer davantage l’ensemble de nos entreprises. Non ! Évitons la caricature : le texte vise bel et bien à corriger les distorsions de ce régime d’imposition, qui permettent aux plus grandes entreprises de payer a minima. Je pense notamment aux entreprises du CAC 40, dont les bénéfices faramineux ne cessent de croître.
Comment expliquer sans gêne que, par un tour de passe-passe et de judicieux montages d’optimisation fiscale, certaines multinationales françaises sont assujetties à un taux d’imposition deux fois moins élevé que celui des PME ? Comment expliquer que, dans notre pays, plus une entreprise est importante, moins elle est assujettie à l’impôt ?
Selon un rapport rédigé en 2009 par le Conseil des prélèvements obligatoires, les entreprises du CAC 40, qui représentaient en 2006 plus de 30 % des profits, rapportaient à peine 13 % de l’impôt sur les sociétés. En revanche, les PME dont la taille n’excédait pas 250 personnes s’acquittaient de 21 % du même impôt, pour seulement 17 % des profits générés par les entreprises françaises.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cette situation est contraire à l’esprit même de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle notre collègue François Rebsamen faisait référence, et dont l’article XIII dispose que la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cela, me semble-t-il, vaut bien aussi pour les entreprises !
Avec des taux faibles pour les plus forts et des taux forts pour les plus faibles, c’est toute une mécanique inéquitable et implacable à laquelle il convient de mettre un terme. Pour cela, nos collègues socialistes proposent, dans leur texte, trois remèdes à appliquer aux trois principaux maux de l’impôt sur les sociétés.
En premier lieu, la proposition de loi tend à supprimer le mécanisme dit du bénéfice mondial consolidé.
Ce mécanisme permet aux sociétés mères de certaines multinationales françaises de retenir l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établie sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. Ce système dérogatoire, soumis à agrément ministériel, permet ainsi aux grands groupes d’imputer sur leurs bénéfices français les résultats souvent déficitaires des filiales nouvellement implantées à l’étranger.
Je parlais précédemment d’optimisation fiscale : nous y sommes ! Pour éviter les doubles impositions, l’impôt sur les sociétés payé en France par la maison mère sur son résultat consolidé est diminué de l’impôt sur les sociétés versé à l’étranger par chacun de ses établissements stables ou chacune de ses filiales. Au bout du compte, les gains fiscaux optimisés représentent un jackpot de plusieurs centaines de milliers d’euros par entreprise concernée.
En 2010, selon les services du ministère du budget, cinq sociétés ont bénéficié de ce régime, qui a coûté la bagatelle de 302 millions d’euros à l’État ! Cerise sur le gâteau, grâce à ce dispositif formidable, le groupe Total, cité à plusieurs reprises, n’a payé aucun impôt sur les sociétés en 2010, alors même qu’il a réalisé un bénéfice de 10, 5 milliards d’euros, le plus important du CAC40, et qu’il a distribué la bagatelle de 5, 2 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires.

En deuxième lieu, la proposition de loi tend à introduire un taux de base auquel aucune société ne saurait échapper.

Il s’agirait tout simplement d’atténuer les effets de distorsion entre les entreprises soumises au taux de droit commun et les entreprises soumises à des taux particulièrement bas par des jeux d’abattement et de décote.
Cette disposition est d’autant plus judicieuse que, paradoxalement, ce sont bien les sociétés les plus importantes qui bénéficient des taux les plus compétitifs. Une telle situation est particulièrement injuste à l’égard de la majorité de nos PME, qui sont confrontées depuis trois ans aux conséquences de la crise financière. Les petites et moyennes entreprises n’acceptent plus – elles ont raison – de participer au prix fort aux efforts de la nation quand les entreprises du CAC 40 persistent dans l’optimisation fiscale et la répartition outrageante des dividendes entre leurs actionnaires.
Oui, l’établissement d’un taux plancher est une mesure de bon sens, qui permettrait à l’État de renflouer ses caisses en s’appuyant sur l’automaticité d’un taux de 16 %, alors même que la moyenne des taux européens se situe à hauteur de 23 %. L’argument consistant à dénoncer le manque d’attractivité fiscale de notre pays pour les entreprises deviendrait ipso facto irrecevable.
En troisième lieu, la proposition de loi introduit un dispositif prévoyant que le taux de l’impôt sur les sociétés puisse être modulé en fonction de l’affectation du bénéfice imposable par les entreprises.
L’objectif est de majorer le taux d’imposition lorsque la fraction des bénéfices distribuée en dividendes excède un certain seuil. Il s’agit donc d’inciter les entreprises à privilégier l’investissement et l’emploi, grâce à un dispositif fiscal rendant la démarche de capitalisation interne plus attrayante qu’une politique de généreuse distribution de dividendes.
Sur ce point également, l’enjeu est de taille, puisqu’il est question de rendre prioritaire la réutilisation des bénéfices pour l’innovation et la création d’emplois et de limiter l’enrichissement à court terme d’une minorité d’actionnaires, plus soucieux de rentabilité financière que de pérennité d’activités.
Mes chers collègues, on le voit bien, c’est toute la politique fiscale menée depuis plusieurs années qu’il convient de réformer en profondeur. Les débats d’aujourd’hui concernant l’impôt sur les sociétés ne sont que les prémices de l’ouvrage qui nous attend dans les mois qui suivront mai 2012.
Pour l’heure, une chose est sûre : la politique fiscale coûte très cher à l’État ! Le rapport de la Cour des comptes de 2009 nous indiquait déjà que, dans le déficit total de 140 milliards d’euros, le déficit structurel s’élevait à 70 milliards d’euros, l’essentiel de ce dernier étant dû aux décisions prises par les gouvernements depuis 2002 en matière de baisse des recettes fiscales. La présente proposition de loi de nos collègues socialistes s’inscrit dans une logique inverse, fondée sur la responsabilité et l’éthique financière.
C’est pourquoi, avec la majorité des membres de mon groupe, je voterai en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’est pas facile de parler de l’impôt sur les sociétés en sept minutes !
Avant toute chose, je veux remercier notre collègue François Rebsamen pour la citation qu’il a faite, que je partage, de Jean Jaurès, fondateur d’un journal qui m’est très cher, L’Humanité.
J’en viens à la proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste. Reconnaissons d’emblée une qualité à ce texte, celle de rompre avec une règle fiscale tacite, à l’œuvre depuis trop longtemps, qui veut que l’on ne puisse envisager l’amélioration de la situation économique et sociale du pays qu’à l’aune de l’allégement de la participation des entreprises au financement de la charge commune.
Pour une fois, nous sommes saisis d’un dispositif qui tend naturellement à redresser le niveau de la contribution des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, à la fois en mettant en cause l’une des multiples niches fiscales qui l’amputent – je veux parler du régime du bénéfice mondial consolidé – et en proposant de traiter différemment les bénéfices afin de tenir compte de leur affectation.
Il faut sans doute un début à tout, pourrait-on dire à la lecture de cette proposition de loi. Celle-ci n’a pas, pensons-le, vocation à couvrir l’ensemble de la problématique de l’impôt sur les sociétés, mais elle cible assez judicieusement une partie des questions que pose un long processus de dévitalisation d’un impôt, pourtant nécessaire aux comptes publics et, par-delà, à la collectivité nationale.
Avant donc que nous ne donnions notre avis sur le texte qui nous est soumis, il nous faut procéder à une forme de revue de détail de ce qui a conduit notre fiscalité des entreprises, depuis 1985, à cesser de contribuer efficacement à l’équilibre budgétaire.
C’est en effet en 1985, sous le gouvernement dirigé par Pierre Bérégovoy, que le processus de réduction de l’impôt sur les sociétés a été enclenché. Dès cette époque, il a été justifié par la nécessité de favoriser l’investissement productif, le maintien de l’emploi ou l’embauche de nouveaux salariés, l’aménagement des politiques salariales permettant, dans le cadre de la négociation collective, de garantir le pouvoir d’achat des salariés.
Le grand mouvement de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, qui nous a conduits à appliquer aujourd’hui un taux facial de 33, 33 % pouvant être majoré du taux de la contribution sociale pour certaines grandes entreprises, s’est accompagné, au fil du temps, d’une série de mesures tendant à agir sur l’assiette de l’impôt. On a ainsi fini par réduire considérablement la part des bénéfices soumis au taux facial.
Le fameux rapport de la Cour des comptes, publié en octobre 2010, sur la situation fiscale des entreprises au regard des niches fiscales et sociales dont elles bénéficient, a sans doute motivé la proposition de loi dont nous débattons. Mais il a surtout confirmé ce que nous n’avions cessé de dénoncer depuis plusieurs années, notamment au cours des discussions budgétaires.
Ainsi, le Conseil des prélèvements obligatoires, émanation de la Cour des comptes et rédacteur de ce rapport, soulignait la profusion de dispositifs d’un coût parfois élevé et d’une efficacité douteuse. Le crédit d’impôt recherche est l’un des dispositifs auxquels on pense immédiatement, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, alors même que vous venez d’en vanter les mérites, mais je reviendrai sur ce point. Surtout, ce rapport mettait en évidence les sommes considérables mobilisées par les effets d’éviction sur l’assiette de l’impôt et les dispositifs dérogatoires.
Pour les exercices 2010 et 2011, nous sommes tout de même parvenus, mes chers collègues, à une situation où l’impôt sur les sociétés représente au mieux de 30 % à 35 % de ce qu’il devrait rapporter !
Question : qui paie un tel déficit de recettes, supérieur à 100 milliards d’euros ? Réponse : les autres, tout simplement !
En d’autres termes, cela justifie – je réponds ainsi aux précédents propos de M. le ministre – qu’on bride la dépense publique, qu’on supprime des emplois publics, qu’on maintienne le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à 19, 6 %, et j’en passe...
Pour aller à l’essentiel, je rappelle que, depuis 1985, à la suite du lancement du processus d’allégement de la contribution des entreprises aux budgets publics, de la mise en œuvre d’une politique d’allégement de la taxe professionnelle et de développement des exonérations de cotisations sociales, nous avons privé les budgets de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale de centaines de milliards d’euros.
De 1985 à 2007, et cela n’a pas dû s’arranger depuis, bien au contraire, entre baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, remise en cause de la taxe professionnelle et allégements de cotisations sociales, ce sont plus de 500 milliards d’euros de recettes qui ont été purement et simplement perdus ! Sans compter l’impact des mesures affectant l’assiette de l’impôt sur les sociétés et les coûts de trésorerie courante que ces mesures ont impliqués pour l’État.
Dénoncer l’effet « boule de neige » de la dette publique, faute d’atteindre l’excédent budgétaire primaire, devrait nous faire réfléchir au bien-fondé de ces abandons de recettes. Je n’ai pas le temps d’approfondir ce sujet maintenant, mais nous y reviendrons.
D’ailleurs, monsieur le ministre, après ce que vous venez de dire, examinons la question telle qu’elle se pose réellement : dans le cadre d’une politique économique et industrielle comme celle que nous avons pu voir mener depuis une trentaine d’années, ces efforts ont-ils conduit notre pays sur la voie de la croissance et du plein emploi ? Non !
Vu qu’une bonne partie des groupes industriels nationaux privatisés depuis 1986 ont connu quelques mésaventures – que reste-t-il de Pechiney Ugine Kuhlmann, qui était l’un des leaders de l’aluminium en 1981, lors de sa nationalisation ? –, que l’emploi industriel ne cesse d’être victime, dans notre pays, de la recherche continue de la rentabilité maximale, que nous avons un fort volant de main-d’œuvre privée d’emploi et un volume aussi considérable de salariés noyés dans la précarité, force est de constater que cette fuite en avant vers la réduction des impôts dus par les entreprises n’a pas été nécessairement positive pour notre économie, pour nos emplois, pour la population de notre pays dans son ensemble.
À l’écoute de votre discours, monsieur le ministre, on comprend que vous vouliez persister dans la même voie.
Pourtant, les inégalités de revenus continuent à se creuser, comme le souligne ce matin le journal Les Échos. C’est toujours la même rengaine : « après la crise, il importe, dites-vous, de favoriser l’investissement, de créer plus de richesses ». Mais pour qui est cette richesse ? Il suffit de regarder les sociétés du CAC 40 !
La richesse, monsieur le ministre, elle est pour Mme Bettencourt, qui économise 36 millions d'euros grâce au bouclier fiscal et qui, demain, grâce à vos propositions, verra ses impôts encore réduits.
La richesse, elle est pour ceux qui vont pouvoir échapper à l’impôt sur la fortune grâce à un relèvement du seuil d’exigibilité de 830 000 euros à 1, 3 million d'euros, mesure qui favorisera ainsi 300 000 contribuables déjà privilégiés.
II est temps de changer notre fusil d’épaule et de mettre un terme à cette véritable intoxication au moins-disant fiscal qui a marqué près de trente ans de pratique budgétaire dans notre pays !
La proposition de loi de nos collègues socialistes, sans doute inspirée par le contenu du projet présenté par leur parti en vue des rendez-vous politiques de 2012, constitue un élément du débat. Elle nous rappelle la nécessité de poser la juste et légitime question de la réforme fiscale, sans épuiser par avance le sujet. En effet, entre nous soit dit, à ce stade du débat, elle ne saurait constituer la seule approche et l’exposé des seules solutions des problèmes posés.
Nous la prenons donc comme telle, et nous sommes par ailleurs certains, au-delà du débat d’aujourd'hui, qui tournera un peu court vu la position de la majorité, que la question de l’impôt sur la fortune et de la participation des entreprises à l’effort collectif sera l’un des enjeux clés des futures consultations électorales et du débat public qu’elles susciteront.
En tout état de cause, aujourd'hui, nous voterons en faveur de la proposition de loi présentée par nos collègues socialistes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. M. Yvon Collin applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi de notre collègue François Marc et du groupe socialiste tend principalement à poser le principe selon lequel aucune entreprise ne peut acquitter un impôt sur les sociétés dont le taux réel serait inférieur à la moitié du taux normal, soit 16, 66 %, visant ainsi les grands groupes qui bénéficient d’une imposition sur les bénéfices à des taux effectifs très faibles.
Le texte n’a pas été modifié par la commission des finances. Le rapporteur, notre excellent collègue Philippe Dominati, dont je tiens à saluer la qualité du rapport, a proposé au nom de la commission de rejeter cette proposition de loi.
Pour des raisons évidentes et difficilement contournables, la commission des finances réserve toute modification fiscale aux seules lois de finances, selon sa jurisprudence constante.
Le groupe socialiste souhaite mettre fin aux abattements et réductions d’assiette d’impôt sur les sociétés, qui conduisent les grandes entreprises à bénéficier d’un taux effectif d’impôt sur les sociétés inférieur à celui s’appliquant aux PME ou aux TPE. Selon notre collègue François Marc, la minoration de l’impôt sur les sociétés aurait pour effet immédiat de gonfler les dividendes des actionnaires.
En conséquence, le groupe socialiste propose de supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé, d’empêcher toute entreprise d’acquitter un impôt sur les sociétés dont le taux réel serait inférieur à la moitié du taux normal et de moduler le taux de l’impôt sur les sociétés entre 30 % et 36, 66 %, en fonction de l’affectation du bénéfice réalisé : plus bas si affecté à l’emploi à l’investissement, plus haut si affecté à la distribution de dividendes.

Par le but qu’elle vise, cette proposition de loi rejoint de légitimes préoccupations de justice sociale. Il est primordial, pour atteindre ce but plus que tout autre tant il est générateur d’espoir, de se donner les moyens d’agir avec efficacité. Pour cela, aucune incertitude ne peut demeurer. J’en relève malheureusement un certain nombre.
Les chiffres mettant en exergue un écart de taux réel d’impôt sur les sociétés acquitté sont différents selon les études. Les calculs de la Cour des comptes donnent des taux effectifs supérieurs à ceux du Conseil des prélèvements obligatoires.
Les écarts de taux existent, bien sûr, mais au-delà de la pétition de principe, il est important d’agir sans approximation. À cet effet, la direction générale du Trésor est en train de réaliser une étude pour préciser les chiffres.
Avant de prendre une décision, il convient également de procéder à une évaluation de l’intérêt du bénéfice mondial consolidé. Dans quelle mesure son coût est-il plus important que son intérêt ? Attendons pour le savoir la remise au Parlement, le 30 juin prochain, du rapport du Gouvernement évaluant l’efficacité et le coût de toutes les dépenses fiscales.
Le relèvement du taux d’imposition sur les bénéfices des grands groupes devra certainement être discuté. Toutefois, la proposition du groupe socialiste de relever le taux réel à un taux minimum de 16, 66 % est, dans l’attente des nécessaires évaluations que nous venons d’évoquer, une mesure dont on ne connaît pas le véritable impact et qui, au-delà de son effet d’annonce, pourrait se révéler prématurée, voire dangereuse.
Rappelons que, à l’heure où l’on parle de convergence fiscale, le taux nominal d’impôt sur les sociétés est plus faible en Allemagne qu’en France, soit de 30 % au lieu de 33, 33 % et, surtout, les cotisations sociales sont nettement moins importantes outre-Rhin, soit de 13 % du PIB, contre plus de 16 % en France.
Deux questions se posent : est-ce le moment d’augmenter la pression fiscale sur les entreprises françaises, plus faibles en export que les entreprises allemandes, même lorsqu’il s’agit de grands groupes ? Si oui, de quelle manière et dans quelle proportion ?
Dans ce schéma généreux, n’oublions pas la dépréciation de l’euro par rapport au dollar ou au yuan.
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent la mise en place d’un taux d’impôt sur les sociétés qui varie selon le niveau du bénéfice qu’elles mettent en réserve ou distribuent. Cette proposition paraît séduisante, mais la différenciation nécessite un suivi complet des affectations comptables du bénéfice sur plusieurs années, suivi qui n’a jamais réussi à être mis en œuvre.
C’est une matière complexe, fluctuante, et les risques de délocalisation sont, hélas, bien présents.
La direction du Trésor et le Gouvernement travaillent sur l’exactitude des chiffres, l’évaluation du coût et l’efficacité des dépenses fiscales.
Dans un esprit pragmatique, qui est aussi celui de l’équité, le Président de la République a d’ores et déjà annoncé la mise en place dans le collectif budgétaire de juin prochain d’une prime aux salariés que devront verser les entreprises qui distribuent des dividendes. C’est, certes, une manière différente d’aborder l’exigence de justice sociale, mais cette mesure sera peut-être perfectible. En tout cas, elle aura l’avantage indéniable de pouvoir être appréhendée par le salarié de manière directe en le remettant au cœur de la bonne marche de l’entreprise.
Dans ces conditions, et pour toutes les raisons évoquées, le groupe UMP votera contre l’ensemble de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que s’achève la discussion générale, je souhaite vous faire part de quelques observations.
D’abord, je remercie les auteurs de cette proposition de loi de nous donner l’occasion de mener une réflexion sur les niches fiscales. Hier matin, en commission des finances, nous tentions de mieux appréhender le concept même de niche fiscale, qui n’est pas simple. Il sera de la responsabilité du Parlement d’en dessiner les contours afin de clarifier nos débats sur des questions qui peuvent choquer l’opinion publique et susciter de vives protestations et de réelles incompréhensions.
Les niches mettent en effet à mal le pacte républicain et l’idée que nous nous faisons de l’égalité des Français devant l’impôt. Sur ces questions extrêmement graves, nous ne pouvons nous contenter d’effets tribunitiens, faute de quoi nous égarerions nos concitoyens, les empêchant de s’approprier les motifs qui rendent nécessaires un certain nombre de réformes.
Outre les auteurs de la proposition de loi, je remercie également le rapporteur général Philippe Marini, le rapporteur de ce texte, Philippe Dominatiainsi que M. le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui a bien voulu suppléer les ministres en charge de l’économie et de la fiscalité, retenus sans doute par d’autres travaux, pour freiner toute tentation de créer de nouvelles niches fiscales ou sociales.
Le sujet qui nous inspire ce matin, c’est la mondialisation et les défis qu’elle suscite.
Depuis plusieurs semaines, j’assiste en quelque sorte au procès de Total. M. Rebsamen s’est lâché sur ce thème, mais je le mets en garde : évoquer ces questions, qui suscitent une incompréhension absolue, c’est manier de la nitroglycérine !
Si j’ai bien compris, en 2009, Total n’a pas payé d’impôt en France. Mais sur le plan mondial, l’entreprise a acquitté 7, 7 milliards d'euros d’impôt pour un bénéfice net d’un peu plus de 8 milliards d'euros. Cela veut dire que les entités économiques paient l’impôt dans le pays où elles réalisent des bénéfices. Il s’agit de savoir si Total a fait des bénéfices en France.

Les raffineries de Total sont-elles rentables ? Les activités développées en France par Total sont-elles globalement rentables ? Manifestement non ! Peut-être y a-t-il eu de l’optimisation fiscale, conséquence de la subtilité des textes que nous votons désormais au fil des lois de finances, lesquelles auront, je l’espère, le monopole des dispositions fiscales.
Monsieur Rebsamen, je vous mets donc en garde. La vraie question est de savoir si Total a fait ou non des bénéfices en France. Il n’en a probablement pas fait, et c’est pour cela que l’entreprise ne paie pas d’impôt en France. Par conséquent, invoquer devant l’opinion publique l’argument selon lequel Total n’a pas payé d’impôt en France peut être rentable à court terme sur un plan électoral, mais ce n’est pas ainsi que nous améliorerons la compréhension collective des problèmes que nous avons à résoudre pour relancer la croissance, l’emploi et lutter contre le chômage. Donc, évitons de nous laisser aller à des considérations quelque peu tribunitiennes.
Autre question que nous devons nous poser : pourquoi l’entreprise Total ne fait-elle pas de bénéfices en France ? Nos lois, nos réglementations sont-elles compatibles avec l’espérance de bénéfices ? Ne sont-elles pas activatrices de délocalisation de certaines activités ? Il va falloir que nous remettions en cause un certain nombre de nos conventions de langage et de pensée.
Nous avons dû, au fil des années, puisqu’il faut aller à la conquête des marchés du monde, imaginer des fiscalités plus modernes, compétitives par rapport aux régimes fiscaux en vigueur dans d’autres pays.
Je me trouvais voilà une semaine aux Pays-Bas, avec plusieurs membres de la commission des finances. Nous nous demandions pourquoi un certain nombre de grandes sociétés internationales y avaient leur siège. Ce pays a, au moins autant que nous, compris les enjeux de la mondialisation.
Notre dispositif de bénéfice mondial consolidé permet à un groupe de déduire les pertes de ses filiales implantées à l’étranger des bénéfices réalisés en France par ses sociétés rentables. Mais lorsque ses filiales déficitaires deviennent excédentaires, elles paient l’impôt dans le pays où elles sont établies et, à ce moment-là, les résultats enregistrés en France n’intègrent pas les bénéfices constatés à l’étranger. Autrement dit, monsieur le ministre, nous jouons assez systématiquement perdants.
M. François Rebsamen approuve.

Cette situation doit inspirer une réflexion : avez-vous d’autres solutions ? Quelles réponses peut-on apporter ?

Telles sont les interrogations sur lesquelles j’appelle votre attention.
Les Pays-Bas, pour reprendre cet exemple, ont inventé un système de ruling : il permet, par le biais d’une négociation débouchant sur une convention, d’aboutir à un accord avec les dirigeants du groupe.
La France n’est pas isolée dans le monde ; elle est en compétition avec d’autres pays, notamment avec les Pays-Bas. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, une directive européenne permettrait d’harmoniser l’assiette des impôts sur les sociétés : c’est l’objet de l’ACCIS, l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés.
Essayer de réguler au plan national une question qui doit être traitée à l’échelon européen ne peut s’apparenter, j’en ai bien peur, qu’à un exercice de pure gesticulation. Il est aisé de débattre de cet important sujet à la tribune ; cela nous permet de rendre compte à nos concitoyens des efforts que nous avons menés pour améliorer le rendement fiscal. Mais il faut en être conscient, cela revient à cracher en l’air !
Nous devons également nous interroger sur les prix de transfert. En effet, à l’échelon des groupes, il peut être commode d’optimiser en facturant depuis un pays où les bénéfices sont soumis à des taux relativement modiques vers un autre pays où les bénéfices sont imposés à des taux beaucoup plus élevés. Ne nous payons pas de mots ; l’instauration d’un système de ruling peut permettre d’apporter des réponses pragmatiques.
Chers collègues socialistes, je vous remercie de nous avoir permis de mener cette réflexion commune. Toutefois, je ne partage pas les convictions que vous avez défendues ce matin et je doute que, avec votre proposition de loi, vous puissiez atteindre les cibles que vous visez, qu’il s’agisse de la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé, qu’il s’agisse du plancher de cotisations ou de la régulation en fonction de l’affectation des résultats c'est-à-dire selon que l’on distribue ou que l’on mette en réserve les bénéfices. Tout cela me paraît quelque peu théorique, technocratique, et me semble se prêter à de nouvelles optimisations.
Vous posez de véritables questions, mais, selon moi, vous devrez reprendre votre copie, car vos réponses sont illusoires. Dans ces conditions, je ne voterai pas les articles de votre proposition de loi.

Mes chers collègues, je vous rappelle qu’un second texte est inscrit à l’ordre du jour de ce matin. Je vous recommande donc d’user de votre temps de parole avec économie.
La parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, Mme Bricq m’a reproché d’avoir parlé trop longtemps. Toutefois, je tiens à répondre à ceux qui m’ont interrogé, …
… car je m’en voudrais d’être discourtois avec les intervenants. J’ai beaucoup de respect pour la Haute Assemblée et pour ceux qui ont travaillé sur cette proposition de loi.
Je l’ai indiqué tout à l’heure, le chiffrage du taux effectif de l’impôt sur les sociétés est une affaire de convention. Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe socialiste, vous vous demandez pour quelle raison les entreprises du CAC 40 ne sont imposées qu’à 8 %, alors que les PME le sont à des taux plus lourds.
La réalité est beaucoup plus complexe : parmi les grandes entreprises, certaines réalisent d’importants bénéfices en France et payent beaucoup d’impôts, d’autres enregistrent des déficits et ne sont donc, par définition, pas taxables. Les chiffres que vous avancez sont d’ailleurs contestés par des études s’appuyant sur d’autres conventions.
Monsieur Rebsamen, vous m’avez reproché d’être politique. Mais vous l’avez été bien plus que moi, et avec beaucoup plus de talent. Je ne tiens pas me frotter à vous sur ce terrain-là !
Sourires
Vous avez évoqué tout à l’heure l’impôt minimum : il s’agit de l’impôt forfaitaire annuel, supprimé au début de cette législature parce qu’il frappait fort injustement les PME.
Messieurs Collin, Rebsamen et Foucaud, vous vous êtes interrogés sur le bénéfice mondial consolidé. Vous avez raison, un nombre très restreint d’entreprises est concerné. Les chiffres sont clairs, il s’agit de deux grands groupes et de trois PME. Chacune de ces entreprises fait l’objet d’un agrément, et donc d’un examen précis. Mlle Joissains l’a relevé à juste titre, et je l’en remercie, vous n’aurez pas beaucoup à attendre pour obtenir des réponses à vos questions, car, comme il s’y était engagé, le Gouvernement remettra le 30 juin 2011 une évaluation d’ensemble des niches fiscales, dont fait partie le régime du BMC.
Je partage l’opinion du président Arthuis, qui s’est exprimé avec grand talent. Je vais essayer de cheminer sur ses traces… Nous devrions être fiers d’avoir un groupe comme Total en France.
En tout cas, je ne vous ai pas entendu le dire ! Je vous ai surtout entendu reprocher à Total de ne pas payer d’impôt sur les sociétés !
Oui, monsieur Marc, nous sommes effectivement fiers des salariés de Total et eux-mêmes sont certainement très fiers de travailler dans ce groupe.
Cela ne vous aura pas échappé, Total fait de l’exploitation pétrolière. Monsieur Marc, monsieur Rebsamen, monsieur Foucaud, monsieur Collin, je ne pense pas que l’exploitation pétrolière puisse se faire autour du Palais du Luxembourg ou du Palais Bourbon ! Total n’a pas d’activité produisant des effets qui pourraient déterminer le paiement de l’impôt sur les sociétés en France. C’est bien connu, notre pays a beaucoup d’idées, mais pas de pétrole !
Voilà pourquoi il faut être prudent dans ses propos. Si Total ne paye pas d’impôt sur les sociétés, c’est peut-être tout simplement, si l’on y réfléchit bien, parce que cette entreprise ne fait pas de bénéfices en France.
En revanche, le groupe paye beaucoup d’autres contributions sur ses bénéfices. Les chiffres qu’il a communiqués font état de 800 millions d’euros d’impôts.
Dans le cadre de l’agrément lié au bénéfice mondial consolidé, le groupe a pris des engagements, notamment celui d’investir en France 4, 5 milliards d’euros sur la période 2009-2011. Il n’y était pas obligé, et pourtant il l’a fait ! Pour ma part, je préfère rendre hommage aux initiatives prises par le groupe et constater les faits.
Je terminerai en évoquant la question de l’impôt minimum, que plusieurs d’entre vous ont soulevée.
Dans le texte que nous examinons, vous proposez d’appliquer un taux minimum d’impôt de 16, 5 % sur le bénéfice imposable. Je ne comprends pas bien cette proposition.
Aujourd'hui, le taux d’imposition applicable aux bénéfices est de 33 %. Votre proposition revient à taxer non plus les bénéfices, mais un solde comptable intermédiaire qui ne tiendrait pas compte des dépenses des entreprises et des besoins de financement de l’investissement. Or nous voulons, pour notre part, encourager le financement de l’investissement. Il est normal qu’une société qui investit puisse bénéficier de déductions de ses charges financières ou de ses amortissements.
Monsieur le président de la commission, je souscris aux réponses que vous avez apportées aux autres questions soulevées par les orateurs. Je connais votre compétence et votre volonté de rigueur dans le domaine des niches fiscales.
Vous avez probablement raison lorsque vous évoquez les lois et les réglementations « activatrices » de délocalisations. Le Gouvernement réfléchit aux pistes que vous avez mentionnées. Vous avez cité l’exemple des Pays-Bas, mais vous auriez pu prendre tout aussi bien celui de l’Irlande qui, avec un taux très incitatif de 12 %, attire un certain nombre de sociétés sur son territoire.
Pour conclure, je tiens à remercier le groupe socialiste d’avoir lancé ce débat qui a permis au Gouvernement, soutenu par le président de la commission, M. Arthuis, son rapporteur, M. Dominati, et Mlle Joissains, pour le groupe UMP, de rétablir un certain nombre de vérités.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
L’article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.

Monsieur le ministre, je n’avais pas prévu d’intervenir sur les articles, mais j’ai changé d’avis après avoir entendu vos propos.
On nous dira bientôt que, puisque Renault construit des voitures en Slovénie ou en Turquie, le groupe ne fait pas de bénéfices en France et qu’il n’est donc pas taxable.

Le même raisonnement pourrait s’appliquer à de multiples entreprises ! Je tiens à rappeler que le groupe Total distribue tout de même des dividendes en France.
Mes chers collègues, je veux vous faire part de mon étonnement : depuis des années, nous ne cessons de mener des débats sérieux, approfondis, parfois empreints de gravité, sur la situation de nos comptes publics, la nécessité de respecter nos engagements, notamment européens, de réduire les déficits publics.
Or, au moment où nous sommes saisis d’un texte qui porte en partie remède à la situation, j’entends M. le ministre, M. le rapporteur et, à l’instant, M. le président de la commission des finances nous dire que c’est une très mauvaise idée de demander aux entreprises de contribuer un peu plus, elles aussi, à l’effort exigé de tous.
Quelle drôle d’idée en effet de rendre aux salariés, sous forme de service public financé par leurs impôts, une partie de la richesse nationale qu’ils ont produite par leur travail, plutôt que de la perdre dans la distribution de dividendes et d’investissements financiers à l’étranger !
Monsieur le président de la commission des finances, il existe bien des dividendes ! D’ailleurs, même le Président de la République, à quelques mois de l’élection présidentielle, s’en aperçoit et propose d’en redistribuer une partie !

Nous voulons taxer ceux qui font de l’argent, notamment ceux qui possèdent des actifs financiers.

Ils font aussi de l’argent en France ! Et cet argent ne profite ni à l’emploi ni à la production dans notre pays.

Mais les groupes payent des impôts à l’étranger ! C’est la mondialisation.

Monsieur le président de la commission des finances, vous évoquez souvent l’économie ouverte, la mondialisation et la globalisation.
J’ai choisi deux exemples montrant que les grands groupes nous ont administré de nouvelles preuves du bien-fondé des politiques de concurrence fiscale, lesquelles ont cours depuis si longtemps qu’on a oublié qu’elles étaient censées nous permettre de sortir de la crise des années soixante-dix.
Premier exemple, le groupe Lactalis, qui exploite quelques-unes des marques leaders de l’agro-alimentaire, notamment des produits frais, dans notre pays, vient d’annoncer qu’il a utilisé une part importante de son trésor de guerre, accumulé au détriment de ses salariés payés à bas prix et des coopératives laitières auxquelles ils imposent le prix de la matière première, pour réaliser une OPA sur le groupe italien Parmalat.
Autre exemple, l’entreprise Renault, à peine remise de la rocambolesque affaire d'espionnage industriel qui ne semble avoir été qu'une machination interne à l'encontre de quelques cadres, vient d'annoncer son intention de développer ses activités de recherche et développement à l'étranger, notamment en Roumanie. Depuis quelques très anciens accords qu’elle avait passés avec le régime de Ceausescu, elle est fortement implantée dans ce pays, où elle fait construire une large part des véhicules qu’elle réimporte ensuite en France pour les vendre sous la marque Dacia.
Mes chers collègues, la démonstration est ainsi faite qu'il est urgent de ne rien changer, conformément aux conclusions du rapport de notre collègue Philippe Dominati.
La réalité, c’est que la France, bien qu’elle ait l'impôt sur les sociétés le moins rentable de toute l'Union européenne, continue malgré tout de voir partir ses industries, cependant que ses industriels sont plus préoccupés par leurs parts de marché extérieur que par le développement de leur potentiel de production, de leurs capacités de recherche et de conception sur le territoire français.
Monsieur le président de la commission, les quelques entreprises, dont Renault fait d'ailleurs partie, qui tirent aujourd'hui profit du régime du bénéfice mondial consolidé n'ont pas besoin de telles dispositions fiscales pour s'en sortir au mieux. Ainsi, Renault dans le passé – j’ai souvent cité cet exemple – aurait pu éviter de placer au chômage technique certains de ses salariés si 1 % seulement des dividendes versés aux actionnaires avaient été consacrés au paiement des salaires ! Avec ou sans tous ces régimes de faveur, ces entreprises continueraient de procéder comme elles le font depuis trop longtemps.
Les chiffres l'attestent, le régime du bénéfice mondial consolidé ne semble pas se traduire dans notre pays par un effort particulier en direction des salaires, de l'emploi ou du développement des capacités d'innovation et de production. C’est pourquoi il est temps de mettre un terme à ce dispositif qui, en réalité, n'est qu'un cadeau fiscal sans objet et sans intérêt.

Évitons la tentation du repli sur soi, ne dressons pas partout des barrières, des frontières, mais, au contraire, engageons ensemble un débat sur la mondialisation et ses enjeux.
Monsieur Foucaud, je l’ai dit, nous étions la semaine dernière aux Pays-Bas, non pas à Rotterdam, mais à La Haye.
Ne croyez-vous pas, puisque nous parlons de la mondialisation, que nous pourrions à cette occasion évoquer la question des ports et celle de leur fonctionnement ? Pensez-vous que l'attitude de certains syndicats portuaires français soit bénéfique pour notre pays et facilite la création des emplois que vous appelez de vos vœux ?
Aussi, j’invite un certain nombre de personnes à se remettre fondamentalement en cause et à délaisser les considérations tribunitiennes. C'est ainsi que l'on redonnera confiance et espoir.

Madame la présidente, je demande la parole pour répondre à M. le président de la commission.

Mme la présidente. Mon cher collègue, je ne peux vous la donner, car vous n'avez pas été mis en cause personnellement, et je souhaite que nous avancions.
M. Thierry Foucaud proteste.

Je mets aux voix l'article 1er.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du Gouvernement est également défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 198 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice fiscal donné, toute société est tenue d’acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l’application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, à l’assiette de son bénéfice imposable.

Cet article est particulièrement important, puisqu'il « pèse », d'après nos calculs, 10 milliards d'euros.
Certains ont parlé d’une proposition de loi théorique et technocratique. Je réfute ces qualificatifs. Au contraire, notre texte se veut pragmatique : il s’agit pour nous d'aider le Gouvernement dans son effort d'assainissement des finances publiques en lui permettant d’engranger 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires.
Monsieur le ministre, au moins, vous ne reprocherez pas à l'opposition de ne pas être aux petits soins avec vos soucis du quotidien !
Sourires
M. Patrick Ollier, ministre. Merci de votre soutien !
Nouveaux sourires.

L’examen de cette proposition de loi nous donne l’occasion de débattre sur le fond d’un certain nombre de questions économiques et budgétaires. À cet égard, j'observe que le bien-fondé de notre démarche ne suscite pas véritablement de contestation, et je m’en réjouis. Tout le monde a bien conscience que le dossier des niches fiscales doit évoluer.
Notre intention n’est pas d’accroître l’impôt ; nous voulons simplement que la fiscalité en vigueur s'applique équitablement à tous les contribuables, conformément aux exigences de notre modèle républicain.
Monsieur le ministre, ni vous ni personne d’autre dans cette enceinte n’a répondu à la question que nous posons : alors que le taux légal de l'impôt sur les sociétés est de 33 % en France, que les PME sont taxées à 22 %, pourquoi les grandes entreprises du CAC 40 ne paient-elles que 8 % ? Je regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée à cette question fondamentale.
Enfin, j’ai bien noté qu’une étude sur les niches fiscales serait remise au Parlement au mois de juin. Certes, le dossier avance, mais Mme Lagarde nous a annoncé qu’un délai de deux à trois ans serait nécessaire après la remise de ce rapport pour que soit engagée une réforme de ces niches fiscales. Ne fera-t-on rien entre-temps ? Nous ne sommes pas d'accord avec cette analyse et c'est pourquoi nous estimons que notre proposition de loi a tout son sens.
En réalité, le blocage essentiel est d'ordre idéologique.
M. le président de la commission des finances le conteste.

Or on a bien vu à quoi mènent les baisses d’impôts : pour les particuliers, elles ont créé tant d’injustices depuis plusieurs années que même la droite s'emploie à les corriger ; pour les entreprises, force est de constater le caractère injuste et les redoutables effets pervers du dispositif du bénéfice mondial consolidé.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Sénat serait bien inspiré de voter l’article 2 et, plus largement, cette proposition de loi, qui ne suscite visiblement aucune opposition, dont le bien-fondé est reconnu, qui ne pénalise pas la France dans le concert international et grâce auquel l'État pourrait encaisser 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires.

M. le président de la commission, qui se pose toujours la question des recettes, est très attaché, à juste raison, à l'équilibre budgétaire. Cependant, il ne répond pas fondamentalement à cette question : pourquoi les entreprises du CAC 40 ne paient-elles en moyenne que 8 % d'impôt sur les sociétés ? Voilà la question de fond !
Mme Christine Lagarde, au Sénat, en mars 2010, s’étonnait de l’écart entre le taux d’imposition facial des entreprises de 33, 3 % et le taux réel de 22 % en moyenne s’appliquant aux PME. Quant à nous, nous nous étonnons de l’écart entre 33, 3 % et 8 % !
Bien sûr, il faut que nous ayons des grandes entreprises et qu’elles réalisent des bénéfices ! Mais il faut qu’elles les investissent, comme nous le proposons avec le bonus-malus, plutôt que de distribuer des dividendes. D’ailleurs, ces derniers devraient être réintégrés dans l’impôt sur les sociétés, selon la proposition de l’un de nos collègues, ce qui permettrait de limiter la distribution indue de dividendes retardés. Vous savez très bien de quoi il s’agit.
Pourquoi refuser cette proposition de loi dont le bien-fondé est reconnu ? Vu l’ampleur du déficit budgétaire, on aurait tort de se priver de 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires !
On nous promet tous les ans une étude, et ce depuis plusieurs années. Voilà trois ans, dans cette même enceinte, M. Éric Woerth m’avait donné raison et avait annoncé une étude, m’assurant que la question serait réexaminée à l’occasion de la discussion budgétaire.
Nous essayons donc de vous convaincre, ce qui est bien normal dans le débat démocratique. Il nous reste deux articles pour y parvenir…
Sourires

L’article 2 dont nous débattons est particulièrement important, puisque c’est celui qui permettrait, s’il était adopté, d’engranger 10 milliards d’euros.
C’est pourquoi j’incite tous mes collègues à le voter et, à travers lui, à voter cette proposition de loi fort intelligente déposée par M. François Marc.

Monsieur le président de la commission, permettez-moi de faire une remarque sur vos propos concernant le port de Marseille et la mondialisation.
Le raisonnement que vous tenez n’est pas nouveau. De tout temps, bien avant la mondialisation, on a dit aux ouvriers : « Calmez-vous ! Travaillez pour être compétitifs ! Travaillez ! ». On utilisait déjà cet argument dans la compétition entre les régions. Depuis toujours, le patronat a incité les ouvriers à modérer leurs revendications concernant les salaires et les conditions de travail.
La mondialisation pose la question non pas de la disparition des syndicats, mais de la présence de ces derniers dans le monde. Il faut veiller aux conditions de travail et aux salaires en Chine, en Inde, dans l’ensemble des pays. La mondialisation doit respecter les salariés. C’est un problème clairement idéologique.
N’y a-t-il pas un rapport d’ailleurs entre le volet social et le volet économique ? Force est de constater que l’augmentation du nombre de jours de grève a correspondu à une période florissante pour l’économie française ! Cela relativise tout le discours tenu sur les syndicats et la remise en cause des luttes des travailleurs.

Les trois articles de la proposition de loi peuvent sembler se prêter à des débats sur une stratégie d’ensemble concernant la fiscalité des sociétés.
L’article 2 est l’article pivot. Il laisse penser que les PME françaises sont défavorisées par rapport aux grandes sociétés. En réalité, dans la vie des affaires, le développement d’une entreprise, d’une PME qui devient moyenne ou grande société internationale, repose sur l’internationalisation et la mondialisation. À l’évidence, plus la société fait de chiffre d’affaires à l’étranger, plus le taux de fiscalité dont elle bénéficie est faible.
Ce débat a permis de dresser un constat commun, qui n’a pas été contesté par les auteurs de la proposition de loi : ils ont admis que nous avions le taux de fiscalité le plus élevé.

Le rapport de la commission, qui est modéré, souligne que la France pratique actuellement un taux d’impôt sur les sociétés extrêmement élevé, ce que, je le répète, personne n’a contesté.
Plus une société se développe à l’international, plus elle trouve à l’étranger des taux d’imposition favorables à son développement, ce qui entraîne une baisse automatique du taux global d’imposition auquel elle est assujettie. Lorsque ses activités en France ne représentent plus que 15 % de son chiffre d’affaires, quelle que soit sa taille, le taux global d’imposition baisse mécaniquement. Comme les sociétés les plus fortes à la mondialisation, avec des représentations dans cinquante ou soixante filiales, se trouvent au CAC 40, il existe une différence inévitable entre ces sociétés et les autres sur le plan de la concurrence.
J’aurais été sensible à une proposition de votre part en faveur d’un système inverse visant à abaisser la fiscalité avec une conception plus libérale et orientée vers la compétitivité.
En réalité, contrairement à ce que vous dites, vous voulez multiplier par deux l’imposition des sociétés concernées, sous prétexte de cibler des symboles comme le CAC 40 et les dividendes importants. S’il y a trop de difficultés à l’exportation, tant pis !
Or, on le voit, notre commerce extérieur rencontre certaines difficultés et ce sont ces sociétés du CAC 40 qui sont concernées. Vous, vous voulez multiplier leur charge fiscale. Certes, la fiscalité n’est qu’un élément dans l’ensemble de l’attractivité d’une société, mais la compétitivité est un aspect essentiel.
Monsieur Foucaud, vous constatez que les activités de recherche et développement partent dans un autre pays. Mais, vous en avez conscience, l’entreprise Renault ne peut pas vivre uniquement de son marché national
M. Thierry Foucaud proteste.

Avec la seule part qu’elle détient sur le marché national, Renault n’est absolument pas viable. Il en est de même de n’importe quel autre constructeur automobile.
Plus la société est compétitive dans la mondialisation, plus elle a une chance de prospérer. Cette compétitivité se retrouve automatiquement au regard de l’impôt sur les sociétés.
Si certains dispositifs prévoyaient de faire un effort en direction des PME qui exportent, mon point de vue serait différent, car l’approche ne serait pas budgétaire.
Je l’ai dit, l’existence des niches fiscales ne se justifie que parce que nous avons un taux facial extrêmement élevé et peu compétitif. Si nous réduisons les niches, je suis d’accord pour trouver une assiette plus large et un taux plus faible, à l’instar de nos concurrents et de nos deux principaux partenaires européens.

Il n’y a pas les PME d’un côté et les grandes entreprises de l’autre. Les sociétés qui peuvent exporter, qui sont puissantes, grandes et dotées de moyens, jouent sur la fiscalisation et sur toutes les niches fiscales occasionnées pour l’attractivité, comme le crédit d’impôt recherche. En résumé, plus on va vers l’export, moins on paie d’impôts ; c’est automatique.

Monsieur Desessard, ne vous méprenez pas. Mon rêve est que les relations sociales soient fécondes et compréhensives, tout comme dans les pays proches du nôtre.
Je pense notamment aux Danois qui, en 1987, ont supprimé les charges sociales et augmenté la TVA. Ils ont trouvé un consensus social : ils ont obtenu la croissance, le plein-emploi et l’équilibre budgétaire. L’affrontement n’est pas obligatoire !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. S’agissant des ports français, le problème est réel, et je compte beaucoup sur Thierry Foucaud pour être mon avocat auprès des intéressés !
Sourires

J’ai beaucoup d’estime pour François Rebsamen, mais il me fait penser à Laurent Fabius
Ah ! sur les travées du groupe socialiste.

Je ne sais pas si c’est un compliment ! À mes yeux, cette façon de faire de la politique égare nos concitoyens.
Le taux de 8 % ne veut rien dire ! On peut avoir une assiette imposable en France s’il y a des bénéfices. Mais les entreprises du CAC 40 qui fait notre fierté, réalisent leurs affaires hors de France maintenant ! Avons-nous conscience de cela ?

Ce sont les PME qui restent chez nous, qui sont enracinées sur notre territoire.
Si le taux de 8 % est la conséquence de l’optimisation d’un crédit d’impôt recherche, je veux bien qu’on revoie cela. Mais, monsieur Rebsamen, pour l’essentiel, un certain nombre de sociétés enregistrent des pertes en France et réalisent leurs bénéfices ailleurs, ce qui fait que l’impôt qu’elles payent en France peut être nul.

La proposition de résolution, déposée notamment par notre collègue ancien ministre et député, Christian Estrosi, citant une publication – source Journal du dimanche du 19 décembre 2010 –, indique ce que les sociétés du CAC 40 paient en France et à l’étranger.
Essayons d’instruire cette question avec objectivité. N’accréditons pas l’idée selon laquelle les sociétés qui sont grandes paient peu d’impôt et les petites sont taxées à 22 % ! Cela n’a pas de sens !

Ne tenons pas de tels propos ; faisons œuvre utile et soyons un minimum pédagogues.

Je mets aux voix l'article 2.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Mes chers collègues, je vous propose, avec l’accord des auteurs de la proposition de loi et du rapporteur, de ne pas procéder au scrutin public et de considérer que le Sénat émet sur l’article 2 le même vote qu’à l’article 1er.
Il n’y a pas d’opposition ?...
L’article 2 n’est pas adopté.
Avant le a. du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aa. Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »

Mes chers collègues, je vous rappelle que si l’article 3 est rejeté, il n’y aura pas lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi dans la mesure où les trois articles qui la composent auront été rejetés. Par conséquent, si certains d’entre vous souhaitent prendre la parole, c’est pour eux la dernière occasion de le faire.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

L’article 3 concerne le mécanisme qui vise à favoriser l’investissement.
Monsieur le ministre, vous avez souligné que cette disposition figurait dans le projet socialiste. Puisque vous êtes chargé des relations avec le Parlement, je vous fais remarquer que le groupe socialiste au Sénat dépose régulièrement et depuis plusieurs années un amendement sur ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances. On peut se féliciter que l’élaboration du projet socialiste reprenne cette proposition.
Monsieur Foucaud, vous avez fait référence à la baisse de l’impôt sur les sociétés du temps où la gauche était aux responsabilités. Ce type de mécanisme avait été utilisé précisément pour favoriser l’investissement. À l’époque, nous avions baissé le taux de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui faisaient un effort d’investissement.
Monsieur le ministre, vous ne donnez aucune réponse aux questions que nous avons posées. Je peux le comprendre puisque nous représentons l’opposition et que nous sommes à un an des élections présidentielles. En revanche, vous ne répondez pas davantage à la centaine de députés de votre majorité qui ont déposé, à peu près dans les mêmes termes que notre proposition de loi, une proposition de résolution à l’Assemblée nationale.
Les sujets que nous abordons traversent donc tous les groupes politiques, vous ne pouvez l’ignorer.
Vous avez utilisé, les uns et les autres, deux arguments et Mlle Sophie Joissains, a repris, au nom du groupe UMP, cette antienne. Il s’agit de la compétitivité et de la concurrence.
Je reviens sur la question de la compétitivité. Vous n’avez pas démontré, lors du débat sur l’article 1er, plus particulièrement sur le bénéfice mondial consolidé qui constitue à nos yeux une niche fiscale octroyée depuis de nombreuses années à quatre ou cinq entreprises du CAC 40, comment cet avantage fiscal encourageait la compétitivité.
J’en viens à la question de la concurrence. Monsieur le président de la commission, personne, ici, ne veut attaquer nos champions nationaux. Plutôt que de faire l’éloge du CAC 40, j’aurais préféré que vous posiez le problème d’une manière plus globale, comme vous en avez l’habitude, et que vous évoquiez l’ensemble des coûts qui pèsent sur les facteurs de production.
Or plus les charges qui pèsent sur les coûts de production sont fortes, plus le rendement de l’impôt sur les sociétés est faible. Ce simple constat aurait pu déboucher sur un débat fécond et intéressant, mais ce n’est pas celui que vous avez fait.
À la demande du Président de la République, la Cour des comptes a réalisé un rapport sur la convergence franco-allemande. Nous étions d’ailleurs en déplacement à Berlin voilà une quinzaine de jours.
Dans les systèmes allemand et français, les taux d’imposition sont à peu près équivalents. Cependant, la fiscalité ne permet pas de régler tous les problèmes, même si elle dégage des marges de manœuvre. En revanche, il y a une différence considérable entre les deux systèmes : en Allemagne, on soutient les PME dans leur effort de compétitivité à l’international, ce qui n’est pas le cas en France.

Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, vous connaissez très bien, vous qui faites l’éloge du CAC 40, la manière dont certaines entreprises agissent avec leurs sous-traitants implantés sur le sol national. On peut s’interroger sur les vertus de ces entreprises à encourager les PME qui dépendent de donneurs d’ordre. Tous les éléments doivent être pris en compte.
Monsieur le président de la commission, vous avez évoqué les prix de transfert. Il s’agit, vous avez raison, d’un véritable sujet de discussion. Je ferai toutefois une observation. Lors de la discussion du projet de loi de régulation bancaire et financière, le groupe socialiste, dans un souci de visibilité, a défendu un amendement dont l’objet était d’obliger les entreprises à afficher leurs comptes. Or, cet amendement, vous ne l’avez pas voté. Il faudra donc revenir sur ce sujet.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué, toujours à propos de la concurrence et de la compétitivité, le cas de l’Irlande, auquel le rapporteur général de la commission des finances est sensible. Partout où il passe, il fustige le faible taux d’imposition irlandais de 12 % à peine.

Il y a une différence entre l’Irlande et la France. Le nouveau Premier ministre irlandais le sait et il s’en sert lorsqu’il déclare que, finalement, les entreprises paient plus d’impôts dans son pays qu’en France compte tenu du mitage de l’impôt sur les sociétés dans notre pays.

C’est un argument dont il vous faudra tenir compte dans les négociations européennes. Aujourd’hui, nous sommes mal placés pour négocier dans de bonnes conditions le projet de directive qui est en cours d’examen à la Commission européenne, car nous sommes affaiblis par le mitage de l’impôt sur les sociétés.
Le groupe socialiste, et c’est l’objet de cette proposition de loi, propose d’en finir avec tout cela. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet qui, croyez-moi, nourrira le débat de 2012.

Madame Bricq, je n’ai pas fait l’apologie du CAC 40. Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire et de l’exprimer publiquement à plusieurs reprises, le CAC 40 est parfois un accélérateur de délocalisations, tant il fait pression sur les sous-traitants, les fournisseurs. Globalement, le CAC 40 supprime plutôt de l’emploi, directement et indirectement au travers de la sous-traitance.
Dans le CAC 40, il y a des entreprises comme Renault. La question est de savoir pourquoi on délocalise aussi massivement. J’espère que nous pourrons engager un débat sur le sujet, mais que nous le ferons dans des conditions sereines qui nous permettront d’engager les réformes nécessaires. En tout état de cause, taxer la production, c’est organiser méthodiquement le transfert d’activités hors du territoire national.

Je ne me suis pas exprimé sur l’article 1er, mais veux vous dire, madame Bricq, que le mécanisme du bénéfice mondial consolidé, qui existe depuis 1965, tombe en désuétude.

Son coût est tout de même de 400 millions d’euros ; c’est cher par les temps qui courent !

J’ai regardé quelles étaient les entreprises qui en profitaient, afin de m’assurer qu’il n’apportait pas un avantage indu.
Force est de constater qu’un petit nombre seulement sont intéressées, la plupart des sociétés compétitives jugeant ce mécanisme sectoriel trop complexe. Lorsqu’on a voulu l’étendre aux PME voilà trois ans, la tentative est restée sans suite. Comme le montrent les débats parlementaires, les gouvernements n’y ont recours que dans des conjonctures bien particulières.

À partir du moment où ce mécanisme est appelé à mourir de sa belle mort à l’échéance des conventions qui sont en cours et sachant que le pouvoir politique peut garder la faculté d’y recourir soit pour remédier à un problème sectoriel dans une branche d’activité, soit pour préserver des emplois, il n’y a pas de raison d’envisager sa suppression sans en avoir évalué les conséquences dans un audit préalable.
Tout dépendra de l’intérêt qu’il présente pour le sauvetage de telle industrie ou tel bassin d’emplois. Il se peut qu’un ministre décide, dans une conjoncture particulière, de renouveler une convention de cinq ans.

Dans le cas contraire, il disparaîtra.
J’en viens à l’article 3 proprement dit. Les entreprises qui « marchent » sont celles où les salariés sont intéressés à la création de richesses. Cet intéressement se traduit soit par le versement d’une prime s’ajoutant au salaire, soit par la participation.
Comme l’a souligné le président de la commission des finances, il est risqué de toucher aux dividendes. Je connais une entreprise dont la filiale française a perdu 120 millions d’euros en deux ans. Cette entreprise appartient à un groupe de taille mondiale qui gagne de l’argent à l’étranger. Comment fait-on, dans ce cas, pour répartir les dividendes ? Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise ne verse pas de dividendes à ses actionnaires pendant trois ans ? Que se passe-t-il en cas de versement d’un dividende exceptionnel ? La participation et l’intéressement doivent donc se cantonner a priori sur la rémunération et le salaire. Toucher aux dividendes est selon moi très délicat. Mais je suis persuadé que nous reviendrons sur ce sujet dans quelque temps.

Madame la présidente, dans la mesure où je pressens que l’article 3 ne sera pas adopté, je souhaite expliquer mon vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
C’est la crise… Les salariés sont affectés par le chômage et la hausse des prix, les petites entreprises pâtissent de l’atonie de l’économie et l’État connaît une situation budgétaire dramatique. Pour autant, l’année 2010 n’a pas été morose pour tout le monde. Les entreprises du CAC 40 affichent un bénéfice cumulé de 82, 5 milliards d’euros, proche du record historique de 2007.
On pourrait donc imaginer que ces grandes banques et industries ont à cœur de participer à l’effort national par une contribution à la hauteur de leur prospérité. Quelle naïveté ! Le Conseil des prélèvements obligatoires relève qu’elles sont imposées à hauteur de 8 % ! Total, que l’on a évoqué à maintes reprises au cours de cette discussion, ne ferait, nous dit-on, aucun bénéfice en France : cela demande à être vérifié ! Total, première entreprise française, qui a réalisé 10 milliards d’euros de profits en 2010 grâce à la hausse du prix du brut, ne paie pas un euro d’impôt sur les sociétés en France !

Dans le même temps, on ne cesse d’entendre le patronat se lamenter de la pression fiscale française... Où est l’erreur ?
La présente proposition de loi, très modérée, vise à réintroduire dans la fiscalité un grain de bon sens. Elle permet simplement de rétablir un peu de justice et de réalisme dans la répartition de la richesse nationale, en obligeant les très grands groupes à ne pas payer moins d’impôt que les PME et en incitant les entreprises à investir plutôt qu’à rémunérer trop généreusement les actionnaires.
Comment peut-on sérieusement s’y opposer dans le contexte social actuel ? Considère-t-on que Total, qui fleurit sur la crise environnementale, que la BNP, qui spécule dans les paradis fiscaux, ou que France Télécom, qui harcèle son personnel, méritent véritablement de payer en France moins d’impôts qu’un artisan ?
Tout cela est si peu raisonnable que les dirigeants de la majorité eux-mêmes en conviennent publiquement : « Je veux que les entreprises qui investissent et qui créent des emplois paient moins d’impôts sur les bénéfices que celles qui désinvestissent et qui délocalisent. » C’est ainsi que Nicolas Sarkozy s’adressait à la « France qui souffre », en 2006.

« Je ne trouve pas très sain qu’il y ait un tel écart entre le taux facial d’imposition sur les bénéfices et le taux réel. » déclarait Mme Lagarde au journal Les Echos, au mois de mars 2010. M. Baroin, enfin, évoquait fort astucieusement, en décembre dernier, un « impôt de chagrin ».
Pourquoi la majorité d’aujourd’hui ne veut-elle pas mettre en œuvre les propositions de campagne de M. Sarkozy ?

Pourquoi nous faudrait-il nous résigner à guetter pendant deux ou trois ans l’hypothétique toilettage des niches fiscales, évasivement promis par Mme Lagarde, plutôt que d’agir maintenant ?
La réponse est à chercher dans l’archaïsme du discours idéologique de la droite libérale, laquelle n’a jamais admis sa responsabilité intellectuelle dans la crise financière qui a secoué le monde et se trouve aujourd’hui engoncée dans une posture en complet décalage avec la réalité.

Dans les couloirs, pourtant, certains parlementaires de la majorité considèrent que cette proposition de loi est pertinente et raisonnable. Mais la droite est aujourd’hui soumise à une chape de plomb idéologique et aux rodomontades d’un Président de la République aux abois, qui joue la fuite en avant avec des propositions mal étudiées et incohérentes, comme cette surprenante prime de 1 000 euros !

M. Jean Desessard. N’attendons pas, encore et toujours ! Plutôt que de repousser à demain ce que l’on peut faire le jour même, parce que la situation économique et sociale appelle davantage de responsabilité et de solidarité, les sénatrices et les sénateurs écologistes voteront pour cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

La proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste a le mérite de placer le débat fiscal sur un sujet peu abordé, que l’on aurait même pu penser tabou : la fiscalité des entreprises, en particulier le statut, l’assiette et les composantes de l’impôt sur les sociétés.
Ce débat a bien plus de sens que celui qui consiste à essayer de regagner le vote de 300 000 cadres et assimilés, en les dispensant de l’ISF auquel ils sont aujourd’hui soumis, tout en faisant un cadeau généreux à ceux qui y resteront assujettis.
Je ne m’étonne pas que ceux qui freinent des quatre fers dès qu’il est question d’apporter la moindre modification à l’impôt sur les sociétés soient également ceux qui prônent un allégement de l’ISF. Il s’agit là, nous le savons, de la priorité fiscale du moment de tous les Français !
Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.

Deux articles de cette proposition de loi ont été rejetés par la majorité – le troisième est en passe de l’être – au nom d’arguments ressassés et, pour tout dire, purement idéologiques.
Nous aurions pu en concevoir bien d’autres, tant est foisonnante la forêt impénétrable des mesures qui allègent aujourd’hui l’impôt sur les sociétés, depuis le crédit d’impôt recherche, qui, je le dis au passage, n’a rien réglé au problème de la recherche et développement dans notre pays, jusqu’au report en arrière des déficits en passant par les crédits d’impôt les plus divers et les plus étonnants.
Nous connaissons l’affaire : on dépense aujourd’hui deux fois plus à ne pas appliquer le taux de l’impôt sur les sociétés qu’à encaisser une recette fiscale pourtant nécessaire à l’équilibre des comptes publics. Si j’ajoute l’effet de la baisse du taux, je vous laisse imaginer la situation…
Que la majorité du Sénat ne s’en tienne pas pour quitte ! Le fait qu’elle repousse aujourd’hui cette proposition de loi ne clôt pas le débat sur la réforme fiscale, loin de là, et nous rappelle même qu’il devra porter aussi sur l’impôt sur les sociétés.
Mes chers collègues, ne comptons pas sur la seule taxe carbone, même rebaptisée « contribution climat-énergie », ou sur la « TVA éco-modulable » – je me demande d’ailleurs où est la différence – pour faire le compte du côté de la nécessaire réforme fiscale à entreprendre en 2012, pour poser les termes d’une véritable alternative aux pratiques qui ont cours depuis trop longtemps et se sont amplifiées au cours des dix dernières années.
Monsieur le rapporteur, si nous voulons réformer la fiscalité des entreprises, ce n’est nullement parce que nous n’aimons pas les entreprises ou que nous cherchons à rançonner le capital ! C’est simplement parce qu’il est normal que l’entreprise, lieu de création de richesse résultant du travail des salariés, soit aussi le lieu où l’on produit la matière fiscale, la base naturelle d’une contribution légitime, et ce à la charge de tous.
C’est avec le produit du travail de tous, par des cotisations sociales, par la fiscalité locale, par une juste imposition des résultats que nous pouvons et que nous devons concevoir l’alternative, la réponse la plus adaptée aux besoins collectifs, quels que soient leur forme, leur coût apparent ou leur réalité.
Rendre plus efficace et plus rentable l’impôt sur les sociétés est donc légitime de ce point de vue, comme était légitime que nous proposions, au mois de mars dernier, un accroissement du rendement de la fiscalité locale, notamment de la contribution économique territoriale des entreprises. Nous avions alors proposé, vous vous en souvenez, d’impliquer les actifs financiers des entreprises dans cet effort sans que cela rencontre pour l’heure le soutien de notre assemblée, notamment – pardonnez-moi, mes chers collègues ! – du groupe socialiste.
Il n’est pourtant pas certain que l’idée ne fasse pas son chemin dans l’esprit des élus locaux, qui sont toujours aux prises avec la réforme de la taxe professionnelle dont ils se rendent de plus en plus compte qu’elle les prive et les privera de ressources.
Toujours est-il, mes chers collègues, que la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui va dans le bon sens ; c’est pourquoi nous la voterons.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
M. Patrick Ollier, ministre. Je ne voudrais pas allonger les débats…
M. René-Pierre Signé s’exclame.
Madame Bricq, vous avez dit à deux reprises que je n’avais pas répondu aux questions. J’ai pourtant répondu à M. Rebsamen et à M. Marc, en précisant, sur le point concernant le CAC 40 et les 8 %, que c’était une question de méthode de calcul, comme M. Arthuis l’a fait, d’une manière d’ailleurs beaucoup plus technique que moi. Je ne reviendrai donc pas sur ce point.
Sur l’impôt minimum, ma démonstration a été, je le crois, tout à fait probante, même si vous n’avez pas voulu l’entendre.
En ce qui concerne l’article 3, vous n’en avez pas trop parlé
Mme Nicole Bricq s’exclame
S’agissant de l’évolution du système fiscal, je vous rappellerai, vous l’avez d’ailleurs reconnu, qu’un rapport sur les niches fiscales sera remis à la fin du mois de juin. Le BMC sera évalué à cette occasion. Je vous propose d’attendre cette évaluation, qui nous permettra de disposer de données beaucoup plus précises, notamment sur des méthodes de calcul, afin que le débat prospère.
Monsieur Marc, je vous remercie d’avoir permis, avec vos collègues, l’ouverture de cette discussion.
Je n’ai pas retenu les arguments que vous avez évoqués lors de vos interventions en explication de vote.
M. Patrick Ollier, ministre. Je les trouve un peu caricaturaux !
Non ! sur les travées du groupe socialiste.
La caricature n’est pas injurieuse si l’on a l’art de bien tenir son crayon !
Je tiens à remercier également M. le président de la commission des finances d’avoir éclairé fort judicieusement les débats, grâce à ses arguments très précis, ainsi que M. le rapporteur, qui a fait une démonstration brillante sur la fiscalité des entreprises. Nous nous y reporterons lorsque le débat reprendra.
Je remercie Mme Joissains et les membres de la majorité d’avoir soutenu le Gouvernement afin que cette proposition de loi ne puisse pas être adoptée aujourd’hui.
Enfin, je veux vous remercier, madame la présidente, de la manière dont vous avez présidé ces débats.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Je mets aux voix l'article 3.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de l’UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Mes chers collègues, je vous propose de considérer, dans les mêmes conditions qu’à l’article 2, que la Haute Assemblée émet, sur l’article 3, le même vote qu’aux articles précédents.
Il n’y a pas d’opposition ?...
L’article 3 n’est pas adopté.
Les trois articles de la proposition de loi ayant successivement été repoussés, la proposition de loi est rejetée.

L’ordre du jour appelle l’examen, à la demande du groupe socialiste, de la proposition de résolution instituant une « journée nationale de la laïcité », présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés (proposition n° 269).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous présenter une proposition de résolution visant à instaurer une journée nationale de la laïcité.
Le texte de cette résolution se suffit à lui-même, mais il paraît utile de faire quelques rappels sur l’historique de la laïcité, et de motiver plus amplement cette proposition.
Quand j’ai déposé ce texte, convaincu de son bien-fondé, je ne savais pas, monsieur le ministre, qu’il allait autant coller à l’actualité et faire suite à un débat politique lourdement contesté qui s’est déroulé au début du mois d’avril.

Cet épisode est regrettable, car la laïcité n’a pas à être débattue ; elle se vit et s’applique en tant que principe fondateur et consubstantiel à la République.

Ma volonté, aujourd’hui, vise simplement à rappeler que la France est un pays laïc.
Loin de moi l’intention de m’étendre sur une définition du mot « laïcité », que l’on a parfois tendance à confondre avec l’œcuménisme qui tend à unir toutes les églises, l’athéisme qui nie l’existence de toute divinité, ou l’agnosticisme qui considère que la connaissance du sens de l’existence est inaccessible à l’esprit humain.
La laïcité, j’y reviendrai, tolère tous ces concepts.
Mais ce doux mot, féminin, porteur de tolérance, peut aussi provoquer des attitudes violentes, extrémistes, voire nauséabondes.
Je choisis, pour expliquer la motivation de cette démarche, de faire un bref retour historique, car c’est dans l’histoire de la laïcité que l’on comprend mieux la nécessité de défendre aujourd’hui ses principes.
L’étymologie du mot « laïc », qui vient du substantif grec laos – le peuple –, signifie « populaire » ou « national ». Ce terme était utilisé dans les premières communautés chrétiennes pour désigner ceux qui ne faisaient pas partie de la communauté religieuse, les illettrés, le peuple.
Issue du siècle des Lumières, c’est à la Révolution française, en 1789, que la laïcité a acquis une véritable consistance par l’affirmation de principes universels, dont la liberté de conscience et l’égalité des droits exprimés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En 1801, ces principes furent remis totalement en cause lors du Concordat signé par Napoléon et le représentant du Pape Pie VII.
En 1850, le ministre de l’instruction publique, Alfred de Falloux, réorganisa le système d’enseignement pour le mettre sous la tutelle de l’église catholique, avec la tristement célèbre loi Falloux… Cela motiva une virulente protestation de Victor Hugo devant l’Assemblée législative en ces termes : « J’entends maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et salutaire séparation de l’Église et de l’État qui était l’utopie de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. [:..] Je ne veux pas qu’une chaire envahisse l’autre ; je ne veux pas mêler le prêtre au professeur. [...] Je veux l’enseignement de l’Église en dedans de l’église et non au dehors. [:..] En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères : l’Église chez elle et l’État chez lui. »
Ce long conflit entre les partisans d’une France monarchique, catholique et conservatrice, et les défenseurs d’une France laïque, républicaine et ancrée vers la gauche fut communément appelé la « guerre des deux France ».
Le terme de « laïcité » apparu pour la première fois sous la Commune de Paris, en 1871. Quelques décennies plus tard, s’ensuivirent l’affaire Dreyfus, puis l’époque des hussards de l’école publique, qui se voulaient héritiers du siècle des Lumières, adeptes de la Raison. C’étaient des républicains, souvent libres-penseurs, francs-maçons ou protestants. Quelques grands noms de cette époque sont incontournables : Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinand Buisson et René Goblet. Tous apportèrent leur pierre à la laïcisation de l’enseignement.
Enfin, la lutte entre anticléricaux et catholiques conservateurs vit son aboutissement avec la loi du 9 décembre 1905, adoptée dans la foulée de celle de 1901 sur les associations.
Cette loi du 9 décembre 1905, pilier des institutions, fut le résultat d’un long débat, d’une haute tenue philosophique, idéologique et juridique, qui se déroula du 31 mars au 3 juillet 1905. Il convient d’y ajouter le temps consacré à la préparation du projet de loi par une commission de trente-trois membres, présidée par Ferdinand Buisson, président de l’Association nationale des libres-penseurs de France.
Face à une tâche aussi délicate, cette commission a siégé plus de dix-huit mois, ce qui a fait dire à Jean Jaurès que ce document parlementaire détenait « le record de travail de la législature présente, de celles passées et peut-être de celles à venir... ». Cela ne s’est pas démenti !
Les débats, nécessairement longs, furent souvent tendus et houleux. Pouvait-il en être autrement ? Les guerres de religions et toutes leurs conséquences, au demeurant pas si lointaines, étaient ancrées dans beaucoup de mémoires.
Aristide Briand, député socialiste de la Loire, rapporteur du projet de loi, arriva, grâce à ses talents de conciliateur, à faire adopter un texte d’équilibre.
Ce texte pose le principe de la liberté de conscience et celui du libre exercice des cultes. Parallèlement, il affirme son intention de sécularisation, en confiant à l’État les biens confisqués à l’Église et en supprimant la rémunération du clergé par l’État.
L’essentiel est contenu dans l’article 1er de la loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Ce texte a su donner satisfaction à tous en consacrant la séparation entre sphère publique et sphère privée, en laissant à chacun la liberté de croire à une religion ou – c’est important de le rappeler aussi – de ne pas croire. Je pense aux athées et aux agnostiques, qui sont également attachés à la réaffirmation des principes de la laïcité.
En effet, la laïcité repose non pas sur la tolérance des différences, mais sur l’égalité des citoyens. Voilà pourquoi, comme le disait Jean Jaurès dès 1893, « démocratie et laïcité sont deux termes identiques ».
Cependant, si la laïcité, comme garante des valeurs républicaines « liberté, égalité, fraternité », a été élevée au rang de principe constitutionnel, force est malheureusement de constater qu’aujourd’hui elle est de plus en plus oubliée, voire bafouée. Alors que l’on pouvait penser acquis le caractère laïque de l’État français et que personne ne semblait plus remettre en cause les principes de laïcité et de séparation des églises et de l’État, découlant de la loi de 1905 et de la Constitution de 1958, des tentatives de remise en cause, de plus en plus distinctes, ont été observées. Face à ces tentatives, on peut regretter que, à la place d’un rappel clair du principe constitutionnel de laïcité, une certaine confusion ait été entretenue.
Nous avons tous en mémoire la violence, à certains moments, des querelles sur l’école, la difficile coexistence entre l’école publique et l’enseignement privé, essentiellement catholique.
Le principe de laïcité française ne devrait pas diviser ; il devrait au contraire rassembler les hommes d’opinions, de religions ou de convictions différentes dans une même société. Ciment de notre démocratie et du « vivre ensemble », il revêt la même importance que le triptyque « liberté, égalité, fraternité » qu’il complète.
C’est pourquoi cette idée, ou plus précisément cette valeur, socle de notre République, doit être aujourd’hui réaffirmée, en direction notamment des jeunes générations.
Comment mieux intégrer la notion de laïcité qu’en la faisant reine d’une journée par an, pour la faire vivre, l’enseigner, se l’approprier ?
Aujourd’hui, il se trouve que ce principe, que l’on pensait acquis, subit des manquements dangereux.
Comment ne pas comprendre le très profond attachement à la laïcité des membres d’associations qui ont mis ce concept au centre de leur réflexion, ou de ceux qui, en sorte d’héritage, gardent en mémoire le fossé qui a divisé, durant plusieurs décennies, catholiques et protestants, ou encore de ceux qui ont connu les pratiques encore en cours dans la première moitié du XXe siècle, notamment les difficultés pour célébrer les mariages mixtes ou les inhumations au fond des jardins, hors du cimetière communal où n’étaient pas admis les protestants ? Nos institutions peuvent-elles admettre la présence religieuse dans des manifestations officielles ou associatives ?
À l’inverse, la République française ne doit pas être présente en tant que telle dans les manifestations ou offices religieux. La très récente décision du Président de la République de demander au Premier ministre d’assister à la béatification du Pape est une entorse grave au principe de laïcité inscrit dès l’article 1er de notre Constitution.

Quant à la justification exprimée par le porte-parole du Gouvernement, elle est tout autant inadmissible ! Non, monsieur le ministre, la France n’est pas la fille aînée de l’église, la France est une République laïque.

Cela vaut également bien sûr pour le monde de l’éducation. Au summum de la gravité et du manquement à la laïcité, un lycée de mon département a connu récemment un exemple de prosélytisme anti-avortement de la part d’un enseignant.
Le temps me manque pour aborder le débat opportuniste sur les lieux où peuvent se pratiquer les offices religieux. Je préfère retenir que les citoyens, aux prises avec des problèmes sociaux parfois insurmontables, méritent un plus grand respect de la République ; alors, ils respecteront à leur tour la République.
La loi de 1905 doit-elle être modifiée ? Non.
En effet, véritable monument législatif, elle répond à tous les cas de figure. Je l’affirme d’autant plus volontiers que je suis viscéralement contre.
J’aurais pu vous livrer plusieurs citations sur ce sentiment largement partagé dans nos formations politiques et associations républicaines. Ne souhaitant pas être accusé de partialité, j’ai volontairement choisi de citer les propos tenus par Jean-Louis Debré, alors président de l’Assemblée nationale, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905 : « Un siècle après son adoption, la loi de 1905 figure au nombre des grandes lois de la République, de notre République. Elle constitue une clé de voûte de notre modèle de laïcité. […] Elle représente aujourd’hui un point d’équilibre, et vouloir la remettre en cause serait irresponsable. »
Son adaptabilité à tous les temps est contenue dans l’intitulé même de la loi, au travers de l’emploi du pluriel « des églises », pluriel que le concept populaire néglige souvent, à tort, puisque l’on parle – Victor Hugo lui-même le disait – de « séparation de l’église et de l’État ». Nous considérons que cette loi contient des valeurs qui se proclament et ne se discutent pas.
Pour autant, pourquoi instaurer, m’a-t-on demandé, une journée de la laïcité ? Et certains d’ajouter : « encore une nouvelle journée ! »
Mais, mes chers collègues, n’est-ce pas un bel enjeu que de célébrer chaque année l’un des fondements de notre République, le 9 décembre, jour anniversaire de la loi concernant la séparation des églises et de l’État ? Ne peut-on y consacrer un petit jour par an, pour rappeler la laïcité, pour faciliter le « vivre ensemble » ?
Savez-vous que, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905, un sondage a montré que plus de 80 % des jeunes enseignants étaient attachés à la laïcité. Ce constat rassurant m’a renforcé dans mes convictions.
Je salue et je remercie les membres de mon groupe qui m’ont suivi dans ma démarche depuis le dépôt de cette proposition de résolution. Par ailleurs, les nombreux soutiens, écrits et oraux, que j’ai reçus sont encourageants et me laissent espérer une large adhésion de nos concitoyens et – pourquoi pas ? – du Sénat.
Il s’agira donc de donner un peu plus d’oxygène à la laïcité pour ranimer la flamme de la liberté de conscience, permettre aux options spirituelles de s’affirmer sans être inquiétées et sans s’imposer. Non, il n’est pas inutile de réapprendre régulièrement aux citoyens de notre pays les règles élémentaires de la liberté de penser et du respect de l’autre. Un jour par an, ce principe de tolérance pourrait être fêté au sein des associations, conjugué dans les établissements scolaires.
Il convient de réaffirmer de façon claire ce principe humaniste, fondateur de notre société moderne. La laïcité est en effet une de nos chances pour l’avenir. Je ne doute pas une seconde de la créativité de nos concitoyens, enseignants, bénévoles d’associations et autres, pour animer cette journée de façon pédagogique, ludique et festive, dans la convivialité. Je fais confiance à l’imagination des animateurs de nos établissements d’enseignement, de nos institutions ou de nos associations, pour inspirer une exploration intelligente du concept de laïcité au travers, chaque année, d’un thème national : par exemple, « laïcité et enseignement », « les associations et la loi de 1905 », « laïcité de l’état civil » – c’est un sujet important –, « croyants et non-croyants ».
Pour finir, je soumets à votre réflexion un extrait d’un discours d’Aristide Briand, s’exprimant juste avant le vote de la loi : « permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme [...] aura pour effet désirable d’affranchir ce pays d’une véritable hantise, sous l’influence de laquelle il n’a que trop négligé tant d’autres questions importantes, […] Ces grands problèmes se poseront demain, dès qu’auront disparu des programmes les questions irritantes, qui comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu’à la haine et gaspillent en discordes stériles les forces les plus vives et les enthousiasmes les plus généreux de la nation. […] Mais, pour qu’il en fût ainsi, […] il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s’exprimer librement. »
J’espère vous avoir convaincus, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, que la laïcité, qui porte en elle la garantie d’une coexistence pacifique de tous les habitants de notre pays, qui peut – je le souligne – apaiser des peurs injustifiées, vaut bien que nous lui consacrions une journée par an pour la promouvoir et la défendre de toute agression.
Il se trouve, mes chers collègues, qu’un autre groupe politique, de la majorité, a déposé le même jour une proposition identique. C’est dire combien le thème de la présente proposition de résolution suscite le consensus.
Solennellement, le groupe socialiste vous engage, mes chers collègues, à soutenir cette proposition de résolution, par laquelle nous demandons que la République française instaure une journée nationale de la laïcité, garante de la cohésion républicaine, journée non fériée ni chômée, fixée au 9 décembre, et permettant chaque année de faire le point sur les différentes actions menées en la matière par les pouvoirs publics et d’être l’occasion de manifestations au sein du système associatif et éducatif.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous informe que, devant suspendre nos travaux à treize heures, nous ne pourrons malheureusement achever l’examen de la présente proposition de résolution ce matin.
Dans la suite de la discussion, la parole est à Mme Roselle Cros.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la laïcité est l’un des principes fondamentaux de notre République. C’est une évidence que nous partageons avec les auteurs de la proposition de résolution qui nous est soumise.
Affirmée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle a aujourd’hui valeur constitutionnelle. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est l’un des textes républicains les plus fondateurs de notre législation. Notre collègue Claude Domeizel nous a fait un rappel historique complet et fort intéressant de la laïcité.
Cependant, mes chers collègues, depuis 1789 et même depuis 1905, les temps ont changé. Le contexte passionné et très conflictuel de l’époque est révolu. Nous n’en sommes plus à devoir batailler pour affirmer ou réaffirmer la séparation des églises et de l’État. Que les auteurs de la proposition de résolution le veuillent ou non, la laïcité est, fort heureusement, un acquis que nul ne veut vraiment remettre en cause.
Dans l’exposé des motifs, on nous explique de manière succincte, allusive et, il faut bien le dire, un peu mystérieuse que « des tentatives de remise en cause, de plus en plus distinctes, ont été observées ». C’est bien sur ce constat que nous divergeons : non, il n’y a pas, à nos yeux, de contestation sérieuse du principe de la laïcité.
Il est vrai que certains faits divers ont pu être montés en épingle par les médias, que certains débordements ont pu, au prix d’une certaine exagération, être interprétés comme des remises en cause, que des questions ont pu être soulevées à l’occasion de l’occupation d’espaces publics ou lors de discussions sur le respect de prescriptions alimentaires de nature religieuse dans les repas des cantines scolaires. Mais les polémiques sont retombées naturellement, sans devenir de réels enjeux nationaux, comme en témoigne la faible mobilisation qu’a suscitée le dernier débat organisé sur le thème de la laïcité.
Est-ce bien notre rôle de parlementaires que de raviver de vieilles querelles ?

Est-ce bien notre rôle de souffler sur des braises qui n’arrivent plus à s’enflammer ? Je ne le crois pas.
La laïcité est à ce point acquise et consensuelle que la défense de ce principe ne figure plus au nombre des préoccupations quotidiennes des Français. Ceux-ci sont inquiets avant tout pour des raisons d’ordre économique et financier.
Qu’est-ce qui les préoccupe en tant qu’individus ? Le pouvoir d’achat, le prix de l’essence, la scolarité de leurs enfants, l’insécurité sous toutes ses formes, le devenir de leur emploi, et cela se comprend.
Quant à ceux, nombreux, qui s’intéressent à la politique, de quoi parlent-ils en famille ou entre amis ? De la dette publique, la nôtre et celle de nos voisins européens, de la mondialisation, avec ses répercussions sur les fermetures d’usine, de la crise du monde arabe. Mais sûrement pas de la laïcité, qui n’est pas devenue l’affaire Dreyfus de 2011 !
J’en veux pour preuve les débats sociétaux de fond qu’ici et là on a tenté de lancer. Le débat sur l’identité nationale, qui avait pourtant un sens, n’a pas produit les effets attendus. Au lieu d’engager une réflexion et d’être l’occasion de renforcer le lien national, ce débat a été détourné de ses objectifs, provoquant des polémiques, sans que nos citoyens se sentent vraiment concernés.
Dès lors, pourquoi créer une journée nationale de la laïcité plutôt qu’une sur chacun des autres grands principes de la République ? Pourquoi pas une journée de la liberté ou une journée de l’égalité ?
Mes chers collègues, j’estime que les manquements à l’égalité sont plus importants que les manquements à la laïcité. On ne commémore pas les fondements de notre République : on les met en pratique et on s’attache à les sauvegarder dans le cadre de nos institutions et de nos dispositifs législatifs et réglementaires.

Ce qui est pertinent, c’est de laisser aux autorités publiques, quelles qu’elles soient, l’État, les collectivités territoriales – et celles-ci sont largement concernées –, les juridictions, le soin de veiller au respect du principe de laïcité dans la sphère publique et à la garantie de la liberté religieuse dans la sphère privée : chacun s’y emploie au niveau qui est le sien.
En conclusion, vous l’aurez compris, mes chers collègues, parce qu’il s’agit pour nous d’un faux débat, j’ai même envie de dire d’une fausse bonne idée, …
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

, sans susciter aucun enthousiasme fédérateur chez nos concitoyens, dont les préoccupations sont tout autres, les membres du groupe Union Centriste et moi-même ne voterons pas la présente proposition de résolution.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution présentée par notre collègue Claude Domeizel est une excellente initiative, et j’espère qu’elle fera l’objet d’un consensus. Mais j’en doute après les propos qui viennent d’être tenus…
Chacun possède une identité propre, plurielle, dépendant de son vécu, de son histoire, de ses origines, de sa culture, de sa confession, de ses engagements. Cette pluralité fait la richesse de notre pays et, en même temps, de chacun de nous, y compris dans nos contradictions. Mais pour que cette richesse porte des fruits, pour qu’elle soit effectivement un gage de renforcement de notre pays, il faut un socle partagé, nous permettant de surmonter nos diversités et de favoriser l’échange. Tel est l’office de la laïcité, qui est le ciment de notre « vivre ensemble » et la matrice surplombant nos identités plurielles.
D’aucuns ont cru devoir discuter de la loi de 1905, la modifier, du fait de comportements marginaux de certains… de certains musulmans, disons-le. Ne touchons pas à cette loi, mais, en revanche, réglons les problèmes qui se posent à la deuxième religion de France parce que sa visibilité dans l’espace public dérange, et c’est bien normal. J’observe toutefois que cela dérange aussi la très grande majorité des Français de confession musulmane.
Réglons cette question de manière technique, par exemple au moyen du prêt de salles une à deux heures par semaine. Arrêtons d’en faire un sujet exploitable par l’extrême droite. Arrêtons de banaliser l’idée selon laquelle l’islam serait incompatible avec la République.
Les musulmans peuvent, comme les autres, être sécularisés dans leur comportement personnel et adhérer à la laïcité sur le plan politique. Il n’est qu’à les écouter pour comprendre qu’ils sont très attachés au principe de laïcité. Ils ont bien saisi que ce principe leur permettait de pratiquer leur foi dans la sérénité.
Aussi, certains seraient bien inspirés de ne pas engager de débats inutiles et dangereux sur un principe d’une profonde modernité, des débats qui ne portaient pas sur la laïcité, mais qui étaient en fait dirigés contre la laïcité, des débats qui ne portaient pas sur l’islam, mais qui étaient dirigés contre l’islam.
Dépositaires, comme chaque citoyen, des valeurs laïques, les Français de confession musulmane ont refusé l’instrumentalisation de la laïcité en rejetant ce débat. Ils ont répondu avec mesure et sens des responsabilités.
La véritable arme de destruction massive restera toujours l’ignorance. Ibn’Arabî, grand maître soufi, disait justement que « les hommes sont les ennemis de ce qu’ils ignorent ».

La laïcité a plus besoin d’être expliquée à tous nos concitoyens que d’être débattue. Nous vivons en effet sous ce principe alors que beaucoup le connaissent mal. Cela vaut notamment pour certains enseignants, pourtant chargés de le faire appliquer au sein de l’école, mais aussi pour les hommes politiques, qui transgressent parfois ce principe sacré.
Au nom d’une vision fausse de la laïcité, d’aucuns assignent des identités particularistes – hier juive, aujourd’hui musulmane – à ceux de leurs concitoyens qu’ils veulent subordonner ou exclure du corps national.
Cette journée de la laïcité permettrait de rappeler qu’il s’agit d’un principe intégrateur, émancipateur et rassembleur. Il faut faire vivre ce principe. Une approche utilitariste, encore trop souvent mise en œuvre, ou incantatoire de la laïcité ne permet pas à la jeunesse de se réapproprier ce beau principe.

La grille de lecture de certains, qui se situent notamment à l’extrême droite, c’est le rejet des évolutions par le métissage des pensées, des modes de vie et des identités. Notre pays ne peut se construire sur ce qu’il n’est plus. Dans une France métissée et plurielle par nature, la laïcité sera de plus en plus nécessaire parce que porteuse d’une vie commune pacifiée et d’une société où ce qui rassemble prime sur ce qui divise.
Notre modèle permet la coexistence de chacun dans la neutralité nécessaire d’un État qui a admis une fois pour toutes que la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi.

Si nous ne voulons pas renforcer la tendance au cloisonnement entre groupes sociaux, religieux ou ethniques par des débats stériles, nous pouvons, en revanche, autour d’une journée de la laïcité, réhabiliter des lieux où les différentes confessions se rencontrent : au premier chef, l’école, où tout se joue.
Comme le disait Raymond Aron, la laïcité a cela de merveilleux qu’elle permet d’être Français, citoyen français et de rester en fidélité avec la tradition qui nous a portés.
Dans un monde troublé où la quête de sens se fait davantage jour, ce ne sont pas les religions qu’il faut combattre, c’est le pacte républicain qu’il faut rétablir, et vite, un pacte au cœur duquel se trouve la laïcité. Alors, monsieur le ministre, fêtons-la !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, près d’un siècle après la Révolution de 1789, la République s’est enrichie d’un principe vertébral : la règle laïque.
En effet, à côté du triptyque « liberté, égalité, fraternité », la laïcité fait, depuis 1905, partie des fondements de la République française. Elle lui est désormais consubstantielle. Ce principe éclaire notre devise nationale, lui donne tout son sens et impose des devoirs à notre communauté ainsi qu’à tous ses représentants.
Pourtant, force est de constater que la laïcité est aujourd’hui trop souvent contournée, voire menacée. Comme l’indiquent les auteurs de la proposition de résolution instituant une « journée nationale de la laïcité », « des tentatives de remise en cause, de plus en plus distinctes, ont été observées ».
Les radicaux, qui ont contribué à forger l’histoire de la République laïque, déplorent également la multiplication des atteintes à la laïcité. Nous avons eu bien souvent, ici même, l’occasion d’exposer la conception que nous avions de cette valeur fondamentale.
En 2004, dans le cadre du débat relatif à la loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics, j’avais rappelé les dangers d’une conception relative et évolutive du principe de laïcité.
Plus récemment, à l’occasion de l’examen du projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, mon collègue Jean-Michel Baylet avait souligné que la laïcité était le rempart de neutralité absolue contre les influences des religions sur les institutions publiques.
Je le répète aujourd’hui, la laïcité est un principe intangible, qui ne saurait souffrir aucun compromis ni aucun accommodement. Peut-on être plus explicite ?
Disons clairement aussi à tous ceux qui en douteraient – ou à tous ceux que cela arrangerait – que la laïcité républicaine n’est pas une idéologie antireligieuse, une sorte de dogme dirigé contre la liberté de conscience. Je dirai qu’elle est, au contraire, la garantie de cette liberté. En protégeant l’exercice libre des cultes et en n’en favorisant aucun, la loi de la République protège non pas les religions, mais le libre choix de chaque individu.
La laïcité n’est pas non plus un dogme. Comme vous le savez, mes chers collègues, elle n’est pas une vérité républicaine révélée.
Née de la philosophie des Lumières, nourrie par différents courants philosophiques tels que le rationalisme, le positivisme ou encore le scientisme, la laïcité est fille de la raison. Et, contrairement à la foi, la raison s’applique à douter. En acceptant le doute, la pensée laïque laisse aux individus la possibilité de choisir.
Pour autant, cette protection du libre choix, qui doit à mon sens être au cœur de toute définition de la laïcité, n’implique pas la renonciation à l’action.
À nos yeux, il est clair que les options confessionnelles ne doivent pas peser sur la délibération publique. Ce fut le combat de nos aînés lorsque les congrégations religieuses prétendaient détourner à leur profit la loi de 1901 sur les associations. Aujourd’hui, ce combat consiste à exercer une vigilance de tous les instants dans l’espace public, pour éviter un affaiblissement de la laïcité lorsque celle-ci fait manifestement l’objet d’entorses. Les radicaux de gauche sont d’ailleurs des membres fondateurs et très actifs de l’Observatoire de la laïcité. Quand cela est nécessaire, cette surveillance doit s’accompagner de l’intervention du législateur pour clarifier des situations et rappeler les principes fondamentaux de la République française.
Les radicaux de gauche, et plus largement les membres du RDSE, sont bien entendu favorables à toutes les démarches allant dans le sens du respect de la laïcité. C’est dans cette optique que nous avons approuvé la loi du 15 mars 2004, qui devait aider à résoudre la question du port du voile à l’école.
Parce qu’elle est le creuset où se forge la liberté de conscience et où se fabrique l’intégration républicaine, l’école publique doit être strictement à l’abri de toute influence confessionnelle. Elle ne doit favoriser aucun culte, quel qu’il soit. Elle doit demeurer le terrain privilégié de l’application des règles de neutralité.
S’agissant du port de la burqa ou du niqab dans l’espace public, dont nous avons discuté en septembre dernier, il est apparu aux membres du RDSE qu’il ne fallait en aucun cas céder devant les pratiques d’une infime minorité qui, sous prétexte d’user de sa liberté religieuse et de son droit à la différence, entendait imposer son sectarisme en foulant aux pieds les principes fondamentaux de notre démocratie.
Ce matin, il est question d’instituer une « journée nationale de la laïcité », ni fériée ni chômée, qui permettrait de réaffirmer, chaque 9 décembre, le caractère fondamental de ce grand principe constitutionnel.
Bien que mon groupe soit quelque peu réservé sur la répétition de journées commémoratives, la grande majorité des membres du RDSE, très attachée au principe de laïcité, approuve la présente proposition de résolution. Ceux qui ont choisi de s’abstenir le feront uniquement en raison de l’institution d’une journée nationale supplémentaire.
J’ajoute que, si cette journée était instaurée, elle ne devrait pas nous dédouaner d’une attention quotidienne et surtout partagée à tous les niveaux et par tous les représentants de l’État.

La laïcité est un principe qui doit être mis en pratique tous les jours !

Il serait vain, en effet, de réaffirmer la laïcité de l’État français si c’était pour voir le premier représentant de celui-ci ne pas faire preuve de la plus grande prudence dans ses propos. Sans vouloir rouvrir une polémique, il me semble utile de rappeler que le chef de l’État, gardien de la Constitution, doit afficher la neutralité la plus absolue. Or, en s’agenouillant devant le pape en sa qualité de chanoine, en faisant approuver par décret le pouvoir du Vatican d’admettre ou de refuser la validation de nos diplômes, en rappelant régulièrement l’identité chrétienne de la nation française, le Président de la République s’écarte de son rôle, de sa mission et de sa fonction.

Si ses convictions personnelles sont respectables – et nous les respectons ! –, elles ne doivent pas, à mon sens, s’immiscer dans le discours public ou la posture publique.
Mes chers collègues, parce que les radicaux ont été à l’avant-poste du combat qui a conduit à la loi de 1905, c’est dans un esprit de responsabilité que nous apporterons notre soutien à la proposition de résolution de nos collègues socialistes. Nous souhaitons être non pas des héritiers passifs, mais des républicains vigilants et protecteurs d’un principe ni négociable ni ajustable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, très chère Marianne, notre assemblée se pose aujourd’hui la question de savoir s’il est opportun d’instaurer en France une « journée nationale de la laïcité ». Mon groupe et moi-même frissonnons devant tant d’audace… Et l’on imagine l’émotion que cela pourrait faire ressurgir sous les linceuls de Jean Jaurès, Léon Gambetta et Victor Hugo !
Une « journée nationale de la laïcité », proposez-vous, quand 365 jours par an ne nous suffisent pas à regagner le terrain perdu depuis la séparation, au demeurant incomplète, des églises et de l’État !
Les livres d’histoire décrivent un Sénat autrement plus combatif sur le sujet ! Sur ces travées, combien d’illustres tribuns se sont fait entendre avec force pour défendre la primauté des pouvoirs civils sur l’ordre du religieux ? Combien se sont battus pour faire reconnaître le droit de croire ou de ne pas croire, pour abolir toute hiérarchie entre les croyances, comme entre croyance et non-croyance, sous la protection vigilante d’un État neutre et désintéressé ?
C’est un contresens de déclarer la laïcité ennemie de la religion. Elle est, au contraire, le fruit d’un combat pour la liberté de conscience ; pour la liberté, tout simplement.
Là, la guerre civile en vue d’instaurer un pouvoir religieux. Ici, la gangrène du communautarisme et, trop souvent, le citoyen français ramené à un statut de franco-musulman ou de franco-juif... Cette pente réactionnaire nous rappelle que, comme pour la démocratie, nos combats pour la laïcité sont universels et permanents. Au moment où la laïcité est menacée, nous ne devons pas faiblir !
Aussi, je critique votre idée de résolution non parce qu’elle est mauvaise, mais parce qu’elle n’est pas à la hauteur du défi et des exigences de notre temps.
« Liberté, égalité, fraternité » et laïcité ne sont pas des croyances ; ce sont les éléments de l’air que nous respirons tous les jours. Que l’un d’eux vienne à manquer et la société tout entière devient irrespirable.
Aurait-on l’idée d’instaurer une journée pour la liberté, une autre pour l’égalité, une autre encore pour la fraternité ? C’est chaque jour que nous devons nous lever pour faire vivre ces valeurs, et chaque jour plus vigoureusement ; au Parlement comme ailleurs, au Parlement plus qu’ailleurs. Chez nous, on ne dénonce pas les privilèges seulement le 4 août !
La laïcité est un état d’esprit qui se vit dans tout l’espace de notre République.
En France, l’Église et l’État sont presque séparés. Ce « presque » signifie que nous n’avons pas fini le travail entrepris par nos prédécesseurs.
Vous le savez, notre groupe et le Parti de gauche sont attachés à l’application pleine et entière de la règle de la séparation des églises et de l’État contenue dans la loi de 1905. Pour nous, les privilèges publics dont bénéficient encore certains cultes en Alsace-Moselle ne se justifient plus. Du temps a passé en Guyane depuis le décret-loi de Charles X ! Les délais nécessaires à une transition culturelle non violente vers un régime authentiquement républicain me paraissent donc avoir été amplement respectés.
Je me permets de pointer que la départementalisation de Mayotte a mis fin aux droits coutumiers : preuve que l’on peut étendre les lois de la République à l’ensemble du territoire.
La règle est simple à énoncer et respectueuse des orientations religieuses et philosophiques de chacun : les cultes sont libres et égaux en droit, mais ils ne constituent pas un service public. Ce sont les fidèles, et non pas l’impôt, qui financent leurs lieux de culte, les salaires du prêtre et de l’évêque ! Notre combat est celui-là.
« En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l’Église chez elle et l’État chez lui. », proclamait Victor Hugo, le catholique, debout au premier rang de notre hémicycle, comme le rappelait M. Domeizel. Quelles raisons impérieuses auraient les Républicains d’aujourd’hui d’y renoncer ?
À la puissance publique de s’occuper de l’intérêt général, aux citoyens de financer ce qu’ils croient juste pour eux et leurs intérêts particuliers, en fonction de leurs convictions spirituelles et religieuses.
Déshabiller Marianne pour habiller Marie, c’est chercher noise à la communauté des citoyens, qui est une et indivisible.
La liberté d’adhérer à une église ne donne aucun droit particulier, ne dispense pas de l’application des lois et relève de la sphère privée.
La France, officiellement laïque, permet pourtant à son président de porter le titre de chanoine d’honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. C’est symbolique, certes, mais la République, surtout lorsqu’elle est menacée dans ses fondements, de l’intérieur comme de l’extérieur, aurait besoin d’exposer d’autres symboles au regard de ses citoyens et à la face du monde.
Est-ce en tant que Président ou en tant que chanoine que Nicolas Sarkozy demande que les étudiants israélites puissent passer leurs examens la nuit, en raison de la Pâque juive ?
Assez de ce mélange des genres !
Nous l’avons dit en débattant des horaires de piscine, des consultations à l’hôpital ou du port du voile intégral : en République, il n’y a pas de place pour des privilèges, des passe-droits attachés à des appartenances ou à des pratiques religieuses.
En France, l’école privée a droit de cité. Elle ne doit plus avoir le droit de détrousser l’école publique. Chaque année, 10 milliards d’euros sont volés à l’école publique, offerts à l’enseignement privé, confessionnel à 90 %. Cela a assez duré ! Les vases communicants ont été organisés et, je le déplore, ils ont été votés dans cette assemblée.
La République ne doit plus céder aux exigences des églises, voilà tout ! Cette soumission a privé cinq cents de nos villages d’une école publique, a fait naître plus encore d’écoles confessionnelles payées par les communes et de nombreuses crèches confessionnelles. En poursuivant dans cette voie, M. Carle doit le savoir, nous irons sans aucun doute au-devant de graves déconvenues.
Pour toutes ces raisons, j’estime que promouvoir la laïcité, c’est faire plus et mieux que de l’honorer une fois l’an. Défendre l’idée de laïcité, c’est l’appliquer et l’appliquer sans trêve !
En conséquence, je pense que, sans rejeter la proposition minimaliste qui nous est soumise pour solde de tout compte, il conviendrait plutôt d’aborder cette question au fond, par exemple en débattant de bonne foi sur la proposition de loi du Parti de gauche, proposition dont M. François Autain et moi-même avons eu l’honneur d’être les premiers signataires.
« Trop souvent les hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise. Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre avec ses différences dans l’horizon de l’universel... ». Je vous invite à vous approprier cette recommandation du philosophe Henri Peña-Ruiz.
Puisque vous semblez tenir à une commémoration, je vous propose de célébrer l’école laïque, chaque 28 avril par exemple, en reprenant l’hymne qui fut chanté dans toutes les écoles lors de son cinquantenaire :
« Honneur et gloire à l’École laïque,
« Où nous avons appris à penser librement,
« À défendre, à chérir la grande République
« Que nos pères jadis ont faite en combattant. »

Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la mesure où la séance doit impérativement être suspendue avant treize heures, je me vois contrainte d’interrompre l’examen de cette proposition de résolution. Croyez bien que j’en suis particulièrement désolée pour vous, monsieur le ministre, ainsi que pour ceux de nos collègues qui étaient inscrits dans la discussion et n’ont pas encore pu s’exprimer.
Il reviendra à la conférence des présidents de trouver, dans le calendrier de nos travaux, un créneau pour terminer la discussion de cette proposition de résolution, qui est donc renvoyée à une séance ultérieure.
Nous reprendrons nos travaux, pour la suite de l’ordre du jour, à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.